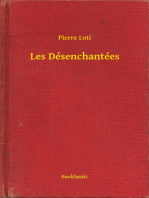Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
L'amour, La Fantasia - Assia Djebar PDF
Încărcat de
zbimboTitlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
L'amour, La Fantasia - Assia Djebar PDF
Încărcat de
zbimboDrepturi de autor:
Formate disponibile
ASSIA DJEBAR
L'Amour, la fantasia
ROMAN
Il y eut un cri dchirant je l'entends encore au moment o je t'cris -, puis des
clameurs, puis un tumulte...
Eugne Fromentin Une anne dans le Sahel
PREMIRE PARTIE
LA PRISE DE LA VILLE
ou
L'amour s'crit
L'exprience tait venue nos sen-tinelles : elles commenaient savoir distinguer du pas
et du cri de l'Arabe, ceux des btes fauves errant autour du camp dans les tnbres.
Barchou de Penhon Expdition d'Afrique, 1835.
FILLETTE ARABE ALLANT POUR LA PREMIRE FOIS L'COLE
Fillette arabe allant pour la premire fois lcole, un matin d'automne, main dans la main du
pre. Celui-ci, un fez sur la tte, la silhouette haute et droite dans son costume europen,
porte un cartable, il est instituteur l'cole franaise. Fillette arabe dans un village du Sahel
algrien.
Villes ou villages aux ruelles blanches, aux mai-sons aveugles. Ds le premier jour o une
fillette sort pour apprendre l'alphabet, les voisins prennent le regard matois de ceux qui
s'apitoient, dix ou quinze ans l'avance : sur le pre auda-cieux, sur le frre inconsquent.
Le malheur fon-dra immanquablement sur eux. Toute vierge savante saura crire, crira
coup sr la lettre. Viendra l'heure pour elle o l'amour qui s'crit est plus dangereux que
l'amour squestr.
Voilez le corps de la fille nubile. Rendez-la invi-sible. Transformez-la en tre plus aveugle
que l'aveugle, tuez en elle tout souvenir du dehors. Si elle sait crire ? Le gelier d'un corps
sans mots et les mots crits sont mobiles peut finir, lui, par dormir tranquille : il lui
suffira de supprimer les fentres, de cadenasser l'unique portail, d'le-ver jusqu'au ciel un
mur orbe.
Si la jouvencelle crit? Sa voix, en dpit du silence, circule. Un papier. Un chiffon froiss.
Une main de servante, dans le noir. Un enfant au secret. Le gardien devra veiller jour et nuit.
L'crit s'envolera par le patio, sera lanc d'une terrasse. Azur soudain trop vaste. Tout est
recommencer.
A dix-sept ans, j'entre dans l'histoire d'amour cause d'une lettre. Un inconnu m'a crit; par
inconscience ou par audace, il l'a fait ouverte-ment. Le pre, secou d'une rage sans clats,
a dchir devant moi la missive. Il ne me la donne pas lire ; il la jette au panier.
L'adolescente, sortie de pension, est clotre l't dans l'appartement qui surplombe la cour
de l'cole, au village; l'heure de la sieste, elle a reconstitu la lettre qui a suscit la colre
pater-nelle. Le correspondant mystrieux rappelle la crmonie des prix qui s'est droule
deux ou trois jours auparavant, dans la ville proche ; il m'a vue monter sur l'estrade. Je me
souviens de l'avoir dfi du regard la sortie, dans les couloirs du lyce de garons. Il
propose crmonieusement un change de lettres amicales . Indcence de la demande
aux yeux du pre, comme si les pr-paratifs d'un rapt invitable s'amoraient dans cette
invite.
Les mots conventionnels et en langue franaise de l'tudiant en vacances se sont gonfls
d'un dsir imprvu, hyperbolique, simplement parce que le pre a voulu les dtruire.
Les mois, les annes suivantes, je me suis engloutie dans l'histoire d'amour, ou plutt dans
l'interdiction d'amour; l'intrigue s'est panouie du fait mme de la censure paternelle. Dans
cette amorce d'ducation sentimentale, la correspon-dance secrte se fait en franais : ainsi,
cette langue que m'a donne le pre me devient entre-metteuse et mon initiation, ds lors,
se place sous un signe double, contradictoire...
A l'instar d'une hrone de roman occidental, le dfi juvnile m'a libre du cercle que des
chu-chotements d'aeules invisibles ont trac autour de moi et en moi... Puis l'amour s'est
transmu dans le tunnel du plaisir, argile conjugale.
Lustration des sons d'enfance dans le souvenir; elle nous enveloppe jusqu' la dcouverte
de la sensualit dont la submersion peu peu nous blouit... Silencieuse, coupe des mots
de ma mre par une mutilation de la mmoire, j'ai par-couru les eaux sombres du corridor en
miracule, sans en deviner les murailles. Choc des premiers mots rvls : la vrit a surgi
d'une fracture de ma parole balbutiante. De quelle roche nocturne du plaisir suis-je parvenue
l'arracher?
J'ai fait clater l'espace en moi, un espace perdu de cris sans voix, figs depuis longtemps
dans une prhistoire de l'amour. Les mots une fois clairs ceux-l mmes que le corps
dvoil dcouvre , j'ai coup les amarres.
Ma fillette me tenant la main, je suis partie l'aube.
I
Aube de ce 13 juin 1830, l'instant prcis et bref o le jour clate au-dessus de la conque
pro-fonde. Il est cinq heures du matin. Devant l'impo-sante flotte qui dchire l'horizon, la Ville
Impre-nable se dvoile, blancheur fantomatique, travers un poudroiement de bleus et de
gris mls. Triangle inclin dans le lointain et qui, aprs le scintillement de la dernire brume
noc-turne, se fixe adouci, tel un corps l'abandon, sur un tapis de verdure assombrie. La
montagne parat barrire esquisse dans un azur d'aquarelle.
Premier face face. La ville, paysage tout en dentelures et en couleurs dlicates, surgit dans
un rle d'Orientale immobilise en son mystre. L'Armada franaise va lentement glisser
devant elle en un ballet fastueux, de la premire heure de l'aurore aux alentours d'un midi
clabouss. Silence de l'affrontement, instant solennel, sus-pendu en une apne d'attente,
comme avant une ouverture d'opra. Qui ds lors constitue le spec-tacle, de quel ct se
trouve vraiment le public?
Cinq heures du matin. C'est un dimanche ; bien plus, le jour de la Fte-Dieu au calendrier
chr-tien. Un premier guetteur se tient, en uniforme de capitaine de frgate, sur la dunette
d'un vaisseau de la flotte de rserve qui dfilera en avant de l'escadre de bataille, prcdant
une bonne cen-taine de voiliers de guerre. L'homme qui regarde s'appelle Amable Matterer.
Il regarde et il crit, le jour mme : J'ai t le premier voir la ville d'Alger comme un petit
triangle blanc couch sur le penchant d'une montagne.
Cinq heures et demie du matin. Sur trois ran-ges, l'immense cortge de frgates, de bricks
et de golettes pavoiss de pavillons multicolores, peuple sans discontinuer l'entre de la
baie, dga-ge prsent totalement de la nuit et de son risque d'orage. Le branle-bas est
dcid partir du Provence, le btiment amiral.
Par milliers, les corps des matelots et des sol-dats se relvent sur les ponts, remontent des
soutes par grappes cliquetantes, s'agglutinent sur les gaillards. Silence tal d'un coup en un
drap immense rverbr : comme si la soie de lumire dj intense, prodigue en flaques
tincelantes, allait crisser.
La ville barbaresque ne bouge pas. Rien n'y fr-mit, ni ne vient altrer l'clat laiteux de ses
mai-sons tages que l'on distingue peu peu : pan oblique de la montagne dont la masse
se dtache nettement, en une suite de croupes molles, d'un vert clairci.
A peine si officiers et simples soldats, dresss cte cte aux rambardes, se heurtent des
pes au flanc, peine si l'on peroit une interjection ici, un juron l, un toussotement ou le
bruit d'un crachat plus loin. Dans le dsordre des hamacs suspendus en vrac, entre les
pices d'artillerie et les batteries sur le qui-vive, telles des btes de cirque prtes la
crmonie derrire un halo de projecteurs, la foule des futurs envahisseurs regarde. La ville
se prsente dans une lumire immuable qui absorbe les sons.
Amable Matterer, capitaine en second du Ville de Marseille, et ses compagnons demeurent
immobiles. La Ville Imprenable leur fait front de ses multiples yeux invisibles. D'o cet excs
mme dans la blancheur de la cit, comme si le panorama aux formes pourtant attendues
ici une coupole de mosque reflte dans l'eau, l- haut quelque ciselure de donjon ou une
pointe de minaret se figeait dans une proximit troublante.
Des milliers de spectateurs, l-bas, dnombrent sans doute les vaisseaux. Qui le dira, qui
l'crira? Quel rescap, et seulement aprs la conclusion de cette rencontre? Parmi la
premire escadre qui glisse insensiblement vers l'ouest, Amable Matte-rer regarde la ville qui
regarde. Le jour mme, il dcrit cette confrontation, dans la plate sobrit du compte rendu.
A mon tour, j'cris dans sa langue, mais plus de cent cinquante ans aprs. Je me demande,
comme se le demande l'tat-major de la flotte, si le dey Hussein est mont sur la terrasse de
sa Cas-bah, la lunette la main. Contemple-t-il en per-sonne l'armada trangre? Juge-t-il
cette menace drisoire? Depuis l'empereur Charles V, roi d'Espagne, tant et tant
d'assaillants s'en sont retourns aprs des bombardements symbo-liques!... Le dey se sent-il
l'me perplexe, peut- tre mme sereine, ou se convulse-t-il nouveau d'une colre
thtrale? Sa dernire rplique, l'envoy du Roi de France qui rclamait des excuses
extravagantes, combien de tmoins l'ont rpte depuis :
Le Roi de France n'a plus qu' me demander ma femme !
Je m'imagine, moi, que la femme de Hussein a nglig sa prire de l'aube et est monte sur
la ter-rasse. Que les autres femmes, pour lesquelles les terrasses demeuraient royaume des
fins de jour-ne, se sont retrouves l, elles aussi, pour saisir d'un mme regard l'imposante,
l'blouissante flotte franaise.
Au dpart de Toulon, l'escadre fut complte par l'embarquement de quatre peintres, cinq
des-sinateurs et une dizaine de graveurs... Le conflit n'est pas encore engag, la proie n'est
mme pas approche, que dj le souci d'illustrer cette cam-pagne importe davantage.
Comme si la guerre qui s'annonce aspirait la fte.
En cette aurore de la double dcouverte, que se disent les femmes de la ville, quels rves
d'amour s'allument en elles, ou s'teignent jamais, tandis qu'elles contemplent la flotte
royale qui dessine les figures d'une chorgraphie mystrieuse?... Je rve cette brve trve
de tous les commence-ments ; je m'insinue, visiteuse importune, dans le vestibule de ce
proche pass, enlevant mes san-dales selon le rite habituel, suspendant mon souffle pour
tenter de tout rentendre...
Ce 13 juin 1830, le face face dure deux, trois heures et davantage, jusqu'aux clats de
l'avant- midi. Comme si les envahisseurs allaient tre les amants! La marche des vaisseaux
qui suit la direction du soleil se fait si lente, si douce que les yeux de la Ville Imprenable
paraissent les avoir fichs l, au-dessus du miroir d'eau verte, dans l'aveuglement d'un coup
de foudre mutuel.
Et le silence de cette matine souveraine pr-cde le cortge de cris et de meurtres, qui vont
emplir les dcennies suivantes.
TROIS JEUNES FILLES CLOTRES..
Trois jeunes filles sont clotres dans une mai-son claire, au milieu d'un hameau du Sahel
que cernent d'immenses vignobles. Je viens l durant les vacances scolaires de printemps et
d't. Me retrouver dans ces lieux, enferme avec ces trois surs j'appelle cela aller la
campagne . Je dois avoir dix, puis onze, puis douze ans...
Jeux d't avec la benjamine des filles, mon ane d'une ou deux annes. Ensemble, nous
pas-sons des heures sur la balanoire, au fond du ver-ger, prs de la basse-cour. Nous
interrompons par instants nos jeux pour pier, travers la haie, les villageoises criardes des
fermettes voisines. Au crpuscule, le portail s'ouvre devant le troupeau compos de
quelques chvres ; j'apprends traire les plus dociles. Je bois, pour finir, dans l'outre dont
l'odeur de goudron me donne la nause. A peine si je languis de ne pouvoir errer dans les
ruelles poussireuses du village.
La demeure est spacieuse. Multiples chambres fraches, ombreuses, encombres de
matelas empils mme le sol, de tentures sahariennes, de tapis tisss autrefois par la
matresse de mai-son parente par alliance de ma mre, elle est originaire de la cit
voisine.
Je n'entre jamais dans la pice du fond : une aeule, brise de snilit, y croupit dans une
pnombre constante. La benjamine et moi, nous nous figeons parfois sur le seuil : une voix
aride tantt gmit, tantt se rpand en accusations obs-cures, en dnonciation de complots
imaginaires. De quel drame enfoui et qui renat, rinvent par le dlire de l'aeule retombe
en enfance, frlons- nous la frontire ? La violence de sa voix de pers-cute nous paralyse.
Nous ne savons pas, comme les adultes, nous en prmunir par des formules conjuratoires,
par des bribes de Coran rcites bien haut.
Cette prsence, dj d'outre-tombe, pousse les femmes ne manquer aucune des prires
quoti-diennes. Dans la plus vaste des salles, proche de l'office, l'une coud ou brode tandis
qu'une autre, courbe au-dessus du sol, trie vivement lentilles ou pois chiches, rpandus sur
des linges blancs tals. Soudain cinq, six femmes se dressent, ttes et paules entirement
enveloppes de voile, amincies, silencieuses, paupires baisses, la fois raidies et
affaiblies par la liturgie propitiatoire. Frles fantmes, elles s'inclinent plusieurs reprises, de
haut en bas, en cadence... Ma mre fait quelquefois partie du groupe des dvotes qui se
prosternent, effleurent de leurs lvres le carrelage froid.
Nous, les fillettes, nous fuyons sous les nfliers. Oublier le soliloque de l'aeule, les
chuchotements de ferveur des autres. Nous allons compter les pigeons du grenier, humer
dans le hangar l'odeur des caroubes et le foin cras par la jument partie aux champs. Nous
faisons des concours d'envol sur la balanoire. Ivresse de se sentir, par clairs et sur un
rythme altern, suspendues au-dessus de la maison, du village. Planer, jambes dresses
plus haut que la tte, le bruit des btes et des femmes s'engloutissant derrire nous.
Dans un blanc de ma mmoire tale, surgit le souvenir d'un t torride, interminable. L'aeule
dlirante a d mourir l'hiver prcdent. Les femmes de la parentle sont l en moins grand
nombre : la cit voisine a, cette mme saison, multipli circoncisions et mariages tant de
maries ds lors rconforter, fliciter, conso-ler pour le groupe d'accompagnatrices
frustres... Je retrouve les jeunes filles du hameau presque seules.
Dans la courette, malgr les chvres, les caroubes et les pigeons du grenier, j'ai la nostalgie
du lyce et de l'internat. Je me plais dcrire mes compagnes les heures de basket-ball.
Je dois avoir douze ou treize ans environ. J'en parais davantage; trop longue, trop maigre
probablement. L'ane des surs rappelle tout propos, qu' ma premire sortie dans une
crmonie en ville, alors que je portais le voile, une bourgeoise est venue tourner comme
une abeille autour de moi : '
Son fils a d tomber amoureux de ta sil-houette et de tes yeux! Ta premire demande en
mariage ne va pas tarder !
Je trpigne, je bats du pied, un malaise ambigu exagre ma colre purile. Je boude l'ane,
des jours entiers.
Au cours de ce mme t, la benjamine et moi avons pu ouvrir la bibliothque celle du
frre absent et qui jusque-l avait t ferme clef. Il travaille en qualit d'interprte au
Sahara, qui nous parat aussi loin que les Amriques. En un mois, nous lisons tous les
romans entasss ple- mle : Paul Bourget, Colette et Agatha Christie. Nous dcouvrons un
album de photographies rotiques et, dans une enveloppe, des cartes pos-tales d'Ouled-
Nals alourdies de bijoux, les seins nus. Autrefois la svrit bougonne du frre nous inspirait
une terreur quotidienne; le voici rede-venu trangement prsent, ces heures opaques de la
sieste. Nous refermons discrtement l'armoire, quand les femmes se relvent pour la prire
de l'aprs-midi. Nous nous imaginons sur-gir d'une rgion interdite ; nous nous sentons plus
vieilles.
Cet t, les adolescentes me firent partager leur secret. Lourd, exceptionnel, trange. Je
n'en par-lai nulle autre femme de la tribu, jeune ou vieille. J'en fis le serment ; je le
respectai scrupu-leusement. Les jeunes filles clotres crivaient; crivaient des lettres ; des
lettres des hommes ; des hommes aux quatre coins du monde; du monde arabe
naturellement.
Lettres d'Irak, de Syrie, du Liban, de Libye, de Tunisie, d'tudiants arabes Paris ou
Londres. Ces missives parvenaient de partout! Envoyes par des correspondants choisis
dans les annonces d'un magazine fminin largement rpandu, l'poque, dans les harems ;
l'abonnement permet-tait de recevoir, avec chaque numro, un patron de robe ou de peignoir
dont se servaient mme les analphabtes.
Ces surs qui habitaient le hameau avaient t les seules musulmanes frquenter l'cole
pri-maire. Or leur pre un campagnard robuste et pieux, le meilleur connaisseur de la
rgion en cultures marachres ne savait ni lire, ni crire le franais. Chaque anne, il
consultait l'une ou l'autre de ses filles, qui vrifiait les factures envoyer au comptable.
Seul, le facteur, un fils d'artisan du village, avait d s'tonner de ces lettres qui dferlaient de
si loin sur son bureau de poste, jusque-l ignor. Il avait pourtant gard le secret : les trois
filles du cheikh ! Elles qu'il n'avait jamais aperues et qui devaient lui paratre des
princesses!... Ces enveloppes portaient au verso des noms de pseudo-expditrices,
prnoms sophistiqus de vedettes de cinma oriental. Il n'avait pas t dupe. Il devait rver
aux amis des jeunes filles, aux amoureux pensait-il. Il savait que les filles ne sortaient
jamais, sinon pour aller au bain maure le plus chic de la ville voisine, dans une calche que
le pre conduisait lui-mme... Cette correspondance tout vent devait le hanter; elle
entretenait en lui quelque secrte frustration !
Je ne me souviens que de l'origine gogra-phique de ces lettres et de leur prolifration. Lors
des veilles, la benjamine et moi, nous ne parlions plus des romans lus durant les longs
aprs-midi, mais de l'audace que cette correspondance clan-destine ncessitait. Nous en
voquions les ter-ribles dangers. Il y avait eu dans nos villes, pour moins que cela, de
nombreux pres ou frres devenus justiciers ; le sang d'une vierge, fille ou sur, avait
t vers pour un billet gliss, pour un mot soupir derrire les persiennes, pour une
mdisance... Dans cette maison, dsormais une rvolte sourde s'tait infiltre. Nous la
vivions avec une insolence de gamines.
L'ane des filles, connue pour sa morgue qui la poussait refuser tous les prtendants,
avait amorc cette exprience comme un jeu ; un jour, elle avait lu tout haut l'annonce du
journal ses surs, pendant que, dans la pice ct, les autres femmes se remettaient
prier :
Tunisien, 22 ans, yeux bleus, aimant Farid el Attrache, cherche correspondante dans
pays arabe, romantique ... Si je lui rpondais?
Au premier, au second, au troisime correspon-dant, je ne sus jamais ce qu'elle crivait : sa
vie de tous les jours, l'exigut de son espace ou ses rves, des aventures peut-tre qu'elle
inventait, les lectures qu'elle faisait. Je ne le demandai pas. Je m'effarais seulement de la
rapidit avec laquelle elle s'tait trouve encombre d'une dizaine d'amis lointains. La plus
jeune des surs en avait presque autant. Mais la seconde qui, silen-cieusement,
prparait avec minutie depuis des annes son trousseau de noces , la seconde, la plus
belle, la plus douce, la plus sage, persistait dire qu'elle n'crirait, elle, jamais un inconnu.
Si cela arrivait, cela voudrait dire qu'elle allait aimer. Or elle prfrait attendre, coudre et
bro-der, pour aimer ensuite le fianc attendu.
Et moi, treize ans peut-tre, cette fois, tait-ce alors des vacances d'hiver , j'coutais,
au cours de la veille, la dernire des filles marier me raconter leurs dbats, leurs
concep-tions diffrentes de l'crit. L'ane changeait avec ses multiples amis des paroles
de chansons gyptiennes ou libanaises, les photographies des vedettes du cinma et du
thtre arabes. Mon amie, elle, gardait une rserve sibylline sur le contenu de ses propres
lettres...
Tout, durant ce dernier sjour, se mle dans mes souvenirs : les romans en vrac dans la
biblio-thque interdite du frre et les lettres myst-rieuses qui arrivaient par poignes. Nous
nous amusions imaginer la curiosit effare du fac-teur. Il devait s'offenser en outre de ne
pouvoir prtendre la main de ces reines de village !
Nous continuions de chuchoter, la benjamine et moi. Dans les interstices du sommeil qui
s'approchait, j'imaginais un tournoiement de mots crits en secret, sur le point d'enserrer de
rets invisibles nos corps d'adolescentes couches l'une ct de l'autre, en travers de
l'antique lit familial. Le mme lit au creux duquel l'aeule en dlire dbitait autrefois ses
plaintes en blessures corrosives, antiennes d'un oubli blasphmatoire.
J'avais peur et je l'avouais. Certainement une lumire allait gicler du plafond et dvoiler notre
pch, car je m'incluais dans ce terrible secret !
La benjamine poursuivait tout bas son discours heurt. Une volont convulsive la secouait,
tandis que la nuit s'paississait autour de nous et que btes et gens s'taient depuis
longtemps endormis.
Jamais, jamais, je ne me laisserai marier un jour un inconnu qui, en une nuit, aurait le
droit de me toucher! C'est pour cela que j'cris! Quelqu'un viendra dans ce trou perdu pour
me prendre : il sera un inconnu pour mon pre ou mon frre, certainement pas pour moi !
Chaque nuit, la voix vhmente droulait la mme promesse purile. Je pressentais que,
der-rire la torpeur du hameau, se prparait, insouponn, un trange combat de femmes.
II
Le combat de Staouli se droule le samedi 19 juin. Auparavant, cinq jours d'escarmouches
avaient succd au dbarquement. Plus que des escarmouches, c'est une vraie guerre de
tirailleurs qui oppose les adversaires. Ils apprennent se mesurer : cavaliers et fantassins
arabes disperss par groupes variables et capricieux, voltigeurs franais ttant le terrain par
colonnes et masses compactes. On compte une moyenne de quatre-vingts morts par jour,
dans le camp des envahisseurs.
La premire victime franaise est tombe la veille du dbarquement, sur le pont du Breslau,
lorsque la flotte, ayant dfil devant la Ville Imprenable et dpass la Pointe-Pescade, est
parvenue au large de Sidi-Ferruch et de sa baie. Une tentative de dbarquer les premires
troupes sur des chalands mis la mer a avort ; des obus sont partis des broussailles de la
rive africaine non encore foule. Elles clatent sur un vaisseau de premire ligne; un gabier,
la cuisse perce d'un clat, meurt sur le coup.
L'ordre vient de reporter le dbarquement au lendemain. La diane rveillera les hommes
trois heures du matin. La nuit s'coule assourdissante de bruits d'armes et de grognements :
quarante mille soldats et trente mille marins emplissent ces vaisseaux devenus des prisons
mobiles surpeu-ples ; une odeur de pestilence les enrobe depuis des jours. Tout autour,
proximit, une nature vierge, silencieuse, mme pas menaante, presque purificatrice,
semble les attendre.
Le lendemain, une heure peine aprs le dbarquement des premiers dix mille hommes,
dans le silence et la solitude apparente des lieux, un cavalier arabe vient proximit des
avant-postes caracoler sur une colline. Les obusiers le visent ; il tente d'viter le feu qui
arrive, mais tou-ch, il tombe la renverse. Homme et bte dispa-raissent derrire un tertre;
cette premire chute arabe dclenche un hourra de rires et de haros.
Les morts se succderont vite. Je relis la rela-tion de ces premiers engagements et je retiens
une opposition de styles. Les Algriens luttent la faon des Numides antiques que les
chroniqueurs romains ont si souvent rapporte : rapidit et courbes fantasques de
l'approche, lenteur ddai-gneuse prcdant l'attaque dans une lance ner-veuse. Tactique
qui tient du vol persifleur de l'insecte dans l'air, autant que de la marche lui-sante du flin
dans le maquis.
Les guerriers s'observent de loin, se servent mutuellement d'appeau, tentent de synchroniser
leur rythme meurtrier. L'instant d'aprs, luttant au corps corps, ils se retrouvent, aprs une
pal-pitation soudaine, cadavres sans tte, quelquefois mutils.
Premier baiser de la mort dans ces camps anta-gonistes : une rupture de tons se manifeste
ds l'ouverture. Chaque victoire de l'envahisseur imprime sur chaque victime atteinte son
style de farce discordante; le clan qui affronte l'invasion prfre, lui, marquer le trpas qu'il
impose du sceau d'un silence dchir. La carabine claque de loin; peu aprs, la lame proche
d'un couteau rapide tranche l'artre jugulaire. Turcs rutilants et Bdouins envelopps de
blanc parent le corps corps de la joute d'une ostentation de frocit; l'allgresse du dfi s'y
mle, puis culmine dans une crte de cris suraigus.
Comme si, en vrit, ds le premier affronte-ment de cette guerre qui va s'tirer, l'Arabe, sur
son cheval court et nerveux, recherchait l'embrassement : la mort, donne ou reue mais
toujours au galop de la course, semble se sublimer en treinte fige.
L'arrivant, lui, propose un masque caricatural de la mort. Or une pugnacit tragique
aiguillonne l'indigne qui, pour l'instant, caracole ou pavoise, s'avance sur le devant de la
scne, tout heureux de tuer, de mourir, dans la lumire tincelante. Et le soleil l'inonde d'un
coup sur le versant de l'ombre ultime.
Ils sont deux maintenant relater le choc et ses prliminaires. Le capitaine de vaisseau en
second, Amable Matterer, verra, depuis le Ville de Mar-seille, les combats s'enfoncer
progressivement dans les terres mme s'il redevient acteur, la veille de la reddition,
lorsque le bombardement de la ville est command partir de la mer, mme s'il rpte
maintes fois j'cris, l'pe au ct ... Un second tmoin va nous plonger au sein mme
des combats : l'aide de camp du gnral Berthe- zne, responsable des premiers rgiments
directe-ment engags. Il s'appelle le baron Barchou de Penhon. Il repartira un mois aprs la
prise de la Ville; au lazaret de Marseille, en aot 1830, il rdigera presque chaud ses
impressions de combattant, d'observateur et mme, par clairs inattendus, d'amoureux d'une
terre qu'il a entre-vue sur ses franges enflammes.
Ds ce heurt entre deux peuples, surgit une sorte d'aporie. Est-ce le viol, est-ce l'amour non
avou, vaguement peru en pulsion coupable, qui laissent errer leurs fantmes dans l'un et
l'autre des camps, par-dessus l'enchevtrement des corps, tout cet t 1830?
La fascination semble vidente de la part de ceux qui crivent et ils crivent pour Paris,
frl, ce mme t, par un autre bouleversement : l'hydre d'une Rvolution qu'il s'agit, tout
prix, de juguler. Mais si cette fascination paralysait galement le camp menac ?
L'agha Ibrahim, le gendre du dey, aurait-il aussi superbement nglig la dfense, justement
pour voir les assaillants s'approcher de plus prs ? Se croyait-il si sr de les craser, comme
cela eut lieu, les sicles prcdents, devant les mmes menaces (il est vrai que la tempte
salvatrice, qui autrefois contribua faire chouer les Espagnols, les Anglais, les Hollandais,
tant d'autres, est sur-venue, cette fois, peine deux jours trop tard)? La motivation d'Ibrahim
n'aurait-elle pas t plu-tt de scruter les adversaires de plus prs, de les toucher, de
combattre contre eux, au corps corps, et de mler ainsi les sangs verss ?
Les tribus bdouines sont venues comme une fantasia de plus o le risque est par
d'insou-ciance. Elles ne croient pas, elles non plus, que la Ville puisse tre prise, mais le
danger les aiguil-lonne : elles esprent que le pouvoir militaire d'Alger subira, dans l'preuve
de force, quelque branlement...
De fait, aprs la dfaite de la Ville, les contin-gents des troupes allies, amens par les beys
en volontaires d'une guerre sainte presque joyeuse, s'en retourneront leurs terres, leur
sen-timent d'autonomie prserv. La dbcle inter-viendra surtout pour les Janissaires qui,
en ce duel, vont se dresser toujours en premire ligne, guerriers splendides, flambant de
couleurs vives se dtachant parmi les burnous blancs des auto-chtones insaisissables.
Le chef de bataillon Langlois, peintre de batailles, au lendemain du choc dcisif de Staouli,
s'arrtera pour dessiner des Turcs morts, la rage de la bravoure imprime encore sur
leur visage. Certains sont trouvs un poignard dans la main droite et enfonc dans la
poitrine. Le dimanche 20 juin, dix heures du matin et par un temps superbe, Langlois
excute plusieurs dessins de ces orgueilleux vaincus puis il esquisse un tableau destin au
Muse. Le public amateur en aura des lithographies , note ce mme jour Matterer.
Barchou dcrit le droulement de la bataille. Ibrahim l'a provoque, il en a choisi la stratgie.
Les premiers jours l'ont prouv : les tireurs alg-riens sont plus prcis et d'une habilet
redou-table. La longueur de leurs arquebuses parat tonnante. Ils ajustent lentement, tirent,
puis dis-paraissent.
Le 18 juin l'agha Ibrahim inspecte le terrain : rochers, barrires de lentisque et de
broussailles, collines pineuses ou sableuses, un dcor o la cavalerie arabe dessinera sans
difficult son ballet habituel et les fantassins sauront se plaquer, rep-tiles au sol, invisibles.
Le nombre semble tre lgrement en faveur du camp indigne. Mais l'agha nglige ce qui
psera finalement sur l'issue : la supriorit de l'artillerie occidentale et surtout, face aux
discordes des chefs indignes, l'unit de commandement et de tactique des Franais.
A onze heures du matin, aprs sept heures inin-terrompues de combats le plus souvent
acharns, les batteries algriennes sont contournes, bous-cules. Et c'est la phase dernire
: les rgiments de Bourmont, jusque-l retranchs, repoussent dfinitivement les assaillants,
puis avancent. La premire dnivellation atteinte et prise, ils dcouvrent le camp de l'agha et
des beys : trois cents tentes somptueuses attendent, intactes, abandonnes.
Sur la route d'Alger, la dfaite se dveloppe. Les beys du Titteri, d'Oran et de Constantine se
replient sur les bords de l'oued El Harrach. Pour les troupes victorieuses, c'est l'tape
dcisive d'une possession vritable. On pourrait s'tendre sur les sofas et se faire servir le
caf.
Des cadavres jonchent le plateau de Staouli. Deux mille prisonniers sont compts. Malgr
l'avis des officiers, sur l'insistance des soldats eux- mmes, ils seront tous fusills. Un feu
de batail-lon a couch par terre cette canaille en sorte qu'on en compte deux mille qui ne
sont plus , crit Matterer rest sur son bateau pendant la bataille.
Le lendemain, il se promne placidement parmi les cadavres et le butin.
Du combat vcu et dcrit par le baron Barchou, je ne retiens qu'une courte scne,
phosphores-cente, dans la nuit de ce souvenir.
Barchou la rapporte d'un ton glac, mais son regard, qui semble se concentrer sur la posie
ter-rible ainsi dvoile, se rvulse d'horreur : deux femmes algriennes sont entrevues au
dtour d'une mle.
Car certaines tribus de l'intrieur sont venues au complet : femmes, enfants, vieillards.
Comme si combattre c'tait, plutt que de monter l'assaut et s'exposer la crte, se
donner d'un bloc, tous ensemble, sexes et richesses confon-dus ! Les Zouaves en
particulier, Kabyles allis au bey du Titteri, forment, dans l'effervescence gn-rale, une
houle bigarre.
Un mois aprs, Barchou se souvient donc et crit : Des femmes, qui se trouvent toujours
en grand nombre la suite des tribus arabes, avaient montr le plus d'ardeur ces
mutilations. L'une d'elles gisait ct d'un cadavre franais dont elle avait arrach le cur!
Une autre s'enfuyait, tenant un enfant dans ses bras : blesse d'un coup de feu, elle crasa
avec une pierre la tte de l'enfant, pour l'empcher de tomber vivant dans nos mains; les
soldats l'achevrent elle-mme coups de baonnette.
Ces deux Algriennes l'une agonisante, moiti raidie, tenant le cur d'un cadavre
fran-ais au creux de sa main ensanglante, la seconde, dans un sursaut de bravoure
dsespre, faisant clater le crne de son enfant comme une grenade printanire, avant de
mourir, allge , ces deux hrones entrent ainsi dans l'histoire nouvelle.
Je recueille scrupuleusement l'image, deux guerrires entrevues de dos ou de biais, en plein
tumulte, par l'aide de camp l'il incisif. Annonce d'une fivre hallucinatoire, lacre de
folie... Image inaugurant les futures mater dolo- rosa musulmanes qui, ncrophores de
harem, vont enfanter, durant la soumission du sicle sui-vant, des gnrations d'orphelins
sans visage.
Ds ce prlude, s'attise comme un soleil noir!...
Mais pourquoi, au-dessus des cadavres qui vont pourrir sur les successifs champs de
bataille, cette premire campagne d'Algrie fait-elle entendre les bruits d'une copulation
obscne ?
LA FILLE DU GENDARME FRANAIS..
Au hameau de mes vacances enfantines, la famille du gendarme franais une
Bourgui-gnonne et ses deux filles Janine et Marie-Louise frquentait la demeure des trois
surs. La Franaise, grosse, blanche et la voix gouailleuse, s'accroupissait sans faon au
milieu des femmes arabes, les parentes venues de la ville, les veuves ou divorces qu'on
abritait occasionnellement. La matresse de maison, menue, infatigable, donnait des ordres,
allait et venait, de la cuisine la cour, de la cour la basse-cour. Elle ne consentait
s'asseoir, converser un moment, que lors des visites de la Franaise. Celle-ci se mlait aux
conversations : deux ou trois mots de franais, un mot d'arabe, et sa prononciation faisait
pouffer de rire quelque invite, timidement, avec une pointe de malice.
La mre des filles clotres et l'pouse du gen-darme taient amies; chaque rencontre les
ren-dait heureuses l'une et l'autre. Elles manifestaient leur contentement par d'imperceptibles
dtails : leur srieux quand elles se regardaient malgr la curiosit des autres, leur change
de recettes de cuisine, leurs marques d'attention lorsque la Franaise se relevait, rosie et
rajeunie, pour s'apprter partir. Elles s'observaient debout face face, la silhouette large,
volumineuse de la Bourguignonne devant celle menue, sche, presque muscle de l'Arabo-
Berbre... La Fran-aise finissait par tendre gauchement le bras et avancer la main ; l'autre
se haussait en sautillant dans son large saroual, ses draperies de corsage et les franges de
la coiffe secoues, et, malgr le bras tendu, elle plantait deux baisers rapides sur chaque
paule de la Franaise. Celle-ci, chaque fois surprise et le visage empourpr, claironnait la
ronde :
Au revoir, mes surs !
Quand on entendait battre le portail du dehors, immanquablement, le cercle des visiteuses
assises commentait le salut des deux amies : l'une qui tendait l'avant-bras, l'autre qui voulait
embrasser comme deux paysans se donnent l'accolade au march !
Ces propos meublaient des heures de conversa-tion, tandis que l'intresse, mnagre
affaire, retournait sa besogne. A peine si, d'une voix durcie, elle bougonnait :
C'est mon amie! C'est une Franaise, mais c'est mon amie !
Une parente s'esclaffait :
C'est ton amie depuis des annes et tu n'arrives pas tendre la main pour dire comme
eux : Au revoir, Madame ! Moi, si c'tait devant un homme, je ne pourrais pas, mais
devant une femme comme moi! O est le mal? On peut quand mme faire des choses la
franaise ! Naturellement pas, Dieu nous assiste, sortir sans voile, ni porter la jupe courte
et se montrer nue devant tous, mais dire bonjour comme elles, s'asseoir comme elles sur
une chaise, pourquoi pas? Dieu nous a cres aussi, non?...
Nous, les filles, nous esprions, pour l'aprs- midi, la visite de Janine, plus rarement celle de
Marie-Louise. Janine ressemblait physiquement sa mre, mais sans sa vigueur ni sa haute
taille. Elle tait alle en classe avec l'ane des surs. Ds qu'elle arrivait, elles
s'enfermaient toutes deux dans une chambre; on entendait leurs voix mles, puis des fous
rires qui n'en finissaient plus, un silence, de nouveau des conciliabules. Janine parlait l'arabe
sans accent, comme une autochtone. Avant de sortir, elle passait la cui-sine, demandait
la mre ce dont elle avait besoin. Celle-ci la chargeait de multiples courses : achat
d'aiguilles, de fil, d'articles de mercerie que le pre n'aurait pas su rapporter.
Janine allait et venait, toute la semaine, dans la maison arabe; n'tait son prnom, on aurait
pu la prendre pour la quatrime fille de la famille... Mais il y avait ceci d'extraordinaire : elle
entrait et sortait son gr des chambres la cour, de la cour la rue comme un
garon! Quand elle fermait le lourd portail, au son du heurtoir, l'ane des surs, son amie,
suspendait une seconde un geste de la main, un mouvement du corps. Puis les choses
reprenaient leur cours dans ce flux du temps d'une journe immobilise dans des intrieurs
de maison, toujours des intrieurs naturellement.
Celle qui nous fascinait, la benjamine et moi, c'tait Marie-Louise. Nous ne la voyions que de
temps autre ; elle devait travailler la ville voi-sine, ou mme la capitale, sans doute
comme employe des postes ou secrtaire dans un bureau... Quand elle venait le dimanche
au hameau, elle nous rendait visite, en compagnie de Janine.
Elle nous paraissait aussi belle qu'un manne-quin. Brune, les traits fins, la silhouette mince;
elle devait tre petite, car je la revois perche sur de trs hauts talons. Sa coiffure tait
sophisti-que, avec des chignons labors, des peignes de diverses formes, ici ou l bien en
vidence au milieu des crans et des boucles noires. Nous nous merveillions de son fard :
rose aux pommettes et rouge carmin exagrant l'ourlet des lvres.
Nous la recevions comme une touriste, cause de son allure de citadine coquette daignant
suivre sa mre ou sa sur. Elle s'asseyait sur une chaise ; elle croisait une jambe sur l'autre,
malgr sa jupe courte. Le cercle des femmes se mettait consid-rer sans discrtion les
moindres dtails de sa mise, en faisant de lgers commentaires mi-voix.
Marie-Louise se laissait regarder. Consciente de la curiosit qu'elle provoquait, elle attendait,
fei-gnait de ne pas comprendre :
J'ai oubli l'arabe! soupirait-elle noncha-lamment. Et je n'ai pas le don des langues
comme Janine, moi!
Cette dernire phrase tait jete l comme une concession : pour sous-entendre qu'elle ne
mpri-sait pas la langue arabe, certes pas, mais qu'enfin... Et nous ne savions plus trop,
derrire la distance insidieusement cre, laquelle, de Janine ou de Marie-Louise,
reprsentait l'excep-tion. En outre, quand la Bourguignonne les accompagnait, elle
enveloppait Marie-Louise d'un tel regard de vanit blouie que les femmes pr-sentes ne
disaient plus rien... Ainsi, lors de ces visites, Marie-Louise gotait-elle le plaisir de jouer
l'trangre.
tait-ce deux, trois annes auparavant que Marie-Louise eut un fianc, un officier de la
mtropole comme on disait ? Cela est pro-bable; je devais avoir moins de dix ans; la plus
jeune des surs, mon amie, frquentait l'cole primaire. On ne l'avait pas encore clotre;
cet t-l, nous allions par les rues du hameau pour diverses commissions : porter le plateau
de ptis-series cuire au four du boulanger, rendre visite la femme du gendarme pour
quelque message transmettre...
Ces alles et venues, dans les ruelles que bor-daient de trs hauts marronniers, me restent
pr-sentes. Une fort d'eucalyptus longeait le village en le sparant des collines de vignoble
au loin; nous dpassions quelquefois la maison du gen-darme, nous courions jusqu' l'ore
des premiers rsineux, nous nous jetions sur le sol jonch de feuilles pour nous gorger
d'odeurs vivaces. Notre cur battait sous l'effet de l'audace qui nous habitait.
Notre complicit de fugitives avait un got cre; nous revenions ensuite lentement vers la
demeure du gendarme. Nous restions dans la cour du jardin, debout devant la fentre
ouverte de la cuisine.
Ma mre te demande, commenait la benja-mine essouffle, si tu veux qu'elle te rserve
du lait de la chvre, cailler. Je viens prendre le bidon !
J'ai pour Janine un message de ma sur, reprenait-elle peu aprs. Qu'elle lui achte une
paire d'aiguilles tricoter n 1 la mercerie ! Mon pre en a apport, mais elles sont trop
grosses! Nous, les filles, nous ne pouvons aller ce maga-sin, il se trouve juste en face du
caf maure !
Ces hommes, ricanait la Bourguignonne, les bras tremps jusqu'aux coudes dans l'eau
savon-neuse de sa lessive, tous les mmes !... Le mien ne sait pas rapporter une aiguille
la maison !
Mon pre, rtorquait la fillette, fait trs bien le march! Il achte toujours les plus beaux
fruits, la meilleure viande ! Ma mre ne le reconnat pas ouvertement, mais nous, nous le
savons bien !
Que ta sur se rassure, disait la Bourguignonne, je ferai la commission Janine. Et voici
le bidon!...
Durant cette conversation, par l'embrasure de la fentre, je regardais le corridor qui ouvrait
sur d'autres pices. Je devinais le bois luisant des meubles dans la pnombre ; je me
perdais dans la contemplation de la cochonnaille suspendue au fond de la cuisine; des
torchons grands car-reaux rouges semblaient, ainsi accrochs, un pur ornement; je
scrutais l'image de la Vierge au- dessus d'une porte... Le gendarme et sa famille me
paraissaient soudain ombres de passage dans ces lieux, et par contre ces images, ces
objets, cette viande devenaient les vrais occupants ! Car, pour moi, les demeures franaises
exhalaient une odeur diffrente, refltaient une lumire secrte
ainsi mon il reste fascin par le rivage des Autres .
Durant toute mon enfance, peu avant la guerre qui aboutira l'indpendance, je ne franchis
aucun seuil franais, je n'entrai dans aucun int-rieur d'une condisciple franaise...
Soudain l't 62 : d'un coup ces meubles cachs
miroirs rococo, chambres coucher dmo-des, bibelots disparates , tout ce dcor,
autre-fois tapi dans l'ombre de demeures la fois ouvertes et inaccessibles, se trouva
dvers sur les trottoirs... Trophes dpenaills, butin souill que je vis expos l'encan,
aux devantures submer-ges des brocanteurs qui affichaient l'air vaniteux des pirates turcs
d'autrefois... Ce sont, me dis-je, vraies hardes de nomades, entrailles schant au soleil
d'une socit son tour dpossde !
Mais je stationne encore l, fillette accoude la fentre du gendarme. Je ne dus
contempler leur salle manger qu'ainsi, recevant la lumire de la cuisine, au bout du
corridor. Pour moi, comme pour mon amie, il restait vident que la plus belle maison, par la
profusion des tapis, par la soie chatoyante des coussins, tait sans conteste la ntre . Les
femmes, chez nous, issues de la ville voisine clbre pour ses brode-ries, s'initiaient cet art
la mode dj au temps des Turcs. Elles l'apprenaient ds leur plus jeune ge ! Or, de quel
coin recul de la campagne fran-aise la Bourguignonne se trouvait-elle origi-naire? C'tait l
un thme courant des conversa-tions dans la courette, durant ces aprs-midi que la visite de
Janine et de sa mre avait illumins.
Toutes les Franaises ne viennent pas de Paris, affirmaient les commres. La plupart de
celles que notre pays asservi a tentes savent seu-lement traire une vache leur arrive ! Si
ensuite elles se civilisent, c'est parce qu'elles trouvent ici force et richesse. Car les lois sont
pour elles, pour leurs mles, pour leurs fils !
Vous n'avez qu' voir Janine et sa faon de s'habiller, la pauvre ! Comme sa mre : la
bont au cur mais rien dans l'art appris pour la main !
Et Marie-Louise ?
Marie-Louise est l'exception ! Elle possde le got inn des Parisiennes, et la finesse, le
piquant des brunes de chez nous!... Vous avez vu le noir de jais de sa chevelure, l'clat
d'ivoire de son teint! Celle-l, en habit de marie de chez nous, un sultan la dsirerait !
L'une des locutrices de s'esclaffer :
Peut-tre que l'pouse du gendarme l'a eue d'un chef arabe inconnu, un seigneur des
hauts plateaux, quand le gendarme se trouvait en poste dans le sud!... Quel homme bien n
n'aurait pas fait d'avance une Franaise jeune et vigoureuse comme elle devait l'tre ?
Peut-tre qu'aprs tout, chez eux, cela n'est pas pch !
L'ane des surs protestait; elle accusait la parente de mdisance, ou tout au moins
d'igno-rance. Elle, elle aimait Janine et elle assurait que, dans la famille du gendarme, ne
pouvaient exister que des murs la puret arabe .
Les suppositions s'entrecroisaient, tous les mandres de la conversation revenaient au
postu-lat premier : savoir que, malgr les apparences, notre clan, mme provisoirement
dchu, tait suprieur, par son raffinement, l'tranger avec ses femmes libres. Car elles
taient libres, et, si nous ne les enviions pas, au moins en parlions- nous comme de
peuplades tranges, aux murs exotiques et rarement approches jusque-l.
Nous sommes encore accoudes, la benjamine et moi, la mme fentre de cette maison
fran-aise ; c'est un autre jour ensoleill.
Cette fois, c'est vrai, nous nous sentons quasi-ment bouleverses. La mre, devant son
baquet, termine sa lessive; le pre, un homme gros et court dont l'uniforme dehors fait fuir le
moindre campagnard, reste assis l, en bras de chemise et l'air bonhomme, tenant un
journal local ouvert tout en fumant sa pipe lentement. Exactement face nous, dans un
couloir partant de la cuisine ensoleille, un peu en retrait, Marie-Louise se tient debout,
dresse contre un jeune homme au teint rouge et aux moustaches blondes. C'est lui, le
fianc, l'officier dont tout le monde parle !
Le spectacle nous semblait peine croyable. D'abord l'image du couple presque enlac :
sil-houette mince de Marie-Louise, demi incline contre l'homme tout raide... Leurs rires
touffs, le chuchotement de leurs voix confondues taient les signes, pour nous, d'une
intimit inconve-nante. Or la mre poursuivait son dialogue avec nous, l'air tranquille, jetant
de temps autre un regard sur le couple; le pre, par contre, avait plong du nez dans son
journal.
Je me souviens de Marie-Louise provocatrice, ainsi que de deux de ses expressions, tantt
mon lapin , tantt mon chri . J'avais d ouvrir grand la bouche de stupfaction. Puis
elle se mit se balancer rgulirement, en avant, jusqu' frler le jeune homme, se
reculer, reprendre le mange deux, trois fois... Le tout accompagn de criailleries agaces,
de mon chri rpts ! Pour finir, parce qu'elle risquait de tomber, elle enlaa le fianc
engonc dans son uniforme. Celui-ci tait d'un calme apparent; peine si l'on entendait le
murmure de sa voix; il devait lui demander de se montrer moins bruyante devant les tmoins
: le pre qui ne levait pas la tte, ces deux fillettes figes la fentre...
Une heure aprs, nous mimions la scne dans notre courette, devant les femmes qui
dgustaient le caf autour de la table basse.
Et le pre n'a mme pas lev la tte ?
Non! Marie-Louise disait doucement des mots tendres l'officier, elle l'a enlac, ensuite,
elle s'est mme mise sur la pointe des pieds.
Vous les avez vus s'embrasser? demandait, bahie, la deuxime sur qui ne quittait pas
sa machine coudre.
Ma foi oui!... En avanant l'un et l'autre les lvres, ils se sont embrasss comme des
oiseaux !
Nous n'en revenions pas que le gendarme, si terrifiant dans les ruelles du village, n'et
mme pas os lever les yeux! Il devait tre rouge de confusion; nous le supposions, nous le
commen-tions.
Les Franais, tout de mme! soupirait la brodeuse qui terminait la parure de draps de son
trousseau.
Marie-Louise exagre! remarquait l'ane des surs qui se devait de dfendre la sur de
son amie.
Puis Marie-Louise vint nous rendre visite avant de repartir. Elle avait promis d'amener son
fianc. Les jeunes filles s'taient trouves embar-rasses ; elles craignaient la raction du
pre : pour lui, la prsence chez nous d'un homme, mme Franais, mme fianc Marie-
Louise, aurait t tout fait dplace...
Russirent-elles l'expliquer Marie-Louise, ou tout au moins Janine? Je ne me souviens
pas, en effet, de l'intrusion de l'officier, mme pour quelques minutes ; on avait d lui
demander de passer lentement devant le portail, de faon que les amies clotres puissent,
par les interstices des persiennes, l'apercevoir et fliciter Marie- Louise de la prestance de
son promis...
Je me rappelle, plus nettement encore, l'une des dernires visites de la demoiselle. Elle se
tenait prs de la margelle du puits sous le pampre, ses cheveux relevs en cne au-dessus
de son front, une tresse noire s'arrondissant en dme souple en arrire, ses traits fins, ses
yeux et ses pommettes fardes. De cet clat de bonheur, de sa beaut rehausse par sa
vanit de fiance, me reste une image persistante. Elle avait minaud; avec des rires dans la
gorge, elle avait voqu le prten-dant, sa famille en France, leur mariage prvu dans
quelques annes... Chaque fois qu'elle pro-nonait les mots de Pilou chri , l'une ou
l'autre des spectatrices, assises sur la natte, esquissait un sourire d'indulgence. Pilou chri
, rptait Marie-Louise en dsignant ainsi l'officier. Nous, les fillettes, nous courions
jusqu'au verger pour pouvoir clater de rire et nous moquer. Pilou , c'tait Paul et le
chri qu'elle ajoutait devait tre un vocable rserv, pensions-nous, aux alcves et aux
secrets des couples.
Pilou chri , il me suffit d'peler ces mots pour ranimer le tableau : la jeune Europenne
vaniteuse devant le parterre des auditrices accroupies, notre excitation de fillettes dj
puri-taines, nous qui, ds l'anne suivante, allions res-ter notre tour cantonnes dans
l'espace de la maison et de son verger...
Pilou chri , mots suivis de touffes de rires sarcastiques ; que dire de la destruction que
cette appellation opra en moi par la suite ? Je crus res-sentir d'emble, trs tt, trop tt, que
l'amourette, que l'amour ne doivent pas, par des mots de clin-quant, par une tendresse
voyante de ferblanterie, donner prise au spectacle, susciter l'envie de celles qui en seront
frustres... Je dcidai que l'amour rsidait ncessairement ailleurs, au-del des mots et des
gestes publics.
Anodine scne d'enfance : une aridit de l'expression s'installe et la sensibilit dans sa
p-riode romantique se retrouve aphasique. Malgr le bouillonnement de mes rves
d'adolescence plus tard, un nud, cause de ce Pilou chri , rsista : la langue franaise
pouvait tout m'offrir de ses trsors inpuisables, mais pas un, pas le moindre de ses mots
d'amour ne me serait rserv... Un jour ou l'autre, parce que cet tat autistique ferait chape
mes lans de femme, surviendrait rebours quelque soudaine explosion.
III
Explosion du Fort l'Empereur, le 4 juillet 1830, dix heures du matin. La formidable
dtonation remplit de terreur tous les habitants d'Alger, et de joie triomphante l'arme
franaise qui s'che-lonne depuis Sidi-Ferruch jusqu'aux citadelles de la capitale.
Ils sont trois dsormais crire les prlimi-naires de la chute : le troisime n'est ni un marin
en uniforme ni un officier d'ordonnance qui cir-cule en pleine bataille, simplement un homme
de lettres, enrl dans l'expdition en qualit de secrtaire du gnral en chef. Il est venu l
comme au spectacle : il est vrai qu'il dirige, Paris, le Thtre de la Porte-Saint-Martin, dont
la vedette est son pouse, la clbre comdienne Marie Dorval, aime en ce moment mme
par Alfred de Vigny.
J. T. Merle c'est son nom publiera son tour une relation de la prise d'Alger, mais en
tmoin install sur les arrires de l'affrontement. Il ne se masque pas en correspondant de
guerre ; il aime, par habitude, l'atmosphre de coulisses. Chaque jour, il signale o il se
trouve, ce qu'il voit (des blesss l'infirmerie, le premier palmier ou les fleurs d'agave,
observs dfaut d'ennemis rencontrs au combat...). Aucune culpabilit d'embusqu ne le
tourmente. Il regarde, il note, il dcouvre; lorsque son impa-tience se manifeste, ce n'est pas
pour l'actualit guerrire, mais parce qu'il attend une imprimerie, achat qu'il a suscit lui-
mme au dpart de Tou-lon. Quand le matriel sera-t-il dbarqu, quand pourra-t-il rdiger,
publier, distribuer le premier journal franais sur la terre algrienne ?
Explosion donc du Fort Napolon : les sol-dats franais, qui ne connaissent, en fait
d'empe-reur, que le leur, baptisent ainsi le Fort l'Empe-reur, dit Fort Espagnol , ou plus
exactement Bordj Hassan . Il s'agit de la plus importante des fortifications turques datant
du xvf sicle, clef de vote du systme de dfense d'Alger sur ses arrires. A Sidi-Ferruch o
il stationne depuis le dbarquement, J. T. Merle note :
Le 4, dix heures du matin, nous entendmes une pouvantable explosion, la suite d'une
canonnade qui durait depuis le point du jour. Au mme instant, l'horizon fut couvert d'une
fume noire et paisse, qui s'levait une hauteur prodi-gieuse; le vent, qui venait de la
rgion de l'est, nous apporta une odeur de poudre, de poussire et de laine brle, qui ne
nous laissa pas de doute que le fort de l'Empereur n'et saut, soit par l'effet d'une mine, soit
par l'incendie de ses maga-sins poudre.
La joie fut gnrale et, ds ce moment, nous regardmes la campagne comme finie.
Exactement vingt-quatre heures aprs, l'arme franaise entre dans la ville.
L'affrontement de Staouli, le 19 juin, avait marqu la dfaite de l'agha Ibrahim surtout, et
l'chec de sa stratgie. Intervention des modernes fuses de Congrve : les Franais les
avaient fait exploser sans tre vraiment srs de la prci-sion de leur vise ; elles avaient, par
leur bruit et leur tranget, caus une panique dans le camp algrien dj bouscul...
Le lendemain toutefois, de Bourmont n'a pas boug, faute de soutien logistique. L'artillerie
de sige et les chevaux de bt ncessaires manquent ; Duperr, le chef de la flotte, les a fait
transporter dans le dernier train du convoi : or celui-ci mouille Palma. L'arme franaise
n'avance donc pas. Certains piaffent, d'autres accusent l'tat- major, de Bourmont attend
Duperr qui, lui, attend, partir du 22 et 23 juin, un vent favorable.
La soldatesque, dans le camp fortifi largi au plateau de Staouli, s'est livre l'euphorie
des lendemains de victoire et au pillage effrn du butin.
Les troupes algriennes ont recul, certaines jusque sur les bords d'El Harrach. Elles
contestent auprs du dey Hussein la comptence de son gendre gnralissime. Le 24 juin,
quinze mille combattants regroups attaquent un dta-chement franais qui s'est aventur
un peu loin; parmi les blesss graves de cet accrochage se trouve l'un des fils de De
Bourmont, Amde, qui mourra peu aprs.
Le harclement algrien reprend, les jours sui-vants, intensifi.
Les Franais comprennent que leurs ennemis se sont donn un nouveau chef : une
intelligence mthodique gouverne dornavant les attaques des Arabes. Il s'agit de Mustapha
Boumezrag, bey du Titteri; ses comptences lui assurent le soutien unanime tant des
Janissaires que des troupes auxiliaires.
Du 24 juin au 28, le baron Barchou dnombre, chaque jour, deux cent cinquante victimes
fran-aises ou davantage. Quelques-uns se demandent si Staouli n'a pas t une victoire
illusoire. Enfin, aprs ces pripties, de Bourmont dispose de l'imposante artillerie; il donne
l'ordre d'avancer.
Le 28 juin, la mle est presque aussi vive qu' Staouli. L'offensive algrienne se rvle de
plus en plus efficace : un bataillon du 4e lger manque d'tre totalement dtruit dans une
suite de corps corps meurtriers. Le lendemain, nouvelle bataille aussi vigoureuse ; les
Franais russissent percer le barrage. Le 30 juin, malgr une erreur de direction et une
division de ses lieutenants, de Bourmont, aprs une difficile marche, s'installe face au Fort
l'Empereur. Trois jours sont nces-saires pour creuser les tranches et disposer les normes
batteries, en dpit des attaques disper-ses, mais constantes, des Algriens. Duperr par la
mer vient bombarder Alger deux fois ; peu effi-cacement, il est vrai. Changarnier, simple chef
de compagnie alors, consignera pour ses Mmoires futurs :
Bruyante et ridicule canonnade de la flotte qui, hors de porte, consomme des munitions
pour une somme norme et fait six francs de dgts aux fortifications de la ville.
Le 4 juillet, ds trois heures du matin, le dernier acte commence. Au Bordj Hassan une
garni-son d'lite de deux mille hommes huit cents Turcs et mille deux cents Koulouglis
rsiste cinq heures durant au feu des batteries franaises. A la droite des tranches, de
Bourmont et son tat-major surveillent le pilonnage, partir de la terrasse du Consulat
d'Espagne. Le dey Hus-sein et ses dignitaires assistent au duel du haut de la Casbah. La
milice, les Arabes enferms dans la ville, ceux qui se trouvaient dehors deviennent attentifs
au combat , note le baron Barchou qui, lui, s'est port sur les pentes de la Bouzarah.
Devant ce cirque immense, peupl milliers de spectateurs , deux heures s'coulent
pendant lesquelles les pices algriennes sont rduites suc-cessivement au silence. Les
survivants de la milice qui rsistaient font retraite alors vers la ville.
Une explosion terrible branle le Fort l'Empe-reur qui sombre, peu aprs, au milieu d'une
gigantesque ruption de flammes et de fumes. Dans cet amas de pierres, de canons briss
et demi enterrs, de cadavres dchiquets ceux des derniers dfenseurs , l'ultime
espoir de dfense de la cit disparat. Alger, dite la bien garde , connat le dsespoir.
Par trois fois, des dflagrations bruyantes mais inutiles, tel un toussotement d'agonie, ont
ponc-tu le recul algrien. N'ont mme pas englouti la masse d'assaillants escompte. A
Staouli, juste avant l'abandon du camp de l'agha et des beys, un magasin de poudre a
saut. Le 25 juin, Sidi Khalef, devant une brigade qui, au dernier moment, s'est arrte,
une fougasse a explos et la dtonation est parvenue jusqu' la flotte ; elle fait pourtant peu
de victimes. Enfin, le 4 juillet, lorsque le plus imposant des forts s'croule, et bien que le fort
Bab Azoun et le fort des Anglais continuent de rsister, l'apothose de cette impuissance
culmine en convulsions ultimes.
La stratgie turque a-t-elle eu besoin de se confirmer dans son infriorit technique, si
ais-ment dcelable : dcadence de sa marine, vtust de son artillerie? Mais l'imprvisibilit
du pre-mier commandant en chef, l'insouciance ou l'iso-lement nfaste du dey ont parpill
les nergies qui auraient d se dynamiser.
Les chefs bdouins, les beys presque indpen-dants, les troupes auxiliaires turbulentes
sta-tionnent hors de la cit. Vers la fin, ils regardent, dans une expectative de plus en plus
trouble, la Ville ancre jusque-l dans son irrdentisme sculaire en train de flchir
irrmdiablement.
Le verbe qui unirait ces forces parses ne s'lve pas. Il s'lancera deux ans plus tard, plus
l'ouest, au-dessus de la plaine d'Eghris, lanc par un jeune homme de vingt-cinq ans aux
yeux verts et au front mystique, Abdelkader. Pour l'instant, le pouvoir se sentirait doublement
assig : par les envahisseurs qui pitinent les dcombres du Fort l'Empereur, mais aussi
par ces vassaux trop fiers qui regardent le Turc lentement vaciller.
4 juillet, 10 heures du matin. Bordj Hassan explose, se dtruit sans dtruire l'ennemi. Deux
heures aprs, un missaire du dey Hussein se pr-sente furtivement pour esquisser le
premier pas de la reddition.
J. T. Merle, notre directeur de thtre qui ne se trouve jamais sur le thtre des oprations,
nous communique son tonnement, ses motion et compassion depuis le jour du
dbarquement (la seule fois o il est en premire ligne) jusqu' la fin des hostilits, ce 4
juillet.
Compassion devant les blesss qui s'amon-cellent l'infirmerie ; motion la vue d'une
vg-tation varie, tantt tellement trangre, tantt pareille au bocage franais;
l'tonnement de Merle est suscit par l'invisibilit de l'ennemi. Jusqu' la bataille de Staouli,
en effet, alors que les Arabes ont dj tu et mutil tant de soldats imprudents ou
malchanceux, pas un mort, pas un bless de leur camp n'a t pris. Force prcisions,
recouvrant une admiration non feinte, nous sont donnes sur la manire dont chaque
cavalier arabe, par un engin de bois mani habilement, emporte l'ami bless, ou trane,
malgr les buis-sons, le cadavre de chacun des morts. Une secrte supriorit se manifeste
l, chez ces sauvages coupeurs de ttes : mutiler certes le corps ennemi mais ne rien
cder, mort ou vif, de celui des leurs... La terre, que l'arme franaise pour l'instant grignote,
ne leur parat qu'une partie de l'enjeu immdiat.
D'o la faconde de Merle pour nous dcrire, aprs Staouli, trois blesss ramasss sur le
champ de bataille : un Turc, un Maure et un jeune homme probablement kabyle. Merle
s'attarde sur leur visage, leur maintien, leur rsignation ou leur courage. Il les comble
d'attentions, va les voir l'infirmerie, leur offre comme aux animaux blesss d'un zoo
des morceaux de sucre. Puis, nouvelle anecdote, le plus jeune bless reoit la visite d'un
vieillard, son pre. Nous sommes dsormais en plein thtre, celui que Merle a l'habitude de
produire Paris : pre et fils arabes, objet de la sollicitude franaise ; pre troubl par
l'humanit franaise ; pre arabe franchement hostile l'amputation de son fils que
conseille la mdecine franaise ; fanatisme musulman entranant la mort du fils, malgr
la science franaise . Ce dernier tableau conclut la fiction de Merle, ainsi chafaude sous
nos yeux.
Avant cet pisode de l'hpital, J. T. Merle, comme Matterer et le baron Barchou, a voqu la
brusque arrive d'un vieillard indigne. L'homme est venu au camp franais de sa propre
initiative l'en croire : espion probable, supputent certains, parlementaire isol ou curieux,
supposent d'autres.
Merle, en tout cas, nous rapporte l'accs de curiosit que suscite ce premier Arabe vu de
prs. De Bourmont, qui avait install son lit l o se dresse le catafalque du saint Sidi Fredj,
veut rece-voir ce visiteur inattendu, mais pas en ce lieu o la spulture musulmane
semblerait profane. Il prend le caf avec le vieillard un peu plus loin ; il n'en tire d'ailleurs
aucun renseignement utile. Il dcide de lui faire porter des dclarations rdi-ges en arabe et
qui font tat de ses intentions pseudo pacifiques.
Sitt loign du camp franais, le promeneur sera tu par les siens, prcisment cause de
ces feuillets qui l'ont fait prendre pour un espion de l'envahisseur. Ainsi les premiers mots
crits, mme s'ils promettent une fallacieuse paix, font, de leur porteur, un condamn mort.
Toute cri-ture de l'Autre, transporte, devient fatale, puis-que signe de compromission.
Ces proclama-tions ne seront mme pas lues , prcise Merle qui accuse le fanatisme
religieux d'tre cause d'une mort inutile.
Le Franais relate l'autre vnement significa-tif : l'hpital, un bless n'a pu tre amput
d'une jambe cause du refus de son pre venu en visite ! Mais notre auteur n'avoue pas ce
que nous comprenons par ailleurs : la foule d'interprtes militaires moyen-orientaux, que
l'arme franaise a amens, se rvle incapable de traduire les pre-miers dialogues
l'arabe dialectal de ces rgions serait-il hermtique?
Hors combat, toute parole semble gele et un dsert d'ambigut s'installe.
J. T. Merle met en marche l'imprimerie qu'il a fait dbarquer triomphalement le 25 juin et il
crit :
En quelques heures, la machine infernale de Gutenberg, ce formidable levier de la
civilisation, fut tablie sur le sol africain. Des cris universels de "vive la France! vive le Roi"
clatrent quand on distribua tout le monde les premiers exem-plaires d'une relation de
notre dbarquement et de nos premires victoires.
Quels que soient les crivains d'occasion qui suivront, J. T. Merle est le seul faire ainsi
impri-mer ses textes entre deux batailles, dans le choc de ce prologue. Ces crits paraissent
devancer d'un instant la victoire...
Pourtant ce publiciste de nos jours, on le dirait grand reporter ne s'attache qu'
dcrire son rle drisoire. Il est sans cesse la trane du combat dcisif; il n'est jamais
tmoin de l'vnement. Il ressemble ce peintre de marine Gudin qui, au lendemain de
l'engagement de Staouli, parce qu'il s'est travesti, par jeu, d'une des dpouilles tranant
sous une tente arabe, s'est fait arrter par un officier scrupuleux qui l'a pris pour un pillard.
Le scribe professionnel, quand il erre mal propos sur le terrain o la mort s'est dresse, vit
un destin soudainement triqu : ni guerrier lanc dans le chahut du combat, ni charognard
se prcipitant sur les restes du butin... L'crivain ou le peintre des batailles rde en zone
trouble, habit d'un malaise qui l'loign du vif de la souf-france, et qui ne lui vite pas la
peur qui rapetisse...
J. T. Merle tremble, tout au long de la route qu'il suit de Sidi-Ferruch Alger, alors qu'il
che-mine deux jours aprs la reddition de la ville! Pour lui, la mort se tapit dans le moindre
taillis ; elle risque de surgir sans le luxe d'une mise en scne, sans la menace d'un brusque
empalement.
MON PRE CRIT MA MRE
Ma mre, comme toutes les femmes de sa ville, ne dsignait jamais mon pre autrement
que par le pronom personnel arabe correspondant lui . Ainsi, chacune de ses phrases,
o le verbe, conjugu la troisime personne du masculin singulier, ne comportait pas de
sujet nommment dsign, se rapportait-elle naturellement l'poux. Ce discours
caractrisait toute femme marie de quinze soixante ans, encore que sur le tard le mari, s'il
tait all en plerinage La Mecque, pouvait tre voqu par le vocable de Hadj .
Trs tt, petits et grands, et plus particulire-ment fillettes et femmes, puisque les
conversa-tions importantes taient fminines, s'adaptaient cette rgle de la double
omission nominale des conjoints.
Aprs quelques annes de mariage, ma mre apprit progressivement le franais. Propos
hsi-tants avec les pouses des collgues de mon pre ; ces couples pour la plupart taient
venus de France et habitaient, comme nous, le petit immeuble rserv aux enseignants du
village.
Je ne sais exactement quand ma mre se mit dire : mon mari est venu, est parti... Je
deman-derai mon mari , etc. Je retrouve aisment le ton, la contrainte de la voix
maternelle; le tour scolaire des propositions, la lenteur applique de Lnonciation sont
vidents, bien qu'en apprenant ainsi sur le tard le franais, ma mre ft des pro-grs rapides.
Je sens, pourtant, combien il a d coter sa pudeur de dsigner, ainsi directement, mon
pre.
Une cluse s'ouvrit en elle, peut-tre dans ses relations conjugales. Des annes plus tard,
lorsque nous revenions, chaque t, dans la cit natale, ma mre, bavardant en arabe avec
ses surs ou ses cousines, voquait presque naturellement, et mme avec une pointe de
supriorit, son mari : elle l'appelait, audacieuse nouveaut, par son prnom! Oui, tout de go,
abruptement allais-je dire, en tout cas ayant abandonn tout euphmisme et dtour verbal.
Avec ses tantes ou ses parentes plus ges, elle revenait au purisme traditionnel, par pure
concession cette fois : une telle libration du langage aurait paru, l'oue des vieilles
dvotes, de l'insolence ou de l'incongruit...
Des annes passrent. Au fur et mesure que le discours maternel voluait, l'vidence
m'apparais- sait moi, fillette de dix ou douze ans dj : mes parents, devant le peuple des
femmes, formaient un couple, ralit extraordinaire ! Un fait me pro-curait vanit plus vive
encore : quand ma mre voquait les menus incidents de notre vie villa-geoise qui, aux
yeux de notre parentle cita-dine, tait une rgression , mon pre, mon hros d'alors,
semblait dresser sa haute silhouette au sein mme de ces conciliabules de femmes clotres
dans les patios vieillis.
Mon pre, et seulement mon pre; les autres femmes ne daignaient jamais les nommer, eux,
les mles, les matres qui passaient toute leur journe dehors et qui rentraient le soir,
taci-turnes, la tte baisse. Ces oncles, cousins, parents par alliance se retrouvaient
confondus dans l'anonymat du genre masculin, neutralit rductrice que leur rservait le
parler allusif des pouses.
Mon pre seul... Ma mre, la voix pose, le col inclin, prononait Tahar ce qui, je le
sus trs tt, signifiait le pur , et mme quand ses interlocutrices souriaient demi, ou
avaient l'air mi-gnes, mi-indulgentes, je pensais qu'une dis-tinction nouvelle clairait le
visage maternel.
Imperceptibles rvolutions de ces conversa-tions de harem : mes oreilles n'en percevaient
que ce qui parait ma mre d'une souveraine origina-lit. Mon pre, grce elle qui en
assurait la pr-sence dans le cours de ces murmures, mon pre devenait plus pur encore
que ne le prsageait son prnom.
Un jour, survint un prodrome de crise. Le fait, banal dans un autre monde, devenait chez
nous pour le moins trange : mon pre, au cours d'un voyage exceptionnellement lointain
(d'un dpar-tement l'autre, je crois), mon pre donc crivit ma mre oui, ma mre!
Il envoya une carte postale avec, en diagonale, de sa longue criture applique, une formule
brve, du genre meilleur souvenir de cette rgion lointaine , ou bien je fais un beau
voyage et je dcouvre une rgion pour moi inconnue , etc., et il ajouta, en signature,
simple-ment son prnom. Je suis sre qu' l'poque, lui- mme n'aurait pas os terminer,
avant de signer, par une formule un peu plus intime comme je pense vous , ou, plus
forte raison, baisers . Mais, sur la moiti de la carte rserve l'adresse du destinataire, il
avait crit Madame , suivi du nom d'tat civil, avec en ajout mais je n'en suis pas sre
et ses enfants , c'est--dire nous trois, dont moi l'ane, ge de dix ans environ...
La rvolution tait manifeste : mon pre, de sa propre criture, et sur une carte qui allait
voyager de ville en ville, qui allait passer sous tant et tant de regards masculins, y compris
pour finir celui du facteur de notre village, un facteur musulman de surcrot, mon pre donc
avait os crire le nom de sa femme qu'il avait dsigne la manire occidentale: Madame
untel... ; or, tout autochtone, pauvre ou riche, n'voquait femme et enfants que par le biais
de cette vague priphase : la maison .
Ainsi mon pre avait crit ma mre. Celle-ci, revenue dans la tribu, parla de cette carte
postale avec un ton et des mots trs simples certes. Elle voulait continuer, dcrire l'absence
du mari dans ce village, pendant quatre ou cinq longues journes, expliquer les problmes
pra-tiques poss (les commerants nous envoyaient chaque matin les provisions
pralablement commandes par mon pre, la veille de son dpart). Elle allait poursuivre,
regretter qu'une citadine, isole dans un village avec de trop jeunes enfants, puisse se
trouver bloque... Mais les femmes s'taient cries devant la ralit nou-velle, le dtail
presque incroyable :
Il t'a crit toi ?
Il a mis le nom de sa femme et le facteur a d ainsi le lire? Honte!...
Il aurait pu adresser tout de mme la carte ton fils, pour le principe, mme si ton fils n'a
que sept ou huit ans !
Ma mre se tut. Sans doute satisfaite, flatte, mais ne disant rien. Peut-tre soudain gne,
ou rosie de confusion ; oui, son mari lui avait crit elle en personne!... L'ane des enfants,
la seule qui aurait pu lire la carte, c'tait sa fille : alors fille ou pouse, quant au nom du
destinataire, o se trouve la diffrence ?
Je vous rappelle que j'ai appris lire le fran-ais maintenant !
C'tait, de fait, la plus audacieuse des manifes-tations d'amour. Sa pudeur en souffrit cet
ins-tant mme. A peine si elle le disputait, toutefois, sa vanit d'pouse, secrtement
flatte.
J'ai t effleure, fillette aux yeux attentifs, par ces bruissements de femmes relgues.
Alors s'baucha, me semble-t-il, ma premire intuition du bonheur possible, du mystre, qui
lie un homme et une femme.
Mon pre avait os crire ma mre. L'un et l'autre, mon pre par l'crit, ma mre dans
ses nouvelles conversations o elle citait dsormais sans fausse honte son poux, se
nommaient rci-proquement, autant dire s'aimaient ouvertement.
IV
Ouverte la Ville plutt que prise. Vendue la capitale, au prix de son trsor de lgende. Or
d'Alger embarqu par caissons pour la France o un nouveau roi inaugure son rgne en se
rsi-gnant au drapeau rpublicain et en acceptant les lingots barbaresques.
Dessaisie de son pass et de sa morgue, Alger du nom premier de ses deux les el
Djezar . Ces les avaient t libres des serres espagnoles par Barberousse qui en fit un
nid de corsaires cumant la Mditerrane pendant plus de trois sicles...
Ville ouverte, remparts abattus, crneaux et merlons renverss; son avilissement fait ombre
sur le proche avenir.
Un quatrime greffier de la dfaite comble, de sa pellete de mots, la fosse commune de
l'oubli ; je le choisis parmi les natifs de la ville. Hadj Ahmed Effendi, mufti hanfite d'Alger, est
la plus haute personnalit morale en dehors du dey. En cette imminence de la chute, de
nombreux Alg-rois se tournent vers lui. Il nous rapporte le sige en langue turque, plus de
vingt annes aprs et en crivant de l'tranger, car il s'expatriera. Le sultan ottoman le
nommera gouverneur d'une ville d'Anatolie. Dans son exil, il se rappelle ce 4 juillet et publie
sa relation :
L'explosion fit trembler la ville et frappa de stupeur tout le monde. Alors Hussein Pacha
convoqua les notables de la ville pour tenir conseil. La population tout entire vocifrait
contre lui...
Puis il voque succinctement les premiers ngociateurs des pourparlers, que les
chroni-queurs franais dcrivent, eux, avec force dtails.
La discussion s'ouvre au son de la canonnade entre les reprsentants des deux clans : dans
les dcombres du Fort l'Empereur, les Franais ont install des batteries pour bombarder la
forte-resse de la Casbah, sige du pouvoir. Ce harcle-ment s'arrte lorsqu'un Turc, dont
le costume, la fois lgant et simple, annonait un personnage de distinction , se
prsente par un chemin drob, un drapeau blanc la main. C'est en fait le secrtaire du
dey. Il espre viter une entre des Franais dans la ville; il offre un tribut payer, au nom
de la milice prte probablement renier son Pacha. N'offrant point la soumission, il ne peut
que se retirer.
Le creusement des tranches se poursuit; les batteries franaises et celles, algriennes, du
Fort Bab Azoun continuent rivaliser entre elles avec fracas. Deux Maures, Hamdane et
Bouderba, viennent leur tour, mais toujours sans titre offi-ciel. Aprs le premier pas
d'ouverture, c'est l le dbut d'changes de paroles : Hamdane a voyag en Europe, il parle
couramment le franais. L'artillerie ayant cess son vacarme de part et d'autre, ils repartiront
en sachant que la pntra-tion trangre ne peut plus tre vite, sinon par une rsistance
dsespre.
Or, au Divan de la Casbah, Hussein, plus dcid que les dignitaires de la milice les trois
beys hors de la ville ne sont mme pas consults pour la dcision finale , Hussein semble
rsolu, un moment, rsister jusqu' la mort... Finalement dcision est prise d'envoyer deux
dignitaires offi-ciels, ainsi que le seul diplomate europen rest Alger depuis les
vnements, le consul d'Angle-terre accompagn de son adjoint.
Cette dlgation est reue par l'tat-major fran-ais au complet, dans une petite prairie
l'ombre ; on s'assoit sur les troncs de trois ou quatre arbres frachement coups. L'Anglais,
en qualit d'intermdiaire et ami du dey, parle, nous rapporte Barchou qui assiste la
ngociation, du caractre altier et intrpide de Hussein, pou-vant le porter aux dernires
extrmits .
Ainsi commence la communication : de Bour- mont dicte les termes exacts de la capitulation
exige ville ouverte discrtion aux troupes, avec sa Casbah et ses forts, garantie
des biens personnels du dey et des janissaires qui devront quitter le pays, respect de
l'exercice de la religion des habitants, de leurs biens, de leurs femmes.
Cette convention fut dicte par le gnral en chef, et crite par le gnral Desprez et par
l'intendant en chef Deumier; il fut arrt que le dey y apposerait son cachet en signe
d'adhsion et l'change de la convention devait se faire dans la soire , rapportera, deux
ans aprs, un autre offi-cier d'ordonnance, E. d'Ault-Dumesnil.
Il est environ deux heures de l'aprs-midi, ce dimanche d't. Vers l'ouest, du ct de Bab el
Oued, sortent dj de la ville les premiers groupes de l'migration algroise.
Le dialogue est donc ouvert avec les deux
Maures, Bouderba et Hamdane : changes de paroles, puis tablissement d'un texte crit
durant la confrence pour l'abdication. Mais les mots rsistent; je veux dire, les mots
franais.
Une heure aprs, le dey Hussein renvoie la convention : il ne comprend pas ce que sous-
entend l'expression, employe par l'aristocrate de Bourmont et consigne dans la minute de
son chef d'tat-major, se rendre discrtion .
Il est propos qu'un interprte aille expliquer le texte au dey, et qu'il se porte ainsi garant de
la loyaut franaise. On dsigne un vieil homme, Brasewitz celui-l mme que Bonaparte,
en gypte, avait envoy Murad Bey. Brasewitz entrera donc, le premier, dans la ville.
Nous avons la fois son rcit crit (une lettre au ministre Polignac) et oral (sa relation J.T.
Merle, quelques jours aprs) de ce qu'il vcut comme une expdition hasardeuse. Ce 4 juillet
aprs-midi, il s'avance cheval, derrire le secr-taire turc et il entre par la Porte Neuve : il
est l'objet des menaces que lui lancent, tout au long de son chemin, des Algrois qui
voudraient combattre encore. Or ils voient dfiler, dans la rue, devant eux, l'annonciateur de
leur prochaine servitude.
Le voici enfin face au dey assis sur son divan et entour de dignitaires. Brasewitz tourne le
dos tout un auditoire de janissaires. A chacun des articles qu'il traduit voix haute, la
colre monte derrire lui. Les jeunes officiers prfrent qu'on choisisse la mort. La mort!
rptent-ils... Plus d'une fois, l'interprte se croit en danger. Ayant expos les dtails de la
convention (elle doit tre signe le lendemain, avant dix heures), il boit la citronnade que
gote auparavant le dey, encore soucieux de bonnes manires la veille de son
abaissement. Brasewitz repartira, sain et sauf.
Mais, cause de ces risques affronts et du fait de son grand ge, l'interprte contractera,
ajoute J.T. Merle qui le rencontre le 7 ou le 8 juillet, une maladie nerveuse dont il mourra
quelques jours aprs. Comme si l'claircissement de cette hau-taine expression
discrtion , venue spontan-ment l'esprit du chef franais, devait faire au moins une
victime : le porteur mme de la missive!
En assurant au mot le passage dans la langue adverse (langue turque du pouvoir vacillant
ou langue arabe de la ville maure, je ne sais...), Brasewitz semblait devoir payer cela de sa
vie.
Pour l'instant, le voici revenant, la nuit tom-bante, aux postes franais. Sa mission est
termi-ne. Le dey abdiquera par crit, le lendemain matin.
Alger s'apprte vivre sa dernire nuit de cit libre.
D'autres relateront ces ultimes moments : un secrtaire gnral, bach-kateb , du bey
Ahmed de Constantine (qui regroupera les rsistants de l'est pendant prs de vingt annes
encore) rdi-gera son rcit en arabe. Un captif allemand, qui sera libr le lendemain,
voquera cette mme nuit en sa langue; deux prisonniers, rescaps du naufrage de leurs
bateaux survenu quelques mois auparavant, en feront une description en franais. Ajoutons
le consul d'Angleterre qui note ce tour-nant dans son journal... Je songe, moi, ceux qui
dorment, en ces instants, dans la ville... Qui chan-tera plus tard cette agonie de la libert,
quel pote, anim d'une esprance entte, pourra regarder jusqu'au terme de cette
drive?...
Le mufti Hadi Ahmed Effendi dpeint avec pro-lixit ce sera des dcennies aprs la
rvolte de ses concitoyens :
Quant moi, ne pouvant m'y dcider, j'assem-blai les pieux musulmans... Je les engageai
me suivre contre l'ennemi. Effectivement, ils firent pnitence et, aprs s'tre
rciproquement fait leurs derniers adieux, ils se mirent en marche derrire moi en entonnant
le cri du "tekbir". En ce moment les femmes se prcipitent au-devant de nous, jetant leurs
enfants nos pieds et s'criant : "c'est bien si vous tes vainqueurs, mais si vous ne l'tes
pas, sachez alors que les Infidles viendront nous dshonorer! Partez donc, mais avant de
partir, immolez-nous !"
Si la scne s'alourdit de grandiloquence, elle suggre du moins le tournoiement de cette
transi-tion. Par milliers, la foule de l'exode encombre la route vers Constantine. D'autres, la
lueur du clair de lune d't, se ruent sur la plage, enva-hissent les barques qui les mnent
Cap-Matifou. Familles entires qui s'encombrent de leurs ballu-chons. Le petit peuple, je
suppose, est plus nom-breux partir que les nantis ou les marchands. Quels bourgeois
resteront pour sauver leur for-tune, leurs maisons? Quels citadins prfreront serrer les
derniers effets, les quelques bijoux et enfants et femmes hisss sur des mulets
rejoindre prcipitamment soit l'arme du bey de Constantine, soit celle du bey du Titteri
regagnant la Mitidja?
La ville perd, en une nuit, les deux tiers environ de sa population. Parmi les soldats qui
refusent l'abdication, la considrant comme un dshon-neur, deux mille cinq cents en armes
se regroupent autour du bey Ahmed.
Le mufti Ahmed Effendi, quant lui, reoit du dey l'assurance que les Franais se sont
engags ne pas entrer dans les mosques et respecter la vie des civils. Il calme
l'effervescence.
Toute la population, hommes et femmes, se pressait au seuil de mon logis en criant d'un
ton lamentable : Puisque dj il faut prir, mieux vaut mourir devant la porte d'un alim !
L'arme victorieuse prpare sa mise en scne du lendemain : de Bourmont ordonnance la
marche d'entre du 5 juillet honneur l'artille-rie et aux sapeurs qui ouvriront le dfil. Il
tient pntrer dans la ville prcd du 6e rgiment et de ses tambours.
La prise de possession s'accompagne de nomi-nations qui interviennent aussitt : le chef de
la police, celui de la marine, les responsables aux comptes sont dsigns... Chaque division
des trois lieutenants gnraux occupera quelques places prcises.
Avec deux heures de retard, mais au son des tambours du 6e rgiment comme prvu, les
Fran-ais entrent le matin dans la Ville. A la Casbah, soucieux jusqu'au dernier moment de
sa dignit, Hussein se contente d'accueillir le contingent d'avant-garde, arriv deux heures
auparavant. Le colonel de Bartillat, le responsable, sera gale-ment l'auteur d'une
publication dcrivant cet ins-tant. Par ses yeux, nous dcouvrons la premire cour du palais
et son citronnier, l'offrande de la mme limonade en signe d'hospitalit. Puis le dey et sa
suite disparaissent, tandis qu'un fonction-naire turc attend, stoquement dress dans le hall
du palais, l'arrive du chef franais.
Ce Turc est le khasnadji le ministre des Finances. C'est lui qui, la veille, a dirig la
rsis-tance du Fort l'Empereur. Devant de Bourmont et ses proches, il opre
protocolairement la trans-mission des charges : il accompagne les Franais jusqu'au Trsor
de l'tat algrien. L, se trouve le cur mme de la prise : un amoncellement d'or qui
permettra de rembourser tous les frais de la gigantesque expdition, qui alimentera en sus le
trsor de la France et mme quelques budgets privs.
Trente-sept tmoins, peut-tre davantage, vont relater, soit chaud, soit peu aprs, le
droule-ment de ce mois de juillet 1830. Trente-sept des-criptions seront publies, dont trois
seulement du ct des assigs : celle du mufti, futur gouver-neur en Anatolie; celle du
secrtaire du bey Ahmed qui vivra plus tard la servitude; la troi-sime tant celle du captif
allemand.
Si l'on exclut, de cet amas, le journal du Consul anglais, le seul en position de vritable
neutralit (son statut de diplomate retardera toutefois la publication de son tmoignage), si
l'on met part la relation d'un prince autrichien venu en obser-vateur auprs de De
Bourmont, il reste tout de mme trente-deux crits, en langue franaise, de ce premier acte
de l'occupation.
Une fivre scripturaire a saisi en particulier les officiers suprieurs. Ils publient leurs
souvenirs ds l'anne suivante; le chef d'tat-major est le premier, d'autres peu aprs feront
comme lui. Jusque vers 1835, dix-neuf officiers de l'arme de terre, quatre ou cinq de la
marine, contribueront cette littrature. Cette hte contamine les comparses : un abb
aumnier, trois mdecins dont un chirurgien-chef et un chirurgien aide- major! Jusqu'au
peintre Gudin (qui rdigera ses souvenirs bien plus tard) sans oublier notre publiciste J.T.
Merle, le rival en amour d'Alfred de Vigny.
Une telle dmangeaison de l'criture me rap-pelle la graphorrhe pistolaire des jeunes filles
enfermes de mon enfance : crire vers l'inconnu devenait pour elles une manire de
respirer un nouvel oxygne. Elles trouvaient l une issue provisoire leur claustration...
Mais que signifie l'crit de tant de guerriers, revivant ce mois de juillet 1830? Leur permet-il
de savourer la gloire du sducteur, le vertige du violeur? Ces textes se rpandent dans un
Paris louis-philippard, loin d'une terre algrienne o la reddition a lgitim assez vite toutes
les usurpa-tions, des corps comme des signes. Leurs mots, surgis d'un tel sisme du pass,
me paraissent queue de comte clairant un ciel dfinitivement trou.
Car cette conqute ne se vit plus dcouverte de l'autre, mme pas nouvelle croisade d'un
Occident qui aspirerait revivre son histoire comme un opra. L'invasion est devenue une
entreprise de rapine : l'arme prcdant les mar-chands, suivis de leurs employs en
opration; leurs machines de liquidation et d'excution sont dj mises en place.
Le mot lui-mme, ornement pour les officiers qui le brandissent comme ils porteraient un
illet la boutonnire, le mot deviendra l'arme par excellence. Des cohortes d'interprtes,
go-graphes, ethnographes, linguistes, botanistes, docteurs divers et crivains de profession
s'abat-tront sur la nouvelle proie. Toute une pyramide d'crits amoncels en apophyse
superftatoire occultera la violence initiale.
Mes jeunes amies, mes complices du hameau de vacances, crivaient mme langue inutile
et opaque parce que cernes, parce que prisonnires; elles estampillaient leur marasme,
pour en surmonter plus ou moins le tragique. Les comptes rendus de cette intrusion d'hier
dclent a contrario une nature identique : envahisseurs qui croient prendre la Ville
Imprenable, mais qui tournoient dans le buissonnement de leur mal d'tre.
BIFFURE..
La prise de l'Imprenable... Images rodes, dli-tes de la roche du Temps. Des lettres de
mots fran-ais se profilent, allonges ou largies dans leur tranget, contre les parois des
cavernes, dans l'aura des flammes d'incendies successifs, tatouant les visages disparus de
diaprures rougeoyantes...
Et l'inscription du texte tranger se renverse dans le miroir de la souffrance, me proposant
son double vanescent en lettres arabes, de droite gauche redvides; elles se dlavent
ensuite en dessins d'un Hoggar prhistorique...
Pour lire cet crit, il me faut renverser mon corps, plonger ma face dans l'ombre, scruter la
vote de rocailles ou de craie, laisser les chuchotements immmoriaux remonter, gologie
sanguinolente. Quel magma de sons pourrit l, quelle odeur de putrfaction s'en chappe?
Je ttonne, mon odorat troubl, mes oreilles ouvertes en hutres, dans la crue de la douleur
ancienne. Seule, dpouille, sans voile, je fais face aux images du noir...
Hors du puits des sicles d'hier, comment affron-ter les sons du pass?... Quel amour se
cherche, quel avenir s'esquisse malgr l'appel des morts, et mon corps tintinnabule du long
boulement des gnrations-aeules.
DEUXIME PARTIE
LES CRIS DE LA FANTASIA
Je dus moi-mme diriger une exp-dition chez les tribus berbres des rgions
montagneuses de Bjaia, qui refusaient depuis plusieurs annes de payer l'impt... Aprs
avoir pntr dans leur pays et vaincu leur rsistance, je pris des otages en gage
d'obissance...
Ibn Khaldoun Tarif (Autobiographie).
LA RAZZIA DU CAPITAINE BOSQUET, PARTIR D'ORAN...
Octobre 1840 Oran : depuis que, l'anne pr-cdente, la guerre a repris contre l'mir, la
garni-son franaise vit sur la dfensive.
Un modeste espace de deux ou trois lieues est contrl autour de la place forte, entre les
deux camps de Misserghin et du Figuier : quelques jar-dins pour des cantiniers ici, trois
misrables cabarets l, juste de quoi entretenir et distraire les postes isols, au milieu de la
campagne dserte. A l'est, proximit du rivage, s'tend la ferme de l'unique colon, un
nomm Dandrieu qui s'est ins-tall l pendant la trve de 1837. A l'ouest, commence le
territoire des Douars et des Smlas, tribus allies la France elles l'taient aussi au
prcdent pouvoir turc auquel elles servaient de gendarmes, pour la leve des impts.
Le reste du pays forme une tendue plate, immense, parcourue par les fractions
reconnais-sant l'autorit d'Abdelkader qui vient d'appeler, une nouvelle fois, l'union sacre
contre l'occupant. La phase ultime de la guerre dbute : elle durera huit annes encore.
Sur les routes de Tlemcen, de Mostaganem, d'Arzew, les convois franais bien escorts
passent de temps en temps. Nul Europen ne s'aventurerait sur les sentiers alentour.
Au printemps de la mme anne, les hostilits franco-algriennes se sont avives dans le
centre du pays : le marchal Vale, accompagn des princes royaux, les ducs d'Orlans et
d'Aumale, a tent de contenir, de Cherchell jusqu' Blida et Mda, l'treinte belliqueuse
des tribus de l'Atlas. Elles apportaient aux rguliers d'Abdelkader et de ses lieutenants, des
milliers de suppltifs. Vale a cru organiser une promenade militaire; il a d guerroyer une
nouvelle fois dans les gorges de la Chiffa, puis il est retourn Alger en multipliant les
communiqus et les bilans pompeux. La plaine de la Mitidja a t dgage, mais
l'effervescence persiste.
A l'ouest, un gnral de trente-trois ans, ancien commandant des Zouaves, Lamoricire, est
nomm le 20 aot la tte de la place d'Oran. Il ronge son frein deux mois durant : comment
pas-ser de la dfensive l'offensive, et le plus vite pos-sible? Bou Hamedi, le lieutenant de
l'mir, ne vient-il pas d'attaquer les Douars sur leur terri-toire? N'empche-t-il pas par l
mme le ravi-taillement des Franais ?
Lamoricire, que les Arabes surnomment l'homme la chchia , utilise au maximum le
service de renseignements de Daumas, les cartes et les relevs de lieux de Martimprey ; ce
travail de reprage a t assur pendant des semaines par les espions de Mustapha ben
Ismal, le chef des Douars.
Au-del du Tllat (un oued qui se jette dans l'immense lac sal au sud d'Oran), les
mouve-ments de la tribu des Gharabas et de celle des Beni Ali sont signals. Leurs chefs
sont connus comme des inconditionnels de l'mir. Douze lieues soit une soixantaine de
kilomtres sparent l'emplacement de leurs limites des pre-miers postes franais : l'tape
semble trop longue pour une attaque ventuelle...
Lamoricire est cependant tent : s'il russissait s'emparer des troupeaux et, pourquoi pas,
des silos de ces riches ennemis, cela changerait l'atmosphre de la garnison et le moral des
troupes. Cette victoire assurerait, en outre, un bnfice non ngligeable, l'approvisionnement
de la place pour l'hiver.
Le jeune gnral piaffe d'impatience, mais Oran est truff d'espions. L'opration, la premire
razzia qui partirait d'Oran depuis la reprise du conflit, devrait tre prpare dans le secret ;
or, il parat difficile de tromper les claireurs ennemis. L'attaque est nanmoins fixe au 20
octobre.
Deux hommes criront le rcit de cette expdi-tion : le capitaine Bosquet, que Lamoricire a
fait venir d'Alger pour en faire son aide de camp, et le capitaine Montagnac. Le rgiment de
celui-ci vient d'arriver de Cherchell par mer, le 14 de ce mois.
Les deux officiers, chacun ignorant tout de l'autre, entretiennent une correspondance
fami-liale, grce laquelle nous les suivons en tmoins-acteurs de cette opration. Avec
eux, nous revivons toutes les marches guerrires de cet automne 1840 : lettres que reoit la
mre du futur marchal Bosquet (il sera un hros de la guerre de Crime, vingt ans plus
tard), ptres l'oncle ou la sur de Montagnac (lui que la dfaite de Sidi Brahim
transformera, cinq ans aprs, en martyr). La publication posthume de ces crits entretient le
prestige de ces auteurs, alors qu'ils dcrivent le ballet de la conqute sur notre territoire.
Quel territoire ? Celui de notre mmoire qui fer-mente ? Quels fantmes se lvent derrire
l'paule de ces officiers qui, une fois leurs bottes enleves et jetes dans la chambre,
continuent leur cor-respondance quotidienne ?
Le 21 octobre, midi, l'ordre est transmis l'infanterie, aux spahis de Yusuf et aux cavaliers
allis de Mustapha ben Ismal le Coulougli, de se runir au camp du Figuier, sur la route
sud-est. A six heures du soir, soldats et officiers, tonns, sont passs en revue par le
gnral et son tat- major : deux mille cinq cents fantassins, sept cents cavaliers auxquels
s'ajoutent, en nombre quivalent, les cavaliers indignes (trois cent cin-quante spahis, autant
de Douars), ainsi que deux compagnies de sapeurs et six obusiers.
Lamoricire, malgr le scepticisme de Musta-pha ben Ismal, donne l'ordre de dpart : ces
troupes neuves, peu familiarises avec le terrain, doivent couvrir de nuit au moins cinquante
kilo-mtres pour pouvoir surprendre les ennemis l'aube.
Le convoi de mulets, encombr des bagages et des cacolets prvus pour ramener les
blesss, avance. Il est entour par l'infanterie. Ces der-niers mois, celle-ci a reu un
quipement allg en prvision de la nouvelle tactique fonde, l'instar de celle des
indignes, sur la rapidit offensive.
De l'oued Tllat au point de repre choisi, un ravin prcdant la localit de Makedra, la
troupe va bon train. La cavalerie couvre les hommes sur la gauche, sans dpasser la tte de
la colonne silencieuse. Les claireurs de Mustapha ben Ismal se dtachent rgulirement
en avant, vri-fient que les feux ne s'allument pas sur les collines avoisinantes, pour prvenir
les Gharabas et les Ouled Ali. Ces Sahab ez Zerda ou compa-gnons du butin sont
des bandits-espions et, pour la plupart, des voleurs de chevaux. On a pay leurs
renseignements au poids de l'or. Une part du pillage leur est promise dans de larges
proportions.
A l'arrive au ravin de Makedra, trois compa-gnons du butin se lancent en avant. Une
heure aprs, ils ne sont pas revenus. Bosquet qui va et vient, de la tte l'arrire de la
colonne, pour s'assurer de la bonne marche de l'ensemble, devine l'inquitude de son
gnral. Les espions ont-ils t surpris, puis tus ? Un quatrime clai- reur, l'adjoint de
l'agha Mustapha, disparat dans la nuit.
Ralentissement de la marche ; la cavalerie suit l'arrire. Enfin le Douar revient sur son
cheval fumant, tache blanche dans l'obscurit qui plit :
Les Gharabas sont l. Aucune alerte n'a t donne ! Les tentes sont toujours dresses.
Ils dorment tous !
Murmures prcipits autour de l'agha et du gnral. Celui-ci communique les dernires
direc-tives. A deux heures du but, tandis que l'aube va poindre incessamment, l'effet de
surprise est donc assur. La razzia s'annonce propice : rapt, pillage, peut-tre mme
massacre des ennemis qui, mal rveills, ne pourront pas combattre. La nuit est nous ,
rve l'un ou l'autre de ces capitaines... Bosquet note les couleurs de l'aube qui se lve.
Sur un signe de Lamoricire, la cavalerie s'lance : au milieu, en masse compacte, les
chas-seurs la tunique noire ; leur droite, drapeaux dploys, le goum des Douars avec,
en tte, l'agha Mustapha. Ce vigoureux vieillard, barbe blanche en avant, corps trapu dress
sur ses triers d'or, clate d'allgresse guerrire, malgr ses soixante-dix ans :
Etlag el Goum ! s'exclame-t-il d'un ton presque juvnile.
Rires moqueurs, cris de mort contre les vic-times qu'ils allaient dpouiller , relate Bosquet
qui admire le lanc de ce dpart en fantasia. Sur la gauche, les spahis aux uniformes
carlates, avec le rengat Yusuf leur tte, ont rejoint le sommet d'une crte. Le jour
claire leurs sil-houettes comme une bande infernale et fantastique ...
Trois kilomtres plus loin, c'est l'attaque. Un cercle de multiples tentes apparat; les plus
belles, en laine blanche brode, se trouvent au centre. Le vieux Mustapha, frmissant
d'impa-tience, se prcipite vers elles. Il espre y sur-prendre son ennemi Ben Yacoub, l'agha
des Gha- rabas : mais en vain. Dans l'aurore bouleverse, les assaillants ne dcouvrent que
des femmes; la veille, Ben Yacoub a rejoint l'mir Mascara, avec le gros de son
contingent. Des guerriers moiti nus sautent sur leurs chevaux sans selle; d'autres, des
adolescents, le yatagan la main, se font tuer pour dfendre leurs mres et leurs surs.
Renversement des corps mls. Ils se recroque-villent dans le sang vers; ils glissent dans
le dsordre des tentures macules. Grognements sourds plus prsents que les plaintes, que
les gla-pissements de triomphe ou d'effroi. L'incendie lche, de ses lueurs mobiles, coffres
entrouverts, bijoux et cuivres parpills entre les premiers cadavres. Chute des femmes qui
s'vanouissent. Des spahis de Yusuf prtent main-forte au pillage qui commence, avant
mme la fin des combats.
Les chasseurs, eux, ont sabr sans s'arrter, par une longue diagonale, en travers de cette
foule immense qui parat affaire et qui se disperse. Les troupeaux, leur tour, sont atteints,
dans le halo des torches terre et des fumes d'incendie; les blements du btail parqu
montent en gronde-ment d'orage, de l'horizon encore sombre.
Deux lieues plus loin, les chasseurs n'ont pu surprendre le deuxime campement : tous les
guerriers des Ouled Ali ont disparu, et jusqu'aux femmes des notables. Seuls, les troupeaux
sont ramens par masses, au centre de la valle. Les Douars et les Spahis, arrivs leur
tour, four-gonnent sous ces tentes abandonnes : le butin y semble moins important.
Des rumeurs circulent. Un rassemblement est ordonn par les officiers de Lamoricire; des
tmoins parlent d'un des claireurs des Douars qui aurait fait traverser le camp, sur son
cheval, la femme de l'agha des Gharabas. Il l'aurait lais-se chapper, probablement
contre les bijoux qu'elle portait; on ne le reverra srement plus.
Sans un mot, Lamoricire se fait conduire devant la plus belle tente : un adolescent de
quinze ans gt sur le dos, face pose mme le sol, yeux grands ouverts, la poitrine troue
et les membres raidis.
Il a dfendu sa sur contre cinq soldats! prcise une voix derrire.
Yusuf, cheval, s'approche et son ombre triom-phante s'allonge devant le gnral. Des
prison-nires groupes demeurent accroupies sur des monceaux de velours; elles attendent
dans un calme ostensible. La plus vieille, face dcouverte, dvisage avec morgue les
Franais qui regardent. Bosquet la devine prte, au moindre mot, l'injure. S'approchant de
son chef, il scrute les femmes silencieuses : la vieille ne baisse pas les yeux.
Ce sont la fille de l'agha, ses deux belles- filles, et une ou deux parentes! prcise Daumas
qui a d interroger les servantes qui se tiennent en retrait.
La fille est vraiment belle ! Elle ne veut pas pleurer son frre, elle en est fire! chuchote un
admirateur l'oreille de Bosquet.
Lamoricire demande brivement pourquoi des femmes ont tout de mme t tues plus
loin.
Sept au total ont t excutes par nos sol-dats, prcise quelqu'un. Elles nous ont
accueillis par des insultes !
Chiens, fils de chiens ! criaient-elles, les mgres! s'exclame l'un des spahis, ct de
Yusuf. Celui-ci est d'un mutisme tranquille, peut- tre mme ironique, devant les scrupules
de Lamoricire. Car tous connaissent les ides saint- simoniennes de leur chef.
Une canne dans sa main frmissante, Lamori-cire tourne sa monture. Les traits crisps, il
s'loigne; son aide de camp le suit, impassible.
A prsent, le pillage s'intensifie, scand par les seuls murmures. Quelques foyers d'incendie
se meurent. Et l'charpe de cris s'effiloche, tandis que les vapeurs nocturnes se dissipent
tout fait. L'aube qui se dploie griffe le ciel d'corchures roses ou mauves ; nuances
fugaces, clairs persis-tants disparaissant d'un coup. La puret du jour nettoy dtache les
silhouettes des soldats s'agi- tant dans la plaine.
Notre petite arme est dans la joie et les fes-tins, crit Bosquet le 1er novembre 1840. On
res-pire dans toute la ville une dlicieuse odeur de grillades de mouton et de fricasses de
poulet...
Et il ajoute dans la mme lettre : Je vais te conter tout cela ; il y a de tout dans cette razzia
: marche militaire et sages combinai-sons, nergie digne d'loge dans l'infanterie, qui tait
harasse et ne s'est pas arrte un instant, ensemble parfait dans notre belle cavalerie, et
puis toute la posie possible dans les dtails de la scne, qui fait le fond de la razzia.
Treize jours plus tard, Montagnac, lui aussi partir d'Oran, s'adresse son oncle :
Ce petit combat offrait un coup d'il charmant. Ces nues de cavaliers lgers comme des
oiseaux, se croisent, voltigent sur tous les points, ces hourras, ces coups de fusil domins,
de temps autre, par la voix majestueuse du canon, tout cela prsentait un panorama
dlicieux et une scne enivrante...
Joseph Bosquet qui crit d'ordinaire sa mre rsidant Pau, s'est adress cette fois un
ami, son cher Gagneur . Sa description de l'attaque est rehausse de rflexions,
d'admiration rtro-spective pour le gnie de Lamoricire, ce chef qui sait dcupler, par son
ardeur, l'lan du corps d'arme, et la furia des brigands de Mustapha ben Ismal.
Enfin le vent de la conqute se lve pour notre auteur barnais et il se croit la proue...
L'ennemi? Pour l'instant, ni l'mir, ni aucun de ses clbres cavaliers rouges, pas un de ses
lieute-nants trop audacieux, aucun de ses allis fanati-ss ne se montre. Le dcor ainsi
dploy accen-tue la surprise et l'effarement des victimes. Paysages que l'on traverse durant
des heures, que le rcit ensuite immobilise et les hommes cara-colent en pleine charge de
l'aube. Symphonie exa-cerbe de l'attaque; pitinement par lances furieuses, touffes de
rles emmls jusqu'au pied des cavales. Tandis que le sang, par gicles, cla-bousse les
tentes renverses, Bosquet s'attarde sur la violence des couleurs. L'lan des retombes le
fascine, mais l'ivresse d'une guerre ainsi recule tourne vide.
Notre capitaine s'adonne l'illusion de ce divertissement viril : faire corps avec l'Afrique
rebelle, et comment, sinon dans le vertige du viol et de la surprise meurtrire?...
Bosquet, comme Montagnac, restera clibataire : nul besoin d'pouse, nulle aspiration une
vie range quand le plaisir guerrier se ravive, taraud par les mots. Revivre, par
rminiscence, le haltement du danger; les phrases harmo-nieuses des ptres conservent
cette cret que ne souponnent pas les femmes de la famille rvant dans l'attente.
Parmi ces relations fivreuses, des scories sur-nagent : ainsi ce pied de femme que
quelqu'un a tranch pour s'emparer du bracelet d'or ou d'argent ornant la cheville. Bosquet
signale ce dtail comme ngligemment. Ainsi ces sept cadavres de femmes (pourquoi
avaient-elles choisi, dans le ralenti de la surprise, de se prsen-ter en injurieuses?), les voici
devenues, malgr l'auteur du rcit, comme des scrofules de son style.
Comme si l'amour de et dans la guerre ne ces-sait de puer, ce que notre Barnais dplore!
Ne serait-ce pas le dcor qui, par sa barbarie natu-relle, contamine ces nobles assaillants?...
Impossible d'treindre l'ennemi dans la bataille. Restent ces chappes : par femmes
mutiles, par bufs et troupeaux dnombrs ou par l'clat de l'or pill. Se convaincre que
l'Autre glisse, se drobe, fuit.
Or l'ennemi revient sur l'arrire. Sa guerre lui apparat muette, sans criture, sans temps
de l'criture. Les femmes, par leur hululement funbre, improvisent, en direction de l'autre
sexe, comme une trange parlerie de la guerre. Inhu-manit certes de ces cris, stridulation
du chant qui lancine, hiroglyphes de la voix collective et sauvage : nos crivains sont
hants par cette rumeur. Bosquet rve l'adolescent tu en dfendant sa sur, sous la
tente luxueuse ; il voque ce pied coup de femme anonyme, coup cause du khalkhal
... Soudain les mots de la lettre entire ne peuvent scher, du fait de cette incise :
indcence de ces lambeaux de chair que la description n'a pu taire.
crire sur la guerre d'Afrique comme autre-fois Csar dont l'lgance du style anesthsiait
a posteriori la brutalit de chef , est-ce prtendre repeupler un thtre dsert ?
Les femmes prisonnires ne peuvent tre ni spectatrices, ni objets du spectacle dans le
pseudo-triomphe. Plus grave, elles ne regardent pas. Le comte de Castellane qui, aprs
avoir particip de semblables chevauches, collabore, Paris, la Revue des Deux
Mondes le remarque presque ddaigneusement : ces Alg-riennes s'enduisent le visage
de boue et d'excr-ments, quand on les conduit dans le cortge du vainqueur. L'lgant
chroniqueur ne s'abuse point : elles ne se protgent pas seulement de l'ennemi, mais du
chrtien, la fois conqurant, tranger et tabou! Elles se masquent toutes comme elles
peuvent, et elles le feraient avec leur sang, si besoin tait...
L'indigne, mme quand il semble soumis, n'est pas vaincu. Ne lve pas les yeux pour
regarder son vainqueur. Ne le reconnat pas. Ne le nomme pas. Qu'est-ce qu'une victoire
si elle n'est pas nomme ?
Les mots enrobent. Les mots lvent un pides-tal, en attendant le triomphe que rservent
toutes les Rome.
Cette correspondance au jour le jour, qui part des bivouacs, offre une analogie avec des
lettres d'amour; la destinatrice devient soudain prtexte pour se dvisager dans l'obscurit
de l'moi... Traces semblables de la guerre, de l'amour : danse d'hsitation face l'image de
celui qui glisse. Or, cette fuite fait peur : l'on crit pour la juguler.
Les lettres de ces capitaines oublis qui pr-tendent s'inquiter de leurs problmes
d'inten-dance et de carrire, qui exposent parfois leur philosophie personnelle, ces lettres
parlent, dans le fond, d'une Algrie-femme impossible appri-voiser. Fantasme d'une
Algrie dompte : chaque combat loigne encore plus l'puisement de la rvolte.
Ces guerriers qui paradent me deviennent, au milieu des cris que leur style lgant ne peut
att-nuer, les amants funbres de mon Algrie. Le viol ou la souffrance des anonymes ainsi
rallums devraient m'mouvoir en premier; mais je suis trangement hante par l'moi
mme des tueurs, par leur trouble obsessionnel.
Leurs mots, couchs dans des volumes perdus aujourd'hui dans des bibliothques,
prsentent la trame d'une ralit monstre , c'est--dire littralement offerte. Ce monde
tranger, qu'ils pn-traient quasiment sur le mode sexuel, ce monde hurla continment
vingt ou vingt-cinq annes durant, aprs la prise de la Ville Imprenable... Et ces officiers
modernes, ces cavaliers aristocrates si efficacement arms, la tte de milliers de
fan-tassins de tous bords, ces croiss du sicle colo-nial submerg par tant de clameurs, se
repaissent de cette paisseur sonore. Y pntrent comme en une dfloration. L'Afrique est
prise malgr le refus qu'elle ne peut touffer.
Inutile de remonter la mort de Saint Louis devant Tunis, l'chec de Charles Quint Alger,
ainsi rpars ; nul besoin d'invoquer les anctres accoupls dans croisades et djihads... Les
femmes franaises parcourent la correspondance des vainqueurs, quasiment les mains
jointes : et cette dvotion familiale aurole le mouvement de sduction cens se drouler de
l'autre ct de la Mditerrane.
I
Premires lettres d'amour, crites lors de mon adolescence. L'crit s'y dveloppe en journal
de rveuse clotre. Je croyais ces pages d'amour , puisque leur destinataire tait un
amoureux clan-destin; ce n'tait que des lettres du danger.
Je dis le temps qui passe, les chaleurs d't dans l'appartement clos, les siestes que je vis
en chap-pes. Mes mutismes d'enferme provisoire appro-fondissent ce monologue,
masqu en conversa-tion interdite. J'cris pour encercler les jours cerns... Ces mois d't
que je passe en prison-nire n'engendrent en moi nulle rvolte. Le huis-clos, je le ressens
comme une halte des vacances. La rentre scolaire s'annonce proche, le temps d'tude
m'est promesse d'une libert qui hsite.
En attendant, mes missives en langue franaise partent pour ailleurs. Elles tentent de
circonscrire cet enfermement. Ces lettres dites d'amour , mais contresens, apparaissent
comme des claies de persiennes filtrant l'clat solaire.
Propos perls, mots doux que la main inscrit, que la voix chuchoterait contre la grille en fer
forg. Quelle nostalgie avouer l'ami dont seul l'loignement permet cet apparent
abandon?...
L'moi ne perce dans aucune de mes phrases. Ces lettres, je le perois plus de vingt ans
aprs, voilaient l'amour plus qu'elles ne l'exprimaient, et presque par contrainte allgre : car
l'ombre du pre se tient l. La jeune fille, demi affranchie, s'imagine prendre cette prsence
tmoin :
Tu vois, j'cris, et ce n'est pas pour le mal , pour l'indcent ! Seulement pour dire
que j'existe et en palpiter! crire, n'est-ce pas me dire ?
Je lis les rponses du jeune homme dans une alcve, ou sur une terrasse, mais toujours les
doigts fbriles, les battements du cur prcipits. Un vertige de la transgression s'amorce.
Je sens mon corps prt bondir hors du seuil, au fl-chissement du moindre appel. Le
message de l'autre se gonfle parfois d'un dsir qui me par-vient, mais expurg de toute
contagion. La pas-sion, une fois crite, s'loignait de moi dfinitive-ment.
Un jour ge de dix-huit ans, j'avais cess depuis longtemps de frquenter l'cole
coranique je dcachetai une lettre reproduisant le texte d'un long pome d'Imriou el
Ouas. L'expditeur me demandait avec insistance d'en apprendre les strophes. Je dchiffrai
la calligraphie arabe; je m'efforai de retenir les premiers vers de cette moallakat , posie
dite suspendue . Ni la musique ni la ferveur du barde ant-islamique ne trouvrent cho
en moi. A peine si l'clat du chef- d'uvre me fit fermer une seconde les paupires : tristesse
abstraite !
Ds lors, quels mots de l'intimit rencontrer dans cette antichambre de ma jeunesse ? Je
n'cri-vais pas pour me dnuder, mme pas pour appro-cher du frisson, plus forte raison
pour le rv-ler; plutt pour lui tourner le dos, dans un dni du corps dont me frappent
prsent l'orgueil et la sublimation nave.
La fivre qui me presse s'entrave dans ce dsert de l'expression. Ma voix qui se cherche
qute l'oralit d'une tendresse qui tarde. Et je ttonne, mains ouvertes, yeux ferms pour
scruter quel dvoilement possible... Enfoui dans l'antre, mon secret nidifie; son chant
d'aveugle recherche le chas .par o il s'envolerait en clameur.
Deux ou trois annes plus tard, je reois, au cours d'une sparation d'avec l'aim, une lettre
haletante. Nous sommes poux depuis peu, il me semble. L'absent, dans une lance de
souffrance, l'a crite comme un somnambule. Ses mots dtaillent mon corps-souvenir.
Je lis une fois, une seule, cette lettre d'hallu-cin. Je me sens habite d'une froideur
soudaine. J'ai peine me convaincre que cet crit me concerne; je range le papier dans mon
porte-feuille. Je n'en relis pas le texte. Cet amour exa-cerb se rflchira-t-il en moi? La
lettre attend, talisman obscur. Dsir profr en termes d'corchures, d'un lieu lointain, et
sans le timbre de la voix qui caresse.
Soudain ces feuilles se mettent exhaler un pouvoir trange. Une intercession s'opre : je
me dis que cette touffe de rles suspendus s'adresse, pourquoi pas, toutes les autres
femmes que nulle parole n'a atteintes. Celles qui, des gnra-tions avant moi, m'ont lgu
les lieux de leur rclusion, elles qui n'ont jamais rien reu : aucune voix tendue ainsi en
courbe de dsir, aucun message que traverserait quelque supplica-tion. Elles ne se
libraient que par la psalmodie de leur chant obsidional.
La lettre que je rangeai m'est devenue premire lettre : pour les attentes anonymes qui m'ont
pr-cde et que je portais sans le savoir.
L'pisode se dveloppe en pripties. La spara-tion se prolonge. Je vis une halte chez des
amis, dans la campagne normande. Une querelle m'oppose un soupirant conduit; je
souris d'abord d'indulgence : son garement va passer, les mots de sa passion bavarde ne
m'ont mme pas frle. J'en interromps le flux : reprendre une camaraderie revigorante,
partager des lectures, flner dans des lieux si nouveaux. Je ne me sens sevre que d'amitis
masculines, que de dialogues rtablir... Or l'impatient, forc de se taire, s'introduit dans ma
chambre, durant mon absence. Il l'avoue peu aprs. La colre me fait dcider :
Arrtons cette amiti puisqu'elle devient impasse !
L'tranger ricane, sur un ton de vengeance pu-rile :
J'ai fouill votre sac !
Et alors ?
J'ai lu une lettre. Celle de cet homme cause duquel vous me rejetez !
Et alors ?
Ma froideur est feinte : l'indiscrtion de l'homme m'a caus un bouleversement. Je me durcis,
je m'exclus. Il ajoute, rveur :
Quels mots! Je ne m'imaginais pas qu'il vous aimait ce point !
Que vous importe ? criai-je.
Les mots crits, les ai-je vraiment reus? Ne sont-ils pas dsormais dvis?... J'avais rang
cette lettre dans mon portefeuille, comme la relique d'une croyance disparue.
Les semaines qui suivent, je ne relis pas la mis-sive. Le regard de ce voyeur m'a
communiqu un malaise. Cet homme, fascin par les mots nus de l'autre, qui parlent de mon
corps, cet homme me devient un voleur; pire, un ennemi. N'ai-je pas fait preuve d'tourderie,
de grave ngligence? Une culpabilit me hante : le mauvais il, est-ce donc cela, l'il du
voyeur?...
Un mois plus tard, je me trouve dans un mar-ch de ville marocaine. Une mendiante aux
yeux larges m'a suivie portant un bb endormi dont la tte s'appuyait nonchalamment
contre l'une des paules maternelles. Elle me demande une pice de monnaie, que je lui
donne en m'excusant. Elle s'loigne. Je m'aperois, peu aprs, qu'elle a emport mon
portefeuille, tir de mon sac qui billait.
Elle m'a pris la lettre ! constatai-je aussitt.
Je ne ressens aucun chagrin ; une interrogation vague me saisit devant le symbole : ces
mots qu'elle ne saura pas lire ne lui taient-ils pas desti-ns? En vrit, la voil devenue
objet mme du dsir gren en vocables pour elle ind-chiffrables !
Quelques jours plus tard, une autre mendiante me dira gaiement, dans un dialogue de rues :
O ma sur, toi au moins, tu sais que tu djeuneras tout l'heure ! Et chaque jour, en cela,
il y a pour moi du nouveau !
Elle a ri, mais une vibration pre altra le grain de sa voix. J'ai repens la lettre, que la
premire inconnue m'avait subtilise, non sans quelque justice.
Mots d'amour reus, que le regard d'un tran-ger avait altrs. Je ne les mritais pas, me
dis-je, puisque j'avais laiss le secret affleurer. Ces mots retrouvaient leur vraie place. Leur
trajet les avait amens entre les doigts de cette analphabte dis-parue. Elle aura froiss la
lettre, ou l'aura dchire en morceaux, avant de la jeter dans un caniveau...
Je me souviens donc de cette lettre d'amour, de sa navigation et de son naufrage.
L'vocation de la mendiante rejoint inopinment l'image de mon pre dtruisant, sous mes
yeux, le premier billet invite si banale dont je retirai les mor-ceaux de la corbeille. J'en
reconstituai le texte avec un enttement de bravade. Comme s'il me fallait dsormais
m'appliquer rparer tout ce que lacraient les doigts du pre...
Chaque mot d'amour, qui me serait destin, ne pourrait que rencontrer le diktat paternel.
Chaque lettre, mme la plus innocente, supposerait l'il constant du pre, avant de me
parvenir. Mon criture, en entretenant ce dialogue sous influence, devenait en moi tentative
ou tenta-tion de dlimiter mon propre silence... Mais le souvenir des excuteurs de
harem ressuscite; il me rappelle que tout papier crit dans la pnombre rameute la plus
ordinaire des inquisitions !
Aprs l'incident de la mendiante, je retrouvai l'auteur de la lettre. Je repris la vie dite
conju-gale . Or notre histoire, bonheur expos, aboutit, par une soudaine acclration,
son terme. La mendiante, qui me subtilisa la lettre, tandis que son enfant dormait contre son
paule, l'intrus, avant elle, qui posa son regard sur les mots d'inti-mit, devenaient, l'un et
l'autre, des annoncia-teurs de cette mort.
crire devant l'amour. clairer le corps, pour aider lever l'interdit, pour dvoiler... Dvoiler
et simultanment tenir secret ce qui doit le rester, tant que n'intervient pas la fulgurance de la
rvlation.
Le mot est torche ; le brandir devant le mur de la sparation ou du retrait... Dcrire le visage
de l'autre, pour maintenir son image; persister croire en sa prsence, en son miracle.
Refuser la photographie, ou toute autre trace visuelle. Le mot seul, une fois crit, nous arme
d'une atten-tion grave.
Ds lors l'crit s'inscrit dans une dialectique du silence devant l'aim. Plus la pudeur raidit les
corps en prsence, plus le mot recherche la mise nu. La rserve naturelle ralentit un geste
ou un regard, exacerbe un frlement de la main, de la peau ; par refus orgueilleux de se
parer, la neutra-lit du vtement est affirme en choix en mme temps, et dans un mme
lan, la voix se dnude et se livre par des mots nets, prcis, purs. Elle s'lance, elle se
donne, irruption de lis dans une alle tnbreuse...
Prliminaires de la sduction o la lettre d'amour exige non l'effusion du cur ou de l'me,
mais la prcision du regard. Une seule angoisse m'habite dans cette communication : celle
de ne pas assez dire, ou plutt de ne pas dire juste. Surmonter le lyrisme, tourner le dos
l'emphase; toute mtaphore me parat ruse misrable, approximative faiblesse. Autrefois,
mes aeules, mes semblables, veillant sur les terrasses ouvertes au ciel, se livraient aux
devinettes, au hasard des proverbes, au tirage au sort des quatrains d'amour...
En fait, je recherche, comme un lait dont on m'aurait autrefois carte, la plthore
amoureuse de la langue de ma mre. Contre la sgrgation de mon hritage, le mot plein de
l'amour-au-prsent me devient une parade-hirondelle.
Quand l'adolescente s'adresse au pre, sa langue s'enrobe de pruderie... Est-ce pourquoi la
passion ne pourra s'exprimer pour elle sur le papier? Comme si le mot tranger devenait taie
sur l'il qui veut dcouvrir !
L'amour, si je parvenais l'crire, s'approche-rait d'un point nodal : l gt le risque d'exhumer
des cris, ceux d'hier comme ceux du sicle der-nier. Mais je n'aspire qu' une criture de
trans-humance, tandis que, voyageuse, je remplis mes outres d'un silence inpuisable.
FEMMES, ENFANTS, BUFS COUCHS DANS LES GROTTES...
Le printemps de l'anne 1845 est marqu par l'effervescence de toutes les tribus berbres
du centre-ouest du pays.
L'mir Abdelkader refait ses forces la fron-tire marocaine. Aprs cinq ans d'incessantes
poursuites, ses ennemis Lamoricire et Cavaignac l'ouest, Saint-Arnaud et Yusuf au
centre et Bugeaud Alger le croient terre. Ils commencent esprer : serait-ce la fin de
la rsis-tance algrienne ? Or c'est l'explosion.
Il a suffi de la prdication d'un nouveau chef, un jeune homme aurol de prophties et de
lgendes miraculeuses, Bou Maza, l'homme la chvre , pour que les tribus des
montagnes et des plaines se soulvent son appel. Entre Tns et Mostaganem sur le
littoral, entre Miliana et Orlansville l'intrieur, la guerre reprend dans cette rgion du
Dahra.
En avril, le chrif Bou Maza tient tte deux armes venues de Mostaganem et
d'Orlans- ville. Croient-elles le cerner au centre du massif? Il attaque Tns en y lanant un
de ses lieute-nants. Saint-Arnaud accourt-il pour sauver Tns? Bou Maza surgit et risque
de prendre Orlansville. Des secours arrivs d'urgence pro-tgent cette ville. Le Chrif
menace alors Mostaganem. L'mir lui-mme n'a pas montr autant de promptitude dans
l'offensive... Ce nouveau prdicateur sera-t-il un vicaire d'Abdelkader ou bien, entour dj
d'une hirarchie de fidles, Bou Maza se voudra-t-il autonome? Rien n'est sr, sinon son
style d'attaque, rapide comme l'clair.
Dans le Dahra qu'il parcourt, ses tendards et sa musique en tte, les populations
l'acclament comme le matre de l'heure . Il en profite pour chtier, quelquefois
cruellement, cads et aghas nomms par le pouvoir franais.
En mai, trois armes franaises battent campagne : elles rpriment les rebelles, incendient
leurs villages et leurs biens, les obligent, tribu aprs tribu, demander l' aman . Saint-
Arnaud fait mieux, et s'en enorgueillit dans sa correspon-dance : il contraint les guerriers des
Beni-Hindjes remettre leurs fusils. On n'avait jamais obtenu un tel rsultat en quinze ans.
Bosquet, promu chef du bureau arabe de Mostaganem, apprcie. Les adjoints de Saint-
Arnaud, Canrobert et Richard, surveillent les oprations; on rcupre mme des armes
anciennes, datant de l'exode andalou du XVe sicle... A la prison de la Tour des Cigognes
, Mostaganem, comme dans les citernes romaines, transformes en geles, du nouveau
Tns, les irrdentistes, qui sont pris de plus en plus nombreux comme otages, croupissent.
Le mois de juin commence. Le marchal Bugeaud, duc d'Isly, a supervis les rsultats de la
rpression : parti de Miliana avec plus de cinq mille fantassins, cinq cents cavaliers et mille
mulets de bt, il a parcouru le Dahra en tout sens. Le 12 juin, il s'embarque Tns pour
Alger. Il laisse son colonel d'tat-major Plissier parfaire le travail : il faut rduire les tribus de
l'intrieur encore insoumises.
Les colonnes parties nouveau de Mostaganem et d'Orlansville, mme en coordonnant
leurs efforts, n'ont pas russi encercler le Chrif insai-sissable. Elles ne laissent derrire
elles que de la terre brle, pour obliger le chef rebelle dispa-ratre ou se terrer.
Le 11 juin, la veille de son embarquement, Bugeaud envoie Plissier, qui se dirige vers le
territoire des Ouled Riah, un ordre crit. Cassaigne, l'aide de camp du colonel, en voquera
les termes plus tard :
Si ces gredins se retirent dans leurs grottes, ordonne Bugeaud, imitez Cavaignac aux
Sbah, enfumez-les outrance, comme des renards !
L'arme de Plissier comprend la moiti des effectifs du marchal : quatre bataillons
d'infante-rie, dont un de chasseurs pied, auxquels s'ajoutent la cavalerie, une section
d'artillerie et un goum d'Arabes rallis, le Makhzen .
Les quatre premiers jours, Plissier s'attaque aux tribus de Beni-Zeroual et des Ouled Kelouf
dont il obtient, aprs quelques combats, la sou-mission. Restent les montagnards des Ouled
Riah qui, sur les rives du Chlif, reculent tout en lais-sant progresser les deux mille cinq
cents soldats de la colonne franaise.
Le 16 juin, Plissier place son camp au lieu-dit Ouled el Amria , sur le territoire d'un des
adjoints du Chrif. Vergers et habitations sont totalement dtruits, les maisons des chefs de
frac-tion incendies, leurs troupeaux razzis.
Le lendemain, les Ouled Riah de la rive droite du fleuve entament la ngociation. Ils seraient
prts demander l' aman . Plissier fait connatre le chiffre de l'imposition exige, le
nombre des chevaux livrer, celui des fusils remettre.
A la fin de la journe, les Ouled Riah, qui hsi-taient, aprs dlibration de leur assemble,
renclent remettre leurs armes. Les autres Ouled Riah, qui ne se sont engags que pour
quel-ques escarmouches, rejoignent leurs arrires : des grottes considres comme
inexpugnables et qui leur servaient d'abris dj du temps des Turcs. Elles sont situes sur
un contrefort du djebel Nac- maria, dans un promontoire 350 mtres d'alti-tude, entre deux
valles. L, dans des profondeurs souterraines d'une longueur de 200 mtres envi-ron,
ouvertes sur des gorges quasi inaccessibles, les tribus se rfugient en cas de ncessit,
avec femmes et enfants, troupeaux et munitions. Leurs silos leur permettent de tenir
longtemps et de dfier l'ennemi.
La nuit prcdant le 18 juin s'coule mouve-mente. Bien que Plissier ait fait abattre des
ver-gers autour du bivouac, des guerriers indignes viennent ramper tout prs ; multiples
alertes noc-turnes. Les chasseurs d'Orlans, sur le qui-vive, interviennent; ils les repoussent
chaque fois.
A l'aube du 18 juin, Plissier est dcid tran-cher : il laisse une partie du camp sous la
surveil-lance du colonel Renaud; il fait progresser en montagne deux bataillons d'infanterie
sans sacs, plus la cavalerie et le makhzen , ainsi qu'une pice d'artillerie et des cacolets.
En avant de cette ultime marche, les cavaliers arabes d'el Hadj el Kaim caracolent : ils ne
rsistent pas une fantasia d'ouverture. Face ces hauteurs menaantes qu'ils savent
habites l'intrieur, ne veulent-ils pas se masquer plutt leur angoisse ? Quelques effectifs
de rallis (est-ce pressentiment du drame qui va suivre?) ont profit de la nuit pour
dserter. Plissier est rsolu agir vite.
Le chef du goum demeure impassible. Ces der-niers jours, il a tenu son rle de guide sans
dfail-lance, dsignant inlassablement chacun des lieux et des biens.
Voici les grottes el Frachich ! scrie-t-il et il montre Plissier, accompagn du jeune
Cas- saigne et de l'interprte Goetz, un plateau qui sur-plombe, en avant-scne du paysage
aride.
S'ils sont tous terrs dans leurs grottes, nous allons bientt marcher au-dessus de leurs
ttes! prcise-t-il en pratiquant une soudaine forme d'humour.
Le colonel Plissier vit cette approche de l'aube presque solennellement, en ouverture de
drame. Une scne tragique semble tre avance; dans le dcor austre de craie ainsi
dploy, lui, le chef doit, selon la fatalit, se prsenter avec gravit le premier.
Tout fuyait mon approche, crira-t-il dans son rapport circonstanci. La direction prise
par une partie de la population indiquait suffisam-ment l'emplacement des grottes o me
guidait el Hadj el Kaim.
Plissier est expert en stratgie. Aprs avoir particip au dbarquement d'Alger, il avait runi
ses observations dans un ouvrage de thorie mili-taire. Il a quitt ensuite l'Algrie, y est
revenu en 1841, Oran d'abord. Sa rputation le devance : il doit la mriter.
Sitt install sur le plateau d'el Kantara qui domine les grottes, Plissier envoie ses officiers
en reconnatre l'entre donnant dans le ravin : la principale se trouve en amont. On place
devant elle un obusier. Une autre, moins importante, est repre en aval. Chacune est
place sous la res-ponsabilit d'un capitaine et de quelques carabi-niers; la cavalerie est
dispose couvert pour courir sus aux fuyards possibles, le 6e lger en avant-garde, les
chasseurs d'Orlans prs du colonel.
Ces mouvements ne se font pas sans mal : des Ouled Riah taient aux aguets, posts dans
les arbres et dans les rochers, pour couvrir l'entre des grottes ou faire diversion. Leurs
coups de fusil cotent aux Franais six blesss dont trois grads ; le septime, touch, meurt
sur le coup : c'est un cavalier du makhzen qui mettait pied terre et voulait se rapprocher du
ravin pour les sommations.
Plissier rplique par l'envoi de quelques obus. Les guetteurs disparaissent. L'tau se
referme sur les rfugis. Le colonel fait entasser des fascines de bois sec et des faix
d'herbes que l'on enflamme; les soldats les roulent partir de l'escarpement jusqu' l'entre
d'amont. Mais la grotte est en contrebas : toute la journe, cette tche se rvle peu efficace.
Ds que le brasier diminue d'intensit, les dfenseurs, proches de l'entre, tiraillent.
Le reste du camp est mont rejoindre les assi-geants, avant la nuit... Plissier risque de se
trou-ver en position critique : les Ouled Riah, avec btail et provisions, peuvent tenir
longtemps ; les Franais ne disposent par contre que de trois ou quatre jours de vivres... Si
les tribus avoisinantes et dj soumises prennent conscience de l'impuis-sance grandissante
de Plissier, ne vont-elles pas repasser d'un coup l'hostilit? Comment ds lors faire
retraite, dans ce pays escarp? Dj, certains Arabes auxiliaires sourient; ils voquent entre
eux les vastes chambres intrieures o les Ouled Riah, bien installs, doivent les narguer.
Au cours de la nuit une nuit de claire lune un Arabe qui tait sorti avec une guerba
pour atteindre la rserve par une issue qu'un fourr de thuyas nous avait drobe jusque-l,
fut bless ... On en conclut que les rfugis manquent d'eau. Plissier reprend courage : il
espre les amener conciliation par les ngociations qu'il rouvre avec eux, dans la matine
du 19 juin; en mme temps, il manifeste une volont plus dlibre de passer la manire
forte, si c'est la seule solution.
Une autre issue a t dcouverte : elle com-munique avec la grotte ouverte sur l'entre, en
aval. On peut donc s'en servir comme d'une che-mine d'appoint. De plus grands feux seront
allu-ms aux ouvertures ; cette fois, la fume pntrera dans les cavernes.
Tandis que les corves se multiplient pour cou-per le bois, abattre les arbres aux alentours,
ras-sembler les fascines et la paille, Plissier ne fait pas rallumer la fournaise : il prfre
engager l'ultime phase des pourparlers.
Les rfugis semblent disposs se rendre : un premier missaire neuf heures, un
second, aprs qu'un conseil de djemaa s'est tenu entre eux, un troisime enfin demande
l'aman . Ils acceptent de payer l'imposition de guerre, et donc de sortir ; ils craignent
seulement d'tre emmens captifs la prison des Cigognes de Mostaga-nem. Plissier,
surpris (venant du commande-ment gnral d'Alger, il nglige la triste rputa-tion de ces
geles), promet de leur viter ce sort; en vain. Les Ouled Riah, rsolus payer jusqu' 75
000 francs d'indemnit, hsitent lui faire confiance sur ce dernier point.
Goetz, l'interprte, est envoy pour leur tra-duire le message de Plissier. Il leur assure
nou-veau la libert. Les dlibrations durent trois heures encore. Les assigs ne veulent
pas se livrer dsarms aux Franais ; ils demandent que ceux-ci se retirent des abords des
grottes. Condi-tion inadmissible, juge Plissier, soucieux de son prestige.
Goetz revient la charge :
Vous n'avez qu'un quart d'heure pour sor-tir!... Aucun homme, aucune femme, aucun
enfant ne sera conduit prisonnier Mostaganem!... Encore un quart d'heure et le travail qui
se faisait au-dessus de vos ttes recommencera; alors il sera trop tard !
Plissier, dans son rapport, insistera sur les prolongations du dlai, sur les atermoiements
des assigs. J'tais aux limites de la longanimit , notera-t-il.
Il est une heure de l'aprs-midi. Les corves de bois n'avaient pas cess durant les
pourparlers. Le feu se rallume donc et la fournaise va, sans discontinuer, tre alimente
toute cette journe du 19 juin et toute la nuit suivante.
Les fagots sont jets par la troupe du haut du contrefort El Kantara. Au dbut, le feu s'lve
modrment, comme la veille : une mauvaise direction est donne aux matires
combustibles. La prvoyance mticuleuse de Plissier, qui, tt, le matin, avait fait pratiquer
des plates-formes en haut des rochers pour mieux jeter les fascines, se rvle utile. Une
heure aprs la reprise des opra-tions, les soldats lancent les fagots avec effica-cit . En
plus, le vent qui se lve oriente les flammes; la fume entre presque totalement l'intrieur.
La troupe est heureuse; la troupe s'active. Elle attisera le feu jusqu'au 20 juin, six heures
du matin, soit durant dix-huit heures d'affile. Un tmoin parmi les Franais prcisera :
On ne saurait dcrire la violence du feu. La flamme s'levait au haut du Kantara plus de
soixante mtres, et d'paisses colonnes de fume tourbillonnaient devant l'entre de la
caverne.
Au milieu de la nuit, on entendit quelques dto-nations l'intrieur des grottes, des
explosions assez distinctes. Puis plus rien. Le silence se prolongea jusqu'au matin. Et le feu
cessa.
Bugeaud, en retournant Alger, est m par des proccupations d'ordre politique. Il n'est pas
mauvais, aprs tout, que l'insurrection reprenne; les ministres Paris auront besoin de lui,
le sauveur , lui qui a dclar, l'anne prcdente, qu'Abdelkader tait dfinitivement
terre. Or, plusieurs Abdelkader surgissent. Ils se lvent de chaque rgion, le second, le
troisime, plus fanatiss encore, plus crotts certainement, de moins en moins des chefs
avec qui le pouvoir franais peut envisager de signer des traits. Enfumez-les tous comme
des renards ! Bugeaud l'a crit ; Plissier a obi, mais, devant le scandale qui clatera
Paris, il ne divulguera pas l'ordre. C'est un vritable officier : il possde l'esprit de corps, le
sens du devoir, il respecte la loi du silence.
Mais il a rendu compte. J'ai d reprendre le travail de fascines , crit-il. Trois jours aprs,
quand, mthodique, il rdige son rapport de rou-tine, il prcise toutes les phases : les
multiples tapes de la ngociation, la qualit de chacun de ses envoys, la reprise de l'ultime
pourparler, l'entre infrieure cette fois. Ce ne fut pas un quart d'heure, mais cinq fois un
quart d'heure qu'il affirme avoir accords... Ceux qui se sont terrs mfiants,
circonspects, acaritres n'ont pas prt foi la parole franaise. Ils ont prfr la scurit
de leurs souterrains.
La sommation a t excute : Toutes les issues sont bouches. Rdigeant son rapport,
Plissier revivra par l'criture cette nuit du 19 juin, claire par les flammes de soixante
mtres qui enveloppent les murailles de Nacmaria.
Je reconstitue, mon tour, cette nuit une scne de cannibales , dira un certain P.
Chris-tian, un mdecin qui a vagabond du camp fran-ais au camp algrien pendant la
trve de 1837 1839. Mais je prfre me tourner vers deux tmoins oculaires : un officier
espagnol combat-tant dans l'arme franaise et qui fait partie de l'avant-garde. Le journal
espagnol l'Heraldo publiera sa relation; le second, un anonyme de la troupe dcrira le drame
sa famille, dans une lettre que divulguera le docteur Christian.
L'Espagnol nous parle de la hauteur des flammes soixante mtres ceinturant le
pro-montoire d'El Kantara. Le brasier, affirme-t-il, fut entretenu toute la nuit : les soldats
poussaient les fagots dans les ouvertures de la caverne, comme dans un four . Le soldat
anonyme nous transmet sa vision avec une motion encore plus violente :
Quelle plume saurait rendre ce tableau ? Voir, au milieu de la nuit, la faveur de la lune,
un corps de troupes franaises occup entretenir un feu infernal! Entendre les sourds
gmisse-ments des hommes, des femmes, des enfants et des animaux, le craquement des
roches calcines s'croulant, et les continuelles dtonations des armes!
Le silence des lieux est en effet troubl par quelques dtonations d'armes; Plissier et son
entourage y voient un signe de luttes intestines. Or ce brasier, admir par l'arme comme
une sculpture vivante et ncrophage, isole mille cinq cents personnes avec leur btail. Ce
tmoin espa-gnol est-il seul, l'oreille contre la roche en feu, entendre les convulsions de la
mort en marche ?...
J'imagine les dtails du tableau nocturne : deux mille cinq cents soldats contemplent, au lieu
de dormir, cette progressive victoire sur les mon-tagnards... Certains spectateurs se sentent
sans doute vengs de tant d'autres veilles! Les nuits d'Afrique ! Outre le froid et la nature que
l'ombre fige davantage, les glapissements des chacals font sursauter; l'ennemi invisible
semble ne jamais dormir; les voleurs de chevaux, leur corps nu enduit d'huile, se glissent au
milieu du campe-ment, dfont les entraves des btes, sment de brusques terreurs au cours
desquelles dormeurs et sentinelles du mme camp s'entre-tuent. Tant de fois se produit
l'alerte nocturne ! Dans la langue de ce pays, le mot qui la dsigne signifie galement la
queue du lion les indignes avouent ainsi leur crainte de l'animal royal, l'Innomm.
Les flammes lchent toujours le rebord du pro-montoire d'El Kantara. Le silence succde aux
dtonations d'armes, houle mue en martlement lointain, qui ronge le cur de la
montagne. Dans les yeux levs des soldats, ne se lit que l'attente du secret violent des
pierres.
20 juin 1845, Nacmaria, six heures du matin.
Dans l'clat de l'aube, une silhouette titubante, homme ou femme, russit sortir, malgr les
der-nires flammches. Elle fait quelques pas, hsite, puis s'affaisse, pour mourir au soleil.
Trois ou quatre rescaps, les heures suivantes, viendront respirer leur tour une bouffe
d'air, avant de succomber... Au cours de la matine, la troupe ne peut approcher : la chaleur
touffante, la fume et comme un religieux silence entourent les abords des grottes. Chacun
se demande quel drame s'est jou derrire ces falaises dont la face crayeuse s'altre
peine de la salissure des der-nires fumes : Le problme, ajoute l'Espagnol dans sa
relation, tait rsolu.
Plissier ordonne l'envoi d'un missaire; selon le rapport, il revint avec quelques hommes
hale-tants qui nous firent mesurer l'tendue du mal qui avait t fait .
Ces messagers confirment le fait Plissier : la tribu des Ouled Riah mille cinq cents
hommes, femmes, enfants, vieillards, plus les troupeaux par centaines et les chevaux a
t tout entire anantie par enfumade .
Un jour aprs l'issue fatale, avant d'entrer lui- mme dans les grottes, Plissier envoie les
sapeurs et l'artillerie : deux officiers du gnie, deux autres d'artillerie, plus un dtachement
de cinquante hommes environ de ces deux corps avec leur matriel. Parmi eux se trouve
l'officier espagnol.
A l'entre, gisaient les animaux morts, dj en putrfaction, entours de couvertures de
laine; bagages et hardes des rfugis brlaient encore... De l, en suivant une trane de
cendres et de poussire, les hommes, leurs lanternes la main, dbouchrent dans la
premire cavit. Horrible spectacle , crit l'Espagnol :
Tous les cadavres taient nus, dans des positions qui indiquaient les convulsions qu'ils
avaient d prouver avant d'expirer. Le sang leur sortait par la bouche ; mais ce qui causait
le plus d'horreur, c'tait de voir les enfants la mamelle gisant au milieu des dbris de
moutons, de sacs de fves, etc. Les splologues de cette mort enfouie vont de l'une
l'autre des grottes ; un spectacle identique les attend. Ce drame est affreux, conclut
l'Espa-gnol, et jamais Sagonte ou Numance, plus de courage barbare n'a t dploy !
Voici que, malgr les efforts des officiers, cer-tains soldats se livrent sur place au pillage :
s'emparant des bijoux, des burnous, des yatagans, ils en dpouillent les cadavres. Le groupe
de reconnaissance revient ensuite vers le colonel qui ne veut pas croire l'tendue du
dsastre.
D'autres soldats sont envoys nous sommes dans l'aprs-midi du 21 juin, premier jour de
l't 1845 ! Parmi eux se trouve l'anonyme de la lettre publie par P. Christian :
J'ai visit les trois grottes; voici ce que j'ai vu , commence-t-il. A son tour, il dcouvre,
tendus l'entre, les bufs, les nes, les moutons; leur instinct les a pousss respirer
jusqu' la fin l'air extrieur qui pouvait encore pntrer. Au milieu des animaux, souvent
mme sous eux, gisent des corps de femmes, d'enfants : quelques- uns furent crass par
l'affolement animal... L'anonyme s'attarde particulirement sur un dtail :
J'ai vu un homme mort, le genou terre, la main crispe sur la corne d'un buf. Devant lui
tait une femme tenant son enfant dans ses bras. Cet homme, il tait facile de le
reconnatre, avait t asphyxi, ainsi que la femme, l'enfant et le buf, au moment o il
cherchait prserver sa famille de la rage de cet animal.
Ce second tmoin en arrive au mme dcompte : plus d'un millier de morts, sans compter
tous ceux qui, entasss les uns sur les autres, ne forment qu'une bouillie; sans tenir compte
des enfants la mamelle presque tous envelopps dans les tuniques des mres...
Soixante rescaps sont sortis de ce cimetire, pas tout fait morts. Une quarantaine pourra
survivre; certains sont soigns dans l'ambu-lance... Dix d'entre eux ont mme t rendus la
libert !
Plissier prcise que par un hasard providen-tiel, les plus obstins dans le parti du Chrif
ont succomb . Parmi les survivants, il a gard la femme, la fille et le fils de Ben Nakah, un
khalifa de Bou Maza pour cette rgion. Ce sont les seuls prisonniers dont il accepte de se
vanter!
Cet aprs-midi du 21 juin 1845, les fumes se dissipent autour du promontoire. Je m'attarde,
moi, sur l'ordre de Plissier :
Sortez-les au soleil ! Comptez-les !
Peut-tre, perdant son contrle, aurait-il pu ajouter avec la brusquerie de l'acharnement :
Sortons ces sauvages, mme raidis ou en putr-faction, et nous aurons alors gagn, nous
serons parvenus au bout! ... Je ne sais, je conjecture sur les termes des directives : la
fiction, ma fiction, serait-ce d'imaginer si vainement la motivation des bourreaux?
Plutt que les pas des premiers arpenteurs, quand, la lueur des lanternes, ils dcouvrent
les asphyxis de l'ombre, me fascine davantage l'ins-tant de l'exposition des cadavres :
On en sortit, de la grotte, environ six cents , note l'officier espagnol, et il souligne le
trouble du colonel entour de son tat-major, tous raidis par une froide stupeur.
Six cents Ouled Riah couchs l'air libre, allon-gs cte cte, sans distinction de sexe ou
de rang : les notables avec les plus pauvres, les orphelins de pre, les veuves, les
rpudies, les bbs langs au cou des mres, ou accrochs leurs paules... Des
cadavres dpouills de leurs bijoux et de leur burnous, le visage noirci, dor-ment dans un
silence qui les dnude. Ils ne seront ni lavs, ni envelopps du linceul; nulle crmonie d'une
heure ou d'une journe n'aura lieu...
Les Arabes du goum d'El Kaim eux qui, trois jours auparavant, ont commenc cette
tragdie dans l'inconscience, par une fantasia indigne s'loignent, circonspects : les
cadavres, aligns en tas misrables, semblent les regarder pour les clouer sur la falaise, et
cette maldiction les taraude, puisque ces corps ne sont pas enterrs.
Le gros de la troupe franaise ne s'est pas approch. Hormis les ambulanciers et le groupe
de reconnaissance, les soldats n'aperoivent, du cimetire dploy, qu'une tache... Les
objets du butin, vendus des uns aux autres, circulent. Ensuite les mots s'changent : ceux
des tmoins, qui ont pntr dans les souterrains, dcrivent les corps qu'on n'a pu sortir, et
qui sont confondus en tourbe. Ces Franais rvent soudain de l'ossuaire sous leurs pieds...
Plissier est-il entr en personne dans les grottes? Certains se le demandent. Le troisime
jour du drame est le 22 juin, date du rapport du colonel. Il aurait dit, en sortant :
C'est horrible !
D'autres rapportent qu'il a soupir :
C'est terrible !
En tout cas, il consigne dans le rapport rgle-mentaire :
Ce sont des oprations, monsieur le Mar-chal, que l'on entreprend quand on y est forc,
mais que l'on prie Dieu de n'avoir recommencer jamais !
Ainsi, Plissier souffre, tourn vers Dieu sans doute, dans quelque prire... La troupe
commente l'issue. Ce 22 juin, elle savoure les rsultats tan-gibles de l'opration : de
nombreuses tribus des environs, y compris les Ouled Riah qui s'taient retirs de l'autre ct
du Chlif, les Beni Zeltoun, les Tazgart, les Madiouna, les Achach, toutes envoient leurs
reprsentants. Ils apportent des fusils, prsentent le cheval de gada , symbole de
soumission.
Certains soldats oublieraient volontiers les six cents cadavres exposs que les rallis du
Makhzen enterrent enfin dans une fosse commune. Ils se congratulent avec forfanterie : ces
grottes, pen-dant trois sicles de domination turque, n'avaient jamais russi tre violes !
La victoire semble avoir t remporte sur les falaises. Or, le lendemain, le 23 juin, cette
mme nature se venge : l'odeur de la mort est telle (l'affluence des corbeaux et des vautours
survo-lant le ravin ne cesse pas, les soldats voient mme les oiseaux emporter des dbris
humains!) que Plissier donne l'ordre, ce mme jour, de trans-porter le camp une demi-lieue
plus loin...
Comme si le soleil, l't qui s'appesantit, et le dcor expulsaient l'arme franaise.
Il faut partir, l'odeur est trop forte. Le souvenir, comment s'en dbarrasser? Les corps
exposs au soleil; les voici devenus mots. Les mots voyagent. Mots, entre autres, du rapport
trop long de Plis-sier; parvenus Paris et lus en sance parle-mentaire, ils dclenchent la
polmique : insultes de l'opposition, gne du gouvernement, rage des bellicistes, honte
parpille dans Paris o ger-ment les prodromes de la rvolution de 48...
Canrobert, lieutenant-colonel en garnison dans ce mme Dahra, livrera son jugement plus
tard :
Plissier n'eut qu'un tort : comme il crivait fort bien et qu'il le savait, il fit dans son rapport
une description loquente et raliste, beaucoup trop raliste, des souffrances des Arabes...
Laissons l la controverse : le bruit Paris autour des morts du rapport serait-il simple
pri-ptie politique? Plissier, grce son criture trop raliste , ressuscite soudain sous
mes yeux les morts de cette nuit du 19 au 20 juin 45, dans les grottes des Ouled Riah.
Corps de la femme trouve au-dessous de l'homme qui la protgeait du buf hurlant.
Plis-sier, pris par le remords, empche cette mort de scher au soleil, et ses mots, ceux
d'un compte rendu de routine, prservent de l'oubli ces morts islamiques, frustrs des
crmonies rituelles. Un sicle de silence les a simplement congels.
Asphyxis du Dahra que les mots exposent, que la mmoire dterre. L'criture du rapport de
Plissier, du tmoignage dnonciateur de l'offi-cier espagnol, de la lettre de l'anonyme
troubl, cette criture est devenue graphie de fer et d'acier inscrite contre les falaises de
Nacmaria.
Moins de deux mois aprs, vingt lieues de l, le colonel Saint-Arnaud enfume son tour la
tribu des Sbah. Il bouche toutes les issues et, le travail fait , ne cherche dterrer aucun
rebelle. N'entre pas dans les grottes. Ne laisse personne faire le dcompte. Pas de
comptabilit. Pas de conclusion.
Un rapport confidentiel est envoy Bugeaud qui, cette fois, se garde de le faire suivre
Paris. Et l'on part. Le rapport, Alger, sera dtruit... En 1913, soixante-huit ans aprs, un
honorable uni-versitaire du nom de Gauthier en cherche la trace, ne la trouve pas, se
demande mme si Saint-Arnaud, par vanterie, n'aurait pas fabul. N'aurait pas imagin
cette nouvelle enfumade, pour ne pas faire moins que Plissier et pour jouer au plus
habile!... Mais non, l'enquteur en retrouve le souvenir dans les rcits des descendants de la
tribu.
Saint-Arnaud, moins de deux mois aprs Plis-sier, a bien enfum lui aussi huit cents
Sbah, pour le moins. Il s'est simplement entour du mutisme du triomphe implacable. La
vraie mort. Les enterrs jamais dterrs des grottes de Saint-Arnaud !
Or, mme lui, le bel homme, l'astucieux, celui qui tout russit, celui qu'on choisira, parmi
tous les chefs de l'arme d'Afrique pour contrler le futur coup d'tat du 2 dcembre 1851,
celui qui, en pleine guerre, domine mme ses mots, et donc ses alarmes, mme lui, ne peut
s'empcher d'crire son frre :
Je fais hermtiquement boucher toutes les issues et je fais un vaste cimetire. La terre
cou-vrira jamais les cadavres de ces fanatiques. Per-sonne n'est descendu dans les
cavernes !... Un rap-port confidentiel a tout dit au marchal, simplement, sans posie terrible,
ni images.
Puis il conclut, sur le mode de l'motion qui se veut poignante :
Frre, personne n'est bon par got et par nature comme moi!... Du 8 au 12 aot, j'ai t
malade, mais ma conscience ne me reproche rien. J'ai fait mon devoir de chef, et demain je
recommencerai, mais j'ai pris l'Afrique en dgot!
Un des lieutenants de Bou Maza, Bel Gobbi, rdigea lui aussi une narration en arabe ou
en franais, je ne sais, car elle n'a pu tre retrouve. Vingt ans aprs ces vnements,
certains pren-dront connaissance de ce document, puis ils crivent leur tour. Saint-Arnaud,
son uvre macabre accomplie, se retire au loin d'Ain Merian, et fait stationner son arme
une dizaine de jours. Les indignes n'osent tenter un ultime sauvetage des emmurs.
Cependant un des adjoints de Bou Maza, qui a gard dans la rgion une rputation de hros
la fois d'amour et d'aventures, un certain Assa ben Djinn (surnom qu'on pourrait
traduire par Jsus, fils du Diable ), Assa donc arrive sur les lieux et s'adresse aux autres
Sbah :
Il y a l-dessous, dit-il, une femme que j'ai beaucoup aime ! Tchons de la savoir morte
ou vivante !
Sur son injonction, les autres fractions de la tribu dbouchrent le puits. Une dizaine de
vic-times sortirent en chancelant mais en vie. Elles s'taient places dans la partie amont
des grottes, qui est un ddale vertical d'asprits , consta-tera Gauthier en inspectant les
lieux.
Dans les autres galeries, l o les gaz dltres de l'enfumade avaient sjourn, on marchait
sur les cadavres comme sur une jonche de paille , nous dit El Gobbi. On les laissa
enterrs sur place.
A l'endroit de l'ancien bivouac d'Ain Merian fut cr ensuite un village de colons, Rabelais
. Gauthier, en 1913, y retrouve un survivant de l'enfumade, un octognaire qui avait figur,
alors enfant de moins de dix ans, parmi les survivants sortis de l parce que Assa fils du
diable cher-chait dlivrer une femme qu'il avait beaucoup aime .
Et l'universitaire de la tranquille Algrie coloniale qui dort, travaille, s'enrichit sur une
tourbe fertilise de cadavres d'crire, au terme de son enqute :
Il y a peu de choses aussi loignes de l'exp-rience courante qu'une enfumade... Je suis
conscient de mon impartialit, je puis dire de mon indiffrence dont je ne vois pas
comment on pourrait se dpartir en splologie.
Prs d'un sicle et demi aprs Plissier et Saint- Arnaud, je m'exerce une splologie bien
parti-culire, puisque je m'agrippe aux artes des mots franais rapports, narration,
tmoignages du pass. Serait-elle, l'encontre de la dmarche scientifique d'E. F.
Gauthier, englue d'une partialit tardive?
La mmoire exhume de ce double ossuaire m'habite et m'anime, mme s'il me semble
ouvrir, pour des aveugles, un registre obituaire, aux alen-tours de ces cavernes oublies.
Oui, une pulsion me secoue, telle une sourde otalgie : remercier Plissier pour son rapport
qui dclencha Paris une tempte politique, mais aussi qui me renvoie nos morts vers
lesquels j'lve aujourd'hui ma trame de mots franais. Saint-Arnaud lui-mme, quand il
rompt pour son frre un silence concert, me dlimite le lieu des grottes-tombes. S'il semble
trop tard pour rouvrir celles-ci, bien aprs le fils du diable qui cher-cha la femme aime,
ces mots, couleur rouge cinabre, s'enfoncent en moi comme un coutre de charrue funraire.
Je me hasarde dvoiler ma reconnaissance incongrue. Non pas envers Cavaignac qui fut
le premier enfumeur, contraint, par opposition rpublicaine rgler les choses en muet, ni
l'gard de Saint-Arnaud, le seul vrai fanatique, mais envers Plissier. Aprs avoir tu avec
l'osten-tation de la brutale navet, envahi par le remords, il crit sur le trpas qu'il a
organis. J'oserais presque le remercier d'avoir fait face aux cadavres, d'avoir cd au dsir
de les immortali-ser, dans les figures de leurs corps raidis, de leurs treintes paralyses, de
leur ultime contorsion. D'avoir regard l'ennemi autrement qu'en multi-tude fanatise, en
arme d'ombres omniprsentes.
Plissier le barbare , lui, le chef guerrier tant dcri ensuite, me devient premier crivain
de la premire guerre d'Algrie! Car il s'approche des victimes quand elles viennent peine
de frmir, non de haine mais de furia, et du dsir de mou-rir... Plissier, bourreau-greffier,
porte dans les mains le flambeau de mort et en claire ces mar-tyrs. Ces femmes, ces
hommes, ces enfants pour lesquels les pleureuses n'ont pu officier (nulle face lacre, nul
hymne lancinant lentement dvid), car les pleureuses se sont trouves confondues dans le
brasier... Une tribu entire! Les survivants, en ttonnant aux rives de l'aurore, ne sont mme
plus des ressuscits : des ombres vides plutt, pour lesquelles n'existe, en plein midi,
qu'une lumire d'chaudoir.
crire la guerre, Plissier, qui rdige son rap-port du 22 juin 1845, a d le pressentir, c'est
fr-ler de plus prs la mort et son exigence de crmonie, c'est retrouver l'empreinte mme
de ses pas de danseuse... Le paysage tout entier, les montagnes du Dahra, les falaises
crayeuses, les vallonnements aux vergers brls s'inversent pour se recomposer dans les
antres funbres. Les victimes ptrifies deviennent leur tour montagnes et valles. Les
femmes couches au milieu des btes, dans des treintes lyriques, rvlent leur aspiration
tre les surs-pouses de leurs hommes qui ne se rendent pas.
Plissier, tmoin silencieux, quand il parcourt ces grottes jamais peuples, a d tre saisi
d'une prescience de palographe : quelles strates du magma de cadavres et de cris,
vainqueurs et vaincus s'entremlent et se confondent?
Au sortir de cette promiscuit avec les enfums en haillons de cendre, Plissier rdige son
rapport qu'il aurait voulu conventionnel. Mais il ne peut pas, il est devenu jamais le sinistre,
l'mouvant arpenteur de ces mdinas souterraines, l'embaumeur quasi fraternel de cette
tribu dfinitivement insoumise...
Plissier, l'intercesseur de cette mort longue, pour mille cinq cents cadavres sous El Kantara,
avec leurs troupeaux blant indfiniment au tr-pas, me tend son rapport et je reois ce
palim-pseste pour y inscrire mon tour la passion calcine des anctres.
II
Mon frre, qui j'aurais pu servir de confidente lors de sa premire vasion vers les
montagnes qui flambaient, ne fut ni mon ami ni mon complice quand il le fallait. Mais,
absente, je m'enfermais dj dans un romantisme gotiste qui flambait aussi, plus
incongrment certes que l'incendie des maquis... Mon frre, dont l'adoles-cence navigua
vers les horizons mobiles... Aprs le temps des prisons et des coutes dans le noir, le
rythme des errances traverses de fivre, un seul mot, dans une confidence inopine, a fait
jaillir la rencontre : hannouni .
Le frre, rest adolescent par son sourire de biais humour distrait, tendresse dguise ,
voque devant moi le dialecte de nos montagnes d'enfance. Les vocables de tendresse, les
diminu-tifs spcifiques au parler de notre tribu d'origine mi-chemin du berbre des
crtes et de l'arabe de la cit proche (antique capitale, ruine puis repeuple par l'exode
andalou) :
Un seul mot, si une amie te l'adresse, quand elle s'oublie...
J'attends, il hsite, il ajoute doucement :
Il suffit qu'elle prononce hannouni rni- voix, et tu te dis, sr de ne pas te tromper :
Elle est donc de chez moi !
Je ris, j'interromps :
Cela fait chaud au cur!... Tu te souviens, la tante si douce...
Je dtourne le sujet, j'voque les tantes, les cou-sines attendries de la tribu, celle qui
caresse les bbs et rpte satit : mon foie... han- nouni! , l'aeule qui ne le dit qu'aux
petits gar-ons, parce qu'elle n'aime pas les filles (sources de lourds soucis), qui...
Comment traduire ce hannouni , par un tendre , un tendrelou ? Ni mon chri , ni
mon cur . Pour dire mon cur , nous, les femmes, nous prfrons mon petit foie ,
ou pupille de mon il ... Ce tendrelou semble un cur de laitue cach et frais,
vocable enrob d'enfance, qui fleurit entre nous et que, pour ainsi dire, nous avalons...
Nous marchions, je crois, dans une rue dserte de la capitale. Nous nous tions rencontrs
par hasard, au cours d'un aprs-midi d't, et nous avions ri comme deux inconnus se
reconnaissent, en se croisant ainsi pareillement dsuvrs. Prs de ce frre unique
mince, droit, et plus jeune que moi de deux ans environ , j'affichais souvent une
coquetterie malicieuse en le prsen-tant comme mon an , cause de ses cheveux
prcocement grisonnants et malgr sa silhouette de jeune homme... Il ne m'aura ouvert que
cette brche : un seul mot dvoilant ses amours. J'en ressentis un trouble aigrelet.
J'ai dvi. J'ai rappel le pass et les vieilles tantes, les aeules, les cousines. Ce mot seul
aurait pu habiter mes nuits d'amoureuse... Au frre qui ne me fut jamais complice, l'ami qui
ne fut pas prsent dans mon labyrinthe. Ce mot, nnuphar largi en pleine lumire d'aot,
blanc d'une conversation alanguie, diminutif brisant le bar-rage de quelle mutit... J'aurais
pu...
Dire que mille nuits peuvent se succder dans la crte du plaisir et de ses eaux nocturnes,
mille fois chaque fois, et qu'aux neiges de la rvulsion, le mot d'enfance-fantme surgit
tantt ce sont mes lvres qui, en le composant dans le silence, le rveillent, tantt un de mes
membres, caress, l'exhume et le vocable affleure, sculpt, je vais pour l'peler, une seule
fois, le soupirer et m'en dlivrer, or, je le suspends.
Car l'autre, quel autre, quel visage recommenc de l'hsitation ou de la demande, recevra ce
mot de l'amour inentam ?
Je m'arrte. Chaque nuit. Toutes les nuits du plaisir escalad par mon corps de nageuse
d'ombre.
Sur une avenue poussireuse de notre capitale, le frre adulte m'a donc renvoy
l'appellation lacre de mystre ou de mlancolie. Rompt-il ainsi la digue ? Un clair o
j'entrevois, par-des-sus l'paule fraternelle, des profils de femmes penches, des lvres qui
murmurent, une autre voix ou ma voix qui appelle. Ombre d'aile, ce mot- chott.
Silhouette dresse du frre qui dtermine mal-gr lui la frontire incestueuse, l'unit hante,
l'obscurit de quels halliers de la mmoire, d'o ne surnagera que ce bruit de lvres, qu'une
brise des collines brles d'autrefois o je m'enterre. O s'enfument ceux qui attendaient,
dans le pour-rissement de leur chair, l'amour cruel ou tendre, mais cri.
LA MARIE NUE DE MAZOUNA
El-Djezar tait, depuis quinze ans, tombe entre les mains de l'Infidle. Oran avait suivi,
livre par trahison de son bey. Au pied de l'Atlas, Blida trop proche n'avait pu rsister
l'assaut ennemi et, deux reprises, s'tait vide de ses Maures, fuyant l'arme franaise,
ainsi que Mda-la-haute, o l'mir avait maintes fois tenu sige avec ses lieutenants, y
convoquant en outre les chefs des montagnes voisines. Au loin, la ville des passions ,
Constantine, s'tait, la deuxime attaque, dfendue maison aprs mai-son, puis elle avait
t livre au frntique pillage, le bey Ahmed allant rsister dans les Aurs.
Sur la cte est, Bne avait pli depuis long-temps; Bougie galement, aprs maintes
vicissi-tudes, bien que les chefs kabyles indpendants continuassent venir guerroyer sous
ses rem-parts, leurs femmes chevauchant parmi eux et comme eux se faisant tuer par
bravade ou par ivresse de guerre sainte. Sur le littoral ouest, Mos- taganem s'tait soumise,
puisque dans l'intrieur la glorieuse Tlemcen n'avait pu rsister, ni Mas-cara elle-mme,
capitale capricieuse d'Abdelkader qui venait, par surcrot, de perdre sa smala ; peu
auparavant, Cherchell les avait prcdes
dans la servitude, lorsque les Franais, entrant 3 dans ses ruines d'ancienne Csare, n'y
trouvaient qu'un fou et qu'une paralytique abandonns.
Restaient les cits et les bourgs au milieu des massifs. Les envahisseurs n'y faisaient que
des incursions rapides ; ils parvenaient aux hauts pla-teaux ouvrant aux dserts et aux oasis
ombreuses... Certains des monts du Nord se dres-saient inentams : la Kabylie, pour
longtemps encore imprenable, les Babors l'extrmit orien-tale, galement l'Atlas en
barrire tourmente o les colonnes franaises s'taient affrontes aux rguliers de Ben Allai
et du vieux Berkani.
Au centre du Dahra, promontoire du Nord, une cit secrte se tenait l'cart. A vingt lieues
de Mostaganem et de Miliana, non loin de Tns, o, depuis un an, des colons s'installaient
dans des baraques de planches, et de Cherchell, repeuple de ses citadins dsormais
soumis, Mazouna la vnrable se recroquevillait derrire ses remparts. ' Elle avait t
autrefois le sige du beylik turc de l'Ouest; depuis cinquante ans au moins, elle s'tait
endormie dans une poussire de crpus-cule. Elle demeurait cit autonome, l'instar des
centres prservs du Sud extrme...
Quinze annes s'taient coules depuis la chute d'El-Djezar.
L'anne de la prise d'Alger, naissait la fille unique du cad coulougli de la ville, Si
Moha-med Ben Kadrouma. Elle fut appele Badra, un nom de lune pleine. Dans Mazouna,
on parlait maintenant de la beaut de Badra ses yeux verts, son teint de lait, sa gorge
opulente, sa taille lance de jeune palmier, ses cheveux de jais lui tombant jusqu'aux reins
comme une preuve de la splendeur passe.
La mre de Badra, morte la naissance de sa fille, avait t amene de Tlemcen avec une
pompe demeure lgendaire. C'tait la fille du Khasnadji de cette cit orgueilleuse; lui-mme
avait t tu peu aprs au combat, lorsque les janissaires du Mchouar s'taient dclars
contre l'mir, et que celui-ci avait pris sa revanche, en dportant les familles turques.
Personne n'avait voqu devant la petite Badra les malheurs de sa famille maternelle : or, ne
le dit-on pas, celui qui ne bnficie pas au berceau du sourire de l'oncle maternel ne
commence pas sa vie sous de bons auspices! Badra avait toute-fois gard sa nourrice venue
de l'Ouest, une mul-tresse; esclave affranchie, elle avait nourri l'imagination de l'enfant de
lgendes obscures, de rcits magiques... On la disait originaire du centre du Maroc; les deux
copouses du cad, toutes deux filles de chefs de la rgion, autant dire des paysannes, la
redoutaient.
Badra, princesse isole au cur de la cit dchue. Depuis un an, une effervescence
insidieuse court dans la ville encore raidie dans la fiert de son pass. Le cad Ben
Kadrouma se fait vieux, bien qu'il approche peine de la soixantaine. A vingt ans, au temps
du pouvoir turc les anciens de la ville le racontent encore , il se dis-tingua dans les
troubles qui marqurent la ter-rible insurrection des campagnes contre le bey d'Oran. C'tait
bien avant 1830! Il fit preuve de courage autant que d'intelligence!... Le bey, sortant de
Mazouna pour retourner Oran, avait t surpris dans un dfil; il avait pu fuir, mais sa
garde entire avait t massacre par les redou-tables Sbah et les Ouled Jounes. Revenu
le prin-temps suivant, avec des forces doubles dont la moiti, de tout rcents convertis, ne
parlaient ni turc, ni arabe , le bey stait livr une impi-toyable rpression. Le cad, alors
jeune hritier de sa charge, avait d conduire la dputation qui avait tent d'adoucir la
rigueur ottomane.
En cet avril 1845, le cad Ben Kadrouma se re-trouvait dans des conditions similaires : une
dl-gation de notables mazounis accueillait la porte de la ville (cette porte qu'on n'avait
pas voulu ouvrir, deux ans auparavant, Abdelkader, mal-gr ses cavaliers rouges et son
artillerie) la colonne franaise qui approchait. De durs combats venaient de l'opposer aux
troupes exci-tes du Chrif Bou Maza, le nouveau hros des montagnes, lui que les tribus
saluaient avec une allgresse dangereuse. Les dtails d'un combat dans la plaine de Ghris
avaient t connus Mazouna dans la journe : les Franais avaient charg, mais ils avaient
eu vingt tus! Le Chrif, sur son cheval rapide, avait disparu comme un ouragan.
Le cad s'tait donc prsent devant le chef des Franais qui arrivaient fourbus ; son
discours pro-nonc, celui de son collgue hadri ayant suivi, il avait cout, les traits
impassibles, les menaces du colonel, un certain Saint-Arnaud, qui venait de Miliana...
Du haut de sa monture, Saint-Arnaud dclarait, le visage rougi, la voix de plus en plus
criarde, que Mazouna, cause de la duplicit de ses gens, ne serait bientt que ruines; que
la France n'tait pas dupe, que le commerce le plus florissant de la cit tait le vol et le
brigandage, ou tout au moins le recel et la vente des objets vols ; que les trou-peaux trop
nombreux qu'on entendait bler dans les jardins taient ceux des rfugis et des tribus
rebelles... Tandis que ce discours se droulait, l'officier du bureau arabe, un nomm Richard,
le crne encombr d'un large pansement, parce qu'il venait d'tre bless au prcdent
combat, tradui-sait lentement pour la dizaine de notables qui se tenaient debout, tte
baisse, draps dans leurs amples toges.
Le cad, la fin, rpondit brivement, le regard sec :
Qu'il soit fait selon la volont de Dieu! Mazouna est une ville neutre, une ville libre!... Elle
seule a rsist l'mir et ne lui a pas ouvert ses portes ; elle seule rsistera aux matres
comme aux bandits !
Le Chrif est venu ici il y a moins de qua-rante-huit heures! Il a enrl chez vous trois
cents fantassins, deux khodjas! Nous le savons, nous en avons la preuve ! rpliqua de sa
voix col-reuse le colonel, et Richard traduisait platement les mots vhments.
Je ne l'ai jamais rencontr en face ! rpondit en franais le cad.
S'enveloppant la tte d'un pan de son burnous de serge brune, il recula d'un pas et
s'engloutit dans la masse des dputs.
Saint-Arnaud tait bien inform, mais le cad avait dit vrai. Bou Maza s'tait content, les
jours prcdents, de stationner sous les remparts; il avait reu l ses adeptes et ses
nouveaux fervents, mais le cad, lui, jamais ne se dplaait : ni pour un chef de la rgion, ni
comme autrefois pour l'mir... Ruse, disaient ses ennemis, fiert de ses ascendants
coulouglis, rpliquaient ses ouailles.
Le cad pourtant vieillissait. Ce jour des insultes et des menaces de Saint-Arnaud, un goum
inves-tissait la ville, avec sa tte l'agha de l'Ouarsenis, Si M'hamed. Celui-ci, les Franais
partis, tait venu rendre visite Ben Kadrouma. Il s'tait inclin sur le seuil.
Les deux hommes s'taient considrs un moment : le chef citadin, dans ses atours du
matin, mais le visage durci, malgr la dtente de la prire publique o il s'tait montr dans
la principale mosque, le Berbre au profil d'oiseau de proie, la toge rousse de nouveau
fodal investi par les Franais. Lui que tous savaient redoutable venait avec quelle
arrire-pense assurer le cad de son amiti :
Je poursuivrai sans rpit le Chrif. S'il n'avait pas tu mon ami l'agha Bel Kassem, aprs
l'avoir tortur, j'aurais peut-tre cru sa mission divine! Les fils de la ville et des montagnes
proches accourent lui en cervels... Malgr sa jeunesse, et parat-il son austrit, ce dont
je doute, c'est pour moi un imposteur !
Comment percer l'imposture de nos jours ? rpliqua le cad. Notre libert est partie, les
jours de misre commencent peine !
L'agha de l'Ouarsenis changeait brusquement de sujet ; il parlait de son fils an :
Aprs la zaouia de Mazouna o il a t le meilleur, il a tudi Tunis et Kairouan !
Il vantait sa science et son courage ; il rvait de lui comme successeur de sa charge. Le cad
ne rpondit rien. Je ne lui donnerai jamais ma fille , se disait-il, dcelant l'approche. Ils se
salurent et l'agha s'en alla. Son goum quitta le jour mme la ville dpouille et razzie, qui
refermait ses portes.
C'tait alors la mi-avril ; le printemps se droula en escarmouches, en combats brefs et
nombreux, en poursuites interminables. Chaque jour de mar-ch, on ne parlait que du jeune
Chrif, de sa beaut son signe dessin sur le front, son corps invulnrable aux balles, son
cheval rapide, ses paroles de prophtie. On voquait ses lieutenants ; un jour, le plus
prestigieux d'entre eux, Assa ben Djinn, se montra en personne sur une place.
La nourrice, sortie ce jour-l pour rapporter des herbes fraches et des fioles de parfums
rares, revint blouie. Elle le dcrivit Badra :
Le fils du Diable , comme on l'appelle, sert le Chrif bien-aim ! Il porte une cicatrice
la mchoire, mais son visage, tout en angles et en os, parat si beau : un vrai hros de la
libert ! Dans les dbuts de l'Islam, Sid Ali devait appa-ratre comme cela aux yeux de
Fatima, la fille de notre Prophte bien-aim!...
Ainsi Assa ben Djinn tait cruel, mais il tait pote, ajoutait la nourrice qui rva ensuite, et
souvent tout haut ; on raconte que, dans chaque tribu, peut-tre mme dans chaque
maison ancienne de Mazouna, chaque femme belle rve de lui. Car il doit rjouir chacune,
malgr tous les dangers, puisqu'il aime l'amour, comme il aime la Libert!...
Badra, assise, coutait la description du hros.
Si le Chrif, rpliqua-t-elle, venait demander ma main mon pre, telle que je suis
maintenant, je dirais que je suis prte : prte pour l'pouser sur-le-champ !
Or le soir mme, les deux femmes du cad entrrent dans la pice aux cramiques bleutes.
Ton pre nous charge de te dire..., annona la premire.
Que l'agha de l'Ouarsenis, Si M'hamed, a demand aujourd'hui ta main pour son fils an !
Ton pre l'a accorde. Us viendront vendredi prochain pour la fatiha et pour t'emmener
le lendemain !
Ma pauvre chrie! soupira la nourrice en prenant Badra, stupfaite puis raidie, dans ses
bras.
Sur la couche aux soieries parfumes de musc, on ne sut laquelle des deux femmes
sanglotait... Les martres sortirent d'un mme pas, leurs taffe-tas colors crissant dans le
silence.
L'agha de l'Ouarsenis, en ce dbut de juillet, triomphait. A la tte d'une escorte imposante,
sui-vie de calches pleines des plus belles femmes de sa tribu, il entrait dans Mazouna. Il
considra du haut de sa monture le portier qui entrouvrait les lourdes portes ; il lui tendit sa
tasse de cuivre :
Je te la donne, pour que tu te rappelles ce jour !
Le portier prit la setla cisele. Toute la jour-ne, des rumeurs avaient circul sur la
victoire prtendue ou non de 1 agha sur le Chrif. Ainsi, c'tait vrai, Bou Maza avait d
fuir et l'agha avait tu beaucoup de ses fidles et dispers les autres ; il avait mme mis la
main sur son trsor et ses drapeaux.
Il n'osa pas les apporter l, dans cette cit qu'il savait bruissante des exploits du Chrif et de
ses lieutenants. S'il s'tait hasard montrer un seul des drapeaux vols, le portier lui aurait
peut-tre mme crach la face :
Vous n'tes que des chacals et lui, un lion pour l'instant cach dans son repaire !
La tasse de cuivre, se dit le Mazouni, il me la donne pour souligner qu'il est doublement
riche dsormais : des dpouilles de notre hros et, maintenant, de la plus belle de nos filles
qu'il va emmener demain dans son escorte !
L'agha de l'Ouarsenis traversa en plein centre la vieille cit, sous les regards hostiles
quelques- uns des notables hochant toutefois la tte pour un salut de prudence. Le cortge
de plus d'une cen-taine de cavaliers dfilait en suivant le bord ver-doyant du ravin qui coupait
la ville en diagonale.
La chevauche dura deux longues heures, tandis que dans les demeures du cad, l'ouest,
contre un bosquet d'oliviers centenaires, les you-you des femmes montaient en vrilles
aigus.
La fantasia des cavaliers berbres commena sur la place du march ; elle se prolongea
dans la nuit chaude. Au milieu des invites, mle aux bourgeoises de la ville, Badra fut
installe en idole au visage masqu, les mains et les pieds seuls apparaissant sous la
draperie de moire qui la recouvrait. Les litanies, entrecoupes de bndic-tions, montaient
en gerbes, tandis que la mul-tresse, la face inonde de pleurs, tendait la pte du henn qui
avait t malax dans une tasse de Mdine.
Les bruits des galops et de la poudre secouaient la ville; le choeur des femmes invoquait le
Pro-phte et les saints familiers pour la noce du lende-main... Mazouna vivait sa dernire
nuit de cit libre et la vierge, sous l'attente scrutatrice des invites pares, laissa enfin couler
ses larmes.
Le cortge nuptial quitta Mazouna aux pre-miers instants de l'aube; le palanquin de la marie
en tte, prcd de cinq ou six cavaliers, choisis parmi les plus jeunes des cousins
ger-mains du mari absent.
Debout devant sa demeure, le cad Ben Kadrouma fut le seul dcouvrir le visage de Badra.
Certains plus tard prtendirent qu'il lui parla alors de sa mre morte puis qu'en termes
sibyllins, il lui demanda abruptement pardon.
La centaine de cavaliers qui taient arrivs la veille paradait nouveau avec la mme
morgue. Aux calches qui emportaient les femmes des familles allies l'agha, s'taient
jointes d'autres voitures o les martres de la marie, ses deux tantes paternelles et une
dizaine de citadines avaient pris place. Elles allaient jusqu' Miliana o se prparait, disait-
on, une fte de sept jours.
Dans le palanquin surlev, face Badra dore et farde, la multresse se tenait en robe
bleue scintillante de paillettes, un foulard de soie car- late enveloppant sa chevelure
crpele. Prs d'elle, la fille de l'agha, peine plus jeune que Badra et presque aussi belle,
tait assise.
Au premier rang de l'imposant cortge, l'agha Si M'hamed chevauchait sans quitter des yeux
le palanquin. Sa prochaine fte serait, songeait-il, pour marier sa fille, peut-tre au fils de son
nou-veau collgue, l'agha des Sbah, Si Mohamed, celui qui venait de remplacer Bel
Kassem tu par Bou Maza.
Parmi les jeunes de l'avant-garde, l'un soudain se dtache et accourt rapidement vers l'agha
:
Un groupe de cavaliers la toge rouge appa-rat au-del des premiers vallons, l'ouest !
Des toges rouges de spahis! rpondit l'agha...
Il arrta son cheval, fixa la direction indique : il n'aperut qu'une tache lointaine, peine
mobile. D'un geste du bras lev, il fit signe au cortge d'arrter. Les quatre chevaux qui
condui-saient le palanquin firent un ou deux mouvements brusques, si bien que l'attatich
s'inclina une seconde, sur la gauche... Un cri de femme pera faiblement, mais le palanquin
retrouva sa stabilit.
C'est l'escorte de l'agha Mohamed, mon ami ! s'exclama d'une voix de stentor l'agha
M'hamed. Il me l'avait promis!... Il nous rejoint avec ses gardes et ses cavaliers. Il arrive pour
la fantasia ! Accueillons-le dignement !
Les cavaliers de l'avant revinrent peu peu ; les ranges du cortge s'agglutinaient et
attendaient les ordres.
Placez-vous en deux rangs ! ordonna l'agha.
Tandis que les hommes se groupaient, que seuls les gardes autour du palanquin se tenaient
leur place premire, l'agha de l'Ouarsenis allait des uns aux autres, souriant, enorgueilli de
cette rencontre qui lui rappelait les festivits de sa jeu-nesse, peut-tre de ses propres
noces.
Ils approchent ! remarqua quelqu'un.
Un nuage de poussire, de plus en plus dense, couvrit l'horizon. Dans un poudroiement
diffus, des masses hautes, tte baisse sur de courtes montures, taches carlates toges
en effet de spahis se soulevant dans le vent de la vitesse , se distinguaient nettement.
Soudain, le rythme rgulier, saccad, sembla encore plus proche, comme une mcanique
invisible et dj prsente, avant les hommes... A peine quelques tmoins, circonspects,
s'tonnrent-ils du nombre des arri-vants : vingt, trente cavaliers ou davantage, une avant-
garde probablement. On se mit peu aprs mieux les distinguer, deviner leurs corps
recro-quevills, leurs jambes demi plies, leurs longs fusils en bandoulire.
J'aperois mal mon collgue! murmura l'agha, dress entre ses compagnons, qui s'taient
immobiliss sur une centaine de mtres.
Dans les calches, les femmes s'agitaient, voyeuses invisibles. Puisqu'on parlait de fantasia
imminente, elles firent entendre un long premier cri collectif, you-you multipli, comme un
pro-logue de la fte. Presque au mme moment, un claquement de fusil se perdit dans la
fort strie des clameurs. Quelqu'un cria qu'ils devenaient foule par-derrire. L'agha
M'hamed, toujours isol, fit faire son cheval quelques pas sur le ct ; il se rapprochait
d'instinct du palanquin. Il cherchait toujours des yeux l'agha des Sbah qui, s'il tait confondu
avec ses spahis, pouvait, cette distance, hler au moins son collgue. Si M'hamed
s'inquita soudain, la fois pour sa fille et sa bru.
Coups de feu, cran de poussire persistant, clats dans le brouillard soulev. Une voix
d'homme exhala un gmissement, puis un cri de rage :
Trahison! Trahison!
De la vague des arrivants, une clameur, confuse et informe, se scinda en exclamation
dchire dix fois puis la foule trembla comme champ de bl couch sous l'orage :
Mohamed ben Abdallah !
Mohamed ben Abdallah !
L'agha Si M'hamed comprit enfin; dj prs de lui, un premier, un second homme tombaient
sous le claquement maintenant ininterrompu des carabines.
Trahison! Trahison! rptrent des voix affoles, dans le brouhaha et le dsordre.
C'tait hlas le Chrif Bou Maza, avec ses hommes! Certains arrivants, dans un rire
sau-vage, rejetrent thtralement la veste de spahis dont ils s'taient demi vtus, par ruse
de guerre.
Ils ont tu mon ami l'agha Mohamed et sa garde! Ils se sont dguiss de leurs dpouilles
pour s'approcher de nous. De nous trois, Bel Kas- sem, Mohamed et moi, il ne reste plus que
moi, et je vais mourir! pensa rapidement l'agha qui seul avait gard son fusil charg.
Autour de lui, la cohue ; fuite sur l'arrire. Tous les hommes avaient leurs armes charges
blanc. Plus d'une dizaine tombrent au premier choc; quelques autres eurent le temps de se
servir de leurs poignards... L'agha se battait au corps corps avec un homme du Chrif
un Sbah de la rgion dont il reconnut le type pliysn|in- lu mme temps, ses penses se
bousculaient : ne pas quitter le palanquin pour protger les deux jeunes filles, se dfendre
jusqu'au bout pour les tuer tous ou presque; aucune haine ne l'habitait, mais comme un voile
de surprise blanche l'enveloppait. Son premier rival, touch, recula ; l'agha se trouva face
deux, puis trois ennemis ligus contre lui. Il ne voyait que leurs yeux luisants :
Comment ce diable de Chrif a-t-il pu reve-nir de chez les Flittas, si vite et dans un tel
secret ?
Il s'interrogeait machinalement, tout en se dfendant avec une agilit qu'il savait, la longue,
inutile... Quand il reut sa premire blessure, au flanc droit, sous l'aisselle, il souleva la tte,
dans un sursaut de tout le torse, et il aperut enfin son rival sur une colline, silhouette claire,
un nouveau drapeau carlate tenu droit au-dessus de lui. En aigle dominateur, Bou Maza
surveillait la joute.
A sa seconde blessure, l'agha sut qu'il allait mourir dans cette mle. Quatre ennemis le
har-celaient depuis un moment; l'un d'entre eux, en retrait, surveillait la blessure ouverte.
L'agha tua l'un, blessa le second qui recula, mais revint; le troisime hsita.
Allah est grand ! hurla Si M'hamed en direc-tion du palanquin. Par l'entrebillement des
soie-ries, la face noiraude de la nourrice piait le ter-rible affrontement.
La masse du goum drivait vers l'arrire parce que prive de chef. Certains blesss
s'enfuyaient, poursuivis par Assa ben Djinn et ses soldats. Autour de l'agha ensanglant et
vacillant, plu-sieurs cadavres, la fois d'hommes et de chevaux, formaient dj un
monticule.
L'agha pouvait encore, d'un bond agile, mettre pied terre, tenter de trouver quelque issue.
Il n'y songea pas : Ma fille ! ma bru ! se rptait-il. Il entendait comme de trs loin des
femmes crier, avec des spasmes qu'entrecoupaient les hurle-ments d'hommes des deux
partis. Dans le palan-quin, la multresse, la moiti du corps hors des draperies entrouvertes,
gmissait :
O Allah! O Allah! O sidi Yahia, sidi Abdel- kader!
A la troisime atteinte un poignard plant au-dessus du ventre , l'agha sentit un froid le
pntrer. C'est la fin ! songea-t-il sans tristesse, dans une somnolence soudaine tandis
que le ciel s'largissait devant lui, trs loin, en immense gri-saille bleute.
Sur le ct, toujours loigne, l'image du Chrif immobile lui sembla proche. Or Bou Maza
riait.
Allah est grand! rpta l'agha qu'on dsar-onna enfin et qui tomba d'un coup, du ct du
palanquin dont les rideaux s'ouvrirent.
Mon pre! hurla la fille de l'agha qui, d'un bond, se trouva projete au-dessus de la
victime.
Plaque terre et tout enveloppe de soie verte, la jeune fille croit protger le pre l'agonie
: quatre cavaliers du Chrif la contemplent fasci-ns. En retrait, Assa ben Djinn leva son
bras arm au ciel, dans un geste grandiloquent.
La marie de Mazouna est libre ! s'cria-t-il, sur un ton de parodie.
Longtemps dress au-dessus du champ de la rencontre, Bou Maza s'approcha, le visage
impas-sible. Avant mme de considrer les femmes, il demanda Assa d'une voix douce :
Combien de ces chiens sont morts ?
Ils ont laiss vingt trente des leurs cou-chs. Les femmes sont entre nos mains ; les
autres soldats ont fui ! intervint quelqu'un, tout prs.
Le tratre d'agha a combattu jusqu' la fin. Il faut lui reconnatre le courage ! dclara Assa
ben Djinn et il dsigna ses pieds le corps.
Il fit mine de s'approcher de la fille agrippe au cadavre et qui, cheveux pars, sanglotait. Le
Ch-rif l'arrta d'un geste.
Celle-ci sera pour moi ! allait-il dire.
Il leva alors la tte : Badra, blouissante dans sa parure de noces, sortait majestueusement
du palanquin.
Mohamed ben Abdallah, dit Bou Maza, dit Moul es Saa ou le matre de l'heure , par
les tribus Achaba, Mediouna, Beni Hadjes, Sbah et d'autres aussi belliqueuses du Dahra,
Bou Maza, idole nouvelle de ces montagnes mais aussi terreur des bourgeois de Mazouna,
se tenait dress sur un alezan; les Flittas de l'ouest lui avaient offert ce cheval, aprs l'avoir
enlev deux ans auparavant au vieux Mustapha en personne, le clbre chef des Douars
qu'ils avaient surpris dans un dfil et tu. Bou Maza, sur ce cheval d'un butin glorieux,
admirait Badra sans s'avouer que cette proie l'blouissait.
Elle descendit avec lenteur, le velours de la litire relev par la multresse qui, derrire, se
figeait, yeux exorbits. Badra prsente un visage peine pli sous le diadme qui domine sa
coiffe de moire violette; ses cheveux en deux longues nattes entrelaces de cordelettes de
soie parent son cou dcouvert et tombent dans l'chancrure du corsage que recouvrent des
ranges de sequins... Aprs deux, trois pas d'une dmarche tranquille, Badra s'approche
des cadavres : peine si elle baisse le regard, pour mieux se laisser dvisager par le Chrif.
Ses mules brodes, sa robe de velours meraude, sa ceinture d'or lui enserrant haut la taille,
ses bras soulevant peine un voile de gaze argen-te flottant jusqu' ses reins, chaque
dtail du cos-tume faisait d'elle une apparition irrelle : les cavaliers, derrire Bou Maza,
semblaient sus-pendre leurs souffles.
Assa ben Djinn, sur le ct, prs de la fille de l'agha toujours accroche au corps de son
pre, ironisa seul, mi-voix :
Aprs la hyne, voici la jeune lionne !
Son chef, silencieux, sa main blanche de clerc pose sur le pommeau de cuir damasquin,
fei-gnit de ne pas entendre. Un moment s'coula ; au loin, un cheval hennit; un autre
broncha. Les hommes parurent s'impatienter, mais tous res-taient muets et respectueux.
Assa ben Djin s'approcha de Bou Maza et, cette fois, bien haut :
Les deux filles, avec la servante, nous te les amenons tout l'heure sous la tente,
Seigneur! dclara-t-il.
Les yeux troits et brillants du Chrif ne quit-taient pas la silhouette de Badra. Il tourna enfin
demi la tte vers son lieutenant. Il ne sourit pas. A peine un lger hochement, en signe
d'acquiescement.
D'un mouvement sec, il tourna bride et partit contrler, deux lieues plus loin, si l'autre pige
avait russi : les soldats du goum qui avaient fui, par les gorges de l'oued, avaient trouv
posts l des fantassins Sbah... Le claquement des balles s'tait poursuivi jusque-l. Un
messager venait d'artnoncer que les hommes de l'agha avaient t dcims dans cette
seconde embuscade.
Une heure aprs, Bou Maza se retira sous sa tente, dresse pour la nuit.
Personne ne sut, le lendemain, si les deux vierges ddaignrent le Chrif, quand il prit place
face elles, ou si ce fut lui qui, devant ces proies rvoltes ou fascines, rpugna utiliser
la force.
La fille de l'agha mort, par haine ou par ven-geance, garda, le reste de la journe et toute la
nuit suivante, le poignard de son pre la main. Je me tuerai, ou je te tuerai ! rptait-
elle, avec une fivre d'hallucine, et elle ne se tut mme pas quand Bou Maza fit mine
d'avancer. A peine si les yeux du jeune chef se rtrcirent, peine s'il manifesta un
tonnement muet face ces femelles qui, en dpit ou cause de l'clat de sa victoire, ne
pliaient pas.
La servante, devant la haine convulsive de la fille, reut l'ordre de la faire sortir de la tente.
Elles passrent le reste de la nuit au-dehors : c'tait dbut juillet, quelques jours aprs la
pleine lune. Un feu de bois d'olivier les rchauffa de sa flamme bleutre.
C'est ainsi que Badra demeura seule, cette nuit qui aurait d tre sa nuit de noces, seule
avec le Chrif. Un chacal, de temps autre, hurlait dans les vallons proches. Derrire les
thuyas, un claireur tressautait. La garde tait alors renforce... Mais la lumire des torches
claira sans faiblir la tente du chef. Serrant dans ses bras la fille de l'agha assoupie, la
multresse tendait l'oreille. Pas une voix, pas un bruit tout prs ! Comment un homme
peut-il rsister devant la beaut tincelante de ma petite Badra?... Elle rcita
machinalement des bribes du Coran. Le Chrif est-il un homme ?
A l'aube, l'auvent de la tente blanche fut sou-lev. Bou Maza apparut dans la lueur du
premier jour, mais le halo de la chandelle persistait l'intrieur... Le Chrif cligna les yeux.
La mul-tresse, sans mme s'en rendre compte, se trouva prs de lui. Il fit un signe de tte,
puis s'loigna. La servante entra.
Badra semblait n'avoir pas boug de sa posi-tion, depuis la veille. Statue assise, yeux
ferms, paupires encore bleuies sous le fard, une fine transpiration perlant ses tempes,
dans la moi-teur de l'air... Le poids du diadme , se dit la servante qui se glissa, les
genoux terre.
Alors seulement, perdue de tendresse et d'moi, elle commena d'enlever chaque bijou de
la tte, des oreilles, du cou de la marie : l' aaba aux pendeloques, les chengals en
triangle des oreilles, les multiples colliers de la bessita de Fez, les broches alourdies
d'meraudes, les roses trembleuses de la coiffe. Tous ces bijoux l'ont protge, se dit-
elle, de la convoitise du dsir trop humain... Le Chrif, qu'Allah l'ait en sa garde, n'a pas
daign toucher l'or pour toucher la fille, et la fille...
Badra, la tte et les paules allges, se blottit dans les bras de sa nourrice.
Je suis morte ! soupira-t-elle, je suis morte !
La suivante, aprs avoir couch la pucelle, son-gea que Badra, mortifie, avait pleur... Il a
ddaign la perle la plus rare de Mazouna! se rpta-t-elle.
Dans la matine, un proche du fils du Diable vint annoncer qu'une dlgation de
Mazounis, le cad coulougli en tte, tait arrive et que le Ch-rif les avait reus.
Combien ce chien, fils de chien et valet des Chrtiens t'a-t-il donn comme dot pour ta fille,
toi qui as servi de plus glorieux matres ?
Le cad Ben Kadrouma, tte incline en posi-tion de suppliant, avait d avouer le chiffre :
Tu paieras le double pour reprendre ta fille et retrouver ton honneur !
Chacun des notables avait ensuite discut de la ranon pour chacune des femmes qui
attendaient un peu plus loin. Ddaigneux, le Chrif avait laiss ses lieutenants entrer dans
les palabres.
Ce sont des perfides qui demain, notre premire chute, reviendront nous mordre et
sup-plieront le colonel franais !
Mais comment en vouloir dit quelqu'un des Maures qui de pre en fils, depuis des
gnrations, se laissent pousser seulement par la peur?
Toutes les prisonnires, except Badra et la fille de l'agha, regroupes prs du marabout
Sidi Ben Daoud o, depuis la veille, flottait le drapeau carlate du Chrif, apprirent que la
ranon serait verse dans moins d'une heure : elles allaient tre libres...
Certaines s'taient lacr le visage et le cou, les marquant de griffures sanguinolentes : leur
poux, leur fils taient rests sans spulture sur le champ de bataille. D'autres, qui se
trouvaient tre des parentes de la marie, ne manifestaient ni peur ni chagrin. Impassibles,
elles patientaient, poussant tout au plus des soupirs de lassitude. De temps autre, l'une
d'entre elles chuchotait; la curiosit les tenait haletantes : comment savoir si le Chrif, ou l'un
de ses adjoints redoutables, n'allait pas garder les deux vierges, ou au moins Badra, la plus
belle ?
Bientt le chiffre de la ranon qu'avait verse le cad circula de bouche oreille. Et les
bour-geoises, peine fatigues le wali du marabout avait fait prparer un couscous
acceptable, avec des morceaux de volaille , s'taient mises se rengorger, comme si la
vertu, la beaut prser-ves, plus que les bijoux, avaient un prix estim au poids de l'or!
Le bivouac resta dress pour la seconde nuit. Le Chrif dcida qu'on quitterait le camp
l'aube suivante. Ses claireurs taient revenus peu avant le crpuscule : la nouvelle de sa
victoire avait ter-rifi, racontaient-ils, les garnisons d'El-Asnam, de Miliana, de Tns... Dj
le colonel avait envoy des messagers au gnral de Bourjolly et au chef de la colonne de
Tns. Les Franais allaient s'branler le lendemain, ou dans deux jours au plus tard.
Nous traverserons les Bni Hindjes; de l, nous retournerons chez les Flittas, dclara Bou
Maza.
L'or des bourgeois de Mazouna tait arriv. On avait laiss les citadins passer la nuit dans
l'attente, avec leur trsor.
Nous ne sommes ni des pillards, ni des cou-peurs de route et la justice de Dieu peut
attendre !
Le lieutenant Ben Henni, chef des tribus voi-sines de Tns, arriva, confirmant que les
Maures du vieux Tns, comme Mazouna, ne parlaient que de la rapparition du Chrif.
Les deux mos-ques importantes avaient rsonn de prires vibrantes! Tantt la peur, tantt
l'enthousiasme retrouv de la foi secouait ces cits dchues.
Le saint Sid Ahmed ben Youssef avait bien eu raison de se moquer d'elles par ses dictons
clbres ! murmura quelqu'un, prs du Chrif qui ne sourit pas.
Assa ben Djinn se pencha vers lui :
Seigneur, voici l'heure de rendre les femmes. Mes hommes ont compt les douros de la
ranon. Tout est l!... Tu as de quoi lever le double de troupes dans les tribus fidles, jusqu'
Mostaganem; peut-tre mme pourras-tu faire jonction avec l'mir !
Le Chrif, de sa voix basse, intervint :
On dit justement que son messager, porteur d'une lettre, approche!... Occupe-toi des
femmes!
(Puis, aprs un silence :) Gardons la fille de l'agha ! Elle ne cesse d'insulter : que le sang de
la pucelle continue celui du pre!... Je te la donne!
Assa inclina la tte, sans autre manifestation devant le prsent qui lui tait ainsi fait. Puis :
Une suggestion, commena-t-il. Rends les femmes et les filles des Mazounis sans leurs
bijoux!... Ceux-ci valent autant que l'argent apport !
Et il clata de rire.
On t'appelle fils du diable , rpliqua, en souriant, le Chrif. Agis avec elles comme tu
l'entends. Je te laisse ce nouveau butin !
Les prisonnires sortirent l'une aprs l'autre, chacune enveloppe d'un voile de couleur ou
d'un blanc pass. Elles se prsentrent devant Assa ben Djinn entour de quatre de ses
hommes. Un chaouch, dans ses habits d'apparat, attendait sans armes.
Chacune de vous doit se dpouiller de tous ses bijoux et les remettre au chaouch! Si l'une
hsite, ou fait l'avare, ce sera ses vtements que je lui arracherais de ma main! annona
d'une voix de stentor Assa.
Il y eut des cris, un moi peine domin, une piaillerie de foule jacassante. Quand l'un des
hommes de Assa ben Djinn, levant haut son fusil, tira plusieurs coups en l'air, un silence
s'abattit soudain.
Le chaouch, son turban carlate tombant sur le front, ses moustaches vnrables encadrant
son sourire, s'assit en tailleur et attendit, dans une posture caricaturale de cadi.
Des brigands, des coupeurs de route! siffla l'une des femmes.
Et les autres, aussitt, de protester :
Malheureuse, retiens ta langue, veux-tu nous assassiner?
Chaque dame, face et corps dissimuls, s'avan-ait, forme lente et solennelle. Une main
surgis-sait de dessous le pan color, laissait tomber un diadme, des broches, une paire de
khalkhal, trois, quatre ou cinq bagues... La seconde suivait peu aprs; le dcompte s'tait
organis. Un khodja inscrivait sur une planche le nombre et la nature des bijoux.
L'opration de dpouillement dura plus d'une heure. Le Chrif, mont sur son alezan, allait et
venait un peu plus loin...
Soudain, un brusque suspens, un arrt inter-vint : de la tente du chef, sortait la marie, le
visage dcouvert. Elle portait avec ostentation tous ses bijoux. Ses mains runies
prsentaient le diadme. Elle arrivait la dernire, d'une dmarche raide. Elle semblait porter
elle seule tous les bijoux de la ville : Elle, la source de nos malheurs ! s'exclama l'une
des martres.
Badra s'approcha les yeux baisss, comme si elle connaissait le trajet. Sa nourrice, qui
suivait, pleurait : n'y aurait-il jamais de noces pour la jeune fille?... Le Chrif, qui allait
s'loigner, s'immobilisa, dominant la scne bariole, tandis que, derrire la haie de cactus,
l'aube se dissipait.
Badra hsita devant Assa ben Djinn qui n'osa aucun commentaire ; les yeux admiratifs, il
deve-nait, son tour, spectateur impassible.
D'un geste ample, comme elle l'aurait fait dans sa chambre nuptiale, elle dposa son
diadme, puis ses boucles trop lourdes, puis les quatre, cinq, six colliers de perles, puis les
broches, une dizaine au moins, puis... Allah! Allah! soupi-rait le chaouch, qui demanda
une autre caisse. Le scribe, les yeux blouis autant par la splendeur des bijoux que par
l'clat de la marie elle-mme, oubliait d'inscrire le dcompte.
La jeune fille n'eut plus sur elle que sa robe lgre aux plis relchs et que son gilet aux
amples manches de gaze. D'un mouvement bref, elle ta, pour le dposer avec les autres
bijoux, le bonnet brod d'or et de forme conique libre, son paisse chevelure auburn
ruissela dans son dos. Puis, se baissant prestement, elle retira ses mules de velours vert,
galement brodes d'or. Reprenant le mme mouvement de ballerine, plus souplement
encore, elle fit glisser sur ses hanches la ceinture de lourds sequins. Puis se pliant de
nouveau, elle saisit ses anneaux de cheville pour les offrir, comme furtivement, au chaouch
bahi. On entendit alors un bruit de sabots. Bou Maza s'loignait sur son cheval.
Cela suffit, Allah est grand ! s'exclama Assa, les yeux brillants car il ne se rassasiait pas
du spectacle.
Cela suffit ! hurla une voix de femme perdue dans le groupe des captives.
Va-t-elle se mettre nue? ajouta une autre sur le devant. Alors, le ppiement collectif fusa,
hostile.
En deux enjambes, la nourrice fut l. Elle entoura de ses bras la frle adolescente,
enveloppe de sa robe meraude, les cheveux au vent, le visage lev au ciel et qui rptait
tout bas comme pour elle seule :
Je suis nue! Louange Dieu, je suis nue! Louange...
La multresse, avec des gestes de douceur maternelle, fit peu peu entrer son enfant
puise dans le groupe murmurant des prisonnires.
Aucune ne demanda des nouvelles de la seconde vierge, la fille de l'agha mort. La tente du
Chrif avait t leve. Sa colonne partit la pre-mire, drapeau en tte, l'orchestre de fltistes
et de tambours grenant une musique aigre. Les hommes de Assa ben Djinn, leurs mulets
alourdis par les bijoux et par la charge de la ranon, fer-maient la marche.
Quinze jours plus tard, le colonel de Saint-Arnaud, aprs avoir enfum une fraction de
Sbah, non loin des grottes de Nacmaria, finit par rencontrer la troupe de Bou Maza qui
tentait d'viter, pour un temps, le combat.
Trsor et smala furent pris et Canrobert, adjoint de Saint-Arnaud, dispersa les
partisans... La fille de l'agha, prisonnire du Chrif (parta-geait-elle sa tente, pour continuer
le narguer et l'insulter, nul ne savait), disparut dans le branle- bas de la rencontre. Deux
jours aprs, son frre qui guidait les spahis de Canrobert passa sous un arbre.
Mon frre, Ali, mon frre ! soupira une voix craintive.
Le fils de l'agha s'arrta sous une branche du chne. Une forme menue sauta de l'arbre et
atter-rit directement sur la selle du jeune homme stu-pfait.
Je me cache l depuis deux jours ! murmura la jeune fille, aprs les embrassades.
La colonne franaise, en rentrant Tns, rap-porta le miracle des retrouvailles du frre et
de la sur... Mais, au march de Mazouna les meddahs racontaient au peuple comment le
Sultan, annonc par les prophties, avait rendu nues les femmes et les filles des perfides
et de leurs allis. Mohamed ben Kadrouma, aprs avoir vendu ses biens et rpudi ses deux
pouses, dcida d'entreprendre le plerinage de La Mecque, en compagnie de sa fille.
Au retour, annona-t-il quelques-uns de ses proches, je ne reviendrai pas dans cette cit
qui ne sera plus libre ! J'irai m'exiler, comme tant d'autres, Tunis, Damas, ou mme
Istamboul.
L'anne prcdant ces vnements, un ancien lieutenant de Napolon Ier devenu plus tard
agri-culteur et que ruinrent, vers 1840, deux crues successives du Rhne, vint en Algrie.
Brard c'est son nom choisit de s'installer comme colon dans le nouveau Tns.
L'arme de Bugeaud construisait les maisons de ce village avec des planches, remplaces
plus tard par les pierres des imposantes ruines romaines.
Brard renonce vite l'agriculture. Il se met vendre du papier, des crayons et des cahiers;
il ouvre mme un cabinet de lecture. L'insurrection du Dahra clate, avec toutes ses
pripties, y compris la noce de Mazouna que Bou Maza transforme en guet-apens.
Le libraire Brard, grce son exprience d'ancien soldat de l'Empire, mais grce aussi
son instruction et ses cheveux grisonnants, est devenu un notable du Tns europen,
troubl par cette agitation si proche. Il dirige une des milices mises sur pied... Vingt ans plus
tard, il crira le rcit de cette rvolte : mais il n'ira jamais Mazouna. Aucun Europen ne s'y
hasarde encore ; la neutralit de la vieille cit s'est gele en dfinitif sommeil.
Un des lieutenants de Bou Maza, El Gobbi, a crit galement sa relation des vnements.
Fai-sait-il partie de l'attaque contre le convoi de noces ? Admira-t-il, aux cts de son chef, le
corps nu de Badra ? Il est loisible de l'imaginer.
Brard, quand il rdige ses souvenirs, affirme avoir eu connaissance de la relation d'El
Gobbi. Aurait-il lu une traduction du texte arabe ou aurait-il eu entre les mains une copie de
l'origi-nal ? Celui-ci, pour l'instant, est perdu.
Tout finit par dormir; les corps des femmes crases de bijoux, les cits au pass trop lourd,
comme les inscriptions des tmoins qu'on oublie.
III
A Paris, dans le petit appartement d'un libraire en chambre, le couple emmnagea pour
clbrer la noce.
Jours de prparatifs quelque peu irrels. Il semblait que la fte approchait du cur d'un
insi-dieux dsastre et l'on se demandait si les invits et les maris eux-mmes ne seraient
pas empchs au dernier moment...
La future pouse circulait dans les chambres obscures, aux multiples bibliothques. Elle
rece-vait sa mre, une femme de moins de quarante ans, svelte, une lourde tresse de
cheveux noirs balanant dans le dos ; celle-ci tait arrive par un avion de nuit,
accompagne de sa dernire fille, peine sortie de l'enfance. Les trois femmes avaient fait
un mnage mthodique, puis la mre et la fiance allrent acheter, en une fois, dans les
Grands Magasins, un semblant de trousseau; de la lingerie, un ensemble pied-de-poule bleu
ciel, une paire de chaussures.
La date du mariage avait t fixe un mois auparavant par le fianc qui, oblig de vivre
clan-destinement, dmnageait de logis en logis : la jeune fille, installe dans une pension
d'tu-diantes, s'informait chaque fois du nouveau gte ;
la scurit tait ainsi provisoirement assure. Ce mange dura une anne environ.
L'une des prcdentes demeures faisait face un tablissement de sourds-muets. Il avait
fallu l'abandonner en catastrophe. La concierge tait une courtaude chevele; chaque soir,
dans la cour, elle se rpandait en chapelets d'obscnits par impuissance devant la
saoulerie quotidienne de son poux. Un jour, elle rabroua deux policiers venus enquter sur
le jeune tudiant. Elle les congdia sans hsitation :
Voil belle lurette qu'il n'est plus l, cet oiseau !
Les agents partis, elle monta prvenir en hte le couple, parce que, de nature, affirmait-
elle, je n'aime pas les flics !
L'enqute policire sur le jeune homme avait commenc pour une raison banale : le sursis
du service militaire, dont il bnficiait auparavant, lui avait t supprim. Ses vieux parents,
dans leur bourg de montagne, secou par de frquents attentats et par les ratissages qui s'y
succdaient, alertrent leur fils : ils avaient d donner l'adresse parisienne qu'ils espraient
prime :
Il ne m'crit plus ! avait affirm le pre aux enquteurs. Il doit travailler en France pour
pour-suivre ses tudes. Nous sommes pauvres. Je ne peux lui envoyer nul argent !
Il avait dict ensuite sa fillette d'une douzaine d'annes :
cris : ils parviendront jusqu' toi ! Dmnage !
Le fils n'avait pu quitter les lieux assez vite. D'o l'alarme. Cet t-l, une fraction rivale
natio-naliste qui disputait l'organisation unifie l'adhsion de vieux militants (ouvriers se
retrou-vant dans des cafs nord-africains d'avant-guerre) avait multipli ses menaces de
vendetta. Le pre-mier heurt, entre rseaux rivaux et galement clandestins, s'tait sold par
cinq ou six morts dans un restaurant du centre de Paris. Les quotidiens grand tirage en
avaient parl comme d'un rglement de comptes entre gangsters.
Le couple, dans les promenades qu'il se rser-vait encore errances bavardes hors du
temps des autres et de la Rvolution , comme si, n'ayant pas droit aux majuscules de
l'histoire quand ils s'enlaaient sous les porches, leur bon-heur participait cependant de la
fivre collective , le couple se prmunissait certes contre la fila-ture de la police. Mais ce
dernier pril ne parais-sait pas le plus dangereux.
Il fallait, devant une silhouette persistante ou au contraire trop fuyante, djouer la
surveillance, reprer et dcourager le guetteur : le couple savait que la lutte fratricide pointait
l, grinante, sans repres... Ces rseaux concurrents s'envoyaient, par la poste, des lettres
de menace aux termes paroxystiques, aux condamnations dfinitives, au nom d'un droit
fantme, comme le ferait, auprs de sa rivale, par dsespoir d'amour, une femme dlaisse.
La jeune fille, dans ce Paris o ses yeux vi-taient d'instinct, chaque carrefour, le rouge du
drapeau tricolore (qui lui rappelait le sang de ses compatriotes guillotins dernirement dans
une prison lyonnaise), la jeune fille s'imaginait navi-guer. Il lui semblait que leur couple
disparaissait aux yeux des autres, invisible soudain malgr le ruissellement de lumire, en ce
dbut de printemps.
Il fallait partir : leurs conversations s'alimen-taient de ce thme. Partir ensemble! Retourner
au pays pour retrouver, dans la montagne fami-lire, des maquisards insouciants comme
eux. Or le jeune homme renclait : Ce n'est pas la ra-lit, tu rves ! Il n'y aura pas
d'tudiantes, comme tu le crois ! Nous ne pourrons combattre ensemble... Les seules
femmes dans l'arme de rsistance, ce sont des paysannes habitues aux forts et aux
ronces ! Peut-tre, tout au plus, quel-ques infirmires ! Elle ne comprenait pas pour-quoi il
lui refusait l'accs ce jardin : l'aventure, pour elle, ne pouvait tre que gmelle et pour
cela vcue dans l'allgresse... N'avaient-ils pas sem la veille deux policiers, dans des
couloirs de mtro, avec une aisance toute sportive, un rire inextinguible les secouant
ensuite?...
A force de se mesurer dans ce dsaccord, qu'elle croyait seulement de tactique, ils
dcidrent d'un compromis : dfaut d'un dpart immdiat vers leur pays, autant passer la
frontire au plus tt, mme clandestinement ou sparment (seul le nom du jeune homme
tait sur la liste des sus-pects). Ils se retrouveraient en Tunisie, parmi des rfugis : de l
partaient, sans doute aisment, des masses de volontaires pour les maquis. Elle persistait
croire que l'enrlement s'ouvrait aux filles, les responsables nationalistes n'affirmaient- ils
pas volontiers l'galit de tous devant la lutte ?
Les discussions, les projets dvelopper n'pui-saient pas le rythme des marches.
Esquissant cet avenir, le fianc dcida de leur mariage : le hter au plus vite; partir aprs...
Au printemps prcdent, chez eux, les reprsen-tants des deux familles s'taient rencontrs,
mal-gr l'absence des promis. Journe de fianailles officielles, leur avait-on crit ensuite : la
crmo-nie avait permis de rdiger l'acte de mariage l'avance . L'oncle du mari avait
sign par pro-curation ; quant la marie, elle aurait eu besoin, mme prsente, de son pre
comme tuteur. Mariage lgalis, en dpit de leur loignement : ils avaient ri de ce
formalisme, qui semblait un procd de comdie.
cris ta famille, demanda soudain le fianc, dans une lance de dsir, ou d'inquitude
qu'il ne s'avouait pas. Dis-leur que nous nous marions dans un mois, jour pour jour! Aprs
tout, selon la loi, nous le sommes dj !
Cet appartement de libraire celui d'un Fran-ais dtenu depuis des mois pour avoir aid
un rseau nationaliste tait vide depuis l'arresta-tion de son propritaire, et pour cela, la
police ne le surveillait plus. Un ami sorti de prison le leur signala.
Ils optrent pour cette transitoire installation. Les jours prcdant la noce, la future pouse
s'absorbait dans la lecture de livres rares, aux reliures luxueuses, aprs avoir tent d'allumer
le vieux pole coke : ces matins d'hiver, les pices s'emplissaient d'une fume qui ne
rchauffait mme pas.
La mre et la jeune sur de la marie arrivrent donc, pas tout fait dpayses. Le frre,
encore adolescent, qui s'tait fait arrter en Lorraine comme agitateur , amorait une
dten-tion trop souvent dplace de prison en prison : la mre avait appris voyager par
train, par avion, par bateau, tout comme une touriste occidentale et, chaque trimestre, elle
rendait visite son fils unique en toute ville de France et de Navarre o on le relguait.
Les femmes se consacrrent la remise en tat de l'appartement parisien : cirer le parquet,
redonner la cuisine un aspect propret, prparer pour les maris une literie neuve qui fut
livre in extremis, penser enfin au repas traditionnel pour le lendemain des noces la mre
trouvait ce rite indispensable, elle invitait la dizaine d'amis et de cousins, tudiants et
ouvriers immigrs Paris...
Devant la vivacit et les dambulations de sa jeune mre, la marie se voyait figurante d'un
jeu aux rgles secrtes. Elle voquait tout haut le pro-tocole de leur cit qui, de ce lieu d'exil,
leur sem-blait soudain engloutie ou dtruite. Le danger qui se resserrait sur le fianc, dont
les alles et venues pour les runions politiques se multipliaient, lais-sait planer des doutes
sur la crmonie du lende-main. Quelle crmonie?
La jeune fille s'aperut qu'elle souffrait de l'absence du pre certes, si la noce avait t
clbre dans les formes habituelles, elle aurait rassembl une foule exclusivement
fminine.
Mais la tradition exigeait que le pre, au moment o les femmes du cortge nuptial
emmnent la marie, enveloppe sa fille de son burnous et lui fasse franchir le seuil dans ses
bras. La mre, cette seconde de rupture, pleure abondamment, quelquefois bruyamment;
on croirait un deuil sans liturgie. Dans ce trouble soulign par les clameurs des musiciennes
et des voisines, toute mre dplore qu'on lui enlve ainsi son appui pour les lassitudes
venir. Mais elle languit aussi du souvenir ressuscit de ses rves de femme...
Ma mre, elle, se trouvait dans un Paris d'hiver et elle n'avait pas pleurer. Mme si la noce
avait eu lieu l-bas, dans la demeure aux terrasses mul-tiples de la grand-mre morte,
mme si le tnor andalou avait accompagn de sa voix attendrie le chant du rebec, une nuit
entire nuit de la dfloration et de son moi lent , mon pre n'aurait emprunt aucun
burnous de pure laine, tiss par les femmes de la tribu, pour m'enlacer et me faire franchir le
seuil. Il n'aurait pas sacrifi au protocole : il se voulait moderniste , ddai-gnait les modes
rcentes comme l'tau des cou-tumes citadines. Les vieilles auraient eu beau insister,
prtendre qu'il devait se soucier de la protection divine, il aurait... Mais quoi, pourquoi
chercher, aurait-il seulement fait face au fianc qui, toutes ces annes de promesses
secrtes, puis officielles, s'imaginait lui avoir vol son ane ?
C'tait vrit : le mariage se droulait hors de la protection du pre, non qu'il me la refust
dans la forme souhaite par les aeules. C'tait vrit : ces deux hommes n'auraient pu
s'affronter dans cette ambigut, aucun d'eux ne voulant cder le pas l'autre, probablement
chacun hassant l'autre et ne le sachant pas encore.
Dans un Paris o les franges de l'insoumission frlaient ce logis provisoire des noces, je me
lais-sais ainsi envahir par le souvenir du pre : je dci-dai de lui envoyer, par tlgramme,
l'assurance crmonieuse de mon amour. J'ai oubli l'exacte formulation du pli postal : Je
pense d'abord toi en cette date importante. Et je t'aime.
Peut-tre me fallait-il le proclamer : je t'aime- en-la-langue franaise , ouvertement et
sans ncessit, avant de risquer de le clamer dans le noir et en quelle langue, durant ces
heures prc-dant le passage nuptial ?
Ces pousailles se dpouillaient sans relche : de la stridence des voix fminines, du
brouhaha de la foule emmitoufle, de l'odeur des victuailles en excs tumulte entretenu
pour que la marie, seule et nue au cur de la houle, puisse s'emplir du deuil de la vie qui
s'annonce...
Le mariage signifiait d'abord pour moi dpart : frontires franchir la hte, conspirateurs
nouveaux retrouver sur une autre terre. L'arrive de ma mre et de ma sur si jeune me
reliait aux souvenirs lents du pass. Ces deux femmes deve-naient porteuses d'une gravit
sous-jacente : au creux de chaque silence partag, nous n'avions garde, toutes trois,
d'oublier l'adolescent mur dans des prisons successives, mon frre.
Et j'en viens prcautionneusement au cri de la dfloration, les parages de l'enfance voqus
dans ce parcours de symboles. Plus de vingt ans aprs, le cri semble fuser de la veille :
signe ni de dou-leur, ni d'blouissement... Vol de la voix dsosse, prsence d'yeux graves
qui s'ouvrent dans un vide tournoyant et prennent le temps de comprendre.
Un cri sans la fantasia qui, dans toutes les noces, mme en l'absence de chevaux
capara-onns et de cavaliers rutilants, aurait pu s'envo-ler. Le cri affin, allg en libration
htive, puis abruptement cass. Long, infini premier cri du corps vivant.
Le jeune homme l'avait toujours su : lorsqu'il franchirait le seuil de la chambre conque
d'amour transcendental , il se sentirait saisi d'une gravit silencieuse et, avant de se
tourner vers la vierge immobile, il devrait se livrer des dvotions religieuses.
Corps pli, prostern, cras au sol, cur empli d'Allah, du Prophte et du saint le plus
familier sa rgion ou sa tribu, s'assouvissant de la parole sacre, l'homme, tout homme
devait se recueillir, en crature soumise et, seulement aprs, s'appro-cher de la couche qui
s'ensanglanterait.
Sourire des yeux plats de la pucelle. Comment transformer ce sang en clat d'espoir, sans
qu'il se mette souiller les deux corps ? Approche quasi mystique. Dans ces noces
parisiennes, envahies de la nostalgie du sol natal, voici que, sitt entr dans la pice au lit
neuf, la lampe rougetre pose mme le sol, le mari se dirige vers celle qui l'attend,
voici qu'il la regarde et qu'il oublie.
Des heures aprs, allong contre celle qui fr-mit encore, il se souvient du crmonial
nglig. Lui qui n'avait jamais pri, il avait dcid de le faire au moins cette fois au bord des
pousailles. Un pressentiment le tourmente :
Notre union ne sera pas prserve, murmure-t-il.
L'pouse, amuse par cette tristesse supersti-tieuse, le rassure. Elle dpeint l'avenir de leur
amour avec confiance ; il avait promis que l'initia-tion prendrait autant de nuits qu'il le
faudrait. Or, ds le dbut de cette nuit htive, il pntrait la pucelle.
Le cri, douleur pure, s'est charg de surprise en son trfonds. Sa courbe se dveloppe.
Trace d'un dard corch, il se dresse dans l'espace ; il emma-gasine en son nadir les
nappes d'un non int-rieur.
Ai-je russi un jour, dans une houle, atteindre cette crte? Ai-je retrouv la vibration de ce
refus ? Dans cette ore, le corps se cabre, il coule son ardeur dans le cours du fleuve qui
passe. Qu'importe si l'me fuse alors, irrpressiblement ?
Dire aussi ma victoire, son got de douceur vanouie, dans les lames de l'instant. Victoire
sur la pudeur, sur la retenue. Rougissante mais volontaire, j'ai russi dire devant la jeune
mre, et la sur, la tendresse qui rassure :
Laissez-moi la maison seule pour cette nuit, s'il vous plat!... Il vous emmnera dormir
l'htel !
J'ai formul ce souhait sur un ton convention-nel... Puisque le destin ne me rservait pas des
noces de bruits, de foule et de victuailles, que me ft offert un dsert des lieux o la nuit
s'talerait assez vaste, assez vide, pour me retrouver face lui j'voquai soudain
l'homme la manire traditionnelle.
Ce cri, dans la maison de la clandestinit. Je gotai ma victoire, puisque la demeure ne
s'emplit pas de curieuses, de voyeuses, puisqu'une femme et une fillette s'loignant
momentan-ment, le cri droula les volutes du refus et parvint jusqu'aux linteaux du plafond.
La lampe ne s'teint pas... Le mari, que la police recherche, s'embourbe dans sa dception
: il s'tait promis de faire sa prire avant.
Avant quoi? Pens-je en titubant dans le couloir, algazelle atteinte tandis que j'vite les
miroirs.
Avant le cri, bien sr. Non, me dis-je, ni Dieu, ni quelque formule magique ne protgeront cet
amour que l'homme espre jusqu' la mort . Circulant dans le mtro, les jours suivants, je
dvisage d'un regard avide les femmes, toutes les femmes. Une curiosit de primitive me
dvore :
Pourquoi ne disent-elles pas, pourquoi pas une ne le dira, pourquoi chacune le cache :
l'amour, c'est le cri, la douleur qui persiste et qui s'alimente, tandis que s'entrevoit l'horizon
de bonheur. Le sang une fois coul, s'installe une pleur des choses, une glaire, un silence.
Il n'y a pas eu les yeux des voyeuses rvant de viol renouvel.
Il n'y a pas eu la danse de la mgre pare du drap macul, ses rires, son grognement, sa
gesti-culation de Garaguz de foire signes de la mort gele dans l'amour, corps fich l-
bas sur des monceaux de matelas... L'pouse d'ordinaire ni ne crie, ni ne pleure : paupires
ouvertes, elle gt en victime sur la couche, aprs le dpart du mle qui fuit l'odeur du sperme
et les parfums de l'idole; et les cuisses refermes enserrent la clameur.
Il n'y a pas eu le sang expos les jours suivants.
SISTRE
Long silence, nuits chevauches, spirales dans la gorge. Rles, ruisseaux de sons
prcipices, sources d'chos entrecroiss, cataractes de murmures, chu-chotements en taillis
tresss, surgeons susurrant sous la langue, chuintements, et souque la voix courbe qui,
dans la soute de sa mmoire, retrouve souffles souills de solerie ancienne.
Rles de cymbale qui rencle, cirse ou ciseaux de cette tessiture, tessons de soupirs
naufrags, clapo-tis qui glissent contre les courtines du lit, rires pars striant l'ombre
claustrale, plaintes tidies puis diffractes sous les paupires closes dont le rve s'gare
dans quelque cyprire, et le navire des dsirs cule, avant que craille l'oiseau de volupt.
Mots coulis, tisons dlits, diorites expulss des lvres bantes, brandons de caresses
quand s'boule le plomb d'une mutit brutale, et le corps recherche sa voix, comme une plie
remontant l'estuaire.
De nouveau rles, escaliers d'eau jusqu'au larynx, claboussures, aspersion lustrale, sourd
la plainte puis le chant long, le chant lent de la voix femelle luxuriante enveloppe
l'accouplement, en suit le rythme et les figures, s'exhale en oxygne, dans la chambre et le
noir, torsade tumescente de forte rests suspendus.
Soufflerie souffreteuse ou solennelle du temps d'amour, soufrire de quelle attente, fivre
des staccato.
Silence rempart autour de la fortification du plaisir, et de sa digraphie.
Cration chaque nuit. Or broch du silence.
TROISIME PARTIE
LES VOIX ENSEVELIES
Sur ce, me voici en la mmoire, en ses terrains, en ses vastes entrepts ...
Saint Augustin Confessions, X. 8.
Quasi una fantasia... Ludwig van Beethoven opus 27 sonates 1 et 2.
PREMIER MOUVEMENT
LES DEUX INCONNUS
Deux trangers se sont approchs de moi au plus prs, jusqu' me sembler, durant quelques
secondes, de mon sang : ce ne fut ni au cours d'un change d'ides, ni dans un dialogue de
respect ou d'amiti. Deux inconnus m'ont frle, chaque fois dans l'clat d'un cri, peu importe
que ce ft l'un ou l'autre, ou que ce ft moi qui le poussai.
J'ai dix-sept ans. Ce matin-l, il fait soleil sur la ville bourdonnante. Je surgis dans une rue
qui dgringole jusqu' l'horizon ; partout, au bout des artres comme au fond des venelles,
c'est la mer qui attend, spectatrice. Je me prcipite.
Aprs une querelle banale d'amoureux que je transforme en dfi, que je lance en rvolte
dans l'espace, une secrte dchirure s'tire, la pre-mire... Mes yeux cherchent au loin; une
pousse trange propulse mon corps, je crois tout quitter, je cours, je dsire m'envoler. Il fait
soleil sur la ville bourdonnante, la ville des autres...
Fivre, impatience, dlire d'absolu ; je dvale la rue. Alors que je n'ai rien formul, sans
doute rien projet, sinon cet lan dans sa puret seule, mon corps se jette sous un tramway
qui a dbouch dans un virage brusque de l'avenue.
Suis-je dans un quartier du port? Quand je m'anantis dans cet envol vers la mer, cette
plon-ge dans l'oubli, une image ultime se dresse : des mts de navire, entr'aperus comme
dans une immense aquarelle, trouant l'azur. Juste avant le noir, la double raie des rails au
sol devient mon lit.
Lorsqu'on me releva, quelques minutes plus tard, de l'ombre de la tragdie d'o lentement je
resurgis, j'entendis, dans le brouhaha de la foule des badauds assembls, une voix isole,
celle du conducteur qui avait pu freiner de justesse la machine. Dans le vide dlav de cette
nouvelle naissance, un dtail prit une importance excep-tionnelle. Me frappa l'accent de
petit Blanc de l'homme qui, boulevers, rptait :
Ma main en tremble encore, regardez ! et il cria.
Il redit la phrase, la clamant presque, et sa voix derechef vibra. J'ai ouvert grand les yeux.
Encore tendue sur la chausse, j'ai aperu la masse de l'homme, puis son visage pench
vers moi : la foule avait d le laisser s'avancer pour qu'il se ras-sure. Sans doute scruta-t-il la
jeune fille gisante, mais vivante.
Depuis, j'ai tout oubli de l'inconnu, mais le timbre de sa voix, au creux de cette houle,
rsonne encore en moi. moi dfinitivement prsent :
Ma main en tremble encore, disait-il, regar-dez!
Aux tmoins agglutins, il devait montrer sa main qui, en domptant la vitesse du tramway,
me sauva.
On sortit la jeune fille de dessous la machine ; l'ambulance transporta son corps peine
contu-sionn jusqu' l'hpital le plus proche. Plutt tonne elle-mme, comme somnolente
d'tre alle, elle le pensa emphatiquement, jusqu'au bout au bout de quoi, tout au plus
de l'adoles-cence qui vrille. Elle se rveilla donc la voix du conducteur de tramway, sombra
ensuite dans le marasme des jours incertains, reprit enfin le cours de l'histoire d'amour. Ne
parla personne de sa chute crise de lyrisme ou de rvolte sans objet. Dcouvrit-elle
seulement le dsespoir?
Seul cet accent des quartiers populaires euro-pens de la ville, ce parler qui avait fait la voix
du conducteur plus prsente lui resta tellement proche : parure de la mort dont l'aile trane,
un instant, sur le sol.
Longue histoire d'amour convulsif; trop longue. Quinze annes s'coulent, peu importe
l'anecdote. Les annes d'engorgement se bous-culent, le bonheur se vit plat et compact.
Longue dure de la plnitude ; trop longue.
Deux, trois annes suivirent; le malheur se vit plat et compact, failles du temps aride que le
silence hachure...
Une femme sort seule, une nuit, dans Paris. Pour marcher, pour comprendre... Chercher les
mots pour ne plus rver, pour ne plus attendre.
Rue Richelieu, dix heures, onze heures du soir; la nuit d'automne est humide. Comprendre...
O aboutir au bout du tunnel de silence intrieur ? A force d'avancer, de sentir la nervosit
des jambes, le balancement des hanches, la lgret du corps en mouvement, la vie
s'claire et les murs, tous les murs, disparaissent...
Quelqu'un, un inconnu, marche depuis un moment derrire moi. J'entends le pas. Qu'importe
? Je suis seule. Je me sens bien seule, je me perois complte, intacte, comment dire, au
commencement , mais de quoi, au moins de cette prgrination. L'espace est nu, la rue
longue et dserte m'appartient, ma dmarche libre laisse monter le rythme mien, sous le
regard des pierres.
Tandis que la solitude de ces derniers mois se dissout dans l'clat des teintes froides du
paysage nocturne, soudain la voix explose. Libre en flux toutes les scories du pass. Quelle
voix, est-ce ma voix, je la reconnais peine.
Comme un magma, un tourteau sonore, un poussier m'encombre d'abord le palais, puis
s'coule en fleuve rche, hors de ma bouche et, pour ainsi dire, me devance.
Un long, un unique et interminable pleur informe, un prcipit agglutin dans le corps mme
de ma voix d'autrefois, de mon organe gel; cette coule s'exhale, glu anonyme, trane de
dcombres non identifis... Je perois, en tmoin quasi indiffrent, cette charpe curante
de sons : mlasse de rles morts, guano de hoquets et de suffocations, senteurs d'azote de
quel cadavre asphyxi en moi et pourrissant. La voix, ma voix (ou plutt ce qui sort de ma
bouche ouverte, billant comme pour vomir ou chanter quelque opra funbre) ne peut
s'interrompre. Peut-tre faut-il lever le bras, mettre la main devant la face, suspendre ainsi la
perte de ce sang invisible ?
Amoindrir au moins l'intensit ! Les trangers, derrire leurs murs, se recueillent et je ne
suis, moi, qu'une exile errante, chappe d'autres rivages o les femmes se meuvent
fantmes blancs, formes ensevelies la verticale, justement pour ne pas faire ce que je fais
l maintenant, pour ne pas hurler ainsi continment : son de barbare, son de sauvage, rsidu
macabre d'un autre sicle!... Attnuer quelque peu ce rle, le scander en mlope
inopportune. Incantation dans l'exil qui s'tire.
La rue Richelieu se droule longue, troite, dserte. Parvenir au bout et arrter mon pas ;
du mme coup couper cette voix de l'trange, ce lamento qui m'appartient malgr moi.
Derrire, l'inconnu que j'ai oubli suit toujours ; ralentit quand je ralentis, et, lorsque ma voix
oppresse va pour s'adoucir, ou mourir :
Je vous en prie, madame, ne criez pas comme cela! proteste-t-il.
Le cri s'est arrt net. Dans le halo d'un rver-bre, je me retourne, le visage fig : que croit
cet importun, que je souffre ?
Laissez-moi seule, s'il vous plat !
J'ai parl d'un ton presque doux, tonne de l'motion qu'a manifeste l'inconnu. Je ne me
souviens plus de son visage, peine de sa sil-houette, mais sa voix, dans l'urgence de sa
demande, me parvient encore aujourd'hui, chaude, avec une vibration qui en fait palpiter le
grain imperceptiblement. Son moi a driv parce que, dit-il, je crie . Est-ce l que finit le
bourdonnement souterrain de ma rvolte entra-ve?... La raction de cet inconnu, je la
perois soudain en rvlateur, je la reois en couverture tendue. Aucune coute ne peut plus
mcharner.
S'il vous plat ! rpt-je plus bas.
Je recule instinctivement. Une lueur gicle sur la silhouette longue, sur le regard brillant de
l'homme qui me dvisage. Je baisse les yeux. Il s'loigne. Deux corps peine tendus,
proches une seconde l'un de l'autre, dans le bouleversement fugace d'une tristesse
entrecroise. Rve d'enlacement.
D'avoir entendu l'homme supplier, tel un ami, tel un amant, m'exhuma peu aprs de
l'enfouisse-ment. Je me librai de l'amour vorace et de sa ncrose. Rire, danser, marcher
chaque jour. Seul le soleil peut me manquer.
Deux messagers se dressent donc l'entre et la sortie d'une histoire d'amour obscure.
Aucun tranger ne m'aura, de si prs, touche.
VOIX
Mon frre an, Abdelkader, tait mont au maquis, cela faisait quelque temps dj. La
France arriva jusqu' nous, nous habitions la zaouia Sidi M'hamed Aberkane... La France
est venue et elle nous a brls. Nous sommes rests tels quels, parmi les pierres noircies...
Le second de mes frres, Ahmed, partit son tour. J'avais treize ans. De nouveau, les
soldats revinrent; de nouveau, ils nous brlrent. La population nous aida reconstruire. Le
temps passa; une anne peut-tre.
Puis les soldats eurent un accrochage avec des maquisards, sur la route qui traversait la
fort voisine. Ils firent irruption chez nous, le mme jour. Us cherchaient la preuve et ils la
trou-vrent : nous gardions en effet quelques vte-ments des Frres, et mme des balles. Ils
emme-nrent ma mre, ainsi que la femme de mon frre. Ils nous brlrent la maison une
troisime fois.
Alors les Frres sont venus, le soir mme. Ils nous conduisirent plus haut, vers Sidi bou
Amrane. Nous parvnmes dans le douar, avant l'aube. Les maquisards nous cherchaient un
logis et nous tous, nous les suivions : les femmes, mon vieux pre, mes petits frres.
Le peuple de l-bas ne nous accepta pas tout d'abord :
Les soldats vont venir nous brler notre tour! Que ceux-ci ne restent pas chez nous! La
zaouia a brl; notre douar aussi va brler!
Ils protestrent longtemps. Mais Si Slimane et Si Hamid (Si Boualem avait t arrt) tinrent
bon :
Ces gens entreront parmi vous! Tant pis!... Certains d'entre vous ont-ils peur des
cons-quences? Qu'ils aillent se rendre l'ennemi, s'ils prfrent... Ces gens resteront l!
Nous nous sommes donc installs l. Nous avons gard le contact avec les Frres. Tous,
nous avons travaill. De nouveau, la France est monte et a tout brl. C'est alors que le fils
de Hamoud s'est rendu.
La France dcida de faire descendre tout le peuple jusqu' la plaine. Nous, nous sommes
res-ts sur place, avec notre mre qui avait t lib-re. Mon frre Ahmed, que Dieu ait son
me, par-tit de nuit pour nous chercher un autre abri.
Il n'eut pas le temps de revenir et de nous gui-der. Peu avant l'aube, l'ennemi nous
encerclait. Ils proclamrent :
Vous descendrez de force, comme les autres !
Quand des hommes s'approchrent pour me forcer me lever :
Je n'irai pas ! criai-je.
Un soldat me prit par le bras, un second par l'autre; moi, je continuai de crier. Ils m'ont sortie
ainsi de la maison.
Ils nous ont donc emmens. Sur le trajet, il fal-lait franchir un oued. Or, il avait plu la veille.
L'eau tourbillonnait dans le torrent. Un homme souleva ma jeune sur pour traverser. Elle
se dbattit de toutes ses forces :
Ne me porte pas !
L'homme tait un goumier.
Comment cela, nous vous aidons ! s'exclama-t-il, car il croyait rendre service.
J'intervins :
Elle t'a dit de ne pas la toucher, ne la touche pas !
Nous voici ensuite au village, Marceau. Ils nous ont installs dans une sorte de rduit :
ciment sur ciment, des murs aussi gris que le sol... Nous avons d passer la nuit l, dans le
froid et l'urine des enfants.
Le matin, une vieille qui semblait habiter tout prs vint jusqu' la porte pour nous prvenir :
Moi, je vais travailler aux champs! chuchota-t-elle. Demandez sortir, ne restez pas ici !
Nous sommes sortis. Ils nous ont regroups, femmes et enfants d'un ct, les quelques
vieux de l'autre. Ils nous conduisirent aux abords du vil-lage o ils nous installrent des
tentes. L, pen-saient-ils, ils nous surveilleraient mieux.
Quelques jours passrent. Nous guettions la garde, nous reprions l'espacement des
rondes. Il nous fallait bien, pour subsister, aller et venir pour de menus travaux. Quelques
femmes allaient glaner, mais sur la lisire. Les bbs pleu-raient chaque jour. Le peu de
btail et de poules fut vite gorg.
Ceux de la montagne me firent parvenir un message :
Toi, avec l'une de tes surs, reviens ; nous avons besoin de toi, l-haut ! J'ai presque
dans de joie; je serrais les lvres pour retenir les youyou .
Car j'appris aussi que mon jeune frre se cachait non loin de l. Je russis mclipser;
toute une journe, je cherchai comment me gui-der, mais je ne retrouvais plus la route. Je
dus revenir au soir, puise, dcide repartir, cher-cher encore... Deux jours aprs, je
repartis : en vain encore, cette fois. A mon retour, je me trou-vai face ma mre en pleurs :
elle scha en silence son visage en larmes, mais ne me ques-tionna pas.
La troisime fois, j'eus enfin le contact. Ma sur, plus jeune que moi d'un an,
m'accompa-gnait. Mais je me ravisai :
Toi, retourne ! Tu dois retourner !
Je me dis soudain que ma mre allait demeurer seule, avec les tout petits. Qui l'aiderait?...
Je ne compris cela qu' ce moment du vrai dpart. Ma sur m'obit de mauvais gr. Peut-
tre m'en vou-lut-elle par la suite.
J'arrivai, aprs une marche de plusieurs heures avec le guide, chez les maquisards. Mon
frre Ahmed se trouvait parmi eux. Il m'enlaa et il me dit exactement ces mots :
ma sur, puisque je te vois, toi, ma sur, c'est comme si je voyais ma mre !
Je me mis pleurer, je ne sais pourquoi. Je le touchai, heureuse de le sentir en bonne
forme, mais je pleurais...
Nous sommes ds lors rests ensemble, Ahmed et moi. Il y avait, dans ce groupe de
maquisards, d'autres filles un peu plus ges que moi ; deux de Cherchell, Nacra et Malika,
et quelques autres des environs.
Quelque temps aprs, l'un des maquisards se rendit. Il nous ramena l'ennemi. Pas la
premire nuit, mais la seconde. Les soldats nous encer-clrent l'aube.
Hlas! nos veilleurs s'taient endormis, je ne sais comment. Cette mme nuit, mon frre
Ahmed et un autre taient partis rapporter du ravitaillement. En revenant, ils se rendirent
compte de l'approche ennemie. Les voil qui se prcipitent en courant et qui crient :
Sortez ! Sortez vite !
A peine quittions-nous nos abris que les coups de feu s'changrent. Ce matin-l, je me
sentais trs fatigue: je n'ai pu courir aussitt; mes jambes taient comme paralyses, peut-
tre parce que c'tait pour moi la premire alerte...
Cours, mais cours donc! s'exclamait mon frre derrire, qui me poussait presque.
Je ne peux pas! Cours en avant toi le pre-mier ! Va devant !
Cours, ma sur ! suppliait-il en s'en allant et j'ai encore l'accent de sa voix dans l'oreille.
S'ils te tiennent, ils te tortureront !
Il courait devant moi quand il est tomb : une balle l'atteignit l'oreille. Il est tomb devant
moi... Il est tomb sur la face et, dans sa chute, il a mme renvers un garon qui s'est
bless sur la pierre. Mais le garon s'est relev.
Lui et moi, nous avons repris la course ; je sui-vais l'enfant, je connaissais mal encore la
rgion. Les balles volaient autour de nous, notre fuite dura longtemps, je ne voyais que
l'enfant devant moi... Puis je me suis retrouve seule; je conti-nuai le long d'un oued, jusque
vers un bois, au- del des collines. Je me rendis compte alors du silence autour : je
m'arrtai.
Je cherchai me situer. De l o je me trouvais, j'apercevais quelques cabanes. Je me dis :
Cela doit tre Trkech. Je savais que, dans ce douar, les hommes taient avec la
France. Je pris une autre direction, traversai un champ. Je m'abritai dans un bosquet.
J'entendis au loin comme un bruit d'avion. Je me recroquevillai et ne bougeai plus de mon
trou.
De part et d'autre, un peu au-del, deux routes se croisaient. Je vis un moment quelques
uni-formes ; ils disparurent. La toux me prit soudain. J'eus peur qu'on ne me surprt.
J'arrachai des feuilles d'un chne (on dit que c'est bon pour la toux), je les mchai en
silence. Je ne bougeais toujours pas, je dus mme m'assoupir.
La nuit arriva. veille et angoisse, j'entendis un chacal. Le chacal criait... Je sortis, me mis
marcher jusqu' l'une des deux routes, trs pru-demment. Au loin, j'apercevais le feu d'un
incen-die, puis, dans un pr dsert, deux ou trois vaches abandonnes. Je me rchauffai un
instant prs d'elles, puis j'eus peur que quelqu'un ne vienne pour les btes et ne me
dnonce. J'ai prfr continuer le long de la route... D'autres btes, plus loin, semblaient
avoir fui un autre incendie... Comme j'avais froid ! C'tait une nuit d'hiver : il ne pleuvait pas,
mais il restait de la neige dans les fosss, en plaques irrgulires sur les pierres.
Que faire? Dormir par terre, malgr le froid? Mais je serais la merci des sangliers et des
cha-cals. Grimper sur un arbre? Je craignais, en m'endormant, de tomber... Finalement, je
trouvai un chne robuste, au tronc puissant. Je m'instal-lai l, m'agrippai une branche. Je
parvins res-ter ainsi demi endormie, jusqu'au matin. Je me suis fie la protection de
Dieu !
Le jour suivant, je me cachai jusqu'au nouveau crpuscule. Les combats qui avaient repris
se continuaient un peu plus loin. Il me semblait tre devenue un fantme, j'entendais les
gens s'agiter comme dans un autre monde !
J'eus peur que n'arrivent les hlicoptres et qu'ils ne me surprennent. Tout cessa peu peu ;
la guerre s'loigna tel un songe.
Je dus m'endormir d'un coup, de fatigue. Avant la fin de la nuit, peu avant l'aube, j'aperus
des chvres qui sortaient en file, avec un berger der-rire, tranquille, comme si rien ne s'tait
pass, comme si j'avais rv cette longue poursuite. Mon frre, mon frre Ahmed ? me
dis-je avec angoisse.
Je sautai de mon arbre. Le berger s'arrta, fit un signe derrire lui. Quatre hommes surgirent
au loin, qui me parurent des maquisards ; un cin-quime, en arrire, me fit des gestes. Je me
dis : J'ai assez perdu de temps ! Je vais aller voir o est tomb mon frre !
Les hommes m'appelaient, une voix cria mon nom. Mais je courais dj droit devant moi, en
me rptant : Je vais aller voir o est tomb mon frre !
C'est ton frre, ton frre Abdelkader! s'exclama quelqu'un dans ma direction.
Je compris que c'tait mon autre frre, mais moi, je voulais voir mon cadet, celui qui tait
tomb... Je m'lanai, je courais le plus vite pos-sible. Dieu voulut que je me repre aussitt
et que je trouve l'endroit la premire.
Ahmed tait l, couch : l'ennemi l'avait dpouill de ses papiers, des photos qu'il portait sur
lui. On lui avait enlev ses meilleurs habits. De son uniforme de maquisard, ne restait que
son pantalon. Sa vieille chemise en laine, dchire, tait toute macule de sang...
Je vis l'oued pas trs loin. Je tentai de le porter; je ne pus que le traner, ses pieds sans
bottillons laissant un sillon derrire lui... Je voulais le laver, lui mouiller au moins le visage.
J'ai pris de l'eau dans mes paumes : j'ai commenc l'en asperger, comme pour des
ablutions, sans me rendre compte qu'en mme temps je pleurais, je sanglo-tais...
Derrire, mon frre an Abdelkader s'appro-cha, et dit soudain aux autres, d'une voix
col-reuse :
Mais pourquoi lui avoir montr le corps ? Ne voyez-vous pas que c'est une enfant?
Il est tomb devant moi! dis-je en me retournant d'un coup. Devant moi !
Et ma voix chavira.
CLAMEUR..
Les longs cheveux jauntres de la fillette ont d virer d'un coup au rouge flamboyant,
autrefois. Les commres souponneuses avaient qualifi ses yeux verts de yeux de chatte
rdeuse . Larges yeux verts aux prunelles tachetes d'or... Comme la mre avait t fire
de celle qui lui tait venue aprs trois garons!
C'est elle, la bergre de treize ans, la premire fille des Amroune, elle que les cousins, les
voisins, les allis, les oncles paternels accusent de se prendre pour un quatrime mle, en
fuyant le douar et les soldats franais, au lieu de se terrer comme les autres femelles ! Elle a
donc err, elle s'est accroche aux arbres durant la poursuite interminable.
La voici orpheline du frre tomb, dans cette aube de l't immobile; nouvelle Antigone pour
l'adolescent tendu sur l'herbe, elle palpe, de ses doigts rougis au henn, le cadavre demi
dnud.
L'oued, pas tout fait sec, circule dans un creux de ronces et de mousses parfumes. En
contrebas, la source fait entendre son bruissement. A quelques pas, en un cercle irrgulier,
quatre hommes circonspects sont tourns vers un cin-quime, plus trapu, raidi dans son
uniforme : c'est le second frre Amroune. Il halte, il esquisse un geste vers la fille.
Le cadavre dort, face contre terre... La fillette l'a tran elle-mme, peu avant l'arrive des
hommes. Croyant l'amener jusqu' la source, elle a fait halte la premire dnivellation... Le
visage clabouss d'eau ne s'est pas rveill: elle l'a pos de profil contre une pierre.
Ensuite elle s'est tourne, pour protester, ou se convaincre.
Mais il est tomb devant moi ! devant moi !
Elle a rpt sa plainte, la deuxime fois sur un mode plus aigu. Son accent se dchire,
comme si elle dpliait derrire elle le linceul.
Elle a caress lentement la face morte; elle l'a repose contre la pierre du ruisseau. Elle s'est
redresse.
Tout alors a fait silence : la nature, les arbres, les oiseaux (scansion d'un merle proche qui
s'envole). Le vent, dont on devinait la brise ras du sol, s'asphyxie; les cinq hommes se
voient devenir tmoins inutiles, dans le gel de l'attente. Elle seule...
Bergre sortie des franges du songe et de son pou-droiement, elle se sent habite d'une
gravit acre, telle une faux en suspens dans l'tincellement de l'attente.
Elle a entonn un long premier cri, la fillette. Son corps se relve, tache plus claire dans la
clart aveugle; la voix jaillit, hsitante aux premires notes, une voile peine dplie qui
frmirait, au bas d'un mt de misaine. Puis le vol dmarre pr-cautionneusement, la voix
prend du corps dans l'espace, quelle voix ? Celle de la mre que les sol-dats ont torture
sans qu'elle gmisse, des surs trop jeunes, parques mais porteuses de l'angoisse aux
yeux fous, la voix des vieilles du douar qui, bouches bantes, mains dcharnes, paumes en
avant, font face l'horreur du glas qui approche ? Quel murmure inextinguible, quelle
clameur ample, grenele de stridence?... Est-ce la voix de la fillette aux doigts rougis de
henn et de sang fraternel?
Le sang qui fuse a fait reculer, d'un mme pas, les maquisards derrire. Ils savent quoi
accompa-gner dsormais : le hululement rythm des morts non ensevelis qui reviennent,
l'appel des lionnes disparues, que nul chasseur n'a atteintes... Le thrne de l'informe rvolte
dessine son arabesque dans l'azur.
La complainte se fait houle : soubresauts suivis d'un frmissement ; un ruisseau d'absence
creuse l'air. Des barbels se tendent au-dessus de supplices invisibles... Le corps de la
fillette de treize ans se meut alors par soudaine ncessit, va et vient pour scander la
douleur; la bergre prend connaissance du cercle rituel. Du premier cercle autour du premier
mort...
Au-dessus de l'abme, les hommes rivs la regardent : faire face la dure du cri qui tangue,
tel le balancement d'un drap de sang s'gouttant au soleil. Le cadavre, lui, s'en enveloppe,
semble re-trouver sa mmoire : miasmes, odeurs, gargouillis. Il s'inonde de touffeur sonore.
La vibration de la stridulation, le rythme de la dclamation langent ses chairs pour parer
leur dcomposition. Voix- cuirasse qui enveloppe le gisant contre la terre, qui lui redonne
regard au bord de la fosse...
puis, le cri revient en peau qui se ratatine sur le sol. Il dserte la fillette qui se dresse,
interrogative. Elle ne parat pas prostre; peut-tre est-elle plus forte.
Raidi dans son uniforme, le maquisard s'approche; enlace sa sur, lui frle les cheveux.
Elle s'appelle Chrifa. Quand elle entame le rcit, vingt ans aprs, elle n'voque ni
l'inhumation, ni un autre ensevelissement pour le frre gisant dans la rivire
.L'APHASIE AMOUREUSE
J'ai pass chacun de mes ts d'enfance dans la vieille cit maritime, encombre de ruines
romaines qui attirent les touristes. Jeunes filles et femmes de la famille, des maisons
voisines et allies, rendent rgulirement visite quelque sanctuaire... Des groupes
piailleurs se rpandent, ds lors, dans la campagne proche.
Un ou deux garonnets font office de guetteurs vigilants, tandis que nous, les fillettes, nous
nous mlons aux parentes voiles. Soudain, c'est l'alarme :
Un homme approche !
Sous le figuier ou l'olivier, ou contre le bosquet de lentisques, les voiles qui ont gliss sur
l'paule sont remonts vivement sur les chevelures. L'une se remmitoufle, alors qu'elle
arborait ses bijoux sur sa poitrine dcouverte, une autre se relve et veut voir sans tre vue,
une troisime touffe ses rires, agace chaque approche d'un mle.
Le danger se rvle quelquefois sans fonde-ment :
Voyons, remarque l'une, c'est un Franais !
La pudeur habituelle n'est plus ncessaire. Le passant, puisqu'il est Franais, Europen,
chr-tien, s'il regarde, a-t-il vraiment un regard ? Face elles, qui ont mission, leur vie
entire, de prser-ver leur image, de considrer ce devoir comme le legs le plus sacr, face
elles toutes, mes tantes, mes cousines, mes semblables, l'tranger, en s'arrtant, en les
dvisageant, les voit-il lorsqu'il croit les surprendre? Non, il s'imagine les voir...
Le pauvre , commente l'une, quand l'inconnu, tout prs, a lev les yeux, a aperu l'clat
de jais d'une tresse trop longue, la lueur d'yeux fards et moqueurs :
Le pauvre, il s'est troubl !
Car il ne sait pas. Son regard, de l'autre ct de la haie, au-del de l'interdit, ne peut toucher.
Aucune stratgie de sduction ne risque de s'exer-cer; ds lors, pour ces promeneuses d'un
entracte furtif, pourquoi se cacher?
Ainsi de la parole franaise pour moi. La langue trangre me servait, ds l'enfance,
d'embrasure pour le spectacle du monde et de ses richesses. Voici qu'en certaines
circonstances, elle devenait dard point sur ma personne. Qu'un homme se hasardt
qualifier, tout haut et devant moi, mes yeux, mon rire ou mes mains, qu'il me nommt ainsi et
que je l'entendisse, apparaissait le risque d'tre dsaronne ; je n'avais d'abord hte que de
le masquer. Faire sentir par un sursaut, une rai-deur soudaine, une fermeture du regard, qu'il
y avait maldonne, plus, intrusion. Le jeu du compliment banal ou galant ne pouvait se
drouler parce que sans prise.
Dans un second mouvement, je souffrais de l'quivoque : me prserver de la flatterie, ou
faire sentir qu'elle tombait dans le vide, ne relevait ni de la vertu, ni de la rserve pudibonde.
Je dcouvrais que j'tais, moi aussi, femme voile, moins dguise qu'anonyme. Mon corps,
pourtant pareil celui d'une jeune Occidentale, je l'avais cru, malgr l'vidence, invisible ; je
souffrais que cette illusion ne se rvlt point partage.
Le commentaire, anodin ou respectueux, vhi-cul par la langue trangre, traversait une
zone neutralisante de silence... Comment avouer l'tranger, adopt quelquefois en
camarade ou en alli, que les mots ainsi chargs se dsamoraient d'eux-mmes, ne
m'atteignaient pas de par leur nature mme, et qu'il ne s'agissait dans ce cas ni de moi, ni de
lui ? Verbe englouti, avant toute destination...
Je redevenais ma faon une Vestale gare dans un dehors dpouill de magie. Invisible,
je ne percevais, du discours flatteur, que le ton, quelquefois le don. Ma rponse s'attnuait
d'une indulgence vers ce que je jugeais cette poque, dans mon exprience limite et
nave, comme un dfaut propre l'ducation europenne : la prolixit verbale, la logorrhe si
peu discrte dans ces prambules de la sduction. Sre pour ma part, et tout fait a priori,
que la surabondance du dire amoureux survient en couronnement, en feu d'artifice pour la
fte qui scelle la double jouissance et le rassasiement.
Je ne m'apercevais pas que ma prsomption signifiait une reprise du voile symbolique. Ayant
dpass l'ge pubre sans m'tre immerge, l'instar de mes cousines, dans le harem,
demeu-rant, lors d'une adolescence rveuse, sur ses marges, ni en dehors tout fait, ni en
son cur, je parlais, j'tudiais donc le franais, et mon corps, durant cette formation,
s'occidentalisait sa manire.
Dans les crmonies familiales les plus ordi-naires, j'prouvais du mal m'asseoir en tailleur
: la posture ne signifiait plus se mler aux autres femmes pour partager leur chaleur, tout au
plus s'accroupir, d'ailleurs mal commodment.
Ftes nocturnes sur les terrasses d'o, parques en peuple d'invisibles, nous regardions
l'orchestre andalou avec son tnor vnrable. Celui-ci trnait au milieu des hommes pars
de leurs atours et qui se savaient observs par les femmes plonges dans le noir. Elles
rythmaient la rencontre par leurs clameurs vrilles qui s'lanaient en gerbes. Ce cri
ancestral de dchirement que la glotte fait vibrer de spasmes allgres ne sortait du
fond de ma gorge que peu harmonieusement. Au lieu de fuser hors de moi, il me dchirait.
Je pr-frais couter la longue vocifration de ma mre, mi- roucoulement, mi- hululement
qui se fondait d'abord dans le chur profus, puis le terminait en une vocalise triomphale, en
long solo de soprano.
De l'agglutinement de ces formes tasses, mon corps de jeune fille, imperceptiblement, se
spare. A la danse des convulsions collectives, il participe encore, mais ds le lendemain, il
connat la joie plus pure de s'lancer au milieu d'un stade enso-leill, dans des comptitions
d'athltisme ou de basket-ball. Ce corps n'est cependant pas encore arm pour affronter les
mots des autres.
Dans cette communication avec le sexe double-ment oppos, puisque du clan oppos, a pu
me toucher, quelquefois, la rserve d'un soupirant venu d'ailleurs. Seule loquence possible,
seule arme qui pouvait m atteindre : le silence, non pas tant par respect ou par timidit, de
celui qui ris-quait, tout moment, de se dclarer; le silence, parce qu'ainsi seulement il se
dclare. Entre l'homme et moi, un refus de langue se coagulait, devenait point de dpart et
point d'arrive la fois.
A dire vrai, quand au XVII e sicle, le chevalier d'Aranda, esclave Alger pendant deux
annes, remarquait propos des Algriennes d'alors : Les femmes ne sont pas
scrupuleuses devant les esclaves chrtiens, car elles disent qu'ils sont aveugles , je ne me
cache pas que, d'une illusion identique, l'effet aurait pu tre exactement l'inverse; que,
devant le regard ou le mot de l'homme-tabou, la femme dvoile prouve sans doute
jouissance avive de se rendre nue, vuln-rable, conquise... Justement conquise . Les
femmes qu'a connues d'Aranda acceptaient l'amour d'un tranger aveugle peut-tre,
mais en tout cas esclave.
Je vivais, moi, dans une poque o, depuis plus d'un sicle, le dernier des hommes de la
socit dominante s'imaginait matre, face nous. Lui tait alors te toute chance
d'endosser, devant nos yeux fminins, l'habit du sducteur. Aprs tout Lucifer lui-mme
partage avec ve un royaume identique.
Jamais le harem, c'est--dire l'interdit, qu'il soit d'habitation ou de symbole, parce qu'il
empcha le mtissage de deux mondes opposs, jamais le harem ne joua mieux son rle de
garde-fou; comme si les miens dcims, puis dracins, comme si mes frres et par l mes
geliers, avaient risqu une perte de leur identit : trange drliction qui fit driver jusqu'
leur figure sexuelle...
Cette impossibilit en amour, la mmoire de la conqute la renfora. Lorsque, enfant, je
frquen-tai l'cole, les mots franais commenaient peine attaquer ce rempart. J'hritai
de cette tanchit; ds mon adolescence, j'exprimentai une sorte d'aphasie amoureuse :
les mots crits, les mots appris, faisaient retrait devant moi, ds que tentait de s'exprimer le
moindre lan de mon cur.
Lorsqu'un homme de ma langue d'origine pou-vait, me parlant en franais, se permettre une
approche, les mots se transformaient en un masque que, dans les prliminaires du jeu
esquiss, l'interlocuteur se rsignait prendre. C'tait lui, en somme, qui se voilait, pour oser
avancer vers ma personne.
Si je dsirais soudain, par caprice, diminuer la distance entre l'homme et moi, il ne m'tait
pas ncessaire de montrer, par quelque mimique, mon affabilit. Il suffisait d'oprer le
passage la langue maternelle : revenir, pour un dtail, au son de l'enfance, c'tait
envisager que srement la camaraderie complice, peut-tre l'amiti, et pourquoi pas, par
miracle, l'amour pouvait surgir entre nous comme risque mutuel de connaissance.
S'agit-il d'ami ou d'amoureux issu de ma terre, expuls d'une enfance identique, lang des
mmes bruits originels, oint par la mme chaleur des aeules, corch l'identique arte de
la frus-tration des cousins, des voisins, des ennemis intimes, plong encore dans le mme
jardin des interdits, dans le mme enfouissement de la lthargie, oui s'agit-il pour moi de
frres ou de frres-amants, je peux enfin parler, partager des litotes, entrecroiser des
allusions de tons et d'accents, laisser les courbures, les chuintements de la prononciation
prsager des treintes... Enfin, la voix renvoie la voix et le corps peut s'approcher du corps.
VOIX
Abdelkader et les maquisards se mirent me rprimander :
Ton frre Ahmed est mort en martyr! Bien-heureux si nous finissons comme lui !
Ils m'emmenrent. Je retrouvai les autres filles. Elles me proposrent :
Reste avec nous ici !
Non, rpondis-je. O va mon frre, je vais !
Nous sommes partis de l. A Bou Harb, nous avons rencontr Nourredine. Ce chef leur dit,
en me dsignant :
Qu'elle mette une kachabia! Qu'elle n'aille pas ainsi, avec les soldats !
Nous avons rencontr Abdelkrim, un commis-saire politique. Nous sommes rests avec lui,
environ trois mois. Puis nous sommes alls Bou Athmane o j'ai retrouv deux filles : la
compa-gnie des Frres allait et venait; nous nous sommes mises, toutes les trois, nous
occuper de la nourriture. Finalement, on m'a envoye, moi, la plus jeune, l'hpital du
maquis pour y tre utile.
L, j'ai connu Ferhat, le mdecin.
Tu vas apprendre donner les premiers soins aux blesss, me dit-il.
Je restai avec lui et ses malades; j'ai appris faire des piqres (or maintenant, je ne peux
plus cause de ma sant : mes mains tremblent).
Je passai la premire nuit dans la salle com-mune. Au matin, un bless, tout fivreux, se
rveilla et m'aperut : j'avais alors les cheveux trs longs, je les avais rpandus sur mes
paules pour les peigner. Alors celui qui dlirait s'cria :
Regardez ! C'est une ogresse !
Et les autres de rire... Je restai donc parmi eux. Plusieurs infirmiers arrivrent ensuite. Moi, je
lavais les malades et leur linge ; je commenais faire les piqres. Je vcus l toute une
anne.
A la fin, brusquement, je n'eus plus envie de rester. Mon frre an vint une seule fois me
voir. Les autres s'taient mis me dire :
Pourquoi partir ? Personne ne sait aussi bien que toi s'occuper des blesss !
Je ne reste plus ! rpondis-je. Cela fait une anne entire que je n'ai pas vu une femme, ni
mme un enfant ! Que des maquisards blesss ! Et mon frre m'a rendu visite une seule fois
!
Est-ce l la raison? me demandrent-ils.
La seule raison, rtorquai-je, c'est Dieu! C'est comme s'il m'avait mis soudain de l'ombre
sur cet endroit !
J'aimais pourtant les malades. Je me disais mme : Si ma mre me voyait, comme elle
serait fire ! Voil, je suis laveuse de blesss ! Une par-tie de l'hpital tait construite sous
terre; on y mettait les malades compltement immobiliss; on amnageait des couches aux
autres sous les branchages, dans la fort.
Les chefs sont venus pour inspection, Slimane, Si Djelloul de Cherchell, Si Mahmoud (tous
sont tombs ensuite en martyrs). Ils me dirent :
Reste ! Tu fais bien ton travail, tu es bien l !
Et moi, je m'enttais, je disais toujours non.
Quelqu'un t'aurait-il dit quelque chose? me demandrent-ils. Ils sous-entendaient : t'a
man-qu de respect .
Personne ne m'a dit quelque chose! rpon-dis-je. Mais je ne reste pas ! Mon cur n'est
plus l.
O veux-tu aller?
O vous voulez m'envoyer, mais plus ici ! Je ne veux plus de cet endroit !
Ils m'ont donc change de lieu d'affectation. Le jour de mon dpart, les malades et moi, nous
pleurions tous !
Ils m'ont conduite l'hpital de Mimoun, o Si Omar soignait. J'ai mis quelque temps
m'habituer. Or voil que soudain, ils me disent :
Tu te maries !
Non, je ne me marie pas, rpliquai-je. Mme si vous voulez me tuer, allez-y, mais je ne me
marie pas !
Ils ont eu beau faire! Le mdecin qui m'avait tout appris, avait protest, pour moi et pour
Omar :
Ce sont comme des enfants! Laissez-les tranquilles !
A la fin, parat-il, ce mdecin a quitt le maquis cause de cet incident. Il n'a rien fait, il n'a
pas trahi, mais il a prfr se constituer prisonnier!...
Dans cette histoire de mariage, ils pensaient me donner un chef ! Un chef de Mouzaa.
J'ai persist dans mon refus. Us m'ont dit alors :
Si ce n'est pas avec celui-ci, marie-toi avec un autre, celui que tu veux ! Choisis !
J'ai rpondu :
Est-ce pour le mariage que je suis venue chez vous? Non, je ne me marierai avec
per-sonne ! Ces hommes sont tous mes frres !
Ils m'ont enfin laisse tranquille. Je suis reste ce second hpital. Une femme est venue,
qui avait travaill en ville, dans les complots . Elle arriva en compagnie de son mari. Pour
le suivre, elle avait dit qu'elle savait coudre les uniformes, alors qu'elle ne savait pas
vraiment... Mais nous sommes restes ensemble. Je passais la nuit avec elle. Par la suite,
une autre arriva, marie gale-ment.
Quelques mois plus tard, de Cherchell vinrent Si Djelloul et d'autres, ses adjoints. Ils dirent
mon sujet :
Cette fille est de chez nous ! Nous ne la lais-serons pas ici ! Nous la remettons dans notre
sec-teur !
Ils avaient appris mon opposition au projet de mariage; ils ne me dirent rien, mais ils m'ont
ramene vers Bou Hillal, avec des maquisards de ma rgion. Nous restions au poste. La
nuit, les hommes s'installaient d'un ct; les femmes, mme celles qui avaient pous des
maquisards et qui ne portaient pas l'uniforme, restaient de l'autre... Je me souviens que l'une
d'elles, la plus ge, se prit d'affection pour moi. Je l'appelai Djedda .
Quelques mois plus tard, un maquisard trahit. A l'aube, les Franais nous encerclrent.
Djedda et moi, nous nous tions leves les premires, pour faire les ablutions de la prire.
J'entendis non loin parler franais. Je m'tonnai :
Qui parle franais ?
La vieille me dit :
Un maquisard, sans doute !
Non, rpondis-je, tu sais bien que c'est dfendu maintenant de parler franais.
Je me retournai pour pier quand j'aperus les
soldats de la France. J'alertai aussitt tout le monde :
Les soldats ! Les soldats !
A peine avais-je commenc courir et crier que la fusillade commena. Un enfant
(certaines des pouses avaient des enfants) venait de se lever et de sortir le premier, en
trbuchant : une balle l'atteignit en plein front et l'tendit mort sur le sol devant moi. Le
pauvre : du sommeil la mort, en un seul pas! Djedda et moi, nous nous mmes courir. Les
autres femmes, qui ne s'habillaient pas en soldats, renoncrent fuir.
L'ennemi nous poursuivait. Je russis me cacher. Le soir et toute la nuit, je ne quittai pas
ma cachette. Mais cette fois, l'ennemi resta sur place, mme la nuit. Nous continuions tre
encercls. Ils ont fini par me trouver, recroquevil-le parmi des figuiers de Barbarie !
Quand ils me sortirent, un commis, originaire de Mnacer, leur rapporta (je ne le connaissais
pas, mais il jouait de la musique dans les mariages, me dirent les autres, par la suite) :
Celle-l, c'est la sur des Amroune! Un de ses frres est mort au combat, l'autre est
toujours maquisard !
Ils me demandrent si c'tait vrai. J'acquiesai.
O est ton frre vivant ?
Je ne l'ai pas vu !
Comme j'tais habille en maquisarde, un offi-cier leur ordonna :
Fouillez-la ! Elle peut cacher une arme !
Le Franais dit cela, mais le goumier qui me surveillait rpondit :
Non, si elle cache quelque chose, tant pis!... Si elle veut tuer, qu'elle tue !
Un autre goumier s'approcha et m'accusa :
Je te reconnais! J'tais prsent quand toi, ton frre et Arbouz, vous avez tu vingt-huit
personnes ! Vous tuez vos semblables ! C'est pourquoi je vous ai quitts et je me suis rendu
!
Tratre parmi les tratres, lui rtorquai-je, tu oses parler ainsi ! C'est toi qui tues et qui
gorges les tiens, puis qui vas trahir ! Nous, nous ne nous tuons pas entre nous!... C'est toi
qui vas vendre les tiens, toi qui t'engages pour la gamelle et pour la soupe!
Furieux, il dirigea son fusil sur moi. Il me menaa :
Je vais te tuer!
Tue-moi, lui dis-je, si tu es un homme ! Mais tu n'es pas un homme, tu es un goumier ! Moi
qui ne suis qu'une fille, vas-y, tue-moi ! Je ne suis pas une femme complte, mais c'est tout
comme! Tue-moi, car tu aimes tuer!
Ils m'ont fait passer la nuit sur place. Les sol-dats avaient auparavant dcid :
On va te ficeler !
Jamais, rpond is-je, aucun de vous ne me touchera ! Gardez-moi plusieurs, si vous
voulez ! Personne ne me ficellera !
Ils sont rests plusieurs de garde. Le matin, ils m'ont apport du caf.
Je ne bois pas avant de m'tre lav la figure !
Ils m'ont apport de l'eau. J'ai fait mes ablu-tions. Ils m'ont reprsent le caf.
Je ne bois pas ! ai-je dit.
Ils ont voulu me donner des biscuits.
Je ne mange pas !
J'ai pris les biscuits et je les ai poss terre.
Tu les as mis l pour tes frres ? ironisa l'un d'entre eux.
Mes frres, rpliquai-je, ne sont pas comme vous, pousss seulement par la faim !
Qui vous apportait la nourriture ?
Nous-mmes!
Qui vous apportait des vtements ?
Nous-mmes!
Ils m'ont ensuite prsent des ossements humains : ceux de certains qui avaient tra-vaill
avec la France.
Qui les a tus ?
Je n'ai rien vu !
Montre-nous les chemins que vous preniez partir d'ici !
Je ne sais pas, je restais ici !
Dis-nous comment ils sont ! Dcris-les-nous !
Des soldats comme vous ! Moi, je ne regarde pas les visages !
Comment se fait-il que, toi si jeune, tu sois arrive jusque-l et que tu aies abandonn
pre et mre?
Les maquisards sont mes frres et, en mme temps, ils me tiennent lieu de pre et de
mre !
Puis, sans qu'ils m'aient demand autre chose, j'ajoutai :
Je ne reconnais pas la France ! J'ai t leve selon la parole arabe! Les Frres , ce
sont eux mes frres !
Ils m'ont emmene. Prs d'un oued, un goumier me donna en cachette une cartouchire.
Mais l'officier surgit; l'autre reprit aussitt les car-touches... Un peu plus loin, celui qui m'avait
accuse et insulte s'approcha et se remit me menacer : Je vais la tuer ! Je le narguai
nou-veau, je lui rptai ce que je pensais de lui, qu'il n'tait qu'un vendu, pour la gamelle
et pour la soupe!
Un autre goumier, du nom de Chrif, intervint et dit l'autre :
Laisse-la donc! Regarde les Franais; peine s'ils osent lui parler, malgr son ge, et toi,
alors qu'elle est ta compatriote, tu cherches l'exciter !
Un troisime, tourn vers moi, proposa :
Tiens, prends ce fusil et tire, toi aussi !
Naturellement, je savais qu'il se moquait. Mais je rpondis :
Crois-tu que je ne sache pas tirer ? Donne et tu verras !
La dispute continua, mais on nous emmena dans des camions. A Cherchell, ils s'arrtrent
une caserne. Ils me mirent dans un rduit au sol dall. Je m'tendis et m'endormis. Un
surveillant arriva plus tard :
Tu veux te laver?
Il m'emmena une fontaine, me donna du savon et une serviette. Je me lavai et retournai
la cellule. Ils vinrent ensuite me chercher pour l'interrogatoire, qui commena tout au dbut
de l'aprs-midi. Cela dura des heures... Je me contentais de rpondre toutes leurs
questions :
Je ne vous reconnais pas! Je ne reconnais pas la France !
Ils essayrent de me faire dire o marchaient les khatibas , ainsi que les noms des chefs.
Je rpondais invariablement :
Je n'en sais rien !
Ils m'emmenrent d'un bureau l'autre. Puis ils me demandrent :
La khatiba hamdaniya (nomme ainsi parce que le chef en tait Hamdane) s'est
fractionne, n'est-ce pas ?
Moi, je savais que c'tait vrai, mais je les narguais :
Non, elle est toujours entire! Vous n'avez qu' voir : l'autre jour, quand vous avez subi
notre accrochage et qu'on a rempli l'hpital des vtres, c'tait bien elle ! Elle qui va du djebel
Chenoua Bou Hilal !
Un officier s'nerva et me frappa, par deux fois, au visage. Puis ils amenrent une
mitraillette.
Avoue, donne les renseignements, ou l'on te tire dessus !
Tirez ! ai-je dit. Cela m'importe peu ! Je suis une fille, je ne suis pas une femme complte,
mais je laisserai derrire moi des hommes!... Chacun d'eux tuera cent d'entre vous ! Tuez-
moi !
Ils apportrent une cravache. Ils me frapprent. Ils branchrent l'lectricit de leurs
appareils. Ils me torturrent.
Je ne vous reconnais pas !
Je ne ressentais aucune peur : Dieu me rendait ces Franais comme des ombres devant
mes yeux ! Et c'tait vrai, j'aurais prfr tre morte !
Soudain quelqu'un m'interrogea :
Est-ce que tu es vierge?... On nous a dit que tel... (et il dit le nom du chef de Mouzaia) t'a
demande en mariage !
Je compris qu'ils avaient appris l'histoire par l'ex-maquisard devenu goumier.
Je ne suis pas marie ! rpondis-je.
Ils ont fini par me ramener en cellule. Ils me donnrent un lit, une couverture. Ils
m'appor-trent une assiette de nourriture avec mme de la viande, du pain et une cuillre. Or
une fois seule, je me mis brusquement pleurer : mes larmes ne s'arrtaient pas !
Comment se fait-il, me disais-je avec dsespoir, que Dieu a voulu que je tombe aux mains
des Franais ?
Un goumier vint entrouvrir la porte.
Allons, allons, ne pleure pas! me dit-il. Tu n'es pas la premire fille qu'ils attrapent. Au
dbut, quand ils t'interrogent, c'est dur, mais aprs, ils finiront par te librer!
Je ne voulus pas lui rpondre. Il referma la porte. Je m'approchai de la nourriture. Je touchai
la viande : deux ou trois bouches seulement, car j'avais si faim, mais je me mfiais. Je
laissai le reste intact. Le matin, ils m'apportrent le caf. Je demandai me laver d'abord : ils
me firent sortir dans une cour, jusqu' la fontaine. Je me lavai sous leurs yeux : je
m'aspergeai le visage, les bras jusqu'aux coudes, les pieds puis les jambes jusqu'aux
genoux : comme pour les ablutions. Je librai mes cheveux qui n'taient plus aussi longs, je
me peignai et j'arrangeai ma coiffure. Et eux tous qui restaient l me regarder!
As-tu fini?
J'ai fini !
Dans ma cellule, je gotai une gorge de caf, pas plus ! Mme si la faim me tenaillait, je
voulais leur montrer, montrer devant la France, que j'tais rassasie !
Tu as bu, c'est fini? dit quelqu'un.
C'est fini, je remercie Dieu !
Ils me firent monter en voiture. Vint l'officier ventru qui, la veille, m'avait frappe au visage. Il
me parla en arabe :
Sais-tu o tu vas maintenant ?
Comment le saurais-je ?
Est-ce que tu connais Gouraya?
Je ne connais pas !
Vous, les Arabes, vous ne savez que dire : Je ne connais pas !
Quand on marche dans une fort, dis-je, pourquoi connatre forcment le nom de cette
fort ?
Un autre Franais, un officier galement, s'interposa :
Elle est jeune. C'est normal, si elle ne connat pas !
Ce dernier monta dans la voiture, ainsi que le chauffeur et un goumier. Une jeep suivait. A
chaque village que nous traversions, l'officier qui croyait vraiment que je ne reconnaissais
pas les lieux, me prcisait les noms arabes des villages. A Gouraya, Brardi, le chef de la
SAS, bien connu dans la rgion sortit et vint saluer l'officier. Celui-ci me murmura :
C'est Brardi !
Aprs Gouraya, nous sommes arrivs au lieu- dit le bois sacr . Je savais que se trouvait
l la plus grande prison de la rgion. Un officier, un lieutenant nomm Coste, nous accueillit;
il m'examina sans me parler, il hocha la tte :
Emmenez-la en cellule! dit-il. Une cellule en plein soleil !
Quand il partit, l'officier de la voiture demanda une autre cellule pour moi. Un maquisard
prison-nier, sans doute en cours d'interrogatoire, russit s'approcher de moi peu aprs :
O ma sur, o t'a-t-on prise?
Je l'examinai sans rien rpondre. Lui, il conti-nuait avec hte : tu connais un tel, et un tel...
? Je dis oui, car ma mfiance disparut. On me ramena l'interrogatoire. Je rpondis de la
mme faon qu' Cherchell. Ils utilisrent nouveau l'lectricit. Une fois, cela dura de
l'aube jusqu' deux heures de l'aprs-midi. Ce fut particulire-ment prouvant.
Us me confrontrent avec le goumier qui m'avait reconnue lors de mon arrestation et ils me
menacrent. Je ne me laissai pas intimider :
Mettez-moi vingt ans de prison, si vous vou-lez, je ne suis pas perdante ! Quelle guerre a
dur vingt ans? La ntre ne va pas durer autant!... Faites de moi ce que vous voulez !
Finalement, ils me laissrent dans ma cellule. De nuit comme de jour, la porte restait ferme
sur moi. Un jour vint le lieutenant Coste. Il me demanda :
Tu es bien ?
Non, je ne suis pas bien ! J'clate cause de la chaleur!... Nous, quand nous avions les
vtres prisonniers chez nous, nous ne les enfermions pas ainsi, jour et nuit!... Nous, nous
n'agissons pas injustement comme vous !
Ils me permirent alors de garder la porte ouverte sur la' cour. Si je voulais sortir un moment,
je le pouvais. La nuit, ils refermaient la porte sur moi. Je suis reste ainsi sept mois ou
davantage !
Par la suite, je pus circuler dans les cours du camp. Quand arrivaient de nouveaux
prisonniers et que commenait leur interrogatoire, j'allais les rconforter, je leur apportais
boire. Cette situa-tion ne dura pas, cause d'un goumier, originaire de Constantine. Une
nuit, je ne sais comment, il fit ouvrir la porte de ma cellule, puis il m'appela par deux fois, tout
doucement, dans le noir. Je sortis et j'appelai bien fort la garde. Il disparut.
Au matin, il vint me demander pardon. Je ne pardonne pas , dis-je et je protestai; ils lui
infli-grent huit jours de cachot, pour avoir ouvert ma porte ainsi.
A sa sortie, il revint, mais pour me faire des reproches. Il s'avana dans la cour au-devant de
moi, avec un chien. Je ne dis rien, j'allais ouvrir les portes des frres arrts, comme je le
faisais quand je leur distribuais eau et nourriture. Le goumier me menaa :
Pourquoi es-tu alle te plaindre au lieute-nant Coste? Pour qui te prends-tu?... Et les
fel-lagha, tes frres, qu'est-ce qu'ils sont, sinon des rats cachs dans des trous !
Devant cette insulte, je ne pus me contenir :
Approche donc si tu veux ! Puisque tu nous traites de rats, on va voir si nous sommes des
rats ou des lions !
La dispute s'envenima. Le lieutenant Coste arriva, avec son adjoint, le spcialiste de
l'lectri-cit dans les interrogatoires, qui parlait arabe. Il traduisit pour le lieutenant. Je leur
rapportai les insultes du goumier. Le lieutenant lui interdit de m'adresser la parole.
Deux ou trois mois aprs environ, ce mme goumier rapparut. C'tait le matin ; je servais le
caf des dtenus en cours d'interrogatoire. Je le vis s'approcher de moi; je signalai le fait
un autre garde. Ce dernier, pour prvenir tout incident, me demanda de rentrer dans ma
cellule. Ce n'tait pas moi cder la place !
Je ne rentre pas! dcidai-je. Arrive ce qui arrivera ! Aujourd'hui ce sera ou lui, ou moi !
Tu n'as qu' rester dans ton trou ! ricana le goumier Sans rien voir de la clmence de
Dieu !
Je ne rentre pas ! rptai-je.
Je m'chappai vers une deuxime cour. Il se mit m'insulter tout haut, devant tous :
Vous, les fellagha, vous vivez dans les forts en btes sauvages, et vous voulez ici vous
conduire en sauvages!
D'o sortez-vous, vous, les goumiers ? rtorquai-je. Vous avez vendu votre foi ! Quant
moi, l'tendard auquel je crois ne flotte pas ici au- dessus de ces lieux ! Il est l-bas, dans les
forts et sur les monts !
La dispute s'alimentait devant tous. Cela dura quelque temps. A la fin, je m'emparai d'une
grosse cafetire et, quand il s'approcha de trop prs, je le frappai de toutes mes forces sur
l'paule.
Maudite ! s'cria-t-il. Elle m'a fractur l'paule !
En fait, j'avais un couteau en poche : un dtenu me l'avait fait parvenir, ds le dbut de la
dispute. Et je venais de ramasser une barre de fer qui tra-nait prs d'un grillage. Je m'tais
dit : S'il revient, je vais le frapper avec le fer, puis je l'ach-verai avec le couteau! Je me
sentais tout fait dcide!... Certes, l'poque, j'tais clatante de sant ! La France, quand
elle m'avait arrte dans les montagnes, tait tonne ! A la vue seulement de mes poignets,
on voyait ma force... Hlas, si un des frres de ces jours-l me rencontrait aujourd'hui, il
jurerait que je ne suis pas la mme!
Un sergent-chef et un autre sont arrivs. Ils m'ont reproch d'avoir frapp le goumier. Je
reconnus les faits. Ils voulurent me faire rentrer dans ma cellule.
Je ne rentre pas !
Tu rentres !
Ils se mirent trois ; je rsistai tout entire : mes jambes, mes bras, ma tte, tout mon corps
frappait sur le sol. Us cessrent et me laissrent l, gisante, en pleine crise nerveuse... Vint
l'adjoint du lieutenant Coste. Il me parla tout dou-cement et me pria :
Allons, rentre dans ta cellule ! Le lieutenant Coste va venir et tu verras avec lui !
Je rentrai dans ma cellule. Us me condam-nrent ensuite au cachot : trois jours et trois nuits,
sans manger ni boire. Aprs ces trois jours, quand ils m'apportrent de la nourriture, je
dci-dai mon tour de ne pas y toucher, et cela pen-dant vingt jours! Comme si je
n'attendais qu'aprs eux!... Les frres dtenus me faisaient parvenir un peu de pain,
quelquefois une pomme (qui me durait trois jours); par une lucarne, ils faisaient passer un fil
de fer avec des petits bouts d'aliments... Un soldat originaire d'Oran, qu'ils avaient ralli
nous, ouvrait quelquefois ma porte pour me glisser le pain. L'essentiel, pour moi, vis--vis
des Franais, tait de leur montrer que je n'avais pas besoin d'eux !
A la fin, ils me laissrent tranquille et je ne revis plus le goumier.
Longtemps aprs, un groupe de la Croix-Rouge vint au camp. Une dizaine d'hommes en civil
entrrent dans ma cellule et me salurent respec-tueusement. Mais le lieutenant Coste
s'interposa :
Elle ne comprend pas le franais ! leur dit-il.
Ils partirent. Des mois passrent. Vint une fois un officier important. Il me dit en entrant :
C'est de Gaulle qui m'envoie dans les prisons comme celle-ci !
Deux goumiers qui l'accompagnaient tradui-saient :
Puisque tu es l, o as-tu t arrte ?
Je dis que j'avais t arrte dans les mon-tagnes .
Que faisais-tu dans les montagnes?
Je combattais !
Et pourquoi ?
Pour ma foi et mes ides !
Et maintenant, puisque tu te retrouves pri-sonnire ?
Je suis prisonnire, et aprs ?
Qu'as-tu gagn ?
J'ai gagn le bien de mes compatriotes et le bien pour moi-mme! M'avez-vous arrte en
train de voler ou de tuer? Je ne volais pas! Ma conscience est avec moi !
Il partit. Je restai au camp mais, grce cet homme, sans doute, je pus voir mes parents. Ils
vinrent du village jusque-l. En me voyant, mon vieux pre a pleur.
Six mois avant le cessez-le-feu, ils ont pu obte-nir mon transfert tout prs d'eux. Ils venaient
de perdre Abdelkader, mon frre an...
CORPS ENLACS
La voix de Chrifa enlace les jours d'hier. Trace la peur, le dfi, l'ivresse dans l'espace
d'oubli. Sursauts de prisonnire rtive dans le camp bant au soleil.
La voix raconte? Mme pas. Elle dbusque la rvolte ancienne. La courbe des collines
brles tant de fois se dploie, le rcit droule la chevau-che travers les tendues
rousses de ces monts appauvris, o je circule aujourd'hui.
Petite sur trange qu'en langue trangre j'inscris dsormais, ou que je voile. La trame de
son histoire murmure, tandis que l'ombre rengloutit son corps et son visage, s'tire comme
papillon fich, poussire d'aile crase maculant le doigt.
La conteuse demeure assise au centre d'une chambre obscure, peuple d'enfants accroupis,
aux yeux luisants : nous nous trouvons au cur d'une orangeraie du Tell... La voix lance ses
filets loin de tant d'annes escalades, la paix soudain comme un plomb. Elle hsite,
continue, source gare sous les haies de cactus.
Les mots s'vaporent... Chrifa se retrouve prsent marie un veuf taciturne, un ouvrier
que j'ai vu partir peu avant sur un tracteur; il est le responsable du matriel dans cette
cooprative agricole. Elle lve les cinq enfants de l'homme.
Elle parle lentement. Sa voix dleste la mmoire; s'chappe le souvenir tire-d'aile vers la
fillette de cet t 56, l't de la dvastation... Est-ce que ses mots l'expulsent? Elle brave la
belle-mre souponneuse qui rde autour de nous, qui tente de surprendre quelle ncessit
du rcit, quel secret, quel pch, ou simplement quelle chappe se dcle dans l'histoire
qui tressaille.
Chrifa vieillie, la sant dclinante, est immo-bilise. Librant pour moi sa voix, elle se
libre nouveau; de quelle nostalgie son accent flchira- t-il tout l'heure?...
Je ne m'avance ni en diseuse, ni en scripteuse. Sur l'aire de la dpossession, je voudrais
pouvoir chanter.
Corps nu puisque je me dpouille des souve-nirs d'enfance , je me veux porteuse
d'offrandes, mains tendues vers qui, vers les Sei-gneurs de la guerre d'hier, ou vers les
fillettes rdeuses qui habitent le silence succdant aux batailles... Et j'offre quoi, sinon
nuds d'corce de la mmoire griffe, je cherche quoi, peut-tre la douve o se noient les
mots de meurtrissure...
Chrifa ! Je dsirais recrer ta course : dans le champ isol, l'arbre se dresse tragiquement
devant toi qui crains les chacals. Tu traverses ensuite les villages, entre des gardes, amene
jusqu'au camp de prisonniers qui grossit chaque anne... Ta voix s'est prise au pige; mon
parler franais la dguise sans l'habiller. A peine si je frle l'ombre de ton pas !
Les mots que j'ai cru te donner s'enveloppent de la mme serge de deuil que ceux de
Bosquet ou de Saint-Arnaud. En vrit, ils s'crivent travers ma main, puisque je consens
cette btardise, au seul mtissage que la foi ancestrale ne condamne pas : celui de la
langue et non celui du sang.
Mots torches qui clairent mes compagnes, mes complices; d'elles, dfinitivement, ils me
sparent. Et sous leur poids, je m'expatrie.
DEUXIME MOUVEMENT
TRANSES
Ma grand-mre maternelle dresse en moi son souvenir de haltement sombre, son
impuissance de lionne.
Rgulirement, tous les deux ou trois mois environ, l'aeule convoquait les musiciennes de la
cit : trois ou quatre femmes d'ge vnrable, dont l'une tait presque aveugle. Elles
arrivaient dans leurs toges uses et leurs dentelles sous le hak dfrachi, leurs tambours
emmaillots dans des foulards.
On apportait en hte les kanouns emplis de braises. Visages carlates des femmes au
milieu des premires fumes... Les servantes, les jeunes filles disposaient les braseros dans
la pice obs-curcie de ma grand-mre ; celle-ci restait invisible depuis l'aube.
Les parfums d'encens montaient peu peu ; les musiciennes laissaient chauffer les peaux
des tambours, tandis que l'aveugle, dans un coin du lit haut, entonnait une litanie funbre.
Cette voix chevrotante de la nuit nous faisait accourir, mon cousin et moi, demi troubls,
pareillement fascins... Je devais tre la pre-mire enfance; ce garon, un peu plus g,
se parait alors d'un prestige certain mes yeux : turbulent, effront, il provoquait sa mre
qui, en proie de vritables crises nerveuses, poursuivait le gamin sur les multiples
terrasses. Je la revois courant dsesprment pour lui administrer une correction... On avait
surnomm l'enfant le medjnoun ...
Ces jours tranges dbutaient par les chants liturgiques du petit orchestre ; la relation entre
ce cousin et moi s'inversait alors. Il s'effrayait, se crispait; il se serrait contre moi la plus
jeune, dans l'attente du spectacle qu'il redoutait. Moi, par contre, je jouissais avec intensit
de mon rle de tmoin. Assis cte cte, prs d'une fentre, nous attendions.
Les doigts bagus des chikhats se mettaient frapper les tambours; l'insidieuse litanie
du chur montait dans la chambre enveloppe de fumes, tandis que femmes et enfants
s'agglutinaient.
Ma grand-mre arrivait enfin, en comdienne l'art consomm. Droite, la tte enturbanne
de foulards bariols, le corps allg dans une tunique troite, elle se mettait danser
lente-ment. Nous toutes, spectatrices, nous le pressentions : malgr les apparences, ce
n'tait pas une fte qui commenait.
Une heure, deux heures durant, le corps osseux de l'aeule tanguait, tandis que ses cheveux
se dnouaient, que sa voix, par instants, faisait entendre un haltement rauque. Le chant de
l'aveugle intervenait pour l'aiguillonner, tandis que le chur s'interrompait :
Laisse sortir le malheur! Que les dents de l'envie et de la convoitise t'pargnent, ma
dame!... Mets au jour ta force et tes armes, ma reine !
La mlope des autres reprenait son antienne, dans la torpeur chaude. Les femmes
s'activaient, de la chambre aux cuisines, pour entretenir le feu des kanouns et prparer le
moment ultime. Mon cousin et moi, raidis par l'attente, puis par la musique qui s'emballait,
nous devinions que nous assistions un prambule solennel.
Enfin la crise intervenait : ma grand-mre, inconsciente, secoue par les tressaillements de
son corps qui se balanait, entrait en transes. Le rythme s'tait prcipit jusqu' la frnsie.
L'aveugle entonnait son chant en solo continu et lyrique ; elle seule, elle tenait ferme les
rnes de l'motion collective. Les mnagres abandon-naient leurs prparatifs culinaires
pour accourir : l'une ou l'autre des tantes, des cousines aidaient l'aeule, soutenant de
chaque ct son buste affai-bli. L'aveugle adoucissait le thrne, le rendait murmure, rle
imperceptible; s'approchant de la danseuse, elle chuchotait, pour finir, des bribes du Coran.
Un tambour scandant la crise, les cris arri-vaient : du fond du ventre, peut-tre mme des
jambes, ils montaient, ils dchiraient la poitrine creuse, sortaient enfin en gerbes d'artes
hors de la gorge de la vieille. On la portait presque, tandis que, transformant en rythmique
ses plaintes quasi animales, elle ne dansait plus que de la tte, la chevelure dnoue, les
foulards de couleurs violentes, parpills sur l'paule.
Les cris se bousculaient d'abord, se chevau-chaient, demi touffs, puis ils s'exhalaient
gon-fls en volutes enchevtres, en courbes tresses, en aiguilles. Obissant au
martlement du tam-bour de l'aveugle, la vieille ne luttait plus : toutes les voix du pass
bondissaient loin d'elle, expul-ses hors de la prison de ses jours.
Une demi-heure ou une heure aprs, elle gisait au fond de son lit, en une masse qu'on
apercevait peine, tandis que, parmi les odeurs d'encens, les musiciennes mangeaient et
devisaient. Leur magie de prtresses paennes avait disparu pour laisser place, dans le jour
qui, midi, semblait seulement commencer, la laideur des visages exagrment fards.
Durant la crise, le cousin medjnoun tait rest agripp mes paules, cherchant une
pro-tection frileuse, alors que je n'avais pas dtach mes yeux du corps en transes de ma
grand-mre elle que nous tous, enfants, nous redoutions d'ordinaire. J'imaginais entrer,
la suite de la danseuse, dans un royaume de fureurs.
Je sentais le mystre : l'aeule, habituellement, tait la seule des femmes ne jamais se
plaindre ; elle ne prononait les formules de soumission que du bout des lvres, avec un
ddain condescen-dant; or, par cette liturgie somptueuse ou dri-soire, qu'elle dclenchait
rgulirement, elle sem-blait protester sa manire... Contre qui, contre les autres ou contre
le sort, je me le demandais. Mais quand elle dansait, elle redevenait reine de la ville,
indubitablement. Dans cet antre de musiques et de sauvagerie, elle puisait, sous les yeux de
nous tous rassembls, sa force quotidienne.
La voix et le corps de la matrone hautaine m'ont fait entrevoir la source de toute douleur :
comme un arasement de signes que nous tentons de dchiffrer, pour le restant de notre vie.
VOIX
La rvolution a commenc chez moi, elle a fini chez moi, comme peuvent en tmoigner
les douars de ces montagnes !
Au dbut, les maquisards mangeaient de mon bien. Jusqu' une petite pension que je
recevais et que je leur apportais. Quant au bl, avant que la France nous brle, nous le
donnions au moulin, puis nous ptrissions la farine. Je possdais deux fours pain. Ils
existent encore prsent car ils avaient t construits en ciment. Ma ferme, aprs avoir t
brle plusieurs fois, est reste sans toit, les murs sont encore l... Quand j'y habitais, j'avais
alors bien du btail !
Au dbut donc, ils ne venaient que pour man-ger... Ensuite Sid Ali est arriv et m'a dit :
On va installer le refuge chez toi, tante! (c'est le neveu de ma mre).
Non, lui rpondis-je. Vois le Kabyle sur la route, Mohand Oumous, voici peine quinze
jours que vous avez tabli le refuge chez lui, et ils lui ont tout brl !
Mais il ajouta :
Ma tante, ne raisonne pas ainsi ! Ne dis pas j'ai ou c'est mon bien, dis plutt je ne
possde pas ! Remets-toi Dieu et laisse, s'il le faut, tout ce feu courir et tout manger.
C'est ainsi qu'ils tablirent le refuge dans ma ferme...
A partir de ce moment, je ne leur assurais plus moi-mme la nourriture. Des gens se sont
mis donner. Peut-tre avaient-ils peur, du moins cer-tains ; peu aprs, ils donnaient
tellement que nous mangions tous et qu'il restait du surplus ! Il nous arriva quelquefois de
jeter... Vers la fin, nou-veau, tout se rarfia. A nouveau, nous avons connu la faim et la
misre!...
Quant au nombre des moudjahidine , pou- vais-tu les compter? Tu ne pouvais pas! Mme
quand deux ils entraient dans une demeure, ils semblaient remplir le patio!... Et pouvais-tu
par-ler ? Tu ne pouvais pas ! Seulement retrousser les manches, ptrir la pte, prparer la
marmite, contrler la cuisson, ainsi, toute la journe ; car ils venaient, ils partaient, par petits
groupes... La surveillance du refuge s'tait organise. Moi, je travaillais devant les marmites
tout le temps, je servais manger, puis je m'asseyais dehors et j'attendais, volontaire pour la
mort... Oui, la porte du verger ! J'avais si peur ! Je faisais le guet, le temps qu'ils
mangeaient. Supposons que quelqu'un soit mont et les et surpris, nous y serions passs
tous sur-le-champ!
Ce refuge a servi chez moi cinq ans. Oui, cinq ans, jusqu' ce que la rvolution arrivt
son terme!...
Une fois, je fus trahie ; ce fut cause d'un tout jeune garon qui se trouvait tre de ma tribu,
par son pre.
Il tait trop jeune pour savoir! Il devait avoir quinze ans. Sa mre, une voisine, tait alle au
Djebel Chenoua, chez sa fille marie l-bas. Elle me recommanda :
Veille sur lui ! Ce garon est si jeune, si naf. S'il circule trop, il va se faire attraper dans un
contrle !
Il est donc rest cach chez moi, en l'absence de sa mre. Un jour, il sortit, pour aller irriguer
le verger. Sa mre lui avait rpt : Veille irri-guer le jardin chaque nuit ! Or, cette nuit-
l, il ne s'tait pas rveill ; il y est all son lever, mais le soleil tait dj bien haut...
Les soldats franais l'ont arrt. On me l'emmena : moi, je ne l'avais pas reconnu d'abord. Il
portait un pantalon europen, la place de la culotte bouffante de son pre. Ils lui avaient
macul le visage de je ne sais quelle poudre. Et il portait un chapeau sur le crne!... Je n'ai
nulle-ment pens lui. Mais peine se mit-il parler que je reconnus sa voix. Il leur dit :
C'est ainsi... ainsi...
Alors, pour la premire fois, ils me brlrent la maison.
Quand sa mre revint, je ne me suis pas gne : je lui ai tout racont de ce qu'avait fait son
fils. Elle me rpondit sans se dmonter :
Et alors? Puisque la France l'avait attrap, que voulais-tu qu'il fasse? Fallait-il qu'il
meure?...
Quand ma ferme fut la proie des flammes, un homme dont la maison ne se trouvait pas loin,
sur la route, s'cria :
Eh bien, Dieu a bien fait!... Cette femme, lorsque les maquisards ont install le refuge chez
elle, je l'ai conseille : N'accepte pas ! Elle m'a rpondu : J'accepte d'aller jusqu' la
mort ! Puisqu'elle prtendait aller jusqu' la mort, nous allons voir!
Ce mme paysan, quand quelqu'un passait devant chez lui, il le harcelait de questions :
Ne sont-ils pas en train de nourrir les maquisards ?
Son fils vint d'ailleurs pour se rendre compte des dgts : mme les marmites, ils me les
avaient brises !... Les jours suivants, je m'enttai : je dci-dai d'aller allumer mon feu entre
des pierres et je russissais quand mme donner manger aux Partisans ! Jusqu'
l'extrme, me disais-je, j'irai jusqu' l'extrme! Le reste est dans la main de Dieu !
Le voisin passait donc son temps m'pier. Il se mit aller donner des renseignements :
Telle compagnie est venue chez Sahraoui Zohra!... Telle autre katiba ...
Hlas! nous sommes des analphabtes. Nous ne laissons pas de rcits de ce que nous
avons endur et vcu!... Tu en vois d'autres qui ont pass leur temps accroupis dans des
trous, et qui, ensuite, ont racont ce qu'ils ont racont !
Ils ne nous ont rien laiss : ni le btail, ni les rserves des silos, rien. Mme pas une chvre !
Ils ne nous ont rien laiss...
Auprs des gens qui m'avaient lou de petites parcelles, les soldats allaient et demandaient :
Ce sont les vaches de Sahraoui Zohra?... Ah, ce bien est elle?
Et ils brlaient, jusqu' ce que nous soyons res-ts dmunis ! Alors, j'ai dcid : Je
descends au village ! Les Frres m'ont dit :
Ne te rends pas !
Je ne vais pas me rendre, dis-je. Je descends seulement au village, puisque je n'ai plus de
bien ici!
Non, reste l !
Je suis alle au village. Les maquisards descen-daient pour me contacter. Un garde-forestier
m'a trahie : il les vit une fois traverser la fort, l-bas. O vont-ils ? Il comprit ensuite
qu'ils venaient chez moi.
Un matin, l'aube, les gendarmes furent chez moi et me ficelrent.
Toi, c'est toi qui renies la France ! Pour qui te prends-tu?... A la montagne, tu voulais nous
en faire voir, et l aussi c'est pareil !
Us me menaaient, croyant me faire peur. Je m'tais dit ce jour-l : Cette fois, ils vont me
tuer! et je me sentais calme. Or, grce la cl-mence de Dieu, parmi eux se trouva un
nomm Ali, un parent par alliance de ma mre. Il s'exclama :
Comment, ce serait cette vieille qui aurait tout brl dans toutes ces montagnes ? Une
vieille comme celle-l?... Ou vous la librez, ou sinon, moi, je remonte combattre au maquis !
Oui, il leur a dit ces paroles : car cet homme avait t maquisard, puis, il s'tait rendu .
Certes, depuis qu'il travaillait avec la France, j'avais peur de lui. Me voyant au village, il lui
arri-vait de venir chez moi : j'acceptais de lui laver son linge et je lui prparais manger...
N'tait-il pas un parent de ma mre ?
Cette fois-l, quand ils m'ont arrte, je ne suis pas reste longtemps en prison !
Ma maison se trouvait presque la lisire de la fort... Les Frres avaient fait vacuer cette
cabane, en dcidant : Cette femme entrera l ! Le propritaire du logement est encore
vivant : nous ne lui avons pas pay de loyer. Cela repr-sentait sa forme de participation.
J'ai tant habit en ce temps-l de demeures, tant et tant!... Finalement, en sortant de prison,
j'ai prfr retourner ma ferme. Comment aurais-je su que, en redescendant la fois
suivante au village, je me trouverais sous une tente, telle une nomade !
Au dbut, je possdais trente et une vaches... A la fin, je ne gardai pas une seule tte ! Les
soldats m'ont tout pris !
Ma ferme fut brle trois fois. Quand ils remontaient et qu'ils la trouvaient de nouveau en bon
tat, ils savaient qu'entre-temps, les Frres nous avaient reconstruit la maison! Ils
rappor-taient des tuiles du toit des fermes des colons. De nouveau, les soldats franais
dtruisaient. De nouveau, les Frres ramenaient des tuiles des toits des Franais et nous
recouvraient l'abri... La France revint. Nous avons alors dcid de prpa-rer la nourriture en
plein air, entre les murs sans toit et mme dans la fort.
La troisime fois, ils nous descendirent au vil-lage. Ils nous descendirent et nous mirent sous
des tentes. Et l'oued fut en crue. Ils ne nous ont rien donn : ni couverture ni nourriture. Us
nous ont laisss tels quels. Ils croyaient que nous allions mourir. Mais nous ne sommes pas
morts... Nous nous sommes parpills, l o nous avons pu, qui chez son frre, qui chez son
cousin. Moi, je suis alle Hadjout, chez Djennet. J'ai fui chez elle et je lui ai fait maintes
recommandations :
Attention, Djennet ! Si on te dit que ta tante se trouve chez toi, n'avoue pas ! Dis qu'elle n'y
est pas!
Quand j'entendais du bruit, ou quand quelqu'un lui parlait la porte, je me cachais, je me
glissais sous son matelas, comme un serpent!... Aprs, quand ils taient partis, je
demandais :
Ils sont partis ?
Oui!
Car j'avais peur! Je savais que ces gens venaient pour Dieu et son Prophte , en toute
bonne foi, mais malgr tout, s'ils me voyaient, en partant, ils parleraient ! Ils diraient : Lia
Zohra de Bou Semmam est l ! Elle est venue pour que Hadjout brle son tour! Je devais
me cacher!
Tout ce qui est pass sur moi ! Mon Dieu, tout ce qui est pass !
MURMURES..
Djennet est assise sur le seuil, mme le carre-lage, ou sur une peau de mouton
immacule.
Un rayon de soleil claire de biais son corps ample, noy sous la toge de coton bariol. Ses
che-veux noirs sont relevs en natte lourde qui aurole son visage aux traits fins. Elle attend
: l'poux a t pris la suite d'un contrle militaire qui a arrt le car sur la route; l'homme a
disparu depuis une anne; o demeure-t-il maintenant, dans quelle prison, dans quel camp
ou dans quel prcipice? Djennet rve aux fils, aux filles qu'elle n'a pas eus durant vingt
annes de noces striles...
Au fond de la pice, la vieille tante Acha, descen-due des montagnes, se tasse dans une
encoignure. Mais elle exhale sa plainte volubile :
Qu'ils ne viennent pas, fille de ma sur! Que les voisins qui jasent ne doutent pas cette
fois, eux les maudits, les curs froids, les rejetons de hynes corches !
La voix monte, rauque ou chantante, par strophes rgulires avec des maldictions rimes
en gerbes finales. Aprs un silence, sa prire rituelle intervient... Djennet assise ne prie pas,
mme si les lamentos des muezzins, en arabesque apaise, par-viennent jusqu' elle.
Elle fait le guet par habitude : un enfant peut frapper la porte, il faudra l'arrter ds le
vestibule. A tout propos, les curieuses des terrasses voisines envoient demander un uf qui
leur manque, une cuillere de paprika, une tasse pleine de pois chiches, ou du sucre en
semoule. Djennet sait qu 'elles savent, elles, les espionnes, les jalouses, les cancanires.
Elles disent sans doute que la vieille est venue pour un autre complot, comme marieuse ou
faiseuse de mdecine magique... Elles s'ima-ginent que la solitude de la couche dserte
taraude la veuve d'hier, la strile sans couve, la silencieuse des cits...
L-haut, la France entretient l'incendie chaque jour. Elle disperse femmes et enfants sur
les routes et dans la boue. Les rafles se multiplient dans les marchs du bourg. Djennet se
dit que l'poux pourrit dans une prison : un messager viendra-t-il, un parent par alliance ou
un mendiant de Dieu portant un signe de bon augure?...
Assise sur le seuil, Djennet attend, tandis que, dans la pnombre, la vieille Acha fait enfler
ses rles.
Djennet se saisit du pilon de cuivre pos devant ses pieds nus, prs de ses mules
abandonnes :
Occuper mes mains, prophte aux yeux doux, Lia Khadidja sa bien-aime ! Occuper
mes doigts pour desserrer les dents de l'angoisse!...
Commencent les bruits rguliers du pilon qui crase gousses d'ail, puis herbes fraches.
Malgr le rythme lourd, Djennet entend la voix de la rfugie hagarde : Depuis trois jours,
elle palpite, elle tente, la malheureuse, d'carter d'elle le souffle de la tem-pte qui
l'clabouss , se dit-elle et elle pse de tout son torse sur ses poignets qui font sonner le
mtal...
Elle se lve lentement, elle va et vient, mains sou-dain trop actives; elle se rassoit. Elle
recale le pilon entre ses pieds nus aux orteils teints par le henn cramoisi. La soire se
poursuit, la voix de la vieille couche au fond, corps cras sur le matelas de crin et sous un
drap blanc ( blanc comme un lin-ceul ! a-t-elle gmi), la voix de la rfugie reprend,
antienne incohrente ou monologue de magicienne.
Les lueurs du crpuscule s'teignent au-dessus de la terrasse au jasmin frle. Djennet
continue son travail de percussion : l'ail est cras, le coriandre est rduit en poudre, le
cumin est devenu poussire, mais Djennet, dans l'odeur des pices et des herbes
embaumant la pice assombrie, dcide de ne cesser qu'avec le dlire de la voix de
pnombre...
Les voisines peuvent entendre, les curieuses des terrasses risquent de comprendre, l'enfant
envoy qui soulvera le heurtoir de la porte aura le temps de franchir le vestibule, d'arriver
jusque-l et de les surprendre; il faut veiller, il faut pier, heure aprs heure, tous les jours.
Que la fugitive calme son effroi, retrouve sa force et qu'elle puisse repartir, voile, protge,
vers les transes de l'aventure...
LA MISE SAC
Dans les runions d'autrefois, les matrones font cercle selon un rite convenu. L'ge, tout
d'abord, a priorit avant la fortune ou la notorit. Chaque vieille pntre, la premire, dans
le vestibule coud, dbouche dans le patio aux cramiques bleuies; elle prcde sa bru,
qu'elle appelle sa marie , mme dix ans aprs la noce (comme si son fils s'tait content
de convoler par procura-tion), puis viennent ses filles veuves, divorces, ou encore vierges...
Et chacune de s'asseoir; les divans du centre sont rservs chaque dame en tte de la
proces-sion : seule elle parle haut, interroge, flicite, dis-tribue les bndictions, tandis
qu'elle se dvt du voile de laine immacule, que sa marie enlve son hak de soie
raidie, que chaque visiteuse s'ins-talle dans des touffes de bruissement.
La marie de chaque famille doit exposer, pen-dant deux ou trois heures, son visage, ses
bijoux anciens, ses soieries brodes; la belle-mre, tout en participant au dialogue, garde
l'il pos sur sa bru pour vrifier qu'elle suscite compliments et envie.
J'observe ce protocole du couloir ou d'un coin du patio; nous, les fillettes, nous pouvons
circuler tout en restant attentives aux clats, aux silences creuss par instants, dans le
brouhaha collectif.
Les jeunes femmes, maries ou veuves, sont installes le plus souvent sur des chaises;
elles s'immobilisent mal l'aise. J'imagine alors qu'elles doivent souffrir.
Pourquoi ne parlent-elles donc pas? demand-je quelquefois.
A peine si elles murmurent un remerciement, un compliment pour le caf ou la ptisserie;
peine si elles changent, d'une voix imperceptible, quelques salutations avec leurs voisines.
Les questions sont formules selon des termes conve-nus, avec des remerciements Dieu
et au Pro-phte. Quelquefois, l'ordre des politesses est si peu inchang que, d'un bout
l'autre de la pice, une visiteuse se contentera de remuer ses lvres l'intention d'une autre
:
Comment va le matre de ta maison ? Com-ment va ta couve? Et le Cheikh, que Dieu lui
accorde plerinage !
Et de mme, dans l'autre sens; salutations et bndictions s'entrecroisent dans un change
presque mim.
Les voix hautes des plus ges, un clat joyeux, quelquefois un rire gras ou une bauche
d'obsc-nit gouailleuse, rsonnent inopinment dans le lieu cras de parfums, par-dessus
les criailleries des enfants qui s'impatientent sur le seuil ou sur le tapis. Les matrones, une
fois caf, th et gteaux distribus, peuvent se dtendre. Sous forme d'allusions, de dictons
ou de paraboles, elles s'adonnent aux commrages sur telle ou telle famille absente.
Puis le retour se fait sur soi-mme, ou tout au moins sur l'poux, voqu par un il trop
prsent plutt que de se plaindre d'un malheur domestique, d'un chagrin trop connu (une
rpu-diation, une sparation momentane, une dispute d'hritage), la diseuse, voquant son
propre sort, conclura la rsignation envers Allah et envers les saints de la rgion.
Quelquefois ses filles reprendront, en commentaires chuchots mais prolixes, le thme
autobiographique de la mre. En traits rapides, en images incisives, elles esquisseront le
droul du malheur : l'homme rentr ivre et qui a frapp, ou au contraire lui victime de la
ruine, de la maladie, entranant le cortge des pleurs, des dettes, de la misre
irr-pressible... Ainsi se droule le thtre des cita-dines assises qui se font tmoins, tant
bien que mal, de leur propre vie.
Dans ces runions, peu importe, le spectacle des corps et le folklore des costumes : le
calicot et les srouals des vieilles datent du dbut du sicle, les roses d'or trembleuses au-
dessuS du front, les tatouages au harkous entre les sourcils peints des brus figes ne
changent pas depuis deux ou trois gnrations...
Chaque rassemblement, au cours des semaines et des mois, transporte son tissu
d'impossible rvolte; chaque parleuse celle qui clame trop haut ou celle qui chuchote trop
vite s'est lib-re. Jamais le je de la premire personne ne sera utilis : la voix a
dpos, en formules stro-types, sa charge de rancune et de rles chardant la gorge.
Chaque femme, corche au-dedans, s'est apaise dans l'coute collective.
De mme pour la gaiet, ou le bonheur qu'il s'agit de faire deviner; la litote, le proverbe,
jusqu'aux nigmes ou la fable transmise, toutes les mises en scne verbales se droulent
pour grener le sort, ou le conjurer, mais jamais le mettre nu.
La Seconde Guerre mondiale se termina, dans mon pays pargn mais qui avait livr son
impor-tant contingent de soldats tus au front, par un flambe nationaliste. Un enchanement
de vio-lences marqua le jour mme de l'Armistice.
Dans ma ville natale, on parla d'un complot djou de justesse : des armes voles
l'arsenal, une bombe clate l'hpital militaire. Les auteurs de ces troubles furent arrts
peu aprs.
Aux vacances d't qui suivirent, je participai une crmonie inaccoutume, qui rappelait
les enterrements. Le neveu de ma grand-mre, arrt parmi les comploteurs, avait t
condamn aux travaux forcs, comme un brigand.
Afflux des voiles blancs des visiteuses; la litur-gie du deuil ennoblissait la maison modeste,
o habitait la jeune sur de ma grand-mre. tait-ce une mort sans cadavre? Nous
stationnions, grappes d'enfants interloqus, dans le vestibule : les matrones entraient,
s'installaient sur les mate-las, dodelinaient de la tte pour partager le lamento de la mre qui,
le front serr d'un ban-deau blanc, se laissait aller, par convulsions suraigus, au droul de
sa douleur.
Nous qui regardions, nous nous sentions fasci-ns du manque trange : l'absence de
cadavre altrait la crmonie. Du rite habituel, ne se conservaient que les paroles, que la
solidarit et la soumission fminines, raffirmes durant la psal-modie de la mre... Au
retour, nous entendmes parler, par bribes, de travaux forcs (condam-nation inattendue
pour ce fils qu'on n'enterrait point, mais qu'on pleurait), d'une bombe, d'un vol d'armes : tout
un roman tait voqu mi-voix par les bourgeoises, sur le ton de la commisra-tion ou de
la fatalit.
Je fus frappe par le verdict formul par ma grand-mre : non sur le neveu qu'elle s'abstint
de juger en hros ou en voleur de grand chemin, ni sur le malheur qui touchait sa famille
dont elle se voulait le porte-parole. Mais elle condamna sa sur parce qu'au cours de ce
rassemblement, celle-ci avait expos son chagrin avec un excs d'emphase. L'essentiel,
pour l'aeule, tait de se maintenir la hauteur du rle que heur ou malheur vous imposait.
Le neveu fut graci l'anne suivante : je ne me souviens pas que ma grand-mre revnt, elle,
sur son jugement l'gard de sa cadette qui avait dshabill trop lyriquement sa peine.
Dans les lieux peine changs aujourd'hui de la demeure familiale, c'est ce tribunal
qu'incarne, pour moi, le fantme de l'aeule morte.
Comment une femme pourrait parler haut, mme en langue arabe, autrement que dans
l'attente du grand ge ? Comment dire je , puis-que ce serait ddaigner les formules-
couvertures qui maintiennent le trajet individuel dans la rsi-gnation collective?... Comment
entreprendre de regarder son enfance, mme si elle se droule dif-frente ? La diffrence,
force de la taire, dispa-rat. Ne parler que de la conformit, pourrait me tancer ma grand-
mre : le malheur intervient, inventif, avec une variabilit dangereuse. Ne dire de lui que sa
banalit, par prudence plutt que par pudeur, et pour le conjurer... Quant au bonheur, trop
court toujours, mais dense et pulpeux, concentrer ses forces en jouir, yeux ferms, voix en
dedans...
Laminage de ma culture orale en perdition : expulse onze, douze ans de ce thtre des
aveux fminins, ai-je par l mme t pargne du silence de la mortification? crire les plus
ano-dins des souvenirs d'enfance renvoie donc au corps dpouill de voix. Tenter
l'autobiographie par les seuls mots franais, c'est, sous le lent scalpel de l'autopsie vif,
montrer plus que sa peau. Sa chair se desquame, semble-t-il, en lambeaux du parler
d'enfance qui ne s'crit plus. Les blessures s'ouvrent, les veines pleurent, coule le sang de
soi et des autres, qui n'a jamais sch.
Sous les projecteurs des mots voraces ou dfor-mants, la nuit ancestrale se dploie. Avale
le corps dans sa grce d'phmre. Nie les gestes dans leur spcificit. Ne laisse subsister
que les sons.
Parler de soi-mme hors de la langue des aeules, c'est se dvoiler certes, mais pas
seule-ment pour sortir de l'enfance, pour s'en exiler dfinitivement. Le dvoilement, aussi
contingent, devient, comme le souligne mon arabe dialectal du quotidien, vraiment se
mettre nu .
Or cette mise nu, dploye dans la langue de l'ancien conqurant, lui qui, plus d'un sicle
durant, a pu s'emparer de tout, sauf prcisment des corps fminins, cette mise nu renvoie
tran-gement la mise sac du sicle prcdent.
Le corps, hors de l'embaumement des plaintes rituelles, se retrouve comme fagot de
hardes. Reviennent en cho les clameurs des anctres dsaronns lors des combats
oublis; et les hymnes des pleureuses, le thrne des spectatrices de la mort les
accompagnent.
VOIX
Mes fils sont monts au maquis tous les quatre. Le jour o l'on a arrt sept maquisards d'un
coup, deux de mes fils s'y trouvaient. Ils les ont enchans ensemble. Quelqu'un d'ici, un
chef des goumiers a dit :
Tout ce complot, c'est sous l'organisation de votre mre... Ahmed!
Ce fils n'avoua rien. Ses autres frres lui avaient envoy un message de l-haut : Si nous
enten-dons dire que tu as lch un mot, nous viendrons nous-mme t'abattre!
Ils me laissrent finalement ce dernier; il resta avec moi... Pour que je puisse voir les autres,
il me fallait faire des voyages! Pendant longtemps je restai sans nouvelles de l'un d'eux,
Malek. Je me disais : Il doit tre mort ! Un parent vint me voir de la ville :
Tu as des nouvelles de tes fils? me demanda-t-il.
De tous, sauf de Malek, soupirai-je. Il est mort sans doute !
Il eut comme une ombre de sourire, mais il se taisait.
Puisque je vois ton sourire, dis-je, peut-tre as-tu des nouvelles?
Il se baissa alors pour me baiser la tte :
Il se trouve en ville, chez Kaddour, mais tiens ta langue, chuchota-t-il en partant.
Malek avait pass beaucoup de temps au maquis. Il tait tailleur de profession. Il m'avait pris
ma machine coudre Singer et il travaillait pour les Frres... Au dbut, j'avais piqu moi-
mme les uniformes. Mais comme il fallut s'occuper des marmites, je ne pouvais tout faire !
Alors Malek avait emport la machine la mon-tagne... A l'poque, la ferme me rapportait
encore un peu de bien. Je pus en acheter une autre. Mais les soldats de la France me l'ont
casse en mor-ceaux, par la suite.
Comme j'tais fire des uniformes que je confectionnais ! Sans vanit, les miens taient les
mieux coups! Tu en dpliais un, tu le suspen-dais : tu arrivais peine croire qu'il n'tait
pas achet au magasin !
Tout le monde parle encore de l'avion que les maquisards ont abattu. On a trouv chez moi
une des pices de l'avion et les gens ont su que cet exploit revenait celui de Kola .
C'est le sur-nom donn mon fils an, dans la rgion.
Bien avant la guerre, il aimait la musique, il aimait la poudre et la noce. Quand les gens
allaient la fte de Sidi Mhamed Ben Youcef, le marabout, ils lui disaient :
Viens avec nous la fte avec poudre et musique, pour accueillir le prfet et le sous-pr-
fet!
Moi, je n'aime pas les ftes ainsi! rpon-dait-il. J'irai me distraire Kola, l-bas, je ne suis
pas connu, je m'amuserai d'une bien autre faon !
C'est pourquoi on l'appela l'ami de Kola , alors qu'il s'appelle Sahraoui comme moi ! Il vit
Hadjout prsent. Il a son ventre tout dform et cela me dsole !
Dans un accrochage il s'est battu au corps corps. Un combat l'arme blanche ! Ses
intestins sont sortis de son ventre entrouvert! Un paysan lui donna le tissu de sa coiffe pour
ficeler son ventre et maintenir tout, peu prs. Deux jours plus tard, un mdecin du maquis
l'examina et lui cousit l'abdomen. Il n'en est pas mort certes, mais le voil infirme !
Il reste aussi vaniteux qu'il l'tait avant-guerre. Et aussi entt! En outre, depuis l'enfance, il
garde une mauvaise habitude : il n'a pas peur, il ne sait pas avoir peur ! Le voil dsormais
avec un ventre tout dform, lui qui tait un si bel homme ! Mme quand il porte une belle
veste, et je sais combien il est coquet, les gens doivent se demander ce qu'il tient sur sa
hanche!...
La seconde fois o les soldats me brlrent la demeure, le feu se dveloppait, le feu
man-geait et le toit partait en morceaux... Moi, j'entrai dans ce feu en me disant : mme
si je ne sauve qu'un matelas, ce sera toujours cela, pour dormir dessus !
J'en sortis donc un matelas; le feu le mordait par le coin. Je le plongeai dans l'eau de l'oued;
j'teignis le feu. Les soldats me dirent, pour se moquer : Tu le rserves aux fellagha? Ils
revinrent incendier une nouvelle fois. Ils nous trent mme les vtements que nous
portions... Ma sur, que Dieu ait son me, plus vieille que moi, mourut de cette peine! Ils
nous enlevrent les habits et nous laissrent tels quels, tels que notre mre nous a faits!...
Je fis parvenir un message une parente du village. Elle nous envoya du linge. De nouveau,
ils revinrent et nous laissrent dmunis... Quelles preuves raconter et lesquelles laisser
l'oubli?...
A la petite fille que j'avais adopte, je rptais :
Quand ils t'interrogent, mets-toi aussitt pleurer! S'ils te disent : Ta mre, qui vient
chez elle? Que fait-elle? , il faut te mettre pleurer aussitt... Si tu dis un mot, ils
t'interrogeront davantage ! Pleure, ne fais que cela !
Elle agissait ainsi. Elle pleurait, elle se roulait dans le sable, elle s'enfuyait tout en pleurs.
Quand elle arrivait chez moi, je m'inquitai :
T'ont-ils frappe?
Non, me disait-elle, ils m'ont interroge, j'ai pleur, ils ont voulu me donner de l'argent. J'ai
refus et j'ai fui !
Ils croyaient qu'elle savait ce qu'tait l'argent. Or, de l'argent en billets, elle n'en voyait jamais
: certes elle tait petite, mais c'tait surtout parce qu'elle vivait la montagne. En montagne,
qui voit un billet ?
Quand je suis venue au village, je l'ai mise l'cole; mais cela dura si peu de temps...
Au village, un garon nous a vendues . Il est all leur dire :
La mre des Moudjahidine est alle Izzar ! Tante Zohra de Ben Semmam est partie l-
bas !
Je dormais quand ils sont venus frapper ma porte :
Qu'y a-t-il ?
L'officier te demande : il veut te dire un ou deux mots !
Je dcidai d'y aller. Ma fillette et ma sur (c'tait donc avant la mort de celle-ci) se sont
mises me suivre ; elles pleuraient.
Ne pleurez pas, leur ai-je ordonn. Ne pleu-rez pas sur moi ! J'interdis qu'on pleure sur
moi !
Le garon leur avait tout rapport : que j'avais rencontr les Frres, ce qu'ils avaient mang,
combien ils taient. Les Frres m'avaient demand : Es-tu au courant des mouvements
prochains des Franais ? Je leur avais rpondu : Je ne sais pas, pour l'instant, mais
envoyez-moi quelqu'un demain l'aube. Vous aurez le ren-seignement! Toutes ces
paroles, le garon tait all les dire!...
A mon retour de chez les Frres, je m'tais ren-seigne au village; j'avais su que les
Franais allaient monter l-bas. J'avais transmis le ren-seignement... Voil que je me
trouvais mainte-nant devant l'officier franais !
C'est l que j'ai rencontr une nomme Kha- didja. C'tait une femme riche : bien avant la
guerre dj, elle avait pas mal de bien, puis elle s'tait mise acheter, acheter! Elle
dirigeait, que Dieu loigne de nous le mal, une maison, la mauvaise , une maison de
tolrance... Malgr cela, elle tait alle au plerinage La Mecque. Puis elle s tait dit ; Je
vais donner du bien aux Moudjahidines. Peut-tre alors que Dieu me par-donnera ! Elle
leur avait donn trois cents pices d'or!... Aprs quoi, quelqu'un l'a vendue : un homme qui
livrait, parat-il, des mdicaments aux Frres.
Je rencontrai donc cette femme dans cette anti-chambre :
Qui t'a amene l, Khadidja ? demandai-je.
Il en est de moi comme de toi ! rpondit-elle. Sur toi a svi la trahison; sur moi, de
mme!... Dieu a voulu notre rencontre dans ce lieu et en ces circonstances !
Cette fois, je fus interroge l'lectricit jusqu'... jusqu' croire en mourir! J'avais dit: Je
ne veux pas qu'on pleure sur moi ! Si j'avais su qu'ils allaient m'interroger l'lectricit, je
ne serais pas alle, n'importe quel prix! Autant mourir sur place.
Je revins de nouveau la montagne avec ma fille. Nous allions apporter la semoule aux
Frres. Nous cherchions dans la fort o l'entreposer. Il fallait aussi trouver o la ptrir, o la
prparer. Une fois, sur le retour, nous avons aperu les sol-dats au loin.
Nous avons fui vers l'oued. Nous sommes entres dans une guelta un peu profonde. La
maison tait en feu. De ce foyer, se projetaient d'normes braises, ainsi que des morceaux
de poutre enflammes... Nous nous cachions, mais ces projectiles de feu tombaient sur
nous. J'en reus sur la tte.
La fillette, menue, tait couverte entirement par l'eau de la guelta . Moi, seulement
moiti. Le feu prit mes cheveux. Et la petite qui pleurait d'effroi :
Mre, le feu te mange ! Le feu te mange !
C'est ainsi que j'ai perdu tous mes cheveux. Je me jetai dans l'eau. Mais d'autres braises me
tom-baient dessus. Nous ne pouvions quitter l'endroit. Je garde depuis ces cicatrices sur le
front et le cou...
Toute une journe nous nous sommes caches dans la mare. Elle et moi, toutes seules! Les
Frres avaient fui dans la fort. Les soldats ont commenc partir. J'entendais leur
martlement. Ils ont rejoint la route romaine et sont monts dans leurs camions; le
crpuscule approchait... Un silence se fit un certain temps.
O Fatiha, tu es toute petite, dis-je. De loin on te prendrait pour un poussin ou pour une
petite chvre... Grimpe jusqu' la colline et regarde!
Ce qu'elle fit; elle revint me dire :
Ils sont monts dans leurs camions qui s'loignent. Sors!
Je suis sortie. Nous tions libres. Nous nous sommes mises marcher. O aller maintenant,
c'est la nuit! Nous avons march, march... Nous avons trouv un ouali . Nous avons
pass la nuit l, au-dehors, prs du tombeau du Saint. Nous avons eu honte d'aller frapper
chez les gens. Nous sommes restes l jusqu'au moment o le jour a point. Alors seulement,
nous avons frapp chez la dame, la fille de Sid Ahmed Tahar.
O tiez-vous, petite mre? m'a-t-elle demand.
C'est maintenant que nous arrivons, ai-je rpondu.
Je n'ai pas voulu dire que nous avions pass la nuit dehors. Je craignais qu'on ne se moque
de nous... Car ils rient! Ils rient, ceux qui rien n'arrive !
Je n'ai pas voulu parler de l'incendie. Peut-tre mme qu'ils se rjouissent, ceux qui ne
connaissent pas le malheur ? Je lui rptai :
Nous errions dans la fort... C'est mainte-nant que nous arrivons ta porte !
Je dois convenir qu'elle nous accueillit avec gards. Elle nous fit du pain. Nous avons mang
et bu le ncessaire. Puis nous sommes parties. Nous n'avons pas pass la nuit chez elle.
Elle ne nous a rien dit, et nous, nous ne sommes pas res-tes. Les gens n'aiment pas abriter
ceux qui comme nous, font arriver derrire eux, la France !
Nous sommes parties. Nous avons err ici et l-
Aprs tous ces malheurs, j'en suis arrive ce qu'on me traite de folle . Les gens se sont
mis me considrer ainsi, me dire que j'tais folle . En fait, ils avaient peur :
Voici venir la folle, fermez la porte !
C'est vrai qu'aprs que mes cheveux eurent brl, j'ai d tre malade plusieurs mois... Mes
fils se sont occups de moi. Us ont fait des dmarches. On m'a soigne. J'allais mieux. J'ai
d avoir un choc la tte ; mme maintenant, j'ai des pertes de mmoire...
Les Frres aussi se sont occups de moi. Grce eux, je suis gurie. Mais les gens
continuaient fermer leur porte la folle . Ils avaient peur : c'tait cela la vrit; surtout
ceux du village. Ils disaient :
Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, ceux-l? Us nous apportent le malheur!
Je suis alle nouveau chez Djennet, Had- jout ; je n'avais plus rien me mettre. Je
cherchais un pantalon bouffant pour le desserrer la taille et m'en couvrir la tte, m'en servir
comme un voile; je n'ai pas trouv. Qui m'aurait donn un voile ?
J'ai donc dcid d'aller chez Djennet. Il fallait prendre le car. J'ai emport un couffin de
lgumes et... Quand Dieu veut t'aider... Un homme cherchait justement acheter des
oignons. Je l'ai rencontr, je lui ai procur ce qu'il voulait, ainsi, j'ai pu prendre le car !
J'arrivai chez Djennet, sans voile, ni burnous!...
CORPS ENLACS
Lia Zohra, de Bou Semmam, est ge de plus de quatre-vingts ans. Je franchis le seuil de
sa demeure actuelle, la sortie du village de Mnaceur. Je m'engage dans l'alle qui
traverse son potager qu'elle entretient elle-mme, sous un noyer et un abricotier qu'elle me
fera admirer.
Seconde porte, bruit lger du heurtoir qui fait suspendre la berceuse de la machine coudre.
Les chambres peintes la chaux donnent sur un modeste patio; de l, on aperoit les flancs
de la montagne, le Pic Marceau avec ses miradors dsaffects.
Une jeune femme, la couturire, sort la pre-mire. Puis vient la vieille htesse. Nous nous
embrassons, nous nous touchons, nous nous admirons. Je m'assois. Je rappelle la mort de
l'aeule, survenue au lendemain de l'indpen-dance. Depuis, je n'avais plus rencontr Lia
Zohra.
Nous tions cousines, ta grand-mre et moi, dit-elle. Je te suis certes plus proche par le
pre de ta mre; nous sommes de la mme fraction, de la mme tribu. Elle, elle m'est lie
par une autre alliance, par les femmes !
J'coute l'cheveau de la gnalogie se dvider : de telle montagne telle colline, en
passant par la zaouia , par le hameau, puis enserrant le cur de la ville. Je bois le caf.
Je finis par dire :
Je suis venue pour rester une nuit!... Nous avons le temps !...
Sa voix creuse dans les braises d'hier. Au fond du patio, pendant que les versants de la
montagne changent de nuances au cours de l'aprs-midi, la machine coudre reprend son
antienne. La cou-turire, fille adoptive de la conteuse, n'coute pas ; elle ne veut pas
s'engloutir. Plus tard, elle me demandera comment faire pour travailler la cit voisine, la
poste ou dans une cole maternelle...
J'ai accept, petite mre, de te conduire jusqu' ta ferme, en pleine montagne. Aprs deux
heures de marche sur des sentiers pineux, nous avons trouv le sanctuaire, tu l'appelles
le refuge , empruntant le mot franais peine dform : des murs encore debout se
dressent dans des dcombres. Leur pied noirci est souill par des tranes de feux teints,
ceux qu'allument les rdeurs d'aujourd'hui.
L, ta voix a poursuivi le rcit. Le soleil demeu-rait haut. Tu t'es assise, le voile rabaiss la
taille, parmi les ajoncs et les herbes de printemps. Ton visage finement rid mais austre
une rverie fermant lgrement ses traits , je le photogra-phiai parmi les coquelicots... Le
soleil baissa peu peu. Nous sommes revenues dans le silence du soir.
Dire mon tour. Transmettre ce qui a t dit, puis crit. Propos d'il y a plus de un sicle,
comme ceux que nous changeons aujourd'hui, nous, femmes de la mme tribu.
Tessons de sons qui rsonnent dans la halte de l'apaisement...
Laghouat, t 1853. Le peintre Eugne Fro-mentin a sjourn, l'automne et le printemps
pr-cdents, dans un Sahel endormi, tel le ntre aujourd'hui, petite mre.
L't commence. Cdant une pulsion, il se prcipite vers le Sud. Six mois auparavant,
Lag-houat a vcu un terrible sige. Oasis prise par les Franais, maison aprs maison. Les
charniers sous les palmiers se devinent encore, tandis que Fromentin (comme moi qui
t'coute tous ces jours) entend son ami raconter :
Tenez, me dit le lieutenant en s'arrtant devant une maison de la plus pauvre apparence...
Voil une mchante masure que je voudrais bien voir par terre.
Et chemin faisant, il me raconta l'histoire sui-vante en quelques mots brefs empreints d'un
triste retour sur les hasards cruels de la guerre.
Dans cette maison qui, depuis la prise de la ville, a chang de matre, habitaient deux Nay-
lettes fort jolies
Fatma et Mriem, les naylettes , vivent en danseuses-prostitues l'oasis. Elles ont tout
au plus vingt ans. Quinze ans auparavant, l'mir Abdelkader a attaqu El-Mahdi, prs de
Lag-houat, pour tenter de soumettre les seigneurs du Sud et unifier sa rsistance contre le
Chrtien... Ont-elles, dans cette guerre civile, perdu leur pre, certains de leurs frres?
Supposons-le; lorsque nous rencontrons ces deux femmes dans cette embarde du pass,
elles tirent commerce de leur beaut en fleurs...
1. Eugne Fromentin, Un t au Sahara.
Si elles devaient vivre jusqu' quarante ans, petite mre, peut-tre deviendraient-elles des
Khadidja, comme celle que tu accompagnas dans le corridor des tortures : des pcheresses
avec du bien, cherchant aller en plerinage pour se faire pardonner et apporter de l'or
aux Parti-sans !
Quelques mois, ou quelques semaines avant le sige de Laghouat, Fatma et Mriem
reoivent en secret deux officiers d'une colonne franaise qui patrouille dans les parages :
non pour trahir, sim-plement pour une nuit d'amour, que Dieu loigne de nous le pch !
Aprs le combat de rues des 4 et 5 dcembre, les cadavres furent si nombreux que les
puits de l'oasis se remplissent ! expliquai-je.
Et Fatma? Et Mriem? interrompt Lia Zohra qui se surprend suivre cette histoire comme
une lgende d'ade.
O as-tu entendu raconter cela? reprend- elle avec impatience.
Je l'ai lu ! rtorqu-je. Un tmoin le raconta un ami qui l'crivit.
Le lieutenant, l'un de ceux qui furent reus par les Naylettes, fait partie de la premire
compa-gnie d'attaque. Il combat tout le jour. Dans une accalmie on se battait jusqu'au
cur de la ville , prcise-t-il , reconnaissant soudain cer-tains des lieux, il se dirige, avec
son sergent, jusqu' la demeure des danseuses.
Un soldat en sort : sa baonnette rougie de sang s'goutte dans le canon. Deux complices,
les mains pleines de bijoux de femmes, le suivent et se sauvent.
Trop tard! se dit le lieutenant qui pntre dans la maison autrefois amie.
Et c'est le crpuscule.
Fatma tait morte, Mriem expirait. L'une sur le pav de la cour, l'autre au bas de l'escalier
d'o elle avait roul la tte en bas : le tmoin parle, le peintre crit.
Deux corps de jeunes danseuses quasiment nues jusqu' la ceinture, les hanches visibles
travers la dchirure du tissu, sans coiffe ni dia-dme, ni pendeloques, ni anneaux de cheville,
ni collier de corail, de pices d'or, ni agrafes de ver-roterie... Dans la cour, le fourneau est
rest allum ; un plat de couscous vient d'tre servi. Le fuseau charg de laine, du mtier
tisser, est pos, immuable; seul le coffre en bois d'olivier, parce que vid, penche sur le ct,
ses charnires arraches.
Mriem, en expirant dans mes bras, laissa tomber de sa main un bouton d'uniforme
arrach son meurtrier! soupire le lieutenant arriv trop tard.
Six mois aprs, l'officier donne ce trophe Fromentin qui le garde. Fromentin ne dessinera
jamais le tableau de cette mort des danseuses. Est-ce cet objet palp qui transforme le
peintre des chasses algriennes en crivain du deuil?... Comme si la main de Fromentin
avait prcd son pinceau, comme si la transmission s'tait coa-gule dans les seuls
vocables...
La main de Mriem agonisante tend encore le bouton d'uniforme : l'amant, l'ami de
l'amant qui ne peut plus qu'crire. Et le temps s'annihile. Je traduis la relation dans la langue
maternelle et je te la rapporte, moi, ta cousine. Ainsi je m'essaie, en phmre diseuse, prs
de toi, petite mre assise devant ton potager.
Ces nuits de Mnacer, j'ai dormi dans ton lit, comme autrefois je me blottissais, enfant,
contre la mre de mon pre.
TROISIME MOUVEMENT
LA COMPLAINTE D'ABRAHAM
Chaque runion, pour un enterrement, une noce, est soumise d'implacables lois : respecter
rigoureusement la sparation des sexes, craindre que tel proche ne vous voie, que tel
cousin, ml la foule masculine masse dehors, ne risque de vous reconnatre quand,
voile parmi les voiles, vous sortez, ou vous rentrez, perdue dans la cohue des invites
masques.
L'initiation religieuse elle-mme ne peut tre que sonore, jamais visuelle : nul office o
l'ordon-nance des personnes, le code des costumes et des postures, le droul hirarchique
du rite frappe-raient la sensibilit de la fillette. L'motion, quand elle jaillit, n'est provoque
que par la musique, que par la voix corrode des dvotes invoquant la divinit. A la
mosque, dans le coin rserv aux femmes, ne s'accroupissent que les vieilles, qui n'ont
plus de voix.
Dans la transmission islamique, une rosion a fait agir son acide : entrer par soumission,
semble dcider la Tradition, et non par amour. L'amour qu'allumerait la plus simple des
mises en scne apparat dangereux.
Reste la musique. J'coute le chant des dvotes quand, enfants en vacances, nous
accompagnions nos parentes, chaque vendredi, la tombe du saint protecteur de la ville.
Dans l'ombre de la masure fruste, aux murs de pis, au sol tapiss de nattes, des dizaines
d'ano-nymes, venues des hameaux et des fermes voi-sines, se lamentent, psalmodient dans
ce lieu cras d'odeurs. Par ses miasmes de transpiration et de moiteur, l'atmosphre me
rappelle l'anti-chambre d'un hammam o le ruissellement loin-tain des fontaines serait
remplac par le mur-mure des voix corches.
Mais, sur ce seuil d'motions criardes, je ne me sens pas saisie d'exaltation mystique ; de
ces rcri-minations des fidles voiles ( peine si elles ouvrent l'chancrure du drap sur leur
face tum-fie), je sentais l'cret des plaintes, l'air de vic-time des chanteuses... Je les
plains ou je les trouve tranges, ou effrayantes. Les bourgeoises, qui m'environnent et qui se
sont faites belles pour cette visite, ne se laissent pas ainsi aller. Ma mre, les cousines de
ma mre s'approchent; quelques formules coraniques prononces en hte au-des-sus du
catafalque du saint, un baiser esquiss de la main, elles sortent : notre groupe reste l'cart
de la religiosit populaire exacerbe.
Par un sentier, nous descendons jusqu' une crique abrite o les femmes peuvent prendre
des bains de mer l'abri des regards.
Aller au marabout , c'est visiter le saint qui console par sa prsence mortuaire. Pour mes
parentes, le mort semble secourable, et mme bnfique, parce qu'il a eu la politesse, il y a
deux ou trois sicles, de venir trpasser tout prs de la plage. Or, ce prtexte du plerinage
ne pouvait abuser mon oncle qui voyait, en t, son autorit s'largir toute la parentle. Il
voulait bien feindre d'ignorer que nous nous livrions aux plai-sirs profanes des bains de mer
plutt qu'aux dvo-tions annonces.
Mon premier moi religieux remonte plus loin : dans le village, trois ou quatre annes de
suite, le jour de la fte du mouton dbute par la complainte d'Abraham .
Aubes d'hiver frileuses, o ma mre, leve plus tt que d'habitude, allumait le poste de radio.
Le programme arabe comportait invariablement, en l'honneur de la fte, le mme disque : un
tnor clbre chantait une mlope dont une dizaine de couplets mettait en scne Abraham
et son fils.
Cette coute, dont la rgularit annuelle a scand mon jeune ge, modela, je crois, en moi
une sensibilit islamique.
Dans la pnombre de l'aurore, je me rveille sous la tendresse de la voix du chanteur, un
tnor que Saint-Sans finissant sa vie Alger, avait encourag, alors qu'il dbutait comme
muezzin. L'artiste, droulant les couplets, interprtait tous les personnages : Abraham qui,
dans un rve lan-cinant ses nuits, voyait l'ange Gabriel exiger, au nom de Dieu, le sacrifice
du fils ; l'pouse d'Abra-ham ignorant que son garon, par de sa djellaba de fte, tait
emmen la mort; Isaac lui-mme qui avance dans la montagne avec innocence, tonn
que le corbeau sur la branche lui parle de trpas...
Suspendue au drame biblique qui commenait, je ne sais pourquoi ce chant me plongeait
dans une motion si riche : la progression du rcit la fin miraculeuse, chaque personnage
dont la parole rendait la prsence immdiate, le poids de la fatalit et de son horreur qui
pesait sur Abra-ham, contraint de voiler sa peine... Autant que la tristesse du timbre (mon
corps, entre les draps, se recroquevillait davantage), la texture mme du chant, sa diaprure
me transportaient : termes rares, pudiques, palpitants d'images du dialecte arabe. Cette
langue que le tnor savait rendre simple, frissonnait de gravit primitive.
La femme d'Abraham, Sarah, intervenait dans le couplet, comme ma mre, quand elle nous
dcrivait ses joies ou ses craintes, ses pressenti-ments. Abraham aurait pu tre mon pre,
qui, lui, ne parlait jamais pour livrer son motion, mais qui, me semblait-il, aurait pu... L'moi
me saisis-sait aussi devant la soumission du fils ; sa vnra-tion, sa dlicatesse dans le
poids de la peine et cette perfection mme me plongeaient dans un autre ge, la fois plus
naf et plus grand :
Puisque tu devais me tuer, mon pre,
Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?
J'aurais pu treindre ma mre satit!...
Prends garde, en te baissant pour me sacrifier,
de ne pas tacher, de mon sang, le pan de ta toge !
Ma mre, quand tu lui reviendras, risquerait
de comprendre trop vite !
J'aimais la fracheur du chant d'Isaac qui droulait en strophes lentes la dramaturgie du rcit.
Palpitation de cette musique...
A la mme poque, le rcit d'une tante qui dbi-tait en multiples variations une biographie du
Prophte, me rapprocha de cette motion...
Le Prophte, au dbut de ses visions, revenait de la grotte tellement troubl qu'il en
pleurait , affirmait-elle, trouble elle-mme. Lalla Khadidja, son pouse, pour le rconforter,
le mettait sur ses genoux , prcisait la tante, comme si elle y avait assist. Ainsi,
concluait-elle toujours de la mme manire, la premire des musul-manes et des musulmans
tait une femme, peut- tre mme avant le Prophte lui-mme, qu'Allah l'ait en sa
sauvegarde ! Une femme avait adhr la foi islamique, historiquement la premire, par
amour conjugal , affirmait ma parente.
D'une voix triomphante elle faisait revivre maintes fois cette scne; j'avais dix, onze ans peut-
tre. Auditrice rticente soudain, car je n'avais vu de manifestation d'amour conjugal que
dans la socit europenne :
Est-ce donc cela un Prophte? m'offusquais-je. Un homme que sa femme met sur ses
genoux ?
La tante avait un sourire discrtement atten-dri... Des annes plus tard, je m'attendris mon
tour : pour un autre dtail qu'elle rapportait. Bien aprs la mort de Khadidja, Mohamed ne
pouvait dominer son trouble en une circonstance particulire : quand la sur de sa femme
morte approchait de la tente, le Prophte, boulevers, disait que la sur avait le mme bruit
de pas que la dfunte. A ce son qui ressuscitait Khadidja, le Prophte se retenait mal de
pleurer...
L'vocation de ce bruit de sandales me donne-rait par bouffes un dsir d'Islam. Y entrer
comme en amour, un bruissement griffant le cur : avec ferveur et tous les risques du
blasphme.
VOIX
Nous terminions le repas du soir. J'ai donn mon jeune fils une coupe confiture, avec une
petite cuillre en argent. Je tenais celle-ci de mon pre.
Marie de quelques jours je n'avais pas quinze ans , j'tais alle voir mon pre et je
buvais avec lui du caf. Soudain :
Pre, je voudrais prendre cette petite cuil-lre ! lui demandai-je.
Prends-la, rpondit-il. Prends les tasses, regarde autour de toi et prends ce que tu veux
d'ici, ma fille !
Pre, lui dis-je, je ne veux que cette cuillre, parce que tu l'utilises toujours pour ton caf !
Elle est si chre mon cur!
Je la gardai depuis ce temps, et cela dura trente ans au moins, ou peut-tre quarante... Or
cette nuit dont je parlais, les maquisards taient chez nous. Ils avaient bu et mang. D'autres
surveil-laient les environs. Au caf, je tends le confiturier mon fils pour qu'il leur en serve et
j'y mets, je ne sais pourquoi, la cuillre en argent. A peine tait-il sorti de la pice que la
France fit faire une pousse en avant ses troupes. Les balles se mirent tomber de
partout !
C'est ainsi que mon garon partit avec eux : le confiturier jet, mais cette cuillre la main...
Comme s'il emportait la bndiction de mon pre, que Dieu garde celui-ci dans son salut !
Ainsi mon dernier partit avec les maquisards. Il tait si jeune : peine quatorze ans ! Certes,
il avait l'esprit vif, et ptillant d'intelligence. Plus tard, un autre de mes fils, plus g et dj
mari, vint me voir :
Tu devrais, dit-il, demander aux maquisards de te le rendre, il est trop jeune !
coute, lui rpondis-je, s'il revient et si l'ennemi l'interroge, suppose qu'il flanche et qu'il
dise tout ce qu'il sait?... Nous serions dshono-rs ! Laisse-le : s'il doit mourir, il mourra en
hros et s'il est destin vivre, il vivra la conscience fire !
Kaddour resta donc au maquis. Il tait jeune certes, mais il avait de l'instruction. De tous ses
frres, c'tait lui qui avait le plus d'allant...
Une fois, Mustapha, un autre de mes fils, vint de Marceau :
Mre, me dit-il, pre vient d'tre emmen chez l'officier franais qui va l'interroger sur
Kad-dour. Ils ont remarqu qu'il n'tait plus l.
Quand Dieu veut assurer son salut quelqu'un, il le fait! Avant son dpart au maquis,
Kaddour n'aidait en rien pour tout ce qui tait tche manuelle : il n'aurait pas port un bidon,
pour le remplir!... Mais il y eut la grve des coliers : des petits et des grands. Il dut rester
la ferme sans rien faire. On cherchait des saisonniers pour la cueillette du raisin en plaine.
Une Franaise, la fille Moulios, donnait les autorisations de travail pour la cueillette. Kaddour
alla la voir :
Donne-moi une autorisation lui dit-il pour que j'aille travailler comme saisonnier en
plaine! Avec cette grve, je ne supporte pas de rester sans rien faire...
Lui, c'tait juste pour avoir un permis de cir-culer. Il n'avait nullement l'intention d'aller
tra-vailler chez les autres : il tait trop fier pour cela et, comme je l'ai dit, question travail
manuel, il tait paresseux !
La fille Moulios lui donna cette autorisation. Il me la montra :
Eh bien, va travailler! lui dis-je.
J'avais si peur, quand il circulait cette poque, que les goumiers se saisissent de lui et le
frappent, ou le provoquent... Il y eut alors cette nuit d'alerte chez nous; il partit avec les
Moud-jahidine. Quelques semaines aprs, les Franais interrogeaient son pre :
O est le petit?
Il a demand une permission pour aller tra-vailler en plaine! rpondit le pre et il cita la
Franaise. Interroge, elle reconnut avoir donn cette autorisation. Il parat que l'officier
tlphona toutes les fermes voisines, jusqu' Marengo. En vain ! Ils finirent par conclure
qu'il tait mort quelque part.
Bien avant ces vnements, j'entends frapper la porte, en pleine nuit et plusieurs
reprises. Je me trouvais seule la ferme, avec mes brus et les enfants. Je n'ouvris pas.
Or, peine avais-je pos la tte sur l'oreiller que je sombrai dans un profond sommeil. Je fis
un rve qui me rveilla : deux tres, comme des ombres mais tout claires, se dressaient
devant moi et s'adressaient ainsi moi :
O Lia Hadja (je n'tais pourtant pas encore alle La Mecque), certes tu as eu peur et
nous te comprenons :
tu nous croyais bande de goumiers or nous sommes, du Prophte, les hritiers!... Ils
parlrent ainsi, en prose rime et ils rptrent cette dernire affirmation qui me rveilla et
me plongea dans le remords; c'tait vrai, par mfiance, cette nuit-l, je n'avais pas ouvert la
porte aux maquisards !
Us prirent l'habitude de venir, de dner, de veil-ler, puis de repartir dans la nuit. Je les faisais
entrer toujours dans la mme chambre. Dans la journe, je gardais cette pice vide. Il
m'arrivait de me dresser sur son seuil et de me dire : Cette chambre o entrent les fils de la
Rvolution deviendra verte, verte, verte, comme une pastque ferme, et ses murs, un jour,
ruisselleront tout entiers de vapeur de rose ! Voici que moi aussi, comme les ombres du
rve, je m'exprime en prose rime !
Une nuit o les Moudjahidine taient venus, leurs souliers transportrent la boue des
chemins jusque dans cette chambre.
Non, non, ne vous gnez pas ! Nous nettoie-rons demain !
Je me sentais le cur lger; je voulais qu'ils s'asseyent partout, qu'ils aient un peu d'aise. Je
leur fis apporter tous les coussins. Je demandai qu'on leur prsente des brocs d'eau et du
savon, puis des aiguires! Le lendemain... il fallut enle-ver la boue sche du seuil coups
de pioche! Pourtant, Dieu nous a gards toujours dans son salut !
CHUCHOTEMENTS..
En avril 1842, la zaouia des Berkani est brle; femmes et enfants errent sur les neiges des
pentes montagneuses cette anne-l, l'hiver fut rigou-reux. Les cadavres nourriront les
chacals.
Les Franais repartent; leur chef, le commandant de Saint-Arnaud qui a succd au sombre
Cavaignac, a rejoint, par Miliana, sa base d'Orlansville. De son bivouac de la zaouia
dtruite, il n'a pas interrompu sa correspondance avec son frre.
L'anne suivante, les mmes guerriers revien-nent. Puisque destructions et morts n'ont
amen aucune soumission dfinitive, puisque le vieux khalifat Berkani continue, plus
l'ouest, d'animer, comme lieutenant de l'mir, la rsistance, Saint- Arnaud dcide une
rpression plus efficace : il pren-dra des otages dans la famille mme du khalifat :
Huit des chefs des trois principales fractions des Beni-Mnacer , prcise-t-il donc son
frre.
Chuchotements des aeules aux enfants dans le noir, aux enfants des enfants accroupis sur
la natte, aux filles qui deviendront aeules, le temps d'enfanter s'coulant pour elles en
parenthses dri-soires (de quinze trente-cinq ou quarante ans).
Ne subsiste du corps ni le ventre qui enfante, ni les bras qui treignent, qui s'ouvrent dans la
rupture de l'accouchement. Ne subsiste du corps que oue et yeux d'enfance attentifs, dans
le corridor, la conteuse ride qui grne la transmission, qui psal-modie la geste des pres,
des grands-pres, des grands-oncles paternels. Voix basse qui assure la navigation des
mots, qui rame dans les eaux char-riant les morts, jamais prisonniers...
Chuchotements des femmes : dans les couches, une fois la chandelle teinte, pendant les
nuits de l'alerte, une fois les braises des braseros refroidies... De quinze trente-cinq ou
quarante ans, le corps flchit, le corps gonfle, le corps s'ventre, enfin il traverse les annes
de plomb, il triomphe de la pnombre aux bouches billonnes, aux visages masqus, au
regard invariablement baiss... La voix attend dans les entrailles de la mutit, les rles sont
avals, les plaintes transmues.
Temps des asphyxies du dsir, tranches de la jeunesse o le chur des spectatrices de
la mort vrille par spasmes suraigus jusqu'au ciel noirci... Se maintenir en diseuse dresse,
figure de proue de la mmoire. L'hritage va chavirer vague aprs vague, nuit aprs nuit,
les murmures reprennent avant mme que l'enfant comprenne, avant mme qu 'il trouve ses
mots de lumire, avant de parler son tour et pour ne point parler seul...
Huit des chefs des trois principales fractions , crit le commandant franais qui voque
les otages. Quarante-huit prisonniers pour l'le Sainte-Mar-guerite : hommes, femmes,
enfants, parmi eux une femme enceinte , rectifient les chuchotements qui se tissent
aujourd'hui l'endroit o la zaouia a brl, au milieu des vergers plus rares. Les figuiers
s'lvent dsormais en plus grand nombre que les orangers, que les mandariniers : comme
si l'eau nourrissait d'abord les mmoires, et que le ravine-ment s'acclrt sur les roches!
Cuillre de confiturier que la sainte on l'appelle ainsi parce qu'elle jene toute l'anne,
par pit ardente tendait son jeune fils, dans l'alarme. La compassion d'autrefois, du
vieux pre envers sa fille partant pour ses noces, s'inverse, trente ans aprs, dans le don de
celle-ci son cadet qui disparat, une nuit de la guerre. Il reviendra sain et sauf, quelques
annes plus tard!... Cette cuillre de confiturier, objet de luxe dans ces monts appauvris,
m'apparat comme un emblme hral-dique choisir pour quel cimier...
Les vergers brls par Saint-Arnaud voient enfin leur feu s'teindre, parce que la vieille
aujourd'hui parle et que je m'apprte transcrire son rcit. Faire le dcompte des menus
objets passs ainsi, de main fivreuse main de fugueur!
Quand la sainte tait enfant, elle coutait sa grand-mre qui fut la bru du vieux Berkani.
Les historiens perdent celui-ci de vue, juste avant que l'mir soit contraint de se rendre.
Assa el Berkani partit avec sa deira au Maroc. Au-del d'Oudja, sa trace disparat dans
les archives comme si archives signifiait empreinte de la ralit!
L'une de ses brus, longtemps aprs cet exode, se retrouva veuve sans enfant. Elle demanda
au khali-fat ainsi que le rapporte la tradition la permis-sion de retourner dans sa famille,
chez les Beni- Mnacer dsormais soumis. Elle revint, se remaria avec un cousin qui
participa la seconde rvolte, en 1871...
Bien aprs cette seconde flambe, elle chuchote son tour, vieillie dans le cercle reconstitu
d'enfants aux prunelles luisantes. A son tour, l'une des fillettes parcourera le trajet et se
retrouvera envelop-pe de satin et de moire; surnomme la sainte , elle chuchote
pareillement...
Chane de souvenirs: n'est-elle pas justement chane qui entrave autant qu'elle enracine?
Pour chaque passant, la parleuse stationne debout, dissimule derrire le seuil. Il n'est pas
sant de soulever le rideau et de s'exposer au soleil.
Toute parole, trop claire, devient voix de forfanterie, et l'aphonie, rsistance inentame...
L'COLE CORANIQUE
A l'ge o le corps aurait d se voiler, grce l'cole franaise, je peux davantage circuler :
le car du village m'emmne chaque lundi matin la pension de la ville proche, me ramne
chez mes parents le samedi.
A chaque sortie de week-end, une amie demi italienne, qui rejoint un port de pcheurs sur
la cte, et moi nous sommes tentes par toutes sortes d'vasions... Le cur battant, nous
faisons une escapade au centre ville : entrer dans une ptisserie lgante, surveiller les
abords du parc, faire le boulevard qui ne longe que de vulgaires casernes, c'est pour
nous le comble de la licence, aprs une semaine de pensionnat! Excites par la proximit
des plaisirs dfendus, nous finissons par prendre chacune notre car; le sus-pense a rsid
dans le risque de rater ce dpart.
Dans ce dbut d'adolescence, je gote l'ivresse des entranements sportifs. Tous les jeudis,
vivre les heures de stade en gicles clabousses. Une inquitude me harcle : je crains
que mon pre n'arrive en visite ! Comment lui avouer que, forcment, il me fallait me mettre
en short, autrement dit montrer mes jambes ? Je ne peux confier cette peur aucune
camarade ; elles n'ont pas, comme moi, des cousines qui ne dvoilent ni leurs che-villes ni
leurs bras, qui n'exposent mme pas leur visage. Aussi, ma panique se mle d'une honte
de femme arabe. Autour de moi, les corps des Franaises virevoltent ; elles ne se doutent
pas que le mien s'emptre dans des lacs invisibles.
Elle ne se voile donc pas encore, ta fille? interroge telle ou telle matrone, aux yeux noircis
et souponneux, qui questionne ma mre, lors d'une des noces de l't. Je dois avoir treize,
qua-torze ans peut-tre.
Elle lit ! rpond avec raideur ma mre.
Dans ce silence de gne installe, le monde entier s'engouffre. Et mon propre silence.
Elle lit , c'est--dire, en langue arabe, elle tudie . Maintenant je me dis que ce verbe
lire ne fut pas par hasard l'ordre lanc par l'archange Gabriel, dans la grotte, pour la
rvla-tion coranique... Elle lit , autant dire que l'cri-ture lire, y compris celle des
mcrants, est tou-jours source de rvlation : de la mobilit du corps dans mon cas, et donc
de ma future libert.
Pour les fillettes et les jeunes filles de mon po-que peu avant que la terre natale secoue
le joug colonial , tandis que l'homme continue avoir droit quatre pouses lgitimes,
nous disposons de quatre langues pour exprimer notre dsir, avant d'ahaner : le franais
pour l'criture secrte, l'arabe pour nos soupirs vers Dieu touffs, le libyco-berbre quand
nous imaginons retrouver les plus anciennes de nos idoles mres. La qua-trime langue,
pour toutes, jeunes ou vieilles, clotres ou demi mancipes, demeure celle du corps que
le regard des voisins, des cousins, pr-tend rendre sourd et aveugle, puisqu'ils ne peuvent
plus tout fait l'incarcrer; le corps qui, dans les transes, les danses ou les vocifrations, par
accs d'espoir ou de dsespoir, s'insurge, cherche en analphabte la destination, sur quel
rivage, de son message d'amour.
Dans nos villes, la premire ralit-femme est la voix, un dard s'envolant dans l'espace, une
flche qui s'alanguit avant la chute ; puis vient l'criture dont les lettres lianes forment
entrelacs amou-reux, sous la griffure du roseau en pointe. Par contre un besoin d'effacement
s'exerce sur le corps des femmes qu'il faut emmitoufler, enser-rer, langer, comme un
nourrisson ou comme un cadavre. Expos, il blesserait chaque regard, agresserait le plus
ple dsir, soulignerait toute sparation. La voix, elle, entre en chacun comme un parfum,
une gorge d'eau pour gosier d'assoiff; et lorsqu'elle se gote, elle devient plai-sir pour
plusieurs, simultanment : secrte jouis-sance polygame...
Quand la main crit, lente posture du bras, pr-cautionneuse pliure du flanc en avant ou sur
le ct, le corps accroupi se balance comme dans un acte d'amour. Pour lire, le regard prend
son temps, aime caresser les courbes, au moment o l'inscription lve en nous le rythme de
la scan-sion : comme si l'criture marquait le dbut et le terme d'une possession.
Inscrite partout en luxe de dorures, jusqu' net-toyer autour d'elle toute autre image animale
ou vgtale, l'criture, se mirant en elle-mme par ses courbes, se peroit femme, plus
encore que la voix. Elle souligne par sa seule prsence o com-mencer et o se perdre ; elle
propose, par le chant qui y couve, aire pour la danse et silice pour l'ascse, je parle de
l'criture arabe dont je m'absente, comme d'un grand amour. Cette cri-ture que, pour ma
part, j'ai apprivoise seulement pour les paroles sacres, la voici s'talant devant moi en
pelure d'innocence, en lacis murmurants ds lors, les autres (la franaise, l'anglaise ou la
grecque) ne peuvent me sembler que bavardes, jamais cautrisantes, carnes de vrit
certes, mais d'une vrit brche.
Mon corps seul, comme le coureur du penta-thlon antique a besoin du starter pour dmarrer,
mon corps s'est trouv en mouvement ds la pra-tique de l'criture trangre.
Comme si soudain la langue franaise avait des yeux, et qu'elle me les ait donns pour voir
dans la libert, comme si la langue franaise aveuglait les mles voyeurs de mon clan et
qu' ce prix, je puisse circuler, dgringoler toutes les rues, annexer le dehors pour mes
compagnes clotres, pour mes aeules mortes bien avant le tombeau. Comme si... Drision,
chaque langue, je le sais, entasse dans le noir ses cimetires, ses poubelles, ses caniveaux
; or devant celle de l'ancien conqu-rant, me voici clairer ses chrysanthmes !
L'criture est dvoilement, en public, devant des voyeurs qui ricanent... Une reine s'avance
dans la rue, blanche, anonyme, drape, mais quand le suaire de laine rche s'arrache et
tombe d'un coup ses pieds auparavant devins, elle se retrouve mendiante accroupie dans
la poussire, sous les crachats et les quolibets.
Dans ma premire enfance de cinq dix ans , je vais l'cole franaise du village, puis
en sortant, l'cole coranique.
Les leons se donnaient dans une arrire-salle prte par l'picier, un des notables du
village. Je me souviens du lieu, et de sa pnombre : tait-ce parce que les heures de cours
taient fixes juste avant le crpuscule, ou que l'clairage de la salle tait parcimonieux?...
L'image du matre m'est demeure avec une singulire nettet : visage fin, au teint ple, aux
joues macies de lettr; une quarantaine de familles l'entretenaient. Me frappait l'lgance
de sa mise et de ses vtements traditionnels : une gaze lgre immacule flottait derrire sa
nuque, enveloppait sa coiffe ; la serge de sa tunique tait d'un clat irrprochable. Je n'ai vu
cet homme qu'assis la turque, aurol de blancheur, la longue baguette du magister entre
ses doigts fins.
En contraste, la masse des garonnets accrou-pis sur des nattes pour la plupart enfants
de fellahs me paraissait informe, livre un dsordre dont je m'excluais.
Nous ne devions tre que quatre ou cinq fil-lettes. Je suppose que notre sexe, plus que ma
condescendance tonne, nous isolait. Le taleb , malgr son maintien quasi
aristocra-tique, n'hsitait pas soulever d'un trait sa baguette, l'assener sur les doigts de
tel garon rcalcitrant ou l'esprit trop gourd. (Il me semble encore entendre le cinglement
de la badine.) Nous, les filles tions prserves de ces correc-tions habituelles.
Je me souviens des ftes que ma mre improvi-sait dans notre appartement lorsque je
rappor-tais, comme par la suite mon frre devait le faire, la planche de noyer orne
d'arabesques. Le matre nous rcompensait ainsi quand nous avions appris une longue
sourate. Ma mre et la nounou villageoise, qui nous tait une seconde mre, osaient
pousser alors le you you presque barbare. Cri long, saccad, par spasmes roucou-lants
et qui, dans cet immeuble pour familles d'enseignants, toutes europennes except la ntre,
devait paratre incongru, un vrai cri de sau-vage. La circonstance tait juge par ma mre
assez importante (l'tude du Coran entreprise par ses petits) pour que le cri ancestral
s'lant ainsi modul, au cur de ce village o elle se sentait pourtant exile.
Aux distributions de prix de l'cole franaise, tout laurier obtenu renforait ma solidarit avec
les miens; or cette clameur ostentatoire m'enno-blissait plutt. L'cole coranique, antre o,
au- dessus des enfants pauvres trnait la figure hau-taine du cheikh, devenait, grce la joie
mater-nelle ainsi manifeste, l'lot d'un den retrouv.
De retour dans la ville natale, j'appris qu'une autre cole arabe s'ouvrait, pareillement
alimen-te de cotisations prives. L'une de mes cousines la frquentait; elle m'y emmena. Je
fus due. Par ses btiments, l'horaire de ses cours, l'allure moderniste de ses matres, elle
ressemblait une prosaque cole franaise...
Je compris plus tard que j'avais, au village, par-ticip la fin d'un enseignement sculaire,
popu-laire. A la ville, grce un mouvement nationa-liste de musulmans modernistes , se
forgeait une jeunesse nouvelle, de culture arabe.
Ces medersas ont pullul depuis. Si j'avais fr-quent l'une d'elles (il aurait suffi que mon
enfance se droult dans la cit d'origine), j'aurais trouv naturel ensuite d'enturbanner ma
tte, de cacher ma chevelure, de couvrir mes bras et mes mollets, bref de mouvoir mon
corps au-dehors comme une nonne musulmane !
Je fus prive de l'cole coranique dix ou onze ans, peu avant l'ge nubile. Au mme
moment, les garons sont exclus brutalement du bain maure des femmes univers
mollient de nudits qui suffoquent, dans un flou de vapeurs torrides... La mme
condamnation frappa mes compagnes, ces fillettes du village dont je veux ici voquer au
moins l'une d'elles.
La fille du boulanger kabyle avait d frquen-ter, comme moi, l'cole franaise en mme
temps que le cours coranique. Mais je ne me souviens de sa prsence, mes cts, que
devant le cheikh : cte cte accroupies, nous souriions demi, et dj, pour nous deux, la
station en tailleur ne nous paraissait gure commode !... Je devais avoir de trop longues
jambes, cause de ma taille; il ne m'tait pas facile, ainsi installe, de les dissimuler sous
ma jupe.
Pour ce dtail seul, je me dis que j'aurais de toute faon t sevre de l'enseignement
cora-nique cet ge : le sroual, il est certain, permet mieux la posture en tailleur; un corps
de fillette qui commence s'panouir dissimule aisment ses formes sous les plis amples de
l'habit tradi-tionnel. Or ma jupe, que justifiait ma frquenta-tion de l'cole franaise, tait peu
faite pour de telles postures.
A onze ans, je partis en pension pour le cursus secondaire. Qu'est devenue la fille du
boulanger? Voile certainement, soustraite du jour au lende-main aux chemins de l'cole :
son corps la trahis-sait. Ses seins naissants, ses jambes qui s'affi-naient, bref l'apparition de
sa personnalit de femme la transforma en corps incarcr !
Je me souviens combien ce savoir coranique, dans la progression de son acquisition, se liait
au corps.
La portion de verset sacr inscrite sur les deux faces de la planche de noyer, devait, au
moins une fois par semaine, aprs la rcitation de contrle de chacun, tre efface. Nous
lavions la planche grande eau comme d'autres lavent leur linge; le temps qu'elle sche
semblait assurer un dlai la mmoire qui venait de tout avaler...
Le savoir retournait aux doigts, aux bras, l'effort physique. Effacer la tablette, c'tait comme
si, aprs coup, l'on ingrait une portion du texte coranique. L'crit ne pouvait continuer se
dvider devant nous, lui-mme copie d'un crit cens immuable, qu'en s'tayant, pause
aprs pause, sur cette absorption...
Quand la main trace l'criture-liane, la bouche s'ouvre pour la scansion et la rptition, pour
la tension mnmonique autant que musculaire... Monte la voix lancinante des enfants qui
s'endor-ment au sein de la mlope collective.
Anonner en se balanant, veiller l'accent tonique, l'observance des voyelles longues et
brves, la rythmique du chant; les muscles du larynx autant que du torse se meuvent et se
sou-mettent la fois. La respiration se matrise pour un oral qui s'coule et l'intelligence
chemine en position d'quilibriste. Le respect de la gram-maire, par la vocalise, s'inscrit dans
le chant.
Cette langue que j'apprends ncessite un corps en posture, une mmoire qui y prend appui.
La main enfantine, comme dans un entranement sportif, se met, par volont quasi adulte,
ins-crire. Lis ! Les doigts uvrant sur la planche renvoient les signes au corps, la fois
lecteur et serviteur. Les lvres ayant fini de marmonner, de nouveau la main fera sa lessive,
procdera l'effa-cement sur la planche instant purificateur comme un frlement du linge
de la mort. L'criture rintervient et le cercle se referme.
Quand j'tudie ainsi, mon corps s'enroule, re-trouve quelle secrte architecture de la cit et
jusqu' sa dure. Quand j'cris et lis la langue trangre : il voyage, il va et vient dans
l'espace subversif, malgr les voisins et les matrones souponneuses ; pour peu, il
s'envolerait !
Ces apprentissages simultans, mais de mode si diffrent, m'installent, tandis que j'approche
de l'ge nubile (le choix paternel tranchera pour moi : la lumire plutt que l'ombre) dans une
dichotomie de l'espace. Je ne perois pas que se joue l'option dfinitive : le dehors et le
risque, au lieu de la prison de mes semblables. Cette chance me propulse la frontire
d'une sournoise hystrie.
J'cris et je parle franais au-dehors : mes mots ne se chargent pas de ralit charnelle.
J'apprends des noms d'oiseaux que je n'ai jamais vus, des noms d'arbres que je mettrai dix
ans ou davan-tage identifier ensuite, des glossaires de fleurs et de plantes que je ne
humerai jamais avant de voyager au nord de la Mditerrane. En ce sens, tout vocabulaire
me devient absence, exotisme sans mystre, avec comme une mortification de l'il qu'il ne
sied pas d'avouer... Les scnes des livres d'enfant, leurs situations me sont purs sc-narios;
dans la famille franaise, la mre vient chercher sa fille ou son fils l'cole ; dans la rue
franaise, les parents marchent tout naturelle-ment cte cte... Ainsi, le monde de l'cole
est expurg du quotidien de ma ville natale tout comme de celui de ma famille. A ce dernier
est dni tout rle rfrentiel.
Et mon attention se recroqueville au plus pro-fond de l'ombre, contre les jupes de ma mre
qui ne sort pas de l'appartement. Ailleurs se trouve l'aire de l'cole; ailleurs s'ancrent ma
recherche, mon regard. Je ne m'aperois pas, nul autour de moi ne s'en aperoit, que, dans
cet cartlement, s'introduit un dbut de vertige.
VOIX DE VEUVE
Mon mari avait pris l'habitude d'aller chaque dimanche jusqu' Cherchell. Une fois, il nous
ramena un invit. Il y eut le lendemain une r-union d'une quinzaine de personnes : tous
taient venus des montagnes voisines jusqu' notre ferme.
L'invit resta la nuit suivante, et le surlende-main, il repartit la ville. C'tait alors jour de
Ramadhan. Quelqu'un hlas, nous trahit et alla Gouraya raconter la runion.
Le matin qui suivit le dpart de l'invit, les gen-darmes arrivrent. Les hommes mon mari
et ses frres se trouvaient la chasse. Nous poss-dions deux fusils et une cartouchire,
mais enter-rs un peu plus loin.
Le cad, venu avec les gendarmes, demanda ma belle-mre :
Pourquoi ton fils va, chaque semaine, au march de Cherchell ?
Pour des achats, et pour voir des parents! rpliqua-t-elle.
C'est faux ! Je vous connai bien : vous avez de la famille Novi, pas Cherchell !
Il demanda o se trouvaient les fusils de chasse manquants. Elle rpondit que son fils les
avait vendus, il y avait longtemps de cela, la fte reli-gieuse de Si M'hamed ben Youssef.
Ils partirent sans avoir rien trouv.
Nos hommes furent de retour peu aprs. Quel-ques jours s'coulrent; mais les gendarmes
revinrent : cette fois, ils emmenrent tous les hommes la prison de Cherchell.
Aprs neuf mois de prison, mon mari et l'un de ses frres furent condamns mort : on les
accusait d'avoir gard sur eux une liste de noms, de ceux qui travaillaient avec la France et
que la Rvolution avait condamns.
Dans cette prison, ils se retrouvrent nom-breux. Ils dcidrent :
Nous, nous allons nous occuper de nous- mmes !
Un matin, trois d'entre eux russirent immo-biliser un gardien; ils le turent. A une autre
porte, ils agirent de mme avec un autre. L'un des prisonniers, bless la jambe, leur dit :
Sortez tous! Moi, je reste! Je vais mourir! Vous, vous avez votre chance. Sortez ! Moi, je
tue et je serai tu !
Ils se sauvrent; quinze vingt prisonniers s'enfuirent ensemble. Cela se passait neuf
heures du matin. Il y eut mme une femme fran-aise tue, mais nous n'avons pas su dans
quelles circonstances.
Deux heures aprs, les soldats surgirent chez nous. L'un d'eux s'adressa la vieille :
Tes fils se sont sauvs de la prison et ont tu des gardiens ! Si les autres gardiens se
dcidaient venir ici, chez vous, vous mourriez tous, petits et grands, avec vos chats !
Ils ont tout fouill; ils ont redemand o taient les fusils de chasse puis ils ont fini par partir.
Le lendemain matin, un parent nous, d'une autre montagne, vint nous voir. Il nous apprit
que les vads avaient pass la nuit du ct de l'oued Messelmoun. Un neveu
l'accompagna; nous dcidmes que nous, les femmes, nous allions dornavant cuisiner des
quantits de nourriture supplmentaire, en cas de besoin...
Un garon vint nous demander des vtements. Nous nous mmes d'accord pour, chaque
fois, enterrer la nourriture. Enfin je pus voir mon mari; il arriva avec un autre, nomm
Abdoun...
La France, continuait multiplier les gardes. Chaque fois que les vads nous envoyaient un
des leurs, Dieu a conserv sur eux et sur nous le salut !
Une nuit, tous se regrouprent et quelqu'un les emmena plus loin, jusqu'au Zaccar. A partir
de la nuit suivante, nous pmes prendre un peu de repos !
Quelques mois aprs, nos hommes nous ren-dirent visite; ils taient cette fois habills en
maquisards et ils portaient des armes. Nous les embrassions heureuses, fires d'eux !
Louange Dieu ! Enfin, vous tes sauvs de la mort !
La vie continua autrement. La France se mit monter quasiment matin et soir chez nous.
Ensuite elle brla les maisons d'abord, puis les personnes! Emmener les btes, tuer les tres
humains!... Que dire quand ils arrivaient dans une maison et qu'ils trouvaient les femmes
seules?...
Moi, j'ai prfr fuir : je suis alle chez mes parents qui habitaient vers une autre montagne.
J'y restai. Plus tard, parat-il, l'un des soldats demanda ma belle-mre :
Et la femme du lieutenant (ils avaient su que mon mari tait devenu lieutenant chez les
maquisards), o se trouve-t-elle ?
Depuis que vous avez emmen son mari en prison, elle n'a pas voulu rester! Elle est
retour-ne dans sa famille elle !
Ils ne purent me trouver, pendant le reste de la guerre... De l, j'ai commenc aller dans la
mon-tagne pour en aider d'autres ; nous emmenions du ravitaillement, nous lavions les
uniformes, nous ptrissions le pain... Jusqu'au jour o, comme Dieu l'a voulu, mon mari fut
tu au combat !
Je n'ai su sa mort que par des trangers. Quelqu'un me dit, huit jours avant le cessez-le- feu
:
Ton mari est tomb du ct de Miliana, dans un accrochage !
A l'indpendance, les Frres m'envoyrent une lettre pour m'apprendre qu'il avait t enterr
Sidi M'hamed de Belcourt, Alger. J'ai pris cette lettre. Je suis alle chez ma belle-sur,
installe Alger. Son mari me demanda :
Qui te l'a dit?
Je lui parlai de la lettre.
Fais voir ! Donne !
Hlas ! vous rirez peut-tre de moi, mais je n'ai plus revu cette lettre. Comment oser la lui
rcla-mer?... J'ai su que mon mari avait t enterr Alger, parce qu'une infirmire l'avait
soign, aprs l'accrochage. On l'appelait la Cherchel- loise ; en fait, c'tait son mari qui
tait originaire de Cherchell. Elle, elle retourna vivre Miliana.
Une ou deux annes aprs, j'ai cherch la voir, simplement pour qu'elle me raconte. Je
dcidai d'aller la fte religieuse de Sidi M'hamed, le saint patron de Miliana. J'arrivai jusque
chez l'ancienne infirmire et je me dcidai lui parler.
Je ne suis entre chez elle qu'une minute et je suis sortie.
Elle n'a pu tout me raconter, parce que je l'ai trouve en plein travail mnager. Elle me
confirma seulement les faits : qu'elle l'avait soign quand elle tait infirmire au maquis.
C'tait une femme entre deux ges.
CORPS ENLACS
L't 1843 commence quand les prisonniers, otages de Saint-Arnaud, sont parqus, spars
par familles et par sexes, dans les cales d'un paquebot qui quitte Bne pour la France.
Je t'imagine, toi, l'inconnue, dont on parle encore de conteuse conteuse, au cours de ce
si-cle qui aboutit mes annes d'enfance. Car je prends place mon tour dans le cercle
d'coute immuable, prs des monts Mnacer... Je te recre, toi, l'invisible, tandis que tu vas
voyager avec les autres, jusqu' l'le Sainte-Marguerite, dans des geles rendues clbres
par l'homme au masque de fer . Ton masque toi, aeule d'aeule la pre-mire
expatrie, est plus lourd encore que cet acier romanesque ! Je te ressuscite, au cours de
cette tra-verse que n'voquera nulle lettre de guerrier fran-ais...
A Bne, tu montes sur la passerelle, mle la troupe empoussire ; les hommes sont
enchans, avec une mme corde; les femmes suivent, enve-loppes de voiles blancs ou
gris bleutre auxquels s'accrochent les enfants en pleurs, sous lesquels geignent les bbs.
A ce dpart d'exode, tu te sais femme lourde. Accoucheras-tu d'un orphelin, puis-que le pre
n'a pas t pris ? Tu te vois seule, sans pre, sans frre, sans mari, pour te conduire aux
rivages des Infidles. Au milieu de la troupe des cousins, des allis, des parentes, il te faut
aller !
Les exils dorment comme toi mme les planches de la soute ; ils n'ont jamais vu la mer.
Ils la croyaient dsert et plaine, non ce prcipice mouvant... La premire nuit de la traverse,
tu te mets vomir; les douleurs se sont enfles le jour suivant.
La deuxime nuit, tu te dis que la mort, dans ton ventre, avale l'esprance. Tu t'es
recroqueville au centre des cousines, vieilles, jeunes, ou moins jeunes. Elles t'entourent de
leurs voiles humides, comme si elles te ficelaient de leurs prires, de leurs murmures... Sans
crier, tu te dlivres du ftus : la nuit de pleine lune s'largit, la mer est redevenue plate,
rivale indiffrente.
Le navire avance, charg des quarante-huit otages. Tandis que tes compagnes somnolent,
tu demeures immobile, le visage tourn vers la poupe. Une angoisse te dchire :
Comment enterrer le ftus, mon Prophte, mon doux Sauveur !
Une vieille, prs de ton flanc, s'en est saisi comme d'un tas de chiffons.
Mon oiseau mort, mon il ouvert malgr la nuit!
Tu sanglotes, tu t'apprtes te lacrer les joues, tandis que la vieille marmonne des
bndictions.
Notre terre est eux ! Cette mer est eux ! O abriter mon fils mort ? N'y aura-t-il plus
jamais un coin d'Islam pour nous, les malheureux ?
Dans le cercle des dormeuses, une vhmence fouette les femmes rveilles par tes pleurs
: leur chur se met dvider une sourate, ruissellement continu. Mlope inlassable. Tu as
fini par t'endormir, le ftus envelopp dans un linge se trouve dans tes bras. Tu somnoles,
l'ide ne te quitte pas que tu portes, ainsi, ta jeunesse... Le chur des prisonnires s'lve
un peu plus haut...
Plus tard, quelqu'un te secoue dans le noir. Une voix t'interpelle :
Fille de ma tribu maternelle, lve-toi ! Tu ne peux garder ainsi, dans tes bras, l'agneau de
Dieu plus longtemps !
Tu regardes, sans comprendre, le visage rid d'une tante qui te parle. Derrire elle, un rose
ml de gris fait scintiller le ciel de la premire aube ; il aurole la vieille.
Que faire? Dans quelle terre de croyants l'enterrer?
Le dsespoir, nouveau, t'envahit.
Montons jusqu'au pont! Les hommes dorment ! Toi et moi, nous jetterons l'enfant dans la
mer!
L'ocan des Chrtiens! protestes-tu timidement.
L'ocan de Dieu ! rtorque la vieille. Tout est pturage de Dieu et de son Prophte!... Et
ton fils palpite, j'en suis sre, comme un angelot dans notre Paradis!
Deux formes voiles franchissent les masses de dormeurs. Un moment aprs, tes bras, par-
dessus la rambarde, lancent le paquet.
Au moins que ce soit en regardant vers notre patrie! gmis-tu.
Que Dieu nous assiste partout o nous sommes jetes ! reprend ta compagne qui te guide
jusqu' ta place...
Tu ne pleures plus, tu ne pleureras jamais plus ! Est-ce que tu seras du nombre des
rescaps qui, dix annes plus tard, referont le trajet inverse et rejoindront leur tribu soumise
?
QUATRIME MOUVEMENT LE CRI DANS LE RVE
Un rve, par intermittence, me revient aprs une journe qu'a lancine, sous un prtexte
banal ou exceptionnel, l'clair d'une souffrance. Je rve ma grand-mre paternelle ; je revis
le jour de sa mort. Je suis la fois la fillette de six ans qui a vcu ce deuil et la femme qui
rve et souffre, chaque fois, de ce rve.
Je ne vois ni le cadavre de ma grand-mre ni la liturgie des obsques. Mon corps dgringole
la ruelle, car j'ai surgi de la demeure paternelle o la mort a frapp. Je cours, je dvale la rue
cerne de murs hostiles, de maisons dsertes. Je me prci-pite prs de l'glise et des
beaux quartiers o se trouve la maison de ma mre. Tout au long de ma course, ma bouche
s'largit, bante... Rve pour-tant au son coup.
Propulsion interminable. S'tirant dans mes membres, se gonflant dans ma poitrine, cor-
chant mon larynx et emplissant mon palais, un cri enracin s'exhale dans un silence
compact; une pousse anime mes jambes. Tout mon tre est habit par ces mots :
Mamma est morte, est morte, est morte ! ; je porte ma douleur, je la devance mme,
j'appelle ou je fuis je ne sais, mais je crie et ce cri ne signifie plus rien, sinon 1 lan d'un
corps de fillette en avant...
Je crie au prsent et le rve, profus comme un brouillard, ne semble jamais finir. Un cri
d'pais-seur ocane. Ma grand-mre, je la porte comme un fardeau sur mes paules, je vois
pourtant son visage tal sur les faades qui dfilent. Et l'ombre de la morte se lve, ancre
dans ma pre-mire enfance. Depuis que j'ai quitt la chambre parentale la naissance du
frre j'ai donc un an et demi je partage le lit de l'aeule. Le souve-nir s'anime ; pour
m'endormir, la vieille dame me tenait chaque pied dans chacune de ses mains et me les
rchauffait longuement, au seuil du sommeil.
Elle mourut quelques annes aprs. Cette femme douce, dont le dernier fils tait devenu le
soutien, a perdu sa voix dans ma mmoire. Je devrais la nommer ma mre silencieuse ,
face celles mre, grand-mre et tantes maternelles qui, orgueilleuses aristocrates,
m'apparaissent plonges dans la musique, l'encens et le brouhaha.
Elle seule, la muette, par ce geste des mains enserrant mes pieds, reste lie moi... C'est
pour-quoi, je crie; c'est pourquoi, dans ce rve accompagnant le dfil de mes ans, elle
revient en absence tenace et ma course de fillette tente dsesprment de lui redonner voix.
En bas, dans la maison opulente, avec ses ter-rasses et son bruit, la mre de ma mre trne
en reine. L se trouve le chant, l fusent les voix hautes. Si les murmures et les
chuchotements s'installent, c'est par dcence ou par convention, lorsque les hommes
entrent, enfin, pour manger et dormir, l'air presque sur la dfensive.
Mon rve se poursuit parfois dans ces lieux de lumire, prs du bigaradier de l'escalier, sous
les jasmins de la premire terrasse. Des pots de cuivre, contre la rampe, portent les
graniums... Je me retrouve assise, crase, au sein d'une foule de visiteuses voiles, le
visage rougi. Je regarde.
De nouveau, dans un incessant tangage, je me vois en train de courir, dans la ruelle du
vieux quartier mamelonn. Je crie et personne ne m'entend, trange condamnation. Je crie,
non pas comme si j'touffais, plutt comme si je respirais trs fort, trs vite.
Jaillie derechef de la maison du deuil, je des-cends en trombe vers la demeure aux multiples
terrasses. Dans ces lieux o se droulent tant de ftes, je me dis que la grand-mre
silencieuse devrait se trouver l, emprisonnant mes pieds dans ses mains uses.
Dans une pnombre de veille funbre, au rez- de-chausse de la grande maison, l'aeule
pater-nelle, menue, les traits arrondis de douceur, me sourit, une bont parpille sur le
visage. Elle semble me dire :
Elles croient m'enterrer, elles s'imaginent venir ma mort! Toi seule...
Moi seule, je sais qu'elle ressuscite. Je ne la pleure pas ; de nouveau, je crie en courant
dehors, entre les maisons blanches, et j'exhale mon amour dans le vent de la vitesse. La
ruelle, devant moi, s'incline; des garonnets sur leurs planches roues s'cartent; tout en
bas, l'odeur du four indique la seule activit du crpuscule : des cor-beilles de pain l'anis
sont prtes tre distri-bues au cours de la clbration mortuaire.
Ce rve me permet-il de rejoindre la mre silen-cieuse? Je tente plutt de venger son silence
d'autrefois, que sa caresse dans le lit d'enfant adoucit...
Je pris conscience assez tard de la pauvret de ma famille paternelle. Mon pre, entr
l'cole franaise un ge avanc, parcourut un cursus brillant, rattrapa son retard et russit
tt au concours de l'cole normale : ce mtier d'ensei-gnant lui permit de donner la scurit
sa mre, ses surs dont il assura le mariage, avant de se marier lui-mme.
De ce pass qui me fut dcrit, une scne me frappa : mon pre, colier de neuf ou dix ans,
devait faire ses devoirs accroupi devant une table basse, la lumire d'une bougie... Je
connaissais la demeure vtust, ses chambres obscures, sa courette. L'image du pre,
enfant studieux, s'incrusta en moi dans cet humble dcor.
Une chambre isole, en retrait, a longtemps t celle d'une de mes tantes paternelles. Je la
revois, ombre plie, dresse sur le seuil ; le rideau de sa porte est demi soulev. Du fond
de la pnombre, une voix d'agonisant l'appelle, interrompue par une quinte de toux... Cette
tante soignera de longues annes un poux g et tuberculeux; quand il mourut, elle ne
tarda pas, contamine son tour, le suivre dans la tombe.
La seconde des surs de mon pre, la plus jeune, surgit dans mon enfance, avec plus de
relief.
Sa maison n'tait gure loigne de celle de ma mre. L't, il m'arrivait de me quereller
avec un cousin, une cousine, ou une tante adolescente; je ne savais pas, l'instar de mes
compagnes, me lancer dans un chapelet de moqueries, formules images de notre dialecte.
Parmi les enfants piailleurs de la ville, je devais tre aisment dsaronne, cause de ma
timi-dit ou de mon orgueil. Un refuge me restait : quitter la maison bruyante, ddaigner
l'arbitrage de ma mre et de ses amies, occupes le plus souvent des travaux de broderie.
Je me rfugiais chez ma tante paternelle : longue, sche, des yeux verts clairant son mince
visage de berbre, mal-gr sa couve encombrant sa cour, elle m'ouvrait grand les bras. Elle
me cajolait et me faisait entrer dans sa plus belle pice o un haut lit baldaquin de cuivre
me fascinait... Elle me rser-vait confitures rares, sucreries, parfums dverss sur mes
cheveux et dans mon cou. Fille de mon frre , m'appelait-elle avec un rire fier et sa
ten-dresse me rchauffait.
Ma ressemblance physique avec mon pre avait sans doute dtermin cette affection. Un
mariage, dans notre socit, n'entretient qu'un conflit latent, patient, entre deux lignes... Le
couple moderne que formrent mes parents perturba cet habituel rapport de forces.
Plus tard, quand cette tante, avec la mme exu-brance, continuait m'appeler fille de
mon frre , me revenait intact le souvenir de ces ts o sa gouaille et l'assurance de sa
silhouette me rconfortaient.
Y avait-il une hirarchie sociale importante dans cette cit, environne de montagnes que
l'rosion appauvrissait? Cela comptait peu, en regard de la discrimination tablie entre
citadins et paysans des environs ; ou surtout de la sgrga-tion qu'installa la socit
coloniale : rduit en nombre mais puissant, le groupe des Europens, d'origine maltaise,
espagnole ou provenale, pos-sdait non seulement le pouvoir, mais contrlait la seule
activit lucrative, la pche et la jouissance des chalutiers du vieux port.
Les femmes arabes circulaient dans la ville, fantmes blancs, que les visiteurs des ruines
romaines s'imaginaient semblables. Entre les familles de notables, une subtile diffrence
s'entretenait : tant par l'importance du rang social que l'homme maintenait au jour le jour, que
par l'vocation orale des anctres paternels et mater-nels.
Pour moi, la distinction entre les lignes paternelle et maternelle rsida en un seul point,
mais essentiel : la mre de ma mre me parlait longue-ment des morts, en fait, du pre et du
grand-pre maternels. De ma grand-mre paternelle, je ne sus que ceci : veuve trs jeune
avec deux enfants, elle dut pouser un retrait trs g, qui mourut en lui laissant une
maison et deux autres enfants, dont mon pre.
L'aeule maternelle s'imposait moi par son corps dansant dans les sances rgulires de
transes ; en outre, chaque veille, sa voix, d'auto-rit autant que de transmission,
m'enveloppait.
La mre de mon pre, grce aux caresses de ses mains, demeure autant prsente, peut-
tre davan-tage : seul, son silence d'hier continue m'corcher aujourd'hui...
VOIX DE VEUVE
J'ai eu quatre hommes morts dans cette guerre. Mon mari et mes trois fils. Ils avaient pris les
armes presque ensemble. Il restait l'un de mes petits six mois pour la fin des combats; il
est mort. Un autre a disparu ds le dbut : je n'ai reu aucune nouvelle de lui jusqu'
aujourd'hui.
Mon frre fut le cinquime... Lui, je l'ai ramen de la rivire. J'ai cherch partout son corps; je
l'ai retrouv. Il est enterr au Cimetire !
Lorsqu'il tait vivant, il conversait un jour avec moi, comme nous le faisons l. Il me dit
soudain :
coute, l'attentat de l'oued Ezzar, c'est moi. Celui de Sidi M'hamed Ouali, c'est moi. A
Belazmi, c'est moi aussi... (il s'arrta, puis il ajouta :) O fille de ma mre, prends garde de ne
pas me laisser aux chacals, le jour o je mour-rai!... Que les btes ne mangent pas mon
cadavre!...
Que Dieu ait son me, jamais il ne me fit la moindre demande, sauf celle-l!... Ainsi il parla,
ainsi tout se passa par la suite... Ils ont fini par le surprendre. Un matin, l'avion nous a
bombards. L'aprs-midi, ils ont tu mon frre. Nous avons fui la nuit tombante.
Mon frre avait une jument. Il allait et venait pour organiser les rseaux de soutien dans la
population. Partout o il allait, il emmenait cette jument. Quand il dormait dehors, il la liait
son pied.
En fuyant, nous sommes arrivs un oued. Quelqu'un me dit qu'on avait vu, pas loin, la
jument de mon frre : elle restait accroupie, ne voulant pas bouger. C'tait la nuit.
A l'aube, je me mis la recherche de la bte. J'avais perdu espoir de retrouver mon frre. Je
vis la jument qui se releva. Elle avait d sentir le corps... Quelqu'un (un paysan qui, peu
aprs, a t tu) me dit : coute, je crois que ton frre gt non loin de l, prs du ruisseau !
Un avion revint nous bombarder. Je courus et me cachai dans l'eau. Quand l'avion s'loigna,
je sortis; je remontai la rivire lentement, lente-ment, jusqu' ce que je retrouve le corps de
mon frre. Je courus alors pour appeler les gens. On l'enterra au cimetire, dans la mme
tombe que ma mre... Mes fils alors n'taient pas encore morts!
De tous les hommes de la famille, on n'a pu enterrer que mon frre et un neveu moi. Ce fut
tout.
J'allais souvent la montagne pour voir mes fils. Le dernier surtout m'envoyait chercher. J'y
allais aussitt, de douar en douar... Je suis tel douar, me faisait-il dire. Viens! ... A tel
douar, je t'attends!... Je suis nu... Je n'ai pas le moindre centime!... Je suis ainsi... Je suis
ainsi!
Une fois, de tout le btail, il me resta seulement un agneau! Je le tuai (les incendies se
multi-pliaient et il aurait t perdu). Je lui fis envoyer l'agneau entier, pour qu'il mange avec
ses compa-gnons!... C'est celui-l qui il restait seulement six mois pour la fin des combats,
quand il mou-rut!... Restent-ils des pleurs en nous? Non, nos yeux sont secs...
Et celui de mes fils que je n'ai jamais vu, depuis qu'il est mont... L'un de ses compagnons
me fit parvenir son propos le message suivant :
Mre, prends garde si quelqu'un cherche, au nom de ton fils, de te dire d'envoyer un
savon, ou un vtement, ou un peu d'argent!... Ne t'occupe dsormais que de tes autres fils
vivants!... Pour celui-ci, n'y pense plus !
Il tait si jeune pourtant et il dcidait toujours : C'est ainsi !... C'est ainsi ! ... Je l'entends
encore.
A l'indpendance, les gens de la ville ne m'ont rien donn. Il y avait un responsable, du nom
de Allai : le jour o il avait fui, pour monter au maquis, je l'avais cach quelque temps chez
moi !
Ce fut cet homme qui, aussitt aprs la guerre, distribuait les maisons vacantes. Moi, notre
douar dtruit, je descendis en ville avec d'autres. Mais je rpugnais errer. Un vieux, Si el
Hadj, me poussa aller chez ce responsable pour lui rappeler mon cas. Il vint mme avec
moi et frappa sa porte. Allai nous ouvrit : des gens que je ne connaissais pas se trouvaient
dans sa cour.
Je pntrai.
O Allal, o est mon droit? m'exclamai-je. Mes fils ont combattu de l jusqu' la frontire
tunisienne, pendant que toi, tu restais cach dans les grottes et les trous !
Car c'tait vrai. Voil que, devant tous ces cita-dins, il se mit me parler en berbre ! Pour
bien souligner que j'tais une campagnarde ! Je rp-tai, en arabe et avec cet accent que tu
me connais :
Donne-moi mon droit !
Ils ne m'ont rien donn... Tu vois o j'habite maintenant, il m'a fallu donner de l'argent, pour
occuper cette cabane. Tu paies, sinon tu n'entres pas ! m'a-t-on dit.
Les hommes, qui me servaient d'paules, tous ces hommes sont partis !
CONCILIABULES
Conciliabules de-ci, de-l, au hasard des vallon-nements reboiss qui ceinturent les
hameaux reconstruits; de nouveau, murs en pis et barrires de roseaux s'lvent entre les
cabanes envahies de criailleries d'enfants. Je pousse chaque portail, je m'assois sur la natte;
par-del la courette, mon regard rencontre la mme montagne, avec ses mira-dors
abandonns.
Conversations parpilles o ma filiation mater-nelle cre le lien : l'une ou l'autre des
interlocutrices m'affirme que sur la tombe des deux saints de mon ascendance (le vieux
et le jeune , celui la langue noire et l'autre, l silencieux, trs probable-ment son
fils), de nouveau, les paysannes les rpudies, les striles, les orphelines de l'avenir
ont repris plerinages, confessions, sances de transes pour s'assurer la bndiction de ces
deux intercesseurs, pre et fils... Elles s'apprtent me parler de la mme manire
rocailleuse ; ne suis-je pas, par ma mre et le pre de ma mre, une descen-dante de ces
deux morts qui coutent et dont le sommeil ptrifi console?... Oui, l'on me parle, voix dans
l'ombre, et je me tais, j'avale chaque timbre, je pourrais me sentir, sinon sainte ou maudite,
en tout cas momifie.
A quel moment des questions conventionnelles :
Quel ge avais-tu?... O vivais-tu?... Marie ou fille ?... etc.
A quel moment, la seule question vivante s'arrte dans ma gorge, et ne peut s'envoler?... Je
la retiens, je ne peux la formuler, sinon par un mot de passe, un mot doux, neutre,
ruisselant...
Devant cet auditoire, quatre, cinq paysannes qui toutes continuent vivre en veuves de
guerre... Faut-il attendre un tte--tte? L'une d'elles a un goitre norme sur un long cou
flexible : la retenir par des paroles secrtes, laisser entendre que l'entre-tien est devenu de
thrapeutes, changer des conseils pour tel chirurgien ou tel hpital... Parler chacune
comme sa semblable condamne: ni coupable ni victime. S'approcher de la tristesse plate,
attnuer les tons de voix, loin de la soumis-sion ou de la dploration.
Ma question frmit, entte. Il faudrait, pour l'expliciter, prparer mon corps tel qu 'il se
prsente, assis en tailleur sur des coussins ou mme le car-relage : mes mains ouvertes
pour adoucir l'humi-lit, mes paules incurves pour prvenir la dfail-lance, mes hanches
prtes recevoir la brisure de l'motion, mes jambes recroquevilles sous la jupe pour
m'empcher de fuir, hurlant en pleine course, sous les arbres.
Dire le mot secret et arabe de dommage , ou tout au moins de blessure :
Ma sur, y a-t-il eu, une fois, pour toi dom-mage ?
Vocable pour suggrer le viol, ou pour le contour-ner : aprs le passage des soldats prs de
la rivire, eux que la jeune femme, cache durant des heures, n'a pu viter. A rencontrs. A
subis. J'ai subi la France , aurait dit la bergre de treize ans, Chrifa, elle qui justement
n'a rien subi, sinon, aujourd'hui, le prsent tale.
Les soldats partis, une fois qu'elle s'est lave, qu'elle a rpar son dsordre, qu'elle a renou
sa natte sous le ruban carlate, tous ces gestes reflts dans l'eau saumtre de l'oued, la
femme, chaque femme, revient, une heure ou deux heures aprs, marche pour affronter le
monde, pour viter que le chancre ne s'ouvre davantage dans le cercle tribal vieillard
aveugle, gardiennes attentives, enfants silencieux avec des mouches sur les yeux,
gar-onnets dj souponneux :
Ma fille, y a-t-il eu dommage ?
L'une ou l'autre des aeules posera la question, pour se saisir du silence et construire un
barrage au malheur. La jeune femme, cheveux recoiffs, ses yeux dans les yeux sans clat
de la vieille, parpille du sable brlant sur toute parole : le viol, non dit, ne sera pas viol.
Aval. Jusqu ' la prochaine alerte.
Vingt ans aprs, puis-je prtendre habiter ces voix d'asphyxie ? Ne vais-je pas trouver tout
au plus de l'eau vapore ? Quels fantmes rveiller, alors que, dans le dsert de
l'expression d'amour (amour reu, amour impos), me sont renvoyes ma propre aridit
et mon aphasie.
LES VOYEUSES
Oui, une diffrence s'tablit entre les femmes voiles que l'il tranger ne peut voir et qu'il
croit semblables fantmes au-dehors qui dvisagent, scrutent, surveillent; une strie
d'ingalit s'ins-talle parmi elles : laquelle parle haut, libre sa voix malgr l'aire resserre du
patio, laquelle au contraire se tait ou soupire, se laisse couper la parole jusqu' l'touffement
sans recours ?
Dans le langage quotidien, me revient une condamnation que la gravit rendait dfinitive :
plus que la femme pauvre (la richesse et le luxe se vivaient relatifs dans cet espace social
restreint), plus que la femme rpudie ou veuve, destin que Dieu seul lui rserve, la seule
rellement cou-pable, la seule que l'on pouvait mpriser lgre-ment, propos de laquelle
se manifestait une condescendance ostensible, tait la femme qui crie .
Telle ou telle des voisines, ou des parentes par alliance, pouvait user sa patience dans les
soins ncessits par les trop nombreux enfants; telle bourgeoise pouvait exhiber des bijoux
voyants, ou se transformer en martre, en belle-mre injuste on pouvait l'excuser puisque
rares taient celles qui, par chance, avaient eu un poux vrai musulman , un fils
travailleur et docile. La seule qui se marginalisait d'emble tait celle qui criait : celle dont
la voix querellait la couve, s'entendait hors du vestibule et jusque dans la rue, celle dont la
plainte contre le sort ne s'ab-mait ni dans la prire, ni dans le murmure des diseuses, mais
s'levait nue, improvise, en pro-testation franchissant les murs.
En somme, les corps, voils, avaient droit de circuler dans la cit. Mais ces femmes, dont les
cris de rvolte allaient jusqu' transpercer l'azur, que faisaient-elles, sinon attiser le risque
suprme? Refuser de voiler sa voix et se mettre crier , l gisait l'indcence, la
dissidence. Car le silence de toutes les autres perdait brusque-ment son charme pour
rvler sa vrit : celle d'tre une prison irrmdiable.
crire en langue trangre, hors de l'oralit des deux langues de ma rgion natale le
berbre des montagnes du Dahra et l'arabe de ma ville , crire m'a ramene aux cris des
femmes sourde-ment rvoltes de mon enfance, ma seule ori-gine.
crire ne tue pas la voix, mais la rveille, surtout pour ressusciter tant de surs disparues.
Dans les ftes de mon enfance, les bourgeoises sont assises crases de bijoux,
enveloppes de velours brod, le visage orn de paillettes ou de tatouages. Les
musiciennes dveloppent la litanie, les ptisseries circulent, les enfants encombrent les
pieds des visiteuses pares. Les danseuses se lvent, le corps large, la silhouette
tranquille... Je n'ai d'yeux que pour ma mre, que pour mon rve sans doute o je me
reprsente adulte, moi aussi dansant dans cette chaleur. Les rues de la ville sont loin; les
hommes n'existent plus. L'den s'tale immuable : danses lentes, visages mlanco-liques
qui se laissent bercer...
Un dtail du spectacle se met pourtant grin-cer : un moment de la crmonie, quand caf
et ptisseries ont circul, la matresse de maison donne l'ordre d'ouvrir grandes les portes.
Entre alors le flot des voyeuses , ainsi appelle-t-on celles qui vont rester masques,
mme au milieu des femmes ; elles ne sont pas invites, mais elles ont le droit de regarder,
debout, stationnant dans le vestibule. Parce qu'elles sont exclues, elles gardent leur voile;
bien plus, dans cette ville o les citadines circulent voiles, mais les yeux dcouverts au-
dessus de la voilette brode, ces voyeuses , pour rester anonymes l'intrieur de la
noce, dissimulent leur face entire, sauf un il; leurs doigts sous le voile maintiennent un
petit triangle ouvert trangement.
Ces non-invites sont donc introduites au sein de la fte en espionnes! L'il minuscule et
libre des inconnues enveloppes de blanc tourne droite, gauche, scrute les bijoux des
dames, la danse de telle jeune femme, les atours de la marie expose, les louis d'or et les
perles offerts en cadeaux de noce... Les voici, les ensevelies au cur de la parade, celles
dont on tolre la pr-sence muette, celles qui jouissent du triste privi-lge de rester voiles
au cur mme du harem ! Je comprends enfin et leur condamnation, et leur chance : ces
femmes qui crient dans la vie quotidienne, celles que les matrones cartent et mprisent,
personnifient sans doute la ncessit d'un regard, d'un public !
L'htesse leur a ouvert les portes par forfante-rie, de l'air de dire : Tenez, examinez, je ne
crains pas les commres! Ma noce se droule selon les normes ! Que mme celles que je
n'ai pas daign inviter se rendent compte et entretiennent la rumeur! ... L'acm de la
crmonie rside bien l, dans ce nud trouble. Comme si les invites ne souffraient plus
de leur exclusion du dehors... Comme si, force d'tre relgues par les hom-mes, elles
trouvaient une faon d'oublier leur claustration : les mles pre, fils, poux devenaient
irrmdiablement absents puisqu'elles- mmes, dans leur propre royaume, se mettaient
imposer leur tour le voile.
VOIX DE VEUVE
Nous habitions au lieu dit borne 40 ; ces douars ne se trouvaient pas trs loin de la
grande route. Les soldats franais avaient subi l un svre accrochage. De loin, nous
avions vu les feux, la fume... Depuis, ils se mirent venir constamment.
Une autre fois, non loin du poste franais, la route fut endommage, pour empcher que la
France change la garde. Autour du poste, les bar-bels avaient t enlevs en une nuit. Nos
hommes avaient obi aux maquisards venus leur dire de le faire.
Au matin, les soldats du poste arrivrent :
Les fellagha, c'est vous! Vous qui avez enlev les barbels et qui avez endommag la
route !
Toute la journe, nos hommes durent remettre en place les barbels et rendre la route libre.
La nuit suivante, mme mange avec les maquisards. Cette fois, nos hommes se sauvrent
: ils ne vou-lurent pas attendre la rplique ennemie! Il ne resta que nous, les femmes,
supporter!
Les Franais ne trouvrent que les femmes.
Sortez ce que vous pouvez sortir! nous dirent-ils.
Les goumiers mirent le feu aux maisons. Nous devnmes des errantes. Si tu as un frre, va
chez le frre; si tu as un cousin germain, va chez le cousin!... Nous sommes parties, nous
avons laiss nos demeures en ruine... Un peu plus loin, nous avons reconstruit des cabanes
de branchages. Les maquisards sont revenus : car ils nous suivent l o nous allons. Nos
hommes leur cachaient le ravitaillement et travaillaient pour eux, la nuit. Les Franais, eux
aussi, refirent irruption !
Nous, les femmes jeunes, ds que nous voyions arriver les Franais, nous ne demeurions
jamais l'intrieur. Les vieilles restaient dans les maisons avec les enfants; nous, nous
allions nous cacher dans la vgtation ou prs de l'oued. Si l'ennemi nous surprenait, nous
ne disions rien...
Une nuit, les maquisards arrivrent. Ils prirent le caf, puis partirent. A peine n'taient-ils plus
l que la France surgit : les soldats avaient vu nos lumires partir de la route.
Les fellagha taient chez vous ! (car ils appe-laient fellagha ceux que nous, nous
appelions frres ).
Ils voulurent emmener mon mari. Nous savions qu'un homme arrt en pleine nuit ne revient
jamais. Je me mis pleurer, dnouer mes che-veux, me lacrer les joues. Toutes les
femmes de la maison firent de mme, de plus en plus fort : de quoi les assourdir tous !
Dehors, leur officier entendit les pleureuses. Il entra et leur dit :
Laissez cet homme !
Ils prirent seulement ses papiers et le convo-qurent au poste pour le lendemain.
Nous habitions alors prs du champ Ouled Larbi. Nous ne possdions rien : mon mari tait
journalier. Ils ont fini tout de mme par le tuer.
Ils sont venus le chercher au champ. C'tait un vendredi. Il n'est pas revenu. On me dit plus
tard qu'un nomm Mnaia l'avait trahi.
Les Franais l'ont tortur du vendredi au dimanche. Ce dernier jour, quelqu'un vint
m'annoncer que mon mari avait t mis au poteau , sur la place du village. Ils le turent
ainsi, publiquement, devant tout le monde.
Il m'a laiss les enfants en bas ge. Le dernier tait dans mon ventre : j'tais enceinte d'un
mois et demi. Ce fils a maintenant vingt ans! Je lui amne sa marie, si Dieu veut, la
semaine pro-chaine ! Car j'ai une sant fragile. Je me suis dit : Si je meurs, je le saurai
dans son foyer! Je parti-rai tranquille! ... Pour le choix de la fiance, il m'a dit :
Va faire la demande cet endroit !
Il devra travailler seulement pour elle. Car, moi, je n'ai pas besoin de lui! Toutes mes filles
habitent chez elles; mon dernier une fois mari, ma pension de veuve de guerre me suffira !
CORPS ENLACS
Lorsque, en 1956, la section des parachutistes et des lgionnaires franais arrive, au milieu
du jour, El Aroub, les mille habitants de ce village de montagne ont disparu. Un fou erre,
seul, prs d'une range d'oliviers; une vieille femme snile reste accroupie prs de la
fontaine.
La veille encore, quarante-cinq maquisards taient installs l, ouvertement, depuis plus d'un
mois : sur la mosque repeinte, flottait le drapeau vert et blanc de l'indpendance. Les vieux
du vil-lage regrettaient de ne pas voir les Frres y faire rgulirement leurs prires. Mais
l'arrive en force des Franais est signale avant l'aube : les hommes de quatorze
soixante ans se dcident partir avec les maquisards. Femmes, enfants, vieillards, fuient
dans les broussailles et les rochers des alentours, avec l'espoir que l'ennemi ne sera que de
passage.
Or les soldats s'installent. Dans la plaine, sont rests en stationnement le gnie, l'infanterie
et les compagnies militaires. Pousse par la faim, aprs trois longs jours d'attente, la
population civile finit par ressortir; elle revient, drapeaux blancs en tte, pitoyable procession
de femmes aux mamelles vides et aux bbs geignants.
La dception et l'ennui ont pouss la solda-tesque un pillage systmatique. Les habitants
retrouvent leur village retourn de fond en comble, comme un champ : les provisions
sches ont disparu ou ont t crases, les coffres toffes sont ventrs, les toits des
mai-sons dmolis, on y a cherch autant les armes que les pices d'argent caches... Les
robes de noces ont t suspendues aux arbres par drision, tra-nes dans la boue, par-
dessus les chambranles des portes arraches, pour simuler un carnaval grotesque.
Dans ce saccage, les mres cherchent quoi don-ner aux enfants affams. Certaines,
dsespres, pleurent en silence sur les seuils.
Au milieu de ce triste retour, deux hommes en uniforme de maquisards sont capturs :
l'arme pousse ses premiers hourras de victoire.
Le chef des parachutistes, un lieutenant aristo-crate, demande un deuxime classe, un
Alsacien, de tenter d'obtenir des prisonniers l'indication de la cache d'armes. L'interrogatoire
commence en plein air, au pied d'un olivier; il sera interminable. L'Alsacien a cur de
montrer qu'il connat son mtier de tortionnaire. L'offi-cier, qui ne se salit pas les mains,
affiche une impassibilit non dnue de mpris.
Les captifs deviennent vite mconnaissables. Un silence, une distraction s'empare des
soldats, qui avaient t, dans un premier temps, attirs par le spectacle. Les hardes,
pendues aux branches, semblent soudain seules spectatrices du supplice qui s'tire au
soleil...
Enfin, l'un des supplicis cde. Il dsigne la cache. Tous se prcipitent. Mais, sur un geste
du lieutenant rest en arrire, les deux prisonniers sont abattus d'une premire, d'une
seconde rafale.
Parmi les lgionnaires, l'un crit les jours d'El Aroub et les revit. Quelquefois mme il pleure,
mais sans larme, n'en ayant plus depuis long-temps .
Je le lis mon tour, lectrice de hasard, comme si je me retrouvais enveloppe du voile
ancestral ; seul mon il libre allant et venant sur les pages, o ne s'inscrit pas seulement ce
que le tmoin voit, ni ce qu'il coute.
Le lendemain qui suit cet interrogatoire, une paysanne reconnatra son mari parmi les deux
morts sans spulture.
Elle se prcipite hardiment jusqu'au milieu de notre bivouac, pleurant, criant, nous insultant
d'une voix effrayante. Elle nous menaa longtemps de son maigre poing dcharn .
Les soldats, nouveau oisifs, regardent au loin la mer. La plage est tentante, dans cette
canicule, mais une paisse fort la longe sur des kilomtres. Les maquisards aux yeux de
lynx, tapis l sans nul doute, en profiteraient pour attaquer...
Les ordres de retrait tardent. L'agitation autour du village, le dsordre, les pleurs des femmes
se ralentissent. L'ordre arrive de quitter les lieux le lendemain. Les soldats marcheront une
journe entire pour atteindre la mer. Des camions, pr-cds d'auto-mitrailleuses et suivis
de chars, les emmneront jusqu' Constantine. Sales comme des chiens perdus , ils
dorment auparavant sur la plage; l'aube ils se rveillent sous la pluie...
Est-ce au cours de cette descente vers la mer ou le lendemain, dans un des camions du
convoi, sous la pluie, qu'un certain Bernard se confie celui qui fera le rcit de ces jours d'El
Aroub, et voque ce qu'il n'oubliera plus?...
A nouveau, un homme parle, un autre coute, puis crit. Je bute, moi, contre leurs mots qui
cir-culent ; je parle ensuite, je vous parle, vous, les veuves de cet autre village de
montagne, si loi-gn ou si proche d'El Aroub !
La veille du dpart, en pleine nuit, Bernard sans armes rampe sur les genoux et les coudes,
passe dans le noir entre deux sentinelles, pro-gresse, ttonne dans le village, jusqu' ce qu'il
trouve une ferme au toit moiti effondr, la porte presque entirement arrache.
L, avoue-t-il, dans la journe, une jolie Fatma m'avait souri !
Il se glisse sans frapper. Il doit tre une heure trente du matin. Il hsite dans le noir, puis
gratte une allumette : devant lui, une assistance fmi-nine, recroqueville en cercle, le
regarde ; presque toutes sont de vieilles femmes ou le paraissent. Elles sont serres les
unes contre les autres ; leurs yeux luisent d'effroi et de surprise...
Le Franais sort de ses poches des provisions en vrac, qu'il distribue htivement. Il va et
vient, il rallume une allumette; ses yeux qui cherchaient rencontrent enfin la jolie Fatma
qui avait souri. Il la saisit aussitt par la main, la redresse.
Le noir est revenu. Le couple se dirige au fond de l'immense pice, l o l'ombre est de suie.
Le cercle des vieilles n'a pas boug, compagnes accroupies, surs du silence, aux pupilles
obs-curcies fixant le prsent prserv : le lac du bon-heur existerait-il?...
Le Franais s'est dshabill. Je me serais cru chez moi , avouera-t-il. Il presse contre lui
la jeune fille qui frmit, qui le serre, qui se met le caresser.
Si l'une des vieilles allait se lever et venir me planter un couteau dans le dos ? songe-t-il.
Soudain, deux bras frles lui entourent le cou, une voix commence un discours de mots
hale-tants, de mots chevauchs, de mots inconnus mais tendres, mais chauds, mais
chuchots. Ils coulent droit au fond de son oreille, ces mots, arabes ou berbres, de
l'inconnue ardente.
Elle m'embrassait de toutes ses lvres, comme une jeune fille. Imagine un peu ! Je n'avais
jamais vu a!... A ce point-l! Elle m'embrassait! Tu te rends compte?... M'embrasser ! C'est
ce petit geste insens surtout que je ne pourrai oublier!
Bernard est retourn au camp vers trois heures du matin. A peine endormi, il sera rveill en
sur-saut : il faut quitter le village jamais.
Vingt ans aprs, je vous rapporte la scne, vous les veuves, pour qu' votre tour vous
regar-diez, pour qu' votre tour, vous vous taisiez. Et les vieilles immobilises coutent la
villageoise inconnue qui se donne.
Silence chevauchant les nuits de passion et les mots refroidis, silence des voyeuses qui
accompagne, au cur d'un hameau ruin, le frmissement des baisers.
CINQUIME MOUVEMENT
LA TUNIQUE DE NESSUS
Le pre, silhouette droite et le fez sur la tte, marche dans la rue du village ; sa main me tire
et moi qui longtemps me croyais si fire moi, la premire de la famille laquelle on
achetait des poupes franaises, moi qui, devant le voile-suaire n'avais nul besoin de
trpigner ou de baisser l'chin comme telle ou telle cousine, moi qui, suprme coquetterie,
en me voilant lors d'une noce d't, m'imaginais me dguiser, puisque, dfinitivement, j'avais
chapp l'enfermement je marche, fillette, au-dehors, main dans la main du pre.
Soudain, une rticence, un scrupule me taraude : mon devoir n'est-il pas de rester en
arrire , dans le gynce, avec mes semblables? Adolescente ensuite, ivre quasiment de
sentir la lumire sur ma peau, sur mon corps mobile, un doute se lve en moi : Pourquoi
moi ? Pourquoi moi seule, dans la tribu, cette chance?
Je cohabite avec la langue franaise : mes que-relles, mes lans, mes soudains ou violents
mutismes forment incidents d'une ordinaire vie de mnage. Si sciemment je provoque des
clats, c'est moins pour rompre la monotonie qui m'insup-porte, que par conscience vague
d'avoir fait trop tt un mariage forc, un peu comme les fillettes de ma ville promises ds
l'enfance.
Ainsi, le pre, instituteur, lui que l'enseignement du franais a sorti de la gne familiale,
m'aurait donne avant l'ge nubile certains pres n'abandonnaient-ils pas leur fille
un prtendant inconnu ou, comme dans ce cas, au camp ennemi? L'inconscience que
rvlait cet exemple traditionnel prenait pour moi une signification contraire : auprs de mes
cousines, vers dix ou onze ans, je jouissais du privilge reconnu d'tre l'aime de mon
pre, puisque il m'avait prser-ve, sans hsiter, de la claustration.
Mais les princesses royales marier passent galement de l'autre ct de la frontire,
souvent malgr elles, la suite des traits qui terminent les guerres.
Le franais m'est langue martre. Quelle est ma langue mre disparue, qui m'a abandonne
sur le trottoir et s'est enfuie?... Langue-mre idalise ou mal-aime, livre aux hrauts de
foire ou aux seuls geliers!... Sous le poids des tabous que je porte en moi comme hritage,
je me retrouve dserte des chants de l'amour arabe. Est-ce d'avoir t expulse de ce
discours amoureux qui me fait trouver aride le franais que j'emploie ?
Le pote arabe dcrit le corps de son aime; le raffin andalou multiplie traits et manuels
pour dtailler tant et tant de postures rotiques ; le mys-tique musulman, dans son haillon de
laine et ras-sasi de quelques dattes, s'engorge d'pithtes somptueuses pour exprimer sa
faim de Dieu et son attente de l'au-del... La luxuriance de cette langue me parat un
foisonnement presque suspect, en somme une consolation verbale... Richesse perdue au
bord d'une rcente dliquescence !
Les mots d'amour s'lvent dans un dsert. Le corps de mes surs commence, depuis
cinquante ans, surgir par taches isoles, hors de plusieurs sicles de cantonnement; il
ttonne, il s'aveugle de lumire avant d'oser avancer. Un silence s'installe autour des
premiers mots crits, et quelques rires pars se conservent au-del des gmissements.
L'amour, ses cris ( s'crit ) : ma main qui crit tablit le jeu de mots franais sur les
amours qui s'exhalent; mon corps qui, lui, simplement s'avance, mais dnud, lorsqu'il
retrouve le hulule-ment des aeules sur les champs de bataille d'autrefois, devient lui-mme
enjeu : il ne s'agit plus d'crire que pour survivre.
Bien avant le dbarquement franais de 1830, durant des sicles autour des prsides
espagnols (Oran, Bougie, comme Tanger ou Ceuta, au Maroc), la guerre entre indignes
rsistants et occupants souvent bloqus se faisait selon la tactique du rebato : point isol
d'o l'on attaquait, o l'on se repliait avant que, dans les trves intermdiaires, le lieu
devienne zone de cultures, ou de ravitaillement.
Ce type de guerre, hostilit offensive et rapide alternant avec son contraire, permettait
chaque partenaire de se mesurer indfiniment l'autre.
Aprs plus d'un sicle d'occupation franaise qui finit, il y a peu, par un charnement ,
un ter-ritoire de langue subsiste entre deux peuples, entre deux mmoires ; la langue
franaise, corps et voix, s'installe en moi comme un orgueilleux pr-side, tandis que la
langue maternelle, toute en oralit, en hardes dpenailles, rsiste et attaque, entre deux
essoufflements. Le rythme du rebato en moi s'peronnant, je suis la fois l'assig
tranger et l'autochtone partant la mort par bravade, illusoire effervescence du dire et de
l'crit.
crire la langue adverse, ce n'est plus inscrire sous son nez ce marmonnement qui
monologue; crire par cet alphabet devient poser son coude bien loin devant soi, par-
derrire le remblai or dans ce retournement, l'criture fait ressac.
Langue installe dans l'opacit d'hier, dpouille prise celui avec lequel ne s'changeait
aucune parole d'amour... Le verbe franais qui hier tait clam, ne l'tait trop souvent qu'en
prtoire, par des juges et des condamns. Mots de revendica-tion, de procdure, de
violence, voici la source orale de ce franais des coloniss.
Sur les plages dsertes du prsent, amen par tout cessez-le-feu invitable, mon crit
cherche encore son lieu d'change et de fontaines, son commerce.
Cette langue tait autrefois sarcophage des miens; je la porte aujourd'hui comme un
messa-ger transporterait le pli ferm ordonnant sa condamnation au silence, ou au cachot.
Me mettre nu dans cette langue me fait entre-tenir un danger permanent de dflagration.
De l'exercice de l'autobiographie dans la langue de l'adversaire d'hier...
Aprs cinq sicles d'occupation romaine, un Algrien, nomm Augustin, entreprend sa
biogra-phie en latin. Parle de son enfance, dclare son amour pour sa mre et pour sa
concubine, regrette ses aventures de jeunesse, s'abme enfin dans sa passion d'un Dieu
chrtien. Et son criture droule, en toute innocence, la mme langue que celle de Csar, ou
de Sylla, crivains et gnraux d'une guerre d'Afrique rvolue.
La mme langue est passe des conqurants aux assimils; s'est assouplie aprs que les
mots ont envelopp les cadavres du pass... Le style de saint Augustin est emport par
l'lan de sa qute de Dieu. Sans cette passion, il se retrouverait nu : Je suis devenu moi-
mme la contre du dnue-ment . Si cet amour ne le maintenait pas en tat de transe
jubilatoire, il crirait comme on se lacre !
Aprs l'vque d'Hippone, mille ans s'coulent au Maghreb. Cortge d'autres invasions,
d'autres occupations... Peu aprs le tournant fatal que reprsente la saigne blanc de la
dvastation hilalienne, Ibn Khaldoun, de la mme stature qu'Augustin, termine une vie
d'aventures et de mditation par la rdaction de son autobiogra-phie. Il l'intitule Ta'arif ,
c'est--dire Identit .
Comme Augustin, peu lui importe qu'il crive, lui, l'auteur novateur de l'Histoire des
Ber-bres , une langue installe sur la terre ancestrale dans des effusions de sang !
Langue impose dans le viol autant que dans l'amour...
Ibn Khaldoun a alors prs de soixante-dix ans; aprs un face face avec Tamerlan sa
dernire aventure , il s'apprte mourir dans un exil gyptien. Il obit soudain un dsir
de retour sur soi : le voici, lui-mme, objet et sujet d'une froide autopsie.
Pour ma part, tandis que j'inscris la plus banale des phrases, aussitt la guerre ancienne
entre deux peuples entrecroise ses signes au creux de mon criture. Celle-ci, tel un
oscillographe, va des images de guerre conqute ou libration, mais toujours d'hier la
formulation d'un amour contradictoire, quivoque.
Ma mmoire s'enfouit dans un terreau noir; la rumeur qui la porte vrille au-del de ma plume.
J'cris, dit Michaux, pour me parcourir. Me parcourir par le dsir de l'ennemi d'hier, celui
dont j'ai vol la langue...
L'autobiographie pratique dans la langue adverse se tisse comme fiction, du moins tant que
l'oubli des morts charris par l'criture n'opre pas son anesthsie. Croyant me parcourir ,
je ne fais que choisir un autre voile. Voulant, chaque pas, parvenir la transparence, je
m'engloutis davantage dans l'anonymat des aeules !
Une constatation trange s'impose : je suis ne en dix-huit cent quarante-deux, lorsque le
commandant de Saint-Arnaud vient dtruire la zaouia des Beni Mnacer, ma tribu d'origine,
et qu'il s'extasie sur les vergers, sur les oliviers dispa-rus, les plus beaux de la terre
d'Afrique , prcise-t-il dans une lettre son frre.
C'est aux lueurs de cet incendie que je parvins, un sicle aprs, sortir du harem ; c'est
parce qu'il m'claire encore que je trouve la force de parler. Avant d'entendre ma propre voix,
je perois les rles, les gmissements des emmurs du Dahra, des prisonniers de Sainte-
Marguerite ; ils assurent l'orchestration ncessaire. Ils m'interpellent, ils me soutiennent pour
qu'au signal donn, mon chant solitaire dmarre.
La langue encore coagule des Autres m'a enveloppe, ds l'enfance, en tunique de
Nessus, don d'amour de mon pre qui, chaque matin, me tenait par la main sur le chemin de
l'cole. Fillette arabe, dans un village du Sahel algrien...
SOLILOQUE
Circulant depuis mon adolescence hors du harem, je ne parcours qu'un dsert des lieux. Les
cafs, Paris ou ailleurs, bourdonnent, des inconnus m'entourent : je m'oublie des heures
percevoir des voix sans visages, des bribes de dia-logues, des brisures de rcits, tout un
balbutiement, un buissonnement de bruits dtachs du magma des faces, dlivrs de
l'inquisition des regards.
Le coutre de ma mmoire creuse, derrire moi, dans l'ombre, tandis que je palpite en plein
soleil, parmi des femmes impunment mles aux hommes... On me dit exile. La diffrence
est plus lourde : je suis expulse de l-bas pour entendre et ramener mes parentes les
traces de la libert... Je crois faire le lien, je ne fais que patouiller, dans un marcage qui
s'claire peine.
Ma nuit remue de mots franais, malgr les morts rveills... Ces mots, j'ai cru pouvoir les
sai-sir en colombes malgr les corbeaux des charniers, malgr la hargne des chacals qui
dchiquettent. Mots tourterelles, rouges-gorges comme ceux qui attendent dans les cages
des fumeurs d'opium... Un thrne diffus s'amorce travers les claies de l'oubli, amour
d'aurore. Et les aurores se rallument parce que j'cris.
Ma fiction est cette autobiographie qui s'esquisse, alourdie par l'hritage qui m'encombre.
Vais-je succomber?... Mais la lgende tribale zig-zague dans les bances et c'est dans le
silence des mots d'amour, jamais profrs, de la langue mater-nelle non crite, transporte
comme un bavardage d'une mime inconnue et hagarde, c'est dans cette nuit-l que
l'imagination, mendiante des rues, s'accroupit...
Le murmure des compagnes clotres redevient mon feuillage. Comment trouver la force de
m'arracher le voile, sinon parce qu'il me faut en couvrir la plaie ingurissable, suant les
mots tout ct ?
TZARL-RIT (final)
tzarl-rit :
pousser des cris de joie en se frappant les lvres avec les mains (femmes)
Dictionnaire arabe-franais Beaussier
crier, vocifrer (les femmes, quand quelque malheur leur arrive)
Dictionnaire arabe-franais Kazimirski
PAULINE..
Paris, dbut juin 1852. Dix femmes, dont l'une prnomme Pauline, sont rveilles en
sursaut, peu avant l'aube, la prison Saint-Lazare :
Le dpart, c'est le dpart pour l'Algrie !
Les religieuses les bousculent pour hter leurs prparatifs. Le jour ne filtre mme pas
encore; les hommes d'armes font rsonner de bruits d'acier les hauts couloirs gris.
C'est le dpart pour l'Algrie, reprend une voix craintive.
Ainsi le nom de mon pays rsonne en glas pour ces prisonnires. Les balluchons ficeler
vite, le registre de la prison signer et c'est la marche, dehors, sans calche... A peine si
l'une, trop malade, obtient qu'on la transporte.
Dans un Paris de l'aube que le groupe de dte-nues et de soldats traverse, des rires de
ftards attards souillent celles qu'on prend pour des filles de joie. Elles parviennent
l'embarcadre sur la Seine. Quelques heures aprs, c'est le dpart pour Le Havre ; de l, le
voyage en bateau se poursuit vers la terre sauvage. C'est l, en effet, que les tribunaux
parisiens envoient, aprs le Coup d'tat du 2 dcembre, les irrductibles de la rvolution de
48... Des centaines d'hommes et de femmes seront ainsi dports...
Parmi ce peuple comme diraient les diseuses de chez moi se trouve Pauline
Rol-land. Une institutrice de quarante-quatre ans qui combat pour sa foi et ses ides ,
pour reprendre les mots de la bergre de mes montagnes. Pauvre comme elle; comme elle,
humble et trop fire...
Pauline Rolland dbarque le 23 juin 1852 prs d'Oran. Quatre mois plus tard, le 25 octobre,
elle embarquera malade, de Bne, pour revenir en France et mourir aussitt aprs. De
l'ouest l'est, tout cet t d'hier, elle circulera de ville en ville, surveille, espionne,
expulse...
Corps transport de Mers el-Kbir Oran, d'Oran Alger, d'Alger Bougie dans ces
villes, elle ne voit rien, except des soldats et ses geliers; de l, par des chemins qui
longent une Kaby- lie insoumise, Pauline arrive dos d'ne Stif o elle subsiste en
travaillant comme lingre. Deux mois aprs, elle est relgue dans une forte-resse
Constantine ; enfin, elle est amene Bne o lui parvient la permission de rentrer en
France
prtendue sollicitude, n'est-elle pas mre de trois enfants, quoique considre galement
comme une dangereuse agitatrice .
Elle embarquera trs malade. Sur le bateau qu'elle prend, elle demeurera couche sur le
pont, souvent battu par les vagues d'une mer dmonte. Dbarque Marseille, Pauline ne
peut plus se lever. A Lyon, chez des amis, elle agonise, et lorsque son fils an, un jeune
homme couvert de lauriers scolaires, accourt, elle est inconsciente. En fait, elle n'a plus
quitt l'Algrie sinon pour dlirer... Notre pays devient sa fosse : ses vri-tables hritires
Chrifa de l'arbre, Lia Zohra errante dans les incendies de campagne, le chur des veuves
anonymes d'aujourd'hui pourraient pousser, en son honneur, le cri de triomphe ancestral,
ce hululement de sororit convulsive !
Durant les quatre mois de ce voyage algrien, Pauline n'a cess d'crire de multiples lettres
ses amies de combat, sa famille, ses proches...
J'ai rencontr cette femme sur le terrain de son criture : dans la glaise du glossaire franais,
elle et moi, nous voici aujourd'hui enlaces. Je relis ces lettres parties d'Algrie; une phrase
me par-vient, calligraphie d'amour, enroulant la vie de Pauline :
En Kabylie, crit Pauline, en juillet 1852, j'ai vu la femme bte de somme et l'odalisque de
harem d'un riche. J'ai dormi prs des premires sur la terre nue, et prs des secondes dans
l'or et la soie...
Mots de tendresse d'une femme, en gsine de l'avenir : ils irradient l sous mes yeux et enfin
me librent.
LA FANTASIA
Ce mme mois d'octobre 1852, tandis que Pau-line Rolland quitte Bne pour mourir, Eugne
Fromentin commence un sjour dans ce pays que vingt-deux ans de guerre permanente
viennent de ployer. Il y arrive, touriste lgant, aristocrate paisible, un penchant affirm pour
la chasse et les dcors de campagne automnale.
Une gnration d'affrontements sanglants, de poursuite et de hallali s'achve. La Kabylie et
le Sud restent inentams : Fromentin se contentera de longer ces rivages. Au Nord, la nature
qu'il s'applique peindre, o il se promne, regard et oue galement l'afft, se prsente
comme une rserve giboyeuse que de trop longues battues auraient vide. Les tres, tout en
gentillesse et en apparente fragilit, s'avancent, fantmes de quel crmonial perdu... Une
vie, malgr la dfaite, tente de se refaire l et ces demi-morts d'un pays qui s'asservit, o les
rvoltes se circonscrivent des aires prcises, se souviennent du combat, mais font
semblant de dormir, de rver au soleil, de fumer du hachisch.
Une accalmie intervient, o la vgtation n'est point encore celle dont s'empareront les
colons, leurs saisonniers pitinant plus tard dans la pous-sire. En dpit des chocs passs,
les paysages s'offrent dans la puret de la dcouverte, au Nord avec des nuances fugaces,
au Sud dans de hau-tains contrastes.
Surtout, Fromentin s'prend de la lumire; il tente de nous la transmettre. Nos anctres,
nim-bs par elle, deviennent, sous les yeux de cet amoureux du gris, de ce dessinateur
excellant dans les scnes de chasse, des complices attrists de sa mlancolie.
En dcrivant un de ses sjours en Algrie, Eugne Fromentin intitule son rcit Chronique
de l'Absent . Or il trouve, dans le Sahel de mon enfance, un jardin o tout, prcisment,
parle d'absence.
O mon ami, je suis tue !
Ainsi soupire une dernire fois Haoua, une jeune femme venue avec son amie, danseuse de
Blida, pour assister la fantasia des Hadjouts, un jour d'automne ; un cavalier, amoureux
conduit, l'a renverse au dtour d'un galop. Elle reoit la face un coup mortel du sabot de
la monture et, tandis que le cavalier meurtrier disparat l'hori-zon, au-del des montagnes
de la Mouzaa, elle agonise toute la soire. Fromentin se fait narra-teur de cette fte funbre.
Est-ce qu'invitablement, toute histoire d'amour ne peut tre voque sur ces lieux,
autre-ment que par son issue tragique? Amour furieux de ce guerrier hadjout, que Haoua a
quitt et qu'il abat. Amour aussi mais peine devin, d'un ami du peintre franais pour la
Mauresque myst-rieuse qui s'exprimait par les couleurs de ses cos-tumes, par le murmure
indistinct de sa voix d'oiseau... Premire Algrienne d'une fiction en langue franaise aller
et venir, oiseusement, premire respirer en marge et feindre d'igno-rer la transgression...
Haoua a d natre juste avant, ou juste aprs l'anne de la prise de la Ville. Son enfance,
son adolescence ont t nourries de la rumeur des combats, des guet-apens, des
embuscades qu'inflige aux Franais cette redoutable tribu des Hadjouts; celle-ci, cinq ans
aprs la soumission d'Abdelkader, se retrouve dcime et vit, jour aprs jour, sa lente
agonie. Et c'est le vrai tra-gique de cette fantasia que Fromentin ressuscite : gesticulation de
la victoire envole, assomption des corps au soleil dans la vitesse des cavales...
Le printemps prcdent, Haoua a reu, au vu et au su d'une cit voisine, un ami franais.
Cet homme, errant dans la poussire et le silence des routes, est amateur de crpuscules.
La campagne, autour, avec ses ciels moribonds, ses races d'oiseaux sur le point de mourir,
ses chameaux attards, se vide irrmdiablement... Les Had-jouts, compagnons de l'mir,
eux, les brigands qui ont harcel les envahisseurs de la Ville, voient leur tribu disparatre,
comme disparatra, vingt ans plus tard, le magnifique lac Halloula et son peuple d'oiseaux
innombrables.
O mon ami, je suis tue! soupire la jeune femme sous la tente.
Ainsi soupire la plaine entire du Sahel, hommes et btes, les combats une fois termins.
AIR DE NAY
Lors j'interviens, la mmoire nomade et la voix coupe. Inlassablement, j'ai err aux quatre
coins de ma rgion natale entre la Ville prise et les ruines de Csare, elle s'tend au pied
du mont Chenoua, l'ombre du pic de la Mouzaa, plaine alanguie mais aux plaies encore
ouvertes. J'inter-viens pour saluer le peintre qui, au long de mon vagabondage, m'a
accompagne en seconde sil-houette paternelle. Eugne Fromentin me tend une main
inattendue, celle d'une inconnue qu'il n'a jamais pu dessiner.
En juin 1853, lorsqu'il quitte le Sahel pour une descente aux portes du dsert, il visite
Laghouat occupe aprs un terrible sige. Il voque alors un dtail sinistre : au sortir de
l'oasis que le mas-sacre, six mois aprs, empuantit, Fromentin ramasse, dans la poussire,
une main coupe d'Algrienne anonyme. Il la jette ensuite sur son chemin.
Plus tard, je me saisis de cette main vivante, main de la mutilation et du souvenir et je tente
de lui faire porter le qalam .
Vingt ans se sont couls depuis un rcent arra-chement. Dans le silence qui termine
d'ordinaire les opras funbres, je vais et je viens sur ma terre, j'entre dans les demeures de
village o les diseuses se rappellent la cavalcade d'hier puis, le corps emmitoufl, font
semblant nouveau de dormir : enfanter derrire des persiennes, en plein midi, baisses.
Quel rivage s'annonce pour moi, rveuse qui m'avance, retrouvant la main de la mutilation
que le peintre a jete?... Quelle liesse se prpare, han-te par le chant de tribus disparues?
Agilit de doigts rougis au henn qui s'activent, cre parfum des grillades qui s'vapore et les
tambours chauffent sur des braseros enfums...
Dans la gerbe des rumeurs qui s'parpillent, j'attends, je pressens l'instant immanquable o
le coup de sabot la face renversera toute femme dresse libre, toute vie surgissant au
soleil pour danser! Oui, malgr le tumulte des miens alen-tour, j'entends dj, avant mme
qu'il s'lve et transperce le ciel dur, j'entends le cri de la mort dans la fantasia.
Paris /Venise/ Alger (juillet 82-octobre 84)
Table
Premire partie : la prise de la ville ou L'amour s'crit 9
Fillette arabe allant pour la premire fois l'cole 11
I 14
Trois jeunes filles clotres 18
II 25
La fille du gendarme franais 33
III 45
Mon pre crit ma mre 54
IV 59
Biffure 69
Deuxime partie : les cris de la fantasia .... 71
La razzia du capitaine Bosquet, partir d'Oran 73
1 86
Femmes, enfants, bufs couchs dans les grottes 94
II 116
La marie nue de Mazouna 119
III 145
Sistre 156
Troisime partie : les voix ensevelies 159
Premier Mouvement
Les deux inconnus 161
Voix 167
Clameur. 175
L'aphasie amoureuse 179
Voix 185
Corps enlacs 201
Deuxime Mouvement
Transes 205
Voix 209
Murmures 216
La mise sac 219
Voix 225
Corps enlacs 233
Troisime Mouvement
La complainte d'Abraham 239
Voix 245
Chuchotements 249
L'cole coranique 253
Voix de veuve 262
Corps enlacs 267
Quatrime Mouvement
Le cri dans le rve 271
Voix de veuve 277
Conciliabules 281
Les voyeuses 284
Voix de veuve 288
Corps enlacs 291
Cinquime Mouvement
La tunique de Nessus 297
Soliloque 303
Tzarl-rit (final) 305
Pauline 307
La fantasia 310
Air de nay 313
O.F
S-ar putea să vă placă și
- Titre. L Image Et L Identité Féminines Entre Mère Et Patrie Dans La Civilisation, Ma Mère!... de Driss ChraïbiDocument105 paginiTitre. L Image Et L Identité Féminines Entre Mère Et Patrie Dans La Civilisation, Ma Mère!... de Driss ChraïbiMounir Oussikoum100% (3)
- L'Oeuvre d'Émile Zola (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreDe la EverandL'Oeuvre d'Émile Zola (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Assia Djebbar La SoifDocument2 paginiAssia Djebbar La Soifchemseddine chihebÎncă nu există evaluări
- Le Soleil des Scorta - Laurent Gaudé (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreDe la EverandLe Soleil des Scorta - Laurent Gaudé (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Le Fils DU PauvreDocument65 paginiLe Fils DU PauvreHope WilliamÎncă nu există evaluări
- Les Précieuses ridicules de Molière (Analyse de l'oeuvre): Comprendre la littérature avec lePetitLittéraire.frDe la EverandLes Précieuses ridicules de Molière (Analyse de l'oeuvre): Comprendre la littérature avec lePetitLittéraire.frÎncă nu există evaluări
- Le Fils Du PauvreDocument199 paginiLe Fils Du PauvrefergfuÎncă nu există evaluări
- Les impatientes de Djaïli Amadou Amal (Analyse de l'œuvre): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreDe la EverandLes impatientes de Djaïli Amadou Amal (Analyse de l'œuvre): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (1)
- Avant - Projet de MasterDocument8 paginiAvant - Projet de MasterFadhila HasniÎncă nu există evaluări
- Fiche de lecture illustrée - Les Bonnes, de Jean GenetDe la EverandFiche de lecture illustrée - Les Bonnes, de Jean GenetÎncă nu există evaluări
- Assia DjebarDocument391 paginiAssia DjebarsamyÎncă nu există evaluări
- L'Interdite Malika MokeddemDocument197 paginiL'Interdite Malika Mokeddemchelariuroxana100% (7)
- Littérature Féminine Au MarocDocument12 paginiLittérature Féminine Au Marockamal achikeÎncă nu există evaluări
- La Littérature Marocaine D'expression FrançaiseDocument11 paginiLa Littérature Marocaine D'expression Françaiseyogoamor100% (1)
- Mouloud Feraoun - La Terre Et Le SangDocument236 paginiMouloud Feraoun - La Terre Et Le Sangbrian.251610517100% (1)
- L'intertextualité Dans L'oeuvre de Lounis Ait Menguellet - FLICI KahinaDocument193 paginiL'intertextualité Dans L'oeuvre de Lounis Ait Menguellet - FLICI Kahinaidlisen100% (3)
- Abine Bine Entre Tien PortraitDocument3 paginiAbine Bine Entre Tien Portraityounes100% (1)
- Nouvelle Génération D'écrivains Maghrébins Et Subsahariens de Langue Française: Nouveaux Rapports À La Langue Française ?Document17 paginiNouvelle Génération D'écrivains Maghrébins Et Subsahariens de Langue Française: Nouveaux Rapports À La Langue Française ?Titi Suru100% (1)
- Driss Chraibi-Les BoucsDocument74 paginiDriss Chraibi-Les BoucsHafid Tlemcen Rossignol Poète33% (3)
- Le Fils Du PauvreDocument25 paginiLe Fils Du PauvreSite Commune Langue95% (40)
- Maissa Bey - HizyaDocument156 paginiMaissa Bey - HizyaDyhia Kheloufi100% (3)
- Assia Djebar 2Document9 paginiAssia Djebar 2samyÎncă nu există evaluări
- Ces Voix Qui M Assiegent en Marge de Ma FrancophonieDocument22 paginiCes Voix Qui M Assiegent en Marge de Ma FrancophoniesilvacantoniÎncă nu există evaluări
- Femmes Dalger Dans Leur Appartement (Djebar, Assia Etc.) (Z-Library)Document178 paginiFemmes Dalger Dans Leur Appartement (Djebar, Assia Etc.) (Z-Library)إكرام صغيري100% (1)
- La Littérature Maghrébine de Langue FrançaiseDocument19 paginiLa Littérature Maghrébine de Langue Françaisedaria popescu86% (7)
- Zoulikha OUDAI Heroine Epique Dans La Femme Sans Sepulture Dassia DJEBARDocument90 paginiZoulikha OUDAI Heroine Epique Dans La Femme Sans Sepulture Dassia DJEBARSãb RïnãÎncă nu există evaluări
- Batouala Rene MaranDocument6 paginiBatouala Rene Maranarubera201086% (7)
- Le Conte KabyleDocument9 paginiLe Conte Kabylekantikors100% (1)
- Le Fils Du PauvreDocument25 paginiLe Fils Du Pauvrepqnamw0% (1)
- Projet Fin D Etude BoulhakDocument33 paginiProjet Fin D Etude BoulhakMon prof de français100% (1)
- Femme, Identité, Écriture Dans Les Textes Francophones Du MaghrebDocument14 paginiFemme, Identité, Écriture Dans Les Textes Francophones Du MaghrebTiti SuruÎncă nu există evaluări
- La Littérature Comparée - Yves ChevrelDocument99 paginiLa Littérature Comparée - Yves ChevrelCharlotte Wang100% (1)
- Mayssa Bey HiziyaDocument90 paginiMayssa Bey HiziyaMia Culpa100% (3)
- Historique Theatre AfricainDocument2 paginiHistorique Theatre AfricainAdama Dacko100% (3)
- 6 006 Tombeza PDFDocument64 pagini6 006 Tombeza PDFReda Bendimerad100% (1)
- Litterature AfricaineDocument13 paginiLitterature Africainemouhabalde67% (3)
- La Plus Secrète Mémoire Des HommesDocument9 paginiLa Plus Secrète Mémoire Des HommesAhmed AlmassriÎncă nu există evaluări
- Thèse de Doctorat Sur Khaïr-EddineDocument356 paginiThèse de Doctorat Sur Khaïr-EddineGhada Mourad100% (1)
- Marianne Porte Plainte - Fatou DiomeDocument80 paginiMarianne Porte Plainte - Fatou DiomeAdji sadio DioneÎncă nu există evaluări
- Mohammed DibDocument2 paginiMohammed DibDjalal Daoui100% (1)
- (M) Mouloud Mammeri Amawal N Tmazight Tatrart 1973Document138 pagini(M) Mouloud Mammeri Amawal N Tmazight Tatrart 1973Hamid OubaghaÎncă nu există evaluări
- @ebooksdz Les Alouettes Naives - Djebar AssiaDocument279 pagini@ebooksdz Les Alouettes Naives - Djebar AssiaEddy ExantusÎncă nu există evaluări
- LQ Sémiotique Du Conte Comme TexteDocument29 paginiLQ Sémiotique Du Conte Comme TexteNatalia Popusoi100% (1)
- NedjmaDocument121 paginiNedjmavolcanoheartÎncă nu există evaluări
- Analyse Du Roman Les Soleils Des IndépendancesDocument18 paginiAnalyse Du Roman Les Soleils Des IndépendancesAlexis NdayitazireÎncă nu există evaluări
- Césaire, Aimé - Discours Sur Le ColonialismeDocument38 paginiCésaire, Aimé - Discours Sur Le ColonialismeFabien Timer100% (3)
- Puisque Mon Coeur Est Mort - Maïssa BeyDocument180 paginiPuisque Mon Coeur Est Mort - Maïssa BeyKhawla Mehenni100% (3)
- EBOOK Calixthe Beyala - Le Roman de Pauline PDFDocument125 paginiEBOOK Calixthe Beyala - Le Roman de Pauline PDFBelvi Cidy100% (2)
- Une Saison en EnferDocument2 paginiUne Saison en EnferKaren Nataly Garavito MartínÎncă nu există evaluări
- Malika Mokeddem - Des Rêves Et Des Assassins PDFDocument115 paginiMalika Mokeddem - Des Rêves Et Des Assassins PDFKhawla MehenniÎncă nu există evaluări
- Analyse de La Structure Et Des Procédés de Narration Et de Contage - Approche Comparative Des Contes de Perrault Et Des Contes Chaouis - BOUDJELLAL MEGHARI AminaDocument558 paginiAnalyse de La Structure Et Des Procédés de Narration Et de Contage - Approche Comparative Des Contes de Perrault Et Des Contes Chaouis - BOUDJELLAL MEGHARI Aminaidlisen100% (2)
- Brouillard (Jean Claude PIROTTE)Document101 paginiBrouillard (Jean Claude PIROTTE)Romain Mistretta100% (1)
- Dwnload Full Trial Techniques and Trials Aspen Coursebook Series 10th Edition Ebook PDF Version PDFDocument23 paginiDwnload Full Trial Techniques and Trials Aspen Coursebook Series 10th Edition Ebook PDF Version PDFmilton.alvarado146100% (24)
- Bac - Sujets de Francais 1re L, ES, S Important PDFDocument178 paginiBac - Sujets de Francais 1re L, ES, S Important PDFchihebÎncă nu există evaluări
- Sujet Français LDocument7 paginiSujet Français LJournaliste LibérationÎncă nu există evaluări
- Cours de MOCNDocument71 paginiCours de MOCNHouari Pachika91% (11)
- SW Esqu 3d 2000Document5 paginiSW Esqu 3d 2000Dick ManÎncă nu există evaluări
- Polycopie Cours FaoDocument63 paginiPolycopie Cours FaoDick Man0% (1)
- Usinabilité Des Pèces Et Contient Aussi CSG Et B Rep PDFDocument190 paginiUsinabilité Des Pèces Et Contient Aussi CSG Et B Rep PDFDick ManÎncă nu există evaluări
- Exercices PDFDocument15 paginiExercices PDFDick ManÎncă nu există evaluări
- Sinumerik810820 Mill FRDocument90 paginiSinumerik810820 Mill FRDick ManÎncă nu există evaluări
- Etude Du Processus Dusinage Des Pieces M 20150614145017 701034Document102 paginiEtude Du Processus Dusinage Des Pieces M 20150614145017 701034Amel AmoulaÎncă nu există evaluări
- Aboutaleb AbdelatifDocument1 paginăAboutaleb AbdelatifDick ManÎncă nu există evaluări
- Cours Proprietes Mecaniques Des MateriauxDocument122 paginiCours Proprietes Mecaniques Des MateriauxDick ManÎncă nu există evaluări
- Aide Au Choix Des Stratégies D'usinage. Etude de L'état de SurfaceDocument12 paginiAide Au Choix Des Stratégies D'usinage. Etude de L'état de SurfaceDick ManÎncă nu există evaluări
- Aide Au Choix Des Stratégies D'usinage. Etude de L'état de SurfaceDocument12 paginiAide Au Choix Des Stratégies D'usinage. Etude de L'état de SurfaceDick ManÎncă nu există evaluări
- Modeles Geometriques Polynomiaux Pour LaDocument11 paginiModeles Geometriques Polynomiaux Pour LaDick ManÎncă nu există evaluări
- Les MATERIAUXDocument56 paginiLes MATERIAUXDick ManÎncă nu există evaluări
- 1o 181 HamidiDocument6 pagini1o 181 HamidiDick ManÎncă nu există evaluări
- Construction Des LiaisonsDocument64 paginiConstruction Des LiaisonsFethi KoualaÎncă nu există evaluări
- Caractérisation Et Modélisation Thermo-Mécanique DuDocument6 paginiCaractérisation Et Modélisation Thermo-Mécanique DuDick ManÎncă nu există evaluări
- Débuter Avec SurfcamDocument100 paginiDébuter Avec SurfcamDick ManÎncă nu există evaluări
- Caractérisation Et Modélisation Thermo-Mécanique DuDocument6 paginiCaractérisation Et Modélisation Thermo-Mécanique DuDick ManÎncă nu există evaluări
- Intranet-Initiation Catia-0 Introduction À La CAODocument8 paginiIntranet-Initiation Catia-0 Introduction À La CAOMessi LionelÎncă nu există evaluări
- Tessier Doyen Nicolas PDFDocument152 paginiTessier Doyen Nicolas PDFDick Man100% (1)
- TP Arabe SWDocument72 paginiTP Arabe SWDick ManÎncă nu există evaluări
- Mazzoni AurelienDocument248 paginiMazzoni AurelienDick ManÎncă nu există evaluări