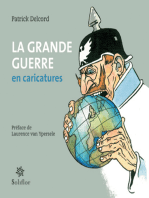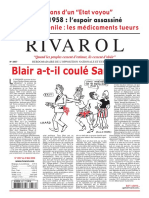Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Antoine Rivarol - Rivarol Avec Une Notice Et Un Portrait
Încărcat de
OCorpoNegroDrepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Antoine Rivarol - Rivarol Avec Une Notice Et Un Portrait
Încărcat de
OCorpoNegroDrepturi de autor:
Formate disponibile
.
*
>
U JViif OTTAWA
Il II liiiii lui
3900300255800-1
:ik!^^
V.
^
:?>
c
IfU
7X.
Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto
http://www.archive.org/details/rivarolavecunenoOOriva
COLLECTION DES PLUS BELLES PAGES
Rivarol
litterature : universalite de la langue franaise
;
voltaire et fontenblle
;
petit almanach de nos grands hommes
;
madame de stal
;
le genie et le talent.
politioue : journal politique national
;
actes des apotres
;
petit dictionnaire de la revolution.
philosophie: lettres a m. necker
;
DISCOURS prliminaire a UN DICTIONNAIRE DE LA LANGUE
FftANAISE. FRAGMENTS ET PENSEES LITTERAIRES, POLITIQUES
ET PHILOSOPHIOUES.
LETTRES. RIVAROLIANA. APPENDICE : DOCUMENTS)
BIBLIOGRAPHIE.
AVEC UNE NOTICE ET UN l'ORTRAir
PARIS
SOCIT DV MERGVRE DE FRANCE
XXVI, RVE DE COND, XXVI
RIVAROL
A LA MME LIBRAIRIE
DANS LA COLLECTION DES PLUS BELLES PAGES
.
RTIF DE LA BRETONNE, aveC UDG DOtlcG Ct UD
portrait i vol
.
GRARD DE NERVAL, av9C UDG DoticG ct lin portrait. I vol.
CHAMFORT, avec une notice et un portrait i vol.
Opuscules de Rivarol
Reproduits sur les ditions originales
I.
'
Lettre critique sur le Pome des Jardinf:, suivie du Chou
et du Navet
(1782).
Tirag'e restreint i fr. 5o
20 ex. sur papier jonquille 3 fr.
Sous Presse
II.
Lettre M. le Prsident de
*"
sur le Globe arostatiqae,
etc.
(1783).
U\.Le songe"d'Aihalie, par M. G. R. h M... de la R. E
.
Y. N.. .
(1787),
avec le Dsaveu et le Vrai Dsaveu, etc.
COLLECTION DES PLUS BELLES PAGES
Rivarol
litterature : universalite de la langue franaise
;
voltaire et fontenelle
;
petit almanach de nos grands hommes;
madame de stal
;
le gnie et le talent.
politique: journal politique national;
actes des apotres
;
petit dictionnaire
de la rvolution,
rilILOSOPHIE: LETTRES A M. NECKER
;
DISCOURS PRLIMINAIRE A UN DICTIONNAIRE DE LA LANGUE
FRANAISE. FRAGMENTS ET PENSEES LITTRAIRES, POLITIQUES
ET PHILOSOPHIQUES.
LETTRES, RIVAROLIANA. APPENDICE : DOCUMENTS;
BIBLIOGRAPHIE.
AVEC USE N0TIC2 ET UN PORTRAIT
PARIS
SOCIT DV MERGVRE DE FRAiNCE
XXVI, RVE DE COND, XXVI
IL A ETE TIUE DE CET OUVRAGE I
Sept exemplaires sur papier de Hollande, numrots la presse
de I
j.
F.XEMPLAmE ^s" 3
7(1
Droits de traduction et de reproduction rservs pour tous pays.,
y
compri;
la Sude. la Norvge et le Danemaric.
RIVAROL
Rivarol est la fois trs connu et trs inconnu :
trs connu comme homme d'esprit, trs inconnu
comme crivain, philosophe, homme politique. C'est
que sa carrire a t coupe en deux par la Rvolu-
lion. Quand les temps calmes furent revenus, il tait
mort et la premire partie de son uvre fut oublie,
tandis que la seconde, qu'il n'tait plus l pour dfen-
dre, demeurait pour ainsi dire indite, perdue en un
gros in-quarto imprim Hambourg.
Ces deux tronons du beau serpent ne se sont pas
encore rejoints dans l'esprit des hommes. Pour la
plupart Rivarol est demeur un brillant causeur qui
rivalisait avec Ghamfort; pour quelques autres, qui ne
voient que le Rivarol de la Rvolution^ c'est un poli-
tique loquent et clairvoyant, une sorte de Mallet du
Pan.
Rivarol, la vrit, fut un critique, et, comme tel,
il critiqua successivement les uvres, les hommes et
les ides qui passionnaient l'opinion.
N en lySS, il vint Paris, vers l'ge de vingt ans,
mena d'abord la vie'obscure d'un jeune homme
pau-
vre. Son esprit, ses manires agrables, la grce de
son visage lui valurent bientt des relations et dans
le monde des lettres et dans celui des salons. Il con-
nut Voltaire, BufFon, d'Alembert, puis tous ceux qui
succdaient ces grands hommes dans l'estime publi-
que; il trouva mme qu'ils
y
prenaient trop de place,
et cela veilla son esprit critique. Jamais il ne consen-
tit tre la dupe d'un La Harpe, d'un Thomas, d'un
Le Brun, d'un Gart. Il poussa mme cette dfiance
un peu loin, et on peut lui reprocher d'avoir mconnu
Beaumarchais et madame de Stal : mais ses rser-
ves n'taient pas toutes d'ordre httraire.
Le premier crit de Bivarol est une Lettre critique
sur le pome des Jardins^ qui venait de paratre;
Grimm
y
trouva beaucoup de mchancet et beau-
coup de vrit. En somme, sous une forme un peu
gauche, c'tait, formule sur l'heure, l'opinion de la
postrit : l'abb Delille
y
reoit le premier des coups
sous lesquels devait, la longue, il est vrai, succom-
ber sa gloire factice.
Rivarol allait donner la sienne une base assez
durable avec son Discours sur T Universalit de la lan-
gue
franaise, morceau crit pour l'Acadmie de Ber-
lin, qui le couronna. Ce discours, dont les parties his-
torique
et philologique ont ncessairement beaucoup
vieilli,
apparat encore tel qu'une uvre matresse et
niVAROL
qu'on ne lit pas sans un ^rand plaisir littraire. Par
bonheur, celui qui faisait un si juste loge de la lanj^ue
franaise crivait lui-mme dans un style d'une belle
originalit; nous en sommes plus satisfaits qu'on ne
le fut de son temps: le got, en
1785,
tait bien gt.
Dans le mme temps, il collaborait au Mercure de
France, lanrait de temps en temps quelque brochure
amusante, quelques-unes de ces parodies o il excel-
lait : Le Chou et le Navet (encore contre l'abb)
;
le
Sonrje d'Athalie^ pour ridiculiser M'" de Genlis, Gri-
mod de la Reynire, La Harpe, Gart, et bien d'au-
tres
;
le Rcit duportier du sieur Caron de Beaumar-
chais, plaisanterie difficile comprendre aujourd'hui.
Tout cela lui avait dj fait bien des ennemis, comme
on peut le croire. Cependant, a ennuy de leur petit
nombre, dira plus tard une de ses victimes, Flins des
Oliviers, il attaqua tout le peuple littraire la fois.
Ce fut dans le Petit Almanch de nos grands hommes
pour l'anne i
j88.
Tout le monde faisait des vers. Jamais on ne vit
d'poque plus potique. La France, inactive,
se
rpandait en odes et en bouquets, en stances,
en
nigmes et en chansons. Piivarol rsolut de faire le
dnombrement de tous ces grands hommes
,
qui
se prenaient vraiment au srieux et qui commenaient
duper le public. 11 ne faut pas s'y tromper, cet
Almanch, sous sa figure de plaisanterie, est une
uvre de bonne critique, de celles qui remettent
leur place
hommes
et
uvres, une de ces oprations
dont la cruaut
indispensable a presque toujours
d'heureuses
suites.
La
Rvolution,
qui vint l'anne suivante, montre
d'ailleurs
que, sous sa ddaigneuse ironie, Rivarol
cachait
un
esprit d'une logique et d'une pntration
rares. Il avait dj
faitses preuves d'excellent crivain
dans sa
traduction
de VEnfer de Dante, d'excellent
philosophe
dans ses Lettres M. Necker, propos de
son livre sur
VImportance des ides religieuses, il
allait, dans le Journal Politique National, cumuler
ces deux
talents, auquel un troisime s'ajoutait : le
talent de la critique politique. Au milieu de l'agita-
tion
universelle,
il garde son sang-froid; parmi les
utopistes et les
metaphysiciens.il garde sa raison pra-
tique.
Disciple de Montesquieu, il est le premier cri-
vain franais qui ait appliqu l'histoire contempo-
raine la mthode de VEsprit des Lois. Cesiun raliste;
c'est un physicien.
On dira qu'il s'est tromp et que la France
s'est
parfaitement tire de l'anarchie o il la croyait enga-
ge pour trs longtemps. Gela n'est pas certain; car
l'anarchie politique n'a t vaincue que par le plus
terrible et le plus positif des physiciens : Napolon.
Mais laissons l'apprciation des vnements poli-
tiques. Quelle que soit l'opinion que l'on professe,
on admirera dans Rivarol, avec la richesse du style, la
richesse de la pense. Mettons-nous en face de son
rcit des Journes d'octobre comme devant un rcil
de l'histoire romaine et nous ne pourrons nous dfen-
dre au moins d'une profonde motion esthtique.
Ces pages o des contemporains retrouvaient le
gnie de Tacite n'absorbaient pas Rivarol au point de
lui faire oublier qu'il avait de l'esprit. Il entremlait
ses graves Rsumes d'histoire, de petits articles des
plus piquants et des plus lgants
;
mais quand il
voulait tre tout fait son aise, il s'adressait aux
Actes des Aptres, Dans ce long et amusant pam-
phlet politique, cinq ou six morceaux appartiennent
videmment Rivarol, et ce sont les meilleurs de la
collection. Il n'a presque jamais rien sign, mais
jamais crivain n'eut moins besoin decette dclaration
de proprit. Aprs cent et quinze ans, dans ce fouil-
lis des Actes, on met la main sur le Rivarol avec une
parfaite certitude. La seule cause d'erreur, c'est qu'il
fut imit de toutes parts avec frnsie : Champcenetz,
s'il n'tait si jovial, pourrait parfois faire illusion. On
a cru voir la main de Champcenetz dans certains
articles du Petit Almanach
;
peut-tre la pourrait-on
voir aussi, ou celle de tels autres, dans tels passages
de Petit Dictionnaire des grands hommes de la Rvo-
lution : ce petit livre reste bien, comme le premier,
l'uvre de Rivarol, l'crit d'un homme dou la fois
de beaucoup de bon sens et de beaucoup d'esprit. Les
deux ouvrages, le littraire et le politique, semblent,
en bien des parties, rdigs de la semaine dernire :
an
y
trouverait, si on tait nicliant, toutes so
d'allusions la littrature d'aujourd'hui) la po
que d'aujourd'hui.
Avant de quitter la France, o sa position tait
venue critique, Rivarol essaya de donner Louis ]
quelques conseils aussi sages que modrs : on
retrouva dans l'armoire de fer. En juin
1792,
il ga
Bruxelles, puis Londres, puis Hambourg, en k^
puis Berlin, o il devait mourir, en 1801.
Son sjour Hambourg fut trs fcond. G*es
qu'il crivit ce Discoursprliminaire un dictionm
de la languefranaise, qui est un trait presque ct
plet de
philosophie. Encore n'est-ce qu'une prem
partie ! uvre un peu confuse, ce Discours prli
naire contient des chapitres admirables. Celui
Animaux, que l'on trouvera plus loin, est un cl
d'uvrede
raisonnement et de science. Rivarol ain
les sciences
;
il tait trs instruit, s'intressait t(
Malheureusement, toutes ses ides sortaient la f
l'une entranant l'autre. Il ne manque de rien, ni
des, ni de style, d'esprit encore moins, s'il est po
ble; il manque un peu de talent de coordination,
ne peut pas cependant dire de lui ce qu'il a dit
Lauraguais : Ses ides sont dans sa tte comme
carreaux de vitres en caisse : claires chacune par
obscures ensemble. Piivarol n'est jamais obscur
est parfois un peu trop blouissant.
De Voltaire Chateaubriand, et
paralllemen
son ennemie, M"'^ de Stal,
llivarol est le meilleur cri-
vain franais. On pourrait le dfinir un Chateaubriand
voltairien, si l'on ne song-eait qu'au Discoursprlimi-
naire, crt il dfend dans cet crit peu prs les mmes
ides philosophiques que Chateaubriand,et
parfois cel-
les de De Maislre; mais il est absolument
incrdule. Il
sait que toutes les religions sont vraies, c'est--dire
fausses; aussi veut-il qu'on les apprcie non d'aprs leur
vrit, mais d'aprs leur utilit. Ceux qui sont venus
aprs lui sont tombs dans leurpropre pige; et, force
de dire que la religion tait utile, ont fini parla croire
vraie; Piivarol est rest ferme jusqu' la fin: voyez le
Dialogue entre un roi et un fondateur de religion.
On espre que le prsent volume donnera une ide
assez exacte des diverses formes du talent de Rivarol.
En plusieurs parties : il peut passer pour indit : ja-
mais par exemple on n'avait rimprim ni ses articles
des Actes des Aptres, ni son Petit dictionnaire
;
les
Lettres, parses en quatre ou cinq ouvrages documen-
taires, sont runies pour la premire fois. La plu-
part des autres chapitres n'avaient pas revu le jour
depuis les uvres compltes (et qui ne le sont pas) de
1808. Il ne tient qu'au public d'ailleurs que les u-
vres rellement compltes de Rivarol puissent voir
le jour. S'il est de notre avis, s'il pense que Rivarol
est, en mme temps qu'un penseur original et un cri-
tique trs sr, l'un des plus agrables et des plus spi-
rituels et des plus curieux crivains franais, il saura
bien rclamer qu'on le lui donne tout entier.
Pour donner un commencement de satisfaction aux
curiosits que ces Plus belles pages ne satisferaient
pas encore entirement, on a fait imprimer part
quelques-uns des opuscules de Rivarol. La place a
manqu pour les donner complets et il tait impos-
sible de les mutiler, alors que d'autres crits suppor-
tent cette opration sans faiblir.
Relatant la manire dont le Petit Almanach a t
compos et imprim tout ensemble
,
Rivarol ajoute,
en raillant : La postrit apprendra tous ces dtails
avec le plus vif intrt. Le moment du vif int-
rt est enfin venu, ou plutt revenu, pour Rivarol,
et la postrit va le lire avec autant de plaisir que ses
contemporains.
LIVRE PREMIER
LITTRATURE
DE L'UNIVERSALIT
DE LA LANGUE FRANAISE
SUJET PROPOS PAR l'aCADMIE DE BERLIN, EN 1783,
Qu'est-ce qui a rendu la langue franaise uoiverselle ?
Pourquoi mrile-elle celte prrogative ?
Est-il prsumer qu'elle la conserve ?
ne telle question propose sur la lang-ue latine aurait
l'org'ueil des Romains, et leur histoire l'et consacre
me une de ses belles poques : jamais en effet pareil hom-
e ne fut rendu un peuple plus poli, par une nation plus
ire.
temps sembletre venu de dire le monde
franais^
me autrefois le monde romain ; et la philosophie, lasse
oir les hommes toujours diviss par les intrts divers
i politique, se rjouit maintenant de les voir, d'un bout
i terre l'autre, se former en rpublique sous la domi-
Dn d'une mme lang-ue. Spectacle dig-ne d'elle, que cet
orme et paisible empire des lettres qui s'tend sur la
H des peuples, et qui, plus durable et plus fort que
pire des armes, s'accrot galement des fruits del paix
js ravag-es de la guerre !
[ais cette honorable universalit de la langue franaise,
en reconnue et si hautement avoue dans notre Europe,
niVAROL
offre pourtant un grand problme : elle tient des causes
si dlicates et si puissantes la fois, que, pour les dmler, il
s'ag-it de montrerjusqu' quel point la position del France,
sa constitution politique, Tinfluence de son climat, le ^nie
de ses crivains^ le caractre de ses habitants, et l'opmion
qu'elle a su donner d'elle au reste du monde, jusqu' quel
point, dis-je, tant de causes diverses ont pu se combiner et
s'unir, pour faire cette lanprue une fortune si prodi;;-ieuse.
Quand les Romains conquirent les Gaules, leur sjour et
leurs lois
y
donnrent d'abord la prminence la lang-ue
latine
;
et quand les Francs leur succdrent, la religion
chrtienne, qui jetait ses fondements dans ceux de la monar-
chie, confirma cette prminence. On parla latin la cour,
dans les clotres, dans les tribunaux et dans les coles; mais
les jargons que parlait le peuple corrompirent un peu cette
latinit, et en furent corrompus leur tour. De ce mlange
naquit cette multitude de patois qui vivent encore dans nos
provinces. L'un d'eux devait un jour tre le langue fran-
aise.
Il serait difficile d'assigner le moment o ces diffrents
dialectes se do;-agrent du celte, du latin et de l'allemand
;
on voit seulement qu'ils ont d se disputer la souverainet
dans un royaume que le systme fodal avait divis en tant
de petits royaumes. Pour hter notre marche, il suffira de
dire que la France, naturellement partage par la Loire,
eut deux patois, auxquels on peut rapporter tous les autres,
le Picard et le Provenal. Des princes s'exercrent dans
l'un et l'autre, et c'est aussi dans l'un et l'autre que furent
d'abord crits les romans de chevalerie et les petits pomes
du temps. Du ct du midi florissaient les Troubadours^
et du ct du nord les Trouveurs. Ces deux mots, qui au
fond n'en sont qu'un, expriment assez bien la physionomie
des deux langues.
Si le provenal, qui n'a que des sons pleins, et prvalu,
il aurait donn au franais l'clat de l'espagnol et de l'ita-
lien
;
mais le midi de la France, toujours sans capitale et
sans roi, ne put soutenir la concurrence du nord, et l'in-
fluence du patois picard s'accrut avec celle de la couronne.
C'est donc le gnie clair et mthodique de ce jargon et sa
prononciation un peu sourde, qui dominent aujourd'hui
dans la langue franaise.
LITTEIVATL'KE
Mais, quoique celte nouvelle lan^^ue et t adopte par
la cour et par la nation, et que, ds l'an 1260, un auteur
italien (i)lui et trouv assez de charmes pour la prfrer
la sienne, cependant T^-lise, l'universit et les parlements la
repoussrent encore, et ce ne fut que dans le seizime sicle
qu'on lui accorda solennellement les honneurs ds une
lan"ue Icg-itime.
cette poque, la renaissance des lettres, la dcouverte
de l'Amrique et du passage aux Indes, l'invention de la
poudre et de l'imprimerie, ont donn une autre face aux
empires. Ceux qui brillaient se sont tout coup obscurcis;
et d'autres, sortant de leur obscurit^ sont venus fig-urer
leur tour sur la scne du monde. Si du nord au midi un
nouveau schisme a dchir l'orlise, un commerce immense
a jet de nouveaux liens parmi les hommes. C'est avec les
sujets de l'Afrique que nous cultivons l'Amrique, et c'est
avec les richesses de l'Amrique que nous trafiquons en Asie.
L'univers n'offrit jamais un tel spectacle. L'Europe surtout
est parvenue un si haut deg-r de puissance que l'his-
toire n'a rien lui comparer
;
le nombre des capitales, la
frquence et la clrit des expditions, les communica-
tions publiques et particulires en ont fait une immense
rpublique, et l'ont force se dcider sur le choix d'une
lang-ue.
Ce choix ne pouvait donc tomber sur l'allemand; car,
vers la fin du quinzime sicle et dans tout le cours du
seizime, cette lang-ue n'offrait pas un seul monument.
Nglige par le peuple qui la parlait, elle cdait toujours
le pas la langue latine. Comment donc faire adopter aux
autres ce qu'on n'ose adopter soi-mme? C'est des Allemands
que l'Europe apprit n2:li2rer la langue allemande. Obser-
vons aussi que l'Empire n'a pas jou le rle auquel son
tendue et sa population l'appelaient naturellement; ce vaste
corps n'eut jamais un chef qui lui ft proportionn, et dans
tous les temps cette ombre du trne des Csars, qu'on
ajffectait de montrer aux nations, ne fut, en effet, qu'une
ombre. Or on ne saurait croire combien une lansrue em-
prunte d'clat du prince et du peuple qui la parlent. Et
lorsque enfin la maison d'Autriche, fire de toutes ses cou-
ronnes, a pu faire craindre l'Europe une monarchie uni-
verselle, la politique s'est encore oppose la fortune de la
RIVAIVOL
lansrue
tiidesque. Charles-Ouint, plus attach son sceptre
hrditaire qu' un trne o son fils ne pouvait monter,
fit rejaillir l'clat des Csars sur la nation espaarnole.
A tant d'obstacles tirs de la situation de l'Empire, on
)eut en ajouter d'autres fonds sur la nature mme de la
anriie alleiriande; elle est trop riche et trop dure la fois.
N'avant aucun rapport avec les lang-ues anciennes, elle fut
pour l'Europe une lan crue-mre, et son abondance effraya
des ttes dj fati^-ues de l'lude du latin et du g-rec. En
effet, un Allemand qui apprend la langue franaise ne fait,
f)our
ainsi dire, qu'y descendre, conduit par la langue
atine : mais rien ne peut nous faire remonter du franais
l'allemand : il aurait fallu se crer pour lui une nouvelle
mmoire, et sa littrature, il
y
a un sicle, ne valait pas un
tel effort. D'ailleurs, sa prononciation g-utturale choqua
trop l'oreille des peuples du midi; et les imprimeurs alle-
mands, fidles l'criture gothique, rebutrent des yeux
accoutums aux caractres romains.
On peut donc tablir pourri^^le gnraleque, si l'homme
du nord est appel l'tude des langues mridionales, il
faut de long-ues guerres dansl'em.pire pour faire surmonter
aux peuples du midi leur rpugnance pour les lan^-ues sep-
tentrionales. Le genre humain est comme un fleuve qui
coule du nord au midi; rien ne peut le faire rebrousser
contre sa source
;
et voil pourquoi l'universalit de la
langue franaise est moins vraie pour l'Espagne et pour
l'Italie, que pour le reste de l'Europe. Ajoutez que l'Alle-
magne a presque autant de dialectes que de capitales, ce
qui fait que ses crivains s'accusent rciproquement de
patavinit. On dit, il est vrai, que les plus distingus d'entre
eux ont fini par s'accorder sur un choix de mots et de tour-
nures, qui met dj leur lansrue l'abri decette accusation,
mais qui le met aussi hors de la porte du peuple dans toute
la Germanie.
Il reste savoir jusqu' quel point la rvolution qui
s'opre aujourd'hui dans la littrature des Germains influera
sur la rputation de leur lancrue. On peut seulement pr-
sumer que cette rvolution s'est faite un peu tard, et que
leurs crivains ont repris les choses de trop haut. Des po-
mes tirs de la Bible o tout respire un air patriarcal, et
qui annoncent des murs admirables, n'auront de charmes
LITTERATURE
que pour une nation simple et sdentaire, presque sans
ports et sans commerce, etqui ne sera peut-tre jamais runie
sous un mme chef. L'AUcmaq-ne otl'rira loni^-temps le spec-
tacle d'un peupleantique et modeste, gfouvern par une foule
de princes amoureux des modes et du lang-a^-e d'une nation
attrayante et polie. D'o il suit que l'accueil extraordinaire
que ces princes et leurs acadmies ont fait un idiome
trang-er, est un obstacle de plus qu'ils opposent leur
lang-ue, et comme une exclusion qu'ils lui donnent.
La monarchie espasi-nole pouvait, ce semble, fixer le choix
de l'Europe. Toute brillante de l'or de l'Amrique, puissante
dans l'empire, matresse des Pays-Bas et d'une partie de
l'Italie, les malheurs de Franois I*"" lui donnaient un nou-
veau lustre, et ses esprancces s'accroissaient encore des
troubles de la France et du mariag-e de Philippe II avec la
reine d'Ano-leterre, Tant de g-randeur ne fut qu'un clair.
Charles -Quint ne put laisser son fils la couronne imp-
riale, et ce Hls perdit la moiti des Pays-Bas. Bientt l'ex-
pulsion des Maures et les mig-rations en Amrique bles-
srent l'Etat dans son principe, et ces deux g-randes plaies
ne tardrent pas paratre. Aussi, quand ce colosse fut
frapp par Richelieu, ne put-il rsister la France, qui s'tait
comme rajeuniedans les g-uerres civiles
;
ses armes plirent
de tous cts, sa rputation s'clipsa. Peut-tre, malg-r ses
f)ertes,
sa dcadence et t moins prompte en Europe, si sa
ittrature avait pu alimenter l'avide curiosit des esprits
qui se rveillait de toutes parts
;
mais le castillan, substitu
partout au patois catalan, comme notre picard l'avait t au
provenal, le castillan, dis-je, n'avait point cette galanterie
moresque dont l'Europe fut quelque temps charme, et le
g"nie national tail devenu plus sombre. Il est vrai que la
folie des chevaliers errants nous valut le Don Oiiichotle, et
que TEspag-ne acquit un thtre
;
il est vrai qu'on parlait
espag-nol dans les cours de Vienne, de Bavire, de Bruxelles,
de Naples et de Milan
;
que cette lang-ue circulait en France,
avec l'or de Philippe, du temps de la ligue, et que le ma-
riage de Louis XIII avec une princesse espagnole maintint
si bien sa faveur que les courtisans la parlaient, et que les
gens de lettres empruntrent la plupart de leurs pices au
thtre de Madrid
;
mais le gnie de* Cervantes et celui de
Lope de Vega ne suffirent pas long-temps nos besoins.
MIVAROL
Le premier, d'abord traduit, ne perdit pointa l'tre; le se-
cond, moins parfait, fut bientt imit et surpass. On s'ap-
perut donc que la mag-niticence de la lang"ue espag-nole et
'org-ueil national cachaient une pauvret relle. L'Espane,
n'avant que le sig-ne de la richesse, paya ceux qui commer-
aient pour elle, sans songer qu'il faut toujours les payer
davantag-e. Grave, peu communicative, subjugue par des
prtres, elle fut pour l'Europe ce qu'tait autrefois la mys-
trieuse Egypte, ddaignant des voisins qu'elle enrichissait,
et s'enveloppant du manteau de cet orgueil politique qui a
fait tous ses maux.
On peut dire que sa position fut un autre obstacle au
progrs de sa langue. Le voyageur qui la visite
y
trouve
encore les colonnes d'Hercule, et doit toujours revenir sur
ses pas
;
aussi l'Espagne est elle, de tous les royaumes,
celui qui doit le plus difficilement rparer ses pertes lors-
qu'il est une fois dpeupl.
Mais, en supposant que l'Espagne et conserv sa prpon-
drance politique, il n'est pas dmontr que sa langue ft
devenue la langue usuelle de l'Europe. La majest de sa
prononciation invite l'enflure, et la simplicit de la pense
se perd dans la longueur des mots et sous la plnitude
des dsinences. On est tent de croire qu'en espagnol
la conversation n'a plus de familiarit
,
l'amiti plus
d'panchement, le commerce de la vie plus de libert, et
quel'amoury est toujours un culte. Charles-Quintlui-mme,
qui parlait plusieurs langues, rservait l'espagnol pour des
jours de solennit et pour ses prires. En effet, les livres
asctiques
y
sont admirables, et il semble que le commerce
de 1 hom.me Dieu se fasse mieux en espagnol qu'en tout
autre idiome. Les proverbes
y
ont aussi de la rputation,
parce qu'tant le fruit de l'exprience de tous les peuples,
et le bon sens de tous les sicles rduit en formules, l'es-
pagnol leur prte encore une tournure plus sententieuse
;
mais les proverbes ne quittent pas les lvres du petit peuple.
11 paratdonc probable que ce sont et lesdfautset les avan-
tages de la langue espagnole, qui l'ont exclue la fois de
l'universalit.
Mais comment l'Italie ne donna-t-elle pas sa langue
l'Europe? Centre du monde depuis tant de sicles, on tait
accoutum son empire et ses lois. Aux Csars qu'elle
LITTErWTUrVE
n'avait plus avaient succd les ponlifes, et la relig-ion lui
rendait constamment les tats que lui arrachait le sort des
armes. Les seules routes praticables en Europe condui-
saient Rome; elle seule attirait les vux et l'argent
de tous les peuples, parce qu'au milieu des ombres pais-
ses qui couvraient l'Occident, il
y
eut toujours, dans
cette capitale, une masse de lumiies; et quand les beaux-
arts, exils de Constantinople, se rfug-irent dans nos cli-
mats, l'Italie se rveilla la premire leur approche, et fut
une seconde fois la Grande-Grce. Comment s'est-il donc
fait qu' tous ces titres elle n'ait pas ajout l'empire du lan-
gage ?
C'est que dans tous les temps les papes ne parlrent et
n'crivirent qu'en latin
;
c'est que. pendant vingt sicles,
cette langue rgna dans les rpubliques, dans les cours,
dans les crits et dans les monuments de l'Italie, et
que le toscan fut toujours appel la langue vulgaire.
Aussi, quand le Dante entreprit d'illustrer ses malheurs et
ses vengeances, hsita-t-il lonar-temps entre le toscan et le
latin II voyait que sa langue n'avait pas, mme dans le
midi de rurope, l'clat et la vogue du provenal; et il
pensait, avec son sicle, que l'immortalit tait exclusive-
ment attache la langue latine. Ptrarque et Boccace eu-
rent les mmes craintes; et, comme le Dante, ils ne purent
rsister la tentation d'crire la plupart de leurs ouvrages
en latin. Il est arriv pourtant le contraire de ce qu'ils esp-
raient; c'est dans leur langue maternelle que leur nom vit
encore
;
leurs uvres latines sont dans l'oubli. Il est mme
prsumer que, sans les sublimes conceptions de ces trois
f>Tands hommes, le patois des Troubadours aurait disput
le pas la langue italienne, au milieu mme de la cour
pontificale tablie en Provence.
Quoi qu'il en soit, les pomes du Dante et de Ptarque,
brillants de beauts antiques et modernes, ayant fix l'ad-
miration de l'Europe, la langue toscane acquit de l'empire.
A cette poque, le commerce de l'ancien monde passait tout
entier par les mains de l'Italie : Pise, Florence, et surtout
Venise et Gnes, taient les seules villes opulentes de l'Eu-
rope. C'est d'elles qu'il fallut, au temps des croisades, em-
prunter des vaisseaux pour passer en Asie, et c'est d'elles
que les barons franais, anglais et allemands, tiraient le
peu de luxe qu'ils avaient. La langue toscane rgna sur
toute la Mditerrane. Enfin, le beau sicle des Mdicis
arriva. Machiavel dbrouilla le chaos de la politique, et
Galile sema les germes de cette philosophie, qui n'a port
des fruits que pour la France et le nord de l'Europe. La
sculpture et la peinture prodiguaient leurs miracles, et l'ar-
chitecture marchait d'un pas q:al.Rome se dcora de chefs-
d'uvre sans nombre, et l'Arioste et le Tasse portrent
bientt la plus douce des langues sa plus haute perfection
dans des pomes qui seront toujours les premiers monu-
ments de l'Italie et le charme de tous les hommes. Qui pou-
vait donc arrter la domination d'une telle langue?
D'abord,une cause tire de l'ordre mme des vnements:
cette maturit trop prcoce. L'Espagne, toute politique et
guerrire, parut ignorer l'existence du Tasse et de l'Arioste:
l'Angleterre, thcologique et barbare, n'avait pas un livre, et
la France se
dbattait dans les horreurs de la Ligue. On
dirait que l'Europe n "tait pas prte, et qu'elle n'avait pas
encore senti le besoin d'une langue universelle.
Une foule d'autres causes se prsente. Quand la Grce
tait un monde, dit fort bien Montesquieu, ses plus petites
villes taient des nations : mais ceci ne put jamais s'appli-
quer l'Italie dans le mme sens. La Grce donna des lois
aux barbares qui l'environnaient : et l'Italie, qui ne sut pas,
son exemple, se former en rpublique fdrative, fut tour
tour envahie par les Allemands, par les Espagnols et par
les Franais. Son heureuse position et sa marine auraient
pu la soutenir et l'enrichir
;
mais, ds qu'on eut doubl le
cap de Bonne-Esprance, TOcan reprit ses droits, et le
commerce des Indes ayant pass tout entier aux Portugais,
l'Italie ne se trouva plus que dans un coin de l'univers. Pri-
ve de l'clat des armes et des ressources du commerce, il
lui restait sa langue et ses chefs-d'uvre : mais, par une
fatalit singulire, le bon got se perdit en Italie, au mo-
ment o il se rveillait en France. Le sicle des Corneille,
des Pascal et des Molire fut celui d'un cavalier Marin,
d'un Achillini et d'une foule d'auteurs plus mprisables
encore : de sorte que, si l'Italie avait conduit la France, il
fallut ensuite que la France rament l'Italie.
Cependant l'clat du nom franais augmentait
;
l'Angle-
terre se mettait sur les rangs, et ITtalie se dgradait dplus
LITTERATURE
9
en plus. On sentit g-nralement qu'un pays, qui ne four-
nissait plus que des baladins l'Europe, ne donnerait ja-
mais assez de considration sa lang-uc. On observa que
l'Italie, n'ayant pu, comme la Grce, ennoblir ses dillrents
dialectes, elle s'en tait trop occupe. A cet gard, la France
parat plus heureuse : les patois
y
sont abandonns aux
provinces, et c'est sur eux que le petit peuple exerce ses
caprices, tandis que la lang-ue nationale est hors de ses
atteintes.
EnKn, le caractre mme de la lang-uc italienne fut ce qui
l'carta le plus de cette universalit
qu'obtient chaque jour
la lang-ue franaise. On sait quelle distance spare en Italie
la posie de la prose : mais ce qui doit tonner, c'est que le
vers
y
ait rellement plus d'pret, ou, pour mieux dire,
moins de mig-nardise que la prose.
Les lois de la mesure et
de l'harmonie ont forc le pote tronquer les mots, et par
ces syncopes frquentes, il s'est fait une lang-ue part, qui,
outre la hardiesse des inversions,
a une marche plus rapide
et plus ferme. Mais la prose, compose
de mots dont toutes
les lettres se prononcent, et roulant
toujours sur des sons
pleins, se trane avec trop de lenteur
;
son clat est mono-
tone
;
l'oreille se lasse de sa douceur, et la lang-ue de sa
mollesse : ce qui peut venir de ce que chaque mot tant har-
monieux en particulier, l'harmonie
du tout ne vaut rien.
La pense la plus vig-oureuse se dtrempe dans la prose ita-
lienne. Elle est souvent ridicule et presque insupportable
dans une bouche virile, parce qu'elle te l'homme cette
teinte d'austrit qui doit en tre insparable. Comme la
lang-ue allemande, elle a des formes crmonieuses, enne-
mies de la conversation,
et qui ne donnent pas assez bonne
opinion de l'espce humaine. On
y
est toujours dans la f-
cheuse alternative d'ennuyer ou d'insulter un homme. Enfin,
il parat difficile d'tre naf ou vrai dans cette lang-ue, et la
plus simple assertion
y
est toujours renforce du serment.
Tels sont les inconvnients de ia prose italienne, d'ailleurs
si riche et si flexible. Or, c'est la prose qui donne l'empire
une lang-ue, parce qu'elle est tout usuelle : la posie n'est
qu'un objet de luxe.
Malg-r tout cela, on sent bien que la patrie de Raphal,
de Michel-Ange et du Tasse ne sera jamais sans honneurs.
C'est dans ce climat fortun que la plus mlodieuse des lan-
e^ues s'est unie la musique des ang-es, et cette alliance
leur assure un empire ternel. C'est l que les chefs-d'uvre
antiques et modernes, et la beaut du ciel attirent le voya-
geur, et que l'affinit des lano-ues toscane et latine le fait
passer avec transport de l'Enide la Jrusalem. L'Italie,
environne de puissances qui l'humilient, a toujours droit
de les charmer
;
et sans doute que, si les littratures an-
g-laise et franaise n'avaient clips la sienne, l'Europe au-
rait encore accord plus d'hommag-es une contre deux
fois mre des aits.
Dans ce rapide tableau des nations, on voit le caractre
des peuples et le gnie de leur langue marcher d'un pas
gal, et l'un est toujours garant de l'autre. Admirable pro-
prit de la parole, de montrer ainsi l'homme tout entier !
Des philosophes ont demand si la pense peut exister
sans parole ou sans quelqu'autre signe : non sans doute.
L'homme, tant une machine trs harmonieuse, n'a pu tre
jet dans le monde, sans s'y tablir une foule de rapports.
La seule prsence des objets lui a donn des sensations. qui
sont nos ides les plus simples, et qui ont bientt amen
les raisonnements. Il a d'abord senti le plaisir et la dou-
leur, et il les a nomms
;
ensuite il a connu et nomm l'er-
reur et la vrit. Or, sensation et raisonnement, voil de
quoi tout l'homme se compose : l'enfant doit sentir avant
de parler, mais il faut qu'il parle avant de penser. Chose
tranre Si l'homme n'et pas cr des signes, ses ides
simples et fugitives, germant et mourant tour tour,n'au-
raient pas laiss plus de traces dans son cerveau que les
flots d'un ruisseau qui passe n'en laissent dans ses yeux.
Mais l'ide simple a d'abord ncessit le signe, et bientt le
sig-ne a fcond l'ide
;
chaque mot a fix la sienne, et
telle est leur association, que si la parole e.->tune pense qui
se manifeste, il faut que la pense soit une parole intrieure
et cache (2). L'homme qui parle est donc l'homme qui pense
tout haut
;
et si on peut juger un homme par ses paroles,
on peut aussi juger une nation par son langage. La forme
et le fond des ouvrages dont chaque peuple se vante n'y
font rien : c'est d'aprs le caractre et le gnie de leur lan-
gue qu'il faut prononcer : car presque tous les crivains sui-
vent des rgles et des modles, mais une nation entire
parle d'aprs son gnie.
.ITTEHAIUHE
On demande souvent ce que c'est que le g-nie d'une lan-
g-ue, et il est difHcile de le dire. Ce mot tient des ides
trs composes
;
il a l'inconvnient des ides abstraites et
g-nrales
;
on craint, en le dfinissant, de le g-nraliser
encore. Mais afin de mieux rapprocher cette expression de
toutes les ides qu'elle embrasse, on peut dire que la dou-
ceur ou l'pret des articulations, l'abondance ou la raret
des voyelles, la prosodie et l'tendue des mots, leurs filia-
tions, et enfin le nombre et la forme des tournures et des
constructions qu'ils prennent entr'eux sont les causes les
plus videntes au g-nie d'une langue; et ces causes se lient
au climat et au caractre de chaque peuple en particulier.
Il semble, au premier coup-d'il, que, les proportions de
l'org-anc vocal tant invariables, elles auraient d produire
partout les mmes articulations et les mmes mots, et qu'on
ne devrait entendre qu'un seul langag-e dans Tunivers. Mais
si les autres proportions du corps humain, non moins inva-
riables, n'ont pas laiss de changer de nation nation, et
si les pieils, les pouces et les coudes d'un peuple ne sont
pas ceux d'un autre, il fallait aussi que l'organe brillant et
compliqu de la parole prouvt de grands changements
de peuple en peuple, et souvent de sicle en sicle. La na-
ture, qui n'a qu'un modle pour tous les hommes, n'a pour-
tant pas confondu tousles visages sous une mmephysiono-
mle. Ainsi, quoiqu'on trouve les mmes articulations radi-
cales chez des peuples diffrents, les langues n'en ont pas
moins vari comme la scne du monde; chantantes et volup-
tueuses dans les beaux climats, pres et sourdes sous un
ciel triste, elles ont constamment suivi la rptition et la
frquence des mmes sensations.
Aprs avoir expliqu la diversit des langues par la nature
mme des choses, et fond l'union du caractre d'un peu-
ple et du gnie de sa langue sur l'ternelle alliance de la
parole et de la pense, il est temps d'arriver aux deux peu-
ples qui nous attendent, et qui doivent fermer cette lice des
nations : peuples chez qui tout diffre, climat, langage,
gouvernement, vices et vertus
;
peuples voisins et rivaux,
qui, aprs avoir disput trois cents ans, non qui aurait
l'empire, mais qui existerait, se disputent encore la gloire
des lettres, et se partagent depuis un sicle les regards de
l'univers.
L'Aneleterrc, sous un ciel nbuleux, et spare du reste
dumoncle, ne parut qu'un exil aux Romains, tandis quela
Gaule,
ouverte tous les peuples, et jouissant da ciel de la
Grce, faisait les dlices des Csars : premire diilerence
tablie par la nature, et d'o driveune foule d'autres diff-
rences. Ne
cherchons pas ce qu'tait la nation anglaise,
lorsques rpandue dans les belles provinces, de France, ado-
ptant notre lang-ue et nos murs, elle n'offrait pas une
physionomie distincte; ni dans les temps o, consterne par
le
despotisme de Guillaume le Conqurant ou des Tudor,
elle donnait ses voisins des modles d'esclavag^e
;
mais
considrons-la dans son le, rendue son propre gnie,
parlant sa propre langue, florissante de ses lois, s'asseyant
enfin son vritable rang en Europe.
Par sa position et par la supriorit de sa marine, elle
peut nuire toutes les nations et les braver sans cesse.
Comme elle doit toute sa splendeur l'Ocan qui l'envi-
ronne, il faut qu'elle l'habite, qu'elle le cultive, qu'elle se
l'approprie
;
il faut que cet esprit d'inquitude et d'impa-
tience, auquel elle doit sa libert, se consume au dedans s'il
n'clate au dehors. Mais, quand l'agitation est intrieure,
elle peut tre fatale au prince, qui, pour lui donner un
autre cours, se hte d'ouvrir ses ports
;
et les pavillons de
l'Espagne, de la France ou de la Hollande sont bientt insul-
ts. Son commerce, qui s'est ramifi dans les quatre parties
du monde, fait aussi qu'elle peut tre blesse de mille ma-
nires diffrentes, et les sujets de guerre ne lui manquent
jamais : de sorte qu' toute l'estime qu'on ne peut refuser
une nation puissante et claire, les autres peuples joignent
toujours un peu de haine, mle de crainte et d'envie.
Mais la France, qui a dans son sein une subsistance
assure et des richesses immortelles, agit contre ses intrts
et mconnat son gnie, quand elle se livre l'esprit de
conqute. Son influence est si grande dans la paix et dans
la guerre que, toujours matresse de donner l'une ou l'au-
tre, il doit lui sembler doux de tenir dans ses mains la
balance des empires, et d'associer le repos de l'Europe au
sien. Par sa situation, elle tient tous les tats : par sa juste
tendue, elle touche ses vritables limites. Il faut donc
ue la France conserve et qu'elle soit conserve : ce qui la
istingue
de tous les peuples anciens et modernes. Le com-
LlTTnATUIXE
l3
merce des deux mers enrichit ses villes marilimes et vivifie
son intrieur; et c'est de ses productions qu'elle alimente
son commerce, si Lien que tout le monde a besoin de la
France, quand l'An^lolorre a besoin de toutlemonde. Aussi,
dans les cabinets de l'Euroj-e, c'est plutt l'Ang-leterre qui
inquite, c'est plutt la France qui domine. Sa capitale,
enfonce dans les terres, n'a point eu, comme les villes ma-
ritimes, l'afiluence des peuples; mais elle a mieux senti et
mieux rendu l'influence de son propre ^n!e,le g"0iit de son
terroir, l'esprit de son gouvernement. Elle a attir par ses
charmes, plus que par ses richesses; elle n'a pas eu le m-
lange, mais le choix des nations; les gens d'esprit
y
ont
abond>et son empire a t celui du got. Les opinions exa-
gres du nord et du midi viennent
y
prendre une teinte qui
plat tous. Il faut donc que la Francecraigne de dtourner,
par la guerre, l'heureux penchant de tous les peuples pour
elle: quand on rgne par l'opinion, a-t-on besoin d'un autre
empire?
Je suppose ici que, si le principe du gouvernement s'af-
faiblit cncz l'une des deux nations, il^'allaiblit aussi dans
l'autre, ce qui fera subsister longtemps le parallle et leur
rivalit : car, si l'Angleterre avait tout son ressort, elle
serait trop remuante
;
et la France serait trop craindre,
si elle dployait toute sa force. Il
y
a pourtant cette obser-
vation faire, que le monde politique peut chan^^er d'atti-
tude, et la France n'y perdrait pas beaucoup. Il n'en est
pas ainsi de l'Angleterre, et je ne puis prvoir jusqu' quel
point elle tombera, pour avoir plutt song tendre sa
domination que son commerce.
La diflerence de peuple peuple n'est pas moins forte
d'homme homme. L'Anglais, sec et taciturne, joint,
l'embarras et la timidit de l'homme du nord, une impa-
tience, un dgot de toute chose, qui va souvent jusqu'
celui de la vie
;
le Franais a une saillie de gat qui ne
l'abandonne pas
;
et quelque rgime que leurs gouverne-
ments les aient mis l'un et l'autre, ils n'ont jamais perdu
cette premire empreinte. Le Franais cherche le ct plai-
sant de ce monde, l'Anglais semble toujours assister un
drame
;
de sorte que ce qu'on a dit du Spartiate et de l'A-
thnien se prend ici la lettre
;
on ne gagne pas plus
ennuyer un Franais qu' divertir un Anglais. Celui-ci
l4
I\IVA!VOL
vovasre pour voir, le Franais pour tre vu. On n'allait pas
beaucoup Lacdmone, si ce n'est pour tudier son g"ou-
vernement
;
mais le Franais, visit par toutes les nations,
peut se croire dispens de voyacrer chez elles, comme d'ap-
prendre leurs lansTues, puisqu'il retrouve partout la sienne.
En Angleterre, les hommes vivent beaucoup entre eux
;
aussi les femmes, qui n'ont pas quitt le tribunal domesti-
que, ne peuvent entrer dans le tableau de la nation : mais
on ne peindrait les Franais que de profil, si on faisait le
tableau sans elles
;
c'est de leurs vices et des ntres, de la
politesse des hommes et de la coquetterie des femmes,qu'est
ne cette galanterie des deux sexes qui les corrompt tour
tour, et qui donne la corruption mme des formes si bril-
lantes et si aimables. Sans avoir la subtilit qu'on reproche
aux peuples du midi, et l'excessive simplicit du nord, la
France a la politesse et la grce : et non seulement elle a la
grce et la politesse, maisc'est elle qui en fournitles mod-
les dans les murs, dans les manires et dans les parures.
Sa mobilit ne donne pas TEurope le temps de se lasser
d'elle. C'est pour toujours plaire que le Franais change
toujours
;
c'est pour ne pas trop se dplaire lui-mme que
l'Anglais est contraint de changer. On nous reproche l'im-
prudence etla fatuit; mais nous en avons tir plus dparti,
que nos ennemis de leur ile""me et de leur fiert : la politesse
ramne ceux qu'a choqus la vanit; il n'est point a'accom-
dement avec l'orgueil. On peut d ailleurs en appeler au
Franais de quarante ans, et l'Anglais ne eragne rien aux
dlais. Il est bien des moments o le Franais pourrait payer
de sa personne
;
mais il faudra toujours que l'Anglais paye
de son ar^rent ou du crdit de sa nation. Enfin, s'il est pos-
sible que le Franais n'ait acquis tant de grces et de got
qu'aux dpens de ses uiu:ur.5, il cit encore trs possible que
l'Anglais ait perdu les siennes, sans acqurir ni le got ni
les grces.
Quand ou compare un peuple du midi un peuple du
nord, on n'a que des
"
extrmes rapprocher; mais la
France, sous un ciel tempr, changeante dans ses mani-
res et ne pouvant se fixer elle-mme, parvient pourtant
fixer tous les gots. Les peuples du nord viennent
y
cher-
cher et trouver l'homme du midi, et les peuples du midi
y
cherchent et v trouvent l'homme du nord. Plus mi cavalier
LIIIKIIATIR!!: i5
Francs, c'est le chevalier Franais quime plat, disait, il
y
a
huit cents ans, ce Frdric I^rquiavait vu toutel'Europe et
qui tait notre ennemi. Que devient maintenant lere})roche,
si souvent fait au P'ranais, qu'il n'a pas le caractre de
l'Anglais ? Ne voudrait-on pas aussi qu'il parlt la mme
lang-ue? La nature, en lui donnant la douceur d'un climat,
ne pouvait lui donner la rudesse d'un autre : elle l'a fait
l'homme
de toutes les nations, et son gouvernement ne
s'oppose
point au vu de la nature.
J'avais
d'abord tabli que la parole et la pense, le gnie
des langues
et le caractre des peuples se suivaient d'un
mme
pas : je dois dire aussi que les langues se mlent
entre
elles, comme les peuples; qu'aprs avoir t obscures
comme
eux, elles s'lvent et
s'ennoblissent avec eux : une
langue
riche ne fut jamais celle d'un peuple ignorant et
pauvre.
Mais, si les langues sont comme les nations, il est
encore
trs vrai que les mots sont comme les hommes. Ceux
qui ont dans la socit une famille et des alliances
tendues
V ont aussi une plus grande consistance. C'est ainsi que les
mots, qui ont de nombreux drivs et qui tiennent beau-
coup d'autres, sont les premiers mots d'une langue et ne
vieilliront jamais; tandis que ceux qui sont isols, ou sans
harmonie, tombent comme des hommes sans recommanda-
tion et sans appui. Pour achever le
parallle, on peut dire
que les uns et les autres ne valent qu'autant
qu'ils sont
leur place. J'insiste sur cette analogie, afin de prouver com-
bien le got qu'on a dans l'Europe
pour les Franais est
insparable de celui qu'on a pour leur langue
;
et
combien
l'estime dont cette langue jouit est fonde sur celle que
l'on sent pour la nation.
Voyons maintenant si le gnie et les
crivains de la langue
anglaise auraient pu lui donner
cette
universalit
qu'elle
n'a point obtenue du caractre et de la
rputation du peuple
qui la parle. Opposons sa langue la ntre, sa
littrature
notre littrature, et justifions le choix de
l'univers.
S'il est vrai qu'il n'y eut jamais ni langage
ni peuple sans
mlange, il n'est pas moins
vident
qu'aprs une
conqute
il faut^lu temps pour
consolider le
nouvel
tat, et pour
bien
fondre ensemble les idiomes et les
familles des vain-
queurs et des vaincus. Mais on est tonn,
quand on voit
qu'il a fallu plus de
mille ans la langue
franaise
pour
l6
RIVAUf)!.
arriver sa maturit. On ne Test pas moins quand on songe
la prodig-ieuse quantit dcrivains qui ont fourmill dans
cette lang"ue depuis le cinquime sicle jusqu' la fin du
seizime, sans compter ceux qui crivaient en latin. Quel-
ques monuments, qui s'lvent encore dans cette mer d'ou-
bli, nous ollrent autant de franais diflrents. Les chang-e-
ments et les rvolutions del lang-ue taient si brusques que
le sicle o on vivait dispensait toujours de lire les ouvra-
g-es du sicle prcdent. Les auteurs se traduisaient miutuel-
lement de demi-sicle en demi-sicle, de patois en patois,
de vers en prose : et dans cette longue galerie d'crivains,
il ne s'en trouve pas un qui n'ait cru fermement que la lan-
g'ue tait arrive pour lui sa dernire perfection. Pasquier
affirmait de son temps qu'il ne s'y connaissait pas, ou que
Ronsard avait fix la langue franaise.
A travers ces variations, on voit cependant combien le
caractre de la nation influait sur elle : la construction de
la pbrase fut toujours directe et claire. La langue franaise
n'eut donc que deux sortes de barbaries combattre : celle
des mots et celle du mauvais got de cbaque sicle. Les
conqurants franais, en adoptant les expressions celtes et
latines, les avaient marques chacune son coin : on eut
une langue pauvre et dcousue, o tout fut arbitraire, et le
dsordre rgna dans la disette. Mais, quand la monarchie
acquit plus de force et d'unit, il fallut refondre ces mon-
naies parses et les runir sous une empreinte gnrale,
conforme d'un ct leur orie;-ine, et de l'autre au gnie
mme de la nation
;
ce qui leur donna une physionomie
double. On se fit une lang-ue crite et une langue parle, et
ce divorce de l'orthogiaphe et de la prononciation dure
encore (3). Enfin le bon got ne se dveloppa tout entier que
dans la pepfection mme de la socit : la maturit du lan-
gage et celle de la nation arrivrent ensemble.
En effet, quand l'autorit publique est an'ermie, que les
fortunes sont assures, les privilges confirms, les droits
claircis, les rangs assigns; quand la nation heureuse et
respecte jouit de la gloire au dehors, de la paix et du com-
merce au dedans
;
lorsque dans la capitale un peuple im-
mense se mle toujours sans jamais se confondre : alors on
commence distinguer autant de nuances dans le langage
que dans la socit; la dlicatesse des procds amne celle
LITTERATURE
n
des propos
;
les mtaphores sont plus justes, les comparai-
sons plus nobles, les plaisanteries plus fines, la parole
tant le vtement de la pense, on veut des formes plus l-
gantes. C'est ce qui arriva aux premires annes du rg-ne
de Louis XIV.Le poids del'autoril royale fit rentrer chacun
sa place
;
on connut mieux ses droits et ses plaisirs;
l'oreille, plus exerce, exigea une prononciation plus douce;
une foule d'objets nouveaux demandrent des expressions
nouvelles : la lan-ue franaise fournit tout, et l'ordre
s'tablit dans l'abondance.
Il faut donc qu'une lanj^ue s'ag-ite jusqu' ce qu'elle se
repose dans son propre g-nie, et ce principe explique un
fait assez extraordinaire. C'est qu'aux treizime et qua-
torzime sicles, la lang-ue franaise tait plus prs d'une
certaine perfection, qu'elle ne le fut au seizime. Ses l-
ments s'taient dj incorpors; ses mots taient fixes, et la
construction de ses phrases, directe et rg"ulire : il ne
manquait donc cette langue que d're parle dans un
sicle plus heureux, et ce temps approchait. Mais, contre
tout espoir, la renaissance des lettres la ft tout coup
rebrousser vers la barbarie. Une foule de potes s'levrent
dans son sein, tels que les Jodelle, les Bafs et les Ronsard.
Epris d'Homre et de Pindare, et n'ayant pas digr les
beauts de ces g-rands modles, ils s'imag-inrent que la
nation s'tait trompe jusque-l, et que la lang-ue franaise
aurait
bientt le charme du grec, si on
y
transportait les
mots composs, les diminutifs, les pjoratifs, et surtout la
hardiesse des inversions, choses prcisment opposes son
gnie. Le ciel fut porte flambeau^iu^niev^ lance-tonnerre;
on cwies agnelets, doucelets
on fit des vers sans rime,
des hexamtres, des pentamtres; les mtaphores basses ou
gig-antesques se cachrent sous un style entortill
;
enfin,
ces potes parlrent grec en franais, et de tout un sicle on
ne s'entendit point dans notre posie. C'est sur leurs subli-
mes chasses que le burlesque se trouva naturellement
mont, quand le bon got vint paratre.
A cette mme poque, les deux reines Mdicis donnaient
une grande vogue l'italien, et les courtisans tchaient de
l'introduire de toute part dans la lane;-ue franaise. Cette
irruption du grec et de l'italien la troul)la d'abord
;
mais,
comme une liqueur dj sature, elle ne put recevoir ces
l8 niVAROL
nouveaux clcments : ils ne tenaient pas
;
on les vit tomber
d'eux-mmes.
Les malheurs de la France, sous les derniers Valois,
retardrent la perfection du lans:ag"e; mais la fin du rcgi-ne
de Henri IV et celui de Louis XIII, ayant donn la nation
l'avant-g-ot de son triomphe, la posie franaise se mon-
tra d'abord sous les auspices de son propre g-cnie. La prose
plus sag-e ne s'en tait pas carte comme elle
;
tmoins
Amyot, Montaigne et Charron; aussi, pour la premire fois,
peut-tre, elle prcda la posie qui la devana toujours.
Il manque un trait cette faible esquisse de la langue
romance ou gauloise. On est persuad que nos pres taient
tous nafs; que c'tait un bienfait de leurs temps et de leurs
murs, et qu'il est encore attach leur langage : si bien
que certains auteurs emprunlent aujourd'hui leurs tournu-
res, afin d'tre nafs aussi. Ce sont des vieillards qui, ne
pouvant parler en hommes, bcgayentpour paratre enfants;
le naf qui se dgrade, tombe dans le niais. Voici donc
com.ment s'explique cette navet gauloise.
Tous les peuples ont le naturel : il ne peut
y
avoir un
sicle trs avanc qui connaisse et sente le naf. Celui que
nous trouvons et que nous sentons dans le style de nos
anctres l'est devenu pour nous; il n'tait pour eux que le
naturel. C'est ainsi qu'on trouve tout naf dans un enfant
qui ne s'en doute pas. Chez les peuples perfectionns et cor-
rompus, la pense a toujours un voile, et la modration
exile des murs se rfugie dans le lanerage; ce qui le rend
plus fin et plus piquant. Lorsque, par une heureuse absence
de finesse et de prcaution, la phrase montrela pense toute
nue, le naf parait. De mme chez les peuples vtus, une
nudit produit la pudeur
;
mais les nations qui vont nues
sont chastes sans tre pudiques, comme les Gaulois taient
naturels sans tre nafs. On pourrait ajouter que ce qui
nous fait sourire dans une expression antique n'eut rien de
plaisant dans son sicle, et c{ue telle pigramme charge du
sel d'un vieux mot et t fort innocente il
y
a deux cents
ans. Il me semble donc qu'il est ridicule, quand on n'a pas
la navet, d'en emprunter les livres: nos grands crivains
l'ont trouve dans leur me, sans quitter leur langue, et
celui qui, pour tre naf, emprunte une phrase d'Amyot,
demanderait, pour tre brave, l'armure de Bavard.
LiiTnATruE
19
C'est une chose bien remarquable qu' quelque poque
de la lang-ue franaise qu'on s'arrte, depuis sa plus obs-
cure orig-ine jusqu' Louis XIII, et dans quelque imperfec-
tion qu'elle se trouve de sicle en sicle, elle ait toujours
charm l'Europe, autant que le malheur des temps l'a per-
mis. 11 faut donc que la France ait toujours eu une perfec-
tion relative et certains agrments fonds sur la position
et sur l'heureuse humeur de ses habitants. L'histoire, q^ui
confirme partout cette vrit, n'en dit pas autant de l'Ang-le-
terre.
Les Saxons, l'ayant conquise, s'y tablirent, et c'est de
leur idiome et de l'ancien jarg-on du pays que se forma la
lang-ue ang-laise, appele anglo-saxon. Celte langue fut
abandonne au peuple, depuis la conqute de Guillaume
jusqu' Edouard III, intervalle pendant lequel la cour et
les tribunaux d'Angleterre ne s'exprimrent qu'en franais.
Mais enfin la jalousie nationale s'tant rveille, on exila
une lan^rue rivale que le gnie anglais repoussait depuis
longtemps. On sent bien que les deux langues s'taient
mles malgr leur haine
;
mais il faut observer que les
mots franais qui migrrent en foule dans l'anglais, et
qui se fondirent dans une prononciation etune syntaxe nou-
velles, ne furent pourtant pas dfigurs. Si notre oreille
les mconnat, nos yeux les retrouvent encore; tandis que
les mots latins qui entraient dans les diffrents jargons de
l'Europe furent toujours mutilas, comme les oblisques et
les statues qui tombaielat entre les mains des barbares. Cela
vient de ce que les Latins ayant plac les nuances de la
dclinaison et del conjugaison dans les finales des mots,
nos anctres, qui avaient leurs articles, leurs pronoms et
leurs verbes auxiliaires, tronqurent ces finales qui leur
taient inutiles, et qui dfiguraient le mot leurs yeux.
Mais dans les emprunts que les langues modernes se font
entre elles, le mot ne s'altre que dans la
prononciation.
Pendant un espace de quatre cents ans, je ne trouve en
Angleterre que Chaucer et Spencer. Le premier mrita,
vers le milieu du quinzime sicle, d'tre appel l'Homre
anglais : notre Ronsard le mrita de mme; et Chaucer,
aussi obscur que lui, fut encore moins connu. De Chaucer
jusqu' Shakespeare et Milton, rien ne transpire dans cette
le clbre, et sa littrature ne vaut pas un coup d'il.
20
nivAnoL
Me voil tout coup revenu l'poque o j'ai laiss la
lang-ue franaise. La paix de Vervins avait appris l'Eu-
rope sa vritable position; on vit chaque tat se placer
son rani^-. L'Ang-leterre brilla pour un moment de l'clat
d'Elisabeth et de Cromw'el, et ne sortit pas du
pdantisme;
l'Espag-ne puise ne put cacher sa faiblesse
;
mais la France
montra toute sa force, et les lettres commencrent sa g-loire.
Si Ronsard avait bti des chaumires avec des tronons
de colonnes grecques, ?.alherbe leva le premier des monu-
ments nationaux. Richelieu, qui affectait toutes les g-ran-
deurs, abaissait d'une main la maison d'Autriche, et de
l'autre attirait lui le jeune Corneille, en l'honorant de sa
jalousie. Ils fondaient ensemble ce thtre, o, jusqu' l'ap-
f)arition
de Racine, l'auteur du Cid rg-na seul. Pressentant
es accroissements et l'empire de la lang-ue, il lui crait un
tribunal, afin de devenir par elle le lgislateur des lettres.
A cette poque, une foule de j^nies vigoureux s'emparrent
de la langue franaise, et lui firent parcourir rapidement
toutes ses priodes, de Voiture jusqu' Pascal, et de Racan
jusqu' Boileau.
Cependant l'Angleterre, chappe l'anarchie, avait
repris ses premires formes, et Charles II tait paisiblement
assis sur un trne teint du sang de son pre. Shakespeare
avait paru
;
mais son nom et sa gloire ne devaient passer
les mers que deux sicles aprs
;
il n'tait pas alors, comme
il l'a t depuis, l'idole de sa nation et le scandale de notre
littrature
(4>
Son gnie agreste et populaire dplaisait au
prince et aux courtisans. Milton, qui le suivit, mourut
inconnu
;
sa personne tait odieuse la cour; le titre de
son pome rebuta: on ne gota point des vers durs, hris-
ss de termes techniques, sans rime et sans harmonie, et
l'Angleterre apprit un peu tard qu'elle possdait un pome
pique. Il
y
avait pourtant de beaux esprits et des potes
la cour de Charles : Cowley, Rochester, Hamilton, Waller
V brillaient, et Shaftesburv htait les progrs de la pense,
en purant la prose anglaise. Cette faible aurore se perdit
tout coup dans l'clat du sicle de Louis XIV : les beaux
jours de la France taient arrivs.
11
y
eut un admirable concours de circonstances. Les
grandes dcouvertes qui s'taient faites depuis cent cin-
quante ans dans le monde avaient donn l'esprit humain
LITTERATUHE
21
une
impulsion que rien ne pouvait plus arrter,
et cette
impulsion tendait vers la France. Paris fixa les ides flot-
tantes de l'Europe, et devint le foyer des tincelles rpan-
dues chez tous les peuples. L'imag-ination de Descartes
rg-na dans la philosophie, la raison de Boileau dans les
vers
;
Bayle plaa le doute aux pieds de la vrit
; Bossuet
tonna sur la tte des rois; et nous comptmes autant de
g-enrcs d'loquence que de g-rands hommes. Notre thtre
surtout achevait l'ducation de l'Europe : c'est l que le
jrand Cond pleurait aux vers du g-rand Corneille, et que
Racine corrigeait Louis XIV. Rome tout entire parut sur
la scne franaise, et les passions parlrent leur lang-ag-e.
Nous emes et ce JMolire plus comique que les Grecs, et le
Tlmaque plus antique que les ouvrages des anciens, et ce
La Fontaine qui, ne donnant pas la lang-ue des formes si
f)ures,
lui prtait des beauts plus incommunicables.
Nos
ivres, rapidement traduits en Europe et mme en Asie, de-
vinrent les livres de tous les pays, de tous les g-ots et de
tous lesg-es. La Grce, vaincue sur le thtre, le fut encore
dans des pices fug-itives qui volrent de bouche en bouche,
et donnrent des ailes la lang-ue franaise. Les premiers
journaux qu'on vit circuler en Europe taient franais, et
ne racontaient que nos victoires et nos chefs-d'uvre. C'est
de nos acadmies qu'on s'entretenait, et la langue s'ten-
dait par leurs correspondances. On ne parlait enfin que de
l'esprit et des g-rces franaises : tout se faisait au nom de
la France, et notre rputation s'accroissait de notre rputa-
tion.
Aux productions de l'esprit se joignaient encore celles de
l'industrie : des pompons et des modes accompagnaient nos
meilleurs livres chez l'tranger, parce qu'on voulait tre
partout raisonnable et frivole comme en France. Il arriva
Qonc que nos voisins, recevant sans cesse des meubles, des
toffes et des modes qui se renouvelaient sans cesse man-
qurent de termes pour les exprimer : ils furent comme
accabls sous l'exubrance de l'industrie franaise; si bien
qu'il prit comme une impatience gnrale l'Europe, et
que pour n'tre plus spar de nous, on tudia notre langue
de tous cts.
Depuis cette explosion, la France a continu de donner un
thtre, des habits, du got, des manires, une langue, un
RIVAROL
nouvel art de vivre et des jouissances inconnues aux tats
qui l'entourent : sorte d'empire qu'aucun peuple n'a jamais
exerc. Et comparez-lui, je vous prie, celui des Romains
qui semrent partout leur lang-ue et Tesclavag-e, s'engrais-
srent de sang-, et dtruisirent jusqu' ce qu'ils fussent
dtruits !
On a beaucoup parl de Louis XIV; je n'en dirai qu'un
mot. Il n'avait ni le gnie d'Alexandre, ni la puissance et
l'esprit d'Aug"uste
;
mais pour avoir su rgner, pour avoir
connu l'art d'accorder ce coup-d'il, ces faibles rcompen-
ses dont le talent veut bien se payer, Louis XIV marche,
dans l'histoire de l'esprit humain, ct d'Auguste et d'A-
lexandre. Il fut le vritable Apollon du Parnasse franais
;
les pomes, les tableaux, les marbres ne respirrent que
pour lui. Ce qu'un autre et fait par politique, il le fit par
g-ot. Il avait de la grce
;
il aimait la g-loire et les plaisirs
;
et je ne sais quelle tournure romanesque, qu'il eut dans sa
jeunesse, remplit les Franais d'un enthousiasme quigag-na
toute l'Europe. Il fallut voir ses btiments et ses ftes
;
et
souvent la curiosit des trangers soudoya la vanit fran-
aise. En fondant Rome une colonie de peintres et de sculp-
teurs, il faisait signer la France une alliance perptuelle
avec les arts. Quelquefois, son humeur magnifique allait
avertir les princes trang-ers du mrite d'un savant ou d'un
artiste cach dans leurs tats, et il en faisait l'honorable
conqute. Aussi le nom franais et le sien pntrrent jus-
qu'aux extrmits orientales de l'Asie. Notre langue domina
comme lui dans tous les traits; et quand il cessa de dicter
des lois, elle garda si bien l'empire qu'elle avait acquis, que
ce fut dans cette mme langue, org-ane de son ancien des
potisme, que ce prince fut humili vers la fin de ses jours.
Ses prosprits, ses fautes et ses malheurs servirent g-ale-
raent la lans^ue
;
elle s'enrichit, la rvocation de Fdit
de Nantes, de tout ce que perdait l'Etat. Les rfugis empor-
trent dans le nord leur haine pour le prince et leurs reg-rets
pour leur patrie, et ces regrets et cette haine s'exhalrent
en franais.
Il semble que c'est vers le milieu du rgne de Louis XIV
que le royaume se trouva son plus haut point de grandeur
relative. L'Allemagne avait des princes nuls, l'Espag-ne
tait divise et lang-uissante, l'Italie avait tout cramdre,
LITTUATL-RE 23
l'An^-leterreet l'Ecosse n'taient pas encore unies, la Prusse
et la Russie n'existaient pas. Aussi l'heureuse France, pro-
fitant de ce silence de tous les peuples, triompha dans la
guerre et dans les arts. Elle occupa le monde de ses entre-
priseset de sa gloire. Pendant prs d'un sicle, elle donna
ses rivaux et les jalousies littraires, et les alarmes politi-
ques, et la fatigue de ladmiration. Enfin l'Europe, lasse
d'admirer et d'envier, voulut imiter : c'tait un nouvel hom-
ma^-e. Des essaims d'ouvriers entrrent en France et en
rapportrent notre lani^'-ue et nos arts qu'ils propa;5-rent.
Vers la fin du sicle, quelques ombres se mlrent tant
d'clat. Louis XIV vieillissant n'tait plus heureux. L'An-
g-lelerre se dg-ag-ea des rayons de la France et brilla de sa
propre lumire. De g-rands esprits slevrent dans son
sein. Sa langue s'tait enrichie, comme son commerce, de
la dpouille des nations. Pope, AddissonetDryden en adou-
cirent les sifflements, et l'ang-lais fut, sous leur plume,
l'italien du nord. L'enthousiasme pour Shakespeare et Mil
-
ton se rveilla
;
et cependant Locke posait les bornes de
l'esprit humain, Newton trouvait la nature de la lumire et
la loi de l'univers.
Aux yeux du sag-e, l'Ang-leterre s'honorait autant parla
philosophie que nous par les arts
;
mais puisqu'il faut le
dire, la place tait prise : l'Europe ne pouvait donner deux
fois le droit d'anesse, et nous l'avions obtenu; de sorte que
tant de g-rands hommes, en travaillant pour leur gloire,
illustrrent leur patrie et l'humanit, plus encore que leur
lang"ue.
Supposons cependant que l'Angleterre et t moins
lente sortir de la barbarie, et qu'elle et prcd la
France
;
il me semble que l'Europe n'en aurait pas mieux
adopt sa langue. Sa position n'appelle pas les voyageurs,
et la France leur sert toujours de passage ou de terme. L'An-
gleterre vient elle-mme faire son commerce chez les diff-
rents peuples, et on ne va point commercer
chez elle. Or
celui qui voyage ne donne pas sa langue
;
il prendrait plu-
tt celles des autres : c'est presque sans sortir de chez lui
que le Franais a tendu La
sienne.
Supposons enfin que, par sa position,
l'Angleterre ne se
trouvt pas relgue dans lOcan, et qu'elle et attir ses
voisins
;
il est encore probable que sa langue et sa littra-
24
RIVAUOL
ture n'auraient pu fixer le choix de l'Europe; car il n'esl
point d'objection un peu forte contre la lang"ue allemande,
qui n'ait encore de la force contre celle des Ang-lais : les
dfauts de la mre ont pass jusqu' la fille. Il est vrai aussi
que les objections contre la littrature ang-laise deviennent
plus terribles contre celle des Allemands : ces deux peuples
s'excluent l'un par l'autre.
Quoi qu'il en soit, l'vnement a dmontr que, la lang-ue
latine tant la vieille souche, c'tait un de ses rejetons qui
devait fleurir en Europe. On peut dire, en outre, que si
l'Anglais a l'audace des langues inversions, il en a l'obs-
curit, et que sa syntaxe est si bizarre que la rgle
y
a
quelquefois moins d'applications que d'exceptions. On lui
trouve des formes serviles qui tonnent dans la langue d'un
peuple libre, et la rendent moins propre la conversation
que la langue franaise, dont la marche est si leste et si
dgage. Ceci vient de ce que les Anglais ont pass du plus
extrme esclavage la plus haute libert politique
;
etquenous
sommes arrivs d'une libert presque dmocratique, une
monarchie presque absolue. Les deux nations ont gard les
livres de leur ancien tat, et c'est ainsi que les langues soni
les vraies mdailles de l'histoire. Enfin, la prononciation de
cette langue n'a ni la plnitude, ni la fermet de la ntre.
J'avoue que la littrature des Anglais offre des monu-
ments de profondeur et d'lvation, qui seront l'terne]
honneur de l'esprit humain : et cependant leurs livres ne
sont pas devenus les livres de tous les hommes
;
ils n'ont
pas quitt certaines mains
;
il a fallu des essais et de la pr-
caution pour n'tre pas rebut de leur ton, de leur got et
de leurs formes. Accoutum au crdit immense qu'il a dans
les affaires, l'Anglais semble porter cette puissance fictive
dans les lettres, et sa littrature en a contract un caractre
d'exagration oppos au bon got elle se sent trop de l'iso-
lement du peuple et de l'crivain : c'est avec une ou deux
sensations que quelques Anglais ont fait un livre
(5).
Le
dsordre leur a plu, comme si Tordre leur et sembl trop
prs de je ne sais quelle servitude : aussi leurs ouvrages,
qu'on ne lit pas sans fruit, sont trop souvent dpourvus de
charme; et le lecteur
y
trouve toujours la peine que l'crivaic
ne s'est pas donne.
Mais le Franais, ayant reu des impressions de tous les
LITTnVTLI\E 25
peuples de l'Europe, a plac le j^ot dans les opinions mod-
res, et ses livres composent la bibliothque du i^enre hu-
main. Comme les Grecs, nous avons eu toujours dans le
temple de la g-loire un autel pour les rces, et nos rivaux
les ont trop oublies. On peut dire, par supposition, que si
le
monde finissait tout coup, pour faire place h un monde
nouveau, ce n'est point un excellent livre ang-lais, mais un
excellent livre franais qu'il faudrait lui lg-uer, afin de lui
donner de notre espce humaine une ide plus heureuse.
A richesse g-ale, il faut que la sche raison cde le pas la
raison orne.
Ce n'est point l'aveuqle amour de la patrie ni le prjug
national qui m'ont conduit dans ce rapprochement des
deux peuples; c'est la nature et l'vidence des faits. Eh!
quelle est la nation qui loue plus franchement que nous?
N'est-ce pas la France qui a tir la littrature ang-laise du
fond de son le? N'est-ce pas Voltaire qui a prsent Locke
et mme Newton l'Europe? Nous sommes les seuls qui
imitions les An^-Iais, et quand nous sommes las de notre
g-ot, nous
y
mlons leurs caprices. Nous faisons entrer
une mode ang-laise dans l'immense tourbillon des ntres, et
le monde l'adopte au sortir de nos mains. Il n'en est pas
ainsi de l'Angleterre : quand les peuples du nord ont aim
la nation franaise, imit ses manires, exalt ses ouvrages,
les Anglais se sont tus, et ce concert de toutes les voix n'a
t troubl que par leur silence.
Il me reste prouver que, si la langue franaise a con-
quis l'empire par ses livres, par l'humeur et par l'heureuse
position du peuple qui la parle, elle le conserve par son pro-
pre gnie.
Ce qui distingue notre langue des langues anciennes et
modernes, c'est l'ordre et la construction de la phrase. Cet
ordre doit toujours tre direct et ncessairement
clair. Le
Franais nomme d'abord le sujet du discours,
ensuite le
verbe qui est l'action, et enfin l'objet de cette action :
voil la logique naturelle tous les hommes; voil ce qui
constitue le sens commun. Or, cet ordre si favorable, si
ncessaire au raisonnement, est presque toujours contraire
aux sensations, qui nomment le premier l'objet qui frappe
le premier : c'est pourquoi tous les peuples, abandonnant
l'ordre direct, ont eu recours aux tournures plus ou moins
a6
nivAHuL
hardies, selon que leurs sensations ou l'harmonie l'exi-
geaient; et Tinversion a prvalu sur la terre, parce que
l'homme est plus imprieusement gouvern par les passions
que par la raison.
Le franais, par un privilge unique, est seul rest fidle
l'ordre direct, comme s'il tait tout raison
;
et on a beau,
par les mouvements des plus varis et toutes les ressources
au style, dguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe : et
c'est en vain que les passions nous bouleversent et nous
sollicitent de suivre l'ordre des sensations : la syntaxe fran-
aise est incorruptible. C'est de l que rsulte cette admi-
rable clart, base ternelle de notre langue. Ce qui n'est
PAS CLAIR n'est PAS FRANAIS; cc qi u'cst pas clair est
encore anglais, italien, grec ou latin. Pour apprendre les
langues inversions, il sufft de connatre les mots et les
rgimes; pour apprendre la langue franaise, il faut encore
retenir l'arrangement des mots. On dirait que c'est d'une
gomtrie toute lmentaire, de la simple ligne droite, que
s'est forme la lan^-ue franaise; et que ce sont les courbes
et leurs varits infinies qui ont prsid aux langues grecque
et latine. La ntre rgle et conduit la pense; celles-l se
prcipitent et s'garent avec elle dans le labyrinthe des sen-
sations, et suivent tous les caprices de l'harmonie : aussi
furent-elles merveilleuses pour les oracles, et la ntre les
et absolument dcris.
Il est arriv de l que la langue franaise a t moins
propre la musique et aux vers qu'aucune langue ancienne
ou moderne : car ces deux arts vivent de sensations
;
la
musique surtout, dont la proprit est de donner la force
des paroles sans verve, et d'atfaiblir les expressions fortes :
preuve incontestable qu'elle est elle-mme une puissance
fart,
et qu'elle repousse tout ce qui veut partager avec elle
empire des sensations. Qu'Orphe redise sans cesse : J'ai
perdu mon Eurydice, la sensation d'une phrase tant rpte
sera bientt nulle, et la sensation musicale ira toujours
croissant. Et ce n'est point, comme on l'a dit, parce que les
mots franais ne sont pas sonores, que la musique les
repousse; c'est parce qu'ils offrent l'ordre et la suite, quand
le chant
demande le dsordre et l'abandon. La musique doit
bercer l'me dans le vague et ne lui prsenter que des motifs.
Malheur celle dont on dira qu'elle a tout dfini;! les
MTTEaATi;UK
27
accords plaisent l'orollle par la mme raison que les
saveurs et les parfums plaisent au
cot
et l'odorat.
Mais, si la rif>'ide construction de la phrase t;cne la marche
du musicien, l'imag-ination du pote est encore arrte
par
leg-nie circonspect de la lane;-ue. Les mfaphores des potes
trang-ers ont toujours un degr de plus que les ntres
;
ils
serrent le stvle fipfur de plus prs, et leur posie est plus
haute en couleur. Il est gnralement vrai que les figures
orientales taient folles; que celles des Grecs et des Latins
ont t hardies, et que les ntres sont simplement justes. Il
faut donc que le pote franais plaise par la pense, par une
lg-ance continue, par des mouvements heureux, par des
alliances de mots. C'est ainsi que les g-rands matre* n'ont
pas laiss de cacher d'heureuses hardiesses dans le tissu
d'un style clair et sag-e
;
et c'est de l'artifice avec lequel ils
ont su dg-uiser leur fidlit au g-nie de leur langue que
rsulte tout le charme de leur stvle. Ce qui fait croire que
la lang-ue franaise, sobre et timide, serait encore la der-
nire des langues, si la masse de ses bons crivains ne l'et
pousse au premier rang", en forant son naturel.
Un des plus grands problmes qu'on puisse proposer aux
hommes est cette constance de Tordre rgulier dans notre
langue. Je conois bien que les Grecs et mme les Latins,
ayant donn une famille chaque mot et de riches modifi-
cations leurs finales, se soient livrs aux plus hardies
tournures pour obir aux impressions qu'ils recevaient des
objets; tandis que, dans nos langues modernes, l'embarras
des conjug-aisons et l'attirail des articles, la prsence d'un
nom mal apparent ou d'un verbe dfectueux, nous font
tenir sur nosg^ardes, pour viter d'obscurit. Mais pourquoi,
entre les lang-ues modernes, la ntre s'est-elle trouve seule
si rig"oureusement asservie l'ordre direct? Serait-il vrai
que, par son caractre, la nation franaise et souveraine-
ment besoin de clart?
Tous les hommes ont ce besoin sans doute, et je ne croi-
rai jamais que dans Athnes et dans Rome les g^ens du
peuple aient us de fortes inversions. On voitmmeles plus
g'rands crivains se plaindre de l'abus qu'on en faisait en
vers et en prose. Ils sentaient que l'inversion tait l'unique
source des difficults et des quivoques dont leurs langues
fourmillent; parce qu'une fois l'ordre du raisonnement
28 nivAiiOL
sacrifi, l'oreille et l'imaginalion, ce qu'il
y
a dplus capri-
cieux dans l'homme, restent matresses du discours. Aussi,
quand on lit Dmctrius de Phalre, est-on frapp des log'es
qu'il donne Thucydide, pjur avoir dbut, dans son his-
toire, par une phrase de construction toute franaise. Cette
phrase tait lo^ante et directe la fois, ce qui arrivait
rarement; car toute langue, accoutume la licence des
inversions, ne peut plus porter le joug- de l'ordre, sans
perdre ses mouvements et sa grce.
Mais la langue franaise, ayant la clart par excellence,
a d chercher toute son lgance et sa force dans l'ordre
direct; l'ordre et la clart ont d surtout dominer dans la
prose, et la prose a d lui donner l'empire. Cette marche
est dans la nature; rien n'est en effet comparable la prose
franaise.
Il
y
a des piges et des surprises dans les langues in-
versions
;
le lecteur reste suspendu dans une phrase latine,
comme un voyageur devant des routes qui se croisent
;
il
attend que toutes les finales l'aient averti de la correspon-
dance des mots
;
son oreille reoit, et son esprit, qui n'a
cess de dcomposer pour composer encore, rsout enfin le
sens de la phrase comme un problme. La prose franaise
se dveloppe en marchant, et se droule avec grce et no-
blesse. Toujours sre de la construction de ses phrases, elle
entre avec plus de bonheur dans la discussion des choses
abstraites, et sa sagesse donne de la confiance la pense.
Les philosophes l'ont adopte, parce qu'elle sert de flambeau
aux sciences qu'elle traite, et qu'elle s'accommode galement,
et de la frugalit didactique, et de la magnificence qui
convient l'histoire de la nature.
On ne dit rien en vers qu'on ne puisse trs souvent expri-
mer aussi bien dans notre prose, et cela n'est pas toujours
rciproque. Le prosateur tient plus troitement sa pense,
et la conduit par le plus court chemin
;
tandis que le versi-
ficateur laisse flotter les rnes, et va o la rime le pousse.
Notre prose s'enrichit de tous les trsors de l'expression
;
elle poursuit le vers dans toutes ses hauteurs, et ne laisse
entre elle et lui que la rime. Etant commune tous les
hommes, elle a plus de juges que la versification, et sa dif-
ficult se cache sous une extrme facilit. Le versificateur
enfle sa voix, s'arme de la rime et de la mesure, et tire une
LITTERATLRS ZQ
pense commune du sentier vuli^airc
;
mais aussi que de
faiblesses ne cache pas l'art des versl La prose accuse le nu
de la pense; il n est pas permis d'tre faible avec elle. Selon
Denis d'IIalycarnasse, il
y
a une prose qui vaut mieux que
les meilleurs vers, et c'est elle qui fait lire les ouvrai^es de
lon^-ue haleine, parce qu'elle seule peut se charger des
dtails, et que la varit de ses priodes lasse moins que le
charme continu de la rime et de la mesure. Et qu'on ne
croie pas que je veuille par l dgrader les beauxvers; l'ima-
gination pare la prose, mais la posie pare limag-ination.
La raison elle-mme a plus d'une route, et la raison en vers
est admirable; mais le mcanisme du vers fatigue, sans
offrir l'esprit des tournures plus hardies, dans notre
langue surtout, o les vers semblent tre les dbris de la
prose qui les a prcds
;
tandis que, chez les Grecs, sau-
vages plus harmonieusement organiss que nos anctres,
les vers et les dieux rgnrent longtemps avant la prose et
les rois. Aussi peut-on dire que leur langue fut longtemps
chante avant d'tre parle; et la ntre, jamais dnue de
prosodie, ne s'est dgage qu'avec peine deses articulations
rocailleuses. De l nous est venue cette rime tant reproche
la versification moderne, et pourtant si ncessaire pour
lui donner cet air de chant qui la dislinguedela prose. Au
reste, les anciens n'eurent-ils pas le retour des mesures
comme nous celui des sons
;
et n'est-ce pas ainsi que tous
les arts ont leurs rimes, qui sont les symtries ? Un jour
cette rime des modernes aura de grands avantages pour la
f)ostrit;
car il s'lvera des scoliastes qui compileront
aborieusement toutes celles des langues mortes; et comme
il n'y a presque pas un mot qui n'ait pass par la rime, ils
fixeront par l une sorte de prononciation uniforme et plus
ou moins semblable la ntre, ainsi que par les lois de la
mesure nous avons fix la valeur des syllabes chez les Grecs
et les Latins.
Quoi qu'il en soit de la prose et des vers franais,
quand
cette langue traduit, elle explique
vritablement
un auteur.
Mais les langues italienne et
anglaise,
abusant de leurs
inversions, se jettent dans tous les" moules que le texte leur
prsente
;
elles se calquent sur lui, et rendent
difficult pour
difficult : je n'en veux pour preuve que
Davanzati. Quand
le sens de Tacite se perd comme un fleuve qui disparat
30
RIVAHOL
tout coup sous la terre, le traducteur plonge et se drobe
avec lui. On les voit ensuite reparatre ensemble
;
ils ne se
quittent pas l'un l'autre, mais le lecteur les perd souvent
tous deux.
La prononciation de la lang-ue franaise porte l'empreinte
de son caractre
;
elle est plus varie que celle des langues
du midi, mais moins clatante; elle est plus douce que
celles des lang-ues du nord, parce qu'elle n'articule pas
toutes ses lettres. Le son de Ve muet, toujours semblable
la dernire vibration des corps sonores, lui donne une
harmonie l^-re qui n'est qu' elle.
Si on ne lui trouve pas les diminutifs et les mignardises
de la lanGrue
italienne, son allure est plus mle. Dg-age
de tous les protocoles que la bassesse inventa pour la vanit
et la faiblesse pour le pouvoir, elle en est plus faite pour la
conversation, lien des hommes et charme de tous les g-es
;
et puisqu'il faut le dire, elle est de toutes les lang^ues la
seule qui ait une probit attache son g-nie. Sre, sociale,
raisonnable, ce n'est plus la lang-ue franaise, c'est la lan-
g-ue humaine. Et voil pourquoi les puissances l'ont appele
dans leurs traits
;
elle
y
rg-ne depuis les confrences de
Nimg-ue
;
et dsormais les intrts des peuples et les vo-
lonts des rois reposeront sur une base plus fixe
;
on ne
smera plus la g-uerre dans des paroles de paix.
Aristippe, ayant fait naufrag-e, aborda dans une le
inconnue, et voyant des fig-ures de gomtrie traces sur le
rivage, il s'cria que les dieux ne l'avaient pas conduit chez
des barbares. Quand on arrive chez un peuple, et qu'on
y
trouve la langue franaise, on peut se croire chez un peuple
poli.
Leibnitz cherchait une langue universelle, et nous l'ta-
blissions autour de lui. Ce grand homme sentait que la
multitude des lang-ues tait fatale au gnie, et prenait trop
sur la brivet de la vie. Il est bon de ne pas donner trop
de vtements sa pense
;
il faut, pour ainsi dire, voyager
dans les langues, et, aprs avoir savour le got des plus
clbres, se renfermer dans la sienne.
Si nous avions les
littratures de tous les peuples passs,
comme nous avons celles des Grecs et des Piomains, ne fau-
drait-il pas que tant de langues se rfugiassent dans une
seule par la traduction ? Ce sera vraisemblablement le sort
LiiiuArcht
3l
des lang-ues modernes, et la ntre leur ofTre un port dans
le naufrage. L'Europe prsente une rpublique fdratlve,
compose d'empires et de royaumes, et la plus redoutable
qui ait jamais exist
;
on ne peut en prvoir la Hn, et cepen-
aant la langue franaise doit encore lui survivre. Les Ktats
se renverseront, et notre langue sera toujours retenue dans
la tempte par deux ancres, sa littrature et sa clart, jus-
qu'au moment o, par une de ces grandes rvolutions qui
remettent les choses leur premier point, la nature vienne
renouveler ses traits avec ^m autre genre humain.
Mais sans attendre l'elfort des sicles, cette langue ne
peut-elle pas se corrompre ? Une telle question mnerait
trop loin; il faut seulement soumettre la langue franaise
au principe commun toutes les langues.
Le langage est la peinture de nos ides, qui leur tour
sont des images plus ou moins tendues de quelques parties
del nature. Comme il existe deux mondes pour chaque
homme en particulier, Tun hors de lui, qui est le monde
physique, et l'autre au dedans, qui est le monde moral ou
intellectuel, il
y
a aussi deux styles dans le langage, le
naturel et le
figur.
Le premier exprime ce qui se passe
hors de nous et dans nous par des causes physiques
;
il
compose le fond des langues, s'tend par Texprience, et
peut tre aussi grand que la nature. Le second exprime ce
qui se passe dans nous et hors de nous
;
mais c'est l'imagi-
nation qui le compose des emprunts qu'elle fait au premier.
Le soleil brle
;
le marbre est froid
;
l'homme dsire la
gloire
;
voil le langage propre ou naturel. Le cur brle
de dsir ;la crainte le glace
;
la terre demande la pluie :
voil le style figur, qui n'est que le simulacre de l'autre,
et qui double ainsi la richesse des langues. Comme il tit-nt
l'idal, il parat plus grand que la nature.
L'homme le plus dpourvu d'imagination ne parle pas
longtemps sans tomber dans la mtaphore. Or, c'est ce per-
ptuel mensonge de la parole, c'est le style mtaphorique
qui porte un germe de corruption. Le style naturel ne peut
tre que vrai
;
et quand il est faux, l'erreur est de fait, et
nos sens la corrigent tt ou tard. Mais les erreurs dans les
figures ou dans les mtaphores annoncent de la fausset
dans l'esprit et un amour de l'exagration qui ne se corrige
gurcs.
32
RIVAUOL
Une lans^ue vient donc se corrompre lorsque, confon-
dant les limites qui sparent le st^le naturel du Ij^-ur, on
met de l'affectation outrer les fig-urcs et rtrcir le natu-
rel qui est la base, pour charger d'ornements superflus l'di-
fice de l'imagination. Par exemple, il n'est pomt d'art ou
de profession dans la vie, qui n'ait fourni des expressions
figures au langage : on dit, la trame de la perfidie
;
le
creuset du malheur
;
et on voit que ces expressions sont
comme la porte de nos ateliers, et s'offrent tous les
yeux. Mais quand on veut aller plus avant, et qu'on dit.
cette vertu qui sort du creuset na pas perdu tout son
alliage : il lui
faut
plus de cuisson : lorsqu'on passe de
la trame de la ^er^die la navette de la fourberie, on
tombe dans l'affectation.
C'est ce dfaut qui perd les crivains desnationsavances
;
ils veulent tre neufs, et ne sont que bizarres; ils tourmen-
tent leur langue, pour que l'expression leur donne la pen-
se: et c'est pourtant celle-ci qui doit toujours amener l'au-
tre. Ajoutons qu'il
y
aune seconde espce de corruption,
mais qui n'est pas craindre pour la langue franaise :
c'est la bassesse des ligures. Pionsard disait, le soleil per-
ruque de lumire
;
la voile s enfle plein ventre. Ce
dfaut prcde la maturit des langues, et disparat avec la
politesse.
Par tous les mois et toutes les expressions dont les arts
et les mtiers ont enrichi les langues, il semble qu'elles aient
peu d'obligations aux gens de la cour et du inonde; mais
si c'est la partie laborieuse d'une nation qui cre, c'est la
partie oisive qui choisit et qui rgne. Le travail et le repos
sont pour l'une, le loisir et les plaisirs pour l'autre. C'est
au got ddaigneux, c'est l'ennui dun peuple d'oisifs que
l'art a d ses progrs et ses finesses. On sent en effet que
tout est bon pour Thomme de cabinet et de travail, qui
ne cherche le soir qu'un dlassement dans les spectacles
et les chefs-d'uvre des arts
;
mais pour des mes excdes
de plaisirs et lasses de repos, il faut sans cesse des attitu-
des nouvelles et des sensations toujours plus exquises.
Peut-tre est-ce ici le lieu d'examiner ce reproche de pau-
vret et d'extrme dlicatesse, si souvent fait la langue
franaise. Sans doute, il est difficile d'y tout exprimer avec
noblesse
;
mais voil prcisment ce qui constitue en quel-
LITTKATUHE 33
que sorte son caractre. Les styles sont classs dans notre
langue, comme les sujets dans notre monarchie. Deux ex-
pressions qui conviennent la mme chose ne conviennent
pas au mme ordre de choses
;
et c'est travers cette hirar-
chie des styles que le bon goiU sait marcher. On peut ran-
ger nos grands crivains en deux classes. Les premiers,tels
lue Racine et Boileau, doivent tout un travail obstin;
ils parlent un langage parfait dans ses formes, sans m-
lange, toujours idal, toujours tranger au peuple qui les
environne : ils deviennent les crivainsde tousles temps, et
perdent bien peu dans la postrit. Les seconds, ns avec
plus d'originalit, tels que Molire ou La Fontaine, revlent
leurs ides de toutes les formes populaires
;
mais avec tant
ie sel, de got et de vivacit, qu'ils sont la fois lesmod-
es et les rpertoires de leur langue. Cependant leurs cou-
leurs plus locales s'efiacent la longue
;
le charme du style
nl s'atl'adit ou se perd, et ces auteurs ne sont pour la pos-
:rit qui ne peut les traduire, que les crivains de leur
lation.ll serait donc aussi injuste denejugerde l'abondance
ie notre langue que par le Tlmaque ou Cinna seulement,
jue de la population de laFrance parle petit nombre appel
a bonne compagnie.
J'aurais pu examinerjusqu' quel point et par combien de
luances les langues passent et se dgradent en suivant le
lclin des empires. Mais il suffit de dire qu'aprs s'tre
leves d'poque en poque jusqu' la perfection, c'est en
,'ain qu'elles en descendent : elles
y
sont fixes par les bons
ivres, et c'est en devenant langues mortes qu'elles se font
rellement immortelles. Le mauvais latin du Bas-Empire
'a-t-il pas donn un nouveau lustre la belle latinit du
iicle d'Auguste ? Les grands crivains ont tout fait. Si
aotre France cessait d'en produire, la langue de Racine et
ie Voltaire deviendrait une lancrue morte
;
et si les Esqui-
maux nous offraient toutcoup douze crivains du premier
Drdre, il faudrait bien que les regards de l'Europe se tour-
oassent vers cette littrature des Esquimaux.
Terminons, il est temps, l'histoire dj trop longue de la
langue franaise. Le choix de l'Europe est expliqu et jus-
tifi : Voyons d'un coup d'il comment, sous le rgne de
Louis XV, il a t confirm, et comment il se confirme
encore de jour en jour.
I
34
RIVAROL
Louis XIV, se survivant lui-mme, voyait commencer
un autre sicle, etla France ne s'tait repose qu'un moment.
La philosophie de Newton attira d'abord nos regards, et
Fontenelle nous la fit aimer en la combattant. Astre doux
et paisible, il rgna pendant le crpuscule qui spara les
deux rgnes. Son stvle clair et familier s'exerait sur des
objets profonds, et nous dguisait notre ignorance. Montes-
quieu vint ensuite montrer aux hommes les droits des uns
et les usurpations des autres, le bonheur possible et le
malheur rel. Pour crire l'histoire grande et calme de la
nature, BufTon emprunta ses couleurs et sa majest
;
pour
en fixer les poques, il se transporta dans des temps qui
n'ont point exist pour l'homme
;
et l son imagination
rassembla plus de sicles que l'histoire n'en a depuis grav
dans ses annales : de sorte que ce qu'on appelait le com-
mencement du monde, et qui touchait pour nous aux tn-
bres d'une ternit antrieure, se trouve plac par lui entre
deux suites d'vnements, comme entre deux fojers de
lumire. Dsormais l'histoire du globe prcdera celle de
ses habitants.
Partout on voyait la philosophie mler ses fruits aux
fleurs de la littrature, et TEncyclopdie tait annonce. C'est
l'Angleterre qui avait trac ce vaste bassin o doivent se
rendre nos diverses connaissances
;
mais il fut creus par
des mains franaises. L'clat de cette entreprise rejaillit sur
la nation, et couvrit le malheur de nos armes. En mme
temps, un roi du nord faisait notre langue l'honneur que
Marc-Aurle et Julien firent celle des Grecs : il associait
son immortalit la ntre; Frdric voulut tre lou des
Franais, comme Alexandre des Athniens. Au sein de tant
de gloire, parut le philosophe de Genve. Ce que la morale
avait jusqu'ici enseign aux homm^es, il le commanda, et
son imprieuse loquence fut coute. Piaynal donnait enfin
aux deux mondes le livre o sont pess les crimes de l'un
et les malheurs de l'autre. C'est l que les puissances de
l'Europe sont appeles tour tour, au tribunal de l'huma-
nit, pour
y
frmir des barbaries exerces en Amrique :
au tribunal de la philosophie, pour
y
rougir des prjugs
qu'elles laissent encore aux nations
;
au tribunal de la poli-
tique, pour
y
entendre leurs vritables intrts, fonds sur
le bonheur des peuples.
LITTRATURE
35
Mais Voltaire rg-nait depuis un sicle, et ne donnait de
relche ni ses admirateurs, ni ses ennemis. L'mfatig-able
mobilit de son me de feu l'avait appel l'histoire tui.'-i-
Live des hommes. Il attacha son nom toutes les dcouvertes,
tous les vnements, toutes les rvolutions de son temps,
t la renomme s'accoutuma ne plus parler sans lui. Ayant
:ach le despotisme de Tesprit sous des grces toujours
aouvclles, il devint une puissance en Europe, et fut pour
lle le Franais par excellence, lorsqu'il tait pour les Fran-
ais l'homme de tous les lieux et de tous les sicles. Il
oig-nit enfin l'universalit de sa lan^-ue, son universalit
personnelle : et c'est un problme de plus pour la postrit.
Ces g-rands hommes nous chappent, il est vrai, mais
lous vivons encore de leur g"loire, et nous la soutiendrons,
)uisqu'il nous est donn de faire dans le monde physique
es pas de g"ant qu'ils ont faits dans le monde moral. L'ai-
ain vient de parler
(6)
entre les mains d'un Franais, et
'immortalit que les livres donnent notre lang-ue, des
Lutomates vont la donner sa prononciation. C'est en
^'rance
(7}
et la face des nations que deux hommes se
lont trouvs entre le ciel et la terre, comme s'ils eussent
ompu le contrat ternel que tous les corps ont fait avec elle.
Is ont voyag- dans les airs, suivis des cris de l'admiration
t des alarmes de la reconnaissance. La commotion qu'un
el spectacle a laisse dans les esprits durera long-temps
;
t si, par ses dcouvertes, la physique poursuit ainsi l'ima-
["ination dans ses derniers retranchements, il faudra bien
[u'elle abandonne ce merveilleux, ce monde idal d'o elle
e plaisait charmer et tromper les hommes : il ne res-
era plus la posie que le langag-e de la raison et des
tassions.
Cependant l'Ano-leterre, tmoin de nos succs, ne les
lartag-e point. Sa dernire g-uerre avec nous la laisse dans
a double clipse de sa littrature et de sa prpondrance
;
t cette guerre a donn l'Europe un grand spectacle. On
y
. vu un peuple libre conduit par l'Angleterre l'esclava^-e,
t ramen par un jeune monarque la libert. L'histoire
le l'Amrique se rduit dsormais trois poques : gorge
>ar l'Espagne, opprime par l'Angleterre, et sauve par
a France
(8).
36
nivAROL
NOTES
(i)
Drunetto
Latini.
(3)
Parole
intrieure et cache.
Que dans la retraite et le silence
le plus absolu,
un homme entre en mditation sur les objets les plus
deo-ao-esde la
maiire, il entendra toujours au fond de sa poitrine une
VOIX
secrte qui nommera les objets mesure qu'ils passeront en revue.
Si cet homme est sourd de naissance, la langue n'tant pour lui qu'une
simple
peinture, il verra passer tour tour les hirolyphes ou les
ima:;es des choses sur lesquelles il mditera. K.
(3;
On connat
notre orthographe trois inconvnients : d'employer
d'abord trop de lettres pour crire un mot. ce qui embarrasse sa mar-
che-
ensuite d'en employer qu'on pourrait remplacer par d'autres, ce qui
lui donne du vague; enfin, d'avoir des caractres dont elle n'a pas le
prononce,
et des prononcs dont elle n"a pas les caractres. C'est par
respect,
dit-on, pour l'tymologie, qu^on crit philosophie et non Jilo-
sofie.
Mais, ou le lecteur sait le rec, ou il ne le sait pas
;
s'il l'inore,
cette
orlhosrraphe
lui semble bizarre et rien de plus : s'il connat cette
lan^^ue,
il n'a pas besoin qu'on lui rappelle ce qu'il sait. Les Italiens,
qui^ont
renonc ds lonrtemps notre mthode, et qui crivent comme
ils
prononcent,
n'en savent pas moins le rec, et nous ne l'is^norons pas
moins,
malgr notre fidle routine. Mais on a tant dit que les langues
sont pour
l'oreille! Un abus est bien fort, quand on a si longtemps rai-
son contre lui: sans compter que nous ne sommes pas constamment
fid'es aux
etymologies, car nous crivons fantme, fantaisie, etc., et
philtre on filtre,
etc.
J'observerai
cependant que les livres se sont fort multiplies, et que
les langues sont autant pour les yeux que pour l'oreille : la rforme
est presque impossible. Nous sommes accoutums telle orthographe :
elle a servi fixer les mots dans notre mmoire
;
sa bizarrerie fait sou-
vent toute la physionomie d'une expression, et prvient dans la langue
crite les
frquentes quivoques de la langue parle. Aussi, ds qu'on
prononce un mot nouveau pour nous, naturellement nous demandons
son orthographe, afin de l'as.-ocier aussitt sa prononciation. On ne
croit pas savoir le nom d'un homme, si on ne l'a vu par crit. R.
(4 Le scandale de notre littrature.
Comme le thtre donne un
grand clat une nation, les Anglais se sont raviss sur leur Shakes-
peare, et ont voulu non seulement l'opposer, mais le mettre encore fort
au-dessus de notre Corneille : honteux d'avoir jusqu'ici ignor leur
propre richesse. Cette opinion est d'abord tombe en France, comme
hrsie en
plein concile: mais il s'y est trouv des esprits chaerins et
anfflomans,
qui ont pris la chose avec enthousiasme. Ils regardent en
piti ceux que Shakespeare ne rend pas compltement heureux, et
demandent
toujours qu'on les enferme avec ce grand homme :
partie
malsaine de notre littrature, lasse de reposer sa vue sur les belles pro-
portions!...
D'oii vient l'enthousiasme de l'Angleterre pour lui? De ses beauts et
de ses dfauts. Le gnie de Shakespeare est comme la majest du peuple
anglais : on l'aime'ingal et sans frein; il en parat plus libre. Son
stvle bas et populaire en participe mieux de la souverainet nationale.
Ses beauts dsordonnes causent des motions plus vives, et le peuple
s'intresse une tragdie de Shakespeare comme un vnement qui se
HTTKR\TLftE
37
passerait dans les raes. Les plaisirs purs que donnent la dcence, la
raison, l'ordre et la perfection ne sont faits que pour les mes dlicates
et exerces. On peut dire que Shakespeare, s'il tait moins monstrueux,
ne charmerait [)as tant le peuple, et qu'il n tonnerait pas tant les con-
naisseurs, s'il n't'lail pas quelquefois si rand. Cet homme extraordi-
naire a deux sortes d'ermemis : ses dtracteurs et ses enthousiastes;
les
uns ont la vue trop courte pour le reconnatre quand il est sublime;
les autres l'ont trop fascine pour le voir jamais autre. K.
(5)
C est avec, une ou deux sensations que quelques Anglais ont
fait
un livre.
Gomme Young, avec la nuit et le silence. R.
(6)
L'airain vient de parler.
Ce sont deux ttes d'airain qui par-
lent, et qui prononcent nettement des phrases entires. Elles sont colos-
sales, et leur voix est surhumaine. Ce bel ouvrae, excut par l'abb
Mical, a rsolu un grand problme. R.
(7)
C'est en France, etc.
Allusion l'invention des globes arosta-
tiques, et au voyage de MM. Charles et Robert.
(8)
Voir l'appendice n. 14.
Jugement port iAcadmie de Berlin sur ce discours.
L'auteur
n'obtiendra les suffrages du public, comme il a dj obtenu ceux de
l'Acadmie, que lorsque son discours sera lu et mdit dans le silence
des prjugs nationaux. Le plan qu'il s'est trac est juste et bien
ordonn, et il ne s'en carte jamais. Son style est brillant; il a de la
chaleur, de la rapidit et de la mollesse. Ses penses sont aussi pro-
fondes que philosophiques, et tous ses tableaux, o l'on admire sou-
veut l'nergique pinceau de Tacite, intressent par le coloris, par la
varit, et, j'ose le dire encore, par la nouveaut. Cet crivain a, dans
un degr suprieur, l'art d'attacher, d'entraner ses lecteurs par ses
raisonnements et son loquence. On lui trouve toujours un got
pur et form par l'tude des grands modles. Ses principes ne sont
point arbitraires; ils sont puiss dans le bon sens et dans la nature
;
et l'on voit bien qu'il s'est nourri de la lecture des matres fameux de
l'antiquit. En un mot,il est peu d'ouvrages acadmiques qu'on puiss
comparer au sien, soit pour le fond des choses, soit pour le style, et
f je ne doute pas que le jus:ement qu'en a port l'Acadmie ne soit enfin
confirm par celui du public.
Sign, Borel
1, de l'Acadmie de Berlin.
I
DIALOGUE ENTRE VOLTAIRE
ET FONTENELLE
1784
FONTENELLE, LA MOTTE ET VOLTAIRE
Fonienelle.
Heureusement que la jalousie, la {gloriole des auteurs, et
tout cet attirail de petites passions humaines, ne passa pas
le Stvx avec nous
;
car, pour peu qu'il me restt de l'homme
encore, je sens que je vous harais bien sincrement.
Voltaire.
Que signifie cette phrase de Normand? Je crois en effet
que vous ne m'aimez gure.
Fontenelle.
Puis-je vous pardonner les plaisanteries sans fin dont
vous m'avez accabl pendant le cours d'une si longue vie?
N'tait-ce pas assez que votre rputation et fait taire la
mienne et celle de La Motte? Nous tions tous deux la
tte de la littrature, quand vous avez paru
;
nous hasar-
dions en style timide des opinions trs hardies, lui sur le
got, et moi sur la religion : le monde se reposait, avec
notre ingnieuse mdiocrit, de la supriorit du sicle pr-
cdent; et vous tes venu lui redonner la fatigue des chefs-
d'uvre en tout genre : de sorte que ma longue carrire,
ef'ace son aurore par les Racine et les Boileau, se trouve
clipse vers sa fin par vous, et rduite comme un point.
Sont-ce l des choses qui se pardonnent ?
La Motte.
Sans compter que vous avez mis en dfaut tous nos
petits historiens, qui auraient bien voulu qu'aprs le sicle
LITTERATURB
39
de Louis XIV fut venu celui de la philosophie,
et ensuite
la
dcadence, afin de pouvoir trouver, dans notre histoire
et
dans celle des Romains, des poques bien symtriques,
le
sicle d'Aug-uste, celui des philosophes, et le reste. Mais,
grce vous, on n'y connat plus rien, et Fontenelle
et
moi nous jouons un triste rle. Enfants d'une nature
en
repos, et qui semblait mnag-er ses forces, parce qu'aprs
le sicle de Louis XlVelle se prparait celui de Louis XV,
nous avons t traits bien chichement
;
et toutefois je suis
de l'avis de mon confrre : nous aurions encore la plus
grande rputation sans vous.
Voltaire.
Ing-ratsque vous tes! vous oubliez combien vous avez eu
de beaux moments
;
vous oubliez, Fontenelle, qu'on pour-
rait envier vos quarante dernires annes, et que c'est beau-
coup, mme sur une vie de cent ans. Quant vous, La
Motte, vous avez cru faire une rvolution en posie, et
quand vous lisiez vos fables l'Acadmie franaise, on les
prfrait celles de La Fontaine : cette double illusion
vous a donn de vritables jouissances. Xe vous laissez
donc pas blouir par les honneurs tardifs que Paris m'a
rendus; ils ont t bien achets; car, sans compter les
dgots d'une vie errante et polmique, je ne passais encore
que pour un bel esprit cinquante ans. On m'a longtemps
oppos le dur Piron, et Crbillon le barbare. Il m'a fallu
expier, par une longue retraite, des succs toujours dispu-
ts, et ce n'est qu'en devenant tranger ma patrie que j'ai
pu
y
rentrer, pour recueillir en un jour le fruit de soixante
ans de travaux; faible moisson de gloire, reprsente par
quelques feuilles de laurier! Et je ne vous dis pas encore de
combien d'pines cette couronne tait en secret tissue : je
triomphais Jrusalem, malgr les Scribes et les Phari-
riens, j'tais log chez le Publicain, et si je suis mort dans
mon lit, j'ai pu prvoir, la consternation de tout ce qui
n\en\ronna.it, que
Je
serais enterr au bord (le la rivire,
ct de cette pauvre Le Couvreur. Consolez-vous donc
avec moi, mes amis :
Tout mortel est charg de sa propre douleur.
Fontenelle
.
Oh! si j'avais eu votre destine conduire, elle n'et
40
RIVAROL
point chou dans le port. Vous aviez une grande fortune,
une rputation sans borne, et, si j'en crois la renomme,
vous tiez devenu une puissance en Europe. Je n'aurais
point quitt 'cette retraite o vous receviez le tribut de tant
d'hommag-es, toujours grossis par la distance, pour venir
Paris faire voir de trop prs l'idole, et me donner une indi-
g-estion de gloire : si j'avais eu la faiblesse d'y venir, rien
n'aurait du moins corrompu la douceur de mon triomphe;
j'aurais remport ma couronne Ferney, avant qu'elle se
ft fltrie.
Voltaire.
Vous parlez d'or, mon cher Fontenelle, et vous avez bien
le droit de remontrance, vous qui avez si sagement conduit
votre petite barque. Mais que voulez-vous que je vous
dise? Cette tte octognaire, que les sollicitations des rois
n'auraient point branle, se rendit aux cajoleries du Publi-
cain, qui voulut me faire entrer dans sa maison, comme le
purificateur de l'ancienne loi. Je n'y gagnai qu'un distique
assez piquant par les ides qu'il rapproche ;
Admirez d'Arouet la plaisante plante :
Il naquit chez Ninon, et mourut chez Villette.
Pour me livrer tout entier l'enthousiasme du plus
aimable de tous les peuples, je jetai l'ancre sur le sable
mouvant;
j'oubliai tout projet de retraite. J'achetai un
htel
;
je signai des baux vie d'une main mourante
;
je
ne m'occupai plus que de tripots et d'acadmies.
Fontenelle.
Ah! que je vous sais gr de n'avoir pas oubli mes pau-
vres
acadmies ! Dans quel tat les avez-vous laisses? Ont-
elles pu, du moins, vous dcerner quelque honneur?
Voltaire.
Elles n'taient pas encore aussi dlabres que vous pour-
riez le croire : les
acadmies ont une longue vieillesse; celle
des sciences, dont mes Elments de Newton n'auraient pas
d
me fermer la porte, me proposa une sance, et je l'ac-
ceptai. On parla de l'air fixe, qui tait la mode en ce
moment, et on lut
quelques loges, dont les vtres seront
toujours la meilleure
critique, et de l je passai l'Acad-
mie franaise.
LITTRATURE
l\l
Fonienelle.
Eh l)ien?
Voltaire.
A l'Acadmie franaise...
Fonienelle.
Vous me troublez ! Quel est donc ce cruel silence? L'au-
dience aurait-elle t muette? Vous aurait-elle refus quel-
ques hommages? On assure qu'elle vous cra son directeur
perptuel.
Voltaire.
Tout tait en rgle, mon cher Fontcnelle, et tout alla
dans l'ordre accoutum : l'Acadmie parla, on lut des Elo-
ges, tout le monde fut lou, et chacun parut sortir avec
plaisir; mais, vous le dirai-je? le nombre admirable des
orateurs, le magnifique babil de cet loge, toujours ancien
et toujours nouveau, le retour des sances, l'clat des
rceptions, tant de choses, en un mot, qui font de l'Acad-
mie franaise le corps le plus auguste de l'univers, ne font
plus aujourd'hui les dlices de la nation : le sicle s'est
aftadi sur le sublime; on s'ennuie l'Acadmie. Voil ce
que j'aurais voulu dissimuler un homme tel que vous, car
c'est vous percer le cur. Je sais qu'on emporte chez les
morts les affections qu'on a eues dans la vie; on a toujours
du got pour son premier mtier, et si j'en crois l-dessus
certains bruits, vous avez rassembl l-bas sous ces myrtes
quelques ombres acadmiques, vous
y
tenez des sances; il
faut, en vrit, que vous ayez bien du got la chose, pour
vous tre fait ainsi le secrtaire ternel des morts ! N'en
rougissez pas
;
si vous me l'avouez, je vous promets d'aller
vos assembles une fois tous les sicles. En! plt Dieu
que l'Acadmie n'et tenu l-haut que des assembles scu-
laires; l'inconstant public ne s'en serait pas si tt dgot.
Mais je vous le rpte avec regret, ce public ne s'en cache
pas : il s'obstine dire que l'Acadmie ne fait plus rien
pour sa gloire cl pour ses plaisirs. Quant aux hommes qui
soutiennent encore l'honneur de la nation, qu'ont-ils
faire d'acadmie? que gagnent-ils se runir? C'est aux
moutons s'attrouper; mais les lions s'isolent, et se font
des empires spars.
42 RIVAROL
La Motte.
N'achevez pas : vous voyez o il en est
;
c'est l'tat o le
rduisent les nouvelles trop vritables qui nous arrivent
tous les jours; comme si un aussi bon esprit n'avait pas d
les prvoir! Une peut supporter l'ide d'une nation sans aca-
dmie : semblable ces Romains qui ne concevaient pas
l'Empire sans le Gapitoie, ou le Capitole sans l'Empire.
Nous avons souvent des discussions l-dessus
;
mais je ne
parviens qu' l'afflig-cr.
Voltaire.
Il faut pourtant qu'il dig-re cette vrit. Mettez-vous bien
dans l'esprit, mon cher Fontenellc, qu'il en est des compa-
gnies litlraires comme de celles de commerce. Quand un
peuple est pauvre et sans industrie, il faut alors crer des
compag-nies, leur donner des privilges exclusifs
;
mais
quand chaque citoyen est devenu commerant, il faut alors
dtruire ces corps privilg'is,carils dgnreraienten mono-
pole, et voudraient touflerTindustrieg-nrale prte clore.
Ainsi, quand une nation est barbare, et que quelques ttes
possdent elles seules le peu d'esprit qu'elle a, il est nces-
saire de les rassembler, afin que les regards du peuple
incertain se tournent vers elles, et qu'on sache bien qu'il n'y
a des lumires et du got que chez elles. Mais quand une
fois la nation a got les plaisirs de l'esprit, que les bons
modles se sont multiplis en tout genre, et qu'un vernis
de littrature s'est rpandu sur toutes les conditions de la
socit, alors ces chambres privilgies, le faste de leurs
inscriptions, leurs sances, leurs adoptions et leurs exclu-
sions, excitent plus de murmures que d'mulation : atta-
ques par les aspirants qu'elles repoussent, elles ne sont
jamais dfendues par leurs m.embres
;
le vu gnral est
contre elles, les bons mots se multiplient, et aprs avoir
rendu une nation le service de lui donner une acadmie,
il ne reste plus qu' la lui ter, moins qu'on n'aime mieux
la laisser mourir de ridicule.
Fontanelle.
Ah ! grand homme, vous frappez juste, mais vous frap-
pez trop fort. Je conviens avec vous que l'Acadmie fran-
aise n'est ni d'absolue ncessit, ni de pur agrment en
France
;
cependant elle fait encore honneur la nation,elle
LITTr\ATL'HE
^3
sert de phare tout le Nord, et peut-tre est-ce elle
quela
langue franaise doit un peu de son universalit. Nous som-
mes en eilet le seul peuple chez qui il
y
ait toujours un corps
subsistant qui veille la puret du lang-ag-e.
Voltaire.
Mais c'est prcisment la chose dont elle s'occupe le moins.
N'est-il pas ridicule, en effet, que l'Acadmie franaise
n'ait point encore profit de son despotisme pour nous don-
ner une orthocraphe, pour fixer la vritable acception de
chaque mot, les classer par racine et par famille, poserenfin
les limites de la lang-ue ? N'est-il pas tonnant qu'elle ne
nous ait pas fait encore un bon dictionnaire ? Au lieu de
cela, ce sont des cabales, des partis, des rceptions qui pui-
sent son activit
;
et sans que le monde en sache rien, il
y
a
telles niaiseries qui cotent plus de briq-ues un secr-
taire d'acadmie, et qui exige plus de dextrit, qu'il n'en
fallait jadis Rome pour le consulat et la prture.
Fontenelle.
Vous ne comptez donc pour rien les loges qu'elle donne
pour prix chaque anne V Tous les grands hommes de la
nation
y
sont lous tour tour, et dans peu, ces Eloges for-
meront une i^i-alerie respectable, gale, peut-tre, celle
qu'on leur prpare au Louvre.
La Motte.
Ah ciel! de quoi nous parlez-vous l, Fontenelle? Vous
raillez, sans doute : le Lth nous apporte chaque anne un
Eloge acadmique; c'est un deuil gnral parmi les ombres
quand le moment approche. Vous le savez, nous nous ras-
semblons toutes alors, et nous attendons toutes avec effroi
la dcision du sort. Celui que l'Acadmie a choisi pour vic-
time, plit tout coup; sa gloire et sa couronne, que le
temps avait respectes, se fltrissent visiblement. Voyez,
sous ces ombrages, Montausier, Suger,
l'Hpital
;
voyez
dans quel tat leurs pangyristes les ont mis : ces ttes illus-
tres paraissent avoir pass deux fois par les ombres de la
mort; et vous-mme, Fontenelle, malgr votre philosophie
et votre amour pour tout ce qui vient de l'Acadmie, vous
n'avez pu vous dfendre d'une secrte horreur en voyant
approcher votre tour. Vous savez quelle main vous tes
44
niVAROL
destin (i). Mais je viole peut-tre votre secret : vous n'avez
jamais voulu convenir de toute votre affliction.
Fontenelle.
Puisque vous le voulez, ce n'est pas avec vous, messieurs
que je dissimulerai mes peines, et cette hypocrisie serait,
je crois, bien inutile, mais je voudrais vous faire convenir
que si TAcadmie nous proposait tous les ans une question
intressante, ou si elle donnait l'Elog-e historique de quel-
ques g'rands hommes, suivi de l'analyse de leurs ouvrages,
et d'observations sur la lang-ue, il en rsulterait en peu de
temps une collection qui aurait son prix. Les convulsions
oratoires et les moules uss du pang-yrique ne produisent
rien que de l'ennui. Saint Louis, pour avoir t tant lou,
n'en est ni mieux connu, ni plus estim. Il faudrait aussi
peut-tre que l'Acadmie franaise ft la seule dans le
royaume qui et le droit de proposer des Eloges, afin que
l'unit du prix lui donnt plus de concours et de solennit.
On ne saurait croire com^bien cette fourmilire d'acadmies
et de muses nuit au bon got et avance la ruine des let-
tres. Le feu sacr se trouve dispers entre trop de miains, et
chacun se fait un rite et une liturgie sa mode. Quand les
petites souverainets se multiplient dans un Etat, l'anarchie
est arrive. Il faudrait enfin que le secrtaire de TAcadmie
franaise ne ft occup que de la vritable gloire de sa com-
pagnie, bien sr en mme temps de travailler pour celle de
la nation et pour la sienne propre; tandis qu'au contraire,
semblable au pilote d'un vaisseau qui fait eau de toute part
ou, si vous l'aimez mieux, une araigne qui jette ses fils
dans toutes les antichambres de Paris, il croit ne pouvoir
exister qu' force d'art et de connaissance du monde.
Voltaire.
Hlas 1 mon cher Fontenelle, vous tes donc toujours le
mme. Laissez l vos pilotes et vos araignes. Adieu; je
m'aperois que vous me feriez passer mon ternit parler
d'acadmies.
(i) Dans lout cet alina Rivarol vise son ennemi littraire particulier
du moment, Dominique-Joseph Gart, dont les loees de Snger el de
Montausier
avaient remport,en
1779
et 1781,16
prix l'Acadmie fran-
aise
;
son Eloge de Fontenelle
(1784)
devait avoir le mme sort.
(Note de P. Malassis.)
LITTRATURE
45
La Motte.
Je suis bien fch que vous partiez, car j'avais un petit
morceau vous lire, en faveur des tragdies en prose et
des vers blancs.
Fontenelte.
Et moi j'allais vous proposer de nouveaux statuts pour
: 'Acadmie.
Voltaire.
Adieu, vous dis-je; il faut quitter les gens quand leur
marotte les prend. Allez, Fontenelle, parmi les Duclos, les
d'Olivet et les Trublet, causer sur votre chre acadmie,
pendant quelques milliers de sicles. Pourmoi,je vaistrou-
ver Sophocle, ^Horace et l'Arioste; c'est l toute lacadmie
qu'il me faut. Quant vous, La Motte, attendez, pour faire
votre lecture, la descente de quelques pauvres diables qui
font des drames pour l'Opra-comique
;
ou bien, informez-
vous d'un abb de Reyrac, qui faisait un hymne au soleil,
en prose, et en un gros volume. Il nous parlait de tout ce
que cet astre a vu depuis l'origine du monde; il prtendait
malicieusement faire ainsi tomber l'Encyclopdie : voustrou-
verez ici son me prosaque, moins qu'il ne soit mort tout
entier.
LE PETIT ALMANACH
DE NOS GRANDS HOMMES
1788
Quesli chi son, c'hanno coianiaorranza
Che dal modo degli altri gll disparte ?
Dame, Enfer, iv,
74.
Quelle est cette foule d'esprits que la gloire
Distingoie des autres enfants des hommes ?
AVIS SUR CETTE NOUVELLE EDITION, OU LETTRE D ADIEU
A NOS AMIS ET LECTEURS
La France ne rit plus, et la g'at franaise a pass comme
une ombre; cette heureuse rvolution a cot bien des
volumes, tandis qu'il n'et peut-tre fallu qu'un drame
pour rasseoir toute la nation. Mais enfin, on a appel de
TAngleterre la philosophie au secours de la nation fran-
aise. Grces en soient rendues aux crivains qui ont donn
notre lang-ue Vaccent an
g
lais, salon l'expression du Jour
nal de Paris, au sujet de feu M. le Tourneur!
Mais si la France est g-rave et srieuse, elle est tout aussi
calme. Les prtentions ont contract entre elles; les ranges
sont assig-ns
;
tout a son prix, et la plus aimable harmonie
rg-ne dans toute la littrature franaise.
Nous n'entreprendrons pas de dire par combien de degrs
il a fallu passer pour amener la nation cette svrit d'hu-
meur qui constitue la vritable dig-nit de l'homme, et nous
parat le sig-ne le plus certain de la flicit publique.
C'est dans cette disposition des esprits, dans cet accord
des caractres et dans cette transaction de tous les amours-
propres, que le petit Almanach de nos Grands Hommes
LlTrlWTUllF.
47
a paru; mais le titre a sembl si mesquin, le ton si futile,
notre air si frivole, que notre but est manqu. On a trouv
qu'en variant l'log-e avec autant de soin qu'on avait jus-
qu'ici vari la satire, nous aurions du naturellement cnor-
g-ueillir nos lus, et dsesprer ceux que nous rprouvions :
tandis que nous avons mdiocrement flatt nos Grands
Hommes, et que le livre a caus un rire universel qui nous
a tout fait humilis. C'est pour l'innocence le comble du
malheur que de causer du scandale. Aussi avons-nous reu
avis sur avis, reproche sur reproche,
menace sur menace :
on nous a traits avec colre, on nous a maltraits avec
esprit : nos mentions ont paru des traits de haine, nos omis-
sions des sig-nes de mpris. L'un nous accuse d'avoir che-
nill le Parnaase ;Vauire d'avoir fait asseoir plus d'un
Grand Homme aux bancs des nes. Il est contre les
murs et la dcence, nous crit-on, dfaire rire le monde.
Les larmes conviennent mieux la misrable espce
(( humaine. 11 vous tait si ais, nous dit-on, d'attrister vos
lecteurs sur toute la petite littrature dont vous faites
(( l'histoire! Pourquoi forcer le naturel de vos hros, et
contrarier le g-ot du public? Le monde est-il donc si gai,
et vos Briquet et vos Braquet sont-ils donc si plaisants?
M. l'abb Salles de la Salle, auteur d'une ode sur le
prince de Brunswick, a runi autour de lui M. de Fnmars,
qui prpare l'histoire secrte de la loge Olympique; M.Lan-
dreau de Maine-au-Pic, et UM. Robert et Roiizet, avo-
cats en trag-die : ils nous reprochent de les avoir oublis,
et se moquent cruellement de nous, en nous demandant si
nous connaissons la dernire charade de M. l'abb Dubosq,
Tnigme de M. Gillet du Coudraij, avocat, et le log-o-
gryphe de M. Lapleigna daCoudray?
Il est vrai qu'il se mle quelques fleurs tant d'pines :
on vient de nous annoncer un pamphlet in-folio,
crit avec
tout Vesprit de M. Manuel. C'est nous
promettre chre
de vilain : la colre met un avare en dpense, et c'est ainsi
qu'Aristote veut qu'on purg-e les passions les unes par les
autres.
Nous nous flattons que le public, en
faveur de nos inten-
tions, daii^rnera oublier jamais le petit Almanach, pour ne
se souvenir que des mille et une rponses qu'on
y
a faites,
et dont il n'et pas joui sans nous : car nous sommes en
48
RIVAROL
littrature la pierre aiguiser, qui ne coupe pas, mais qui
fait couper.
A. D. On n'a jamais lu un dictionnaire de suite, Tordre
alphabtique s'y oppose. Ainsi les personnes qui voudront
parcourir cette g^alerie (i) tout d'une haleine en seront bien-
tt punies, d'autant plus qu'il
y
a une foule de notices qui
ne sig-nifient rien
;
et ce sont les plus ressemblantes.
Ces expressions de /r<?s co/z/i, s/ con/, et autres de cette
espce, qui reviennent souvent dans ce rpertoire,
signi-
fient seulement, trs connu dans les liecueils, si connu
dans les Almanachs, dans les Muses, etc.
Adieu, chers amis et gnreux lecteurs.
A M. DE CAILHAVA DE L ESTANDOUX, PRESIDENT
DU GRAND MUSE DE PARIS
M. le Prsident,
Ce n'est pas sans la plus vive satisfaction que nous
vous ddions cet Almanach de tous les Grands Hommes
quifleurissent dans les Muses
(2)
depuis leur fondation
jusqu'en Van de grce ij88. Combien d'hommages n'en
avez-vous pas reus, soit en vers, soit en prose! car vous
n'tes pas comme les Rois de la terre, qui n'exigent de
leurs sujets que des tributs pcuniaires
;
votre trsor ne
s'emplit que d'opuscules lgers, de pices fugitives, d'im-
promptus et de chansons, et la plus grosse monnaie de
votre empire na jamaispass Vptre ddicatoire ; mais
sans nous, tous ces monuments de leur amour pour le
Muse et de leur got pour les lettres priraient sans
retour; et Von verrait tant de fleurs se faner
sur vos
autels/
Si rAlmanach Royal, seul livre o la vrit se trouve,
donne la plus haute ide des ressources d'un Etat qui
peut supporter tant de charges, croit-on que notre
Almanach puisse tre
indiffrent votre gloire et celle,
de la nation, quand on
y
prouve quun prsident de
Muse peut prlever plus de cent mille vers par an sur
(1)
De 65o noms environ. Nous en avons choisi quelque 200.
(2)
Petites acadmies potiques, cercles littraires.
LiTTRATune:
49
la Jeunesse Jranaise, et marcher dans la capitale la
tte de cinq ou six cents potes?
Notre Almanach sera pour eux le Hure de vie, puis-
que r/iomnie le plus inconnu rj recevra de nous un bre-
vet d'imniortalil. Il
y
a, dit-on, des chemins connus j)our
arriver rAcadmie, mais on n'en connat pas pour chap-
per au Muse. Ceci peut s appliquer notre Almanac/i :
nous ferons au plus modeste une douce violence, et l'on
ne verra plus tant d'crivains exposs ce cruel oubli
qui les gagne de leur vivant, ou ces quivoques plus
outrageantes encore, qui font qu'on les prend sans cesse
l'un pour l'autre. Feu Voltaire, dont vous avez peut-tre
ou parler, disait toujours, labL Suard et M. Arnaud;
et on avait beau lui reprsenter qu'il fallait dire
M. Suard et l'abb Arnaud, le vieillard s'obstinait, et ne
voulait pas changer les tiquettes, ni dranger pour eux
une case de son cerveau. Notre Almanach et prvenu
ce scandale, car sans doute l'auteur du pauvre Diable
nous aurait souvent consults.
Nous sommes avec un profond respect,
Monsieur le Prsident,
Vos trs humbles et trs
obissants serviteurs,
Les Rdacteurs de l'Almanach des
Grands Hommes.
POST-SCRIPTUM
Pour
faire
taire les mauvais propos de certains d-
tracteurs du vrai mrite, nous nous sommes propos de
faire connatre notre dsintressement, dont cependant
on ne nous souponne pas. Aprs avoir tir cle notre
libraire le meilleur parti de cet quitable ouvrage, nous
avons eu la dlicatesse de donner, sans presque rien
gagner, le supplment sparment en faveur des acqu-
reurs de la premire dition; ce qui prouvera notre
zle servir le public.
PREFACE
Il
y
a parmi les
cens
du monde certaines personnes qui
doivent toutle bonheur de leur vie leur rputation de e^ens
d'esprit, et toute leur rputation leur paresse. Toujours
spectateurs et jamais auteurs, lisant sans cesse et n'crivant
jamais, censeurs de tout et dispenss de rien produire, ils
deviennent des jueces trs redoutables; mais ils manquent
un peu de gnrosit. C'est sans doute un terrible avantag-e
que de
n'avoir rien fait, mais il ne faut pas en abuser.
J'coutais l'autre jour la conversation de trois ou quatre
de ces personnes, qui, lasses dparier du sicle de Louis XIV
et du sicle prsent, de tenir la balance entre Corneille et
Racine, entre Rousseau et Montesquieu, descendirent tout
coup de ces hauteurs, et pntrrent dans les plus petits
recoins de la rpublique des lettres. On s'chaulfa, et les
auteurs dont on parlait devenant toujours plus impercepti-
bles, on finit par faire des paris. Je gage, dit l'un, que je
pourrai vous citer tel ouvrage et tel crivain dont vous
n'avez jamais ou parler. Je vous le rendrai bien, rpon-
dit l'autre
;
et en effet ces messieurs se mettant dispu-
ter de petitesse et d'obscurit, on vit paratre sur la scne
une arme de Lilliputiens. Mrard de Saint-Just, Santerre
(( de Magni. Laus de Boissv, criait l'un; Joli de Saint-Just,
Pons de Verdun, Regnault de Beaucaron, criait l'autre.
Guinguen par-ci, Moutonnet, par-l, Briquet, Braquet,
Maribarou, Mony-Quitaine, et puis Grouvelle, et puis Ber-
quin, et puis Panis et puis Fallet; c'tait une rage, un tor-
rent : tout le monde tait partag
;
car ces messieurs parais-
saient avoir une artillerie bien monte; et soit en opposant,
soit en accouplant les petits auteurs, ils les balanaient assez
bien, et ne se jetaient gure la tte que des boulets d'un
calibre gal : de sorte que de citations en citations, tant
d'auteurs exigus auraient fini par chapper aux prises de
l'auditeur le plus attentif, si l'assemble n'avait mieux aim
croire que ces messieurs plaisantaient et n'allguaient que
des noms sans ralit. Mais les deux antagonistes, choqus
de cette opinion, se rallirent et se mirent parier contre
l'assemble. Oui, Messieurs, je vous soutiens qu'il existe
(( un crivain, nomm M. Lvrier de Charnprion ; un au-
tre qui s'apple Delormel de laRotire; un autre Gabiot
i.i ri>:n\iunE
5l
de Salins
;
un autre bi Bastier de Doienroai-t ; un autre
Doigni du Ponceaii; un autre Philipon de la Made-
(( leine
;
et si vous me poussez, je vous citerai M. Groubert
de Grouhental, M. Fcnouillot de Falbaire de Quingei,
et
M. Thomas Minau de la Mistring-ue. A ces mots on
clata de lire
;
mais le discoureur sortit de sa poche trois
opuscules, l'un sur la finance, l'autre sur rimp<j|, et l'autre
sur le drame, qui prouvaient bien que MM. Groubert de
Groubental, Fenouillot de Falbaire de Quinei, et Tliomas
Minau de la Mistrin^ue n'taient pas des tres de raison.
Pour moi, auditeur bnvole, frapp de la riche nomen-
clature de tant d'crivains inconnus, je ne pus me dfendre
d'une rflexion que je communiquai mes voisins, et qui,
ffag-nant de proche en proch<', fit luentt chang-er l'tat de
la question. N'est-ce pas, leur disais-je, une chose bien
trang-e et bien humiliante j)our l'espce humaine, que cette
manie des historiens de ne citer qu'une douzaine tout au
plus de grands crivains, dans les sicles les plus brillants,
tels que ceux d'Alexandre, d'Auguste, des Mdicis ou de
Louis XIV? N'est-ce pas donner la nature je ne sais quel
air d'avarice ou d'indigence? Le peuple qui n'entend nom
mer que cinq ou six Grands Hommes par sicle est tent
de croire que la providence n'est qu'une martre
;
tandis que
si on proclamait le nom de tout ce qui crit, on ne verrait
plus dans elle qu'une mre inpuisable et tendre, toujours
quitte envers nous, soit par la qualit, soit par la quantit;
et si j'crivais l'histoire naturelle, croyez-vous que je ne cite-
rais que les lphants, les rhinocros et les baleines? Non,
Messieurs, je descendrais avec plaisir de ces colosses impo-
sants aux plus petits animalcules; et vous sentiriez s'accro-
tre et s'attendrir votre admiration pour la nature, quand
j'arriverais avec vous cette foule innombrable de familles,
de tribus, de nations, de rpubliques et d'empires, cachs
sous un brin d'herbe.
C'est donc faute d'avoir fait une si heureuse observation
que l'Histoire de l'esprit humain n'ofire, dans sa mesquine
Serspective,
que d'arides dserts, o s'lvent de g-randes
istances quelques bustes outrag-s par le temps, et consa-
crs par l'envie, qui les oppose sans cesse aux Grands Hom-
mes naissants, et les reprsente toujours isols, comme si la
nature n'avait pas fait crotre autour d'Euripide, de Sopho-
cle et d'Homre, princes de la trag-die et de l'Epope, une
foule de petits potes, qui vivaient frug'alement de la
charade et du madrig-al; ainsi qu'elle fait monter la
mousse et le lierre autour des chnes et des ormeaux; ou,
comme dans TEcriture-Sainte, on voit aprs les grands
prophtes paratre leur tour les petits prophtes? Ne
doit-on pas frmir quand on sonare que, sans une lgcre
attention de la part de Virg-ile et d'Horace, Bavius et M-
vius seraient inconnus; et que, sans Molire et Boileau. on
irnorerait l'existence de Perrin, de Linire et de quelques
autres? Enfin, que ne dirais-je pas des soins que s"est don-
ns l'infatig'able Voltaire pour dterrer et pour classer dan>
ses uvres ses plus petits contemporains! Il est temps de
corrig"er une telle injustice; et pour n'tre plus expos des
pertes si douloureuses, je pense qu'il faudrait, par un r-
f)ertoire
exact de tous les hommes qui pullulent dans notre
ittrature, depuis l'niqrme jusqu' l'acrostiche, depuis la
charade jusqu'au bouquet Iris, justifier la nature, et, dis-
putant tant de noms l'oubli, montrer la fois nos trsors
et sa maernificence.
L'assemble g-ota cet honnte projet, et nous rsolm.es
d'lever frais communs un monument l'honneur de tous
les crivains inconnus, c'est--dire, de ceux qui ne sont
jamais sortis de nos petits Recueils. On convint de donner
ce monument le nom e petit Almanach de nos Grands
Hommes, ahn de les veng-er, par cette pithte, de la manie
de ceux qui ne jug-ent d'un homme que sur l'importance de
ses ouvrag-es; car j'avoue en mon particulier que j'estime
autant celui qui n'a fait en sa vie qu'un bilboquet d'ivoire,
que Phidias levant son Jupiter Olympien, ou Pigalle scul-
ptant le marchal de Saxe. In ienui labor.
Cet Almanach paratra chaque anne; et afin que la
nation puisse jug"er de notre exactitude, le rdacteur, arm
d'un microscope, parcourra les Recueils les moins connus,
les Muses les plus cachs, et les socits les plus obscures
de Paris : nous nous flattons que rien ne lui chappera. On
invite tout homme qui aura laiss tomber son nom au bas
du moindre couplet, soit dans les journaux de Paris, soit
dans les affiches de province, nous envoyer des renseig"ne-
ments certains sur sa personne
;
nous recevrons tout avec
reconnaissance, et, selonnotre plan, les articles les pluslong-s
LITTERATURE 53
seront consacres ceux qui auront le moins crit. Un vers,
un seul hmistiche suffira, pourvu qu'il soit sig-n; un com-
pliment, un placet, un mot seront de g-rands titres nos
yeux. C'est amsi que M. d'Aquin de Chteau-Lion est par-
venu faire de sesEtrennes d'Apollon l'ouvrage le plus im-
portant qui existe. Mais nous nous flattons de le surpasser
tientt, et de faire pour lui ce que sa modestie ne lui a pas
permis, et ce que vraisemblablement il ne pourra nous ren-
dre, en lui donnant une place trs honorable dans notre
Almanach.
Au reste, les vtrans de la petite littrature, tels que M. le
chevalier de Palmezeaux, Caron de Beaumarchais, Blin de
Saint-Maur, d'Arnaud de Baculard, etc., nous pardonneront
s'ils ne se trouvent, pour ainsi dire, traits qu'en passant
dans notre Almanach, et si de jeunes inconnus obtiennent
de nous des prfrences marques. Ce n'est pas que nous
ayons prtendu manquer ce que nous devons aux pre-
miers, en affichant notre prdilection pour les autres
;
mais
nous avons cru qu'il tait bien juste d'encourager les jeunes
gens plongs dans les eaux de l'oubli, d'o les autres se sont
un peu dgags, non par leurs uvres, mais par leur ge :
car on sait qu' force de siei'ner priodiquement son nom de
journal en journal, et d'envoyer au Mercure des certificats
de vie, on finit par dompter le public, mais on perd des
droits notre Almanach.
Les gens de lettres qui auront t oublis pourront se
faire inscrire notre petit bureau, qui sera ouvert toute
heure au Palais-Royal. On n'exigera qu'un sou par tte, afin
qu'on ne nous accuse pas d'avoir estim les objets au-des-
sus de leur valeur.
p. s. Comme on travaillait l'impression de cet ou-
vrage, quelques personnes blanchies dans les lettres, et
dont nous avions dj class les noms, sont venues nous
prier de ne pas leur
faire cet honneur. lYous nous som-
mes opposs leur modestie
;
mais elles ont insist, et
ont prtendu cru une simple mention pouvait les blesser.
Comme cet Almanach n'est qu'une nomenclature, nous
leur avons demand comment on pouvait dsoler un
homme, en lui prouvant quil existait rellement, et le
blesser en ne lui disant pas plus haut que son nom ? Ces
personnes ont soutenu que la chose tait possible, puis-
54
RIVAHOL
quelles l prouvaient. Cette querelle nous a d'autant
plus surpris quil est survenu en ce moment un jeune
homme qui a demand d'tre inscrit, en disant : vous
devez me connatre Nous n avons pas dissimul notre
ignorance. Comment, s'est-il cri, vous ne me connaissez
pas ! Et qu" faut-il donc faire pour tre connu? Je n'ai que
dix-huit ans, et j'ai dj fait trente petites ptres dans le
Mercure, mille couplets, cent nig-mes; je fournis la fugitive
tous les journaux, et je sig-ne toujours. Cette double que-
relle nous a jets dans la plus tjrande perplexit : Cun
se
fche
parce que nous avons dcouvert son existence;
l'autre parce que nous ne l'avons pas souponne f...
Mais il
faut
que le service public passe avant tout, et
nous avons procd l'impression.
LE PETIT ALMANACH DE NOS GRANDS HOMMES
Di^ ifjnolls.
A
ALTBERT (m.), de Villefrauche, en Haute-Guienne. Nous
avons reu de cet auteur une fable, qui est capable de faire
une rvolution dans la littrature, si on adopte sa manire,
comme on ne saurait trop le dsirer. Cet auteur fleurit en
province. Quel dommag-e! Puisse le juste tribut d'loges
que nous lui payons Ten^ager venir dans la capitale
y
remplir toute sa destine I Paris ne s'enrichit qu'en dpouil-
lant les provinces.
ALIX (m.), jeune avocat, dont une foule de pices fugiti-
ves, rpandues dans tous les journaux, n'ont encore pu
mettre au jour tout le mrite. Nous avons long-temps cher-
ch la cause de l'obscurit dont il jouit, et force de soins,
nous avons enfin trouv un pome en quatre chants, sur les
quatre ges de l'homme, qui nous a paru la pice coupable
par les beauts dont il tincelle, et qui auront jamais irrit
l'envie contre l'auteur. L'envie qui parle et qui crie est tou-
jours maladroite; c'est l'envie qui se tat qu'on doit crain-
dre. Or jamais pome ne l'prouva mieux que celui-ci. Il
s'est fait comme un concert de muets dans toute la littra-
ture, l'apparition de ce pome. Un tel silence est souvent
de bon augure; mais il ne faut pas qu'il se soutienne.
LlTlBHVTURi: 55
ALLioT (m.), auteur du Muet par Amour. C'est une des
mille et une pices qui font les dlices des socits. Mais les
gens du monde sont de si parfaits ^ostes qu'ils exii^'-ent
souvent d'un auteur que tel ouvrai^e qui leur a plu ne pa-
ratra jamais.
ALCo (M. le Prsident d'). Les stances et les madrigaux
?[ue ce favori des Muses a tirs de son porte-feuille nous
ont bien regretter qu'il en soit trop avare. Les couleurs de
ce pote sont si douces qu'il semble n'avoir travaille que
pour des yeux malades qui craignent le grand jour; ce qui
lui a donn de nombreux partisans dans un sicle justement
dgot de la haute posie.
ANGENY (m. d'). Ce pote russit parfaitement dans les
pices gasconnes. Ce genre n'est pas facile manier, mais
c'est un excellent exercice, et il est ais de reconnatre un
crivain qui s'y est rompu. Il existe de cet auteur une tirade
de vers, qu'il adresse un de ses amis, pour le punir d'avoir
fui le mariage. On ne saurait faire un plus digne usage de
la posie que de la diriger contre les clibataires.
ANDR HONOR (m.). Ses chausons, trop clairsemes dans
nos Almanachs chantants, en ont toujours fait la fortune.
Cet Anacron a jet deux nouveaux couplets dans les recueils
de cette anne, l'un adress quelques jeunes dames, et
l'autre sa propre fille. Les couplets sont signs : M. Andr
ne peut les nier, et quel est le plagiaire qui oserait se les
attribuer ?
ANDR DE MURViLLE (m.). Ce potc fugitif cst si fertile que
nous ne pouvons qu'indiquer ses talents et son nom. Ode,
pitre, quatrains, chansons, rien n'est l'abri de son acti-
vit, et l'admiration et la reconnaissance ont peine avec
lui le temps de respirer. Le Recueil de ses uvres sera un
jour d'un grand poids da^.s la littrature lgre.
ANDRiEux (m.). Les beauts trop dlicates de ses petits
vers ont chapp jusr u'ici aux yeux vulgaires : mais l'ex-
trme naturel de cer vers-ci aurait d frapper tout le monde :
Le feu cer endant clate;
J'entendt' le grillon crier
;
Le chat nent pour qu'on le flatte,
Et joue autour du foyer.
Voil la belle nature et la vritable posie : un seul couplet
56
RIVAROL
de cette force peut arrter la dcadence des arts. Voyez aussi
les stances du mme auteur sur la jeunesse.
AQUiN DE CHATEAU-LION (m. d'). Tout le Hionde connat son
Recueil charmant, intitul, Almanach Littraire ouEtren-
nes d'Apollon. Ce sont de ces livres qui la longue donnent
la France une supriorit dcide sur tous ses voisins.
ARNAUD DE BACULARD (m.). Nous ue disous ricu de cet
anctre de la littrature moderne : la probit de ses vers et
l'honntet de sa prose sont connues.
ARNAULT (m.). Cet crivaiu s'est si bien drob nos
recherches^ que nous n'osons rien affirmer de lui, si ce n'est
son existence. Nous en demandons bien humblement par-
don au public impatient de connatre cet auteur et ses pro-
ductions; mais les affiches de Grenoble nous ont manqu.
Nous promettons de rparer cette omission l'anne prochaine,
et nous nous flattons de satisfaire la foule de Souscripteurs
que cet espoir va sans doute nous procurer.
AVESNE (m. d'j. Cet aimable paresseux a rjoui l'Almanach
des Muses
1781,
d'une pice pleine de g-ot et de gat. Elle
est intitule, Tribunal cTArcadie ; on
y
tient Conseil
d'Anerie ;
l'auteur fait dire des choses admirables un cuir
pel d'asine douairire. Nous croyons que cette fable au-
rait donn du chagrin La Fontaine, et nous ne saurions
trop exciter la jeunesse saisir le bon ton, et le grand sens
de cet crivain.
AVY* (m. l'abb). Nous n'avons encore obtenu que la
moiti du nom de cet auteur
;
mais nous avons une pice
entire de vers de sa faon, intitule : le Nouvelliste aux
Champs-Elyses. Ce jeune abb est comme cette statue
mystrieuse des Egyptiens, qui laissait tomber un de ses
voiles tous les ans. Ceux qui ont le bonheur de le connatre
par son nom nous ont assur que nous n'avions pas plus de
quatre ans attendre, parce que M. l'abb laisse paratre
chaque anne une lettre de plus: il tait A*** en
1786,
Av'*
en
1786,
il est Avy* en
1787.
L'impatience que nous donne
l'incroyable dsir de le connatre est un des grands dsa-
grments de notre tat.
BABLOT (m.). Il
y
a d'normes paris sur cet crivain
;
il
existe pour les uns, il n'existe pas pour les autres. Mais nous
LITTRATURE
67
avons fait des recherches si srieuses sur ce problme int-
ressant que nous sommes parvenus dcouvrir que M. Bab-
lot tait, comme Apollon, pote et mdecin. Il a chant les
austres plaisirs du mariag-e, et voici quatre vers de ce doc-
teur :
Ah ! pourrais-lu douter de mon amour encore ?
Cher amant, me dis-tu, je t'aime, je t'adore :
Ouai-je dit : je i'adore! laissons sur ces ja^rands mots
Grimper l'amour charnel : ce sont l ses trteaux.
BAiLLY(M.).On ne peut rien ajouter aux charmes de cette
muse : seulement peut-on lui reprocher un peu de paresse.
Nous n'avons g-ure trouv plus de cent pices de cet auteur
dans les diffrents journaux.
BARBIER (m.). Auteur de Ciaxare, tra^-die, joue en
socit, et qu'on a eu la cruaut d'y retenir. La nation a, selon
nos calculs, plus de mille drames revendiquer sur les
socits de Paris.
BARR (m.), un de ces esprits faciles, corrects et g-ra-
cieuxque la nature produit quelquefois pour le bonheur des
grosses villes affames de nouveauts. Des Gomtres fort
modrs ont calcul que M. Barr, indpendamment de
M. Piis, pouvait fournir des pices tous les petits thtres
de la capitale; et que, runis tous deux, ils pouvaient faire
demander grce la nation la plus amoureuse des specta-
cles. On ne sait que citer d'un crivain que tout le monde
sait par cur. Pourrait-on oublier en effet ce couplet char-
mant qu'il adresse une dame, en lui envoyant un cur de
sucre, et qui finit par ces deux vers, qui ont fait pmer tout
Paris
:
Mon ciu*, craignant pareille chance,
S'alla faire sucre d'avance.
BARSiN ou BARCiN (m.). Son odc sur l'armement de la
France et de l'Espag-ne parut dans des circonstances fort
heureuses
;
mais elle eut des suites funestes pour l'Europe :
car l'clat extraordinaire de ce pome ayant fix tous les
yeux, les affaires des puissances belli2;-rantes ne firent plus
que lang-uir. C'est donc manquer de patriotisme que de faire
de trop beaux vers dans certaines occasions.
58
RIVAROL
BARTHE (m. l'abb), de la socit Anacrconlique
d'Arras,
excessivement connu par une fable sur deux carrosses.
Les
propos que se tiennent ces deux carrosses sont prodigieux
:
il n
y
a gure dans toute la littrature que les chevaux
d'A-
chille qui soient dij^nes de converser avec les carrosses de
M.
l'abb Barthe. Voyez l'Iliade.
BAUDART ou BODART (m.), gnic prcocc qui vient de don-
ner les Saturnales aux Varits. On sait que, pendant les
Saturnales, les valets taient les matres. M. Bodart sem-
ble avoir pressenti et prvenu notre travail : car nous ne
faisons ici que les Saturnales de la littrature.
MM. BOCOUET, BOREL, LE BUF, BEAUNOIR DE ROBINEAU, BRU-
NET, LE BLANC (l'abbj, BLIARD, BASTIDE, BURY, BILLARD,
BOUTTROUX, BONNEL, BRUIX (le chev. dc), BOISTEL, BP.UTEL
DE CHAMPLEVART, BURSAY, BOUTEILLIER, BREVET DE BEAU-
JOUR
;
Voil dix-huit auteurs dramatiques, tous marqus la
lettre B, et qui brillent sur le Parnasse franais comme une
constellation dont la douce influence fconde tous nos th-
tres. Opra, tragdie, comdie, farce, drame, proverbe, rien
n'chappe leurs regards bienfaisants. Mais tout ainsi que
les toiles semes avec tant de profusion dans la voie lacte
se nuisent mutuellement et ne forment qu'une masse de
lumire qui ne laisse distineruer aucun astre en particulier,
de mme sommes-nous forcs d'avouer que tous ces auteurs,
dont chacun part serait un vrai soleil, sont absolument
invisibles sur l'horizon de notre capitale. Mais nous sup-
plions instamment le lecteur de ne pas traiter avec cette
barbare indiffrence dix-huit grands hommes : nous le
conjurons au contraire (et nous l'en conjurons genoux et
la larme l'il) de se faire l'etFort de classer dans sa m-
moire ces dix-huit noms : la peine de les retenir n'galera
jamais celle que nous avons eue les trouver.
BEAUMiER (m.), uu des plus grands crivains de ce sicle
en vers et en prose. Nous ne citerons rien de cet illustre
auteur; car, pour fruit de nos labeurs, nous exigeons cette
fois que le lecteur nous en croie sur notre serment. Voyez
pourtant son livre, intitul : A ma Patrie, Qld\ M.Ducis.
BEAUGEARD DE MARSEILLE (m.). Ce pote n'a fait qu'un
petit conte, intitul : les deux Neuvaines, qu'il a fait pas-
LITTRATURE
Sq
ser Paris; c'est un g-ant qui donne le bout de son ong-le
pour mesure de tout son corps, et qui est devin.
beaulaton (m.). Sa traduction de Milton et fait oublier
le Paradis perdu, si on avait su la lire; mais ce sicle est
si fou, si rapidement emport dans la sphre de ses frivo-
lits, qu'il lui passe sous les jeux deux ou trois mille chefs-
d'uvre par an, sans qu'il en soit averti. Ah! que le si-
cle de Louis XIV paratrait pitovable, si on songeait tout
ce que nous possdons, sans savoir en jouir! Voici quelques
vers de M. Beaulaton,pourjustifier nos regrets. C'est Satan
qui s'avance vers le paradis terrestre :
Tel Satan travers vaux, monts, rocs, lacs, bois, prs.
Fait route de la tte, et des mains et des pieds,
Marche, vole, bondit, plonge, serpente, nage, etc.
Quel dommage de gaspiller ce style faire des traduc-
tions!
BEAUMARCHAIS. VoJjeZ M. GUDIN DE LA BKUNELLERIE.
BRARDiER DE BATTANT (m. l'abb) a traduit Lucrce en
vers franais; il est parvenu, selon son louable but, tein-
dre ce pote, le plus dangereux de l'antiquit; et c'est ainsi
qu'il faut traduire tous ces athes.
BEFFROY DE REiGNY (m. de), si conuu SOUS le nom de Cou-
sin Jacques. Ses Lunes sont une de ces productions origi-
nales auxquelles on ne peut rien comparer : elles font le
bonheur de la nation franaise; mais, comme le Cousin
Jacques peut nous manquer un jour, tout immortel qu'il
est, nous ne voyons pas sans frmir l'tat de langueur et de
\ tristesse o la France va tomber, quand il faudra se sevrer
I
de tant d'aimables folies. Nous conseillons donc nos
i lecteurs de renoncer peu h peu cette sirne qui les
I
enchante et les dgote des dialogues de Lucien, des facties
de Voltaire, des badinages de Gresset et de Swift; c'est
sous ce point de vue que le Monius franais
est vraiment
dangereux.
BRENGER (m.), Ic plus doux, Ic plus riclic ct Ic plus infa-
tigable des tributaires de tous les journaux. Pour parler
dignement de lui, il faudrait parler de tout, et la vie est
courte.
BEROuiN (m.), aprs avoir t le pote des nourrices, a voulu
devenir le philosophe de l'enfance, et s'est intitul : l'Ami
60
UIVAROL
des Enfants.
L'Allemag-ne lui a fourni cet ouvrag-e priodi^
que dont il nous a fait prsent. Cette traduction lui a valu
toute notre reconnaissance
;
mais elle nous a cot un pome
pique dont M. Berquin tait fort capable, et c'est trop cher.
BoisjOLiN (m. Vielch de). Il est sorti tout coup de l'ai-
mable obscurit o sa modeste muse le retenait, par un tour
de force qui a fait trembler toute la littrature. Ayant choisi
le Mercure pour champ de bataille, il a pris l'Art potique
d'une main, et le pome des Jardins de l'autre
;
et les ayant
balancs quelque temps, il a mis tout coup le pome des
Jardins dessus, et l'Art potique dessous, aux acclamations
de tous les g-ens de got
;
il n'y a que M. l'abb Delille qui
ait paru scandalis.
BOizARD (m.). Ses fables ont fait passer de mode celles de
la Fontaine; ce qui est toujours un peu injuste : on aurait
d conserver la Fontaine en acqurant M. Boizard, et ne
pas perdre l'ancien fabuliste, sous prtexte de faire un plus
beau sort au moderne : enfin, il
y
avait des arrangements
prendre, et nous osons croire que M. Boizard s'y serait
prt.
BOULOGNE et DE BUGEY (mm. de), tous deux fort estims
par une pigramme et six vers lg-iaques. On pourrait leur
faire les plus tendres reproches sur leur paresse.
BouRiGNON (m.), de Saintes. Ses posies fug-itives ont fait
une telle sensation Paris, que nous nous croyons suffisam-
ment autoriss le presser d'habiter une capitale o sa
ffloire l'a prcd. Notre invitation ne peut que dplaire
la Saintong-e qui sera appauvrie, si M. Bourig-non la quitte;
et aux beaux esprits de la capitale qui seront jaloux, si
M. Bourignon arrive : mais qu'importe?
BONNiER DE LAYENS (m.). Le nom seul de M. Bonnier de
Layens entrane avec lui les ides les plus sduisantes : il
rappelle les noms de Chaulieu,de Gresset,de Voltaire, dans
la fugitive. Il nous faudrait le pinceau de l'Albane, pour
tracer une esquisse digne de cet aimable chantre
;
mais ne
ayant pas, nous renvoyons aux recueils du temps, o nos
lecteurs pourront rencontrer l'pitaphe d'un chien et deux
quatrains, qui justifient bien notre silence.
BIENVENU et BiENNOURRi (mm.), de Bordeaux, auteurs du
Thtre la mode. Autrefois les grands talents taient un
peu orageux : on n'tait jamais avec eux bien sr d'avoir
LITTRATURE 6l
la paix
;
Racine et Molire ne surent pas s'accorder. Mais
qu il est doux de voir marcher de front dans la mme car-
rire deux hommes tels que MM. Bienvenu et Biennourri !
BRiouET et BRAQUET (mm.). Il Semble que la Providence
veuille confirmer elle-mme, par les dcouvertes qu'elle nous
laisse faire, ce que nous avons dit plus haut de l'amiti des
Fens
de; lettres. Briqut-t et Braquet, noms consacrs
harmonie, et faits pour le charme ternel des oreilles sen-
sibles ! malheur qui voudra vous dsunir I Les Oreste et
les Pylade, qui s'immolaient l'un pour l'autre, ne se cdaient
que la vie
;
mais vous, combien d'hmistiches ne vous tes-
vous pas donns mutuellement! Et c'est bien autre chose
que la vie. Les gens du monde ne saisiront jamais bien ce
g-enre d'hrosme.
BRUxXEL (m.) a fait environ quatre-ving-ts pices de vers
en diflerents journaux, et notamment une Idylle d'un seul
vers que voici :
Ne serjns-nous jamais contents de notre sort?
Ce sont l de ces vers de rsultat qui contiennent une
foule d'ides en g-erme, et ne laissent rien dire la post-
rit.
BRUTE (m. l'abb). On sait quel bruit fit dans le temps son
ptre sa sur, o il dit, en parlant de Racine et de Rous-
seau :
Le charme de leurs vers sublimes et parfaits
M'inspire la fureur d'en forger de mauvais.
CAiGNiEz (m.). Une seule Chanson, dans les Etrennes
lyriques, lui a fait un nom qui ne mourra jamais, quand
mme cet auteur voudrait un jour renoncer sa gloire. Le
pas est fait; et cet avertissement regarde tous ceux dont les
noms sont tombs dans nos Almanachs, et ont t relevs
dans celui-ci. Si jamais la philosophie les dgotait de leur
clbrit, ils en seraient rduits, comme Calypso, pleurer
du malheur d'tre immortels. Au reste, on se console de
tout avec les vers suivants, tirs de la Chanson de M. Cai-
gniez :
Vnus alors dormait profondment :
4
62
niVAROL
Enfin l'Amour est auprs d'elle
;
Dors-tu, maman ? lui dit-il, mais bien bas, etc.
c.uLLEAU (m.), imprimeur-libraire Paris, qui n'a point
perdu son temps comme les Estienne,les Plantin et les Elz-
virs. On a de lui un recueil de Posies lg-res, o l'on a
surtout remarqu une rponse d'Abailard Hlose, qui,
selon la louable intention du pote, aurait sans doute dli-
vr cette femme clbre du fol amour qui la possdait. Le
San--froid de cette rponse, qui contraste merveilleusement
avec la chaleur de la Lettre de Pope, la sobrit d'expres-
sions et de posie, tout
y
est un effet de l'art
;
mais cette
maie n'appartient qu'aux grands matres
;
et ce n'est que
dans les mains de ^L Cailleau qu'Apollon devient un Abai-
lard.
CAiLLiREs DE l'tang (m.), avocat. Cc paisible citoyen
avant, par mg-arde et dans un moment de loisir, poli une
(3de sur je ne sais quel gnral Sudois,
y
mit son insu
tant de posie, il
y
dcela un talent si prodigieux que,
depuis cette poque, il n'est plus le matre d'un seul de ses
moments. Son cabinet, ses correspondances et sa personne,
tout est aux Muses, et les Lois ont pleurer ce beaii gnie
que la littrature leur enlve.
CAMILLE LEFEBURE (m.), de l'Isle de France, si connu par
son Quatrain sur Zelmire.
CARBON DE FLiNS DES OLIVIERS (m.), Conseiller la cour
des Monnaies. Jeune homme inconnu par une foule de pi-
ces du plus haut g-enre, et que l'Acadmie Franaise a men
tionnes en vain dans ses concours : M. Flins des Oliviers
en est rest aussi obscur que s'il avait eu le prix.
CARCN DU CHANSET (m.) a bien ddommag-M. de Rocham-
beau de toutes les fatig-ues de la guerre d'Amrique, par le
beau pome intitul la double Victoire, qu'il lui a ddi.
Tous les chevaliers deCincinnatusle savent par cur. Voici
quatre beaux vers de ce pome :
Dix mille prisonniers, en nous rendant les armes,
De Glocester, d'Yorck, bannissent les alarmes;
Et pour les mieux soustraire leurs adversits.
Nous remettent les clefs de ces fortes cits.
CARBOXEL (m.) a fait une fable intitule le Lis, ou le Rve
d'un Roi. Que ne peuvent deux lig-nes bien crites, et com-
I.ITTr\ATURE
63
bien aisment un pote donne sa mesure! M. Garbonel,
par
une seule fable, a t mis tout d'une voix ct de M. Boi-
zard.
CARRA (m.), un des plus colriques et des plus
loquents
orateurs de ce sicle. Aprs avoir crit quinze ou seize
voliimesde physique, sur / A/ome,/'^/)a/o/?ze et l'Exaionie^
que tout le monde sait par cur, il n'a pas ddain de
tomber sur M. de Galonn. Arm de tous les foudres de
l'loquence, il a port le dernier coup au lion mourant.
CARRIRE d'oisin (m.), illustrc auteur des Folies du Lord
rprimes, pice dont le public ne peut se lasser, puisqu'on
ne la joue jamais.
CASiMm-vARON (m.), cHvain paresseux, mais plein de
g-rces : c'est le seul qui ait su mettre du sentiment dans les
nig"mes et dans les acrostiches, g-enre toujours un peu sec.
CARMiLioLE (m. l'abb) a traduit la Thbade. Le prodi-
eux succs de cet ouvrag-e a d'abord entran une foule
e jeunes crivains vers la traduction
;
genre qui nous cote
chaque anne bien des ouvrag'es orig-inaux. Ensuite, cette
traduction tant fort la mode, on ne lit presque plus le
texte, et Stace en est moins connu.
CASTOR et cosTARD (mm,). Ges deux grands potes se res-
semblent si prodisrieusement que la peine que se donne le
lecteur pour les distinguer nuit beaucoup au plaisir qu'ils
font tous deux. Il faudrait trouver quelque moyen plus puis-
sant encore que leur sig-nature, pour les sparer
;
car les
almanachs les confondent souvent : on pourrait, par
exemple, leur proposer les doubles et les triples noms qui
sont tant la mode, et dont la renomme se charge avec
tant de plaisir. Voyez jNDI. IMarsollier des Vivetires, Lu-
neau de Boisjermain, Fenouillot de Falbaire de Quingej^
etc. Tous ces Messieurs ont craint d'tre confondus avec des
Marsollier et des Luneau ou des Fenouillot tout court : si
bien que, par cette prcaution, la Fienomme n'a plus de
prtexte avec eux, et ne peut leur manquer, sans tre inex-
cusable.
.
CERCEAU (xM.), auteur de l'Hrode intitule : Didon a
Ene. Le pathtique de ce petit pome est au-dessus de
toute expression. Qui pourrait retenir ses larmes aux vers
que prononce cette reine infortune, quand elle dit son
hros :
64
Des horreurs del mer et des soins du trpas,
Tu montes sur mon Ht et passes dans mes bras, etc.
CHATEAU DE LA ROCHEBARON (M.).Qiielques-unes de ses po-
sies ont t imprimes avec celles de M. Bernard, e:aron de
la chambre de Mo^'le comte d'Artois. Le Recueil est intitul :
Prludes potiques. Mais, n'en dplaise leur modestie,
c'est bien un vritable concert.
couRNAND (m. l'abb), professeur, harangua l'assemble
en vers trissyllabiques. Ces vers nains, trs propres
rendre les ides de cet illustre abb, charmrent tout le
monde (i). On nomma pour aumnier dom
cossEPH DE usTARiz, moiue basque, de la plus haute rpu-
tation. Il parla beaucoup de Baruch, et monta la tte tout
son auditoire, d'autant qu'on ne le comprenait pas beaucoup.
L'obscurit dispense de la profondeur, et n'occupe pas moins
les esprits : elle est sur de la majest, et l'loquence ne
peut s'en passer. Aprs cette promotion, on enregistra les
frands
hommes par ordre alphabtique, et voici la liste
dle
(2)
qui nous fut communiqu'?'.
CLAiRFONTAiNE (m. Daue de), pote dont les chansons
seraient des hymnes et des odes au besoin.
COLLOT d'herbois (m.), infatigable au thtre, et matre
absolu des passions. Voyez ses pices.
coMPAi:,- (M.), esprit universel, et qui dispenserait lui seul
de tous ses collgues.
CONJON (m.), de Baveux, si recherch pour le triolet.
CONTANT d'orvillb, l'cspoir du madrigal.
coouELiN (m.), auteur d'une ode ^L le duc de Chartres.
On ne peut rien extraire d'un tout parfait.
CROisETTiERE (m.), dc l'acadmic de la Rochelle. Ses cou-
plets .sa femme sont un vrai modle : tout y est.
GRiGNON d'anzouel (m.). Sa chanson du lendemain e.sl
celle de tous los jours, pour un homme de got.
CRUX, DE METZ (m.). Sa chanson pastorale a t traduite
dans toutes les langues, et fut chante en chorus par tous
les grands hommes su.snomms. Comme ras.semble se
sparait, on s'aperut de l'absence de MM.
(i) Il s'ait d'une sance dans un muse . L'pisode, un peu tra-
nant, a d tre court.
(j) Xous la dinoinuoDS de beaucoup.
littaatl;re 65
cuBiRES (le clievalicr de)- Voyez M, le cluvaier de Pal-
mezeaux.
cuiNET d'orbeil, poctc, sans lequel on ne peut concevoir
un Recueil. Il rentra au moment o chacun se plaig-nait de
sa disparition et ramena cinq potes oublis dans le dnom-
rement, et dont les noms ne mourront jamais. C'-
taient MM.
ARAIGNON, BUTINI, d'aRRAGON DE VERSAILLES, M. l'abb DU
BARRAL, et M. l'abb amphoux, de Marseille. Ils furent reus
avec acclamation
;
et M. Cuinet d'Orbeil, qui improvisa sur
eux, laissa clia])por des beauts sans nombre. Il fit une
allusion trs fine la fortune de ces deux abbs, dans le
distique suivant :
Tantt par des abus, lantt par des abbs,
Les revenus du roi sont toujours absorbs.
M. l'abb Cournand
y
trouva des longueurs
;
mais il fut
accus de jalousie.
DAURioL DE LAURAGUEL (m. l'abb) ajantjct, jeune encore
et sans trop prvoir les inconvnients de la gloire, une
pttre son pole^ dans les papiers publics, il n'a pu se
refuser la proposition qui lui a t faite de la part de toute
la littrature. On a dsir de se rassembler tous les soirs
autour d'un Pole qui inspire de si beaux vers, et le cabinet
de M. l'abb est devenu le club littraire le plus brillant de
la capitale.
DAiLLANT DE LA TOUCHE (m.), potc auxiliairc, sans lequel
plus d'un Recueil serait dj
mort d'inanition. Ses vers sont
d'une bonne force, et conviennent tous les gots.
DAMAS (m.) est parti du distique pour arriver l'ptre, il
y
a quelques annes : il en est dj la chanson, et tout le
monde fait des vux pour lui.
d'aIX DE BUFFARDIN OU BUFFAIUDIN d'aLX (M.).SeS Cpigram-
mes font honneur son cur.
DELiLLE (m.). Ce n'est point l'auteur de la traduction des
Gorgiques, ou du pome des Jardins; c'est bien un
autre talent. Nous ne citerons, pour preuve, que des vers
Madame Le Brun
;
le quatrain sur le roi de Prusse, qui
4.
66
RIVAROL
vcut comme un tigre, et mourut comme un chat; et
finalement le quatrain suivant M. le comte de Buton :
La nature, pour lui prodiguant sa richesse,
Dans son ocnie et dans ses traits
A mis la force et la noblesse :
En la peignant, il peignit ses bienfaits.
Le jeune pote a mis tant de profondeur dans ce dernier
vers quon a nomm une Commission pour l'expliquer.
Nous saurons un jour jusqu' quel point on doit estimer ce
vers-l.
DELACL05 (m.). Ses vcrs sur la Jalousie en ont donn
tout le monde.
DiDOT fils (m.). C'est un prodige en littrature, et un pro-
disi-e
effrayant pour ses rivaux. Ce jeune homme fait plus
dlivres que M. son pre n'en peut imprimer. Le Recueil
de ses fables empchera la vente du bon La Fontaine qu'on
nous a promise : mais on ne peut tout avoir.
DOBREMEZ (m.). Trop fort pour Tnigme, laquelle il s'est
adonn, il pourrait faire des acrostiches.
ESPAGNE (m.). Les Etrennes de Mnmosyne se souvien-
dront jamais du dbut de M. Espagne. Nous osons le d-
fier de se surpasser
;
nous osons mme le prier de ne pas le
tenter : plus d'un grand crivain s'est perdu par l. Quand
on atteint la perfection du premier coup, on est forc de s'y
borner.
FABRE d'glaxtine (m.). Lc succs de ses pices aux
Franais et aux Italiens est un peu balanc par la fortune
prodig'ieuse de ses couplets, qui font le charme des socits.
C'est peut-tre l un des grands secrets de l'amour-propre
que ce penchant qu'on a pour les petites pices fugitives :
on affecte de trouver M.Fabre d'Eglantineplus g-rand dans
le couplet que sur nos thtres
;
ce qui est injuste. Et com-
ment s
y
prendrait-on, s'il n'et pas fait des romances? Il
faudrait bien que l'admiration tombt sur ses drames.
FALLET (m.). C'est, uotre avis, l'crivain qui a le mieux
LITTIXATLRE
67
mat renvie. Ses bouquets et ses chansons causrent d'a-
bord une .'darnic universelle: on craignit qu'il ne s'empart
de ce p;-enre; mais une trag-die a tout calm. On a aim
M.
Fallet dans Tibre, et Tibre lui-mme
y
a beaucoup
gj-agn. Il fallait bien du talent pour rendre Tibre aimable.
FONTAINE DE SAINT-FREVILLE (m.). Cc protcSSCUr avaut COm-
menc la traduction de l'Enide par ces deux beaux vers :
Vis--vis les canaux o le Tibre, son liut,
Dans le sein de Thtis panche son tribut, etc.
M. l'abb Delille a totalement abandonn la sienne : de
sorte que M. Fontaine est en conscience tenu de continuer.
Le public n'y perdra rien; mais il faut que M. Fontaine
soutienne ce beau dbut; ce qui nous fait trembler.
FRRON, fils (m.). Ses posies fug-itives ont un si prodi-
gieux rapport avec celles de Voltaire, que nous ne doutons
pas qu'en cette considration Voltaire ne se ft rconcili
avec M. Frron pre
;
et que celui-ci n'et consenti aimer
le vieillard de Ferney, en le voyant revivre dans son propre
fils.
FULVY (m. le marquis de), un des plus laborieux potes
de la nation. On trouve, s'il est permis de le dire, que ses
charades sont un peu trop piques : on dsirerait qu'il les
maintnt la hauteur de ses autres posies.
GAALLON (M.),de Cacn, pote qui vient de faire la plus
vive sensation dans toute la Normandie par un impromptu.
Il est si lgant, si neuf et si ingnieux, que les amis mme
de l'auteur ont peine croire qu'il ne soit pas le fruit d'une
profonde mditation. Nous allons le citer ;
Comme Cypris,
Vous avez le talent de plaire,
Comme Cypris,
Vous enchanez les jeux, les ris,
A Gnide, Paphos, Cythre,
Vous savez triompher, Glycre,
Comme Cypris.
GABioT DE SALINS (M.),si prodigicuscmcnt connu pour son
couplet une dame. En voici les deux premiers vers :
68
RIVAIXOL
Heureux Tpoux cjui de ton me
Obtint le premier des soupirs, etc.
Il s'est fait une foule d'ditions de ce couplet, et cepen-
dant il est fort rare. On dit qu'on en prpare une nouvelle
dans les belles presses de rAlmanach de Lii^e.
GAiGNE et GA-NEAU (mm. de). Un drame jou en socit et
quelques chansons accompag-nentMM.deGaig-ne et Ganeau
dans le monde, et les suivront dans ces archives de lag-loire.
M. de Gaig-ne a fait une chanson lui seul.
GALLOIS et GAR-NOT (mm. ). Ccs deux potes se prsentent
aussi sous la mme couronne.
VAffj^s
de la Courlille est
le fruit de leur tendre union. On a beaucoup disput dans
le temps pour savoir s'il
y
a plus de vertu que de talent
dans cette pice. Enfin, on a senti que cette belle farce ne
pouvait tre l'ouvrag-e d'un seul homme.
GAUDiN (m.), se voyant de l'acadmie de Lyon, n'a pas
cru drog-er son tat d'acadmicien en faisant une belle
ptre en vers un enfant de sept ans, ni trop prsumer des
forces de l'enfant, en la faisant fort long-ue. Quant nous,
il nous a paru qu'on ne pouvait pousser plus loin une petite
fille et une g-rande ptre.
GAUDET (m.), fort clbre dans le mois de janvier
1781,
par une pitaphe sur une vieille. Nous en rappelons le sou-
venir avec d'autant plus de raison qu'on ne saurait comp-
ter ni assez dplorer tous les petits chefs-d'uvre qui se
perdent ainsi chaque anne dans les premiers huit jours de
janvier.
GAZON (m.), si connu par ces deux vers sur Voltaire :
Avec tous les talents ce pote naquit;
Ds qu'il put s'exprimer, il montra de l'esprit.
GEOFFROY (m.). C'cst uu dcs uoms les plus connus dans
la littrature moderne; mais comme il appartient plu-
sieurs potes la fois, nous sommes rduits demander du
temps nos lecteurs pour les classer un jour selon les
Recueils o ils dominent, et les journaux o on les loue.
GEORGELiN (m.), secrtaire de la socit patriotique en Bre-
tagne. Ce pote s'est eng-ag- faire un quatrain tous les
ans, ordinairement adress au commandant de la province.
On ne saurait trop admirer l'aimable g-alit quirg-ne dans
tous ces quatrains : la grce et la posie s'y soutiennent tou-
LITTRATURB
6g
jours une mme hauteur. Cet quilibre de talent est Lieu
rare.
GENCY (m. de), pote qui a ehant Jupon court et blanc
Corset. Cette chanson est plus connue que la Ilenriade.
Tels sont les succs attachs l'heureux emploi de ses for-
ces ! Peut-tre M. de Gency aurait t moins fortun dans
l'pope.
GENDRY (M.),d'Ang'ers, vient de refaire la fable de Tircis
et d'Amaranthe, qui en avait certes grand besoin. Nous
j
invitons M. Gendry suivre cette heureuse ide, et nous
i
refaire IdS Animaux malades de la peste, Philmon et
Baucis^ le Chne et le Roseau, etc. Ce sera pour M. Gen-
dry une route nouvelle dans le champ de la g"loire, et il sera
bien sr de n'y rencontrer personne.
GIN (m.), conseiller au grand conseil, si connu et si estim
pour le beau papier et
les superbes gravures de sa traduc-
tion d'Homre.
.;iLLET (m.). Ses couplets de Jean Jeanne sont un
monument de l'Almanach des Grces. Il faut avoir un talent
bien particulier pour viter avec tant de prcaution la po-
sie, l'esprit et l'harmonie, et faire pourtant des couplets si
aimables. C'est que M. Gillet a saisi le genre.
GiNGUEN (m.). Nous avons lu dans le temps son ptre
intitule : Lors de mon entre au Contrle Gnral; et
nous nous flicitions de compter enfin parmi les potes de
ce Recueil un contrleur gnral des finances; mais nous
n'avons jamais pu trouver M. Ginguen dans la liste. Au
reste, si Plutus ne l'avoue pas, les Muses le rclament, et
>t un des plus fermes appuis de leur Almanach.
GODARD (m.) s'est cxerc sur les Bergers
prfrs
et les
Bergers inquiets^ avec un succs incroyable. Heureux
ceux qui n'ont pas encore lu M. Godard ! Ils feront con-
naissance avec une Muse bien originale et bien piquante.
GRAMBERT (.M.). Ou peut trc immortel et inconnu : c'est
le cas de M. Grambert. Ses uvres se sont drobes toutes
nos perquisitions
;
mais son nom ne peut viter nos hom-
mages.
GRATON (m.), pote de Beauvais. Il a chant sur une
'musette si harmonieuse que Paris, jaloux de Beauvais,
devrait s'en venger en attirant ce pote dans son sein. Mais,
70
RIVAROL
si M. Graton manque Paris, il ne manque pas notre
collection.
GRiMOD DE LA reymre (m.). Prodigc uaissaut en littra-
ture : il va Timmortalit par trois routes diflrentes, par
ses livres, par ses actions et par ses soupers; ce qui est peut-
tre sans exemple dans les annales de toutes les nations.
GUDiN DE LA BUNELLERiE (m.), moius clbre par six
volumes de beaux vers et les injustes cabales qui ont fait
tomber ses pices aux Franais, que par son amiti pour
M. de Beaumarchais. Quelques pa^-es des Mmoires ae ce
dernier et quelques plaisanteries de Figaro les avaient un
peu refroidis; mais le dernier Factiim, et surtout Tarare,
les ont lis jamais. M. Gudin, charm que son ami cra-
st Ouinault, le console des cris de l'envie par l'exemple de
Socrate, d'Aristide et de Voltaire, avec qui M. de Beaumar-
chais a en effet des rapports frappants. Seulement, on peut
dire que M. de Beaumarchais, ainsi que feu M. de Ram-
ponneau, est infiniment plus connu que Socrate et Voltaire :
son nom a toute la vogue d'un Pont-Xeuf.
GuiCHARD (m.), extrmement recherch pour une anecdote
en vers sur Henri IV et Bassompierre. Plt Dieu que
M. Guichard voult ainsi mettre en sixains toute l'Histoire
de France! Voyez ses charmants vers Cocotte qui tient
un papillon.
GuiDi (m. l'abb), auteur d'un pome sur Vme des Btes.
Cet ouvrage, plein d'me, vivra ternellement.
GUIS (m.), de Marseille. Ses Pices fugitives ont fait
oublier son Voyage de Grce. Nous croyons en effet que
M. Guis avait perdu son temps voyager
;
sa vritable voca-
tion, c'est le quatrain.
GUYARD (m.), un de nos modernes Quinault. Ses paroles
sont tombes sur Iphignie en Tauride.
GUYTAND (m.). Scs impromptus, ses anecdotes en vers et
ses acrostiches en ont fait, en dpit des rivaux, un des plus
considrables personnages de ce Recueil, et de tous ceux
qui paraissent au mois de janvier. M. Guytand s'est fait
dans la petite posie un arrondissement superbe, et n'en est
jamais sorti.
HAR-M DE GUERviLLE (m.). Scs productious dramatiques
LlTTf\ATURE
V
se trouvent aux Italiens et aux Boulevards.
Observez que ce
pote n'a jamais fait un chef-d'uvre lui seul; il
s'est
toujours donn un collg-ue, ce qui rend le fardeau de sa
gloire plus lger pour l'envie.
HARDUiN (m.), secrtaire de l'acadmie d'Arras; une des
Muses les plus assidues de nos Recueils. Ce pote est si
voluptueux, il va si droit au cur, il excite si violemment
l'imagination qu'on ne saurait trop prendre de prcautions
contre les surprises invitables dans une premire lecture.
Il faut relire M. Harduin pour tre en tat de le bien juger.
HENNET (m.), si clbre par la chanson qui parut en
1781
sur une Rose prudente. On ne conoit pas comment
M. Hennet a pu marier tant de philosophie tant de posie
dans une chanson.
HsQUE (m.), pote qui ne jouit pas de toute la rputa-
tion qu'aurait d lui attirer une pice de huit vers qui parut
il
y
a deux ans dans l'Almanach des Muses.
HiNARD (m.), de Montauban. Ses couplets Hortense et
Isabelle sont dj mis ct des beaux sonnets de Ptrar-
que pour sa Laure; avec cette diffrence, si honorable pour
le pote de Montauban, que Ptrarque n'a pu immortaliser
qu une femme, et que M. Hinard a dj fait deux immor-
telles.
HiRZEL (m.). Son dialogue sur les Suisses mrite toute
l'attention d'un philosophe.
HOFFMAN I, ET HOFFMAN II
(m^s).
NoUS atteudoUS, pOUr
parler dignement de ces deux potes, que le public se soit
dcid sur leur mrite respectif
;
faudra-t-il laisser les rayons
de leur gloire se confondre, ou sparer leurs articles? Voil
la question.
HuiLLiER (m. l'), conseiller Orlans
;
ce magistrat a poli
un sixain dans le cours de l'anne dernire, qui lui a fait
le plus grand honneur. Nous l'exhortons quitter l'aride
tude des lois pour s'adonner aux sixains, puisque le ciel
l'appelle si visiblement ce beau genre.
j et i
JAMES DE SAINT-LGER (m.) a franch les limites du qua-
train, et ne s'est point gar dans un conte de vingt ou
na RIVAROL
trente vers. Ces heureuses tmrits perdent tous ceux qui,
en tant jaloux, se htent de les imiter.
JEUNE (m. le). Ses couplets un cur de Paris sont d'une
posie trop brillante
;
mais ce dfaut est si rare qu'en
vrit nous n'osons pas le trop reprocher M. le Jeune.
JOLY (m.).
JOLY DE SAINT-JUST (M.).
JOLY DE PLA>XY Ct JOLY DE PLANEI (mM.). CcS quatrC UOmS,
s'alement connus, sont comme noys dans la mme g-loire.
La distinction que nous voulions tablir entre eux nous a
cot six mois de travail et d'normes achats de Recueils,
mais nous en sommes encore au mme point. Ce sont tou-
jours, et de tous cts, des couplets, des impromptus, des
bouquets, enfin l'quilibre le plus parfait et le plus dses-
prant
;
si ce n'est pourtant qu'on donne VEgyptiade un
de ces MM. Joly : or, un pome pique romprait bien l'-
quilibre.
jouFFREAU DE LAGERiE (m. Tabb). Quoiquc nous n'ayons
qu'un ou deux vers de ce pote, nous ne savons pas moins
apprcier son talent, et lui donner ici la place que son nom
rclame. A quoi nous servirait notre longue exprience, s'il
nous fallait plus d'un hmistiche pour juger un de nos
potes du jour ou du moment? On assure que M. l'abb
Jouffreau a mis Don Quichotte en vers.
juviGXY' (m. rigoley DE), crivaiu inconnu force d'lo-
quence, de posie, de philosophie et d'rudition; tant l'en-
vie a t aux aguets avec ce grand homme !
iMBERT DE LA platire (m. le comte) . Cet infatigable
jeune homme avait entrepris la Galerie universelle des
grands Hommes; mais cet ouvrage pchait par le mlange
scandaleux du bon et du mdiocre. Nous esprons qu'on ne
pourra nous faire ce reproche : nos grands hommes sont
tous 'iine mme venue, et notre Recueil est sans mlange
comme sans reproche.
iRAiL (m. l'abb) a eu la gloire d'excuter ce que La Motte
avait tent sans fruit, et ce qui l'et combl de joie. Sa tra-
gdie di Henri IV et de la Marquise de Verneuil, en cinq
actes et en prose, a fait la rvolution; et c'est depuis ce
succs que nous n'avons plus que des tragdies prosaques.
LITTKATL'RE
'j'i
LACROIX (m.), avocat et continuateur de Montesquieu.
On
commencerait dj ne plus distinguer l'auteur de l'Esprit
des Lois, de son continuateur, si celui-ci n'tait la fois
pote et lgislateur.
LAVEDAN (m.), Secrtaire du muse de Toulouse. Son p-
tre aux Ours, qu'il appel ses amis et ses
Juges, est d'une
misanthropie sublime.
LAUNAi (m. l'abb de) a des rapports frappants avec l'abb
de Saint-Pierre; avec cette ditlrence que M. l'abb de
Saint-Pierre n'crivait ses projets pour le bonheur du monde
qu'en prose, et que M. l'aob de Launai les met au jour,
tantt en forme de pome, tantt en ode, tantt en chansons.
Il n'est pas de strata2;"me dont iM.de Launai ne s'avise pour
rendre les hommes heureux.
lemteyei\(m.), secrtaire du roi, fameux par une fable
insre dans les Almanachs des Muses. Encore une autre
fable de cette force, et M . Lemteyer pourra se reposer et
jouir. Nous exigeons cette seconde fable, non que M. Lem-
teyer en devine plus illustre, mais c'est que nous en serons
plus heureux.
LEsuiRE (m.). Un des plus laborieux potes de notre si-
cle. Cinq ou six pomes piques, et dix ou douze mille
feuilles volantes, composent le patrimoine de cet enfant des
Muses. Ses ennemis mmes sont forcs d'avouer qu'il ne s'en
tiendra pas l.
LETORS (m.), bailli Chaourse, en Champagne. Le gnie
crot partout. Voyez les beaux vers de M. Letors, sur la
pointe d'une aiguille.
LEVASSEUR (m.) fait la musique de tous ses opras; ce que
personne peut-tre n'aurait fait.
LvouE (m.), un des puissants crivains du sicle. Il a
attaqu l'histoire et la pice fugitive, et en est venu son
honneur : sa dernire victoire a t sur Plutarque, qu'il vient
de traduire.
LUCHET (m. le marquis, jadis marquis de la roche du
I
MAINE). Soixante volumes de vers et de prose caractrisent
I cet illustre crivain. Rien ne lui a rsist; pomes, drames,
I
romans, opras, chansons, histoires, toute la littrature lui
est chue en patrimoine, ou par droit de conqute. Lass des
74
UIVAROL
applaudissements de sa patrie, il a port sa loire en Alle-
mag-ne. On ne conoit pas, d'un ct, l'ingratitude de M. de
Luchet, et, de l'autre, l'insouciance des Franais. Que de
guerres entreprises pour de moindres sujets !
MAiLHE (m.). Une idylle contenant les propos de Henri IV
son pre nourricier a prouv que M. Mailne tait homme
tout. On attend la rponse du pre nourricier avec la plus
vive impatience.
MAisoNNEuvE (m.). Cc potc trag"ique, connu dj par une
foule de quatrains, vient de concevoir un projet magnanime
Eour
la e^-foire du Thtre Franais. Avant donn au pu-
lic la trag'die de Mustapha et Zang-ir sous une nouvelle
forme, et, voyant que son style plaisait beaucoup, il a port
sa bienveillance sur ce qu'on appelait jusqu'ici les chefs-
d'uvre de la scne, et a voulu nous dbarrasser de cette
ennuyeuse monotonie. C'est A/^^re qu'il a d'abord attaque.
En portant son style sur cette pice, il en a fait Odmar et
Zulna, titre plus harmonieux que celui d'Alzire;et cela lui
a si fort russi, qu'il va nous donner successivement Ph-
dre, Britannicus, Iphignie et Ci/ma, sous d'autres titres.
Nous ne saurions trop l'encourager dans une si haute entre-
prise, et nous le prions en notre particulier de vouloir bien
aussi jeter du style sur Athalie, et de finir par l le rajeu-
nissement du Thtre Franais.
MARCHANT et MARCHAND (MM.), dcux potes aussi distincts
que distingus : l'un a fait un pome sur Fnlon, et l'au-
tre des couplets ravissants sur un petit chien.
MARiBAROu (m. de). Uu im-promptu dans l'Almanach des
Grces a caus M. de Maribarou une aussi grande rputa-
tion qu'un gros Pome l'aurait pu faire. C'est qu'avec un
vrai talent on ne fait rien d'innocent.
MAYET et MAYER (mm.). Ccs dcux crivaius rgnent assez
paisiblement sur les vers et sur la prose. Vint volumes de
Romans et de Romances ne leur ont pas attir une seule
critique. Il
y
a eu peut-tre d'aussi grands crivains; on en
trouve peu d'aussi fortuns.
merard de saint-just (m.). Ses posies sont toutes en
distiques, mais si peu distingus par l'imprimeur qu'on est
LnTEn.VTL'IlE
75
sujet les lire de suite, et chercher un sens g-nral tant
de
vers ranims
par paires.
MisTRixGUE (m. Thomas Minau de la). Orateur,
pote et
philosophe. Son dernier ouvrage sur Vimpt^ et le beau
pome qu'il prparc sur la Compagnie des Indes^ ont donn
M. Thomas Minau de la Mistring-ue une place part dans
la littrature franaise. Son nom, si favoranle l'harmonie,
sera chant dans tous les Almanachs et dans tous les si-
cles.
MOREAU (m.). Ses discours sur rhistoire de France
ont
fait oublier Machiavel, par le style surtout, et la profondeur.
M. Morcau ramne tous ceux que .Montesquieu,
Rousseau
et d'Argenson garent; et ses crits servent puissamment
nous tenir en garde contre la raison qu'il met en dfaut,
et contre les charmes de la libert dont il nous dgote.
MouzoN (m.), professeur Bourges. Son pome sur le com-
merce est devenu lui-mme un grand objet de commerce,
par l'norme consommation qu'on en fait dans nos Colonies.
MOUHY (m. le Chevalier de). L'Histoire des thtres, beau-
coup de pices en vers et en prose, et quarante volumes
de romans, donnent cet crivain un des cort-es les plus
imposants de toute notre nomenclature. Nous lui devons la
plupart des jugements ports sur les auteurs dramatiques
vivants. Ce beau gnie semble avoir devin nos intentions,
en insistant sur Corneille, Molire et Racine, beaucoup moins
que sur MM. Mercier etDurosoy, et en louant tout le monde.
C'est aussi la marche de M. ci'Acquin de Chteau-Lion;
et cette mthode est en effet le seul moyen que la prudence
nous ait indiqu pour teindre ces rivalits et ces disputes
odieuses qui dshonorent la littrature franaise, et quichan-
Eent
en vils gladiateurs les vritables matres du public,
'empereur Commode eut la folle bassesse d'amuser un peu-
Sle
qu'il devait gouverner. Mais nous croyons, nous osons
u moins nous flatter que ces courtes notices mettront fin
ce scandale. Quand une fois il sera bien dcid que tout
homme qui signe un quatrain, ou qui est admis aans un
Recueil, est un grand homme, et que nous n'avons en ce
moment que des grands hommes dans la rpublique des let-
tres, il faudra bien que nous ayons la paix. On gale les pr-
tentions en galant les puissances; l'quilibre parfait sera le
fruit de cette politique. Enfin nous qui parlons, nous som-
nQ liivAnoL
mes aussi des grands hommes; et si jamais, par une fausse
modestie, nous venions h dire le contraire, nous prions le
public de nous
confondre, en nous opposant nous-mmes,
et en nous faisant rentrer dans notre Almanach.
NAu (m.). Cet crivain a travaill pour les thtres de so-
cit, et s'est beaucoup illustr; mais ce qui a surtout fait
sa gloire, c'est le Recueil des fables de La Fontaine, mises
en vaudeville. Une ide neuve est une bonne fortune, et
M. Nau l'a eue. On s'tait dj lass de dire La Fontaine;
on ne se lassera jamais de le chanter. Mais, si on ne lisait
plus La Fontaine, on le louait toujours; car on aime louer
les morts; les frais de l'envie sont faits depuis long-temps
avec eux. Eh bien ! nous apprenons tout lecteur que celui
qui chante une fable en vaudeville, et qui croit d'admirer
La Fontaine n"admire en effet que M. Nau
;
La Fontaine n'y
est plus.
NivET DESERiREs (m.). Ses Nouvelles Fables ont t mal
propos confondues avec celles de La Fontaine par un sot
diteur. M. Nivet les a fait imprimer ct de celles deTan-
cien fabuliste, pour tre compares, et non pour tre con-
fondues.
NouGARET (m. Pierre de). Son Vidangeur sensible a t
compar plus d'une fois la Brouette du Vinaigrier, yoi\k
la vraie et la belle nature
;
c'est l qu'il faut la chercher. Ces
deux pices donneront la postrit une ide plus juste de
l'espce humaine, que les prtendus chefs-d'uvre de Racine
et de Molire. ,.
OFFREVILLE (m. d'). Nous cTaignons que ce ne soit le mme
que M. Dofireville dont nous avons dj parl; mais nous
prfrons le risque de nous rpter au malheur d'omettre.
Voici un vers de cet aimable pote sur les approches de
l'hyver :
Nos bouquets sont fltris
;
ils ne sont plus charmants.
ORVILLE (m. Malherbe d'). Nous ne connaissons qu'un
roman de cet crivain
;
c'est un peu sa faute
;
nous sommes
LITTEUATUnE
77
forcs de faire revenir de Saint-Domiug-ue une foule de
romans qu'on ne trouve plus en Kurope.
PALMEZEAux (m. le chevalier de), le plus pur, le plus riche
et le plus brillant modle que nous puissions proposer la
jeunesse : ses soixante volumes de vers et de prose forment
aujourd'hui une collection qui ne laisse plus d'excuse au
jeune crivain qui ne demande que des exemples. L'extrme
activit de M. le chevalier de Cubires, et son admirable
rg"ulai itc dans les Almanachs. devraient faire roug-ir plus
d'un homme de lettres. Nous avons en ce moment onze Re-
cueils de vers sous les yeux, auxquels tout manquerait plu-
tt que M. le chevalier de Cubires; et ce n'est pas un seul
morceau chacun qu'il distribue mesquinement; ce sont des
douzaines de pices la fois, jetes avec mag"nificence dans
les Almanachs riches ou pauvres, sans distinction. 11 en est
de ces Recueils indig^ents pour qui M. le chevalier de Cubires
est une vraie providence. Parmi les quatre-vingts pices
qu'il nous a donnes en ce mois de janvier, sans prjudicier
en rien la collection de ses uvres qui va toujours, on a
disting-u un Dialogue entre les fauteuils de l Acadmie.
Le premier fauteuil prend la parole, et dit :
De l'improRiptu le Dieu troublant ma fantaisie,
De raisonner en vers me souffle le dsir
;
Raisonner envers! quel plaisir!
Cdons la fureur dont ma bourse est saisie, etc.
Le second fauteuil rpond :
Mes coussins sont enflamms, etc.
Le feu jaillit de mes clous menaants, etc.
On ne fait pas ces vers-l sans son tapissier.
PAIN DE LA LORIE (m.).
PANis (m.). Ces deux noms, dont l'un pourrait servir de
traduction l'autre, sont galement fameux; ce qui est vi-
demment injuste, car M. Pain n'a fait qu'un vaudeville; et
M. Panis en est son millime. Les rputations ont leurs
mystres, et nous dfions la gomtrie de rsoudre le pro-
blme Pain et Panis.
^8
RVAROL
PASCALis (m. le chevalier de). Les Mtamorphoses d'Ovide
ont reu la vie des mains de cet auteur : Acton l'a d'abord
frapp et a subi la traduction la plus prompte et la plus
heureuse. M. de Pascalis se rencontrera bientt avec M. de
Saint-Ang-e, au pied de l'arbre de Daphn : c'est l que la
g-loire leur a donn rendez-vous.
PASTELOT (m.) vient d'entreprendre les quatre Saisons;
l'hiver a dj pass par ses mains, et en est sorti brlant de
verve et d'expression : il n'y a d'autre magicien dans la na-
ture que le pote.
PELLETIER (m.) a mis le Tlmaque en vers. C'est l'hom-
mag'3 le plus dlicat qu'on ait encore rendu la prose de
Fnlon : on est fch que l'offrande n'ait pas t mise prs
de l'autel, c'est--dire, qu'on n'ait point imprim M. Pelle-
tier ct de Fnlon.
PERPvOT (m.), niatre, pote et tailleur Paris : il donne
dans la tragdie, et voici deux vers de lui trs connus et trs
pathtiques :
Hlas, hlas, hlas et quatre fois hlas !
Il lui coupa le cou d'un coup de coutelas.
M. Perrot fait aussi Tptre et la fugitive : peu d'auteurs
ont pris de si justes mesures en parlant des hommes et des
animaux
;
tmoins les vers suivants :
Mais, tandis qu'on le leurre,
Le chat passe emportant une li\Te de beurre :
Brusquement on se lve, on court aprs le chat,
Oui, tout saisi d'effroi, ss sauve et casse un plat.
perez-d'uxo (m.). Cet crivain entremle beaucoup de
mora/i/s dans ses pices fugitives. A chaque vers, chaque
hmistiche dans M. Perez-d'Uxo, il se fait un mariage de
la philosophie et de la posie. Ce grand secret, si rare et si
difficile, n'est qu'un jeu pour M. Perez-d'Uxo.
PERR1ER (m.). Nous avons de ce pote huit ou neuf vers
an ami, qui intrigurent tous les connaisseurs, lors de leur
apparition. On voulait absolument savoir qui s'adressait
ce brevet d'immortalit; et quoique le temps ait un peu cal-
m les esprits ce sujet, il nous arrive encore de rencontrer
des personnes de la plus haute considration, qui nous en
parlent, et qui seraient bien aise d'avoir des informations
LITTEI\ATUHE
yg
certaines l dessus. Nous ne pouvons les satisfaire, et nous
ne concevons pas le barbare plaisir que M. Perrier g-ote
tourmenter ainsi l'univers entier.
piERRY (m.). Ce nom est responsable d'une petite fable que
nous avons trouve dans un des cantons les plus dtourns
de la littrature. C'est un vrai bijou que nous rservons pour
redit ion des chefs-d'iiore inconnus; ouvrag-e en qua-
rante volumes in
folio,
auquel nous travaillons jour et nuit.
PIEYRE (m.). Aprs dix ans d'assiduits dans tous nos
Almanachs,M. Pieyre vient de nous faire une infidlit qui
a valu un drame sublime aux Franais. Tous les pres qui
ont se plaindre de leurs enfants
y
ont applaudi avec
transport, c'est--dire qu'il
y
a eu pour lui tous les mnag-es
dans une ville o l'on se marie d assez bonne heure pour
que les pres soient toujours trop jeunes et les enfants trop
vieux
.
piDou (m.). Les crivains les plus srs de leur force sont
ceux qui, s'tudiant sans cesse, ne se laissent pas tourdir
du bruit de leur rputation. Tel est M. Pidou, qui n'a pas
quitt le quatrain, au milieu des acclamations de ses amis,
qui l'invitaient positivement l'pope.
piLHES (m. de), un des plus laborieux commerants de
f)osie
qui existe dans l'empire littraire. Il a transport de
e Grce une foule de petitt^s pices, et les a jetes dans la
circulation, o elles ne restent pas long-temps, cause de
l'avidit des amateurs. Les petits vers de M. de Pilhes
seront un jour d'une horrible chert : il est affreux qu'on
spcule ainsi sur la posie.
Plis (m. Antoine-Pierre-Au2rnste de), secrtaire ordinaire
de Mgr comte d'Artois, etc. Ce jeune pote, tantt avec
M. Desprez, tantt avec ^L Resnier, tantt avec AL Barr,
tantt avec son talent, tantt seul, a conu, corrig ou
enfant prs de mille, pices de thtre. Son pome sur
l'harmonie des mots et des lettres a mis le sceau sa
rputation. C'e.^t l qu'on a vu le
Q
tranant sa queue et
querellant tout bas, etc. M. de Piis est le premier pote qui
ait song donner un tat fixe aux ving-t-quatre lettres de
l'alphabet.
piTRA (m.), profond penseur et pote lger, et selon les
temps, penseur lger et profond pote, que la politique vient
d'enlever aux Muses.
80
KIVAROL
PLANCUET (m.). On dit que cet crivain est extrmement
connu de quelques per.sonnes, pour un petit conte Indien
que nous n'avons jamais pu nous procurer.
PLOuvi (m.). Nous lui devons un Temple de l'Amour,
en vers. Il est peu d'ouvrag-es mieux construits ;
les dtails
d architecture o le pote s'engage feraient croire qu'il n'a
jamais perdu de vue qu'Apollon avait t maon. C'est
quoi Boileau ne songeait pas assez, quand il disait Per-
rault :
Soyez plutt maron si c'est votre talent.
pouLHARiER (m.). C'est l'auteur fort estim d'une com-
die. Cette notice ne parat rien, et quelques personnes
demanderont peut-tre une explication : mais seront-elles
plus heureuses ou plus avances, quand nous leur dirons que
cette comdie est intitule, le Taciturne.
roNS DE VERDUN (m.). Nous dirous peu de choses de cet
Hercule littraire. On sait qu'il n'a point craint de signer
environ dix mille pigrammes ou contes en vers, et de les
expdier pour tous les Almanachset tous les journaux o ce-
jeune pote a form, par leur moyen, des tablissements
trs considrables.
po-xcoL (m. l'abb) n'a traduit qu'une seule pigramme de
Sannazar, et s'est attir tout coup une gloire gale, dit-on,
celle de M. Pons de Verdun. Nous ne pouvons nous accou-
tumer ces sortes d'injustices.
PORRO (m.) a rompu un lacet^ en vers remplis de grce.
Cette pice, qui n'a pas vingt ou trente vers, est un petit
pome, le bien prendre : et ce sont ces petits pomes bien
inconnus et bien signs de leur auteur que nous aimons
la folie : c'est l que nous triomphons. Quel plaisir en effet
d'arracher une victime l'oubli, ce tyran vorace et muet,
qui suit la gloire de prs, pour dvorer ses amants ses
yeux, et qui, toujours vainqueur, ne daigne jamais chanter
ses victoires !
PRUNEAU (m.) a fait une petite pice aux Franais, et s'est
tenu coi. On dit que sa paresse, mle de modestie, s'est
avise d'un stratagme .singulier. M. Pruneau a jur qu'il
ne ferait une seconde pice que lorsqu'on aurait oubli la
premire.
LITTKRATLRK 8r
QUTANT (m.). C'est peiit-t'tro le mme que M. Guytand.
Nous marchons dans des obscurits et des quivoques sans
fin, en parcourant la pnible route o nous nous sommes
eng-ag-s
.
RAUQuiL-LiEUTAUD (m.). Cct crivain a reu du ciel un
talent fort honnte, et en a fait un usag-e plus honnte encore.
Ses Moralits en vers difient des journaux entiers : quel-
quefois, il est vrai, M. Rauquil-Lieutaud se permet des
impromptus d'une tournure un peu aie, et sentant le
monde plus que ses moralits; mais on sait qu'un impromptu
ne dpend point de vous. Les casuistes les ont rang"s parmi
les premiers mouvemenls.
RAT (m.). Chansons, Chansons : tel est l'aimable cri
de M. Rat. On le trouve, on le chante partout : il n'est
point de Journal, de Recueil et d'Almanach o la g-loire ne
vienne crire elle-mme ce nom-l. Sa manire est tellement
lui qu'on nomme ses couplets, les Rats, comme on
appelle les Augustins^ tous les petits contes de M. Auguste
de Piis.
REGXAUT DE BEAUCARON
(>!)
H }' a dcs savauts qui pr-
tendent que c'est le mme que M. Reg-naut de Chaource.
Comme il
y
a dj quelques volumes de dissertations ce
sujet, nous esprons qu'un jour ou l'autre nos doutes seront
cclaircis, et nous serons en tat d'en parler dignement.
RENOUT (m.). Ses tragdies et ses comdies se jouent avec
fureur aux Franais
;
mais elles ne soutiennent pas aussi
heureusement l'examen froid et svre du cabinet. Cela
vient de ce que M. Renout s'est trop livr cette manire
expditive qui a perdu Corneille et Voltaire : il est vrai que
M. Renout produit plus d'effet au thtre que Racine, lequel,
de son ct, l'emporte un peu sur lui la lecture.
RELLY (m.). Son Heureux Divorce, en deux actes et en
prose, est une de ces pices qui ne pouvaient se mettre en
vers, comme l'observe trs judicieusement M. Mercier.
REssGuiER (m. Ic bailli de). Son pome de iile de Rho-
des commence fixer les regards de l'Europe, et donne de
furieuses inquitudes aux Turcs. Mais la Russie le favorise
5.
82
RIVAIVC L
puissamment, parce que ce beau pome, qui ne vise rien
moins qu' la reprise de l'le de Rhodes, ferait une diver-
sion 1res heureuse dans la g-uerre prsente. C'est dans les
Muses de Toulouse que M. de Resscg-uier a mont son
artillerie potique.
RiCHER (m). Quelque ria^ueur que nous ayons mise dans
les perquisitions qu'on a aites sur INI. Richer, on n'a pu
obtenir encore que des esprances. Mais qu'importe ? le
nom de ce pote, quoi qu'il ait fait, ira la postrit, comme
le nom d'Orphe, de Muse et de tant d'autres, dont il ne
reste plus en ef'et que le nom.
RivAHoL (m. le comte de). Cet crivain n'et jamais brill
dans notre Almanach, et le jour de l'immortalit ne se ft
jamais lev pour lui, si M. le marquis de Ximens n'et
bien voulu, pour le tirer de son obscurit, l'aider puissam-
ment d'une inscription en vers, destine parer le buste
du roi. Voici quelques-uns de ces vers adresss au peintre,
et qui terminent la pice :
....
Tu peins un jeune Roi,
De qui la g-loire sans seconde
Est d'avoir en tous lieux fait respecter sa loi,
Sans coter une larme au monde.
Cette petite inscription fit un bruit incroyable
;
le journal
de Paris s'en charg-ea, et c'est l que M. le marquis de Xi-
mens en donna l'investiture M. de Rivarol, dont le nom,
depuis cette poque, fij^ure assez bien dans toute la littra-
ture, qu'on dit lg-re. Les Etrennes d'Apollon, l'ayant enre-
g-istre dans la mme anne, achevrent de donner M. de
Rivarol une g-loire irrmdiable. Notre notice redressera
sans doute le plagiat et l'erreur
;
et quoique ceci ne soit pas
un vol, mais un don. il n'en restera pas moins que la dli-
catesse de l'un devait s'opposer la g-nrosit de l'autre.
Mais quoi ! la gloire est si douce ! on en veut tout prix,
et quel homme ne se laisserait pas violer pour elle ! On ne
connat sous le nom de M. de Rivarol que cette inscription.
RONsiN (m.). Ses Mdrig-aux frisent un peu l'Epigramme
et ses Epiis^rammes sont un peu trop douces : ne serait-ce
pas la faute de l'imprimeur qui aura mal pos les titres ?
ROSIRES (m. le comte de). Des Nouvelles en prose qu'on
a longtemps crues de Boccace,etune foule de petits vers qui
LIITPATURE
83
ont une physionomie toute particulire, et qu'on n'oserait
attribuer personne, forment pour M. de Rosires un m-
lanine
(le g"loire, de rayons nuancs, et une couronne qui ne
peut aller qu' lui seul.
ROUDiER (m.). On ne peut rien affirmer de bien certain
sur cet auteur. Il est dur d'tre rduit ces obscurits avec
des contemporains. Que sera-ce de tous ces noms-l dans
(
quelques sicles ?
ROUSSEAU (mm.). Les Jean-Baptistes et les Jean-Jacques
ont assez occup la renomme : il est temps qu'ils cdent la
place nos Rousseau du jour, d'autant que les premiers
taisaient assez mal l'acrostiche, et que ceux-ci le font trs
bien
;
et font encore, sur le march, tout ce qu'ont fait les
autres, Odes, Epig-rammes, Romans, Discours, Pastorales,
etc. Aussi craig-nent-ils plus la prvention que le parallle.
En tout, il est malheureux de trouver la place prise. Heu-
reux les ans !
ROYou (mm. l'abb et l'avocat). Le premier donne des
lois Paris, et le second des modles la Bretag-ne : le
premier a mis M. le comte de Buff'on en poudre, et le second
la mis en vers. Qui des deux a fait le plus de bien la lit-
trature, ou plus de mal M. de ButFon? Ce problme
vaut bien qu'on le propose.
RUBEL ou REBEL (m. de) a fait, cn
1782,
une rude Epi-
uramme contre les potes lyriques, et cette Epig-ramme,
dont la pointe fut trempe dans le Sfijx, tua en effet toute
la g-nration lyrique
;
la moisson mme des Odes de l'an-
ne scha sur pied; et on a observ depuis cette funeste
Epigramme que le g-enre lyrique dprissait totalement. Il
y
a des circonstances o il faudrait lier les mains au talent.
M. de Rubel est bien coupable.
SABATiER DE CAVAiLLON (m.). Ce nom Serait bien vieux
dans la fugitive, si les Grces pouvaient vieillir : trente ans
d'exercices potiques, et plus de trente volumes n'ont pas
su faner ou puiser cette Muse provinciale. Rien n'g"ale sa
fcondit, si ce n'est sa vi^-ilance : le moindre vnement
dans la province qu'habite ce pote est aussitt affect d'un
84
RIVAROL
quatrain
;
et ses madrlg-aux et mme ses chansons seront
un jour les plus srs matriaux de l'histoire.
SAINT-MARC (.M. Ic marquis). Comment la G;-loire ne s'est-
elle pas attache un pote qui lui prparait un asile dig-ne
d'elle en papier, en dorure, en gravure, et avec tout le luxe
de la typographie, tandis qu'elle poursuit souvent un igno-
ble bouquin sur nos quais ou dans la poudre des boutiques?
Ces caprices sont bien incomprhensibles.
SAiNT-pRAvi (m. de), pote qui rajeunit tous les ans, et
qui fait le meilleur madrigal de la saison.
s\LAUN (m.). Quelques petits vers un chne, qui
M.
Salaun voulait du bien, ont fait une grande fortune.
Qu"il est agrable de passer la fois pour un bel esprit et
pour un bon cur ! c'est un problme moral difficile r-
soudre, que cette difficult presque insurmontable d'allier
les deux rputations : les hommes, qui ne veulent pas tout
accorder la fois, prtendent qu'une partie est toujours
faite aux dpens d'une autre. M. Salaun s'est tir d'atfaire
avec un sixain.
SAUTEREAU DE BFXLEVAUD (m.), avocat Saint-Picrrc-le-
Moustier. C'est presque en rougissant que nous oi'rons cet
infatigable pote un encens dont il n'a que faire. M. Sau-
tereau, quand il veut faire parler de lui, ne peut-il pas
porter la parole au monde par vingt bouches diffrentes,
c'est--dire, par vingt journaux? Y a-t-il mme manqu
une seule fois? Les personnes les moins inities dans les
mystres de la littrature n'osent pas avouer qu'elles ne
connaissent pas M. Sautereau de Bellevaud; et nous croyons
inutile d'avertir que ce pote n'est pas le mme que celui
qui rdige VAlmanach des Muses, recueil annuel qui eut
d'abord des commencements assez minces : on n'y voyait
que quelques pices de Voltaire, de Gresset, de Colardeau
;
mais il s'est dgag peu peu, et par le bienfait du temps,
des langes de l'enfance. Sa marche vers la perfection a t
rapide, grces tous les talents dont nous faisons ici l'his-
toire. On a eu des annes sans tache, et on ne pourrait
gure reprocher celle de 1788
que les strophes de M. Le
Brun. Nous ne concevons pas comment le rdacteur de
VAlmanach des Muses a laiss passer cette ode. C'est une
inadvertance, bien pardonnable sans doute, quand on rfl-
chit aux milliers de pices dans lesquelles ce rdacteur est
LITTRATURE
85
oblig (le faire choix, pour composer le bouquet national.
Ei;l;jiii de tant de couleurs, tourdi par tant de parfums, il
adojle quelquefois une fleur trangre qui ne peut se
marier avec les autres. M. Le Brun s'est faufil heureuse-
ment avec la foule, et s'est assis, quoique intrus, au hanquet
des potes de l'anne. Cette notice, selon notre usag-e, d-
noncera l'usurpation et mettra l'auteur sur ses g-ardes.
SAUTER !M. Tabb), prcepteur de M. l'abb de Montes-
quiou, s'est attribu un sixain de son lve. Mais les
trennes du Parnasse,
1788,
ont redress la fraude, et
restitu le sixain M. le marquis de Montcsquiou. Grces
cette police exacte et vigilante, M. l'abb Sauter n'ira
point l'immortalit, comme il
y
allait grands pas, si on
ne l'et arrt en chemin.
sLis (m.), professeur au collge Royal, et pote de VAl-
manach des Muses. Personne encore n'a plus lou et n'a
mieux lou son monde que M, Slis. On connat son beau
vers M. le duc de Xiveniois :
Nivemois au Parnasse est toujours duc et pair.
SIMON, de Troies (m.). Ce pote, ne pouvant se dissimuler
son mrite et sa fcondit, et venu lui-mme notre se-
cours, en publiant le recueil de ses posies; M. Simon, de
Troies, qui pouvait nier une foule de ses ouvrages, a la
candeur de les avouer tous et de les signer.
THvENEAu (m.). On parle beaucoup de deux stances et
d'une pitaphe de M. Thveneau. Nous allons nous les pro-
curer avec les explications dont un savant les a accompa-
gues, parce que M. Thveneau
y
a cach des allusions
d'une finesse qui exigeait absolument des notes. On dit
mme que les notes ont depuis peu occasionn des remar-
ques essentielles, qui sont leur tour suivies d'claircisse-
ments trs intressants, mais qui ne satisfont point assez
les lecteurs de toutes les classes pour qu'on puisse se passer
d'un commentaire en rgle. Ces sortes de livres conviennent
beaucoup aux nations avances. Les notes qui parurent il
y
a quelque temps, en un volume in-12, sur une pitaphe de
quatre vers grecs, en sont une preuve.
niVARUL
TOURNON (m. de), a fait des vers des novices, et il n'y a
que des esprits consomms en littrature qui puissent en
jouir. Il faut savoir donner du lait aux enfants.
TRIANGLE (m.). Cctlc Musc s'cst cndurcic dans le logog-ri-
phe, malg-r les reprsentations de tous ses amis. Nous con-
cevons bien qu'on puisse s'acoquiner cet aimable genre
;
mais la dcence veut qu'on en sorte quelquefois pour l'-
nigme ou pour l'acrostiche.
VALADE (m.\ imprimeur et pote naissant, dont les Ama-
nachs chantants se sont empars. Nous esprons qu'il n'y
fera que ses premires armes, et qu'il laissera bientt le
flageolet pour la trompette, comme il a dj quitt ses
presses pour le flageolet.
VALBANE (m.). Ce pote a mis Vnus en colre pour en
tirer parti, et l'apaiser ensuite par des vers pleins de
charmes. Voyez la petite pice qui porte ce titre.
VALETTE (m. l'abb DE la), autcur du grand pome sur
les Physionomies. Nous ne saurions trop exciter les jeunes
gens faire de bons et beaux pomes, c'est tout simple
;
mais nous ne saurions trop les louer quand ils
y
russissent
comme M. de la Valette. Il est vrai que les sujets ne sont
pas toujours si heureux
;
tout le monde se pique d'avoir de
la physionomie et chacun en cherche une dans ce pome,
ce qui en a caus le prodigieux dbit.
vALiGN'Y (m. de). S Fille bourrue, comdie, a ravi tout
le monde.
Il n'est point de serpent ou de monstre odieux,
Oui par l'art imit ne puisse plaire aux yeux.
On nous pardonnera de citer Boileau, tout vieux et tout
pass qu'il est, au milieu de cette frache et florissante jeu-
nesse. La grosse raison est toujours de mise.
VARENNES (m. de) a chaut Saint-Hubert^ VAmour dra-
gon, et le Srail du grand Turc. On ne saurait croire
avec quelle souplesse et quelle rapidit M. de Varennes passe
d'un sujet l'autre. On dit qu'il en cote peu cet crivain
pour nous causer tant d'admiration. Tel est le gnie
;
il
fait en se jouant des enjambes, que nous mesurons ensuite
avec beaucoup de peine et de surprise.
LIIIUATUIVE
87
wARoguiER DE S. -FLOUENT (-M.). Scs cliansonnettes pasto-
rales sont si douces qu'elles commencent passer dans les
ordonnances des mdecins instruits, et sont un des plus
puissants calmants qu'on connaisse. Il serait temps enfin
que les productions de l'esprit servissent la sant du corps.
Apollon n'est-ii donc pas le dieu de la Mdecine?
VEUNE de Genve (m,), le plus vig-oureux crivain de la
Suisse en prose et en vers. On ne peut plus se passer des
productions de M. Vernes.Il
y a des relais tablis de Genve
Paris pour jouir plus tt de tout ce qu'il fait.
VERMNAG DE SAINT-MAUR (mm.). Dcux potcs (l'un g"rand
rapport dans les journaux. L'un est pote et homme du
sici<'; l'autre est abb, pote et orateur, et c'est celui qui a
jet le plus g-rand clat. Son oraison funbre pour le pre-
mier prince du sang- a rappel les beaux jours de Bossuet.
On a surtout reconnu la belle expression de Limon orga-
nis, que l'orateur applique son hros, et que Bossuet
n'et peut-tre jamais trouve. M. l'abb de Verninac passe
de ces crmonies lug-ubres un bal, et n'y est point tran-
ffer : il demande en petits vers l'honneur de valser avec
la plus jolie femme de la socit. Omnis Aristippuni
decuit status, color et res.
viviLLE (m. Marchand de la). Auteur d'un millier de
fables qui n'ontencore instruit, charm ou corrig que quel-
ques maisons particulires, o M. de la Viville les lit assi-
duement. Ce pote, qui on][reproche quelquefois sa gloire
prive, et qu'on voudrait rendre la nation, rejette la faute
sur les libraires de Paris qui s'obstinent de concert et
depuis dix ans ne pas imprimer son Recueil. Voici le mot
de cette conjuration. Ce n'est pas que les libraires craignent
Sour
M. de la Viville
;
ils ne sont que trop srs de le ven-
re; mais ils tremblent pour La Fontaine qui resterait dans
leurs boutiques. Que M. de la Viville cautionne La Fon-
taine, ou en puise toutes les ditions qui existent, et nous
lui rpondons d'une prompte impression. Voyez une de ses
dernires fables qui commence par ces vers :
Un magnifique cerf-volant
Ne put maintenir la concorde
Avec sa corde, etc.
viLLARS (m. de), trs-connu par un beau quatrain M. le
marquis de Condorcet, qu'il met l'aise entre Voltaire et
d'Alembert. Cette place convient l'acadmicien, orateur et
g^omtre qui pourra s'amuser pendant le reste de sa vie
calculer la distance qui spare d'Alembert de Voltaire : il ne
trouvera pas aisment la parallaxe de ce dernier: mais en
les prenant tous deux niinimis, il se rapprochera plus
facilement de la g-omtrie de Voltaire et de la littrature de
d'Alembert. Nous ne connaissons de M. Villars que ce petit
quatrain.
wiLMAiN d'abancourt (m.). Commcut un homme peut-il
trouver le temps d'crire ce qu'un autre homme n aurait
jamais le temps de lire, en leur supposant g-alit ak^Q et
de vie? Tel est le problme qui se prsente l'esprit lors-
qu'on se met contempler la liste des ouvrages de M. Wil-
main d'Abancourt. Plusieurs pomes de toute forme, cinq
ou six cents fables, des pices fu^-itives par milliers, des ro-
mans par douzaines, etc., etc. Personne encore n'a pu se
vanter d'avoir lu tout M. Wilmain. On se flicite d'tre
homme quand on voit tout ce qu'un homme peut faire; ce
spectacle charme notre faiblesse; mais il
y a un secret retour
de l'amour-propre qui se sent bientt cras de la comparai-
son. Ce retour est invitable, et c'est ainsi qu'un crivain
peut tre la fois l'orgueil de l'espce humaine, et pourtant
humilier chaque lecteur en particulier.
vixouzE (m. de la), doyen des potes auverg-nats. Clermont
lui doit deux beaux pomes piques, un sur l'avnement de
Philippe V au trne d'Espagne, en quinze chants; l'autre,
sur Louis XIV. En lisant ces deux pomes, suivis d'une
foule de petites pices charmantes, on ne peut se dfendre
d'une secrte jalousie quand on songe que Paris ose peine
compter un pome pique, et qu'une ville du quatrime
ordre en a deux
;
quand on songe surtout que les Auver-
gnats prennent plus de plaisir lire M. de la Vixouze que
Voltaire n'en a jamais donn aux Parisiens! On rougit de
cette jalousie, mais on ne peut s'en dfendre, tant elle est
naturelle et bien fonde.
vosGiEN (m.). Ce pote a mis en vers les Conseils d'une
Mre. Cette petite pice, jete d'abord dans un Recueil peu
connu, s'est glisse peu peu et sans prneurs dans tous les
mnages. Elle entre aujourd'hui dans le trousseau des filles
de bonne maison, qui ont trouve fort doux de n'tre plus
LITTliftATUIVi:
89
grondes qu'en vers par leurs mres. M. Vosii^ien a fait une
rvolution sans
y
son^-er peut-lre. On attend de jour en jour
ses Conseils d'un pre.
N. B. Les lettres X, Y, Z, se trouvant frappes de stri-
lit, la g-loire, toujours soumise aux arrts du hasard, ne
fera rien pour elles, puisqu'elles n'ont rien fait pour nous.
On peut les comparer ces toiles nbnleiisesque les astro-
nomes se contentent d'indiquer dans leurs catalogues. Il
n'y a que M. Piis qui ait pu faire quelque chose pour l'.V,
y et Z dans son Pome de illarnionie ; c'est l qu'ils ont
un rang- et une existence :
Renouvel du XI, l'X excitant !a rixe.
Laisse derrire lui l'Y Grec, jus: prolixe;
Et mis malgr son zle au mme numro
Le Z, us par l'S, est rduit zro.
On peut ajouter ces beaux vers que l'A' fut illustr chez
les Grecs par une foule de g-rands hommes dont il commen-
ait le nom, que l' Fa le mme honneur en Orient et que le
Z rgne en Afrique. Mais quelque amabilit qu'on suppose
ces trois caractres, peut-on les comparer au B, au
6',
au
/> et toutes ces heureuses lettres sous qui sont rangs des
potes et des orateurs sans nombre? Conduiront-elles,
comme ces tendards de la renomme, des troupes d'immor-
tels la postrit? 11 faut donc convenir que les lettres
alphabtiques ont aussi leur fatalit comme nous et nos
livres. Habent sua
fat
a libelli.
Arrivs au terme de la plus brillante carrire que jamais
homme de lettres ait parcourue, nous craignons que les lec-
teurs, fatigus du parfum de nos loges et de l'clat de nos
peintures, ne nous accusent d'un peu de monotonie : ils
trouveront peut-tre que nous n'avons pas assez vari les
formes
;
mais nous les prions d'observer que dans une no-
menclature aussi tendue, nous nous sommes perptuelle-
ment trouvs entre M. Briquet, pre d'une petite chanson,
et ^{.Braquet, arm d'un couplet; entre ^I. Dudoucet et
M. Auzonet, tous deux chargs d'acrostiches; entre
MM. Bouriqnon et Araignon, galement riches en bouts
rimes. Comment le plus mcontent et le plus fcond de nos
lecteurs s'en serait-il tir? Aurait-il voulu gter ses balances
90
niVAROL
et mentir son jugement pour ayer la fantaisie ou pro-
mener les caprices de quelques g-ens du monde? Etions-nous
donc au pays des chimres, pour nous livrer notre imagri-
nation?... Si on
y
rflchit, on s'appercevra bientt que des
historiens tels que nous, asservis la rig-ueur des ressem-
hlances, ont d souvent se trouver
embarrasss; car enfin,
la littrature a ses Mnechmes, surtout quand il
y
a identit
de genres. Quelle difltrencey a-t-il entre MM. IJalet ci Hol-
ler ? Gomment sparer deux hommes unis par le mme
quatrain et la mme erloire? Il nous semble donc (et c'est
avec candeur que nous nous rendons ce tmoignag-e) que les
portraits sont encore plus varis que les fig-ures; et que si
l'art n'a point gal la nature, le travail a surpass la ma-
tire. Maleriam superavit opus.
Nous dirons aussi que cet ouvrage n'ayant pu tre com-
menc qu'au premier janvier, poque o paraissent tous les
Recueils de vers, dont nous ne pouvions nous passer, il a
fallu faire marcher de front l'auteur et l'imprimeur, et
livrer les notices fur et mesure, sans pouvoir jamais les
comparer entre elles. C'est ainsi que l'Almanach de nos
rands hommes a t compos et imprim tout ensemble.
a postrit apprendra tous ces dtails avec le plus vif int-
rt.
Mais, en finissant, qu'il nous soit permis dejeter un coup
d'il de complaisance sur cet immense tableau form sous
nos yeux, sur ces oi-lorieuses archives de la renomme rdi-
f?es par nos mains, sur cette clatante liste de grands
hommes qui nous devront l'immortalit qu'ils dispensent
tant d'autres. France! ma patrie! voil donc ta solide
gloire et tes vritables richesses ! Voil les auteurs de toutes
les nouveauts dont tu es idoltre, de ces brillantes nou-
veauts qui te tiennent en haleine d'un bout de la vie l'au-
tre, qui te dispensent de lire les ouvrages des anciens, du
sicle de Louis XIV et de tes rivaux, et te dlivrent de trois
choses g-alement onreuses, de ton temps, de ton argent et
de tes ides ! Oui, ce sont l les enfants dont tu peux t'ho-
norer; c'est par ces cts brillants que tu peux te montrer
l'Europe.
N'es-tu pas en effet la premire puissance litt-
raire?
Que l'Ang-leterre, l'Italie, l'Espag-ne et l'Empire
runissent leurs g-rands hommes vivants, pourront-ils sou-
tenir la comparaison? et ne scheront-ils pas de dpit et
l
LllTKIlAlUnE
QI
d'envie, quand ils verront que ce n'est pas en compulsant
des sicles et des bil)liothques, mais dans une seule gn-
ration et parmi quelques brochures que nous avons trouv
toute celte florissante jeunesse? Car il faut, Franais, que
je vous apprenne enfin le secret de vos ennemis et le vtre:
ce n'est {)oint Voltaire, Montesquieu, BufTon ou Rousseau
qui en imposent vos perfides voisins
;
ce n'est pas sur cinq
ou six crivains qu'ils vous jug-ent; c'est sur la foule tou-
jours immortelle et toujours renaissante de vos jeunes
g-rands hommes; ce sont les piqres multiplies des journaux
et des Almanachs qui font soufrir mille morts aux Anglais
et aux Allemands. Ils ont fort bien support VEsprit des
Lois, Emile, la Piicelle et vos thtres; mais ils ne sou-
tinent pas l'efort de vos charades et de vos fugitives. Et
cet Almanach, que nous avons enfin termin, ne va-t-il pas
semer l'pouvante dans toute l'Europe? Quand nous n'au-
rions fait qu'un acte de patriotisme, notre gloire ne serait
pas mdiocre. Mais ce qui va nous combler de joie, c'est
qu'en nous rendant si respectables aux yeux du reste de
l'Europe, ce livre doit ncessairement rveiller l'mulation
d'une foule innombrable de jeunes gens, qui, forms trs-
videmment pour la pice fugitive, crs et mis au monde
pour faire des nigmes, se jettent dans les lois, dans les
armes, dans le commerce, dans tous les arts et mtiers :
perte immense et douloureuse que nous ne saurions assez
dplorer 1
Nous esprons qu'anims par la plus flatteuse des rcom-
penses, et prfrant l'immortalit dont ils sont assurs avec
nous au vil plaisir de passer une vie phmre dans les em-
barras de la fortune, ils se hteront de nous envoyer leurs
petites pices et leurs bouts rimes, suivis de leurs noms,
doubles et triples, du lieu de leur naissance, et mme de
leur ge, afin que notre Almanach soit toujours plus bril-
lant et plus riche tous les ans.
Un dernier et puissant motif d'mulation pour la jeunesse
c'est que leurs ouvrages, sous le nom de nouveauts, passent
en foule dans les les et
y
forment les livres classiques des
Croles, si bien qu'un habitant de Saint-Domingue, en
arrivant Paris, ne demande point aux barrires Fonte-
nelle ou Buffon, dont il n'a jamais ou parler; mais il de-
mande M. Mayer ou M. de Cubires,dont les romans et les
ga
tUVAHOL
vers l'ont tant de fois charm. N'est-il pas agrable de
rgner ainsi sur la plus vaste moiti de la terre, sur une
nation vierge encore et qui n'en veut qu' la belle nature?
Notre Almanacli va remonter l'Europe la hauteur amri-
caine, et lui faire secouer jamais le joug des anciens
modles et de tous les prjugs de la vieille lillrature.
Si par malheur (ce qu' Dieu ne plaise) quelques lecteurs
mal intentionns, et ne se croyant qu'habiles, allaient soup-
onner que nous ne sommes pas de bonne foi et que nos
loires sont des blmes, nos conseils des perfidies et noire
gravit un jeu, que nous resterait-il faire, que de nous
renfermer dans notre innocence et de pleurer sur celte per-
versit du cur humain qui empoisonne les meilleures
choses? M. Daquin de Chteau-Lion a-t-il jamais l suspect
dans les nombreuses promotions de grands hommes qu'il
fait chaque anne? Le Mercure ne met-il pas au jour cinq
ou six grands hommes par semaine, sans la moindre rcla-
mation et sans le plus lger scandale?Et si M. Panckoucke
et M. Daquin, au lit de mort et l'heure de vrit, s'avi-
saient tout coup de dire qu'ils n'ont fait que plaisanter
pendant cinquante ans, faudrait-il les en croire sur leur
parole? Pour nous, loin de soufl'rir qu'un petit codicille nous
ravt tout coup vingt ou trente mille grands hommes et
dshonort la nation, nous opposerions la vie entire de ces
deux rdacteurs leur dernier quart d'heure, et nous croi-
rions qu'ils ont perdu l'esprit avant de rendre l'me.
Mais la puret de nos vues nous rassure, et nous nous en
rapportons ce que nous avons dit plus apertement dans
la Prface de ce livre, qui est tout d'une pice d'un bout
l'autre, et dont le but moral ne peut chapper personne.
LITTHATLRK
^3
SUPPLMENT
AL' PETIT ALMANAGH DE NOS GRANDS HOMMES,
Pour Canne ijSS.
Plus on en loue, et plus il s'ea
prsente.
Volt., Pauvre diable.
AVERTISSEMENT
A peine a-t-on su dans le monde que notre entreprise
n'tait pas une chimre, ainsi que certains malveillants
l'avaient fait esprer, qu'il nous est venu de tous cts des
inscriptions en assez grand nombre, et d'un assez g-rand
poids, pour solliciter un Supplment. Nous allons
y
proc-
der, afin que cet important ouvrage approche de plus en
plus de la perfection laquelle il est appel, et qu'il est
pourtant de son essence de ne jamais atteindre; puisqu'tant
annuel de sa nature, au moment mme o nous le compo-
sons, il peut natre et il nateilectivement plusieurs Grands
Hommes dans les journaux, qui se jouent de notre exacti-
tude, et la mettent ncessairement en dfaut.
Mais avant tout, nous dclarons l'univers entier (et ceci
est sans appel) que cet ouvrage n'ayant t conu que dans
les vues d'encourager la jeunesse, et de la pousser soit dans
l'Acadmie, soit dans le monde, nous n'admettons jamais
les noms de ceux qui auront fait une fortune littraire, et
qui par consquent peuvent se passer de nos loges. L'obs-
curit n'est donc pas un titre pour notre almanach, quand
on est de l'Acadmie, et nous comptons pour rien la mdio-
crit quand elle est la vogue. Ceci peut s'appliquer tous
les cas, et sera irrvocable.
En consquence, nous avons fort mal reu les jolis vers
de '^l.GaWa.T.SLir le Panaris de Madame du Foarqueux^
insrs dans tous les journaux.
Nous avons trs mal reu tous les opras de M. Sdaine,
plus riche lui seul en citations convenables notre Alma-
nach que toute la littrature ensemble.
Nous avons retus les petits couplets de M. le comte de
9^
nivAnoL
Choiseul-Meuse, tout prcieux qu'ils sont. Pouvons-nous
ajouter la rputation de cet crivain?
Nous refuserons trs firement le porte-feuile de M. le
comte de Barruel-Beauvert. Qu'a-t-il faire de nos loges?
Nous n'accepterons pas les chansons de M. le marquis
de
Champcenctz, pas mme celles que ses ennemis lui accor-
dent.
Nous rsisterons g^alement aux offres de M. le marquis
de Marnesia, quoiqu'il puisse nous tenter avec un grand
pome sur la nature.
Nous n'accepterons jamais la fable du Pcher et du Peu-
plier de M. le vicomte de Sg^ur, quoique infiniment
notre biensance.
Nous laisserons gnreusement M. le comte de Ses-
maisons tout ce qui semble nous appartenir en lui.
Nous serons inexorables pour M. le chevalier de Florian,
bien qu'il pt, ses vers la main, forcer l'entre de notre
Almanach.
Nous la fermerons aussi M. le chevalier de Bertin,
quoiqu'il se soit cart de M. de Parny pour nous faire sa
cour.
Nous renverrons dcidment les tablettes de M. le comte
de Tilly, malgr l'urgence de nos besoins.
Enfin, plus sa^-es que Voltaire, nous serons sourds aux
cajoleries multiplies de M. le marquis de Villette.
Qu'ajouterait notre faible voix la renomme et l'mu-
lation de ces heureux crivains, gens de lettres et gens du
monde ?Ne vaut-il pas mieux garder nos encouragements
et nos conseils pour les pauvres qui les demandent, que de
les offrir aux riches qui les ddaignent ? Ne sommes-nous
pas les Don Quichottes del littrature, et n'est-ce pas nous
tendre la main aux faibles, dissiper l'obscurit des uns,
clairer le talent des autres, les avertir tous du succs
de leur mrite ?
Fidles nos principes, nous allons passer au Supplment.
BXDON (m.) est rellement auteur d'une tragdie intitule:
Sinoris. Il n'est pas de prcautions que nous n'ayons
employes pour viter les surprises.
Bor^NAY (m. de). Nous avons dpos ses chansons et ses
LITTnATURE QS
nigmes en main tierce, et nous sommes prts les pro-
duire, s'il s'lve quelque cloute sur l'existence de ce pote.
CAMiNADE DE CASTRES (m.). Nous invitous ce potc nous
faire passer ses uvres ou un certificat de vie.
CHAUDON (m. l'abb) nous a recommand son Dictionnaire
des Grands Hommes morts, en huit volumes. Nous ne sau-
rions nous-mmes trop recommander aux jeunes ^ens la
lecture d'un Rpertoire, o l'on trouve l'article Racine :
Que Milhridaie n'est qu'un pithalame
;
que, sans les
fureurs d'Oreste et d'Hermione, Andromaqiie serait une
u
assez bonne tragdie, etc. )) Presque tous les jug-cments de
cet illustre abb sont aussi neufs, et jetteront un grand jour
sur toute la littrature.
cossoN DE LA CRESSONNIERE (-M.). Ses couplcts sout impri-
ms et signs.
cousTiLLiER (m.). Sou diaioguc en vers avec M. de l'Em-
pire parut, il y a dix ans, ou, pour mieux dire, fut cach
dans un Recueil tranquille et modeste qui ne faisait pas
parler de lui. L'efl'et de ce dialogue avait sans doute t
calcul pour dix ans, puisqu'il n'a fait explosion qu'avant
hier, mais cet effet n'en est que plus terrible, et la renom-
me se ddommage amplement du silence auquel M. Cous-
|tillier l'avait contrainte.
DAvm (m.). Pote. Son existence est bien prouve aujour-
d'hui.
DORiGNY (m.), incertain.
DoucET (m.
)
. Deux tmoinsirrprochables nous ont rpondu
d*une chanson de M. Doucet.Nous ne serons pas si faciles
l'avenir, et nous exigerons les pices.
DUMONTELET (m.). Sou Boujour aux Muses n'a pas eu les
suites qu'on en attendait. On ne pouvait pourtant s'y pren-
dre de meilleure heure.
DUPiN (m. l'abb). Cet crivain s'tait cach dans quelques
feuilles du Censeur universel anglais, et le Censeur s'tait
cach chez quelques piciers
;
mais nos infatigables coop-
g
RiVAnoL
rateurs l'ont dterr, et nous l'ont ramen charg' du qua-
train suivant. 11 s'ag-it d'un groupe de Perse et d'Andro-
mde :
Heureux Perse, achve ta conqute
;
C'est peu d'tre vainqueur d'un monstre furieux
;
Sois-le encor d'Andromde, et qu'un myrthe amoureux
S'entrelace aux lauriers que Minerve t'apprte.
DURANDE (m.). Les couplcts sigus de cet auteur avaient
l'air d'tre crits la main, et nous n'admettons que des
pices imprimes.
FEUTRY (m.) Cette omission est encore plus honteuse que
les prcdentes; et M. Feutry, l'un des Nestors de la petite
littrature, ne peut que nous mpriser dans le fond de son
cur. A quoi servent donc quarante ans de travaux et qua-
rante volumes de vers et de prose, s'il faut tre oubli dans
le premier Almanach du coin? Nous ne dissimulons pas
notre tourderie et nos regrets.
FRAlssl^ET DE LA GARRIGUE (m.) Son Commentaire sur
l'dipe de M. Ducis est consult par tous ceux qui n'en-
tendent pas cette pice.
grand'fontaine (m. de), conseiller et pote, garanti par
nos correspondants.
grand'jaouet (m. l'abb). Les fleurs de ces potes loigns
se fanent dans les affiches de province, et seraient l'orne-
ment de nos journaux, si nous tions assez heureux pour
les avoir de primeur. Nous allons prendre des mesures pour
tre mieux servis Tanne prochaine.
jossAUD (le pre), doctrinaire Aix. Une ptre, adresse
un de ses confrres, et insre dans le Mercure, a rjoui
tout le royaume. Ce pote nous
y
apprend que :
Mangeur furieux,
Il dne bien et soupe mieux
;
Qu'il se rgale de fromage.
Ou bien du rble d'un laoin :
LITTRAIUHE
gj
Qu'aussi son teint, nagure hve,
Prend la couleur de la sant;
Que sa joue, autrefois concave.
Acquiert de la convexit, etc.
L'cptre de ce grand homme, adresse un autre grand
homme, est pleine de cette noble familiarit et de ces atails
cliarmanls qui sont le triomphe du vrai pote.
LANDRY DE BUBEL (m.) avouait UAG pigTamme en
1777.
LESCALiER (m.) a fait un pome sur la peinture, o toutes
les difficults sont braves,et les rgles soumises et mates.
En voici un chantillon :
Gerardon plat, mais moins que Vanostade;
Prs de Berghem, Breugle parat maussade :
Et Vauderverf si lch, si fondu.
N'est point gal au large et fin Metzu.
LONGCHAMPs (m. l'abb de). Sa traduction de Properce fait
le plus grand honneur ses murs.
LUNEAu DE BoisjERMAiN (m.). Eucore un de ces noms qui
doivent faire rougir des rdacteurs ngligents. Cet crivain
a remis Racine en honneur par son admirable Commen-
taire : mais aussi courageux qu'habile, il avoue, dans ses
notes sur Phdre
^
que les figues
incohrentes et les ex-
pressions recherches du style font grand tort la pice.
M. Luneau de Boisjermain, outre son commentaire, a crit
vingt volumes de vers et de prose. On dit aussi qu'il pr-
pare des notes sur le Molire de feu M. Bret.
MAiziRE (m.), professeur Reims. Voyez comme il fait
parler homriquement le fier Achille au vieux Priam, qui
lui demande genoux une trve de douze jours :
J'y consens, dit Achille, en lui serrant la main
;
Adieu, compte sur moi; tu peux partir demain.
MERCIER (m.). Voyez M. RTIF DE LA BRETONNE.
MouTONNET DE CLAiRFONS (m.). Co pote-oratcur, fort peu
touch de notre oubli, est venu nous trs paisiblement,
RIVAROL
CEnfer
du Dante la main; nous l'avons lu avec une atten-
tion die^ne de rparer notre tort, et il nous a paru, au pre-
mier coup-d"il, que M.
Moutonnet tait trop doux pour
traduire TEnfer.
NOL (m. Tabb). professeur l'universit de Paris.
Moins indulsrent que M. Moutonnet, ce pote nous a fait pas-
ser avec
indis^nation son ode sur le prince Lopold de Bruns-
wick. Nous l'avons lue avec rsignation, et nous sommes
encore concevoir pourquoi l'Acadmie Tamise au-dessous
de celle de M. Trasse; il est vrai que, si on l'et mise au-
dessus, nous ne serions pas moins embarrasss. Garo vou-
lait d'abord la citrouille dessus et le g-land dessous; mais il
finit par louer Dieu de toutes cboses.
PERCHERON (m. l'abb), Muse provinciale qui se disting-ue
de jour en jour par l'aimable correspondance qu'elle entre-
tient avec M. Tournon de la Cbapelle. C'est ici une de nos
dernires dcouvertes, et nous la devons aux efforts combi-
ns de deux rdacteurs qui ont fait des prodiges en ce genre.
Nous saisissons avec plaisir l'occasion de rendre hommage
leur sagacit et leur vigilance.
RTIF DE LA BRETONNE (m.). Voyez M. Mercier.
SARROT fM.). Ce pote ayant essay d'craser feu Gilbert,
dans la satire, fut d'abord assez mafreu du public prvenu;
mais il ramena les esprits par une pice de vers o se trouve
cette rponse aux objections qu'on lui fait :
Il n'importe ! la lierne o l'auteur se panade
Distribue ec passant toujours quelque gourmade.
Gilbert eut le bonheur de mourir en lisant la pice.
Fin du Supplment.
LITTEUATURE
Q^
Errata.
BEAUMiER (m.). Prcsque toutcs Igs notices de cet Almanach
sont insuffisantes. I\I. Beaumier a expliqu dans une Pr-
face pourquoi son fameux Hommage la Pairie avait
paru si tard et disparu si tt. Voyez la Prface de la pre-
mire et dernire dition de ce pome, o l'auteur instruit
et console son lecteur.
cossEPH DE usTAHiz (Domj. On vient de nous apprendre
que ce n'est point un moine basque, mais M. Gart, profes-
seur au Lyce, qui se dt^-uise quelquefois ainsi pour savoir
ce qu'on pense de lui, quand son nom n'en impose pas. On
assure que le Grand-Seig-neur a souvent recours ce stra-
tag"me, et qu'il attrape de fort bonnes vrits dans les cafs
de Constantinople, la faveur de ses dguisements.
CRiGNON (m.). Ce pote vient de nous avertir qu'il s'app-
lerait dornavant M. Crignon d'Aiizonet. La renomme
s'arrang-era l-dessus, et le Mercure du
19
janvier
1788 s'y
est dj conform au bas d'un distique, sig-n Crignon
d'Auzonel.
cuBiRES (m. le Chevalier de; nous a fait dire qu'il refaisait
rArt potique de Boileau.
RiGOLEY DE juviGNY (m.). On sc demande souvent pour-
quoi la rputation de Voltaire baisse tous les jours d'une
manire si effrayante; ce problme est l'objet de toutes les
conversations de Paris; et nous en tions tourments nous-
mmes un point incroyable, lorsque M. Rig-oley a daig-n
nous tirer de peine, en nous confiant que c'tait lui seul
qu'il fallait s'en prendre. Nous tions flattes d'tre les seuls
confidents du secret; mais il nous revient de toute part que
M. de Juvirny s'en tait dj ouvert d'autres. Puisque la
chose est publique, nous observerons M. Rigoley de Juvi-
ffny qu'il et mieux fait d'attendre, pour se dcouvrir, que
la belle dition de Voltaire de Baskerville et t livre et
distribue. Il faut toujours viter l'odieux en tout.
Fin de rErrata.
LES AVEUX OU l/ ARCHE DE NOE
Nous avouons que si l'autre jour nous conmes le ma-
gnanime projet de louer toute la littrature inconnue, et (ce
qui est sans exemple) de distribuer un millier de grands
nommes des encouragements et des prix annuels, avec une
magnificence et un luxe vraiment ruineux; c'est qu'il nous
avait paru que Voubli, comme un second dluge, gagnant
de jour en jour la surface du globe littraire, le temps de
reconstruire l'Arche tait la fin venu
;
et nous
y
fmes
entrer tous les animaux portant plumes, tant les mondes
que les immondes
;
l'exception de quelques aigles qui se
sauvrent d'eux-mmes sur la cime des monts.
Nous avouons que, satisfaits de braver en paix l'inonda-
tion, nous ne cherchions pas nous enivrer, au sortir de
l'Arche, des acclamations de toute cette harmonieuse famille,
et que nous ne comptions, en bienfaiteurs clairs, que sur
le paisible silence de l'ingratitude.
Quelle a donc t notre surprise, quand M. le Brigand-
Beaumier, ou Beaumier-le-Brigand (i), dput par l'lo-
quence et la posie, tout coup ouvert les fentres de l'Ar-
che, et ayant t se percher en forme de corbeau sur un
trs beau chardon, a pris la parole, comme il prendrait la
fuite, c'est--dire avec beaucoup de vhmence, pour nous
admonter au nom de toutes les espces I
L'orateur a divis sa colre en deux points.
Il a d'abord t indign que nous eussions port la main
sur le gouvernail de l'Arche, sans lui avoir prouv que nous
fussions d'assez bonne maif^on pour un si minent emploi.
M.le Brisrand-Beaumier nous a dmontr que tout n'en irait
que mieux,si, au lieu de chercher du style et des ides dans
un crivain, on
y
cherchait des titres; et sa logique a conclu
que dornavant on parlerait de naissance dans les muses,
t de littrature dans les chapitres.
Nous avouons que cette mthode a du bon, quand on a,
comme M. le Brij^and-Beaumier, autant de naissance que de
talents; mais ce moyen tait funeste Voltaire, qui on
(i) Quelques savants {retendent que M. le Brierand est un, et M.Beau-
mier un autre
;
il ne faut pas perdre un grand homme pour obtenir
ne alliance de mols.R.
LITTEnXTUnE
101
disait chaque ouvrage qu'il mettait au jour, qu'il
tait
fils
d'un paysan
;
ainsi qu'il le confesse danslesAf
moires
pour serrir sa vie.
L'orateur s'est encore indienne de ce que nous restions
sous le voile de l'anonyme, dans le temps mme o nous
nous donnions pour les Don Quichottes et les sauveurs
de
la petite littrature: il n'appartient qu' la nature d'tre
la fois ma^-niHque et muette, l'anonyme se sent trop de la
majest de Torg-ueil. C'est donc pour nous deviner que
l'auteur, exerc aux lo^o^-riphes, a trouv que nous tions
des vignerons, comme le vieux No
;
ou tout au moins des
laboureu rs. \iu'isque nous dfrichions les landes de la rpu-
blique des lettres; ou enfin des cuisiniers faisant noces et
festins,
puisque nous avions si bien vari les services, en
dressant le grand couvert de l'Arche.
Nous avouons que tout cela est g-alement ing-nieux et
vrai.
Ensuite M.Beaumier nous a accuss d'avoir expressment
oubli tous les potes d'une G;-rande naissance dans notre
liste : cette accusation et quelques autres de cette espce
nous feraient croire que Torateur n'a pu se procurer le
Petit Alnianach, lequel en eflet a t jusqu'ici assez cher.
Nous ayowons que cette chert ne vient pas de nous;
c'est une ide ing-nicuse du libraire, qui n'a trouv que ce
moyen pour drober la connaissance du livre aux petits
amours-propres qui pouvaient sVn irriter.
L'orateur nous a su :r d'une parodie du songe d'Atha-
lle et surtout de l'avoir ddie M. le Marquis D***, aprs
sa disgrce.
Nous avouons que si nous tions les auteurs de cette pa-
rodie, nous prouverons aisment qu'elle lui fut par bonheur
ddie huit jours avant sa retraite
;
et que les auteurs, quels
qu'ils soient, ont la lchet de ne plus rien lui ddier, depuis
qu'il a perdu ses places.
L'orateur nous a avou que le Discours sur la langue
n'tait pas franais pour lui
;
que le Petit Almanach tait
mal crit pour lui.
Nous lui avouons notre tour que nous ne connaissons
pas de louange plus dlicate, et que nous osions peine
y
prtendre.
L'orateur furieux nous a donn un coup de pied avec la
102
RIVAROL
main dont il crit : il nous a mme rappel tous ceux qu'il
nous donne familirement chaque fois qu'il nous rencontre
aux Tuileries.
Nous avouons qu'il n'y a rien de si ais que de nous don-
ner des coups de pied, et nous les recevrons toujours avec
reconnaissance.
Enfin, Toratcur s'apercevant qu'un pamphlet, quand il
est inrnieux, est une friandise pour nous, a cach son
venin dans la btise.
Nous avouons que nous ne serons jamais l'preuve de
cette arme-l, et nous demandons grce l'orateur. S'il
nous poursuit encore, nous nous plastronnerons avec ses
uvres qui sont au garde-meuble de la librairie.
LETTRE
SUR L'OUVRAGE DE
Mme
DE STAL,
INTITUL : DE l'iNFLUENCE DES PASSIONS, CtC,
PAR UN AUTEUR CLBRE,
SIGN, LUCIUS APULEIUS.
1797
Pourquoi me demandez- vous ce que je pense d'un livre
que je ne suis pas en tat de lire? Je me souviens que l'au-
teur de Strafford
disait un jour une femme de got, dont
il ne se mfiait pas assez : Que pensez-vous de mon livre ?
Cette femme lui rpondit : Je fais
comme vous, Monsieur,
je ne pense pas. Tout le monde aussi pourrait dire l'au-
teur de iinjluence des passions : Je fais comme vous,
Madame, je n'y entends rien.
En efet, l'apocalypse serait transparente ct de ce
livre : il est tel, qu'il
y
aurait plus de vanit que de bien-
veillance le louer, et que je dfie l'homme le plus mal
intentionn d'en rien conclure contre l'auteur : mais, si on
ne peut expliquer les mystres, on peut du moins en parler
et s'en tonner.
Nous voyons, d'un ct, M. Necker crire constamment
contre sa rputation d'homme d'Etat, et, de l'autre, madame
de Stal, sa fille, s'armer d'un bon volume contre sa rpu-
tation de femme desprit. Il
y
a l-dessous quelque grand
dessein : cette famille nous a accoutums aux projets, aux
miracles, aux mystifications de toute espce. Dans une note
o elle se laisse pntrer, l'auteur dit que ceux qui se res-
semblent se comprennent; ce qui donne l'exclusion bien
I04
RIVAHOL .
du monde. Et cependant, malgr l'oracle, la plupart des
journalistes n'ont pas craint de commenter ce livre : ils auront
peut-tre fait comme l'Ang-leterre, ils auront pris une
dportation pour une descente. Je dis peut-tre; car,
en vrit, je ne suis sr de rien. Au reste, l'pigraphe du
livre dit assez que madame de Stal est ennemie de (a
lumire
;
sur quoi j'observerai que la franchise des pi-
graphes est un trait de caractre dans la famille. On peut
se rappeler que M. Necker, chapp sa rputation, sa
g-loire, sa popularit et la France, en
1791,
fit, de sa
baronnie de Coppet, une sortie in-8'^ contre le pa^'s o il n-
devait plus rentrer. L'pierraphe tait tire du Roi Lear :
Soufflez, soufflez,
temptes; vous le pouvez sans ingra-
titude;
Je
ne vous ai pas donn un royaume. Cette g-rande
dupe de la rvolution avouait donc qu'il avait donn le
royaume l'Assemble Constituante ! Mais laissons l
M. Necker, entre un pass sans excuse et un avenir sans
espoir, et revenons madame sa fille.
Supposons, pour un moment, que ce singulier phno-
mne d'un livre trs obscur crit par une femme d'es-
prit ne nous cache pas quelque profond dessein, et voyons
comment on pourrait l'expliquer, hum-ainement parlant.
On connaissait jusqu'ici en France deux sortes de femmes
classiques. Les premires en date, sans contredit, sont
madame du Noyer, l'auteur du Magasin des enfants (i),
madame de Villedieu, madame d'Aunoy et madame de
Genlis. Leurs livres ne quittent pas l'enfance et les anti-
chambres : ce sont des livres invitables. Aprs celles-l on
lit les Svign, les Deshoulires, les la Fayette, les du Ch-
telet, et quelques autres qui se sont plutt rapproches des
Sapho et des Aspasie que des Genlis : mais enfin point de
bonne ni d'enfants sans les unes, et point d'ducation ni
de monde sans les autres. En un mot, la diffrence entre
elles est de l'enfance au reste de la vie, et de l'antichambre
au salon et la bibliothque.
Madame de Stal, s'ouvrant une route nouvelle, a droit
de commencer un nouvel ordre. Il s'agit donc de se faire
ici quelques notions sur cette femme extraordinaire
;
car je
ne croirai jamais qu'elle soit une nigme sans mot. Pour
(i) Madame Le Prince de Feinmont.
LITTUATURK
I05
lexpliqiicr pourquoi les g-ens d'esprit crivent
quelquefois
sans succs, il faut ncessairement recourir la distinction
de l'esprit et du talent.
Tous les hommes, sans exception, prsentent deux aspects;
'l'un par lequel ils ressemblent, et l'autre par lequel ils
diffrent. Or, c'est ce que les hommes ont de commun entre
,|3ux qui est important; ce qu'ils ont de diffrent est peu de
3hose
;
car ils ont en commun le miracle de la vie et de la
pense, et ils ne diffrent que par des nuances trs fines
l'org^anisation et d'ducation. La diffrence entre un c^rand
lomme et un portefaix n'est presque rien aux yeux de la
lature; mais ce rien est tout aux yeux du monde. Entre
me tulipe de deux sous et une de mille cus, le Hollandais
jaie cher la diffrence; et cependant ces deux fleurs sont
jgalement l'ouvrag-e de la nature
;
elles ont g-alement des
ltales, une tige, des feuilles, des racines, des couleurs et
lu parfum; et c'est en effet dans cet attirail de la vg-ta-
ion qu'est le miracle : la nuance qui le distingue n'est
ien. C'est cependant ce rien qui fait pmer d'aise le jardi-
ner fleuriste, et qui lui vaut mille cus.
Or, dans le monde, c'est cette diffrence d'homme
lOmme, cette nuance, ce rien qu'on appelle gnie, imagi-
'.ation, esprit et talent, qui est compt pour beaucoup;
ar je ne parle pas ici des diffrences extrieures, telles que
1 force et la beaut
;
ni des diffrences sociales, telles que
richesse, la naissance et les dignits
;
diffrences qui
ment d'ailleurs un si grand rle.
On peut tablir pour rgle gnrale que, toutes les fois
ue les hommes entassent diffrents noms sur un mme
bjet, il
y
a confusion dans leurs ides. En effet, on a tou-
>urs trop confondu l'esprit et le talent
;
et pourtant la dif-
^rence est si considrable que c'est d'elle que je me servi-
li pour expliquer madame de Stal.
Nous avons tous des ides, comme nous avons tous un
isage; peu d'hommes, cependant, ont de l'esprit et del
figure. Il faut, pour cela, un certain ordre dans les traits et
ans les ides : il faut surtout la pense de la varit, de
i nouveaut et du mouvement. Un homme, dont les dis-
eurs ne roulent que sur des objets communs, et qui ne
uitte pas les formes ordinaires de la conversation, ne passe
as pour avoir de l'esprit : il a beau s'exprimer de manire
I06 niVAROL
tre entendu, il n'a rien d'expressif.
Mais celui dont les
ides sortentdes routes communes, qui joint l'extraordinaire
la rapidit
;
celui qui, en un mot, dplace les ides de
ceux qui l'coutent, et leur communique ses mouvements,
celui-l passe pour avoir de l'esprit
;
que ses ides soient
justes ou non, exprimes avec g"ot ou sans j^ot, n'importe;
il a remu ses auditeurs, il a de l'esprit. Je ne parlerai pas
ici de la diffrence de l'esprit l'imag-ination active et au
g-nie; ce n'est pas mon objet : il faut en venir au talent.
|
Qu'un homme exprime ses ides ou celles dautrui avec!
force, avec ej-rce, avec sduction
;
qu'il dise des choses
i
communes, si l'on veut; mais qu'en les disant ou en les
crivant, il les pare du charme de l'expression, il aura du
talent en vers comme en prose.
Il V a g-nralement plus d'esprit que de talent en ce
monde. La socit fourmille de g-ens d'esprit qui manquent
de talent.
L'esprit ne peut se passer d'ides, et les ides ne peuvent
se passer de talent
;
c'est lui qui leur donne l'clat et la vie :
or les ides ne demandent qu' tre bien exprimes, et, s'il
est permis de le dire, elles niendient l'expression. A^oil'
pourquoi l'homme talent vole toujours l'homme d'esprit :
l'ide qui chappe celui-ci, tant purement ingnieuse,
devient la proprit du talent qui la saisit.
Il n'en est pas ainsi de l'crivain ^-rand talent
;
on ne
peut le voler sans tre reconnu, parce que son mrite tant
dans la forme, il appose son cachet sur tout ce qui sort de
ses mains. Virgile disait qu'on arracherait plutt Hercule
sa massue qu'un vers Homre.
Le mrite des formes et la faon sont si considrables
que M. l'abb Sieys avant dit quelqu'un de ma connais-
sance : Permettez que je vous dise ma
faon de penser^
celui-ci lui rpondit fort propos : Dites-moi tout uniment
votre pense, et pargnez-moi la
faon
(i).
J.-J. Rousseau, par exemple, emprunte la plupart de ses'
(i) L'anecdote est ainsi raconte dans le Journal Royaliste (2 juin
1792)
: M. de R... s'etant trouv avec M. l'abb Sieys, l'abb s'ex-
prima ainsi : Je vais vous dire ma
fnon de penser. M. de R..., faisant
allusion la difficult avec laquelle cet abb s'explique, dit : Epar-
gnez-moi la faon, et dites-moi seulement votre pense. Sur quoi rabbj
se retira.
LITTEn\TUft3
07
ides Plutarque, et surtout Montaig-ne , mais il trouves!
o\en dans son talent de quoi parer ses vols ou ses emprunts,
lue l'intrt n'en est jamais perdu pour ses lecteurs. On
liirait en effet que les ides sont des fonds qui ne portent
Intrt
qu'entre les mains du talent.
Maintenant, pour en venir madame de Stal, il me sem-
ble, si toutefois son livre n'est pas im pige, il me semble,
lis-je, qu'on peut avancer qu'elle a inliniment plus d'esprit
[ue de talent; la dillerence de madame de Svig-n, qui
ixprimait si bien tout ce qu'elle entendait, et qui peig-nait si
)ientout ce qu'elle vovait. Horace dit, en parlant de Sapho,
fue les Jlarnnies chappes de ses do/ts vivent encore
(ans les cordes de sa lyre. C'est donc le vritable signe
jlu talent que ce caractre de vie qui anime et colore tout ce
[u'il touche; mais une femme sans talent est la martre de
on esprit; elle ne sait que tuer ses ides.
Ce n'est pas que madame de Stal soit ridicule comme
il. G... (i), qui, ayant pris des log^arithmes pour des log-o-
Tjphes, trouve dans cette heureuse mprise de quois'len-
re, s'amplifier et s'vaporer en stvle ^vienu. potique
;
de
uoi se composer un calme, une tempte, l'toile du nord,
? vaste ocan, la boussole, des sauterelles et des mois-
ons, etc., etc., et qui, tonn de sa propre fcondit, s'crie
Dmme Sosie: Voil bien des gentillesses potiques!
|uelle chose inconcevable que cet article
(2)
!Les Parisiens
Dnt bien heureux, aprs tant d'infortunes, d'avoir un jour-
aliste si bouffon, qui leur propose de porter
dfaut de
ouronnCj chacun une lumire sur la tte; qui veut que
s boutiquiers aient, la place d'un barme, les loga-
ithmes de Gardiner sur leurs comptoirs
(3).
Nous invitons aussi madame de Stal laisser au frre d'A-
el Chnier les fausses expressions, telles que les vertus s-
ilaires de M. Lamoig-non. On entend par sculaire, cequi
ivienttous les cent ans
;
par annuel, ce qui revient tous
s ans, comme les serments du peuple franais. Il s'ag-it de
ivoir si les vertus de M. de Lamoig-non ne paraissaient que
(i) Garat.
(2)
Voy. le n* i3 de la
Clef du Cabinet, etc., i3 janvier
1797.
R.
(3)
Riva roi n'invente rien. Dans cet article de la
Cief, Garat annonce
ie nouvelle Table des logarithmes dans le style de la Nouvelle Hlose.
y
a l deux pages bien comiques.
I08
RIVAROL
tous les cent ans. Mais laissons encore ce nouveau pote,
qui ne connat ni les jeux, ni les pomes sculaires des
anciens; laissons-le, dis-je, prolester de son rudition et de.
son talent, de sa prose et de ses vers la main. !
Madame de Stal n'a qu'une chose craindre, c'est que son
talent ne fasse chec son esprit. Elle parle, je ne sais o,
du temps afifreux dont nous avons vcu contemporains :
comment son oreille n'a-t-elle pas t blesse de cette expres-
sion ? Le style est tout, a dit Buffon; miroir et mesure des
ides, c'est sur lui qu'on nous jug-e.
Quand un crivain se couronne de pavots, c'est en vain
que les lyces lui jettent des lauriers.
Que, dans le sicle o nous sommes, un homme, se trou-
vant sans esprit, sans imagination et sans talent, prenne un
fourneau, un alambic, une machine lectrique, et se fasse
chimiste ou physicien, on entendra parler de lui, on verra
clore ce nom inconnu, dont on sera forc de se charger
la mmoire; et, grce leur ignorance, la plupart des gens
du monde ne sauront jamais jusqu' quel point on doit
estimer ou mpriser ce manuvre. Il n'en est pas ainsi en
littrature : quatre lignes de prose ou quelques vers classent
un homme presque sans retour : il n'est pas l de dissimu-
lation.
Cet tat des choses durera jusqu' l'poque heureuse pr-
dite par M. G... poque d'galit et de nivellement, o
tout le monde aura autant d'esprit que M.G...
J'ai l'honneur d'tre, en attendant,
Lucius Apuleius.
LE GNIE ET LE TALENT
(j)
Le
g"nie, tant le sentiment, au plus haut degr qu'on
puisse le concevoir, peut tre diini /acuit cratrice, soit
3u'il trouve des ides ou des expressions nouvelles. Leg-nie
es ides est le comble de l'esprit; le g"nie des expressions
est le comble du talent. Ainsi, que le g-nie fconde l'esprit
ou le talent, en fournissant des ides l'un et des expres-
sions l'autre, il est toujours crateur dans le sens qu'on
attache ordinairement ce mot : le g"nie est donc ce qui
eng'endreet enfante: c'est, en un mot, le don de l'invention.
Il rsulte d'abord de cette dfinition que la diffrence
du
g-nie l'esprit n'est au fond que du plus au moins
;
et
cette diffrence suffit pour que le g-nie soit trs rare : en-
suite, qu'on peut avoir le g-nie des ides et manquer d'ex-
pressions cres
;
et qu'on peut tre dou du talent de l'ex-
pression et manquer d'ides g-randes et neuves.
On a donn tant d'acceptions au mot esprit que je crois
devoir renvoyer ce dtail au dictionnaire de la lang-ue, et
m'en tenir la valeur commune et g-nrale attache ce
mot. L'esprit est donc, en g-nral, cette facult qui voit vite,
brille et frappe. Je dis vite, car la vivacit est son essence :
un trait et un clair sont ses emblmes. Observez que je
parle de la rapidit de l'ide, et non de celle du temps que
peut avoir cot sa poursuite. Ainsi, qu'heureux vainqueur
des difficults de l'art et de la paresse de son imag-ination,
un crivain sme son livre de traits plus ou moins ing-nieux,
il aura fait un ouvrag-e d'esprit, lors mme que cet ouvrag-e
lui aurait cot la moiti de sa vie. Le g-nie lui-mme doit
ses plus beaux traits, tantt une profonde mditation, et
tantt des inspirations soudaines. Mais, dans le monde,
l'esprit est toujours improvisateur; il ne demande ni dlai
(i) On peut lire avant ce morceau, pour savoir l'importance que Ri-
varol donne au sentiment (nous dirions aujourd'hui la sensibilit), le
chapitre du Sentiment, au livre III.
IIO
ni rendez-vous pour dire un mot heureux. Il bat plus vite
que le simple bon sens; il est, en un mot, sentiment prompt
et brillant. Toutes les fois que l'esprit se tire de cette dfi-
nition
;T;-nrale, il prend autant d'pithtes diverses qu'il a
de varits.
Je dfinis le talent, un art ml d'enthousiasme : s'il n'-
tait qu'art, il serait froid; s'il n'tait qu'enthousiasme, il
serait drgl : le g-ot leur sert de lien.
On voit par l qu'il
y
a autant de talents dans ce monde
que d'arts : d'o viennent les emplois varis du mot talent
depuis l'art d'crire jusqu'aux mtiers mcaniques.
Le g-nie ou le talent des expressions, le style, la diction,
l'locution, l'lgance, l'invention dans le style, la verve et
la posie de style, l'imagination dans l'expression, enfin la
cration, sont autant d'apanages du gnie : j'en renvoie les
dveloppements au Tableau de la Langue (i).
Seulement, il faut observer que la verve a plus de rap-
ports avec la vigueur de l'expression, et lenthousiasme avec
les lans et les hauteurs de la pense; et quoique la verve
soit plus commune que l'enthousiasme, cependant le gnie
de l'expression marche de pair avec le gnie des ides,
dans l'ordre des rputations.
Une certaine originalit, le piquant et la grce d'un mot
ou d'un trait, sont du ressort de l'esprit. On sait que dans
les pices l_gres la grce et la gaiet suffisent pour soute-
nir un esprit sans talent
;
et qu' son tour le pur talent et
l'oreille peuvent soutenir quelque temps un homme de peu
d'esprit, ou d'un mdiocre gnie
(2).
Mais on peut dire, en gnral, que le gnie s'lve et s'a-
grandit dans la composition; l'esprit s'y vapore et reste
sec : il est de sa nature de briller, mais de n'clairer que de
petits espaces. Ce qui le distingue encore du gnie, c'est
que celui-ci aime les rapprochements et les analogies : l'es-
prit est plus enclin aux antithses. Quand le gnie n'est pas
soutenu par le talent, il fait des chutes d'autant plus gra-
ves qu'il s'tait plus lev. Le talent sans gnie se soutien-
(i) Ce chapitre n'a pas t crit,
(2)
I\Iais pourtant on a vu le vin et le hasard
Inspirer quelquefois une muse grossire,
Et fournir sans gnie un couplet Linire.
BOILBAU. R.
LITTEUATUUK
IH
drait peine dans une rgion moyenne; de sorte que si le
talent empche le gnie de tomber, le ^nie l'empche de
ramper
L'esprit s'est fait, indpendamment du gnie et du talent,
un domaine part dans le monde : mais, en littrature,
et
surtout dans les grandes conceptions, ses alliances sont sou-
vent funestes au gnie et au talent. C'est plutt au talent
suppler aux intervalles du gnie et aux intermittences
de
Tesprit
;
et c'est, en effet, le secret de Virgile et de Racine:
leur style, qui peint toujours, ne donne pas de trve l'ima-
gination. Quelquefois aussi l'esprit a le bonheur de remplir
les interrgnes du gnie et de masquer les impuissances du
talent. Molire fourmille de ces supplments ingnieux : et
le peintn^qui jeta un voile sur le visage d'Agamemnon, fit
imaginer ce qu'il ne peignait pas, et emprunta son esprit
de quoi se passer du talent.
Il
y
a trois choses destines matriser les hommes : les
expressions qui n'attendent que le talent, les ides qui n'at-
tendent que le gnie, et les forces qui ne demandent que le
courage.
Je reviens au jugement, et je dis qu'il n'a point suffi aux
beaux-arts. Il fallait pour ces nobles enfants du gnie un
amant plutt qu'un juge,et cet amant, c'est le got : car le
jugement se contente d'approuver et de condamner; mais
le got jouit et souffre. Il est au jugement ce que l'honneur
est la probit : ses lois sont dlicates, mystrieuses et sa-
cres. L'honneur est tendre et se blesse de peu : tel est le
got
;
et tandis que le jugement se mesure avec son objet,
ou le pse dans la balance, il ne faut au got qu'un coup-
d'il pour dcider son suffrage ou sa rpugnance, je dirais
presque son amour ou sa haine, son enthousiasme ou son
indignation, tant il est sensible, exquis et prompt! Aussi les
g-ens de got sont-ils les hauts justiciers de la littrature.
L'esprit de critique est un esprit d'ordre : il connat des
dlits contre le got et les porte au tribunal du ridicule
;
car
le rire est souvent l'expression de sa colre; et ceux qui le
blment ne songent pas assez que l'homme de got a reu
vingt blessures avant d'en faire une. On dit qu un homme
a l'esprit de critique, lorsqu'il a reu du ciel, non seulement
la facultde distinguer les beauts et lesdfauts des produc-
tions qu'il juge, mais une me qui se passionne pour les unes
RIVAHOL
et s'irrite des autres, une me que le beau ravit, que lo
sublime transporte, et qui, furieuse contre la mdiocrit, la
fltrit de ses ddains et l'accable de son ennui.
Le recueil des arrts du g-ot s'appelle aussi critique. Il
y
a des critiques gnrales et des critiques particulires. Les
sentiments de l'Acadmie sur le Cid sont une critique
particulire; le trait du Sublime est une critique g-nrale.
Un pote a plac la critique la porte du temple du g'ot,
comme sentinelle des beaux-arts.
C'tait donc une bien fausse dfinition du g'ot que celle
du philosophe qui prtendit qu'il n'tait que le jugement
arm d'un microscope. Ce rsultat, qui fit fortune, est dou-
blement faux, puisqu'il suppose que nos jui^ements ne
roulent que sur des masses ou des objets vastes, et que le
g-ot ne s exerce que sur des dtails ou de petits ouvrag-es.
Le jugement et le g-ot connaissent g-alement des dtails
et des masses, d'un ouvrag-e entier ou d'une seule expression.
Seulement on prfre l'emploi du mot
cfot
pour les ouvra-
ges qui n'offrent que grce, dlicatesse ou futilit. Ainsi,
on ne porte pas son jugement sur un bijou, non parce qu'il
est petit, mais parce qu'il est futile : une fte, un spectacle,
un festin ne sont pas des objets microscopiques; et cependant,
c'est le got qui les ordonne et les juge. Enfin le bon et le
mauvais got
;
les jugements vrais ou
faux;
la puret du
got et la justesse du jugemejit; la corruption de l'un
et la fausset
de l'autre, sont des expressions consacres.
Sur quoi j'observerai que les masses ont toujours un air
de noblesse qui se perd dans les dtails, et qui n'est jamais
le caractre des ouvrages. Et de mme qu'on a dit des per-
sonnes qui s'habituent regarder les objets de trop prs,
qu'elles se brisent le rayon visuel, ce qui signifie, en ter-
mes plus techniques, se contracter le cristallin
;
de mme
on peut dire des esprits qui n'aiment que la dissection des
caractres, le fini des dtails et les miniatures en tout genre,
qu'ils finissent souvent par n'avoir plus qu'une vue micros-
copique, et par changer la grandeur contre la subtilit, et
les belles proportions contre la finesse. L'esprit analytique,
au contraire, peut, en fidle sectateur de la nature, allier
les recherches lmentaires l'art des grandes compositions.
Mais c'est surtout l'tude des belles proportions que le
got s'pure et se forme. Ceci demanderait une potique
LITTRATURE Il3
part, et le plan que je me suis fait s'y refuse. Je me conten-
terai de dire que si l'art du sculpteur consiste carter de
la statue le marbre qui n'en est pas, de mme le ^ot ordonne
de simplifier un sujet, et d'exclure d'un vnement les temps
qui n'en sont pas. Le grand crivain repousse donc la foule
des incidents trangers ou disparates qui dislrayent le sen-
timent, et qui sont comme les parties mortes d'un vnement.
C'est par l que le rcit d'un fait nous frappe si souvent
plus que son spectacle : semblable la rflexion sur le dan-
ger, plus effrayante que le danger mme. C'est par l que
le talent donne un air de vie ses ouvrages. La Vnus de
Florence n'est qu'un marbre, mais ce marbre a la perfection.
Une femme a des imperfections, mais elle a la vie et le mou-
vement ; en sorte que la statue serait insupportable cause
de son immobilit, si elle n'avait le charme que lui donnent
la vie et le jeu des passions. L'art consiste suppler la vie
et la ralit par la perfection, et le got exige cette heureuse
imposture. Mais il veut l'entrevoir; et c'est ce qui explique
le dgot et mme l'horreur que nous causent les imitations
en cire : la transparence des chairs
y
est; les couleurs sont
vraies; les cheveux sont rels, et la personne est immobile;
les yeux brillent, mais ils sont fixes : l'amateur interdit, qui
ne trouve ni fiction, ni ralit, dtourne sa vue d'un cada-
vre color qui ment sans faire illusion, et du spectacle de
ces yeux qui regardent sans voir. En un mot, le faux enchan-
teur qui s'est pass d'art, sans atteindre la nature, a fait le
miracle en sens inverse. Le sculpteur et le peintre ont anim
la toile et amolli le marbre; et lui, il a roidi les chairs, fig
le sang et glac le regard.
Quant aux productions dramatiques, il ne doit
y
avoir
de fiction que sur les temps et les lieux; tout le reste doit
tre vrai, c'est--dire d'une illusion complte.
L'historien et le romancier font entr'eux un change de
vrits, de fictions et de couleurs, l'un pour vivifier ce qui
n'est plus, l'autre pour faire croire ce qui n'est pas.
Le pote pique mle le merveilleux l'action et au rcit.
On peut s'expliquer par l pourquoi l'pope n'emprunte
jamais, avec autant de succs que la tragdie, les grands
personnages de l'histoire. Ce ne sont pas seulement des pas-
sions et des vnements, ce sont des merveilles qu'on attend
d'elle; et quand l'pope ne peut agrandir ni les faits ni
Il4
RVAROL
les hommes, son impuissance la dgrade aux yeux de l'ima-
g-ination.
D'ailleurs, la g-loire d'un hros pique est telle-
ment
rversible au pote qui le cre en le chantant que, dans
niiaile, ce n'est point Achille, c'est plutt Homre qui est
2;Tand. Mais Csar ne reflte pas son clat sur Lucain, et
Lucaui
n'ajoute pas l'clat de Csar. Que faire d'un per-
sonnnire
si plein et tellement insparable de sa gloire qu'on
ne peut ni l'aug-m.enter ni la partager?
Le got triomphe surtout dans la sparation dis {genres.
Si c'est un cirand
art. dans les al'aires, de distinguer ce qui
doit tre crit de ce qui doit tre dit, c'est aussi un grand
sii^ne de got en littrature
;
et le discernement qui spare
ce qui peut tre en vers de ce qui doit tre en prose n'est
pas d'une moindre importance.
Ce qui distingue encore le got de l'esprit, du talent, et
mme du gnie. c'est qu'il ne se laisse jamais blouir. Il pr-
fre Virgile Lucain et Racine Voltaire, par la raison qu'il
aime mieux les jours et les ombres que l'clat et les taches.
Enfin le got viole quelquefois les rgles, comme la cons-
cience les lois, et c'est alors qu'il se surpasse lui-mme :
mais ces cas sont rares. Situs entre les tmrits de l'imagi-
nation et les timidits du jugement, c'est lui se dfier
des ot'res de l'une et des conseils de 1 autre.
Les gens du monde confondent toujours l'esprit avec le
gnie des ides, et cela doit tre. L'esprit, tant le nom le
plus universel du sentiment, est souvent pris comme l'me,
pour l'homme tout entier : on dit, les grands et les petits
esprits, les esprits ordinaires et les esprits extraordi-
naires ;
et d'un homme sans esprit, qu'il est un pauvre
esprit; enfin on oppose l'me au corps, et l'esprit la ma-
tire. Il suffit donc, pour confondre l'esprit avec le gnie,
d'ter l'un et d'ajouter l'autre. En leur supposant des
ides plus ou moins vastes, et des conceptions plus ou moins
profondes, on aura tour tour l'homme d'esprit et l'homme
de gnie, un esprit tendu et un gnie born. Mais il n'est
aspermis de confondre l'esprit ou le gnie des ides avec
e talent.
Il
y
a cette diffrence entre ces deux prsents de la nature,
ue l'esprit, quelque degr qu'on le suppose, est plus avide
e concevoir et d'enfanter; le talent plus jaloux cl'exprimer
et d'orner. L'esprit s'occupe du fond qu'il "creuse sans cesse;
LITTa.VTUME Il5
le talent s'attache la forme qu'il embellit toujours : car,
par sa nature, l'homme ne veut que deux choses : ou des ides
neuves ou de nouvelles tournures.il exprime l'inconnu clai-
rement, pour se faire entendre; et il relve le connu par
Texpression pour se faire remarquer. L'esprit a donc besoin
qu'on lui dise :
y^
vous entends; ai le isAanl : je vous
admire. Il est donc vrai que c'est l'esprit qui claire, et que
c'est le talent qui charme. L'esprit peut s'f^-arer, sans
doute, mais il craint Terreur; au lieu que le talent se fami-
liarise d'abord avec elle, et en tire parti : car ce n'est pas la
vrit, c'est une certaine perfection qui est son objet; et les
variations, si dshonorantes pour l'esprit, tonnent si peu
le talent que, dans le conflit des opinions, c'est toujours
la plus brillante qui l'entrane; d'o il rsulte que l'esprit a
plus de jug-es, le talent plus d'admirateurs; et qu'enfin,
aprs les passions, le talent est dans l'homme ce qui tend le
plus de piges au bon sens.
Ce n'est pas qu'il
y
ait beaucoup de g-ens d'esprit sans
un peu de talent, ni beaucoup de g-rands talents sans quel-
que dose d'esprit, je parle seulement de la partie dominante
dans chaque nomme. Mais il
y
a g-nralement plus d'esprit
que de talent en ce monde : la socit fourmille de g'ens
d'esprit qui manquent de talent.
L'esprit ne peut se passer d'ides, et les ides ne peuvent
se passer de talent : c'est lui qui leur donne l'clat et la vie
;
or, les ides ne demandent qu' tre bien exprimes
;
et,
s'il est permis de le dire, elles mendient l'expression. Voil
Fourquoi
l'homme talent vole toujours l'homme d'esprit:
ide qui chappe celui-ci, tant purement ingnieuse,
devient la proprit du talent qui la saisit.
Il n'en est pas ainsi de J'crivain grand talent
;
on ne
Seut
le voler sans tre reconnu
,
parce que, son mrite tant
ans la forme, il appose son cacnet sur tout ce qui sort de
ses mains. Virgile disait qu'on arracherait Hercule sa
massue, plutt qu'un vers Homre.
L'esprit qui trouve l'or en lingots ajoute aux richesses
du genre humain ;mais le talent faonne cet or en meubles
et en statues qui ajoutent nos jouissances, et sont la fois,
pour nous, sources de plaisirs et monuments de gloire. On
peut rendre heureusement les penses des philosophes : ils
ne craignent pas la traduction qui tue le talent. L'homme
Il6 niVAROL
qui n'aurait strictement que de l'esprit ne laisserait que ses
ides
;
mais Thomme talent ne peut rien cder de ce qu'il
fait : il a, pour ainsi dire, plac ses fonds dans la faon de
ses ouvrag-es. On dirait, en etfct, que les ides sont des fonds
qui ne portent intrt qu'entre les mains du talent.
Mais ce qui fait prcisment sa puissance, c'est d'expri-
mer d'une mnnire neuve et piquante les penses les plus
communes
;
car, les penses de cet ordre se composent des
sensations premires, souvent rptes, fondes sur le besoin,
fortifies par l'usage, et par consquent fondamentales dans
l'homme.
La diffrence du talent l'esprit entrane aussi pour eux
des consquences morales. Le talent est sujet aux vapeurs de
l'org-ueil et aux orag-es de l'envie; l'esprit en est plus exempt.
Voyez, d'un ct, les potes, les peintres, les acteurs; et de
l'autre, les vrais penseurs, les mtaphysiciens, et les g-om-
tres. C'est que l'esprit court aprs les secrets de la nature
qu'il n'atteint g"ure, ou qu'il n'atteint que pour mieux se
mesurer avec sa propre faiblesse
;
tandis que le talent pour-
suit une perfection humaine dont il est sr, et a toujours
le g-ot pour tmoin et pourjug-e. De sorte que le talent est
toujours satisfait de lui-mme ou du public, quand l'esprit
se mfie et doute de la nature et des hommes. En un mot,
les g-ens d'esprit ne sont que des voyag-eurs humilis qui ont
t toucher aux bornes du monde, et qui en parlent, leur
retour, des auditeurs indiffrents qui ne demandent qu'
tre g"ouverns par la puissance ou charms par le talent.
Leur diffrence influe encore sur leur destine. Les hom-
mes qui adorent et idoltrent la puissance caressent le ta-
lent : mais ils ne rendent pas, beaucoup prs, le mme culte
aux grands esprits : ils sentent que l'or et le pouvoir se
communiquent en personne, et que le talent multiplie leurs
jouissances
;
mais que le gnie des ides, semblable au soleil,
ne nous prte que son clat, sans rien perdre de sa subs-
tance : d'o rsulte cette vrit, que, souvent, l'envie auprs
des grands et des riches se chan^-e en flatterie, et en haine
auprs du gnie qui se contente d'clairer sans mouvoir.
Mais c'est surtout pour les talents futiles que le monde
prodigue ses faveurs, et s'puise en applaudissements :
tout est de glace pour l'homme qui pense et qui redresse les
ides de son sicle. C'est que celui-ci ne donne que de la
LITTKATURK II7
falig"ue et humilie la mdiocrit, quand le danseur ou le
musicien ne donnent que du plaisir, et n'humilient que
leurs rivaux. Car, ce ne sont pas les artistes, mais les arts
qui sont frres. Le talent ne craint donc que le talent
;
l'es-
prit a le fii-enre
humain pour anlag-oniste.
Cependant, il faut le dire, l'envie pardonne f[uelquefois
l'clat du stvle un grand homme, qui n'a pas le don de
la parole : parce que, s'il parat dans le inonde, et qu'il
y
montre de l'embarras ou de la disg-rce, il a l'air d'un
enchanteur qui a perdu sa bag-uette,et on se flicile de son
malheur, on en jouit, comme le hibou d'une clipse. Mais
l'homme qui porte son talent avec lui afflii^e sans cesse les
amours-propres : on aimerait encore mieux le lire, quand
mme son style serait infrieur sa conversation. Que sera-
ce donc, s'il tient le double g-ouvernail du cabinet et du cer-
cle ?
Ces petites iniquits sont d'autant plus remarquables que
le vritable esprit rend justice tous les g-enres de mrite
;
comment pourrait-il perscuter ce qu'il aime et troubler la
source de ses jouissances ? Il ne faut pas des sots aux g-ens
d'esprit, comme il faut des dupes aux fripons.
Disons-le la gloire du g-nie et de la vertu : toute nation
a deux sortes de reprsentants: ceux de sa puissance et ceux
de son mrite. Les premiers ne la reprsentent qu'un temps,
les seconds la reprsentent ternellement. Les premiers em-
pruntent d'elle leur clat
;
elle tire le sien des seconds. Les
uns la protg-ent ou la tyrannisent avec ses propres forces
;
les autres la couvrent de leurs rayons et lui prodiguent les
JTruits de leur g-nie. Enfin les premiers ne lui trouvent que
des ennemis dans les peuples environnants
;
les seconds lui
concilient le respect du monde, et n'ont pour ennemis que
ceux du g-enre humain et de sa flicit.
Observons, en terminant ces rflexions, qu'il
y
a deux
espces d'hommes talent, ceux qui,s'exerrant sur la matire,
se passent aisment d'esprit, comme les sculpteurs, les pein-
tres, lesmusiciens etles danseurs : et ceux qui s'exercent sur
la parole, comme les potes et les orateurs; ceux-ci gag-nent
presque toujours de l'esprit et des ides au commerce des
mots. On peut les comparer aux artistes qui ont pour eux
la limaille et les dbris des prcieux mtaux qu'ils faon-
nent.
llS niVAROL
Maintenant, pour runir les deux objets du parallle, il
faut convenir qu'il en est de l'esprit, et surtout du talent,
comme de la puissance en amour. Les esprits et les talents
ordinaires n'ont de puissance que par intervalles : mais les
grands esprits et lesg-rands talents sont presque toujours en
puissance
Toutes ces distinctions entre le g-nie et l'esprit, le talent,
le jugement et le ^oiit, exig-ent une restriction g-nrale :
comme ce ne sont l que des fonctions d'un mme tre, je
veux dire du sentiment, on peut les comparer aux couleurs
du prisme qui, pleines et certaines dans leur^^milieu, sont
toujours un peu quivoques dans les limites o elles se tou-
chent et se confondent.
Je dois aussi restreindre le don de cration accord au
gnie.
Que le sentiment soit entendement, imag-ination, esprit
ou i^rnie, il n'est que trouveur^ ordonnateur, compositeur,
jamais crateur
;
et ces beaux ouvrages du gnie, qu'on
appelle crations, ne sont au fond que des arrangements,
des compositions, des choses trouves mises en ordre : car
si le sentiment, lorsqu'il enfante, savait ce qu'il va produire,
il connatrait avant de sentir, et, comme on l'a dj dit, il
aurait l'ide avant de l'avoir. Mais il en est des conceptions
les plus intellectuelles, comme de nos sensations
;
nous ne
les avons qu'en les prouvant
; nous sommes frapps au de-
dans comme au dehors. L'animal qui crie pour la premire
fois entend sa voix
;
il ne la connaissait pas auparavant.
II en est de mme des ides qu'on nomme ides neuves
j'en appelle ceux qui en ont. Sur quoi tombe donc le titre i
de cration, dont on qualifie un ouvrage et mme une
grande ide ? Sur l'ordre et la composition mme
;
jamais
sur les lments. L'homme reoit les choses simples et cre
les composes
;
il trouve les pierres et cre des difices; il
prouve des sensations, les retient, les combine, et cre un
ouvrage. D'o rsulte cette grande vrit. que, si Dieu n'tait
pas crateur des lments, il aurait trouv l'univers, et ne
diffrerait de l'homme que par les proportions. {Discours
prliminaire.)
FRAGMENTS ET PENSES LITTERAIRES
SUR FLORIAN
-
1788(1)-
Il parat peu d'ouvraf"es dans notre littrature, qui ne
soient ou lous avec extase, ou impitoyablement crass;
avec cette observation pourtant, cjue le nombre des idoles
l'emporte beaucoup sur celui des victimes : il n'y a que quel-
ques infortuns sans amis et sans protecteurs, qu'on immole
sans piti
;
les heureux sont innombrables. Il ne s'annonce
presque pas de livres dans le cours d'une anne que ce ne
soit La plus belle alliance de la philosophie et de Vlo-
quence
;
cest toujours le Hure quon attendait, et une
rvolution dans l" esprit humain parat invitable. Tel
avocat est mis sans faon au rang- des Gicron et des D-
mosthnes, et l'auteur de quelques pices fug-itives s'assied
sans pudeur cot d'Horace et d'Anacron. 11 serait temps
enfin que plus d'un journal chang-et de maxime : il faudrait
mettre dans la louang-e, la sobrit que la nature observe
dans la production des
r-rands talents, et cesser de tendre
des pig-es Finnocence des provinces.
Paris est la ville du monde o on ig-nore le mieux la
valeur, et souvent l'existence d'une foule de livres :
il faut
avoir vcu en province ou la campag-ne
,
pour avoir beau-
coup lu. A Paris, l'esprit se soutient et s'ag-randit dans la
rapide sphre des vnements et des conversations; en pro-
vince, il ne subsiste que de lectures : aussi faut-il choisir les
hommes dans la capitale
;
et dans la province, ses livres.
Ici, l'ouvrag-e le plus vant n'en impose personne, ou
n'en impose pas long'temps. On sait bientt quel parti l'au-
(i) Publi eu
1797
seulement dans le Spectateur du l\'ord.
teur s'est attach; quelles mains le protent ou l'lvent;
et les lumires acquises dans les cercles dissipent les illu-
sions o pourraient nous jeter les journalistes : l'amour-
propre des auteurs mmes n'en est pas dupe. En vain les
trompettes de la renomme ont proclam telle prose ou tels
vers; il
y
a toujours, dans cette capitale, trente ou quarante
ttes incorruptibles qui se taisent : ce silence des cens de
ffot
sert de conscience aux mauvais crivains, et les tour-
mente le reste de leur vie. .
Mais, quand un livre prn dans tous les journaux, et
soutenu par un grand parti, arrive en province, l'illusion est
complte, pour les jeunes g-ens surtout : ceux qui ont du
^ot s'tonnent de ne pas admirer, et la vog^ue d'un mauvais
ouvrag^e fait chanceler leur raison
;
les autres se fig-urent
que Paris reg-ore de grands talents, et que nous avons en
littrature l'embarras des richesses.
Il nous semble pourtant que les g-ens de lettres devraient
eux-mmes prfrer l'analyse et une critique claire de
leurs productions, des log-es donns sans discernement et
sans mesure
;
les honneurs prodig-us ne sont plus des hon-
neurs. Quel auteur dramatique est flatt, aujourd'hui, d'tre
appel grands cris sur un thtre, par un parterre en
dlire?
Faire des observations si svres, c'est nous imposer la
loi d'tre justes et modrs, en les appliquant au roman de
Numa Pompilius, ouvrag-e important par son objet, et qui
n'a pas eu le succs que devait naturellement en attendre
son auteur.
M. de Florian s'annona d'abord par des productions
fug-itives et des pastorales d'un ton fort doux. 11 avait dans
son style cette puret et cette lg-ance continues dont les
g-ens du monde se croient tous dous par excellence, et qui
disting-uent spcialement leurs veux les esprits de la capi-
tale
;
aussi se htrent-ils de lui faire une rputation, char-
ms qu'un d'entr'eux et pris la parole. Mais quand M. de
Florian s'est lev, de petite pice en petite pice, jusqu'
une sorte d'pope, les g-ens du monde l'ont abandonn aux
g-ens de lettres; ils ont t de feuille en feuille ses amis jus-
qu'au volume.
Cette conduite des g-ens du monde, qui semble cruelle au
premier coup d'il, est pourtant consquente leurs ides.
LITTEHATURE
iai
La rputalion, la renomme, cette vie enfin, qui, selon l'ex-
pression de Pope, respire sur les lvres d'autrui, n'est rien
({ue de la vog-ue et du bruit pour les hommes du monde : il
leur semble qu'aprs Catulle il faut aussi que TibuUe soit
la mode, et qu'au dfaut de l'un ils en auront toujours un
autre; mais pour les g-ens de lettres, la renomme est tout;
qui sacrifie le prsent, il faut l'avenir entier pour ddom-
mag-ement. Si les g-ens du monde en avaient cette ide, ils
atecteraient moins de se scandaliser des querelles des g-ens
(le lettres : ils verraient qutant plus sensibles que le reste
(les hommes, ils doivent tre plus irritables; et ce qui prouve
qu'ils sont plus sensibles, c'est qu'ils donnent beaucoup de
sensations : la nature tonne l'oreille de l'homme de lettres,
quand elle murmure peine celle des g-ens du monde. Ils
se disputent d'ailleurs une matresse dont les charmes s'ac-
croissent du nombre des amants qui l'entourent, et des
faveurs qu'elle accorde
;
je veux dire la gloire. Mais, direz-
VDiis peut-tre, la g-loire n'est que fume : j'en conviens,
mais l'homme n'est que poussire.
C'est donc entre de telles mains que devait naturellement
tomber M. de Florian, puisqu'il s'occupait d'un sujet impor-
tant; il faut bien tre jug- par ses pairs.
On a d'abord senti que ce n'tait ni avec l'esprit, ni sur
le ton de ses premiers opuscules que M. de Florian devait
peindre le lg-islateur de Rome. Voltaire, produisant une
pice fug-itive, tait Hercule maniant de petits fardeaux, et
les faisant voltig-er sur ses doig-ts; son excs de force tait
sa g-rce. Mais, quand, avec la mme dose de posie, il est
entr dans l'pope, il n'a fait que la Henriade. Il fallait
donc que M. de Florian se ft ici un nouveau style et une
toute autre manire; en traitant un sujet vaste, il faut sa-
voir lever ses conceptions et sa voix : les grandes entrepri-
ses ne renversent que les petites fortunes.
L'ing-nieuse modestie de l'auteur qui se fait remarquer
('ans la gravure qui est la tte de son livre a forc tout
le monde comparer Nurna Tlmaque; plus il a craint
d'tre cras par la comparaison, plus on s'est obstin la
faire...
Il faut convenir que M. de Florian n'a point eu, comme
Fnelon, le bonheur du sujet. Son imag-ination se promne
dans des landes arides, et sou stjle n'y est jamais rafrachi
KIVAROL
par ces heureux sites et ces riants paysages qu'on rencontre
si souvent dans le Tlmaque.
On a aussi remarqu clans Numa un dfaut absolu de
mouvement et de varit
;
on a dit quelapurctc et l'lgance
ne suffisaient pas dans un ouvrag-c de cette nature; il n'y
a que les expressions cres qui portent un crivain la pos-
trit. M. de Florian parat avoir des lois somptuaires dans
son style, et son sujet exig-eait un peu de luxe.
SUR LE STYLE
La meilleure histoire de l'entendement humain doit, avec
le temps, rsulter de la connaissance approfondie du lan-
g-ag-e. La parole est en effet la physique exprimentale de
l'esprit
;
chaque mot est un fait
;
chaque phrase, une ana-
lyse ou un dveloppement; tout livre, une rvlation, plus
ou moins long-ue, du sentiment et de la pense. Aussi per-
suad de ce g-rand principe que peu certain de l'avoir bien
tabli, j'aurai du moins ouvert la route. C'est pourquoi, en
attendant la deuxime partie de ce discours, destine au lan-
gag-e en g-nral, je n'ai pas perdu les occasions de justifier
les expressions vulgaires que le besoin a cres, et qu'a con-
sacres Tusag-e. Les besoins naturels tant toujours vrais,
leurs expressions ne peuvent tre fausses : elles forment,
pour ainsi dire, la logique des sentiments.
Je me suis donc gard d'imiter certains philosophes qui
demandent qu'on leur passe ou des mots nouveaux ou de
nouvelles acceptions. L'auteur 'Emile, par exemple, exige
qu'on lui permette de changer le sens du mme mot d'une
page l'autre. Il est pourtant vrai que, si tout se peint dans
le langage, il n'est permis de brouiller les couleurs ni dans
les objets ni dans leurs peintures. Changer le sens des mots
d'une langue faite, c'est altrer la valeur des monnaies dans
un empire; c'est produire la confusion, l'obscurit et la
mfiance, avec les instruments de l'ordre, de la clart et
la foi publique : si on drange les meubles dans la cham-de
bre d'un aveugle, on le condamne se faire une nouvelle
mmoire.
Ma fidlit dans l'emploi des mots n'a pas t pourtant
une superstition, il a fallu souvent suppler l'avarice de
l'Acadmie : ce qu'elle me refusait, je l'ai emprunt de l'u-
LITTEHATUPIE
sag-e, qui a fait de eirandcs acquisitions depuis prs de qua-
rante ans, poque de la dernire dition au Dictionnaire.
Malg-r tous mes eflbrts, je sens bien que cet ouvrag-c
n'est qu'un essai trs imparfait : aucun de mes lecteurs
n'en sera plus mcontent que moi. Je ne peux attendre d'in-
dulg-ence que des ttes mtaphysiques, exerces la mdi-
tation, qui savent combien il est difficile d'crire sur les
ides premires, et qui s'apercevront bien que cet essai,
itout faible qu'il est, peut tre un jour pour quelque crivain
l'occasion d'un bon ouvrag-e. [Discours prliminaire.)
DES TRADUCTIONS (l)
Comme on a beaucoup parl des traductions, je n'en dirai
qu'un mot en finissant, pour ne pas paratre mpriser ce
g-enre de travail, ou l'estimer plus qu'il ne vaut. J'ai donc
1 pens qu'elles devraient servir galement la gloire du pote
qu'on traduit et au progrs de lang-ue dans laquelle on tra-
duit
;
et ce n'est pourtant point l qu'il faut lire un pote,
car les traductions clairent les dfauts et teig^nent les
I beauts; mais on peut assurer qu'elles perfectionnent le
'lang-ag"e.
En effet, la lang-ue franaise ne recevra toute sa perfection
qu'eu allant chez ses voisins pour commercer et pour recon-
natre ses vraies richesses; en fouillant dans l'antiquit
qui elle doit son premier levain, et en cherchant les limites
;qui la sparent des autres lang-ues. La traduction seule lui
rendra de tels services. Un idiome traug-er, proposant tou-
jours des tours de force un habile traducteur, le tte pour
ainsi dire en tous les sens : bientt il sait tout ce que peut
ou ne peut pas sa lang-ue
;
il puise ses ressources, mais il
aug-mente ses forces, surtout lorsqu'il traduit les ouvrages
d'imag-ination, qui secouent les entraves de la construction
grammaticale, et donnent des ailes au lnga^-e.
Notre langue n'tant qu'un mtal d'alliage, il faut la
dompter par le travail, afin d'incorporor ses divers lments.
Sans doute elle n'acquerra jamais ce principe d'unit qui
fait la force et la richesse du grec; mais elle pourra peut-
Hre un jour s'approcher de la souplesse et de Tabondance
(i) A propo de sa traduction de VEnfer, de Dante
(1785).
124
RIVArtOL
de la lan2;-ue italienne qui traduit avec tant de bonheur.
Quand une lan^^-ue a reu toute sa perfection, les traductions
V
sont aises faire et n'apportent plus que les penses.
NOTES
L'esprit le plus sec ne parle pas sans mtaphores, et
s'il parat s en garantir dessein, c'est que les imag'es qu'il
emprunte, tant vieilles et uses, ne frappent ni lui, ni les
lecteurs. On peut dire que Locke et Condillac, l'un plus
occup combattre des erreurs, et l'autre tablir des vri-
ts, manquaient g-alement tous deux du secret de lexpres-
sion, de cet heureux peuvoir des mots qui sillonne si pro-
fondment l'attention des hommes en branlant leur imagi-
nation.
Leursaura-t-on gr de cette impuissance? dira-t-on
qu'ils ont craint de se faire lire avec trop de charme,ou que
le stvle sans figures leur a paru convenable la svrit
de
la mtaphysique?
Je pourrais d'abord prouver qu'il n'existe
pas de stvle
proprement direct et sans figures, que Locke et
Condillac taient figurs mal err eux ou leur insu, qu'enfin
ils ont souvent cherch la mtaphore et les comparaisons,
et
on verrait avec quel succs; mais ce n'est pas ici mon objet.
Notre grand modle, la nature, est-elle donc sans imaices, le
printemps sans fleurs, et les fleurs et les fruits sans couleurs?
Aristote a rendu l'imagination un tmoignage clatant,
d autant plus dsintress qu'il en tait lui-mme dnu, et
que Platon, son rival, en tait richement pourvu. Les belles
images ne blessent que l'envie.
Il arrive
quelquefois que l'homme, s'abandonnant ses
habitudes et aux impulsions accoutumes des esprits ani-
maux, agit et parle sans le moi : son corps va sans attention,
comme un vaisseau sans pilote, par le seul bienfait de sa
construction.
C'est que l'homme alors se partage entre ses
mouvenients et des ides trangres ses mouvements, et
qu'ensuite il
y
a comme un premier ordre et un mouvement
d'abord donns, qui n'ont pas besoin d'tre rpts pour que
le corps continue d'obir. Tout homme qui s'observe en
marchant, en parlant et en crivant, connat bien ces ordres
antrieurs
que toute la rapidit du contre-ordre donn par
la rflexion ne saurait prvenir. Ceci explique la diflerence
qu'il
y
a de l'homme qui parl Ihomme qui crit : le pre-
LlTTERATUnE 120
micr est plus extrieur; le jugement dfend d'crire comme
on parle; la nature ne per^iet pas de parler comme on crit;
le ^-ot marie les vivacits de la conversation aux formes
mthodiques et pures du style crit.
On peut comparer le systme de la cration celui du
lang-ag-e: tout discours se rduit en phrases, la phrase en
mots, les mots en lettres, au del il n'est plus de divisions:
les lments de la parole sont inscables. C'est ainsi qu'arri-
ve aux substances lmentaires on ne divise plus. La seule
(litVrence qu'il
y
ait entre le systme physique du monde
't le langage, c'est que les substances ont des affinits qui
les rappellent toujours aux mmes aGi^rg-ations
;
mais les
lettres alphabtiques ne s'altirentpas entre elles: leurs com-
binaisons sont abandonnes la volont des hommes,ce qui
( \|ilique la diversit des langues. Si les vovelles et les con-
nues s'attiraient en vertu de certaines lois, comme les
Itstances, le lang-ag-e serait unique et fixe comme Tuni-
vrrs.
L'homme ne pouvait donner une enveloppe sa pen-
s(''(" sans que cette envelo})pe fut trs ing-nieuse. Aussi que
<!'
finesse, que d'esprit et quelle mtaphysique dlie dans
la cration d'une langue! Le philosophe s'en aperoit, sur-
tout lorsqu'il veut carter ces fils mystrieux dont Ihomme
a entour sa pense, comme le ver soie s'entoure de son
Il ri liant rseau.
La parole est la pense extrieure, et la pense est la
parole intrieure (i).
La langue est un instrument dont il ne faut pas faire
crier les ressorts.
Les langues sont les vraies mdailles de l'histoire.
La grammaire tant l'art de lever les difficults d'une
i) Celle pense n'est qu'un rsum d'un passage de V Universalit.
Mitres se retrouvent textuellement soit dans le mme ouvrage, soit en
litres tcrits reproduits au prsent volume. On les a nanmoins rccueil-
^ dans ces sries de Penses (voir aussi les livres II, III et V', pour
ne (as drouler ceux qui les connaissent dj sous celte forme fragmen-
taire. Nanmoins on a bien p'ult tent de diminuer que d'augmenter le
mmbre de ces aphorismes; on les a, le plus souvent, laisss
leur
t'iace, dans le texte qui les explique et qui s'en claire.
lang-ue, il ne faut pas que le levier soit plus lourd que le
fardea^.
Les mots sont comme les monnaies : ils ont une
valeur propre avant d'exprimer tous les genres de valeur.
Tout est proportion dans Thommc comme dans le lan-
g-ag-e. On ne peut pas dire : J'ai vu une puce couche tout
de son Ion
j,
quoique ce soit aussi vrai d'une puce que d'un
veau.
Le mot cher a quelque chose de doux et de vil : il est
l'expression de Tamour et de Tavarice, et semble dire que
ce qui tient la bourse tient au cur.
On dirait qu'il
j
a dans les 'dictionnaires certains mots
uss qui attendent qu'il paraisse un g'rand crivain pour
reprendre toute leur nergie.
Dans le dictionnaire de l'Acadmie, on ne trouve pas
ce qu'on ne sait point; mais on n'y trouve pas ce qu'on
sadt.
Le mot prcaire signifie aujourd'hui une chose ou un
tat mal assur, et prouve le peu qu'on obtient par la prire
puisque ce mot vient de l.
Voyez tous les grands crivains : ils n'ont rgn que
par l'expression. J.-J. Piousseau a fait taire la renomme
de tous ceux qui avaient crit avant lui sur les devoirs de
la maternit. Le gnie gorge ceux qu'il pile.
La nation la plus vive et la plus lgre de l'Europe a
eu un jeu, une danse et une musique graves: le piquet, le
menuet et nos airs anciens. Serait ce le pourquoi de la gaiet
de Racine, qui faisait des tragdies, et de la tristesse de
Molire, qui faisait des comdies?
Il est bien ridicule d'intituler un livre Histoire philo-
sophique, Examen impartial, etc. Je verrai bien si ton
histoire est philosophique, si ton examen est impartial. Tu
mets un jugement au lieu d'un titre (i).
Un homme habitu crire crit aussi sans ides,
(i) L'ironie des choses a voulu que la premire hiog-raphie deRivarol
ft prcisment intitule : Vie philosophique, politique, etc., de Rivarot.
LITTEUATUUE
127
comme un vieux mdecin nomm Bouvard, qui tlait le
pouls son fauteuil en mourant.
Les g-ens d'esprit aiment les choses de l'esprit, comme
les g-ourmands aiment les friandises et les coquettes, la
louang-o.
On tue l'ig-norancc comme Tapptit : on mang-e, on
tudie, et c'est ainsi qu'on avance vers cet tat qui rend la
mort si ncessaire.
A la fin, tout devient lieu commun en littrature.
On n'aime pas les apparitions trop brusques en littra-
ture, et les rputations les plus brillantes
j
ont besoin d'un
crpuscule.
Il ne faut pas trop compter sur la sag-acit de ses lec-
teurs
;
il faut s'expliquer quelquefois.
Il n'est rien de si absent que la prsence d'esprit.
La peinture n'emprunte qu'une attitude aux person-
nag"es, qu'un incident l'action et qu'un moment au temps;
le peintre ne dispose que d'un lieu, le pote a l'espace sa
disposition.
LIVRE II
POLITIQUE
JOURNAL POLITIQUE NATIONAL
(1789-1790)
Extraits (i)
1. LES PREMIRES FAUTES
Les crivains sont tous plus ou moins corrompus par T-
vnement. On ne nous fera pas sans doute le mme repro-
che. Nous avons crit sans prdilection et sans amertume,
sans crainte et sans tmrit, mais non sans obstacle et
mme sans pril. Dans le feu dune rvolution,
quand les
haines sont en prsence, et le Souverain divis, il est dif-
ficile d'crire l'histoire. Ceux qui ont fait une rvolution
voudraient aussi la raconter
;
ils voudraient, aprs avoir
tourment ou massacr leurs contemporains, tromper encore
la postrit; mais l'histoire repousse leurs mains criminelles;
elle n'coute pas la voix mensongre des passions
;
elle veut
tre le jug'e et non le flatteur des hommes; et comme la loi,
elle les approuve sans amour, et les condamne sans cour-
roux
(2).
^
(i) Les trois premiers chapitres de ce livre sont tirs des Bsams,
histoire des premiers temps de la rvolution, qui forment la partie
principale de ce journal. Voyez l'Appendice,
i5. uvres deRivarol.
(2)
Voir plus loin, pa^e 18a, un extrait du n
9
\x Journal politique.
i3o
nivAROL
La Cour, TAssemble nationale et la ville de Paris sont
galement coupables dans la rvolution actuelle. La Cour est
coupable envers la nation pour avoir entour les pacifiques
dputs du peuple de soldats menaants
;
pour avoir entam
la guerre civile, en excitant les dfenseurs de l'Etat contre
ses
restaurateurs. Toute la conduite du ministre prouve
qu'il n'avait prvu ni compris ce que devaient tre des tats-
fnraux.
accords aprs tant de prires, aprs tant de sujets
e
mcontentement, aprs de si longues dprdations : aussi
d'aprs ses miauvaiscs manuvres, l'autorit royale aban-
donne de l'arme, annule dans l'opinion publique, et
heurte par la masse d'une population norme, s'est-elle
brise comme un verre.
Les torts de l'Assemble nationale ne sont pas moins vi-
dents, quoique plus ncessaires. En armant Paris, elle expo-
sait galement la tte du roi, la vie de ses sujets, et la libert
publique. On n'a qu' supposer un moment que larme
et obi; ou mme aprs la dfection de l'arme, on n'a
qu' supposer que le roi et rsist aux insolentes prten-
tions de Paris
;
on n'a, dis-je, qu' poursuivre cette suppo-
sition par la pense, si toutefois on peut soutenir l'image
des horribles consquences qu'elle prsente. Heureusement
le roi a dconcert ses ennemis en ne leur opposant aucune
rsistance
;
et sans doute que si Charles l^^ en et fait autant,
Cromvsel tait perdu.
Il faut donc que l'Assemble nationale choisisse et avoue
qu'il
j
eut en tout ceci imprudence ou trahison : impru-
dence, si on avait arm Paris sans tre sr de Tarme; tra-
hison, si on avait gagn l'arme avant de soulever Paris.
Maintenant que l'Assemble peut compter le roi pour rien,
elle doit compter Paris pour tout : le temps nous apprendra
si elle a gagn au change. Quoi qu'il en soit, un peuple
immense a dsert ses ateliers, les tribunaux sont ferms,
les rgiments n'ont plus de chefs, et la France, sous les
armes, attend une constitution, ce paisible ouvrage des lois,
comme si elle tait menace d'une descente sur ses ctes, ou
d'une invasion de barbares. Il est donc vrai que l'Assemble
nationale cria au secours sans en pouvoir ni garantir ni
prvenir les suites.
Les torts de la capitale, ou plutt ses crimes, sont trop
connus : elle a dj
fourni des sujets de tragdie la pos-
POLITIQUE
;3
trit, et des ar;-uinents terribles aux ennemis de la libert.
(Les mes douces et sensibles ne veulent plus d'un bien
qu'il
ifaut acheter par tant de crimes et par une anarchie dont on
[ne peut prvoir la fin. C'est, dira-t-on, la faute du despo-
tisme, qui ne laisse de porte ouverte la libert que l'in-
isurrcction : j'en conviens; mais fallait-il, ville
barbare!
j
quand les troupes se furent retires, quand l'Assemble
nationale vint t'apprendre combien elle tait satisfaite
de la
dernire sance royale; fallait-il exisj-er que ton prince,
que
le descendant de tes soixante rois vnt s'abaisser dans
tes
murs? Savais-tu si, du milieu de celte fort de lances et
de baonnettes, quelque monstre ou quelque insens, tel
qu'il s'en est trouv cnez toi dans les temps plus tranquilles
De te couvrirait pas d'un deuil et d'un opprobre ternels (i)?
Mais Paris voulut faire le brave ; il voulut montrer son sein
lriss de fer son roi priv de tout appareil de puissance
et de tout signe de majest.
Ce crime contj"c la royaut a t suivi d'attentats sans
ttoraibre contre l'humanit. En vain le roi, pour prix de
taut de condescendance, a-t-il demand rhtcl de ville
[jue tous ceux que le cri public dsignait pour victimes fus-
sent remis aux tribunaux; en vain a-t-il implor pour ses
mjets, non une grce, mais la simple justice
;
en vain a-t-on
illumin la ville, et rouvert les spectacles : c'est dans le
ODioment de cette fausse paix que le peuple de Paris, roi,
juge et bourreau, aprs quelques meurtres obscurs que
lous passons sous silence, a tran MM. Foulon et Berthier
ians la place de Grve, et leur a fait prouver des suppli-
r-es, et subir une mort dont on netrouve d'exemple que chez
es peuples les plus froces de la terre, ou dans les temps
es plus dsastreux de Thistoire. M. Foulon, vieilli dans les
ifiFaires, et connu par ses talents, tait beau-pre de M. Ber-
hier, intendant de Paris. Il fut livr par les paysans de sa
jdTTC la populace parisienne. On l'accusait, sans preuves
l'avoir dit, une fois dans sa vie, que le peuple tait
fait
iour manger da
foin.
Cette phrase proverbiale ne
l'et
MIS conduit la mort, s'il n'et pas t nomm un
des
I
(i) Cette crainte n'est point hasarde. Un coup de fusil
parti
d'une
aiain inconnue blessa mortellenaent une femme, tout prs du
carrosse
lu roi. R..
l32
UIVAROL
ministres
phmres qui succdaient M. Necker.Ce fut l,
son
vritable crime. On a observ que ce mme peuple, qui
j
s'attendrit
tous les jours sur la passion de J.-C, atlecta de!
la faire endurer cet infortun ministre (i), comme si la|
drision et 1 impit ajoutaient la veng-eance. On l'avait!
couronn
d'pines; lorsque, excd de tourments et de fati-j
g-ues il demanda boire, on lui offrit du vinaigre. Sa tte,!
promene
dans les rues de Paris, fut porte le mme jour
j
son
g-endre, qui s'avanait vers la capitale, au milieu d'une i
foule de pavsans et de bourg-eois arms. Forc de baiser
cette tte sang-lante, M.
Berthier fut bientt massacr sous
les fentres de ce mme htel- de-ville qui demandait en
vain sa grce aux tig-res dont il n'tait plus matre. Le sol-
dat qui arracha le cur de M. Berthier, pour l'offrir toutj
saignant MM. Bailly et la Fayette, prouva ces nouveaux,
sages, que le peuple ne gote de la libert, comme des
liqueurs violentes, que pour s'enivrer et devenir furieux..
Malheur ceux qui remuent le fond d'une nation ! Il n'esli
point de sicle de lumire pour la populace; elle n'est n:^
franaise, ni anglaise, ni espagnole. La populace est tou-
jours et en tout pays la mme : toujours cannibale, toujour
anthropophage
;
et quand elle se venge de ses magistrats
elle punit des crimes qui ne sont pas toujours avrs par de;
crimes certains. Souvenez-vous, dputs des Franais, qu
lorsqu'on soulve un peuple, on lui donne toujours plu.
d'nergie qu'il n'en faut pour arriver au but c[u'on se pro
pose, et que cet excdent de force l'emporte bientt au del
de toutes les bornes. Vous allez, en ce moment, donner de
lois fixes et une constitution une grande nation, et vou
voulez que cette constitution soit prcde d'une dclaratior
pure et simple des droits de l'homme. Lgislateurs, fonda
teursd'un nouvel ordre de choses, vous voulez faire marche
devant vous cette mtaphysique que les anciens lgislateur
ont toujours eu la sagesse de cacher dans les fondements d
leurs difices. Ah ! ne soyez pas plus savants que la nature
|
Si vous voulez qu'un grand peuple jouisse de l'ombrage e
se nourrisse des fruits de l'arbre que vous plantez, ne lais
sez pas ses racines dcouvert. Craignez que des hommes^
auxquels vous n'avez parl que de leurs droits, et jamais d
(i) M. Foulon.
POLITIOUE l33
leurs devoirs, que des hommes qui n'ont plus redouter
l'autorit royale, qui n'entendent rien aux oprations d'une
Assemble lgislative, et qui en ont conu des esprances
exagres, ne veuillent passer de l'galit civile que donnent
les lois, l'galit absolue des proprits; de la haine des
rangs celle des pouvoirs, et que de leurs mains, rougies
du sang des nobles, ils ne veuillent aussi massacrer leurs
magistrats. Il faut aux peuples des vrits usuelles, et non
des abstractions; et lorsqu'ils sortent d'un long esclavage,
on doit leur prsenter la libert avec prcaution et peu peu
comme on mnage la nourriture ces quipages affams
qu'on rencontre souvent en pleine mer, dans les voyages de
longs cours. N'oubliez pas enfin, dputs de la France, que
si les rois se perdent pour vouloir trop rgner, les assem-
bles lgislatives ne se perdent pas moins pour vouloir trop
innover.
D'ailleurs, pourquoi rvler au monde des vrits pure-
ment spculatives? Ceux qui n'en abuseront pas sont ceux
qui les connaissent comme vous, et ceux qui n'ont pas su
les tirer de leur propre sein ne les comprendront jamais, et
en abuseront toujours. Loin de dire aux peuples que la na-
ture a fait tous les hommes s;'aux, dites-leur au contraire
?[u'clle les a fait trs ingaux
;
que l'un nat fort et l'autre
aible; que l'un est sain et l'autre infirme
;
que tous ne sont
pas galement adroits et vigilants, et que le chef-d'uvre
d'une socit bien ordonne est de rendre gaux, par les
lois, ceux que la nature a fait si ingaux par les moyens (i).
Mais ne leur laissez pas croire pour cela que les conditions
soient gales
;
vous savez, vous voyez mme quels malheurs
rsultent de cette fausse ide, lorsqu'une fois le peuple s'en
est proccup. Au premier bruit qu'on a sem de l'abolition
des droits fodaux, les paysans n'ont voulu ni attendre,
ni
entendre que l'Assemble nationale distingut entre les
droits rels et les droits personnels
;
ils ont march par
troupes vers les abbayes, vers les chteaux, vers tous les
lieux o reposent les archives de la noblesse, et les titres des
anciennes possessions; le feu, le sang,la ruine et la mort
(i) Ce pauvre M, de La Fayette, dans une bauche de constitution lue
l'Assemble nationale, a dit au contraire que la nature faisaitles
hommes gaux, et que la socit les rendait ingaux. R.
8
ont marqu partout les traces de ces tigres dmusels
;
et
vous tes dj forcs d'implorer contre ces furieux le secours
de ces mmes troupes rg^les, dont vous avez trop lou la
dsobissance pour que vous puissiez esprer jamais de vous
en faire obir.
4:
Quand une vaste monarchie prend une certaine pente, il
faudrait d'abord s'arrter sur les dpenses de toutes sortes,
parce qu'en tout il vaut mieux dpendre de soi que des
autres, et qu'un roi conome est toujours le matre de ses
sujets et l'arbitre de ses voisins
;
un roi dbiteur n'est qu'un
esclave, qui n'a ni puissance au dedans, ni influence au
dehors. Ensuite, lorsqu'on veut empcher les horreurs d'une
rvolution, il faut la vouloir et la faire soi-mme : elle tait
trop ncessaire en France pour ne pas tre invitable. Com-
bien peut-tre de g-ouvernements en Europe
y
seront pris,
pour n'y avoir pas plus song que le cabinet de Versailles !
On ne cesse de parler, en France et dans le reste de l'Eu-
rope, des causes de cette rvolution. On peut les diviser en
causes loignes et en causes prochaines, les unes et les au-
tres sont trop nombreuses pour les rappeler toutes. La popu-
lace de Paris et celle mme de toutes les villes du royaume
ont encore bien des crimes faire avant d'galer les sotti-
ses de la cour. Tout le rgne actuel peut se rduire quinze
ans de faiblesse et un jour de force mal employe.
D'abord on doit sans tre pourtant tenu la reconnais-
sance), on doit en partie la rvolution M. de la Vauguyon
et M. de Maurepas, Tun gouverneur et l'autre ministre de
Louis XVI
;
le premier forma Thomme, et le second le roi.
On doit presque tout la libert de la presse. Les philo-
sophes ont appris au peuple se moquer des prtres, et les
prtres ne sont plus en tat de faire respecter les rois; source
vidente de l'affaiblissement des pouvoirs. L'imprimerie est
l'artillerie del pense. Il n'est pas permis de parler en public,
mais il est permis de tout crire, et si on ne peut avoir une
arme d'auditeurs, on peut avoir une arme de lecteurs.
On doit beaucoup aussi ceux qui ont teint la maison
du roi : ils ont priv le trne d'un appui et d'un clat nces-
saires
;
les hommes ne sont pas de purs esprits, et les yeux
POLITiyCE
l35
mit leurs besoins : par l ils ont alin les curs d'une
foule
cif g-enlilshommes qui, de serviteurs heureux et soumis
Versailles, sont devenus des raisonneurs dsuvrs et m-
contents dans les provinces.
On doit encore plus au conseil de la eruerrc. Tous ses
membres, et en gnral tous ceux que l'arme
appelle des
faiseurs, taient sans le savoir les vritables instigateurs de
la rvolution. Les coups de plats-dc-sabrc et toute la disci-
pline du nord ont dsespr les soldats franais.
Ceux qui
ont substitu le bton rhonncur mriteraient
qu'on les
traitt d aprs cette prfrence, si la rvolution
n'entranait
que des malheurs.
Il ne faut pas oublier non plus ce qu'on doit M. l'Arche-
veque de Sens (i), qui aima mieux faire une guerre int-
rieure et dangereuse aux parlements qu'une guerre extrieure
et honorable contre la Prusse. La Hollande qu'on aurait sau-
ve aurait donn des secours en argent; et cette guerre
aurait sauv le roi lui-mme, en lui attachant l'arme, et
en le rendant respectable au dedans et au dehors
(2).
Enfin on doit tout au dpit des parlements qui ont mieux
aim prir avec la rovaut que de ne pas se ven^-er d'elle.
Depuis longtemps le cabinet de Versailles tait, pour les
lumires, fort au-dessous du moindre club du Palais-Royal.
La postrit aura peine croire tout ce qu'a fait le gouver-
nement, et tout ce qu'il n'a pas fait. Il
y
a eu comme un
ooncert de btises dans le conseil. A la veille de leurs mau-
vaises dispositions, les ministres firent renvoyer M. Neckcr,
et ce fut encore l un nouvel effet de l'heureuse toile de cet
administrateur, qui aurait t envelopp dans la haine pu-
blique, c'est--dire, proscrit par l'Assemble nationale et
condamn au Palais-Royal ainsi qu' rhtcl-de-ville, s'il ft
rest deux jours de plus Versailles.
On convient unanimement que si le roi tait mont
cheval et qu'il se ft montr l'arme, elle et t fidle,
et Paris tranquille
;
mais on n'avait song rien. Cette
i
i) Lomcnie de Brienne.
2)
Observez que la France, au moment de la rvolution, araitalteint
son plus bas prig-^e en Europe. Elle avait abandonn successivement
tous ses allis, laSude, la Prusse, la Turquie, la Hollande, la Poloo^ne
et les princes de l'Empire : c'est aujourd'hui son trait de commerce
avec l'Angleterre qui achve de la ruiner. W.
i36
nivAROL
arme, en arrivant, manquait de tout
;
elle fut nourrie et
pourvue par ceux qu'elle venait rprimer. Le moyen que ses
pdasrog'ues pussent la dirig-er contre ses nouveaux bienfai-
teurs! Elle a suivi l'exemple des Gardes Franaises, qui au
fond n'ont jamais t dans Paris que des bourg-eois arms.
D'ailleurs, apfs avoir fait la faute d'assembler les tats-
gnraux aux portes de Paris, c'tait commettre une impru-
dence que d'y rassembler les troupes. Les bourgeois de cette
grande ville et une foule d'missaires se rpandirent dans le
pleines mains : cle s
jours aprs leur arrive, il tait peu prs certain que les
camp, et semrent Tor pleines mains : cle sorte que, huit
troupes n'obiraient pas. Le roi, en cong-diant l'arme, ne
consulta sans doute que ia clmence, mais il aurait d la
cong-dier encore en ne consultant que la prudence. On dira
peut-tre que le roi aurait d suivre l'arme; ceci suppose
un autre systme, un autre ordre de choses et un tout autre
roi.
Comme rien n'avait t prvu, rien ne se trouva g-ard.
La Bastille emporte, trente mille fusils et cent pices de
canon entre les mains du peuple, une milice de soixante
mille bouro-eois, un snat permanent l'htcl-de-ville et
dans les soixante districts, l'Assemble nationale se mettant
sous leur sauve-garde, et le roi, forc devenir Paris
approuver leurs fureurs et lg-itimer leur rbellion
;
tels ont
t les derniers symptmes et les signes les plus clatants
de la rvolution : caria dfection de l'arme n'est point une
des causes de la rvolution
;
elle est la rvolution mme.
L'extrme population dans un tat est aussi une des cau-
ses de la chute des pouvoirs et des rvolutions . Tout pros-
pre chez un peuple au gr de ceux qui le gouvernent, lors-
qu'il
y
a plus de travaux faire que d'hommes employer :
mais quand les bras l'emportent par le nombre sur les tra-
vaux faire, il reste alors beaucoup d'hommes inutiles,
c'est--dire, dangereux. Alors il faut recourir aux migra-
tions, et fonder des colonies, ou donner ces peuples une
forte constitution pour les contenir : mais malheureusement
si, au lieu de leur donner cette constitution, le prince les
assemble pour qu'ils se la donnent eux-mmes, alors c'est
cette partie oisive et remuante qui domine, et tout est perdu.
Nous n'avons parl, dans l'numration de ces causes, ni
de ce qu'on reproche la reine, ni des dprdations de quel-
l'LlTIOLE
187
qucs favoris : ce sont l des sujets de mccontcntomcnt, et non
(U's causes de rvolution. Seulement peut-on dire que des
faveurs, entasses sans mnag-ement sur quelques individus,
ont dcourag- et alin une grande partie de la noblesse et
lu clerg-, et que ce sont ces mmes nobles et ces prlats
runis aux parlements, qui ont t les instig^ateurs et les
jnemires victimes de la rvolution. Cela devait tre, puis-
(ju'en dernier rsultat tout mouvement national n'est qu'un
choc de Vgalit naturelle (i) contre les privilg-es, et, s'il
iaut le dire, du pauvre contre le riche. Du moment en effet
([ue les privilg-es sont si coupables, il est difficile que les
!4 landes proprits ne soient pas un peu odieuses; et, voil
[Kturquoi, d'un bout du royaume l'autre, ceux qui n'ont
1 ien se sont arms contre ceux qui possdent, et que le sort
de l'tat dpend aujourd'hui du succs qu'auront les milices
bourg-eoises contre les brig-ands.^
* if-
L'Assemble nationale n'avait pas t dpute pour faire
une rvolution, mais pour nous donner une constitution. Nos
dputs n'ont encore fait que dtruire. Ils cdent aujourd'hui
la tentation de placer une dclaration des droits de l'homme
la tte de la constitution
;
puissent-ils ne pas s'en repentir!
Les princes, qui on parle toujours de leurs droits et de leur
privilg-es, et jamais de leurs devoirs, sont en gnral une
jnauvaise espce d'hommes. L'Assemble nationale aurait-
elle le projet de faire de nous autant de princes? Les pas-
sions ne crient-elles pas assez haut dans le cur humain, et
une assemble lgislative doit-elle favoriser l'envie, qui ne
ut pas qu'un homme puisse jamais valoir ou possder plus
ve
il) Nous entendons, par ce mot, une alit de droit, et non une fc2:a-
lit de fait, puisqu'il est vrai que les hommes naissent avec des moyens
ingaux, et passent leur vie dans des conditions trs ingales, de quel-
.;ue libert que jouisse le pays o ils se trouvent. Un cordonnier de
l'ancienne Home n'tait pas l'sal de ScipioQ, quoiqu il et naturelle-
ment autant de droit que lui aux emplois de la Rpublique
;
ils taient
tous deux cgaux par le droit, et ingaux par les moyens. F^eut-tre fau-
drait-il, au "lieu 'gaiil nalurelle, gaill civile, puisque tous les
citoyens sont protges par des lois gales. Il n'y a, il n'y aura jamais
d'autre galit parmi les hommes. l\.
8.
l38
RIVAROL
qu'un autre? Depuis quand la loi, qui a toujours li les
hommes, ne song-c-t-elle qu' les dlier et qu' les armer?
Tous les lgislateurs ont ajout aux liens les chanes de la
religion
;
ils n'ont jamais cru prendre trop de prcautions
pour tablir parmi le peuple la subordination, cet ang-e tut-
laire du monde. Mais les philosophes actuels composent
d'abord leur rpublique, comme Platon, sur une thorie
rigoureuse
;
ils ont un modle idal dans la tte, qu'ils veu-
lent toujours mettre la place du monde qui existe; ils
prouvent que les prtres et les rois sont les plus grands
llaux de la terre, et quand ils sont les matres, ils font
d'abord rvolter les peuples contre la religion et ensuite
contre l'autorit. C'est la marche qu'ils ont suivie en France
;
ils ont veng les rois des entreprises des papes,et les peuples
des entreprises des rois : mais bientt ils verront, avec dou-
leur, qu'il faudrait qu'il existt un monde de philosophes
pour briser ainsi toute espce de joug : ils verront qu'en
dliant les hommes on les dchane, qu'on ne peut leur
donner nne arme dfensive qu'elle ne devienne bientt oftcn-
sive, et ils pleureront sur le malheur de l'espce humaine,
qui ne permet pas ceux qui la gouvernent de songer la
perfection. Alors, de philosophes qu'ils taient, ils devien-
dront politiques. Ils verront qu'en lgislation comme en
morale le bien est toujours le mieux : que les hommes s'at-
troupent parce qu'ils ont des besoins, et qu'ils se dchirent
parce qu'ils ont des passions; qu'il ne faut les traiter ni
comme des moutons, ni comme des lions, mais comme s'ils
taient l'un et l'autre
;
qu'il faut que leur faiblesse les ras-
semble, et que leur force les protge. Le despote qui ne voit
que de vils moutons, et le philosophe qui ne voit que de fiers
lions, sont galement insenss et coupables.
Il faut pourtant observer que les livres des philosophes
n'ont point fait de mal par eux-mmes, puisque le peuple
ne les lit point et ne les entendrait pas
;
mais il n'est pas
moins vrai qu'ils ont nui par tous les livres qu'ils ont fait
faire, et que le peuple a fort bien saisis. Autrefois, un livre,
qui ne passait pas l'antichambre, n'tait pas fort dangereux;
et aujourd'hui il n'y a que ceux en etlet qui ne quittent pas
les antichambres qui sont vraiment redoutables. En quoi il
faut louer les philosophes qui crivaient avec lvation pour
corriger les gouvernements, et non pour les renverser; pour
POLITIOUE
l3^
"soulag-er les peuples, et non pour les soulever; mais les gou-
vernements ont mpris la voix des g-rancls crivains, et ont
donn le temps aux petits esprits de commenter les ouvrag-es
du nie, et de les mettre la porte de la populace.
Il est dur sans doute de n'avoir que des fautes ou des
crimes raconter, et de transmettre la postrit ce qu'on
ne voudrait que reprocher ses contemporains; mais,
comme dit un ancien, quand on ne peut faire peur aux
hommes, il faut leur faire honte. Jamais en effet g-ouverne-
mcnt n'a t plus humili que le ntre; jamais il n'y eut
d'assemble lg-islativeplus insense.jamais de capitale plus
coupable. Puisse la nation profiter g-aloment des fautes de
la cour, et des crimes de Paris, et de l'incroyable conduite
de ses dputs 1 Puissent-ils s'appercevoir eux-mmes qu'
mesure qu'ils dmolissent avec tant de zle, le peuple ne
cesse de briser avec fureur les matriaux qu'ils tirent du
vieil difice et qui devaient servir la construction du
nouveau !
Qu'ils ne nous accusent pas d'avoir exag-r leurs fautes
ou extnu leurs bonnes intentions
;
nous avons au contraire
jet plus d'un voile sur les maux particuliers, pour ne voir
t ne montrer que le malheur public. Le roi, dans ses pro-
larnations pour le maintien de Tordre, avoue en gmissant,
^ue ce qui se passe est la honte et le scandale de la
France. M. Necker lui-mme dit dans ses discours que le
gouvernement ne peut plus rien : avons-nous avanc des
:hoses plus fortes? avons-nous dtaill tous les crimes,
lmasqu toutes les ruses, dnonc toutes les prtentions?
i3'autres que nous auraient parl de l'affaire de Brest et de
a rpugnance qu'a montre l'Assemble nationale pour
lvoiler ce complot
;
pourquoi un rgiment rvolt contre
es chefs, Strasbourg, aprs avoir commis de grands
xcs, a rclam utilement la protection de l'Assemble
lationale; pourquoi nos dputs comptent leurs mandats,
antt pour beaucoup, tantt pour rien. Mais ces questions
t d'autres encore sont inutiles. L'Assemble enfin ne dissi-
nule plus : elle ne tend qu' obscurcir le trne, et peut-tre
nme l'anantir : mais la nature des choses est plus forte
jue la volont des hommes
;
cette nuit et ces projets se dis-
iperont; l'orage n'aura dispers que les fanatiques dupeu-
Je et les esclaves de la cour, et le trne brillera un jour sous
l40
UIVAROL
un ciel plus pur, appuy sur la libert publique, et revtu
d'une splendeur tranquille.
Sil existait, sur la terre, une espce suprieure Thomme,
elle admirerait quelquefois notre instinct
;
mais elle se moque-
rait souvent de notre raison. C'est surtout dans les grands
vnements que nos eflbrts suivis de tant de faiblesse, et nos
projets accompag-ns de tant d'imprvovance exciteraient sa
piti. Il a fallu que la vanit de l'homme confesst qu'il existe
une sorte de fatalit, un je ne sais quoi qui se plat don-
ner des dmentis la prudence et qui trouble son g"r les
conseils de la sagesse. C'est la brivet de notre vue qu'il
faut s'en prendre. Si nous appercevions les causes avant
d'tre avertis par les effets, nous prdirions les vnements
avec quelque certitude; mais toujours forc de remonter des
effets aux causes, l'homme passe sa vie raisonner sur le
pass, se plaindre du prsent, et trembler pour l'avenir.
Oui aurait dit au vieux Maurepas, lorsqu'il rtablit les
Parlements,
en
1774?
qu'il les perdait jamais, et avec eux
autorit royale 1 Et pour en venir des exemples plus
rcents, qui aurait dit. l'anne dernire, la noblesse et au
clerg", lorsqu'ils demandaient grands cris les tats g-n-
raux, qu'ils
y
trouveraient une fin si prompte? Ils ne son-
geaient pourtant qu' se venger de M.l'archevque de Sens,
et rattraper quelques bribes de pensions que ce cardinal
avait supprimes. M. Necker est peut-tre le seul qui, aprs
avoir accord la double reprsentation au tiers-tat, ait senti
tout coup qu'il renversait l'ancienne monarchie
;
mais l'effet
tait si prs de la cause que ce ministre est impardoimable
de ne l'avoir pas senti plus tt. Son repentir et ses efforts
ont t inutiles : en vain a-t-il indiqu la dlibration par
ordre, comme un remde efficace pour le mal qu'il avait
fait; limpulsion tait donne, et le tiers-tat a cri, par
mille bouches la fois, qu'il dlibrerait /)ar tle.
^Maintenant, s'il est un problme intressant au monde,
c'est celui que nous offre la situation actuelle de la France.
Que deviendra le roi ? que deviendront les fortunes
?
Chacun se le demande, et dans la consternation univer-
selle, l'intrt, la peur oue fanatisme rpondent tour tour.
Nous essayerons bienttsi, travers tous leurs cris, la raison
pourra faire entendre sa voix
;
et sans trop nous livrer l'art
des conjectures, nous verrons jusqu' quel point il est
POLITIQLE
141
i
permis nos faibles reg-ards de se porter dans l'avenir.
']
Mais avant d'examiner les travaux de l'Assemble natio-
'
nale, et de prononcer sur notre tat futur d'aprs l'tat o
jnous sommes,il faut d'abord convenir que les sottises de la
cour et les g-riefsde la nation taient monts leur comble;
nous ne saurions trop le rpter. Tous les rois du monde ont
reu une g-rande leon dans la personne du roi de France.
Les gouvernements apprendront dsormais ne pas se lais-
! scr devancer par les peuples qu'ils dirigent. Dans le nord
|dc l'Europe, l'Ang-leterre excepte, les princes sont instruits,
|et les peuples ignorants; au midi,les princes sont ignorants,
let les peuples clairs : cela vient de ce que les rois du
nord s'occupent lire nos bons ouvrages, et que les rois du
midi ne songent qu' les proscrire. La France surtout offrait
depuis long-temps le spectacle du trne clips au milieu
des lumires. Ce spectacle est dgotant et ne saurait tre
long-. Il faut des rois administrateurs aux Etats industrieux,
riches et puissants : un roi chasseur ne convient qu' des
peuples nomades.
Quand M. de Galonn assembla les notables, il dcouvrit
mx yeux du peuple ce qu'il ne faut jamais lui rvler, le
dfaut de lumires plus encore que le dfaut d'arg-ent. La
nation ne put trouver, dans cette Assemble, un seul homme
l'Etat; et le gouvernement perdit jamais notre confiance.
"est ce cjui arrivera chez tous les peuples que les ministres
consulteront. En effet, que diraient des voyageurs qui au-
raient pris des guides, si, au milieu des bois, ces mmes
guides s'arrtaient tout coup pour les consulter sur la
*oute qu'il faut prendre? Les voyag-eurs seraient encore bien
oux s'ils ne faisaient que mpriser leurs guides. Or, quand
es peuples cessent d'estimer, ils cessent d'obir. Rgle gn-
'ale : les nations que les rois assemblent et consultent com-
nencent par des vux, et finissent par des volonts. Tel peu-
le c{ui se ft estim heureux d'tre cout dans ses plaintes
nit par ne vouloir pas mme entendre la voix de ses mattres
.
Au reste, la nation franaise a pris un moyen infaillible
le se procurer de grands princes, en leur donnant des entra-
xes et mme des inquitudes. Quand les rois taient absolus,
orsqu'il tait si ncessaire qu'ils eussent des talents, on les
bandonnait des g-ouverneurs et des ministres imb-
iles, et ils s'endormaient sur le trne : maintenant que, par
l42 RIVAROL
la constitution, si elle dure, ils seront restreints dans leurs
pouvoirs, et qu'il serait presque indiffrent qu'ils eussent le
mrite personnel, ils seront toujours veills par le besoin et
le malheur, ces grands prcepteurs des rois; ils seront tou-
jours bien entours
;
ils seront guerriers, financiers, politi-
ques
;
ils seront eux-mmes leurs propres ministres.
Voil en peu de mots la grande faute du gouvernement.
Voyons prsent les griefs de la nation.
Ils sont nombreux sans doute
;
et pourtant qui le croirait ?
ce ne sont ni les impts, ni les lettres de cachet, ni tous les
autres abus de l'autorit; ce ne sont point les vexations des
intendants, et les longueurs ruineuses de la justice, qui ont
le plus irrit la nation; c'est le prjug de la noblesse, pour
lequel elle a manifest plus de haine: ce qui prouve videm-
ment que ce sont les bourgeois, les gens de lettres, les gens
de finances, et enfin tous ceux qui jalousaient la noblesse,
qui ont soulev contre elle le petit peuple dans les villes, et
les paysans dans les campagnes. C'est une terrible chose
que la qualit, disait Pascal; elle donne un enfant, qui
vient de natre, une considration que n obtiendraientpas
cinquante ans de travaux et de vertus. Il est singulier en
effet que la patrie s'accorde dire un enfant qui a des par-
chemins : Tu seras un jour prlat, marchal de France, ou
ambassadeur, ton choix , et qu'elle n'ait rien dire
ses autres enfa^nts. Les gens d'esprit et les gens riches trou-
vaient donc la noblesse insupportable, et la plupart la trou-
vaient si insupportable qu'ils finissaient par l'acheter. Mais
alors commenait pour eux un nouveau genre de supplice;
ils taient des ennoblis, des gens nobles, mais ils n'taient
pas gentilshommes
;
car les rois de France, en vendant la
noblesse, n'ont pas song vendre aussi le temps qui manque
toujours aux parvenus. Quand l'empereur de la Chine fait
un noble, il le fait aussi gentilhomme, parce qu'il ennoblit
le pre, l'aeul, le bisaeul, le trisaeul, au fond de leurs
'
tombeaux, et qu'il ne s'arrte qu'au degr qu'il veut. Cet i
emipereur vous donne ou vous vend la fois le pass, le pr- .
sent et l'avenir; au lieu que les rois de notre Europe ne nous
vendent que le prsent et le futur
;
en quoi ils se montrent
moins consquents et moins magnifiques que le monarque
chinois. Les rois de France gurissent leurs sujets de la
POLITIOUE
143
roture, peu prs comme des crouclles, condition
qu'il
en restera des traces.
Je le demande maintenant aux diffrents peuples de l'Eu-
rope, et aux Franais particulirement : qui la faute, si la
folie de la noblesse est devenue pidmique parmi nous?
Faut-il s'en prendre un g-entilhomme de ce que tout le
monde lui dit qu'il est >'entilhomme
;
de ce que tout le
monde lui sait r de porter le nom de son pre
;
de ce que
1 tout le monde lui crie de bien conserver ses vieux papiers et
I
de vivre sans rien faire; de ce qu'enfin tout le monde le tient
I
pour dg-rad si la pauvret le force travailler et se ren-
dre utile la socit? Il est bien clair que si les nobles avaient
t seuls croire ces sottises-l, ils auraient bientt quitt
I
la partie; que si on avait ri, pour la premire fois, au nez de
j
gens qui se disaient nobles, ils ne l'auraient pas dit long*-
|l temps. Mais les roturiers taient encore plus frapps qu'eux
'
de cette maladie : la noblesse est aux yeux du peuple une
II espce de religion dont les gentilshommes sont les prtres
;
i|et parmi les bourgeois il
y
a bien plus dimpies que d'in-
rl crdules. Nos acadmies, moins consquentes que les cha-
pitres nobles o l'esprit et le talent n'ont jamais fait entrer
I
personne, ont voulu se dcorer de gentilshommes, et ont
ouvert leurs portes la naissance. Nos philosophes mme
ont pass leur vie classer dans leur tte les diffrentes
fnalogies
de l'Europe, et se dire entre eux : Un tel est
on, un tel ne Vest pas
;
ce sot et ce fripon
sont des
r/ens comme il
faut ;
un tel est du bois dont on fait
les
Lvcfues et les marchaux de France ; et ils ont ainsi
l'dit un tas de phrases proverbiales qui, passant de
iiche en bouche, ont vici les meilleurs jugements, et
form ce qu'on appelle le prjug de la noblesse.
Je vous le demande donc, nation franaise, qui la faute
si ce prjug a renvers toutes les ttes? N'est-ce pas vous
vous en accuser vous-mme ? INIais, si vous vous en accu-
sez, si vous en rougissez, pourquoi massacrez-vous un
homme par la raison qu'il est gentilhomme ? Pourquoi br-
|lez-vous ses archives et ses chteaux? Peut-tre voulez-vous,
iaprs avoir expi votre sottise par la honte, laver votre
lionte dans le sang et devenir atroce pour faire oublier que
vous avez t ridicule. Mais je vous le prdis, vous n'aurez
fait
que des crimes inutiles
;
vous n'teindrez pas des
144
UIVAUOL
souvenirs. Csar disait l'assemble la plus dmocratique
qui ait exist sur terre : (( Je descends d'Ancus Martius
par les hommes, et de Vnus par les femmes
;
si bien
(( qu'on trouve, dans ma maison, la majest des dieux et la
<( saintet des rois. Il le disait, et on ne l'en aimait pas
moins
;
car les Romains taient plus jaloux des emplois de
la rpublique que des g-nalogies des particuliers : et sans
doute, bourg-eois parisiens, que vous aurez un jour une ja-
lousie aussi raisonnable, quand vous verrez vos enfants par-
venir, comme les nobles, aux charg-es publiques. Mais, je
vous le rpte, les nohles partageront toujours avec vous les
profits des places, sans que vous puissiez partager avec eux
la vanit des titres
;
sans qu'il vous soit jamais possible
d'oublier ni ce qu'ils furent, ni ce que vous tes
;
et mme,
dans votre constitution future, ceux de vous qui auront pass
par les grandes charges deviendront aussi des nobles, et
ceux qui n'y parviendront que les derniers seront toujours
traits ' hommes nouveaux. Ce mal est incurable dans
notre Europe, et il serait encore plus ais nos philosophes
de vous en consoler que de vous en gurir.
II. LA DECLARATION DES DROITS DE L HOMME
On fait, disait le sfrand roi de Prusse, un mtier de dupe
uand on gouverne les Etats dans les temps de trouble et
e malheur. En effet, le crdit de l'homme le plus vnr
peut baisser dans les temps de crise, soit que la toi manque*
aux miracles, ou que les miracles manquent la foi, et c'est
ce que M. Necker prouva, ainsi que nous allons voir.
Ce ministre avait trouv l'Assemble nationale dans une
situation brillante, mais dlicate. Tous les pouvoirs taient
entre ses mains, toutes les cours souveraines ses pieds
;
les flicitations, les encouragements et les adhsions arri-
vaient de toutes parts
;
mais elle avait ses portes cette
capitale dont elle s'tait servie pour renverser le trne; et la
puissance ombrag-euse et farouche d'un peuple qui use de
sa force plutt que de ses droits, exig-eait des mains habiles
pour tre dirige. M. de la Fayette, commandant gnral
des milices, crivait aux bourgeois de Paris : Excuter vos
dcrets;
vivre et mourir, s'il le
faut,
pour vous obir
POLITIQUE
1^5
voil les seules /onctions, les seuls droite de celui que
vous avez daign nommer votre commandant. Tout fl-
chissait, avec plus ou moins de bassesse, devant ce peu[)l('
de rois
;
et comme ils avaient manifest des dsirs trs d-
mocratiques, il tait bien craindre qu'ils n'entranassent
vers un tat trop populaire une Assemble nationale, dpu-
te pour reconnatre que la France est un tat monarchique
dont le chef a la plnitude du pouvoir excutif, et une
g-rande partie du lg-islatif.
L'Assemble ne put, en effet, rsister l'impulsion don-
ne par la capitale et augmente dans son propre sein par
une majorit turbulente. Enivre par les succs, traitant la
prudence de fail)lesse, et la* violence d'nerg-ie, elle voulut
encore ajouter au fol enthousiasme des peuples, en se pla-
ant au-del des usag-es et des droits les plus antiques, et
en prenant les choses de si haut qu'elle eut l'air d'assister
la cration du monde.
Pour remplir, sans obstacle, une si glorieuse destine, les
tats-gnraux s'appelrent tantt les reprsentants de la
France, et tantt la France mme
;
tantt YAssemble
nationale, Qi tantt la nation;com])\^x\i leurs mandats pour
quelque chose ou pour rien, selon le besoin et l'occurrence.
Et d'abord, au lieu d'une constitution et d'une lgislation
dont la France avait un si uri;ent besoin, ils annoncrent
Ijhautement qu'ils allaient faire une dclaration des droits
I
rie ihomme
;
c'est--dire, qu'avant de nous donner un livre
j ncessaire, ils voulurent faire une prface dangereuse. Ils
{|5e considrrent dans leur maison de bois, comme dans une
\ autre arche de No, d'o il leur sembla que la terre tait au
( premier occupant, et qu'ils pouvaient la partagera un nou-
veau genre humain. Ils dclarrent donc, la face de l'uni-
rers, que tous les hommes naissaient et demeuraient
^libres; qu'w/i homme ne saurait tre plus quun autre
V homme, et cent autres dcouvertes de cette nature, qu'ils se
r Flicitaient d'avoir rvles les premiers au monde; se mo-
fcjuant bien philosophiquement de TAn^-leterre, qui n'avait
^ )as su dbuter comme eux lorsqu'elle se donna une consti-
ij ution en 1688.
1/
Mais la joie de nos dputs fut courte. On se demanda
f
bientt, en Europe, quelle tait donc cette nouvelle mthode
l jle conduire les peuples avec des thories et des abstractions
l46 RIVAROL
mtaphysiques
;
de compter pour rien la pratique et l'exp-
rience, de confondre l'homme absolument sauvag-e avec
l'homme social, et l'indpendance naturelle avec la libert
civile. Dire que tous les hommes naissent et demeurent
libres, c'est dire en effet qu'//s naissent et demeurent nus.
Mais les hommes naissent nus et vivent habills, comme ils
naissent indpendants et vivent sous des lois. Les habits
gnent un peu les mouvements du corps
;
mais ils le prot-
gent contre les accidents du dehors; les lois gnent les pas-
sions, mais elles dfendent l'honneur, la vie et les fortunes.
Ainsi, pour s'entendre, il fallait distinguer entre la libert
et l'indpendance : la libert consiste n'obir qu'aux lois
;
mais dans cette dfinition le mot obir s'y trouve, tandis
que l'indpendance consiste vivre dans les forts, sans
obir aux lois, et sans reconnatre aucune sorte de frein.
On trouva donc trange et dangereux que l'Assemble
nationale et rdig le code des sauvages et recueilli des
maximes en faveur de l'gosme et de toutes les passions
ennemies de la socit. Les ngres, dans les colonies, et les
domestiques dans nos maisons, peuvent, /a dclaration des
droits la main, nous chasser de nos hritages. Comment
une assemble de lg-islateurs a-t-elle feint d'ignorer que le
droit de nature ne peut exister un instant ct de la pro-
prit? Du jour o un homme a pris possession d'un champ
par le travail, il n'a plus t en tat de pure nature; son
existence, comme celle de ses voisins, a t industrieuse et
dpendante.Mais FAssemble n'a pas voulu se souvenir que
le corps politique est un- tre artificiel qui ne doit rien la
nature
;
que les hommes naissent insi^aux, et que la loi est
l'art de niveler les ingalits naturelles.
Maintenant,
pour ne rien omettre, il est ncessaire de
remonter l'poque o TAssemble nationale, honteuse
-
leons qu'elle avait reues, et du temps qu'elle a^-ait pei
faire un assortiment des droits de l'homme sauvage et
des droits de l'homme social, se porta avec ardeur vers la
*
constitution qu'attendait d'elle une monarchie qui, loin de
commencer, a dj dur quatorze sicles et dans laquelle
POMTIOL'
'47
on ne trouverait pas, quoi qu'on en dise, un seul homme
en
tat de pure nature...
Ce ne fut que le 6 juillet qu'on proposa de s'occuper de
la constitution. Mais avant mme que la noblesse et le
clere;
.se fussent, pour ainsi dire,eni>;-loutis et fondus dans le tiers-
tat, l'Assemble avait dcrt : (( Qu'elle abolissait tous
les impts existants, comme ilh'^-aux dans le droit et dans
K( la forme, etc., mais qu'en attendant, pour ne pas boule-
(( verser le royaume, on continuerait de les payer, etc.
Presque tous es dcrets de l'Assemble nationale ont t
aits sur ce modle, c'est--dire que, dans le premier mem-
bre du dcret, l'Assemble abolit, et que, dans le second,
*lle maintient pour un temps. Mais le peuple n'a bien en-
end, n'a excut que la premire partie du dcret, et s'est
noqu de l'autre. Voil la clef de tous les dsordres dont
lous^-missons.
Les crivains du tiers-tat, et, en gnral, tous les philo-
;ophes, ayant pouss bout et forc les consquences du
u-incipe que La souverainet est dans le peuple, il a bien
allu que la rvolution crite dans les livres fut joue et
eprsentcdans la capitale et dansles provinces. Pouvait-on
n efl'et arrter une Assemble qui exerait la souverainet
u peuple, et qui avait ^a^-n l'arme ? N'tait- ce pas en
lme temps une vritable jouissance pourdes dputs. dont
i plupart avaient pass leur temps saluer le bailli de leurs
illag-es, ou courtiser l'intendant de leurs provinces; n'-
dt-ce pas, dis-je, une douce jouissance pour eux que de
)uler aux pieds un des premiers trnes du monde? Des
v'ocats pouvaient-ils rsister au plaisir d'humilier les cours
mveraines? Ceux qui n'avaient rien n'taient-ils pas char-
s de distribuer les trsors de l'g^lise aux vampires de
Etat ?
On ne saurait trop insister sur tout le mal que peut faire
1 bon principe quand on en abuse.
La souverainet est dans le peuple: maiselley est d'une
anire implicite, c'est--dire, condition que le peuple ne
xercera jamais que pour nommer ses reprsentants; et si
st une monarchie, que le roi sera toujours le premier
agistrat. Ainsi, quoiqu'il soit vrai au fond que tout vient
la terre, il ne faut pas moins qu'on la soumette par le
avail et la culture, comme on soumet le peuple par l'auto-
i48 niVArvOL
rite et par les lois. La souverainet est dans le peuple comme
un fruit est dans nos champs, d'une manire abstraite. Il
faut que le fruit pas.se par l'arbre qui le produit, et que
l'autorit publique passe par le sceptre q.ui l'exerce. D'ail-
leurs, un peuple ne pourrait gouverner toujours par lui-
mme que dans une trs petite ville : il faudrait mme que
des orateurs turbulents et des tribuns emports vinssent
l'arracher tous les jours ses ateliers pour le faire rg-ner
dans les places publiques; il faudrait donc qu'on le pas-
sionnt pour le tenir toujours en haleine. Or, des que le
Souverain est pa.ssionn, il ne commet que des injustices,
des violences et des crimes (i).
Cette maxime de la souverainet du peuple avait pourtant
si bien exalt les ttes que l'Assemble, au lieu de suivre
prudemmicnt le projet du comit de constitution, et de btir
un difice durable et rg-ulier, s'abandonna tout entire au
flux et reflux des motions, ainsi qu' la foup;-ue de ses ora-
teurs, qui entassrent l'envi dcrets sur tlcrets, ruines
sur ruines, pour satisfaire le peuple qui fourmillait dans les
traves de la salle, menaait au Palais-Pioval, et fermentait
dans les provinces.
Si, au lieu d'exciter le peuple, on et cherch l'adoucir, i
on lui aurait dit qu'une nation n'a point de droits contraires'
son bonheur
;
qu'un enfant qui se blesse exerce .sa force Qi\
non ses droits : car tout peuple est enfant et tout g-ouvcrne-
1
ment est pre. Mais l'Assemble avait un autre plan. Dul
principe de la souverainet du peuple dcoulait ncessaire-
i
ment le dogme de l'o-alit absolue parmi les hommes, et ce
dogme de l'galit des personnes ne conduirait pas moins
ncessairement au partage gal des terres. Il est assez vi-i
dent aujourd'hui que l'Assemble nationale a pris, poiiri
russir, un des grands moyens de l'vangile: c'est de pr-
cher la haine des riches; c'est de les traiter tous de niauuais
riches. De l au partage des biens, il n'v a qu'un pas. C'est
une dernire ressource que nos philosophes ne voient, dans
l'obscur avenir, qu'avec une secrte horreur. Mais ils s'y
seraient dj rsolus, si la longue dfaillance du pouvoir
excutif ne leur et donn le temps de ttonner dans leur
(i) En gnral, le peuple est un souverain qui ne demande qu' man-
ger, et sa majest est tranquille quand elle digre. R.
POLITIQUE
l49
marche, et avant de s'arrter cet affreux moyen, d'essaver
de tous les autres. Peut-tre aussi que la condescendance
du
prince a empch l'Assemble de (l<''|)Ioyer toute son ner*-ie,
et de faire explosion
;
le corps qui fi'aj)pe, ne trouvant pas de
f)oint
d'appui dans celui qui cde, fait moins de ravaQ;-es;
et
e g"Ouvernemeut, en reculant sans cesse, a fait la rsistance
des corps mous. Heureusement encore tjue cet expdient
d'armer le pauvre contre le riche est aussi absurde qu'ex-
crable. Il
y
a sans doute quinze ou seize millions d'hommes
qui n'ont rien en France que leurs bras
;
et quatre ou cinq
millions, qui ont toutes les proprits. Mais le besoin et la
ncessit ont jet plus de liens entre le pauvre et le riche que
la philosophie n'en saurait romj)re. C'est la ncessit qui
fait sentir la multitude des pauvres, qu'ils ne peuvent
exister sans le petit nombre des riches : c'est cette provi-
dente ncessit qui dfend au lierre d'touffer, avec ses mille
bras, le chne qui le soutient et l'empche de ramper sur la
terre. Oui, la ncessit est plus humaine que la philosophie:
car c'est la nature qui fait la ncessit, et c'est nous qui fai-
sons notre philosopnie.
Le riche est f;iit pour beaucoup dpenser
;
Le pauvre est fait pour beaucoup amasser :
Et le travail, g;ag par la mollesse,
S'ouvre, pas lents, la route la richesse.
Ces rapports sont ternels. C'est de l'in^'alit des condi""
lions que rsultent les ombres et les jours qui composent le
tableau de la vie. Les novateurs esprent en vain d'anantir
cette harmonie. Ur/nlit absolue parmi les hommes est
Veucharistie des philosophes (i). Du moins l'^-lise difiait
sans cesse; mais les maximes actuelles ne tendent qu' d-
truire. Elles ont dj ruin les riches, sans enrichir les pau-
vres : et au lieu de l'ei-alit des biens, nous n'avons encore
que l'i-alit des misres et des maux.
J'entends bien ce que c'est que la philosophie d'un parti-
culier; ce que c'est qu'un homme dgaJ' des murs du peu-
ple, et mme des passions; un philantrope, un cosmopolite,
pour qui toutes les nations ne forment qu'une seule et mme
(i) Les uvres conipl/es disent : ... le mystre... Exemple des
corrections timores que des diteurs pieux ont fuit subir la pense,
toujours uette et hardie, de Rivaroi.
l50 RIVAROL
famille : mais qu'est-ce que la philosophie d'un peuple ?
qu'est-ce que cette philanthropie, cette libert gnrale du
commerce, cette charit qui consiste renoncer tous L s
avantages que les autres n'auraient pas? Que serai t-i'
qu'un peuple sans passions, qui ouvrirait tous ses ports,
dtruirait ses douanes, partagerait sans cesse ses trsors et
ses terres tous les hommes qui se prsenteraient sans fur-
tune et sans talent? Un homme n'est philosophe que par( o
qu'il n'est pas peuple; donc un peuple philosophe ne ser
pas peuple, ce qui est absurde. La vraie philosophie ci
peuples, c'est la politique; et tandis que la philosophie pr-
che aux individus la retraite, le mpris des richesses et des
honneurs, la politique crie aux nations de s'enrichir aux
dpens de leurs voisins, de couvrir les mers de leurs vais-
seaux, et d'obtenir par leur industrie et leur activit la
prfrence dans tous les marchs de l'univers : car deux
nations sont entre elles, en tat de pure nature, comme deux
sauvasres qui se disputent la mme proie.
D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper
;
le patriotisme est
l'hypocrisie de notre sicle
;
c'est l'ambition et la fureur de
dominer qui se dguisent sous des noms populaires. Les
places taient prises dans l'ordre social
;
il a donc fallu tout
renverser pour se faire jour. Ce n'est point en effet le peu-
ple, ce ne sont pas les pauvres, au nom desquels on a fait
tant de mal, qui ont gagn la rvolution
;
vous le voyez :
la misre est plus grande, les pauvres plus nombreux (i)
;
et la compassion est teinte; il n'y a plus de piti, plus de
commisration en France. On donnait beaucoup lorsqu'on
croyait devoir des ddommagements
;
la charit comblait
sans cesse Fintervalle entre lespetitset les grands; la vanit
et l'orgueil tournaient au profit de l'humanit : ce n'tait pas
une pe, c'tait la prire qui armait la pauvret; et la ri-
chesse, qui a disparu devant la menace, ne rebutait pas la
misre suppliante. Maintenant que peuvent donner des
riches opprims des pauvres rvolts? On a renvers les
fontaines publiques sous prtexte qu'elles accaparaient les
eaux, et les eaux se sont perdues.
(i) Il
y
a dans le monde, et il
y
aura toujours des pauvres de profes-
sion, des mendiants
;
mais on ne devrait connatre que les pauvres
ouvriers et les pauvres infirmes; on ne devrait avoir que des ateliers et
des hpitaux II.
I
POLITIQUE l5l
Nos philosophes rpondent que les pauvres, qui dorna-
vant prendront tout, ne demanderont phis rien. Mais o
trouveront-ils de quoi prendre, moins d'un massacre g'n-
ral de tous les propritaires? Et alors, en poussant un tel
systme, il faudra donc que, de gnration en gnration,
les pauvres massacrent toujours les riches, tant qu'il
y
aura
de la varit dans les possessions
;
tant qu'un homme culti-
vera son champ mieux qu'un autre; tant que l'industrie
l'emportera sur la paresse
;
enfin, jusqu' ce que la terre
inculte et dpeuple n'oflVe plus aux regards satisfaits de la
philosophie que la vaste galit des dserts, et l'aflreuse
monotonie des tombeaux.
m. LES JOURNKES D OCTOBRE
/.
Le J octobre.
On a beaucoup parl des disettes de Paris pendant
1789;
la vrit est que, sous le rgne de Louis XVI, c'est--dire
jusqu' la mort du dernier prvt des marchands, Paris a
t amplement approvisionn
;
on pourrait mme reprocher
l'ancien gouvernement ses prdilections et ses profusions
pour la capitale, qui a toujours mang le pain meilleur
march que les provinces, et toujours aux dpens du trsor
royal. Les cris des Parisiens n'ont jamais t mpriss. Le
gouvernement n'tait aguerri que contre la misre des
campagnes : car les bouches les plus affames ne sont pas
les plus redoutables. Enfin, depuis que Paris, mtamorphos
en rpublique, s'est gouvern lui-mme, il n'est point d'in-
justices, il n'est point de violences (et je peux dire d'injusti-
ces et de violences heureuses), que le patriotisme de ses
officiers n'ait tentes pour approvisionner la ville.
A cette poque, l'migration de ceux que la populace
appelle aristocrates avait t si considrable que la con-
sommation de Paris tomba tout coup onze ou douze
cents sacs par jour. Aussi a-t-il t dmontr et reconnu
depuis, que la halle avait constamment regorg de farines.
Cette abondance pouvait tre fatale la faction d'Orlans
;
mais l'or, qui fait ordinairement sortir le bl, servit le
faire disparatre. Quoique l'approvisionnement de Paris ne
l52 niVAROL
ft que d'environ douze cents sacs, les boulano-ers s'en firent
distribuer dix-huit cents et jusqu' deux mille cinq cents
par jour (i). Avec cet excdent, leurs maisons ne laissaient
pas d'tre assif^es du matin au soir par le petit peuple qui
criait famine. En mmetemps il n'tait pas rare Je rencon-
trer des gens du peuple, devenus tout k coup oisifs, qui
disaient : Qu'avons-noiis besoin de travailler ? Notre pre
dOrlans nous nourrit. Ainsi l'or de ce prince produisait
son gr deux phnomnes Lien diffrents, la disette et
l'abondance; et ce double moyen n'tait rien an prix des
violences exerces la halle par quelques furieux qui ven-
Iraient les sacs et dispersaient les farines dans les rues.
Enfin, comme si ces manuvres taient encore trop lentes,
on accusale bl d'un vice qu'il n'avait pas : on rpandit qu'il
tait d'une mauvaise qualit, comme pour le punir de son
abondance, qui contrariait les desseins del cabale et triom-
phait partout des g-aspillages du peuple. Ce bruit accrdite
fut cause d'une expdition faite la halle sur deux mille
sacs qu'on jeta dans la Seine. Des tmoins irrprochables
ont g-ot cette farine, et ont affirm qu'elle tait de la
meilleure qualit...
C'est ainsi que la faction d'Orlans semait, force d'or,
la disette au milieu de labondance^ et prparait une insur-
rection dans les faubourg-s, dans les halles et dans les dis-
tricts. La nouvelle du repas des g-ardes du corps vint donner
un but ces mouvements intestins. ((Quelle orgie indcente,
s'criait-on! la cocarde nationale foule aux pieds! TAs-
semble maudite et menace ! allons punir tant de blas-
(( phmes
;
vengeons la nation et enlevons le roi aux enne-
(( mis de la patrie. Ces murmures et ces cris n'auraient
pourtant produit que d'autres cris et d'autres murmures, si
la faction d'Orlans n'et ramass trois ou quatre cents;
poissardes, et quelques forts de la halle habills comme elii
et mls a des espces de sauvages portant de longues bar-
bes, des bonnets pointus, des piques, des btons ferrs et
d'autres armes bizarres : hommes tranges qu'on voyait
pour la premire fois Paris, et qui parurent et disparu-
rent avec cette dernire tempte.
La troupe des assassins, nommes, femmes et sauvages,
(i) Voyez les registres de la halle, du samedi 3 octobre. R.
rOLITIQL'E
l55
s'empara le 5 ortobre, sept heures du matin, de l'htel-de-
ville, et I^ pilla. Le bruit de cette expdition amentale* peu-
1)le
;
des flots d'ouvriers arrivrent des fanbourGi's; on battit
a g-cnralc; les districts fournirent quelques bataillons; la
place de Grve fut bientt investie, et on reprit Thtel-dc-
ville, mais sans faire aucun mal aux brig-ands, sans les
chasser; au contraire, les vainqueurs se mlaient aux vain-
cus, et d'heure en heure la place de Grve se remplissait de
gardes nationales, qui fondaient de tous les districts, de
tous les quartiers et de toutes les rues. Vers midi parut le
commandant lui-mme. Le peuple lui cria d'une voix f-
roce, qu'il fallait aller Versailles chercher le roi et la
famille rovale; et comme ce commandant hsitait, on le
menaa du fatal rverbre. Ple, perdu, sans nerg'ie, et
sans dessein bien dtermin, il flottait sur son cheval au
milieu de cette foule immense, qui prenait son irrsolution
pour un refus, et le pressait de toutes parts. M. de la
Fayette voulait bien sans doute que le roi ft amen dans
Paris, mais il craig-nait une expdition entreprise par tant
de btes furieuses. Il expiait la faiblesse qu'il eut de ne pas
s'exposer la mort, ds le commencement, pour sauver la
vie MM. Foulon et Berthier : car, ou il aurait succomb
hroquement, ou il et jamais enchan la frocit du
Eeuple.
Mais pour avoir molli, il donna le secret de sa fai-
lesse, et le peuple n'a cess depuis d'en abuser. EnHn,vers
les deux heures^ la g-arde nationale fut absolument ma-
tresse de la place de Grve
;
il
y
eut alors prs de dix-huit
mille hommes arms. Le marquis de la Fayette monta
l'htcl-de-ville, et de-manda un ordre de la commune pour
aller Versailles, avec toute la milice nationale. Sans
doute qu'un autre sa place et fait dlibrer la commune
sur les moyens de dissiper le peuple , ce qui tait facile,
puisque son arme tait matresse de la Grve
;
et si cette
arme n'et pas obi, n'tait-ce pas une belle action de re-
noncer au commandement de cette milice indiscipline?
Mais soit faiblesse, soit ambition, M. de la Fayette sollicita
l'ordre pour Versailles. Vingt membres, au lieu de trois
cents, composaient en ce moment la commune de Paris : ils
donnrent M. de la Fayette la dlibration suivante : Vu
ou entendu la volont du peuple, il est enjoint au com-
mandant gnral de se rendre Versailles. Muni de la
9.
l54 RIVAROL
cdille de ces ving-t bourcreois, il partit, vers les quatre
heures, la tte de dix-huit ou ving-t mille hommes, et
marcha contre son roi.
Il Y avait dj cinq ou six heures que les poissardes et les
brig-ands expulss de l'htel-de-ville avaient pris la route
de Versailles, recrutant des ouvriers et surtout les femmes
qu'ils rencontraient en chemin, sans distinction d ag^e et de
rang-. En ctoyant la Seine et la terrasse des Tuileries, ces
poissardes rencontrrent un g-arde cheval et lui crirent :
Tu vas Versailles
;
dis ci la reine que nous
y
serons
bientt pour lui couper le cou. Quelques personnes, qui
du haut de la terrasse entendirent ce propos, dcamprent
d'ellroi; chacun fermait ses portes; les rues se dpeuplaient
devant le torrent qui se gTossissait en route de tout ce qui
se prsentait, et qui fondit sur Versailles vers trois heures
et demie.
A cette heure, le roi, qui ds le matin avait donn sa
rponse sur les articles de la constitution et sur la dclara-
tion des droits de l'homme, chassait paisiblement Meu-
don : et cependant le marquis de la Fayette s'branlait avec
son arme patriotique pour l'enlever
;
les poissardes et les
assassins taient dj aux g-rilles de son chteau; l'Assem-
ble nationale lui cherchait des torts, et lui prparait des
afVonts
;
Paris attendait l'vnement avec cette curiosit
barbare qui est son sentiment habituel.
Telle tait la situation de ce malheureux prince : dans le
mme jour, et la mme heure, l'arme patriotique en
voulait sa libert
;
les poissardes et les brig-ands sa
femme, et l'Assemble nationale sa couronne.
La sance de l'Assemble nationale tenait encore : elle
avait commenc le matin par la lecture de la rponse du roi.
Ce prince accdait tous les articles constitutionnels qu'on
lui avait prsents, mais condition que le pouvoir excu-
tif
aurait un plein et entier
effet
entre ses mains. C'est
comme s'il et dit : A condition d tre le parfait et seul
serviteur de CAssemble nationale. On ne sait qu'admirer
le plus, ou des ministres qui dictrent cette rponse au roi,
ou de l'Assemble qui en fut mcontente. On se plaig-nit
vivement de ce que le roi semblait mettre des clauses et des
restrictions son obissance; on observa qu'il donnait son
accession et non son acceptation. Les uns voulaient qu'on
I
POLITIQUE l55
fort lo monarque venir dans TAssemble pour jurer l'ob-
servation des articles : d'autres, plus consquents, soute-
naient que TAssemblce n'avait pas besoin du monarque
pour
constituer la France. Enfin, un des plus factieux, nomm
Ption, parla, pour la premire fois, du trop fameux repas
des g-ardes du corps. Il dnona des menaces, des outrages,
des cris sditieux, des blasphmes, des imprcations vomies
dans ce festin contre les augustes commis de la nation; et
la cocarde nationale
foule aux pieds.
Un memjjre, d'une probit embarrassante, somma le sieur
Ption d'crire sa dnonciation : sur quoi M. de Mirabeau
-se leva, et dit : Quon dclare seul le roi inviolable, et je
dnoncerai aussi
;
paroles qui consternrent la majeure
Sartie
de l'Assemble. M. de ^Mirabeau, qui sentait l'approche
e l'arme parisienne, ne demandait qu' tre pouss; la
ffalerie tait nombreuse et violente; et, si la reine et t
dnonce, les brigands leur arrive, trouvant cette prin-
cesse accuse par un membre de l'Assemble lgislative,
auraient cru lgitime l'assassinat qui n'tait encore que pay.
Heureusement M. Meunier, qui prsidait l'Assemble, rpon-
dit qu'il ne souffrirait pas qu'on interrompt l'ordre du jour,
ni qu'on se permt rien d'tranger la rponse du roi : pru-
dente mesure qui, pour cette matine, du moins, rduisit
M. de Mirabeau la seule intention du crime.
Cependant quelques dputs avertirent M. Mounier qu'une
arme de vingt ou trente mille hommes arrivait de Paris.
Cette nouvelle s'lant aussitt rpandue dans l'Assemble,
on dcida que le prsident se rendrait chez le roi avec une
dputation pour oDlenir de sa majest une acceptation pure
et simple des
29
articles de la constitution. Il tait trois
heures et demie
;
et on allait clore la sance, lorsque la
troupe des brigands et des poissardes arriva.
Le roi, qui avait t averti, quitta brusquement la chasse,
et vint Versailles, o il prcda d'un quart d'heure l'arri-
ve des assassins. Le prince de Luxembourg, capitaine des
gardes du corps, demanda sa majest si elle avait quelques
ordres donner; le roi rpondit en riant : Eh quoi f pour
des femmes ! vous vous moquez. Cependant la phalange
des poissardes, des brigands et des ouvriers parut tout
coup dans l'avenue de Paris : ils tranaient avec eux cinq
pices de canon. Il fallut bien alors faire vite avancer quel-
l56 RIVAROL
qiies draa^ons pour aller la rencontre de cette bande, et
l'arrter dans l'avenue
;
quoi les officiers tchrent de par-
venir
;
mais les soldats les laissrent passer.
Aprs avoir surmont ce lg-er obstacle, les poissardes se
prsentrent l'Assemble nationale, et voulurent forcer les
ecardes. Il fut rsolu, la majorit des voix, de leur permettre
rentre de la salle, et il en entra un grand nombre qui se
placrent sur les bancs, ple-mle avec les dputs. Deux
hommes taient leur tte : Tun d'eux prit la parole et dit :
Qu'ils taient venus Versailles pour avoir du pain et de
(( Targ'ent, et en mme temps pour faire punir les g-ardesdu
(( corps; qu'ils avaient, en bons patriotes, arrach toutes les
cocardes noires et blanches qui s'taient prsentes leurs
(( yeux dans Paris et sur la route. Et en mme temps cet
homme en tira une de sa poche, en disant qu'il voulait avoir
le plaisir de la dchirer en prsence de l'Assemble; ce qu'il
fit. Son compagnon ajouta : Nous forcerons bien tout le
u monde prendre la cocarde patriotique. Ces expressions
ayant excit quelques murmures, il reprit : Eh quoi ! ne
sommes-nous pas tous frres? Le prsident lui rpondit
avec mnagement : Que l'Assemble ne pouvait nier cette
fraternit
;
mais quelle murmurait de ce qu'il avait parl
de forcer quelqu'un prendre la cocarde nationale. En
quoi, il me semble que ce briofand, avec son grossier et
froce instinct, raisonnait plus consquemment que M. Mou-
nier, prsident de l'Assemble. Le roi ayant t forc lui-
mme d'arborer la cocarde patriotique, et la souverainet
active tant reconnue dans le peuple par l'Assemble natio-
nale, il est certain qu'il n'est personne que ce peuple ii.
puisse et ne doive forcer porter cette cocarde. Ici FAssem-
ble nationale apprenait, par l'tat d'anantissement o ell:
se trouvait en prsence de quelques poissardes, combien ellr-
avait t imprudente et malintentionne tout ensemble,
quand elle avait excit la populace, et consacr ses rvoltes.
O pouvait-elle, en ce moment, tourner les yeux pour
demander assistance, dans la dissolution de toutes les forces
publiques? Fallait-il qu'elle invoqut l'autorit royale, qui
tait elle-mme alors un objet de piti?
^*Le dialogue du brigand et du prsident de l'Assemble
fut interrompu
par les cris des poissardes qui, se dressant
sur les bancs, demandrent toutes la fois du pain pour
sa
via
une
'les, c
POLITIQUE
l5y
( l!(\s et pour Paris. Le prsident rpondit :
Quo l'Assem-
Ijle ne concevait pas qu'aprs tant de dcrets il
y
et si
peu de g-rains; qu'on allait encore en faire d'autres, et que
i<'s citoyennes n'avaient qu' s'en aller en paix. Cette
|)onse ne les satisfit pas; et sans doute que le
prsident en
(lit fait une autre, s'il avait su que Paris n'avait
jamais man-
(jiidc farines et que les poissardes taient
arrives Ver-
illes, suivies de plusieurs chariots remplis de
pain, de
ndes et d'eau-de-vie. Elles dirent donc au
prsident :
del ne
suffi
f point
;
mais sans s'expliquer
davantage;
et
liicntcjL aprs, se mlant aux dlibrations des
honorables
iiirnibres, elles criaient Vun, parle donc, dput ;
ci .
l'autre, tais-toi^ dput ; \o canon, ([u'i grondait
dansl'ave-
soutenait leurs apostrophes, et tout plissait
devant
xcept le seul comte de Mirabeau, qui leur
demanda
II'
quel droit elles venaient imposer des lois
l'Assemble
nationale. Et, chose tonnante! ces poissardes, si
terribles
( 'ux qui tremblaient devant elles, souriaient celui qui
les
i:()urmandait ainsi. Telle est, et telle a toujours t,
dans
Ile rvolution, la profonde sagesse de M. de Mirabeau :
il
:! Vst point de parti o il n'ait eu des intelligences, et
qui
Il "ait compt sur lui. Nous l'avons vu parler pour le
veto
absolu, dans un temps o ce seul mot conduisait la mort
et le Palais-Royal n'en tait pas moins sr de son me; ici
nous le voyons impunment affronter les poissardes, qui ne
peuvent le regarder sans rire : dans peu, nous le verrons
chercher propos, et devant tmoins, une querelle au duc
l'Orlans. C'est ainsi que, trafiquant sans cesse de sa per-
nne, faisant et rompant ses marchs, tous les jours, il a,
[.ir l'universalit de ses intrigues et la texture de ses perfi-
dies, si bien embarrass sa renomme que la foule de nos
rivains ne sait plus quel parti doit enfin rester la hon-
ise proprit du nom de Mirabeau.
* if-
Le lecteur se figure sans doute que les reprsentants de la
nation taient humilis ou indigns du rle qu'ils jouaient
au milieu de cette vile canaille; on pourra croire que ces
augustes lgislateurs gmissaient de l tat o se trouvait le
roi, car on entendait dj les coups de fusils, et on ne pou-
l58 RIVAROL
vait douter du massacre des g-ardes du corps : mais il n'en
est rien. Tous les dputs dont on pouvait disting-ucr les
visasres taient d'une joie remarquable
;
ils se mlaient avec
ravissement aux poissardes, et leur dictaient des phrases.
Le colonel du rgiment de Flandres, le marquis de Lusi-
gnan, qui, le jour du fameux dner, tait en habit uniforme,
se trouvait en habit de crmonie le jour du combat, et ne
quitta pas la salle : son rgiment refusait en ce moment de
repousser les brigands et de dfendre le roi. On remarqua
surtout la conduite de M. de Mirabeau : sr du rs;-iment de
Flandres, des dragons, de la milice de Versailles et de
l'arme, qu'on attendait d'heure en heure, ce dput osa
sortir de la salle et se montrer dans l'avenue de Paris. Il
joignait l'habit noir et la longue chevelure, costume du
tiers-tat, un grand sabre nud qu'il portait sous le bras. On
le vit en cet quipage s'essayer peu peu dans l'avenue,
marcher pas compts vers la place d'armes, et, plus aid
de sa figure que de son sabre, tonner les premiers brigands
qui renvisagrent. On ne sait jusqu'o cet honorable mem-
bre aurait pouss sa marche, s'il n'et pris l'air glac des
brigands pour un air de rsistance ou de menace. Le mal-
heur de 5L de Mirabeau a toujours t de trop partager
l'efiroi qu'il cause, et de perdre ainsi tous ses avantages.
11 rentra donc avec prcipitation dans la salle
;
mais, un
moment aprs, la rtlexion l'emporta sur l'instinct, et il
sortit encore pour voir, comme il le dit lui-mme, o en
tait le vaisseau de la chose fjubliqiie. Mais le bruit des
premiers coups de fusils le fit renoncer cette entreprise,
et ce bon patriote rentra dans la salle pour n'en plus sortir.
*
* *
Vers dix heures, un aide-de-camp de M. del Fayette vint
annoncer son arrive prochaine, la tte de l'arme natio-
nale de Paris. Le trouble des ministres redoubla. On savait
que le marquis de la Fayette tait parti, par ordre de la
populace, et pour faire tout ce que voudrait la populace. La
cour tait loin de partager l'heureuse confiance d'un gnral
qui marche avec l'intention de faire tout ce que lui ordon-
nera son arme. On ne savait quoi se rsoudre : la stupeur
prsidait aux dlibrations, et la peur donnait des conseils
POLITIQUE iSg
la pour. Aprs tant de faux calculs et de pas en arrire,
aprs tant d'amnisties, ou, pour mieux dire, tant d'encoura-
p;-emenls donns aux rvolts de toutg-enre; aprs l'abandon
de sa prrogative, et le sacrifice de ses ei-ots et de ses plai-
sirs, le roi avait enfin trembler pour la vie de tout ce qui
lui tait cher, et il n'avait que sa terreur opposer au
danger.
Onsait qu'au milieu detoutes sesmagnificences LouisXIV
avait laiss un pont de bois Svres, afin, dit-on, que, dans
les moments de crise, cette communication, entre le sjour
des rois et une capitale dangereuse, pt tre coupe en un
clin-d'il. Mais c'est en vain que ce pont choquait, depuis
un sicle, la vue et l'imagination des Franais et des tran-
gers qui venaient admirer les bronzes et les marbres de
Vcrsadles
;
on oublia, quand le moment fut venu, ou peut-
tre mme on craignit d'user d'une prcaution impose par
la crainte au luxe et au despotisme : c'est en efiet un des
caractres de la peur de s'opposer ses propres mesures. Le
pont de bois sur lequel ont pass les brigands nationaux, de
toute race, de toute forme et de tout sexe, ne fut point
coup. Je ne fais cette observation minutieuse que pour
prouver quelle tait en ce mioment Versailles la dfection
de toutes les idesgrandes et petites. Qu'on nous dise, aprs
cela, que les cours sont des foyers de dissimulation, de poli-
tique et de machiavlisme! La cour de France a dploy, de
nos jours, une profondeur d'ineptie, d'imprvoyance et de
nullit d'autant plus remarquables qu'il n'y a que des
hommes au-dessous du mdiocre qui aient figur dans la
rvolution. Je ne crains point de le dire : dans cette rvolu-
tion si vante, prince du sauj^, militaire, dput, philoso-
phe, peuple, tout a t mauvais, jusqu'aux assassins. Telle
est la diffrence, entre la corruption et la barbarie. L'une
est plus fconde en vices, et l'autre en crimes. La corruption
nerve tellement les hommes qu'elle est souvent rduite
employer la barbarie pour l'excution de ses desseins. M. de
la Fayette et tous les hros parisiens ont beaucoup moins
servi le peuple qu'ils ne lui ont chapp. Les dputs les
plus insignes, tels que les Chapelier et les Mirabeau, taient
entrs aux tats gnraux, extrmement affaiblis par le
mpris public, et devaient craindre que le roi ne s'honort
de leur chtiment. Les philosophes du Palais-Pioyal taient,
66
RIVAROL
la vrit, des malfaiteurs; mais les assassins ga^-s se se
trouvs des raisonneurs qui ont distingu entre la reine < i
le roi
(0.
Enfin, le duc d'Orlans s'est ju^- lui-mme indi-
g-ne de tous les crimes qu'il pavait, et s'est enfui, renow-
ant au prix cause de la dpense, et mettant conjuration
bas, selon, sa propre expression. Nous verrons pourtant
qu'il n'a dsert qu'au moment o il fallait que l'Assemhl'
nationale et Paris optassent entre Louis XVI et lui. Il cdait
aux vnements, et une erreur de l'avarice le consolait des
faux pas de l'ambition.
Le roi, n'ayant plus une pe opposer l'arme de M. de
la Fayette, voulut du moins se couvrir de l'inviolabilit des
reprsentants de la nation, et fit savoir au prsident com-
bien il dsirait de le voir au chteau avec le plus grand nom-
bre de dputs qu'il pourrait amener. La salle, pleine, cette
heure-lk, de poissardes, de crocheteurs, de forts de la halle
et de quelques dputs, offrait, comme le dit M. de Mira-
beau, un majestueux assemblage; mais il n'y avait plus
d'Assemble. Le prsident fit prier les officiers municipaux
de Versailles, de rappeler, au son du tambour et de rue en
rue, les reprsentants de la nation. Pendant qu'ils arrivaient
successivement, la populace, qui sig-eait dans la salle, se
plaignit de n'avoir rien mang de tout le jour. M. Mounier
ne savait comment nourrir, sans pain ou sans miracle, cette
multitude affame, au milieu d'une nuit dj fort avance;
il ignorait que le duc d'Orlans tait pour les brigands une
vritable providence : des vins, des viandes et des liqueurs
entrrent subitement par toutes les portes de la salle; et les
dputs de la nation assistrent au banquet du peuple-roi.
On fut enfin averti de l'arrive du marquis de la Fayette,
entre onze heures et minuit. Il fit arrter sa milice la hau-
teur de la salle deTAssemble nationale, et s'y prsenta seul.
Il dit d'abord au prsident : Qu'il fallait se rassurer; que
a la vue de son arme ne devait troubler personne
;
qu'elle
(( avait jur de ne faire et de ne souffrir aucune violence.
Le prsident lui demanda ce que venait donc faire cette
(i) Dans une taverne de Svres, quatre assassins habills en femmes,
s'tant arrts pour boire, ie jour de l'exp'^dition, l'un deux disait aux
autres : Ma
foi
.'
je ne peux me rsoudre le tuer, lui
;
cela n'est pas
juste; mais pour elle, volontiers
;
son voisin lui rpondit : Sauve
qui peut, il faudra voir, quand nous
y
serons. R.
i ; : ! 1
I
liiic
POLITIQUE
iGl
iine. Le pcnral rpondit : Qu'il n'en savait rien; mais
iiril fallait calmer le mcontentement du peuple, en
priant
!''
roi d'loig-ner le ri^iment de Flandres, et de dire quel-
(jues mots an faveur de la cocarde patrioticjue.
l'n terminent cet trane;-e dialo2fue.lemar(iuis alla rejoin-
dre son arme, la posta sur la place d'armes, Tentre des
ivcnues, dans les rues, partout enfin o elle voulut se pla-
i
, et monla chez le roi, auquel il dit, en entrant : Sire^
^
u
prfr
de venir vos pieds avec vingt nulle honi-
nies arms, plutt que de j)rir en place de Grve
;'\\
.ij'Uita que d'ailleurs Paris tait assez tranquille. Aprs
( Hc harangue, qui rend si incroyables celles des Thucidide
des Xnophon, M. de la Fayette eut avec le roi un entre-
ii secret et assez Ion"-, dans lequel il donna ce prince
t de motifs de scurit que, le prsident de TAssemble
tionale s'tant prsent avec un cortge de dputs, le roi
lit : (( J'avais dsir d'tre environn des reprsentants
(( de la nation, dans les circonstances o je me trouve, et je
' v(His avais fait dire que je voulais recevoir devant vous le
marquis de la Fayette, afin de profiler de vos conseils;
mais il est venu avant vous, et je n'ai plus rien vous
lire, sinon que je n'ai pas eu l'intention de partir, et que
i
'
ne m'loig-nerai jamais de TAssemble nationale. Ces
rniers mots sig-nifiaient ou que le roi avait en effet dli-
ai l de partir, ou qu'il savait que le peuple de Versailles
lui en imputait l'envie. Mais l'ascendant du g"nral sur le
nu)narque fut tel que sa majest, d'abord si empresse de
consulter l'Assemble nationale, et peut-tre m.Sme de s'loi-
uiier de Versailles, n'y song-ea plus aprs cet entretien, et se
reposa de tout sur un nral qui n'tait sur de rien.
Le prsident et les dputs retournrent minuit dans la
'le, et poursuivirent leur sance au milieu de la populace
les environnait. Comme ils n'attendaient en effet que
! . vnement, ils ouvrirent, pour g^agner du temps, une dis-
:-sion sur les lois criminelles. Le peuple les interrompait
liaque instant, et leur criait: Du pain, du pain, pas
:if de lonqs c//scowr5. Mais le pain neman(piait pas
;
car,
au moment o l'arme parut, elle fut accueillieavec des cris
de joie par les brigands et par la milice de Versailles : elle
siinit aussitt aux drag-ons et ce rg-iment de Flandres,
objet de tant d'alarmes et prtexte de l'invasion. Gomme
102
_
RrV'AROL
cette affreuse nuit tait froide et pluvieuse, les troupes
allies se rcfug-irent dans les cabarets, dans les curies,
dans les cafs, sous les portes et dans les cours des maisons.
D'immenses provisions de viande et de pain leur furent dis-
tribues; on leur prodig-ua les plus violentes liqueurs. M. de
la Favette, tmoin de cette abondance et de cette joie, bien
loin d'en redouter les suites et les progrs, en conut le
meilleur aug-ure. Il se hta de placer quelques sentinelles,
et de garnir quelques postes avec ses gardes- nationaux
Parisiens. Satisfait de tant de prcautions, il monta chez le
roi, et lui communiqua la contagion de sa scurit. Il rpon-
dit des intentions de sa milice et du bon ordre pour le reste
de la nuit. Ses propos assoupirent toutes les craintes. Le roi,
persuad, .se coucha. Il tait environ deux heures. M. de la
Fayette, en sortant de chez le roi, dit la foule qui tait
dans la salle de i'il-de-buf : (c Je lui ai fait faire quel-
ce ques sacrifices, afin de le sauver. Il parla en mme temps
des prcautions qu'il avait prises, et s'exprima avec tant de
calme et de bonheur qu'il parvint donner aussi tous
ceux qui l'coutaient le dsir d'aller se coucher. Ces succs
en amenrent d'autres. Le marquis de la Fayette conut
l'ide de faire coucher toute l'Assemble nationale : il
y
vole
aussitt. C'tait, comme on l'a dit alors, le gnral Mor-
phe. Il arrive, il parle au prsident de l'Assemble, lui
expose avec candeur ses motifs de scurit et lui inspire la
plus forte envie d'aller dormir. Ce prsident tenait la sance
depuis dix-huit heures, et son extrme lassitude lui rendait
les conseils du gnral plus irrsistibles. Si vous avez
(( quelques-craintes, lui dit pourtant M. Mounier, parlez et
(( je retiendrai les dputs jusqu'au jour. M. de la Fayette
rpondit : Qu'il tait si certain des pacifiques disposi-
tions de son arme, et qu'il comptait avec tant de foi sur
la tranquillit publique, pour cette nuit, qu'il allait se cou-
ce cher lui-mme. )) Le prsident, press du poids de la parole
et de l'exemple, leva la sance et se retira. Il ne resta que
MM. Barnave, Mirabeau, Plion et quelques autres dma-
gogues zls, qui ne voulurent pas quitter la foule dont la
salle et toutes ses dpendances regorg-eaient. Seuls ils rsis-
trent aux calmants de M. de la Fayette, et refusrent,
comme un autre Ulysse, de s'endormir sur le bord d'un
cueil. Ils ont veill, toute la nuit, sur le vaisseau de la
I
POLITIQUE l63
rJLOse publique : mais, comme ils n'ont point cmpcli ks
( limes du matin, et qu'au contraire ils les ont vus, et, pour
ainsi dire, consacrs de leurs rec^ards, l'histoire doit en
..' tuser leur prsence, autant du moins qu'elle en accuse
l'ahsence des autres.
Kn entrant chez lui, M. Mounier apprit qu'une ving-taine
(If luig-ands taient venus demander sa tte, et avaient pro-
mis de revenir. On sait qu'il avait t dsig-n au peuple
( umme aristocrate^ ^owv ^iwow soutenu \o. veto roi/at ei
la ncessit d'une seconde chambre l^islative. Malgr
(!
nouveau sujet d'alarmes, M. Mounier avoue, dans
V'wpos de sa conduite, qu'il dormit profondment, jus-
(j'ii au grand jour, sur la parole de M. del Favette,qui tait
alK' se jeter aussi dans son lit, aprs avoir endormi les vic-
times au milieu des bourreaux. Quand ce g-nral se serait
( oncert avec les brig-ands, aurait-il pu mieux faire? Tant
ii est vrai que, dans les places importantes, le dfaut d'es-
pi it a tous les effets de la perversit du cur (i) !
Au sein de tant de perfidies de tout g-enre, sur ce thtre
on la peur et la lchet conduisaient la faiblesse sa perte,
il s'est pourtant rencontr un grand caractre, et c'est une
IVnime, c'est la reine qui l'a montr. Elle a fg-ur, par sa
contenance noble et ferme, parmi tant d'hommes perdus
cL consterns; et par une prsence d'esprit extraordinaire,
(]iia'nd tout n'tait qu'erreur et vertig-e autour d'elle. On la
\\[, pendant cette soire du 5 octobre, recevoir un monde
considrable dans son grand cabinet, parler avec force et
dig-nit tout ce qui l'approchait, et communiquer son
assurance ceux qui ne pouvaient lui cacher leurs alarmes.
"
.e sais, disait-elle, qu'on vient de Paris pour demander
'
ma tte: mais j'ai appris de ma mre ne pas craindre
^' la mort, et je l'attendrai avec fermet.
//.
Le 6 octobre.
Depuis trois heures du matin jusqu' cinq et demie, rien
ne transpire, et tout parat enseveli dans la tranquille hor-
(i) Ferdinand, grand-duc de Toscane, disait qu'il aimait mieux un
ninistre corrompu, mais ferme, qu'un ministre probe, mais faible. R.
1^4
RIVAROL
reur de la nuit. C'tait pourtant un spectacle bien dig^ne
d'tre observ que cette profonde scurit de la famille
royale, dormant sans dfense au milieu d'une horde d'as-
sassins renforcs de ving-t mille soldats; et cela, sur la pa-
role d'un gnral qui avoue lui-mme qu'il n'a conduit ou
suivi son arme que de peur d'tre pendu en f)Iacedc Grve!
C'est pour la premire fois peut-tre qu'une si g-rande peur
a inspir une si grande confiance !
Il
y
eut nanmoins, dans cette nuit, quelques personnes
qui ne partagrent point cette scurit, et qu'un esprit de
prvoyance empcha de dormir. Une, surtout, presse d'une
secrte inquitude, sortit de sa maison et monta au chteau.
Ce tmoin, dig-ne de foi, vit que les postes taient occups
par les anciens Gardes Franaises et par la milice deVersailles,
mais qu'il n'y avait pas une sentinelle d'extraordinaire.
Seulement il trouva, prs de la cour de marbre, un petit
bossu, cheval, qui se dit plac l par M. de la Fayette,
et qui, sur les craintes que lui marquait notre tm.oin, au
sujet des brigands, ajouta qu'il rpondait de tout; que les
g-ens piques et bonnets pointus le connaissaient bien:
(( Mais insista le tmoin, puisque votre g-nral est couch,
et que le chteau est sans dfense, comment ferait-on si
on avait besoin de la g^arde nationale ? Le bossu rpondit :
Il ne peut
y
avoir du danger qu'au matin. Ce propos
tait effrayant
;
mais qui le rendre ? Le tmoin parcourut
la place d'armes et l'avenue de Paris, jusqu' l'entre de
l'Assemble nationale. Il vit, de proche en proche, de grands
feux allums, et autour de ces feux, des g-roupes de brigands
et de poissardes, qui mang-eaient et buvaient. La salle de
l'Assembletait absolument pleine d'hommeset de femmes.
Quelques dputs s'vertuaient dans la foule. La milice pa-
risienne tait disperse dans tous les quartiers de la ville;
les curies, les cabarets, les cafs regorgeaient. Telle fut la
situation de Versailles, depuis trois heures du matin jusqu'
la naissance du jour.
Sur les six heures, les diffrents groupes de brig-ands,
de poissardes et d'ouvriers se runirent, et aprs quelques
mouvements, leur foule se porta rapidement vers l'htel
des g-ardes du corps, en criant : Tue les gardes du corps,
point de quartier. L'htel fut forc en un moment. Les
g-ardes, qui taient en petit nombre, cherchrent s'chap-
toi.iTiQU
i5
por : on les poursuivit tic tous cts avec une rag-e inexpri-
mable
;
on en tua quelques-uns; d'autres furent horrible-
ment maltraits ets'enruirenl vers le chteau, o ils tomb-
j ont entre les mains de la milice de Versailles et de celle
<!(>
Paris
;
quinze furent pris et conduitsvers la grille, o on
- retint, en attendant qu'on et avis au g-enre de leur
ipplice. Presqu'enmmetempsarriva le^rosdcs brig^ands,
hommes et femmes, quiavaient dj pill etdvast l'htel
;
'U
se jel'rent dans toutes les cours du chteau, en prsence
'
la milice de Paris, et sans que les sentinelles poses par
.1. de la Fayette lissent la moindre rsistance; pntrrent
.iiissitt, les uns par 1<)
c;-rand escalier, et les autres par le
'l de la chapelle, dans l'intrieur des salles, et forcrent
lie des cent-suisses
;
mais auparavant ils ^i^org-rent deux
l'des du corpsquilaient en sentinelle, l'un prs de la grille
l'autre sous la vote. Leurs corps tout palpitants furent
trans sous les fentres du roi, ou une espce de monstre,
ium d'une hache, portant une longue barbe, et un bonnet
(i'une hauteur extraordinaire, leur coupa la tte. Ce sont ces
deux mmes ttes, tales d'abord dans Versailles, qui ont t
portes sur des piques, devant le carrosse du roi, et prome-
lies, le mme jour et le lendemain, dans les rues de Paris.
Les assassins ayant donc pntr dans la salle des cent-
suisses, et tu un troisime ^arde du corps, sur le haut de
icscalier de marbre, demandent rrands cris la tte de la
'ine; les horribles menaces et les hurlements de ces btes
roces retentissaient dans le chteau
;
les erardes du corps
lorment une espce de barricade dans leur salle, et se
replient du ct de l'il-de-buf : mais leur faible barri-
cade est bientt emporte, et on les poursuit de salle en
-.die. Le qarde, qui tait en sentinelle la porte de la
ine (i), se dfend hroquement, et, avant de succomber,
imne l'alarme par ses cris et par des coups redoubls la
{orle de l'appartement. La reine, rveille par ses femmes,
s.iute hors du lit et s'enfuit en chemise, par un troit et
i) C est e chevalier de Miomandre Sainte-Marie : il reut plusieurs
coups de piques et de sabre dans le corps et sur la tte : il fut trpan
et n'est pas mort de ses blessures. Un de ses camarades, appel M. du
Picpaire, vint son secours, et pour dfendre en mme temps la porte
d'' la reine : il fut aussi cruellement bless que lui. (Note des uvres
v)iplctes.)
l66
RIVAROL
long- balcon, qui borde les fentres des appartements int-_
rieurs : elle arriva une petite porte qui donne dans l'il
de-buf; et aprs avoir attendu,
pendant cinq minutes,
qu'on ouvrt cette porte, elle se sauve dans la chambre du
roi. A peine avait-elle quitt son appartement qu'une bande
d'assassins, dont deux taient habills en femmes, entrent
et pntrent jusqu' son lit, dont ils soulvent les rideaux
avec leurs piques. Furieux de ne pas la trouver, ils se rejet-
tent dans la g-alerie, pour forcerlil-de-buf ;ctsans doute
qu'ils auraient mis la France en deuil, s'ils n'avaient ren-
contr les g-renadiers des anciens Gardes-Franaises, qui
remplissaient dj cette antichambre^ dfendaient l'appar-
tement du roi, et arboraient Ttendard des cardes du corps,
afin de les drobera la furie des bourreaux, soit en les fai-
sant prisonniers, soit en les laissant passer dans la cham.bre
de Louis XIV, et dans celle du conseil, o ces infortuns
taient rsolus de dfendre les jours du roi, jusqu' la der-
nire goutte de leur sang. Enfin, ces g-renadiers, aprs avoir
dgag- les e;-ardes du corps, repoussent peu peu la foule
acharne des brigands et des assassins, les forcent des-
cendre dans les cours, et s'emparent de tous les postes, afin
de g-arantir le chteau d'une nouvelle invasion. Mais je dois
dire la cause de cet heureux vnement, qui, en sauvant la
famille rovale, parg-na une tache ternelle au nom franais,
renversa l'difice de la conspiration, et fit perdre aux fac-
tieux tout le fruit de leurs crimes.
Le marquis de la Fayette, arrach de son lit, au premier
bruit de ce qui se passait, s'tait brusquement jet sur un
cheval, et avait couru au chteau. Dsespr de son som-
meil, de sa crdulit, de ses promesses et de toutes les sot-
tises qui composaient sa vie depuis vingt-quatre heures, il
se prsente d'un air passionn aux grenadiers des Gardes
Franaises, incorpors dans la milice parisienne, leur parle
des dano^ers du roi, et s'offre lui-mme en victime. Les
grenadiers mus volent au chteau sur les traces sanglan-
tes du peuple et dlivrent les g-ardes du corps, ainsi qu'on
a vu; mais toujours en respectant les bandits et les assas-
sins. Presqu'au mme instant M. de la Fayette aperoit
les quinze gardes sur le supplice desquels la populace dli-
brait : il
y
court, il harangue le peuple et gagne du temps-
Une seconde troupe de grenadiers passait : Grenadiers?
POLITIQUE
167
. l(nirciia-t-il,souffrirez-vousdoncqucdc braves g*ens soient
ainsi lchement assassins ? Je les mets sous votre sauve-
garde. Jurez-moi, foi de g-renadiers, que vous ne souflVi-
rcz pas qu'on les assassine. Les g-renadiers le jurent,
l mettent les g-ardes du corps au milieu d'eux. Mais plus
')iii la populace, chasse du chteau, furieuse et merveil-
( iisement seconde par la milice de Versailles, avait arrt
piclqucs autres g-ardes et s'apprtait les cgorg-er. Ce fut
r dsir de rendre leur excution plus clatante, en les mas-
ai rant sous les fentres du roi, qui les sauva. Un officier
l(i la milice nationale de Paris en arracha huit d'entre les
nains de cette troupe forcene. Parmi les autres se trou-
aient quelques brig-adiers cheveux blancs, dont ils taient
ntours : Notre vie est entre vos mains, disaient-ils;
vous pouvez nous g-org-er
;
mais vous ne Tabrg^erez que
de quelques instants, et nous ne mourrons pas dshono-
rs. Cette courte harang-ue produisit une sorte de rvolu-
ion dans les esprits. Un officier de la garde nationale,
ouch du noble discours et de l'air vnrable de ces mili-
iies, saule au cou du plus g^ et s'crie : Nous n'g-or-
erons pas de braves i^ens comme vous. Son exemple
-l suivi par quelques officiers de la milice parisienne. Au
nme instant, le roi, instruit que ses gardes taient si mi-
rablement gorgs, ouvre lui-mme ses fentres, se pr-
dite sur son balcon, et demande leur grce au peuple. Les
aides du corps rfugis prs de sa personne, voulant sau-
cr leurs camarades, jettent du haut du balcon leurs ban-
loiilires ce mme peuple, mettent bas les armes, et
rient : vive la nation ! La dmarche du roi, et l'action de
s gardes flattent et amollissent l'orgueil de ces tigres :
I
s cris redoubls de vive le roi ! partent de toutes les
ours et de toute l'tendue de la place d'armes. En un mo-
ii'nt les victimes qu'on allait massacrer sont ftes, embras-
('es et portescn tumulte sous les fentres du roi : on invite
eux qui taient auprs de sa majest descendre
;
ils des-
(iident en effet et partagent avec leurs compagnons les
aresses bruvantes et les tendres fureurs de cette populace
ont nous dcrirons bientt le barbare triomphe et les
nielles joies. Mais voyons auparavant ce qui se passait
ans la chambre du roi.
La reine s'y tait peine rfugie que Monsieur,
I
i68
Madame et Madame Elisabeth vinrent
y
chercher un asile :
un moment aprs, arrivrent les ministres et beaucoup de
dputs de la noblesse, tous dans le plus grand dsordre.
On entendait les voix des brig-ands mles au cliquetis des
armes, et ce bruit croissait de plus en plus. Bientt les
anciens g-renadiers des Gardes Franaises occuprent l'il-
de-buf, pour en dfendre l'entre aux assassins
;
mais on
n'en fut e;-ure plus rassur. Quelle foi pouvait-on ajouter
des soldats intidles etcorrompus? Une belle action tonne
plus qu'elle ne rassure, quand l'intention est suspecte.
Aussi, tout n'tait que pleurs et confusion autour de la
reine et du roi. Les femmes de la reine criaient et sanglo-
taient
;
le g-arde-des-sceaux se dsesprait
;
MM. de la Luzerne
et Montmorin se vojciient tels qu'ils taient, sans courage
et sans ides : le roi paraissait abattu
;
mais la reine, avec
une fermet noble et touchante, consolait et encourageait
tout le monde. Dans un coin du cabinet du roi tait M. Nec-
ker,
plono;- dans la plus profonde consternation, et c'est de
toutes les figures du tableau celle qui doit frapper le plus.
a Etait-ce donc l votre place, grand homme, ministre irr-
(( prochable, ange tutlaire de la France? Sortez, idole du
<( peuple; montrez-vous ces rebelles, ces bri^ands, ces
(( monstres
;
exposez-leur cette tte qu'ils ont eux-mmes
charge de tant de couronnes
;
essayez sur eux le pouvoir
de votre popularit et le prestige de votre rputation
;
le
(( roi et l'Etat n'ont que faire de vos larmes. Jamais, en
eftct, M. Necker ne se disculpera de sa conduite en ce jour.
S'il se ft prsent, on ne sait jusqu' quel point il et
influ sur la multitude
;
mais du moins on ne dirait pas
aujourd'hui que M.Necker ne se montre que pour avoir des
statues et des couronnes.
Le peuple, ayant fait grce aux gardes du corps, ne per-
dait point de vue le principal objet de son entreprise, et
denaandait g-rands cris que le roi vnt fixer son sjour
Paris, M. de la Fayette envoyait avis sur avis : le roi, fati-
gu, sollicit, press de toutes parts, se rendit enfin, et
donna sa parole qu'il partirait midi. Cette promesse vola
bientt de bouche en bouche, et les acclamations du peuple,
les coups de canon et le feu roulant de la mousqueterie
y
rpondirent. Sa majest parut elle-mme au balcon pour
conhrmer sa parole.
POLITIQUE
l6g
A relte sccondo apparition, la joie des Parisiens ne ron-
II lit plus de bornes, et se manifesta sous les formes les plus
hideuses. On s'empara des g-ardes du corps, auxquels on
venait d'accorder la vie; on leur arracha leur uniform^, et
> ;i leur fit endosser celui de la ^arde nationale. Ils furent
serves comme prisonniers, comme otag-es, comme orne-
'nts du triomphe des vainqueurs. Les deux milices de la
j)itale et de Versailles ne cessrent, pendant quelques
il lires, de se donner des preuves mutuelles du bonheur le
plus insultant pour le roi et pour la famille royale. L'espce
(le monstre bonnet pointu et loni^-ue barbe, dont nous
;ivons dj fait la peinture, se promenait avec ostentation
sur la place, montrant son visag^e et ses bras, couverts du
san^ des g-ardes du corps, et se plait^nant qu'on l'et fait
venir Versailles pour ne couper que deux ttes. Mais rien
n'g-ala le dlire mhumain des poissardes : trois d'entre
(lies s'assirent sur le cadavre d un g-arde du corps, dont
elles mangrent le cheval dpec et apprt par leurs com-
png-nes : les Parisiens dansaient autour de cet trang-e fes-
liii.
A leurs transports, leurs mouvements, leurs cris
inarticuls et barbares, LouisXVI,qui les voyait de sa fen-
tre, pouvait se croire le roi des cannibales et de tous les an-
iliropophag-es du nouveau monde.Bientt aprs, le peuple et
1 s
milices, pour ajouter leur ivresse par un nouveau suc-
. '\s, demandrent voir la reine. Cette princesse, qui n'a-
it encore vcu que pour les g^azettes ou la chronique, et
li vit maintenant pour l'histoire, parut au balcon avec
Al. le Dauphin et Madame Royale ses cts. Ving-t mille
voix lui crirent : point denfants!
Elle les fit rentrer et
SI'
montra seule. Alors son air de g-randeur dans cet abaisse-
ment, et cette preuve de courage dans une obissance si
prilleuse l'emportrent, force de surprise, sur la barba-
i''
du peuple : elle fut applaudie universellement. Son
nie redressa tout coup l'instinct de la multitude g-are,
s'il fallut ses ennemis des crimes, des conjurations et
d"
long-ues pratiques pour la faire assassiner, il ne lui fai-
llit elle qu'un moment pour se faire admirer. C'est ainsi
que la reine tua l'opinion publique, en exposant sa vie;
tandis que le roi ne conservait la sienne qu'aux dpens de
son trne et de sa libert.
L'austrit de ces annales ne permet pas qu'on dissimule
10
170
RIVAROL
ce qui avait arm l'opinion publique contre la reine : Paris
attend de nous que nous clairions sa haine, et les provin-
ces, leur incertitude. Je sais qu'on ne craint pas d'tre trop
svre envers les princes; qu'il n'y a de la honte qu' louer
et que les mensong-es de la satire sont presque honorables
pour un historien : mais on a dit tant de mal de la reine
qu'il nous serait possible de profiter de la lassitude g-cncrale
pour en dire du bien, si un tel artifice n'tait pas indigne
de l'histoire.
11 faut d'abord convenir que la tendresse exclusive du roi
pour la reine a excit contre elle une haine que les peuples
n'ont ordinairement que pour les matresses. On sait qu'il
est de bonnes murs, en France, que les reines soient con-
soles des infidlits de leurs poux par la malveillance
publique contre les favorites. Jeune et sans exprience, la
reine n'a point vu le danj^er de ses avantages; elle a rgn
sur le roi comme une matresse, et l'a trop fait sentir aux
peuples. De l ces bruits de prodigalits et de dons excessifs
sa famille, regards comme la cause du dficit, bruits
si absurdes, lorsqu'on pense l'origine et Tnormit
de cette dette : mais si la haine n'ose imaginer certaines
calomnies, elle les emprunte et les rend la sotti.se (i).
L'affaiblis.sement de l'tiquette est une autre source d'ob-
jections contre la reine. Par l, dit-on, elle a diminu la con-
sidration et le respect des peuples. Il est certain que cette
princesse, toujours plus prs de son sexe que de son rang,
s'est trop livre aux charmes de la vie prive. Les rois sont
des acteurs condamns ne pas quitter le thtre. Il ne faut
pas qu'une reine qui doit vivre et mourir .sur un trne rel
veuille goter de cet empire fictif et pas.sager que les grces
et la beaut donnent aux femmes ordinaires, et qui en fait
des reines d'un moment.
On reproche encore la reine son got pour les toffes
anglaises, si funeste nos manufactures
;
et ce reproche n'est
point injuste. Quand le ciel accorde une nation industrieu.se
et galante une reine qui a les charmes de la taille et de la
(1)
La dette, qu'en n'est pas encore parvenu bien dterminer, tait
ji
de quatre milliards en
1776,
selon l'abbe Baudeau. Qu'on explique une
telle dette avec les profusions, je ne dis pas de la reine de France, mais
de toutes les reines de l'Europe. En
1776,
la reine ne rgnait que de-
puis deux ans. R.
POLITIQUE
171
lioantt',ce prsent devient une richesse nationale. La France
se montra jalouse de la reine, et la reine n'y tut pas assez
sensible (i).
On dit enfin, en matire de rsultat, que laconr/nite
de la
reine a t aussi fatale au roi que celle du roi ci la nionar-
r//fV. Sans combattre une phrase qui plat autant la j)aresse
(le l'esprit qu' la malignit du cur, nous dirons
qu il n'est
point de Franais qui ne dt souhaiter au roi le caractre
(le la reine, et l'Assemble nationale les bonnes intentions
du roi. En un mot, la conduite de la reine, depuis qu'elle est
abandonne elle-mme, force l'histoire rejeter ses fautes
sur ceux qu'elle ap[)elait ses amis.
Cependant les factieux, dsesprs d'avoir manqu leur
coup, et les dmag-ogues, ravis de la dernire victoire
du
j)Ouple, se donnaient de g-rands mouvements sur la place
d'armes. Ils faisaient circuler des listes de proscription dans
ios mains du peuple, et les plus honntes g-ensde l'Assemble
nationale n'y taient point oublis. On assure que M. le duc
d'Orlans parut dans le salon d'Hercule, au plus fort du
tumulte, je veux dire entre six et sept heures du matin :
mais, s'il est vrai qu'il soit venu,son apparition fut courte
(2).
11 sentit sans doute qu'il fallait profiter du crime, et non pas
s'en charger. Ce qu'il
y
a de certain, c'est que ce prince,
afin d'apprendre chaque instant o eu tait l'entreprise, n'a
pas quitt, pendant la nuit, la g-rande route de Passv Ver-
sailles. Je ne crois pas que le marquis de la Fayette lui et
|)(M\suad d'aller dormir; et cependant M. le duc d'Orlans
^t de tous les hommes le moins propre aux fatigues et aux
' igoisses d'une conjuration : j'en appelle tous ceux qui le
connaissent. Epicurien, contempteur de l'opinion, plus fait
aux calculs toujours srs de l'avarice qu'aux projets vagues
de l'ambition, il s'est pass peu de jours, depuis la rvolu-
tion, o ce prince n'ait regrett ses plaisirs et son or.
0\i demandera peut-tre quel tait le plan de sa faction,
^^'i) Comment les Parisiens, qui s'irritent contre le g'ot de la reine
pour les marchandises anglaises, supportenl-ils de sang- froid que l'As-
S'inble nationale n'ait pas encore voulu prter l'oreille aux rclamalious
Cw tout notre commerce contre le trait avec l'Angleterre ? R.
(m) Le comit des reche)-ches s'est trop occup effacer tous les ves-
ti^ies de cette conspiration, pour qu'o puisse jamais parvenir une
clart parfaite sur certains dtails. R,
niVAROL
et il est difficile de le dire avec quelque prcision. On ne
doute pas que les brig-ands et les poissardes n'aient eu le
projet d'assassiner la reine; mais y avait-il parmi tant d'as-
sassins une main ^aq-ne pour tuer le roi? Pourrait-on dire
en effet ce qui ft arriv, si les brirands eussent poursuivi
et atteint la reine dans les bras du roi? Et si la famille
royale et t massacre, aurait-on pu arrter le duc d'Or-
lans, second par une faction puissante Paris et dans
l'Assemble
nationale? Ce prince et t port au del mme
de ses esprances; car on n'et pas hsit dclarer M. le
comte
d'Artois et les autres princes fu2ritifs, ennemis de
l'tat. 11 parat que la faction d'Orlans n'eut pas de plan
bien dtermin : elle voulut profiter de la crile des peuples
et de la baisse du trne, et donner un but quelconque tant
d'ag-itations. Le parti d'Orlans, selon Texpression orientale
d'un pole hbreu, sema des vents et recueillit des tem-
ptes.
Ds huit heures du matin, et avant qu'il et donn sa
parole de suivre les rebelles Paris, le roi avait tmoig-n
quelques dputs de la noblesse combien il dsirait que
tous les membres de l'Assemble nationale se rendissent
auprs de lui, pour l'assister de leurs conseils dans la crise
effravante o il se trouvait. Ces dputs vinrent avertir ou
plutt rveiller le prsident qui dormait encore, et, chemin
faisant, ils prirent quelques dputs qu'ils rencontrrent de
se rendre au chteau. Ils entrrent mme dans la salle, o
ils trouvrent un assez rand nombre de dputs, tant de
ceux qui n'en avaient pas dsempar de la nuit que de
ceux qui s'y taient rendus le matin; ils leur notifirent le
dsir du roi", au nomdu prsident. M. de Mirabeau rpondit:
Que le prsident ne pouvait les faire aller chez le roi,
sans dlibrer. Les g-aleries, pleines del plusvile canaille,
se joii^nirent lui, et dclarrent qu'il ne fallait pas sortir
de la salle.
Vers dix heures le prsident
y
arriva, et ft part des inten-
tions du roi. Le sieur de Mirabeau se leva et dit : Qu'il
tait contre la disrnit de l'Assemble d'aller chez sa
majest; que les dlibrations seraient suspectes, et qu'il
.suffisait d'y envoyer une dputation de trente-six mem-
bres. Il V a beaucoup d'hypocrisie et de sottise dans
cette rponse. Il n'tait point contraire la dignit de l'As
POLITIQUK 173
nble de se rendre auprs du chef de la nation; et d'ail-
:rs, c'tait bien de di;?;-nit qu'il s'a2;-issait en ce mo-
. . nt! Le roi allait tre enlev, conrluit de force Paris, et
[l
'iit-tre massacr
;
il demandait aide et conseil et on fei-
:; liait de craindre l'influence de pon autorit, si on dlib-
rait avec lui, quand lui-mme n'tait pas sr de sa vie. Au
r;'ste,le roi, implorant l'assistance de 1 Assemble, lui offrait
mie occasion de prouver qu'elle n'tait pas complice des
! rii^ands; et quelques-uns de ses membres, moins habiles
imk; malintentionns, lui faisaient perdre, par un refus, cette
unique occasion. M. ?.Iounier protesta inutilement contre ce
1 -lus; il dit en vain que c'tait un devoir sacr que d'accou-
rir la voix du monarque, lorsqu'il tait en danger, et que
l'Assemble nationale se prparait une honte et des reg-rets
'
''rnels. On ne lui rpondit qu'en dressant la liste des
!r-nte-six dputs qui devaient tenir lieu au roi de toute
l'Assemble.
Ce fut alors qu'on apprit que sa majest, rduite aux
(li'rnires extrmits, s'tait eng-ag-e la suite des brig-ands
<!
des hros parisiens. Sans examiner quelles aflYeuses
( onjonctures on devait cette rsolution du roi, ce mme
lirabeau, qui avait opin qu'il ne lui fallait qu6
trente-six
(!
'ptes dans le pril, proposa de lui en donner cent pour
t''inoins de sa captivit; et comme il s'tait refus la pre-
TTire dputation qui pouvait craindre quelque dang-er en
ourant le roi, il s'offrit pour la seconde, qui ne devait
l'avilir sa majest, en g-rossissant le cortsre de ses vain-
queurs. Il demanda, en mme temps, qu'on ft une adresse
.M!x provinces, pour leur apprendre que le vaisseau de la
c/iose publique allait s'lancer plus rapidement
que
jamais
(1).
Le roi ne partit qu' une heure aprs
midi. Tout
fi) <<
Je sais, me disait un jour ?>I. de Mirabeau, que vous et tous les
is de l'art ne faites pas grand cas de mon style: mais soyez sur que
uis de moiti avec vous pour me moquer de ceux qui m'admirent.
ne me sers de ma rputation et de la sottise de mes lecteurs que pour
.1 fortune. Nous rapportons ce propos, pour le petit nombre de ceux
i.en lisant M. de Mirabeau, sont tonns qu'il ?<o\i fameux, et pour
IX qui, en sona:eant sa clbrit, sont surpris qu'il crive si mal. 11
en effet des cens dont le rot chancelle devant foutes les g^randes
Mutations, et qui trouveraient le testament de Cartouche bien crit.
:e cette classe de lecteur apprenne qu'il serait encore plus ais de
uouver M. de Mirabeau honnte homme, que bon crivain. R.
tait prt, depuis assez long"-tomps, pour la marche triom-
phale dont il tait le sujet; et dj le peuple murmurait
hautement du retard qu'on apportait cette excution.
On vit d'abord dfiler le g-ros des troupes parisiennes :
chaque soldat emportait un pain au bout de sa bayonnette.
Ensuite parurent les poissardes, ivres de fureur, de joie et
de vin, tenant des branches d'arbres ornes de rubans,
assises califourchon sur les canons, montes sur les che-
vaux et coiffes des chapeaux des j^rardes du corps
;
les
unes taient en cuirasse devant et derrire, et les autres
armes de sabres et de fusils. La multitude des brig-ands et
des ouvriers parisiens les environnait, et c'est du milieu de
cette troupe que deux hommes, avec leurs bras nus et
ensanglants, levaient, au bout de leurs longues piques, les
ttes de deux gardes du corps. Les chariots de bl et de
farine, enlevs Versailles, et recouverts de feuillages et de
rameaux verts, formaient un convoi suivi des grenadiers
qui s'taient empars des gardes du corps dont le roi avait
rachet la vie. Ces captifs, conduits un un, taient dsar-
ms, nu-tte et pied. Les drag"ons.les soldats de Flandres
et les cent-suisses taient l
;
ils prcdaient, entouraient et
suivaientle carrosse du roi. Ce prince
y
paraissait avec toute
la famille royale et la gouvernante des enfants: on se figure
aisment dans quel tat, quoique la reine, de peur qu'on
ne se montrt la capitale avec moins'de dcence que de
douleur, et recommand aux princesses et toute sa suite
de rparer le dsordre du matin. Il serait difficile de peindre
la confuse et lente ordonnance de cette marche qui dura
depuis une heure etdemie jusqu' sept. Elle comm^ena par
une dcharge gnrale detoute lamousqueterie de la garde
de Versailles et des milices parisiennes. On s'arrtait, de
distance en distance, pour faire de nouvelles salves
;
et
alors les poissardes descendaient de leurs canons et de
leurs chevaux, pour former des rondes autour de ces deux
ttes coupes, et devant la carrosse du roi; elles vomissaient
des acclamations, embrassaient les soldats, et hurlaient des
chansons dont le refrain tait : Voici le boiilarifjer, la
boulangre et le petit mitron. L'horreur d'unjour sombre
froid et pluvieux
;
cette infme milice barbotant dans la
boue
;
ces harpies, ces monstres visasse
humain, et ces
deux ttes portes dans les airs; au milieu de ses gardes cap-
POLITIQUE
I7D
llfs, un monarque tran lentement avec toute sa famille:
tout cela formait un spectacle si effroyable, un si lamen-
table mlang-e de honte et de douleur que ceux qui en ont
<
t les tmoins n'ont encore pu rasseoir leur imagination
;
.
t de l viennent tant de rcits divers et mutils de cette
nuit et de celte journe qui prparent encore plus de
i rmords aux Franais que de dtails l'histoire.
V'oil comment le roi de France fut arrach du sjour de
>
pres, par les meurtriers de ses serviteurs, et
traduit
;
ar une arme rebelle, l'htel-de-ville de sa capitale.
\urait-on cru, lorsque cet infortun monarque passa devant
!.i salle de rAsscmble nationale, qu'il lui reslAt encore un
Moclacle qui piit ajouter ses amertumes et Thorrear de
sa situation ? Mirabeau tait l, abusant de son vlsag-e, et
!V)rt de la horde des dputs qui devaient se joindre
la
troupe victorieuse. Plus loin, sur la route dePassy, tait le
duc d'Orlans, contemplant d'un air agit l'arrive du roi,
se rservant pour dernier ontrag^e...
Louis XVI voulut affaiblir l'intrt de ses malheurs : il
livit l'Assemble nationale pour lui apprendre son arri-
13 dans la bonne ville de Paris, le sjour qu'il comptait
y
laire dsormais, et la joie qu'il ressentait du dcret sur leur
iusparabilit mutuelle. Enfin, sa majest fit si bien enten-
dre qu'elle avait suivi librement ses assassins Paris; elle
;mi donna de telles assurances l'Assemble, qu'on pourrait
lire que ce prince, force de flicitations, diminuait le
triomphe et la flicit de ses vainqueurs.
IV. LETTRE SUR LA CAPTURE DE M. L ARBE MAURY
li
A PRONNE (l)
Pronne, 28 juillet 1789.
Aprs nous tre arrachs. Madame, aux charmants spec-
tacles que Paris vous donne tous les jours, soit la Grve,
(i) Forme le n'^ 24 du Journal Politique
(1'* srie).
176
RIVAROL
soit au
Palais-royal, nous nous sommes mis voyag-er,
munis des passeports de Messieurs les lecteurs de la ville,
et nous
traversons en ce moment la Picardie. Un grand
vnement la remplit tout entire : c'est la capture de
M. Tabb
Maurv. Les Picards sont bons, mais ils sont
exacts, et pour arriver plus vite la perfection, ils se mod-
lent en tout sur les Parisiens Ils ont des assembles, des
cocardes, des armes et de bonnes intentions; ils jouent,
comme Paris, une partie dont chaque coup est chec an
Roi
;
ils ont brl les douanes, jet les commis dans les
rivires, intercept les revenus publics, larg-i les malfaiteurs
emprisonn les maGcistrats, et ils comptent tout cela pour
rien, s'ils n'ont bientt entre leurs mains M. l'Archevque
.
de Cambrai. Pronne est peu prs le chef-lieu de tant de
i^,
ressemblances avec la capitale.
Nous
y
sommes arrivs, aujourd'hui 28, de bon matin.
L'abb Maury, qui
y
tait entr dtruise, le dimanche 26, et
.''
qui avait t reconnu, pour avoir demand un chemin de
^
traverse, se trouvait en ce moment environn des milices
nationales de Pronne, au milieu d'un corps-de-ei'arde, sur
le derrire de l'Htel-de-ville. Nous avons d'abord demand
comment on avait fait cette prise, quel erenre de dfense
M. l'ahb allg-uait. et quels taient .sur lui les projets de la
Picardie. Mille bouches se sont ouvertes la fois, et nous
serions encore comprendre un mot tout ce que
do-oi-
saient tant de Pronnels et de Pronnelles, si nous n'avions
ji.
appel l'ordre et invit un chanoine en cocarde, qui tait
,
en face de nous, parler seul, et parler franais, si cela ne
le g-nait pas. Messieurs, nous a-t-il cri, l'homme que la
Patrie a cru devoir arrter ici, et que nous allons renvoyer
\ANation, qui est l'Htel-de ville de Paris, a mrit juste-
ment cette imposition de mains. lia voulu passer chez l'tran-
g-er. la drobe, sans rabat et sans cocarde, et a demand un
chemin de traverse : ce qui n'a pas sembl droit nos mili-
ciens, qui nous l'ont amen. Nous l'avons reconnu pour
tre M. Tabb Maury, cause du sig-nalement qu'on nous
avait fait passer depuis quelque temps, et qui s'est trouve'
fidle. Nous lui avons dit : Vous tes M. l'abb Maury, e;
nous allons vous renvoyer l'Htel-de-Ville de Paris, sur
es pas de MM. Foulon et Berthier. A quoi M. l'abb Maury
a rpondu : Puisque le dg-uisement et la peur n'ont rien
POLITIQUE iqq
liang- la fit>-urc que le ciel m'a donne, je ne vous nierai
sas. comme tout autre le ferait ma place, que je ne sois
l'abb Maury. Il
y
a eu jusqu' prsent de la candeur
l'avouer, et maintenant il
y
a du coura^-e. Me voil votre
prisonnier, et si vous m'envoyez Paris, entour de bayon-
nettes patriotiques, je ne doute pas que la populace ne
Vime traite peu prs comme ]\LM. Foulon et Bertnier; mais
[ je ne me soucie pas beaucoup de g-rossir le martyrolog*e des
1 aristocrates, et je vous prie, Messieurs, d'envoyer un cour-
rier, mes frais, devers Messeig-neurs de l'Assemble
nationale. Je ne doute pas que plusieurs d'entr'eux ne me
'.rclament fortement, de peur que je ne fasse planche; il
in'y
a que la majorit du cleri^ qui ne me rclamera peut-
Slre pas, cause de quelques principes qu'on me reproche,
st qui au fond me sont trs honorables. Ces curs ne veu-
ulent pas concevoir que, du jour o j'ai fait vu d'tre v6-
que, tout ce qui est entr comme moyen dans mou vu est
non seulement justifi, mais sanctifi. Des ttes picardes
comprendront cela trs aisment. Maintenant, Messieurs,
que je suis entre vos mains, prsentez-moi, je vous prie, au
Commandant de la milice, 5l. le maire de la ville, et enfin
Litous les permanents. Rien de plusjuste; et nous l'avons
lussitt amen et constitu dans notre Htel-de-Ville, o,
3n attendant la rponse de l'Assemble nationale, il vit au
ilieu de nos messieurs, et se fait tout tous.
Charms de tant de dtails, nous dsirions que le bon
chanoine ajoutt notre reconnaissance, en nous procurant
"es moyens de voir un moment M. l'abb Maury, au milieu
du comit permanent de Pcronne : ce qu'il nous a accord
sans difficult.
Jug^ez, Madame, si l'abb Maury a t content de nous
voir! Quoiqu'il attendt des nouvelles satisfaisantes de
'Assemble nationale, il n'tait pourtant pas sans inqui-
ude. Quand on a des ennemis, quelque nombreux et quel-
que loigns qu'ils soient, on les retrouve tous dans une
g-uerre civile. C'est ce que nous a trs bien fait sentir cet
A.cadmicien. Il nous a prsents d'abord aux messieurs
Eui
l'entouraient, au commandant de la milice, au prvt
es marchands et tous les lecteurs.
Le La Fayette des Picards est un ancien servent, boiteux
etborg-ne; qui s'tait dj signal dans deux ou trois meu-
1^8
niVAROL
tes populaires, o il avait perdu Til qui lui manque.
Il
nous a racont, avec beaucoup de complaisance, toutes les
peines qu'il avait prises pour enrgimenter cent ving-t
Picards, et leur procurer des cocardes et des fusils. C'est
avec cette escorte qu'il esprait avoir l'honneur de conduire
M. l'abb Maurydans la capitale.
Le prvt des marchands de la ville de Pronne n'est pas
des trois Acadmies, comme M. Bailly
;
mais il avait t
nomm par acclamation, ainsique lui, et tait en ce moment
marg-uillier mrite et matre d'cole.
Nous demandmes ces messieurs, et tous les lecteurs
pourquoi la Nation ne massacrait pas ses prisonniers
Pronne, comme Paris, et pourquoi leur ville se privait
du spectacle de ces excutions, qui font d'abord tant de
plaisir, et ensuite tant d'honneur aux Parisiens : Car sans
faire tort personne, avons-nous ajout, M. l'abb Maury
tait digne de votre colre patriotique. Pourquoi le renvoyer
Paris? Attendez-vous, comme les g'ens de Beaune, une
meilleure occasion?
Messieurs! messieurs! a repris gTa-
vement le maire de la ville, Paris a droit d'excution sur
tout le royaume; mais nous ne tuons jamais que des Pi-
cards, car nous ne sommes pas prcisment la nation.
comme les Parisiens. M.l'abb Maury est un transfuse d^
Etats-s^nraux
;
ceci est dlicat : nous attendons les ordi
de l'Assemble nationale; elle nous tirera d'embarras. Nous
n'avons dj que trop d'affaires. Cette nuit mme, sur un
avis qu'on nous a fait parvenir de la capitale, le Hainaut, bi
Flandre et toute la Picardie ont t sous les armes
;
le toc-
sin sonnait dans les campag-nes et dans les villes; Soo.ooo
hommes de
patrouilles bourg-eoises ont t sur pied, et tout
cela pour recevoir 2.000 brig'ands enrg-iments qui doivent
se rpandre dans nos champs et brler nos moissons.
Nous nous sommes bien aperus, Messieurs, d'un mouve-
ment considrable, en traversant votre province; mais faute
d'tre instruits du sujet de vos craintes, nous avons pris
cet tat violent pour l'tat naturel de la Picardie. Des pa-
trouilles bourg-eoises, armes de fourches, de btons ferrs.
de faulx, et de quelques fusils, nous arrtaient chaqii
pas, et nous faisaient jurer d'aimer la Patrie, et par dessii
tout, levillag-co nous passions. De porte en porte, on nous
a donn un milicien pour nous accompag-ner, et le dernier
l'OUTIOUE
179
[iii nous a fait cet honneur est mont sur le sige de notre
oitiire, tenant derrire lui ses pistolets en sautoir, de sorte
[1!'' les bouches pointaient sur nous.
C'est dans cet tat que nous sommes arrives Rove, o
in nous a demand si M. Nccker tait arriv. Nous avons
<|u'il arriverait bientt : Et toujours il arrivera! il arri-
1 ! s'est cri un des plus apparents de la troupe; je suis
It. id arrter le premier qui ne me dira pas que M. Ncc-
vir est arriv, et l'envoyer, pieds et poing-s lis, l'Htcl-
le-Villc de la Xalion, Paris.
<(
Bien avertis pour cette fois, nous n'avons cess de dire
ur toute la route que ]M. Necker tait arriv, et nous vous
Il
dirons autant, Messieurs, si vous l'exicz. Permettez-
loiis seulement de dire ce qui en esta M. l'abb Maury, et
le vous demander, au sujet de la chaude et fausse alarme
(u'on vous a donne, quel peut tre le but de ceux qui vous
.nt ainsi passer les jours et les nuits sous les armes. D'o
luiirraient venir ces deux mille hommes qui doivent br-
(]'
vos moissons? Le Roi n'cst-il pas d'intellig^ence avec
onlela nation? Les soldats ne font-ils pas le service par-
uut, conjointement avec les bourg-eois?Ce que vous dites
. Monsieur, est bien suspect, a dit le maire, en nous re-
r;irdant de travers; vous tes bienheureux que nous cntcn-
lious laraison. Il nous plat de croire que nous sommes en
langer; celui qui nous rassure est notre ennemi, et ce n'est
['l'en donnant des alarmes qu'on peut tenir sur pied une
rine de trois millions de bourg-eois et de paysans, d'un
1 -ut du royaume l'autre (i), et cette arme existe en ce
noment.
M. l'abb Maury nous fit sig"nc de l'ceil, et nous chan-
gions de conversation, lorsqu'on entendit grand bruit dans
a rue : c'tait le courrier de l'Assemble nationale qui arri-
ait en ce moment, et qui venait revendiquer, non la per-
oiine, mais la libert de >L l'abb Maury, en le dclarant
a(l et inviolable : ce qui mortifia la ville de Pronne un
)oiiit qu'il serait difficile d'exprimer. On avait fait des
rais, on s'tait quip pour le conduire Paris
;
on s'tait
lalt de donner une grande preuve de zle l'Htel-de-
ille, et d'effacer peut-tre le souvenir du supplice de
i) C'est l tout le secret de l'Assemblce nationale. K.
iBo
RIVAROL
MM. Foulon et Berthier, en faisant un peu brler M.l'abb
Maury. Il fallait renoncer de si douces esprances, et rel-
cher sa proie.
On nous reg-arda mme de fort mauvais il, quand nous
flicitmes M. l'abb Maurv sur sa dlivrance, et nous f-
mes trs heureux qu'il ne tombt pas dans Fesprit de cet
abb de nous appeler ses amis et de nous embrasser, car
nous tions lapids. Je ne sais s'il s'est aperu de ce nouveau
moyen de f)erdre ses ennemis; mais il s'est tir des maii;
de ses geliers, fort content d'en sortir, et en mme temp
fort chang- pour les trois jours qu'il
y
a passs.
Nous ne savons s'il aura cd la reconnaissance pour
l'Assemble nationale, ou son ressentiment contre le petit
peuple et contre tous les dmocrates
;
c'est--dire, s'il sera
retourn Versailles, ou s'il aura pass dans les Pays-Bas;
il est sorti sans nous dire son secret. On lui a fait jurer, en
partant, qu'il aimerait toujours Pronne. Il l'a jur sans
dit'Hcult, bien sr qu'il trouverait parmi les vques de la
majorit quelque casuiste qui le dlierait de la saintet du
serment.
Croiriez-vous, Madame, que M. l'abb [Nlaury passait son
temps lire ses Sermons et ses Discours acadmiques aux
miliciens qui le g-ardaient? Il aura trouv les Pronnels
incorruptibles en fait d'loquence. On dit que Csar, tant
tomb entre les mains des pirates, leur lisait ses harang-ues,
les traitait de barbares quand ils n'coutaient pas, leur pro-
mettait de les faire pendre s'il retournait jamais Rome, et
ce qu'il
y
a de plaisant, c'est qu"il leur tint parole. Nous ii
savons pas ce que Maury-Csar a promis aux corsaires d-
Pronne, ni quel sort il leur rserve, si jamais les aristo-
crates ont le dessus.
Quoi qu'il en soit, son aventure a beaucoup servi ui
autre abb qui est arriv tout l'heure .
Pronne : cc^
<
M. l'abb Sabatier de Castres, auteur d'un dictionnaire sur
les Trois sicles de littrature franaise^ o il a attaqu
la philosophie, en l'accusant d'avoir nui autant aux gouver-
nements qu'aux relig^ions. Les j^^ens de Pronne ne savent
rien de tout cela. Mais puisqu'ils taient en train de ramas-
ser tous les abbs paves, ils auraient sans doute arrt
celui-ci, et l'auraient envoy expier trois sicles de littra-
ture par vlngl-quatre heures d'auto-da-f l'Htel-de-ville,
POLITIOLK
l8l
sans la rponse de l'Assemble nationale, qui les avait tout
;i fait d;^oilts de faire des prises. Cet abb Sabatier est
Internent signal dans les uvres de Voltaire, mais il est
plus dan-rrrux de Ttre Paris. Nous avons mme observ
(pie M. labb Maurj a fait semblant de ne pas le connatre.
]!st-ce g-ard ou inimiti? Dans les circonstances actuelles,
t t'st peut-tre un bonheur pour l'un et pour Tautre, puis-
(pie Tun pourrait tre brl chez les fanatiques, et l'autre
cliez les pliilosophes.
Si Pronne savait quels hommes elle a possds en ce
moment, et quels risques elle a courus! C'est comme dans
Doni Japhet d'Armnie :
Deiijc soleils resserrs dans un petit endroit
tiendeni trop excessif le contraire du
froid.
La fortune, qui avait rassembl ces deux abbs, des deux
i)Outs de la littrature ecclsiastique, les a heureusement
spars aussitt : la conjonction de ces deux astres n'a dur
(pi'un instant, et Pronne est sauve.
Nous la quittons en ce moment, et nous serons bientt
Cambrai. Si quelque aventure vient encore jeter de la va-
rit sur notre voyage, nous vous l'crirons; mais ne vous
attendez pas qu'on ait tous les jours des abbs Maurys
vous conter,
Je suis, etc.
P. S.
Gardez-vous bien. Madame, de songer publier
cette lettre, moins que vous n'avez rsolu de faire pen-
dre quelque honnte libraire du Palais royal. Quand nous
n'avions qu'un matre, on pouvait l'viter en crivant
;
mais
aujourd'hui il n'y a de sret crire que contre lui. Car
depuis que le peuple de Paris est roi, la populace est reine,
et on peut tre criminel de lse-majest depuis les Porche-
rons jusqu' la Courtille, et de la Rpe jusqu' la Grve.
Il faut esprer, avec le Journal de Paris, que mesdames
de la Halle feront entendre raison aux rois et aux reines
de leur quartier. Puissent-elles faire comprendre tous
ces princes que la clmence est une vertu royale qui con-
vient merveilleusement dans les commencements d'un
rgne !
I
Quand vous aurez, Madame, gagn toutes ces puissances,
iSs niVAROL
je repartirai pour aller vous joindre. C'est en vain que
rHtel-de-Ville vient de publier, au nom du peuple-roi,
une amnistie gnrale; je ne veux pas me fier au secrtaire
d'un roi qui ne sait pas lire; je ne me servirai jamais d'un
passe-port sign Pitra : ce nom, qui a donn la mort tant
e pauvres livres, ne peut assurer la vie de personne.
y. NOTES ET PETITS ARTICLES
Au Public.
On sent bien que les changements d'imprimeur, les d- L
placements de bureaux et les frais de voyages absorbent tous
|
,]
les produits de notre feuille; mais il nous plat de servir
![
l'humanit nos dpens, et d'crire l'histoire du vivant
mme
de ceux qui nous en fournissentles matriaux. Nous aimons;
mieux nous exiler avec la vrit et la libert, que de nousi
enfermer Paris avec la licence et la calomnie. Si certains
j
journalistes avaient eu le mme amoifr que nous pour la
v-jlf
rite, ils ne seraient pas rests Paris pour la voir immolerj
tous les jours sous le fer des bourreaux dont ils sont envi-
ronns; ils auraient fui, comme nous, plutt que de rester
vais instruments de l'imposture et apologistes de la cruaut,
racontant froidement les meurtres des citoyens, et parlant
^
avec respect de Mesdames de la Halle et de Messieurs de iai'"
Gveye: A uni sacra fams/... u
S'il existait encore, ou s'il pouvait se former au milieu de|
Paris un Tribunal, digne organe des lois, nous lui dnon-jr."
cerions nous-mmes notre feuille, et nous lui demanderionsi
d'tre dclars ennemis de la patrie, s'il est vrai que nousip,
ayons une seule fois prt des crimes la capitale, ou justi-'
'
fi les sottises de la cour. Notre feuille est, au contraire
galement redoutable tous les ennemis de l'humanit
;
e
nous croyons servir la patrie, en prouvant aux trangers qu(
la nation franaise, jadis si polie et si gnreuse, n'est pai-j
_
toute barbare.
(1-9)-
Les Parisiens, qui passaient pour un bon peuple, ont ma-
'
nifest dans ces temps-ci une frocit inoue. Le jour oii,su]
un simple soupon, ils cherchaient partout le marquis de h
POLITIOCE
l83
Salle pour le tuer, deux hommes monts sur le rverbre
qui devait servir de potence, criaient au peuple : Messieurs,
le premier venu, puisque, nous n avons pas le marquis
de la Salle. Ces Dons Parisiens ne voulaient pas tre mon-
t' s sur le rverbre inutilement.
(I,
10).
... Quant la prise de la Bastille, je vois bien que les
Franais v tiennent, comme autrefois au fameux passage
du Rhin, qui ne cota pourtant de peine qu' Boileau.Les
Parisiens s'taient arrang-s pour blouir l'Europe de cette
fameuse prise, mais l'Europe n'a pas tard savoir que le
pjuverneur de la Bastille n'avait pas donn aux habitants
de la capitale le temps de montrer leur courag-e. M. de
Launay avait perdu la tte, avant qu'on la lui coupt.
'
(1,
.3;.
11
y
a deux vrits qu'il ne faut jamais sparer, en ce
monde : i" que la souverainet rside dans le peuple
;
2
que
le peuple ne doit jamais Pexercer.
(1,
13;.
Des libelles du temps.
Dans une sdition populaire, un gouvernement se con-
tente de faire saisir les plus mutins, pour l'exemple, et le
reste se sauve dans la foule
;
c'est ainsi que, dans la quan-
tit de libelles dont la France est aujourd'hui frappe, nous
ne distinguerons qu'une brochure intitule /a /'ra/ice libre.
Jette brochure est sa troisime dition et porte heureuse-
M ment le nom de M. Desmoulins, avocat au Parlement de
Paris... M. Desmoulins commence d'abord par dire qu'il
voudrait bien avoir le style de M. de Mirabeau, qu'il ap-
pelle un excellent citoyen; et nous, nous commencerons
ar fliciter M. Desmoulins en lui apprenant qu'il a prci-
(inent le style de M. de Mirabeau (i), et que vraisembla-
jlement, il est aussi bon citoven que lui...
(I,
.5).
Il faut au monde ou des nouvelles ou des nouveauts,
(1)
Sur le cas que Rivarol faisait du style de Mirabeau, voir la note
la page 178.
mais un homme qui pense ne peut se rsoudre tre le jur
crieur de tant de petits vnements, dont la rapide vicissi-
tude sert d'imagination aux journalistes, et de pture la
curiosit. Dans une grande rvolution, il ne considre que
les vnements qui influent sur la fortune publique, et il
y
voit l'histoire que voudra lire un jour la postrit. Cet ou-
vrage priodique estdonc pluttune nouveaut qu'un ramas
de nouvelles. N'est-ce pas en etiet une nouveaut qu'un
livre qui dit la vrit dans les conjonctures ou nous som-
mes? Si elle avait toujours de tels contemporains, on ne la
verrait pas, cette triste vrit, en appeler sans cesse d'au-
tres gnrations, et oftnr aux enfants le remde des maux
dont leurs pres ont souffert. Une ide vraie, une rflexion
juste consolent ou raniment les esprits
;
mais la foule de
nos folliculaires ne cherche que des crimes ou des mal-
heurs. Tel homme qui a dj dnonc trois ou quatre mille
conjurations aux Parisiens, n'a pu encore leur donner une
:
ide. (II, i).
Il faut rendre cette justice M. Target, qu'il s'est aperu
aprs un ou deux mois d'loquence, qu'il tuait l'Assemble,
et qu'il a srard
depuis un silence fort honnte. Il
y
a peu
de gens qui sacrifient ainsi leur rhtorique et qui, avant \q\^-
talent de parler, aient l'humanit de se taire.
:'^'
(11,4).
'
Une fois que les dmagogues de l'Assemble, et les phi-
losophes du Palais-Royal, eurent le mot des capitalistes, ils -
se garantirent mutuellement la dette et la rvolution. Le!,
marquis de la Fayette promit d'tre un hros; M. Bailly
promit d'tre un sage; l'abb Sieyes dit qu'il serait un Ly-
curge ou un Platon, au choix de l'Assemble
;
M. Chasse-j'
beuf de Volney parla d'Erostrate; les Barnave, les Ption,
^
les Buzot et les Target engagrent leurs poumons
;
les
Bussi de Lameth,les Gupard de Toulongeon et les Bureau
de Pusy, dirent qu'ils feraient nombre; on ne manquait
pas de tartufes, le Palais-Royal promit des malfaiteurs, e1
on compta de tous les cts sur M. de Mirabeau.
(II,
6).
Averiissement.
Quelques-uns de nos lecteurs, chefs de municipalits
POLITIOUB l85
jidputs ou supplants du Tiers-Etat se sont plaints du style
des Rsums. Ils prtendent que cette manire d'crire
donne trop penser, et oii'il n'existe point de journal
"us l'on ait si peu d'gards pour eux. Ils demandent net-
ement un style plus familier,
plus populaire, et pour
tout dire plus na^fo^a/. C'est donc pour leur plaire que
M. Salomon, notre diteur, leur a donn VAdresse aux
Impartiaux, insre dans le numro lo (i;. On ne se
)laindra pas, je pense, des airs de hauteur de cette prose-
,
ni de l'aristocratie du style. Cette Adresse parle la
classe la plus respecte, comme la plus respectable, .sans
acception de personnes, et nous comptons sur la reconnais-
sance de ceux de nos lecteurs auxquels la prose des Rsu-
ms a donn des soucis. Mais nous les avertissons que nous
ferons rarement le sacrifice de notre manire et que nous ne
donnerons que fort peu.de ce style ais qui leur plait tant:
nous ne nous sommes pas retir la campag-ne pour nous
g-ner. D'ailleurs, si nous descendions toujours pour leur
viter la peine de monter, nous laisserions la bonne compa-
gnie qui nous suit depuis lon^-temps et qui est plus aise
vivre qu'on ne pense, puisqu'elle n'exige pas qu'on spare
les gards qui lui sont ds de ceux qu'on doit la langue,
au got, au vritable ton et la majest de l'histoire.
Ce n'est pas pourtant que, dans VAdresse aux
Impar-
tiaux, on ait pouss la condescendance jusqu' l'incorrec-
tion ou la bassesse du style
;
on a seulement
proscrit les
formes lgantes, afin de se conformer l'esprit .d'une na-
tion qui renonce toutes les apparences du luxe en faveur
des capitalistes, et qui sera sans doute fort aise qu'on ta-
blisse aussi des lois somptuaires dans la prose. Mais il faut
dire aussi que la franchise et la puret de principes qui
rgnent minemment dans VAdresse aux
Impartiaux,
demandent grce pour sa nudit, aux yeuxles plus dlicats,
et si le mauvais style de tous les journaux de Paris a fait
Easser
tant de fausses ides dans le peuple,
pourquoi la
ont des principes n'excuserait-elle pas un style sans pa-
rure chez les gens du monde ? (11,
1
1).
(0
Adresse M^f. les Iinpartiauj: ou les Amis de la Paix, runis
chez M. le duc de' la Rochefoucauld.
Elle forme le numro lo du se-
cond abonnement.
l80 RIVAROL
Sans examiner si les Noirs ne sont pas moins malheureux
en
Amrique qu'en Afrique, il me semble qu'il est bien
extraordinaire que des hommes ptris de nei^e et de boue,
des
g-omtres qui n'ont rien aim, tels que MM. Dupont et
Condorcet, veuillent nous persuader qu'ils ont calcul les
larmes des ng-res et que leur sort les empche de fermer
l'il. Est-ce qu'en politique il faut parler de sensibilit?
En poussant le principe d'humanit jusqu'o il peut aller,
il faudrait ne rien manj^er de ce qui a vie, laisser les che-
vaux en libert, et, comme les Brames, balayer les chemins
avant d'y passer, de peur d'craser un insecte. Gardons nos
larmes pour nous.
(11,24).
L'Assemble nationale, en crasant tous les corps inter-
mdiaires et tous les privilg-es, n'a fait qu'achever en
France l'ouvrage des Rois Ds que l'Etat pourra don-
ner une arme au Prince, cette arme lui donnera l'Etat.
Qu'on se repose tant qu'on voudra sur Theureux naturel
de Louis XVI
;
la nature des choses sera plus forte que la
nature du roi, et si ce n'est celui-ci, ce sera son successeur.
(in,
4).
ACTES DES APOTRES
COMMENCS LE JOUR DES MORTS..,
(1789.I792)
I. SUR ROBESPIERRE
(789)
Les aristocrates ont rpt avec une joie indcente que,
e jeudi
19
novembre, M. de Robespierre, dans le chaleur
le la discussion sur la dmarche du bureau renforc du
Gambrsis, avait dit que ce bureau tait un corps arislo-
"rassiqne que l'esprit arisiocrassique dirig-eait unique-
m<'nt, et qu'il fallait s'empresser de le dtruire; le mot
arisiocrassique fit sourire les auditeurs : cependant, l'-
ruilition, le g^ot et les talents de M. de Robespierre, qui
l'ont conduit la tribune nationale, sont connus de toute la
France. Si le despotisme d'un pdant de collge ne tolre
pas un solcisme un pauvre boursier, la libert de TAs-
isemble doit souffrir parfois une expression qui s'loigne
si peu de la puret du lang-age. M. de Robespierre est cit
dans tout l'Artois comme un auteur classique. Il lui est
mme chapp des ouvrag-es de pur agrment que tous les
srens de got ont recueillis, et nous croyons faire plaisir
nos lecteurs en leur faisant connatre un madrigal de
M. de Robespierre, qui a fait le dsespoir de la vieillesse
de M. de Voltaire :
Crois-moi, jeune et belle Ophlie,
Quoi qu'en dise le monde,et malgr ton miroir.
Contente d'tre belle et de n'en rien savoir,
Garde toujours ta modestie.
Sur le pouvoir de tes appas
Demeure toujours alarme,
Tu n'en seras que mieux aime,
Si tu crains de ne Tctre pas.
M. de Robespierre ne se borne pas la littrature lgre;
il dirig-e le journal intitul /T'^/o/2 ou le Journal de la
Libert
;
cette feuille a t d'abord compose en franais et
en ang-lais
;
mais le prodig-ieux dbit que les premiers nu-
mros ont eus en Ansrleterre ayant effray les p;*azetiers
ansrlais, ils ont pri M. de Robespierre d'accepter dix mille
livres sterling pour rendre son journal absolument fran-
ais. Nous invitons nos lecteurs lire avec attention la
sance du soir de samedi 21
;
ce morceau est entirement
dans la manire de Tacite, et quand on le rapproche du
madrigal que nous venons de faire connatre nos lecteurs
on se rappelle involontairement
que l'auteur de l'Esprit
des Lois a fait aussi le Temple de Gnide. Les crivains
qui savent allier la force la grce, l'imagination la phi-
losophie, la profondeur des ides l'lgance du style, de
tels crivains, disons-nous, sont trs rares. Nous avons
t tents un moment de comparer M. de Robespierre
Montesquieu
;
mais nous nous sommes ressouvenus que
l'aristocratie de ce dernier mlait un sombre nuage aux
rayons de sa gloire. M. de Robespierre joint ses autres
talents une connaissance
approfondie de la gographie; il
n'est pas moins familier avec la physique exprimentale";
sa rputation politique en Artois a commenc par un m-
moire foudroyant sur les paratonnerres... Si M. le comte de
Mirabeau est le flambeau de la Provence, M. de Robes-
pierre est la chandelle d'Arras.
(N 5).
II. RPONSE DE M. ROBESPIERRE, A M.
***,
QUI l'a-
YAIT RELEV SUR LE MOT
ARISTOCUASSIQUE,
DONT
ROBESPIERRE SE SERT FAMILIEREMENT DANS L^AS-
SEMBLE NATIONALE
Ce 29 novembre 1789.
Je vous dois une rjDonse, M., pour l'honorable mention
que vous faites de moi : mais je vous prie d'observer que
POLITIf)UE
189
je ne vous dois qu'une rponse. Un autre croirait vous
devoir quelques bonnes plaisanteries; je m'en tiens au sim-
ple ncessaire et ne pousserai pas la politesse jusqu' l'es-
prit. Ce n'est pas dans l'adTeuse situation o nous sommes
({ue j'talerai au luxe. L'Assemble nationale a tabli deux
choses galement favorables notre rgnration, Vcono-
mie et la libert. Mais malheureusement on n'a jamais bien
entendu ces deux mots
;
on a cru sottement que Vconornie
regardait les Finances, et la libert les Personnes; mais ce
n'est pas cela. L'Assemble nationale, qui cote 3o.ooo liv.
par jour la France, et qui a dj emprisonn ou mis en
fuite plus de cent mille Franais, n'a visiblement entendu
dcrter que l'conomie d'esprit, et la libert du lang-ae.
L'Acadmie franaise, fonde par Richelieu, patron des
aristocrates, avait en elfet tabli en France la plus insup-
|)ortable des aristocraties, celle de l'esprit et de l'loquence.
Il est dit, dans les statuts de cette mtropole des Lettres,
qu'en France une compa)2rnie de 4o hommes aurait le pri-
vilge exclusif du beau lang-age. C'tait le temps o une
autre acadmie, compose aussi de 4<J hommes, avait de
son ct le privilge exclusif de tous les revenus de lEtat.
Ce double monopole des fermiers-gnraux de la langue
franaise, et des acadmiciens de la ferme -gnrale, n'em-
pchait pas qu'il ne se glisst beaucoup de lapins de con-
trebande dans Paris, et beaucoup de solcismes et de bar-
barismes l'Acadmie : mais c'tait avec bien de la peine,
et le despotisme gnait incroyablement la libert des bles,
si bien assure aujourd'hui par la dclaration des droits de
l'homme. Autrefois un lapin ne pouvait tre tu que dans
quelques lieux privilgis, maintenant il a du moins la
libert d'tre tu partout. Les solcismes et les barbarismes,
jadis prescrits par les solitaires de Port-Royal, n'osaient
presque plus se montrer. Ils attendaient
patiemment la
rvolution; et quand le moment est venu, tous nos acad-
miciens leur ont ouvert la porte, et ont afranchi par eux la
langue franaise, cette ancienne esclave de Racine et de
Boileau. Les philosophes du Palais-Royal ont t les pre-
miers crire avec cette mle et noble libert qui foule
ses pieds les rgles, les modles, et toutes les autres mar-
ques de servitude. Les Rulhires, les Crutti, et la foule
des crivains enrichis par les aristocrates, ont saisi Tocca-
igo
niv.vuoL
sion dfaire du vice de l'ingratitude une vertu patriotique;
et de briser deux jougs la fois, en nous dlivrant de la
connaissance des principes, et des principes de la reconnais-
sance.
M. Suard, l'homme de son temps qui fait le mieux ce
qui est faire, a pass de la police la libert; et n'y a
pas trouv grande diffrence. Toute la rvolution, selon lui,
se rduit ceci : qu'on pouvait jadis penser sans parler^
et quon peut aujourd'hui parler sans penser : ce que le
cyclope Artaut, qui voit toujours les choses du bon il,
appelle une vritable quation (i). Je conclus de tout ceci,
Monsieur, que les forts de l'Assemble nationale, les Mira-
beau, les abb Sievs, les Villeneuve-de-Pthion, les Cha-
pelier, les Glezen, et divisi toto orbe britanni, ont, sans
me compter, le droit de se moquer des rgles du langage, et
de rpondre librement tous les esclaves qui criaient qu'on
ne peut vivre sans gouvernement, ni crire sans style et
sans ides.
Je ne parle pas des fautes que vous me reprochez en go-
graphie, en physique et en posie : j'ai trop maudit dans
ma jeunesse le joug de la science, pour ne pas crire et
parler aujourd'hui en homme tout fait indpendant.
ROBESPIERRE
(2).
(^^^
7)-
m. EXPLICATION D UNE CHARADE
Le public a vu dans notre 83^ chapitre avec quelle con-
fiance nous avons soumis la sagacit du comit national
des recherches, la charade qu'on nous avait adresse
(3) ;
impatient d'en connatre l'objet, dj sans doute il nous
accuse de ngligence. Le rcit que nous allons faire sera
(i) Ce M. Artaut est borgne (Xofe de rauteur). R.
(2) Cet article a paru galement dans le Journal Politique (I, i8).
RivaroI,qui crit toujours Roberspierre, fait suivre la signature de ces
mots nig-matiques : Ereac et exlex.
(3)
Mon premier en blason figurait noblement;
Mon second au moulin sert avec modestie;
Et mon tout, des pervers redoute justement.
Dvoile les complots de l'aristocratie.
FOLITIOUE
'9
notre justification. Nous sup[)lions tous les bons citoyens de
l'couter avec bont, et de ne pas tirer consquence contre
nous les bons principes de nos bons amis Chapelier et
Menou, qui blment les g-ens avant de les entendre.
Lorsque nous prsentmes M. le Prsident du comit
notre production nigmatique, il tait occup tout entier de
son loquent rapport sur les lettres aristocratiques de l'v-
que de Blois, et il faisait des etorts incroyables pour pro-
portionner son style au physique de la plus grande et cle la
plus aug"uste assemble de l'univers. Mais il daig^na nous
assurer avec cette bont, les manires douces et engageantes
qui le caractrisent, qu'aussitt que le Chtelet aurait t
charg de faire pendre l'voque de Blois, son marchand de
papier, son imprimeur, ses correspondants, ses lecteurs, etc.,
etc., etc., ce comit s'occuperait de notre atlaire.
Cette promesse a t ponctuellement remplie. Ds le ven-
dredi 1 6 avril, nous avons t avertis de nous rendre la
barre du comit. La sance tait au moment de s'ouvrir, et
la vue de ces illustres amis del libert, par oui le rgime
inquisitorial de l'ancienne police a t si utilement rem-
plac, nous avons prouv cette douce et tendre motion
dont quelques aristocrates ne peuvent encore se dfendre
quand ils voient souper le pouvoir excutif et sa femme, ou
promener leur petit garon.
M. le prsident a annonc l'ordre du jour et notre grande
uvre a t dpose sur le bureau. A la seule indication du
titre, M. Goupil de Prefeln, homme consomm dans la
connaissance de l'antiquit, s'est livr une dissertation
aussi savante que curieuse sur l'origine de la charade. Sa
rapide loquence, parcourant les monuments de l'histoire, a
prouv que la charade avait pris naissance en Perse, la
mme poque o les Grecs inventaient le jeu de l'oie. A
cette occasion, l'orateur a pathtiquement dplor la mal-
chance de ce jeu, qui, n au sein de la libert, mais prati-
qu depuis longtemps /)ar les ci-devant princes et grands
.s>?/^/ieMrs, tait ainsi devenu un Aas instruments du despo-
tisme. Il a parl d'un plan de rgnration qui, le restituant
sa destination primitive, le rendrait vraiment national et
fort utile aux corps de gardes nationaux dans les longues
soires de l'hiver.
Nous attendions le dveloppement de cette conception
102
lUVAUOL
Patriotique
quand un honorable membre a observ que
opinant s'cartait visiblement de la question, et a demand
qu'on l'v rappelt. En vain M. Goupil a prtendu que, quand
il avait'la parole, personne ne de\a\i(i
)
lui faire Thonneur
de l'interrompre, M. le Prsident a prononc contre lui, et
notre charade a t lue. Sur le premier aperu, quelques-
uns voulaient que, pour simplifier ce travail, on se formt
en sections
;
d'autres demandaient qu'on nommt des com-
missaires qui feraient leur rapport trs prochainement;
mais on a rpondu aux premiers qu'il tait notoire que les
sections ou bureaux niaient l'esprit public. On a observ
aux seconds que le choix des commissaires emporterait un
temps prcieux, qu'il valait mieux employer approfondir
la question.
Alors la discussion s'est tablie
;
mais les difficults
naissaient chaque pas. On entrevoyait bien que le comit,
ou quelqu'un de ses membres, pouvait tre l'objet que l'au-
teur du quatrain avait voulu clbrer. On sentait bien encore
que tous les noms sur lesquels on s'exerait ne se prsen-
taient pas avec un gal RYSintage. Boutteville-Dumetz tait
long- et insignifiant; Joubert, trop court, ne rimait rien;
Salicelii n'tait pas franais; Kervelegan avait plus de
deux pieds;.4 /^/er tait trop dur; Glezen n'avait pas de
sens. Mais comment oser prononcer l'exclusion de ces noms
clbres. Paris lui-mme, choisi pour
Jur
dans cette
grande question de
fait,
n'et su auquel adjuger la
pomme, et chaque membre se trouvait partag entre sa pn-
tration qui cartait des rivaux, et sa modestie qui lui d-
fendait de se replier sur lui-mme.
Dj l'ajournement indfini tait demand, dj tous les
yeux se fixaient sur le prsident pour l'inviter le pronon-
cer, quand on s'aperut qu'une aimable rougeur colorait
son visage. Ce phnomne tonnant claira l'assemble, on
relut la charade, et ds le premier vers: cest un pal, dit
l'un , c'est un ne, cria l'autre , c'est notre prsident,
s'crirent tous les membres la fois
;
et sur le-champ,
M. Palasne de Champeaux ou de Champeaux Palasne
fut proclam le hros de la fte. Confus de tant d'honneurs,
(i)
Expression favorite de M. Rabaud de Saint-Etienne dans sa pr-
sidence, H.
POLITIQUE
ig3
rapprochant tous ses succs de la semaine, ce pirantl homme
v( rsa des larmes, et nous manifesta par un coup d'iltrs
spirilucl qu'il nous reportait une partie de son triomphe.
Nous sortmes ivres de joie et combls d'honneurs pour
jious rpandre dans la capitale, et en empruntant le lan-
i^aq-e de notre ami Dubois de Cranc, nous assurons que,
(l;s le soir, tout Paris et son aban lieue savaient le mot de
riiig-me.
Ainsi s'est termine
cette journe mmorable, o les ver-
tus couronnes par les talents ont tait rejaillir sur eux une
j)artic de l'clat qu'elles
en
avaient reu, et o, selon la pr-
diction de notre cher g-nral Lameth, les humbles ont t
levs pour le dsespoir et Chumiliation des superbes.
IV. NOUVEAUX DIALOGUES DES MORTS
IMITS DE LUCIEN
Conversation de M3J. Bulhires et Suard^ tous deux
membres de VAcadmie franaise et
officiers
de la ci-
devant police de Paris.
SuARD.
Me cherchiez-vous ?
RuLHiRES.
Non... et vous ?
S.
Je ne vous cherchais pas non plus
;
mais je ne suis
pas fch de vous rencontrer,
R.
Je ne sais pas
;
mais il me semble que nous nous
fuyons depuis quelque temps.
S.
J'en conviens, depuis la rvolution on s'vite ; on
n'y est plus. . .Franchement mme, il faut que ce soit vous
pour que je m'arrte.
R.
Nous aurions pourtant bien des choses nous
dire
;
la rvolution nous laisse du loisir, au lieu que, sous
l'ancienne police, on agissait plus qu'on ne parlait : et d'ail-
leurs on n'a rien se dire quand on a le mme confident.
S.
Il est certain que l'ancienne police. en nous atta-
chant tous les deux elle, nous dispensait de nous attacher
l'un l'autre ;mais nous pouvons maintenant nous dire un
mot d'amiti.
Pi.
Oui, mais cetteamiti nous cote cher tous deux.
Combien perdezvous au nouveau rg-ime?
1^4
niVAROL
s.
J'avais environ quarante mille livres des bienfaits,
ou, si vous voulez, des forfaits
de l'ancien gouvernement.
Et vous?
R. Je n'ai jamais pu tirer que dix douze mille francs des
sottises du ministre.
S.
Ma foi, je perds tout. Mais aussi (|ui s'attendait
un tel bouleversement ? Avec une police si bien monte.
tant de censeurs, d'exempts, d'inspecteurs, d'officiers de
toute espce ! quel ordre ! quel systme ! De quoi se plaignait-
on? Enfin, tout est bas, je n'ai plus rien.
Pi. Mais vous tes de l'Acadmie, je crois?
S.
Et vous aussi, mais on ne pave plus; vous savez
que les jetons taient du bon papier, on trouvait de l'ar-
srent dessus, et le premier orfvre du coin pouvait tre
banquier de l'Acadmie... Tout m'chappe la fois : ma
femme n'est plus une njmphe! M. Necker n'est plus un
Dieu:
R.
J'ai eu l'adresse de me brouiller avec le baron (i
),
avant qu'il se brouillt lui-mme avec la fortune, et cela
n'a pas pass long^tempspour une ingratitude
;
mais vous,
mon cher, vous avez t arrach tout vivant de vos amis
;
M. Lenoir d'abord, et puis M. Necker.
S.
Aprs cela, qu'on nous parie de prudence, de
masure, de conduite... J'aurais pu lcher M. Lenoir la
rvolution : mais M. Necker ! C'est inconcevable
;
je n'ose
presque pas lever les yeux.
R.
Il faut pouiiant les lever, et voir se retourner.
S.
Avouez quec'estbien cruel, et convenez que Cham-
fort etCrutti ont mieux vu que nous la rvolution.
R- Je ne suis pas de votre avis. Ils ne sont pas plus
avancs que nous : ils sont avec ceux qui dmolissent et
voient tomber M. Necker et leur petite fortune devant
eux : voil leur avantage
;
tous nos beaux esprits en sont
logs j'd.Il
y
en a trois d'affichs la porte d'un journal
[?.),
Autrefois beaucoup d'articles dans le Mercure pouvaient
(i) De Breteoil. R.
is) Ce journal est maiDtenanl intitul : Mercure de France, par Mes-
iii'urr Marmontel. La Harpe et Ckampfort tcus trois de l'Acadmie
Fraii^i=-e,i. Il est dmocratique dans la partie lituVaire et aristocratique
dans la panie politique. C'est comme la chauve-souris de la fable: Vive
U Roi, vive LaLiffue. ^Nole de l'auiecr.^ K.
fOLITIOLE fjO
corirluire un pauvre homme l'Acadmie prsont, il faut
tre de l'Acadmie pour faire un article au Jfercure : c'est
urif iniae^e assez nave de la rvolution.
S.
Il me semble que nous autres ij^ens de lettres n'au-
is jamais d favoriser celle rvolution. Les grands et
ministres taient notre jg-ibier, et nous avons eu la btise
d'ouvrir nos parcs la populace.
R.
Qu'est-ce qui aurait cru qu'une rvolution philo-
hique ruinerait les philosophes?
S.
Quelquefois la mine tait sauter les mineurs.
l\.
Voil bien des vrits, mon confrre.
S.
Un homme ruin en dit beaucoup : la fortune ne
-te que des monson2;-es.
K.
Je voudrais bien ce prix faire encore la mienne,
fillt-il louer l'esprit de M. Crqui, et vanter toujours la
'u de Madame Mati^non.
S.
Quant moi, je n'ai jamais rien lou, pas mme
M. Lenoir.
Pi.
Vous tiez comme les muets du srail, mais votre
ice n'en tait pas moins un terrible service.
S.
Point d'pig"ramme entre nous. Nous nous connais-
s : vous tiez au ministre de Paris; moi la police.
. e^t comme les facteurs de la poste, l'un la grande, l'au-
ti
'^
la petite.
R.
Avec votre comparaison, nous n'avanons g-ure :
voil une conversation qui ne mne rien. Avez-vous un
plin, des projets?
S.
A quoi s'attacher? Quand il n'y a ni arbres, ni
murailles, les lierres ne montent plus.
Pi.
Et ce comit des recherches?
S.
Cela aurait pu devenir quelque chose; mais ils se
.1 mis faire le mal pour rien.
i.
Quelle canaille! Et ce Bailly, et ce La Fayette, les
z-vous tals?
S.
J'ai d'abord vu M. Bailly : je lui avais mme trac
n:i plan : mais le bonhomme n'entend rien rien. Croirez-
s qu'il a paru surpris que je ne fusse pas aide-de-camp
NL de la Fayette, comme tant d'autres de nos confr-
(i)? J'ai voulu lui parler de ce qu'il tait, et de ce qu'il
[i] Les aides-de-camp du g''neral La Fayette sont d'excelleots espions
ig6
RIVAROL
pouvait tre : il m'a dit naveincnt qu'il demanderait sa
Femme... C'est une piti... D'ailleurs, tous les mots du nou-
veau dictionnaire : le peuple-roi, le pouvoir excutif, le
lgislatif, les sections, la commune... J'ai dcamp. C'est
un homme perdu.
R.
Et La Favette?
S.
Le petit Dumas, qui tait aide-de-camp du mar-
chal de Brolie, la veille de la rvolution, et qui le lende-
main endossa la livre de M. de la Favette, m'a dgot de
la maison du g-nral. C'est un de ces petits intrigants, qui ne
sont ni matres, ni coliers, et qui dsolent les bons esprits.
Fi.
H bien !
j
irai, moi, chez La Fayette, et nous ver-
rons.
S.
Je vous prviens d'abord que, toutes les fois que
j'ai assist sa toilette, je l'ai trouv lisant la vie de Sylla.
Voyez si cela peut vous servir.
R.
Beaucoup. Je lui proposerai de faire l'histoire se-
crte de la rvolution d'aprs ses mmoires, dans le g'enre
de celle que j'ai faite de Catherine, et s'il a quelque chose
se reprocher, je lui mettrai le doiglsur l'article o lesOrlow
font assassiner le czar; vous entendez ce que cela veut dire.
S.
Prenez-y G^arde; si vous
y
mettez de l'esprit, il n^^
vous entendra plus. Nous nous gtons, nous autres, avec no-
dlicatesses, et nous finissons, au sortir d"un entretien, par
tre inintelligibles au reste du monde.
R.
Mais puisqu'il lit Sylla, ce choix...
S.
Et si c'est celui de son valet de chambre?
R.
Eh bien ! je m'attacherai au valet de chambre.
S.
Ne vous
y
trompez pas : la rvolution n"a pas laiss
sur pied une seule de nos maximes; je ne connais point de
bonne corde en ce moment; mais vous tes sage; voyez
l'heureux Sylla.
R.
Et vous, qu'allez-vous devenir?
S.
Mon ami, quand on est de la police, on peut tro
de l'Acadmie; mais quand on n'est plus que de l'Acad-
mie... Hlas!
R.
Hlas !
(No
i63.)
de police
;
chacun sait comment le sieur Julien a travaill dans l'affaire
de M. de Bonne-Savardin. (Note de l'auteur.) R.
POLITiyLE IQ7
V. NOTES ET PETITS ARTICLES
Le bruit sYtant rpandu que M. de Barentin, ancien
rarde des sceaux, tait cacli dans le couvent des Annon-
iades, dg^uisc en novice. M. le ohevalier de Lainelh,niem-
ire du Comit des recherches de l'Assemble nationale, s'est
lansport aux Annonciades, accompag-n de i5o hommes
1('
la ^ardc nationale parisienne. Ce dtachement s'est em-
ar de toutes les issues; on a fait une visite exacte du cou-
.'Ht, dans lequel M. de Barenlin ne s'est point trouv.
On no saurait donner trop d'log-cs aux dispositions de
\[. de Lameth dans cette expdition : toutes les prcautions
liaient t prises pour en assurer le succs; la visite du
Hivent s'est faite avec la dcence que le lieu exig-eait, et
\l. de Lameth s'est retir en ordre sans avoir perdu un seul
lomme.
Des hommes connus en France sous le nom de persifleurs
iiU essay de rpandre du ridicule sur la demarchedeM.de
Lameth. Nous croyons rendre un service important lapa-
lie, en lui dnonant le persiflag-c comme une aristocratie,
?t (le l'espce la plus dan^q-ereuse, car on peut dfinir le per-
^idag-e, l'aristocratie de l'esprit.
Tous les bons citoyens n'ont vu, dans la conduite delNL de
Lameth, que celle d'un patriote pur, zl, qui veille sans
relche au salut de la cho^e publique. Cette conduite a t
isoutenue depuis le commencement de l'Assemble. MM. de
J^.ameth, issus d'une famille aristocratique, comble des
faveurs de la cour et des bonts de la reine, n'ont cess de
;c montrer les plus ardents dfenseurs de la dmocratie,
:'est--direde la seule forme de gouvernement qui convienne
k un g-rand empire. M'Sl. de Lameth ont sacrifi la recon-
naissance particulire l'intrt public, et nous avanons,
saiiS crainte d'tre contredits par les amis de notre libert,
que la non-g-ratitude, qui est presque toujours le dfaut des
mes viles, est la vertu de M>L de Lameth.
Nous ne connaissons qu'un homme dans l'Assemble qui
ait autant de droits que M^L de Lameth l'estime et au
respect de la nation, et dt notre franchise nous rendre
odieux tous ceux qu'on appelle assez incorrectement les
honntes gens, nous cdons au sentiment qui nous presse,
^9^ RIVAI\OL
en rendant un hommage public aux vertus et aux talents
de M. le comte de Mirabeau.
Nous n'avons pu voir sans indig-nation l'auteur
d'un
libelle atroce refuser M. de Mirabeau les talents mme de
l'crivain. Pour dtruire une assertion aussi injuste, nous
opposerons l'anonvme lui-mme. Il ne conteste point
M. de Mirabeau le^projet de la loi martiale, et il voudrait
nous faire croire que Vadres^e aux commettants est de
M. de Roverai. Nous conviendrons avec la franchise dont
nous faisons profession, qu'on trouve quelques incorrections
de stvle dans le projet de loi martiale de M. de Mirabeau,
maisil estconvenu aussi en littrature d'appeler ces incorrec-
tions les carts du g-nie. Puisqu'il
y
a du gnie dans l'a-
dresse aux commettants, et des incorrections dans le projet
de loi martiale, il en rsulte videmment que l'un et l'autre
sont de M. de Mirabeau. Tous les bons citoyens seront de
notre avis sur les ouvrag-es de ce grand homme, comme
tous les bons log-iciens le seront sur ses vertus. Celle qui le
distingue peut-tre de tous les hommes talents qui brillent
dans l'Assemble est sa modestie; c'est le soin qu'il prend
de drober au public des actions hroques. Nous devons le
faire jouir de toute sa gloire, et publier, malgr lui, ce qu'il
veut qu'on io;-nore.
Ce vejidredi
3o octobre, M. le comte de Mirabeau eut en
sortant de l'Assemble une discussion assez viveavecM. Co-
cherel, dput de Saint-Domingue, sur l'impatience et l'hu-
meur qu'une partie de l'Assemble avait tmoignes pendant
les opinions de quelques honorables membres. Aprs avoir
chang
quelques sarcasmes assez durs avec son adversaire,
le farouche Amricain, se livrant l'imptuosit de son
caractre,
s'emporta jusqu' la menace, et proposa son illus-
tre confrre de sortir. Plusieurs prlats, entre autres M.l'-
vque de Chlons-sur-Marne,
suppliaient M. de Mirabeau
de rester.
Eh, Messieurs! s'cria M. Cocherel, pargnez-
vous tant de soins et de peines, je vous rponds qu'il ne
songe pas sortir.
Croirait-on
que nous avons trouv beaucoup de gens dans
le monde qui ont os taxer de lchet la modration et la
prudence de M. de Mirabeau? Sa conduite nous parat au
contraire
fort sage et trs mthodique; elle s'explique
d'elle-mme.
M. de Mirabeau a trs bien jug qu'un com-
POLITIOLE
'99
I
bal entre deux dputs ne serait que scandaleux et devien-
i
drait interminable, car deux personnes sacres et inviola-
I bls sont ncessairement invulnrables. Voil le seul motif
qui a encban son courag-e.Ils n'en douteront pas^ ceux qui
ont t porte comme nous de voir cet excellent citoyen
se promenant le lundi 5 octobre sur la place d'armes Ver-
sailles, son sabre nu sous le bras, avec le maintien qui
caractrise le vrai courage, et qui lui valut cet log-e flatteur
de la part du commandant du r^-iment de Flandre :
K Vous nous retracez Charles XII.
Ce mot laconique dans la bouche d'un brave et ancien
otHcier n'est point le lang-age de la flatterie; c'est l'expres-
sion pure de la vrit et du sentiment d'admiration qu'ins-
ipirent les petites actions de M. de Mirabeau, et mme son
! inaction...
(-V I.)
Que faites-vous du matin au soir chez M"" Le Jaj, dit-on
M. de Mirabeau? Hlas! rpondit-il, j'y suis l'homme le
plus occup du royaume; je caresse la femme, je bats le mari
et je pille le comptoir.
(No
ig.)
La rputation de probit de M. Targ-et lui vient d'un mot
de M. de Beauharnais et n'a point dmenti cette source. Le
mot important est si familier cet orateur, qu'on n'ose plus
s'en servir qu'en parlant de lui. M. Targ-et est matre de
dcrier tel mot de la langue qu'il voudra.
(NO
ig.)
LETTRE DE M. VILLKTTE
ci-devant marquis de la Villette, et un peu
plus avant M. de Villet te
M. Riquet--VEnchre^ ci-devant
comte de Mirabeau
(extrait)
Notre beau pre-d'Orlans, et vous, Riquet, notre cher
frre, vous voil donc blancs comme neige, au rapport du
vertueux Chabroud (i) !
(i) Les marchands de Paris appellent blanc d'Orlans toutes les cou-
leurs obscures et noirtres. R.
Oh ! la belle et bonne uvre que ce rapport. C'taient
sans doute de beaux jours que les 5 et 6 octobre, mais le
jour du rapport est bien autre chose. Car ce n'est pas le tout
de faire des crimes, il faut encore les justifier, sans quoi
une rvolution n'est pas complte.
Quoique les fagots et les feux ne me plaisent gure, il
faut bien s'en servir, puisque la joie publique n'a pas d'au-
tres signes. J'ai donc allum mon petit fagot et fait mon
petit feu de joie avec nos bon amis.
Si quelque ombre pourtant pouvait se mler tant d'-
clat, si quelque nuage pouvait ternir un peu votre triomphe
et alarmer notre admiration, ce serait le serment que vous
avez fait de poursuivre le Chtelet et les tmoins jusqu'au
tombeau. An! renoncez un si funeste dessein, conu dans
la premire ivresse du succs. Laissez, comme dit Racine,
attendrir votre victoire : songez que vous ne rgnez que
depuis un an,etque si la clmence est malheureusement une
vertu, elle est bien ncessaire au dbut d'un rgne. D'ail-
leurs,
puisque vous avez jur de vous venger, songez qu'en
pardonnant vous serez parjure, et qu'un parjure n'est pas
ngliger...
A
la hauteur o vous tes, vos ennemis mmes conviennent
que le gibet est le seul genre d'lvation cjui vous manque.
Il faut avouer aussi que, pour les couvrir de boue, vous
n'auriez qu' vous jeter sur eux
;
m.ais au nom de votre
gnie, comme vous le disait Crutti (i), mprisez ce facile
succs : on ne vous reproche que trop de faiblesses.
(N'^ i8i.)
'
Vers pour tre mis au bas du portrait du
feu
roi de \
Prusse
I
Pote conqurant, sage voluptueux.
Aprs avoir instruit et ravag la terre,
Il se lassa des rois, des vers et de la guerre,
Mprisa ses sujets et les rendit heureux.
(xV2
64.)
(t) Crutti, avec ses phrases luisantes, s'attache tous nos grands
hononncs
;
c'est le limaon de la littrature : il laisse partout une trace
argente, mais ce n'est que de la bave.R.
PETIT DICTlOxNNAIRE
DES GRANDS HOMMES
DE LA RVOLUTION
CI-DEVANT RIEN
Tous les hommes sont bons.
sEDAi.xE, Dserteur
ou abbe sieyls, Droits de l'homme.
AU PALAIS ROYAL
1790
Epitre ddicatoire son excellence Madame la
baronne de Stal, ambassadrice de Sude auprs de la
Nation.
Madame,
Publier le Dictionnaire des grands hommes du jour,c'est
vous otYrir la liste de vos adorateurs
;
aussi dt-elle au pre-
mier aspect vous effrayer, je n'ai pas balanc un instant
vous en faire l'hommag-e. Toute la France sait qu'elle vous
doit ses meilleurs dfenseurs, et qu'en paraissant soupirer
vos g-enouxals ne pouvaient en ctit'et brler que pour la patrie.
,Ah! sans doute, Madame, vous possdiez trop d'avantag-es
pourqu'un mortel ost vous aimer pour vous-mme; il aurait
Fallu qu'il se dcidt entre votre esprit et vos charmes; qu'il
quittt sans cesse vos ouvrae;"es pour vos yeux, vos yeux
pour vos ouvrag-es
;
et le poids de tant de prodig-es tait
au-dessus des forces humaines. Tous les bons Franais ont
donc t rduits ne dsirer en vous que le bien public, et
se sacrifier pour lui entre vos bras. Il tait crit, Madame,
RIVAROL
que jusqu' vos amants,tout serait libre en France
;
et vous
avez second, on ne peut mieux cette g-rande destine. Vous
avez prouv leur patriotisme par vos discours; vous l'avez
fortifi par vos faveurs
;
enfin vous avez form des hommes
au-dessus de tous les vnements. Qu'il est beau, Madame,
d'teindre ainsi l'amour en seprodig-uantsoi-mme,etdefaire
delajouissanceunfrein redoutable, au lieu d'une vile rcom-
pense! Une pareille science tait sans doute rserve la
fille du plus g-rand ministre de l'anne passe, la fille du
plus profond g-nie de l'anne passe, une fille enfin qu'on
peut regarder comme le seul dbrisde la g-loirede son pre.
Mais je m'arrte^. Madame. A force de vous louer, je pour-
rais oublier, et qui vous tes, et ce que je vous dois
;
et je
serais inconsolable, si, en recevant mon hommag-e, vous
vous trompiez sur son intention. Je l'abrge donc, de peur
de l'affaiblir, et je finis, Madame, par joindre au respect
invincible et gnral que vous inspirez, celui de
Votre trs humble et trs heureux admirateur
l'Auteur du petit Dictionnaire.
PRFACE
Tandis que nous sommes libres, il me prend envie de
faire le dnombrement des g-rands hommes de chaque
espce, qui, d'une paisible monarchie, ont fait une si bril-
lante rpublique. Egalement habiles, ils ne sont pas tous
g'alement clbres
;
et c'est peut-tre le seul hommage digne
d eux que de rassembler leurs noms et de confondre leur
gloire. La postrit est si in^rate! Elle jouit tranquillement
de ce qu'on a fait pour elle, et rougit souvent de ses bien-
faiteurs ! Il faut donc la forcer la reconnaissance, en
lui prsentant le tableau de nos illustres compatriotes, et en
lui traant leur caractre et leurs exploits. Je vais l'essayer
avec toute la patience qu'exige ce travail; et si, par hasard,
nos neveux se trouvaient un jour le peuple le plus heureux
de la terre, ils sauront du moins qui s'en prendre.
Ce qu'il
y
a de vraiment admirable dans notre glorieuse
rgnration, c'est que toutes les classes d'hommes
y
ont
galement contribu. Le pair de France sans crdit s'est
joint au savetier sans pratique, pour sauver la patrie en dan-
ger; le guerrier mcontent a rassur le timide badaud, en se
POLITIQUE
ao3
mettant sous ses ordres
;
et l'crivain malheureux,
de con-
cert avec 1 crivain public, a chant nos victoires
;
c'est sans
|doute cet heureux amalg-ame que nous devons notre incroya-
ble libert. C'est par un accord parfait entre le rebut de la
cour et le rebut de la fortune, que nous sommes parvenus
cette misre g-nrale qui atteste seule noire g-alit. Quoi
jde plus injuste, en effet, que cette ingale distribution des
biens, qui forait le pauvre travailler pour le riche, ce qui
donnait l'arei-ent une circulation mal entendue, et la
terre une fertilit dangereuse ! Grces au ciel, tout est rta-
bli dans l'tat sauvage o vivaient les premiers hommes
;
le
parti le plus fort s'est trouv naturellement le plus juste, et
comme tout le monde s'est mis gouverner, les cris des
mcontents ont t touffs. Des gens mal intentionns ont
pu reprocher la nation le sang qu'elle a rpandu en s'em-
,
parant de l'autorit; ils ont cru que la faible voix de l'hu-
manit pouvait interrompre une entreprise si importante:
comme ils se sont tromps, les perfides ! L'lite des Franais,
les braves Parisiens, se sont pntrs d'une cruaut vrai-
iment civique: ne voulant plus de chefs, ils n'ont souhait
que des victimes, et ils ont gorg avec ignominie les indi-
gnes sujets qui obissaient leur matre.
Que ne doit-on pas aussi aux gnreux gardes-franaises,
qui ont si bien soutenu leur rputation ! Pour se joindre au
I
peuple irrit, ils n'ont pas mme attendu qu'on les ft mar-
jeher contre lui; et dans l'ardeur d'abandonner leurs dra-
!
peaux, ils ont devin la tyrannie. Quel spectacle admirable
I
pour l'arme franaise que de voir quatre mille guerriers,
dfenseurs ns de la majest du trne, abjurer un si vil
mtier, donner le signal d'une noble dsertion, et prfrer
les aumnes de la populace la solde d'un grand roi ! Il
semble que la renomme ait attach une gloire particulire
ces illustres fugitifs. Ce qui fit jadis leur honte les immor-
talise aujourd'hui; et si la guerre calme leur courage, l'a-
narchie en fait des hros. En effet, par combien de belles
actions ne viennent-ils pas de se signaler ! Depuis le brave
grenadier qui tira sur son officier jusqu' celui qui condui-
sit M. de Launav la Grve, tous ont dploy le mme
genre de valeur. C'est devant eux que les murs de la Bas-
tille se sont crouls; ils s'aperurent les premiers qu'elle
'^"('tait point dfendue, et ils la conquirent avec cette fre
204
UIVAUOL
assurance qui ne connat point d'obstacles
;
leurs noms ne
seront donc pas les plus faibles ornements de mon petit Dic-
tionnaire, et si, par gard pour le lecteur, j'ai t oblig de
faire un choix parmi tant de conqurants, ceux queje ne nom-
merai point ne m'en devront pas moins de reconnaissance,
et leur conscience les consolera aisment de l'oubli.
Mais c'est dans ce parti populaire de l'Assemble natio-
nale que j'ai puis mes plus brillants caractres; les habi-
les lgislateurs qui le composent se sont tous trouvs placs
pour seconder la rvolution. Les injustes disgrces de la
cour ont donn aux uns l'nergie de la vengeance
;
la ruine
malheureuse de leur fortune a donn aux autres le gnie
de l'agiotage : et comme leur fonction commandait sans
cesse leur opinion, ils sont rests jusqu' ce jour invaria-
bles dans leurs principes. Voulant rformer la France, ils
ont senti la ncessit de brouiller l'tat. Le peuple tait en-
core retenu par quelques prjugs monarchiques, et par un
aveugle amour de son roi. Ces grands publicistes lui ont
ouvert les yeux
;
ils lui ont fait dcouvrir son tyran dans son
matre
;
ifs lui ont prouv que les nobles n'taient que des
usurpateurs hrditaires, puisqu'ils osaient jouir des pos-
sessions de leurs pres; ils lui ont abandonn les biens des
prtres, pour lui ter jusqu'aux freins spirituels de la reli-
gion
;
enfin, par leurs subbmes dcrets, ils ont dpouill
le faible et encourag le fort.
C'est aussi dans cet auguste aropage que nous avons
vu clore des gnies qui, sans elle, seraient encore l'ennu-
yeux rebut de la socit. Que de miracles n'opre point le
patriotisme! Les plus lourds esprits de la littrature se sont
bien montrs les plus profonds de l'assemble
;
les plus
illustres ignorants de la jeunesse franaise n'ont paru ni
embarrasss, ni dplacs dans la tribune parisienne: en un
mot, les ennemis de la langue sont devenus tout coup les
dfenseurs de la nation. On ne se mfie pas assez dans le
monde de ces soudaines mtamorphoses. On s'imagine
aujourd'hui qu'un homme est un sot, parce qu'il est sans
grces, qu'il parle mal de tout, que ses ides mmes l'em-
barrassent, et que la raison s'anantit dans sa bouche. L'ex-
prience dtruit tous les jours cet horrible prjug. Si ce
mme homme a bien le caractre de sa mdiocrit, il obtient
toujours une espce de rputation
;
comme il dsarme l'en-
POLITIQUE
ao5
vie, il est estim sans re<2;Tels
;
il abandonne l'art de plaire
aux beaux esprits, et lamour de la "-loire l'homme
talent, et devient ce qu'on appelle un nomme de mrite :
voil ce qui caractrise tous les grands homme de la rvo-
lution. Qu'on me cite, en effet, un crivain, un philosophe,
un acadmicien mme qui se soit disling-u dans ces derniers
temps de trouble et de prosprit ! M. Bailly est le seul
^Tand homme que les sciences aient fourni la France alar-
me
;
encore ne doit-il son lvation qu' la sublime sim-
plicit de son caractre. On n'admire en lui que ce qu'on
n'y avaitjamais admir, et ses ouvrag-es seront indpendants
de son immortalit. Ce sont donc les plus simples mortels
({ui font aujourd'hui la g-loire du nom franais
;
la mdio-
crit fait encore ressortir l'clat de leurs actions, et ce n'est
qu'opposs eux-mmes, qu'ils peuvent tonner la postrit.
Il faut donc peindre ces tiers rpublicains avec la peinture
qu'ils mritent
;
il faut empcher leur modestie d'chapper
la clbrit, et il faut mme leur sauver l'honneur de
rentrer dans leur premire obscurit.
Je ne me suis pas dissimul que j'avais un modle inimi-
table dans VAlmanachdes grands hommes de /jcS*^. L'au-
teur de ce registre immortel a si bien vari ses log-es qu'il
ne m"a pas laiss de formes nouvelles pour encenser mes
personnag-es
;
mais l'importance de mon sujet fera peut-
tre oublier la supriorit de sontalent.il n'a exhum qu'un
millier de bons crits
;
moi, je ressuscite un millier de gran-
des actions, et, obscurit g-ale, le hros doit l'emporter
sur l'crivain. Je vais donc entrer en matire, sans m'ef-
frayer de la rivalit, et si la rvolution s'tend jusque sur
le bon g"ot, j'aurai bien des chances pour tre victorieux.
Mon projet tait d'abord d'assig^ner le profit de cet
ouvrag-e tous les estropis du patriotisme
;
mais j'ai rfl-
chi que, toute leur g"loire venant de leur misre, ce serait les
dg"rader que de les secourir, et j'ai bientt eu honte de
mon humanit. Une plus heureuse ide s'est prsente
moi. Les infirmits du corps ne demandent que nos soins
;
mais celles de l'esprit exig-ent toute notre piti.
Mille autres penseurs, tels que des journalistes, des mo-
ralistes, des publicistes, hasardent chaque jour leur
existence, dans l'talag-e de leurs productions. Les pauvres
insenss! ils fondent leur subsistance sur nos ennemis, et
200
ils se trompent encore! On ne les achte point, et le travail
n'a fait qii irriter lenr faim. Ne serait-il pas gralement beau
et profit;u4e, de les mettre l'abri de la misre de la litt-
rature, et d'acqurir leur inaction par quelques offrandes
pcuniaires? C'est donc eux que je destine le revenu de ce
dictionnaire : ds l'instant qu'on l'aura mis en vente, qu'ils
Tiennent en assurance recevoir le prix de leur silence; mais
qu'ils s'eng-aerent ne plus le rompre : car, la pre-
mire rechute, on les abandonnerait leurs talents. On
paiera cinquante francs par mois le repos d'un journaliste;
cent francs celui des faiseurs de pamphlets
;
et quand le
)roduit de l'ouvrasre sera puis, on proposera une qute a
a nation, pour continuer une opration si salutaire.
PEXrr DICTIONNAIRE DES GRANDS HOMMES DE LA REVOLUTION
AIGUILLON (le duc d').
Un des plus tonnants champions
de la libert franaise. Il lui a suffi de prendre le nom de
son pre pour faire oublier ses talents et ses crimes. Son du-
cation n'a g-ure commenc qu' l'ouverture des tats-g"n-
raux; mais, au bout de six semaines, il rptait dj ses
motions avec toutes les gfrces de l'adolescence : on fut mme
oblig- d'touffer son esprit naissant pour en faire un g-rand
homme. On lui arrang-ea des principes sa porte, et il se
disting-ua comme tout le monde. Bientt il devint la terreur
de la famille royale, et l'admiration du faubourg- Saint-
Antoine, dans la crise de la rvolution; ses vovag^es deParis
Versailles ne furent qu'un enchanement de g-randes
actions; mais on prtend qu'il les couronna toutes la
journe du 6 octobre. Ce fut l, dit-on, qu'il travestit son
courage, et devint intrpide sous l'humble vtement d'une
harangrre
;
on assure qu'il combattit lonsrtemps la tte de
son nouveau sexe, et qu'il fit des prodg-es de valeur au
Sied
du trne abandonn. Tant d'exploits, sans doute, ne
evedent pas rester inconnus : et l'on ajoute qu'un clat de
rire le fit reconnatre au milieu du carnagre. Mais s'il s'est
trahi, ce n'est que pour tre immortel.
BEAUHARNAis.
Un des plus illustres danseurs de l'an-
cienne monarchie, et qui n'aurait jamais fait un mauvais
pas. sans son dbut aux tats-g-nraux . La majest de l'en-
rcMxiiQVK 207
ceinte l'a effraj, et depuis ce moment il n'a plus fait que
chanceler. Quelle honte pour la noblesse franaise
BEACMXTz.
Dput de la noblesse d'Artois, pour le
peuple de Paris. Personne n'a mieux faitque lui les honneurs
de sa province TAssemble nationale. Il a mme sacrifi la
justice de soo pajs^ et est magistrat N'est-ce pas le comble
dm daDtreaaeiiient ?
BREVET DE BEAUJOPR.
C'est VWmaiis^ des
grands
hommes que l'Assemble nationale doit cet oratmr. Sans
cet honnte ouvrage, M. Brevet aurait peut-tre dba^
l'estime de l'Anjou, et ne le reprsenterait pas aiijovralkc
avec tant de di^it. A force de donner daiis la tribune, il
s'est attir la place de secrtaire, et il la remplit avec toute
la modestie cootfcnable. On l'a souponn de n'tre parvenu
tant d'bomiear qu'en contrefaisant la mdiocrit
;
mais
jamais sovpoik ne fut plus injuste, ni dguisement plus
inutile. M. Brevet est arriv naturellement tout, et il n'a
eu besoin que de se faire connatre pour dsaoraier
l'envie.
BROUSSE DES FAUCHERES.
Cc sTand ffnie a eu deux arloi-
res mener de front, la g-loire dramatique et la gloire mu-
nicipale, et il s'en est fort bien tir, car il a sacrifi la pre-
mire. Il a senti qu'il serait plus utile son pays sous
M. Baillv, que sous Molire
;
et il s'est laiss faire lieute-
nant de maire. Peu de mortels sont capables d'un pareil
-lent. peu d'crivains font le sacrifice de leur plum.e
. .^nt de rsig-nation : aussi M. Brousse en est devenu
plus ebcr qae jaonais la nation.
rAiTt
DssMOuiJss.
L'crivain chri de la nation pari-
sienne. Chaque orateur a son champ de bataille et son audi-
toire. Les uns s'emparent de la tribune, les astres de la
chaire, les autres du fauteuil acadmique ;
c'est dans la rue
que M. Desmoulins s'est tabli avec son loquence, et il a
tous les passants pour admirateurs. Avec trois mots savants:
natioB, lanleme, et anstiicxate, il a su se mettre la porte
de l'koBBle ^aroa bcwcber, de la modeste
poissarde, et de
tous ces nouveaux lecteurs qw'a enfantiRS la lfolvtioD. Il
faut de telles
r
luBies pemr conduire le pevple et FaceiMte-
mer a a :es. Voltaire et RovsaeaB,
avecleursshfc-
mes c:
-: fait qu'clairer et adoucir les
Janrais iiS n cLuiaientsu les daroter du jou]
Jamais, pour les civiliser, ils ne leur aurai
2o8 nivAuoL
forces, et jamais leur slvle tant vant n'aurait os ensan-
flanter
la France. Voil justement ce que nos crivains
p-
lies ont su faire. Sans leurs harangues priodiques, les
Franais seraient encore tranquillement esclaves. Aujour-
d'hui mme ils se cacheraient, et se fatig"ueraient de ne
vivre que de victimes. Mais heureusement M. Desmoulins
entretient leur nerg-ie avec ses feuilles
;
il tient pour ainsi
dire leur veng-eance en haleine, et il ne parat pas un de
ses numros, qu'il n'y aitquelque part du sang- de rpandu.
CHABOT. Jeune hros qui a immol la patrie son nom, son
tat, sa fortune et mm.e sa g-loire, s'il en existait une avant
la g-arde nationale. Si toute la noblesse et imit ce g-rand
exemple, le militaire franais tait perdu jamais, et l'a-
ristocratie tait sans ressources. Nous n'aurions plus crain-
dre que quelques armes trang"res
;
encore notre situation
nous rassurerait-elle. En effet, est-il aujourd'hui une puis-
sance qui, en contemplant bien la France, puisse tre ten-
te de la conqurir ?
CHMER.
Vritable pote de rvolution. Il a profit, on
ne peut plus heureusement, du renversement des ides, et il
a donn son Chai-les IX. Il fallait un parterre rempli des
hros du faubourc" Saint-Antoine, pour que cette pice ft
dig-nement admire, et c'est ce souverain public qui Ta cou-
ronne. Racine, Corneilleet Voltaire, dans dtelles circons-
tances, auraient fait tout au plus quelque chef-d'uvre de
st;)le, qui n'et respir que l'humanit. M. Chnier a bien
mieux saisi le g'ot du moment; il a fait un drame natio-
nal : il a mis un cardinal fanatique et un roi atroce sur la
scne; il a employ exprs le patois le plus barbare, pour
animer le peuple contre la tyrannie, et Iharmonie du tocsin
lui a suffi pour charmer son auditoire. En secouant ainsi
les rg-les despotiques du thtre, il a laiss bien loin de lui
tous ces prtendus g-rands hommes, et il s'en loigrie en-
core tous les jours par de nouveaux drames.
CROIX (dej.
Un des muets de l'Assemble nationale;
mais la nation est sre delui.Ilest dvou la bonne cause,
il se lve pour la bonne cause, il reste assis pour la bonne
cause, il tape du pied pour la bonne cause, et il ne se tait
mme que pour une bonne cause.
cusTiNE. Jusqu' prsent on le croit neutre dans l'Assem-
ble, mais il a le cur trop bien plac pour ne pas devenir
POLITIOUE
209
bientt un des meilleurs patriotes du ct gauche
;
et sa
passion pour une simple fille publique donne dj les meil-
leures esprances.
DEMEUMKR.Uu dc CCS hommcs doutla rvoluliou a dcid
le g-nie. Sous le rg-ne du despotisme, il traduisait modes-
tement des gazettes, et ne prvoyait pas alors qu'un jour il
aurait des ides, qu'il parlcraitcourammentdans une grande
assemble, et qu'il deviendrait l'objet d'une commune admi-
ration. On a mme t forc de le faire quelquefois prsi-
dent, pour teindre le feu continuel de son talent; tant de
miracles ne pouvaient s'oprer que par une insurrection
-l'nrale : mais quel est le pays qui n'achte pas un peu cher
Ja possession d'un g-rand homme?
FAucHET(robb).
Il est impossible derunir plus de titres
ilriotiqucs que M. l'abb Fauchet. Il est, la fois, rcpr-
iitant del commune parisienne, prdicateur rvolution-
naire et volontaire dans l'arme nationale. Il a su faire tte
tant de charges, et partout il s'est illustr. Il a dit en
chaire que les aristocrates avaient pendu Jsus-Christ, et
les aristocrates n'ont pu le nier. Ne pouvant dcemment
sauver M. Foulon dans ce monde-ci, il l'a subtilement sauv
dans l'autre, et lui a gliss l'absolution travers les glaives
des bourreaux. Il a dit aussi, dans le Journal de Paris, qu il
n'y avait plus de mauvais plaisants que parmi les aris-
tocrates. On Ta cru un moment aristocrate, mais on n'en a
pas moins senti cette g-rande vrit.
GARRAT le cadet.
Autre journalier de l'Assemble, mais il
est plus habile que tous les autres; il dguise la vrit dan-
gereuse, il encense la force triomphante, il attnue les hor-
reurs d'une catastrophe; enfin on peut le regarder comme
l'optimiste de la rvolution. Que de citoyens alarms n'a-t-
il pas tranquilliss, en assurant, dans sa feuille, qnavec
deux ou trois ides on repousserait tous les ennemis de
la France ? Il a d'ailleurs dans son style cette concision
ncessaire pour chanter une insurrection, et le Journal de
Paris sera toujours pour le peuple la meilleure histoire du
temps. On a cru jeter du ridicule sur cet ouvrage, en fai-
sant une liste de ses nouveaux abonns, et en disant quil
avait regagn en alles ce quil avait perdu en portes
cochres. Mais on en a fait, sans le vouloir, l'loge le plus
convenable. On a cru humilier l'crivain, cl l'on n'a fait que
flatter le patriote.
GRARD.
Grossier laboureur, mais un des meilleurs
rpondant du patriotisme de la Bretag-ne. A la vrit, il n'a
jamais ouvert la bouche, mais la sublime simplicit de son
costume a suffi l'admiration de Paris et de N'ersailles, et
il a paru inutile de faire expliquer un pavsan sur l'abolition
des droits seigneuriaux.
GouY d'arcy. Jeune homme infatigable et qui a fini par
faire parler de lui de la manire la plus avantageuse. Ayant
essay inutilement de plusieurs bailliages pour parveniraux
tats gnraux, il a faitsemblantd'arriver de Saint-Domingue
et on l'a reconnu dput de lautrc monde. Il a fait pouser
aux ngres le patriotisme de Paris, et on l'a bientt confondu
avec les dfenseurs de la patrie. On a voulu le rendre mpri-
sable et le tourner au ridicule; mais il n'a eu besoin que de
parler et de se m^ontrer pour rendre tout cela inutile.
GRGOIRE.
-
Encore un cur sacrificateur. Son plan pour
la suppression de tous les frais de culte suprme tait aussi
sublime qu'vanglique. Il ne demandait chaque paroisse
de France que six cents francs par an pour l'existence de
Dieu. Lui-mme se faisait forf, pour vingt sols par jour, de
tenir fort proprement un autel, d
y
clbrer deux ou trois
messes par semaine, et mme de prcher et d'encourager
le peuple dans les grandes occasions. Une religion si bon
march devait sans doute sduire toute la rpublique; mais
les ennemis de ce bon cur ont fait chouer tous ses projets
de rforme : ils l'ont mme contraint jusqu'ici de recevoir
ses dix-huit francs par jour, et en vritable Grgoire, il en
gmit sans cesse au cabaret
.
GROUVELLE.
Un de ces valets littraires, qui savent quitter
les genoux des grands, quand leurs grandeurs disparaissent.
Il a mme surpass en ce genre tous ses honntes confrres.
Non seulement il a abandonn le prince de Cond qui l'a-
vait sustanl, mais il a crit contre Montesquieu, qui avait
nourri son esprit Une telle impartialit lui a fait beaucoup
d'honneur et lui a tenu lieu de connaissance et de talents
auprs de ses lecteurs.
GuiLLOTiN. Mdecin patriote, qui a cru que son art pou-
vait tourner au projet de l'humanit. Il a vu la lancette en
grand, il l'a dirige sur tous les maux qu'entrane la jus-
POLITIQUE 211
.re, et il a invent sa machine immortelle. On l'a accus d'a-
. ord de confondre un peu les criminels d'avec ses malades,
t d'tre aussi tranchant rHpital qu' la Grve; mais on
/ii a bientt pardonn des distractions insparables du g-nie
t on a couronn la guillotine. On attend un bon crime de
'.
.'se-nation pour en faire Fessai
;
et en faveur de cette "rande
-xcution, M. Guillotin a promis de renoncer la mdecine.
HUMBERT.
Enfant dedouzeans, qui a pris la Bastille tout
:omme une rande personne. Il a braqu son petit fusil sur
l'norme citadelle, et il a cass une vitre du gouvernement
;
ela ne parat rien, mais ce sont des petites actions comme
:elle-l qui ont dcid la victoire, et le petit Humbert, ce
;
jur-l, en valait bien un autre.
LANJuiJNAis.
Patriote, avocat et Breton
;
trois titres pour
larler beaucoup, et mme pourse faire couter. M.Lanjuinais
n'a jamais eu de ces mouvements d'loquence qui meuvent
lauditire, mais il a eu souvent de ces emportements qui
lui plaisent; il aurait mme pouss quelquefois la chaleur
usqu' rinjure, si on et pu distinguer ce qu'il pensait
iravers ce qu'il disait
;
mais l'obscurit adoucit les traits
les plus amers, et on fait tout entendre avec son secours.
LA MAXDDfiRE. Uu desplusforts vainqueurs de la Bas-
tille. Il pntre dans le fort de la place avec dix mille jeunes
g-enstoutau plus, et quatre invalides voulurent en vain arr-
ter leur imptuosit. Aprs quelques heures de combat, ces
vaillants sexag-naires furent vaincus
;
et deux seulement
furent pendus, selon les lois de l'insurrection . On a voulu
jeter du ridicule et de l'atrocit sur ce fameux sige
;
mais
l'embarras des assisreants excuse leur frocit : quand
on ne trouve pas de dfense, on attaque comme on peut.
LA ROCHEFOUCAULD (le duc de).
Ancieu conomiste, et
qui ne pouvait pas dfendre la monarchie sans droger ses
principes. Il n'a pas trop brill dans le parti rpublicain
;
mais a prfr la mdiocrit l'inconsquence, et cette
estime de ce qu'il vaut lui a fait beaucoup) d'honneur.
LJA>couRT (le duc de).
Grand publiciste qui tenait la
cour par ses places et la nationparses principes, et qui a su
tout accorder et tout conserver. Il s'est laiss attendrir pour
le roi, il s'est laiss insulter pour le peuple, et il a gagn
tous les curs. Un succs aussi gnral est fort rare, et
demande un homme d'une mdiocrit invincible. Il faut
que son ambition ne puisse tre contrarie par aucun talent,
et qu'il laisse mme ses rivaux la douceur de ne pas
rcstimer. C'est ainsi que le modeste duc de Liancourt est
arriv k tout
;
il aspire tranquillement tous les g'cnres de
g-loire, sans que personne s'avise seulement de demander
pourquoi il est question de lui.
LUY^-Es(leduc de). Patriote inbranlable. Il s'est tabli
dans le parti populaire
;
il a fait sig-ne qu'il s'y trouvait fort
bien et
on ne lui en a pas demand davantag-e.On a eu soin
seulement de mettre ses cts deux forts de l'assemble,
qui le
soulvent et le rassoient quand il faut opiner pour
la patrie.
MIRABEAU (le comte de).
Ce grand homm.e a senti de
bonne heure que la moindre vertu pouvait l'arrter sur le
chemin de la gloire, et jusqu' ce jour, il ne s'en est permis
aucune. Il n'a regard l'honneur et la probit que comme
deux tvrans qui pouvaient mettre un frein son gnie, et il
s'est rendu sourd leur voix
;
il a renonc toute espce de
coura?e,pour ne pas rendre sa destine trop incertaine
;
en-
fin, il a profit de son manque d'me pour se faire des princi-
pes l'preuve des remords. Des milliers de Franais se sont
dvous pour la patrie
;
lui, s'est vendu pour la patrie, et
cela est bien plus sr : le gnie est si flottant dans sa mar-
che qu'une grande rpublique ne peut compter sur lui
qu'en le payant fort cher. D'ailleurs, quand il s'agit de la
libert, il ne faut rien pargner
;
et la hdlit du comte de
Mirabeau prouve la magnificence du parti qu'il dfend. Il
n'a parl quelquefois en faveur de l'autorit royale que
pour prouver que son jargon aurait trouv partout Se pla-
cer, et que son loquence gagnait cent pour cent tre diri-
ge contre sa conscience.La nation lui a donc laiss le plaisir
de combattre quelquefois contre elle, et la misre du roi l'a
toujours rassure
;
le comte de Mirabeau n'en passe pas
moins pour un des meilleurs ouvriers de la rvolution, et il
ne s'est pas commis un grand crime dont il ne se soit avis
le premier.
MiTOUFLET.
Lc plus grand prsident que le district de
Saint-Ro.h ait jamais produit. C'estlui qui a fait une guerre
si savante au club del rue Royale; c'est lui qui a appris au
peuple que deux cents citoyens, en jouant aux dames et aux
checs, conspiraient contre la libert, et que ces deux jeux
POLITIOUB
2l3
emblmatiques taient l'cole de l'arislocratie : il a mme
|dcouvert que M. de Favras avait djeun deux fois dans
icette maison infernale, et aussitt elle a t dtruite. Les
jmembres de cet horrible sabbat ont t vaincus et disperss
par vingt mille passants, soutenus par la e^arde nationale
(4 le faubourq- Saint-Antoine; et le procs de M. Mitouflet,
devenu l'ornement de tous les coins de rues, ternisera
jamais le souvenir de cette grande victoire.
MONTESQUiou.
Citojcn facile, qui se prte volontiers
toute espce de gouvernement, et qui, dans lestroubles d'un
empire, trouve toujours une puissance flatter, et une for-
tune se promettre. Il perd cent mille cus dans une nuit,
't tche de prendre sa revanche, en prsentant un plan de
inance l'Assemble nationale. Un tel caractre serait mpri-
sable, et peut-tre dangereux dans une monarchie, mais on
l'accommode de tout dans une rpublique; et pour que la
ihcrt soit sans bornes, il faut que tous les vices puissent
.'exercer.
MOREL.
Un des plus illustres dnonciateurs de M. de
'
vras. Par une confiance au-dessus de Ihumanit, il s'est
;i pendant un an l'espionnage, Thvpocrisie, et atout
c que la trahison a de plus infme, pour sauver la France
'un massacre gnral que deux ou trois personnes allaient
xcuter. On a cru aisment un hommequi sacrifiait son
lays tout ce qui lui restait de probit, et on a noblement
compens une perfidie si patriotique. Pour tre cons-
lcnt, il fallait immoler M. de Favras
;
et faute de preuves
u s'en est rapport aux fureurs du peuple.
XARBONNE (le comte Louis de).
Cet ex-courtisan s'tant
vis d'tre citoyen, et voulant se distinguer quelque
tre que ce soit, ne s'est point dcourag en trouvant
aris toutes les places prises, et il s'est fait patriote de pro-
ince
;
il s'est d'abord dbarrass de quelques grces de
Ancienne cour, auprs de la fille du grand Necker, et il est
arti bien corrig pour la Franche-Comt
;
muni d'un cer-
ficat de levque dWutun, il
y
est bientt devenu com-
landant de toutes les gardes nationales. Il s'y distingua
iaque jour par de nouvelles vertus. Il exerce ses troupes
ir ses harangues, il les encourage par sa prudence
;
et si
ite province tourne en petit royaume, comme il
y
a lieu
de l'esprer, ce qui peut arriver de pis M. de Narbonne,
c'est de la g^ouverner.
NOL (l'al^b). Un des plus recommandables journaliers
de la rvolution
;
il n'a fait qu'un saut de l'universit dans
la chronique de Paris, et il a rpar trente ans d'obscurit.
Il mourait de faim, ses discours la bouche; il s'enrichit,
les injures la main. Quelle noble source d'abondance
nous a fourni la libert de la presse! Elle n'a rum que
les talents et le bon g-ot, c'est--dire, quelques individus qui
faisaient rougir un million de pauvres crivains. L'galit
d'esprit est donc une des plus grandes oprations de l'As-
semble nationale,et c'est au dcret qui la constitue qu'elle-
mme a le mieux obi : on ne voit plus dans son sein, ni
penseur, ni orateur se distinguer insolemment
;
aucun
esprit ne s'lve; aucun homme loquent ne fait rougir son
voisin. Quel exemple touchant pour toutes les nations clai-
res !
ORLANS (le duc d').
Le prince le plus sage qui ait jamais
paru dans une insurrection. Il a su gagner un pauvre peu-
ple par sa bienfaisance imprvue, par son air d'insouciance;
et le peuple s'est charg, sans le savoir, de son ambition et
de son courage. Philippe d'Orlans s'est laiss louer, adorer,
estimer mme, sans s'inquiter d'un pareilaveuglement
;
et
il se serait laiss couronner, si le trne ne ft pas devenu le
poste le plus prilleux del monarchie. C'est donc par pru-
dence qu'il devint tout coup le dernier des citoyens.
M. de la Fayette l'envoya en cette qualit en Angleterre,
pour tranquilliser la France et accoutumer les Parisiens
son absence; et le prince s'est montr digne d'une mission
aussi honorable
;
pendant six mois, il sest constanlment
laiss mpriser de toute l'Europe
;
il a toujours mis sa
gloire et son salut dans l'oubli de la nation franaise. Son
espoir n'a pas t tromp. Il est revenu tranquillement
Paris pour l'auguste fte du i4 juillet. A peine le faubourg
Saint-Antoine, la halle, et le Palais-Pioyal se sont-ils rappel
sa figure et ses bienfaits, et il a t oblig de se faire insul-
ter pour se faire reconnatre.
PTioN DE VILLENEUVE.
Avocat de Chartres, qui, par
faute de .clients, est venu plaider pour les Parisiens dans f
l'Assemble nationale. Ce n'est pas prcisment de l'lo-
quence qu'il a dploye, mais une certaine turbulence qui
il
POLITIQUE
2l5
la remplace et qui la vaut bien
;
il a une discussion si tour-
dissante que, dans le plaidoyer touchant le droit de faire la
paix ou la t^^uerre, on Ta oppos au terrible Mirabeau.
Ces deux orateurs
y
mirent la fois tant de chaleur et d'im-
partialit qu'ils se dirent un torrent d'injures. Cette fran-
chise rpublicaine les couvrit de g^loire, et confondit le vain-
queur et le vaincu.
popuLus.
Dput fameux par ses amours avec M'^' Th-
roig-ne de Mricourt, la plus grande citoyenne du Palais-
j
Royal. Cette habile matresse le contient dans le boudoir et
ne l'chaufe que dans l'assemble. Assise au premier rancr
de la tribune publique, elle veille avec ardeur sur l'lo-
quence de son amant; d'un reard, elle encourag-e son
I esprit
;
d'un soupir,elle lui annonce la victoire : en un mot,
elle l'enchane pour lui faire chanter la libert. Il est donc
clair que M. Populus doit la parole et sa renomme
Mil
Throig-ne, et que la France doit un grand homme de
plus l'amour.
SAi.NT-FARGEAU. Jeunc Tobin del plus haute esprance,
lia foul aux pieds son mortier de prsident, il a renonc au
noble surnom de Saint-Farg-eau
;
enfin, il a fait tous ces
petits sacrifices avec la grce et la navet de son g'e. L'As-
semble nationale, enchante de son bon naturel, s'est amu-
se jouer avec lui au fauteuil et la sonnette, et l'aima-
ble enfant s'est tir merveille de cette plaisanterie. Les
g-aleries mmes en auraient t la dupe et 1 auraient cru un
vrai prsident, s'il ne s'tait pas avis de contrefaire
M. Targ-et.
TARGET.
Cet habile lg-islateur a constamment prt le
flanc tous les ridicules, afin de g"ouverner plus son aise,
et dedg-oter ses semblables de l'autorit; en effet, travers
les hues de ses amis et de ses ennemis, il a vu s'accomplir
tous ses vastes projets; sans lui, la constitution serait dj
faite, et peut-tre dj renverse. C'est lui qui la recule sans
cesse en
y
travaillant, et qui, par la profusion de son style,
la rend d'avance inexplicable. Tantt il prche la paix et
la. concorde, suivies dacalme et del tranquillit ;ia.nioi
il annonce la guerre, suivie dune victoire ou dune
dfaite
;
enfin, il parle tant que rien ne se fait, et que la
libert rg-ne toujours. Les amis de la rvolution ne savent
donc pas ce qu'ils demandent en soupirant sans cesse aprs
2l6 RIVAROL
la constitution
;
ils ne voient pas que ce n'est que par ellc
que le roi peut se relever, et avec lui l'ordre, la justice, les
lois, tous ces flaux d'un g-rand empire. Au lieu de bnir
le g-rand Tarqet et son ig-alimatias, ils le traitent sans cesse
de bavard et d'ig-norant : les ingrats !
TREiLHARD. Hounte avocat, mais dont le patriotisme a
t si brlant qu'il a effac ses talents au lieu de les faire res-
sortir. Sa faon de penser tait trop pure, pour qu'elle ne
perdt pas beaucoup tre exprime, et il n'y a rien en lui
que ses vertus n'aient fait paratre mdiocre. Gela explique
comment on n'a pu l'estimer et l'couter la fois, et cela
prouve, en mnie temps, que son peu d'esprit est dans son
cur. On l'a fait une fois prsident, pour l'encourg-er au
silence; il a rempli l'aug'uste fauteuil avec la plus heureuse
tranquillit
;
et moins de s'y tre endormi, on ne peut pas
s'en tre montr plus digne.
TABLE
De tous les noms des grands hommes de la rvolution,
Aig'uillon(d').
Alexandre de Lameth.
Antraigues (d').
Arn.
Artaud.
Auniont.
Bouille.
Barnave.
Barrire de Vieuzac.
Beaucur.
Beauharnais.
Beaumarchais.
Beaumetz.
Blin.
Biron.
Bordier.
Bouche.
Boucher
d Argis.
Brevet
de Beaujour.
Brissot de Warville.
Brog-lie.
Brousse des Faucherets.
Bureau de Puz.
Camille Desmoulins.
Camus.
Carra
.
Castelanne.
Chabot.
Crutti.
Champfort.
Charles de Lameth.
Chnier.
Cholet.
Cic.
Clavire.
Clermont-Tonnerre.
Condorcet.
Courtomer.
Croix (de).
Custine.
POLITIDUE
217
Danton.
Demeunicr.
Dinocheau.
Dionis du Sjour.
Dubois.
Dubois de Cranc.
Dupont.
Duport.
Ely.
Emmen.
Fabre d'Eg-lantinc.
Fauchet.
Fejdel
.
Frteau
.
Gart.
Garran de Coulon.
Gautier de Bianzat.
Grard.
Gerle.
Gorsas.
Goupil dePrfeln.
Gouttes.
Gouvion
.
Gouy d'Arcy.
Grg-oire.
Grouvelle.
Guillotin.
Hullin.
Humbert.
Jacques
.
Jess.
Julien.
La Blache.
La Borde de Merville.
La Clos.
La Coste.
La Fayette.
Lallv-Tollendal.
La Mandinire.
Lanjuinais.
La Poule,
La
Rochefoucauld.
La Touche.
Le Chapelier.
Le Couteulx de la Moraje.
Le Franc de Pompignan.
Liancourt.
Lusignan.
Luynes
.
Manuel.
Marat
.
Martel
.
Mathieu de Montmorency.
Menou
.
Mercier
.
Mirabeau
.
Mitouflet.
Montesquiou.
Moreau de Saint-Mri.
Morel.
Moreton
.
Narbonne
.
Necker.
Nicolas
.
Noailles.
Nol.
Orlans (d').
Ormesson (d').
Prigord
.
Ption de Villeneuve.
Peuchet.
Poix.
Populus.
Prud'homme.
Quatremre.
Quillard.
Rabaud de Saint-Etienne.
Rewbell
.
Robespierre.
Rderer.
Saint-Fargeau
.
Salmon.
i3
2l8
niVAROL
Saint-Huruge.
Treilhard.
Sievs. Turcati.
Silerj.
Valadi
.
Talon. Vauvilliers
Targ-et. Vilette.
Thouret. Volney.
Thuriotdela Rosire.
Au total i36 (i) grands hommes.
(i) En ralit i35, parmi lesquels nous en avons choisi 36.
FRAGMENTS ET PENSES POLITIQUES
PREMIER MMOIRE A M. DE LA PORTE
Remis le 25 avril ijgi
(Extrait)
Quoique je ne fasse pas grand cas des conseils rtroac-
tifs, et de yes^v'ii d'aprs coup, je ne dois pas cependant
ng'lig'er de faire un tableau raccourci de quelques faits
importants qui ont influ sur l'tat actuel du roi et de la mo-
narchie. Ce tableau servira :
lO
c jeter du jour sur ce que
j'ai dire, et donnera du poids au plan que je propose, en
prouvant que mes ides s'enchanent de loin, et tiennent
g-alement aux causes et aux effets de la rvolution
;
2
ce
tableau prouvera qu'on a toujours conseill au roi des actes
qui taient forcs d'avance, ce qui lui a fait perdre l'-pro-
pos de tous ses sacrifices. On ne saurait trop insister sur
cette vrit, afin de renoncer le plus tt possible une poli-
tique si malheureuse.
L'effroi de la banqueroute ayant ncessit un remde
aussi violent que les Etats-g-nraux, comment le roi ne
s'aperut-il pas d'abord que M. Necker le trompait? Ce
ministre avait dit et redit que la main seule de la nation
pouvait combler le g-ouffre du dficit^ et peine les dputs
sont-ils arrivs, qu'il leur parle avec mpris de ce dficit, et
prtend le combler avec du tabac en poudre et autres ingr-
dients de cette force. N'tait-il pas vident que ce ministre
trompait ou le roi ou les dputs ? Je communiquai cette
observation M. le comte d Artois, qui promit d'en faire
part Sa Majest.
Le discrdit o tomba brusquement M. Necker, aprs son
discours d'ouverture, tait un moment heureux; on n'en
profita point, et il ne fut renvoy que deux mois aprs.
220 RIVAROL
On sait avec quel dsavantag-e il a fallu que ce ministre,
qui n'avait pas de plan, mourt peu peu d'inaction.
Comme il ne s'tait picautionn que contre le roi, il n'a pu
rsister aux attaques.
Quant la dclaration du 23 juin, n'est-il pas vident
que, si elle et t donne six mois auparavant, elle et fait
perdre non seulement l'ide, mais jusqu'au dsir des Etats-
g-nraux ?
Vers les premiers jours de juillet, je proposai au marchal
de Brog'lie et M. de Bi'eteuil un parti dcisif. Je deman-
dai qu'au moment mme o l'Assemble nationale dispu-
tait l'arme au roi, Sa Majest vnt elle-mme Paris lui
disputer la nation. Qu'on juge de Teffet qu'et produit l'ar-
rive soudaine et volontaire du roi, proposant l'Htel-de-
ville les principaux articles d'une bonne constitution, et
faisant lui-mme une simple lg-itime de cadets aux prtres
et aux nobles, qui taient alors les heureux ans de la
nation. Cette dmarche, soutenue de quelques distributions
d'argent, aurait mis le roi en tat de sortir de Paris avec un
cortge de vingt trente mille hommes qui seraient venus
Versailles faire dcr':er par l'Assemble ce qui aurait t
dcid l'Htel-de-ville par le concours de la nation et du
roi. Le duc d'Orlans, qui je fis craindre cette dmarche
(lorsque je vis qu'on
y
renonait), en fut tellement effray
que l'abb Sieys m'a avou que le duc de Bironetlui avaient
vu le moment o ce prince allait se jeter aux pieds du roi.
Si, au Champ-de-Mars, le roi se ft avanc vers l'autel,
et, aprs avoir prt le serment, il et dit haute voix : a
Je
ne suis pas roi de Paris, mais roi de France
;
je veux m'ac-
compagner des fdrs et visiter avec eux mes provinces,
il parat certain que rien au monde n'et arrt l'enthou-
siasme des fdrs, que rien ne les et spars del personne
du roi.
Enfin, j'ai dit M. Delessert, le lendemain du jour o
Ton illumina pour la convalescence du roi, qu'il me semblait
urgent que Sa Majest profitt de cettemarque de tendresse
publique pour faire au peuple le sacrifice de tout ce qu'on
appelle aristocrates. Ce sacrifice, n'ayant pas t fait
propos, est aujourd'hui plus ncessaire que mritoire.
Tel est le systme qui a prdomin dans le conseil du roi,
systme qui consiste n'abandonner une main que lorsque
POLITIOUE
221
le bras est dj g-angren. Avant de parler du nouveau plan
qu'il faut substituer celui-l, disons un mot des aristocra-
tes, dans leurs rapports avec la fortune publique et avec la
situation particulire du roi.
Si tous ceux qu'on appelle aristocrates n'avaient fait la
grande faute de vouloir rsister, sans moyen, au torrent de
la rvolution, ils auraient, comme le roi, arbor la cocarde
de toutes parts, prt le serment, brigu et obtenu facile-
ment toutes les places, ils seraient aujourd'hui la tte des
districts; ils domineraient dans tous les clubs, mneraient
le peuple leur r, etc.; mais il fallait pour cela concevoir
un plan et le suivre; tandis que les uns se sont enfuis, les
autres .^e sont dclars contre la cour, et la troisime partie,
qui ne l'a pas quitte, lui a t plus funeste que ses plus
ardents ennemis. Quand le vaisseau prit, si tout le monde
se jette dans la chaloupe, elle prit aussi; d'ailleurs, le roi
ayant pris le parti de la douceur et de l'acquiescement tout
ne devait pas rester avec les vaincus : c'est runir tous les
inconvnients.
Aujourd'hui, les aristocrates prononcs ne sont bons
rien pour s'tre tromps sur tout; ceux qui sont rests
passent leur vie Paris, autour de trois mille tapis verts,
et se consolent par la perte de leurs cus de celle de leur
existence. Placs tous les jours entre le sabre et le rteau,
ils ont des bals et des concerts; et plus touchs de la rigueur
de l'hiver que de la rigueur des circonstances, leur unique
chagrin est de prvoir qu'il n'y aura pas de glace l't pro-
cham. En tout, la corruption a des effets plus cruels que la
barbarie. Les aristocrates ont succomb sous les dmocrates,
ar la raison qui fit tomber les Gaulois et les Romains sous
es fondateurs de la monarchie. Rgle g"nrale : toutes les
fois qu'on est mieux chez soi que dans la rue, on doit tre
battu par ceux qui sont mieux dans la rue que chez eux.
C'est le principe des rvolutions et mme des conqutes (i).
(i) Il avait dit dans le Journal Politique (I, i4)
'
Nous ne regar-
dons pas comme aristocrates les gens de cour et les nobles; ils n'ont
jamais t nos yeux que d"ennuyeux libertins Paris, ou des men-
diants talons rou^-es Versailles. El dans le m*me Journal (I.221 :
N'est-ce pas une drision que d'appeler aristocrates de pauvres e:en-
tilsbommes qui mettent leurs enfants l'cole militaire ou Saiut-Cyr,
qai passent leur vie mendier des secours dans toutes les antichambres
fe
niVAUOL
LETTRE DE M. LE COMTE DE RIVAROL
A M. DE LA PORTE
Remise le 3o septembre lygi.
En crivant, clans ma solitude, sur un objet aussi impor-
tant que celui de la souverainet du peuple, je n'ai pu
m'empcher de jeter quelques re^^ards sur la situation pr-
sente du g-ouvernement et de la nation. Je vous les commu-
nique, Monsieur, avec toute la franchise ([ue vous m'avez
inspire; mais je me souviens toujours de l'inutilit de mes
observations, l'oLiverture des Etats-gnraux, quand l'As-
semble, tire en sens contraires par quelques factions encore
faibles et tim.ides, ne demandait qu'une main un peu ferme
pour tre dirig-ce; je n'espre pas un plus heureux succs
pour mes rflexions actuelles. Les temps sont bien changs,
direz-vous, et la leon du malheur est quelque chose
;
je
conviens que cela doit tre, mais soyez sr, Monsieur,. que
la raison qui prvoit les disgrces^ et la raison qui peut les
rparer, sont galement mconnues, et toujours par les
mmes causes. Il
y
a une fatalit attache notre nature :
c'est que tout favorise en nous la maladie dont nous devons
prir, nos aliments, nos gots, nos habitudes, et jusqu' nos
raisonnements; mais la raison, quand elle se prsente, est
toujours traite de mdecine.
Deux choses me paraissent devoir empcher Sa Majest de
tirer une consquence pratique des Mmoires soumis ses
rflexions, et doivent aussi l'empcher d'adopter un systme
suivi : d'abord les souvenirs d'une vie passe dans un ordre
si dif'rent de celui qui existe^ et, en second lieu, les services
rendus par la coalition de quelques dputs de la premire
lsrislature avec les ministres.
En eflet, le roi, ayant t lev par la noblesse et avec la
noblesse, n'a pu tout coup se dtacher des intrts, des
passions et des maximes de cet ordre, et cela est naturel :
de Paris et de Versailles, et qui peuvent mourir dans les prisons pour
une dette de trois louis? One doivent dire les mag-istrats de Berne et les
Nobles vnitiens, en apprenant que l'ig'norance parisienne a fait des titres
de leur gouvernement une injure et un tort pendable? b
POLITIQUE
2 23
tout chang"e en nous et hors de nous, avant que nous chan-
gions nous-mmes. On ne se dfie pas assez des effets de
l'ducation. On ne se dit pas assez : que serais-je, si j'avais
t lev autrement? Mais, dans la personne de Louis XVI,
le roi devrait l'emporter sur l'homme : Alexandre aban-
donna les Grecs ds qu'il se vit roi de Perse.
Quant la coalition de quelques dputs avec le minis-
tre, je me contenterai d'observer que MM. Thouret, Cha-
pelier, Barnave, etc., ne peuvent, dans les conseils qu'ils
donneront, que mnager leur ouvrag-e, et apprendre aux
ministres , masquer les dfauts de la Constitution; ils
passeront leur vie lcher l'ours; ce qui est absolument
contraire au systme qu'il faut adopter, si on veut nous tirer
de l'anarchie o nous sommes. D'ailleurs, ces hommes-l,
s'tant dcris par les derniers dcrets qu'ils ont emports,
ont perdu la popularit, et ne peuvent influer en aucune
manire sur la nouvelle lg-islature, qui, tant le produit de
tous les clubs du royaume, est arrive absolument arme
contre eux. J'ajouterai cela qu'aucun de ces messieurs
n'est redoutable hors de la tribune : c'est de leurs poumons
que dpend leur empire.
A propos des dernires rjouissances de Paris, et des suc-
cs populaires de Leurs Majests, j'observerai, Monsieur,
qu'on pourrait bien compter sur le peuple, s'il tait aban-
donn lui-mme; mais ces transports n'ont fait qu'irriter
les rpublicains, et ces transports auront pass^ que la haine
de ceux-ci prendra de nouvelles forces, parce qu'elle est
systmatique et combine : l'enthousiasme populaire n'a
pas de racines. Je pourrais dire encore que la majorit des
aristocrates est aussi consterne de l'acceptation du roi que
tous les dmocrates, et que, diviss par ce motif, ils s'unis-
sent par la passion. J'en ai de fortes preuves. En un mot,
le roi peut dire qu'il aura combattre, auprs de son peu-
ple, les dmocrates, les aristocrates, les dpartements, les
clubs, et les ministres
;
comme autrefois le peuple avait
combattre auprs du roi, les commandants, les intendants,
toute la cour, et toujours les ministres.
Heureux les rois qui savent prendre les conseils amers,
et g-arder un conseiller qui dplat! Chercher un ministre
ag-rable, c'est comme si on voulait une matresse /"emme
d'tat.
224 RIVAROL
Je finis en vous priant de ne pas oublier celui qui ne
peut cesser de vous aimer.
Le comte de Rivarol.
PORTRAIT DU DUC d'oRLANS ET DE M^- DE G... (l)
(1793)
Tel a t ce prince que tous ses vices n'ont pu conduire
son crime; et tel est Teffet de cet affaissement total de nos
facults, fruit de la dbauche, de la flatterie et de tous les
poisons. Oui fut insensible la gloire, le devient l'infa-
mie. Les Mirabeau, les Laclos, le crime enfin avec tous ses
leviers, ne purent soulever cette me plong-e dans son bour-
bier : la haine, le mpris et toutes les tortures de l'opinion
furent impuissantes contre cette insensibilit, qui serait le
comble de la philosophie, si ce n'tait le dernier deg-r de
l'abrutissement et le symptme de la dissolution.
Nous l'avons vu au 6 octobre, dans les rues de Versailles,
entour d'assassins et caressant le fameux Coupe-tte :
c'tait la corruption mendiant le secours de la barbarie.
Mais il paya le crime et ne fut point servi : le conspirateur
n'tant qu'un lche, ses satellites ne furent que des voleurs,
et sa trahison ne trouva que des tratres.
C'est non seulement de tous les princes, mais encore de
tous les hommes, celui qui serait rest le plus profondment
enfonc dans le mpris de l'Europe, si l'opinion publique
n'avait dcouvert derrire lui une femme, conseil de ses
crimes ef me de ses conseils, instig-atrice de ses projets,
apolog-iste de ses forfaits et corruptrice de ses enfants :
femme qui ne l'a quitt qu' l'chafaud, comme une par-
tie perdue
;
car en effet le supplice de ce misrable fut bien
plutt la peine d'un dessein avort, qu'une satisfaction pro-
portionne pour les rois, pour les peuples et pour la morale.
C'est elle qui s'est charge du fardeau de sa renomme et
qui, se portant pour cause de tant de malheurs et de crimes,
ne lui laisse que le titre de vilinstrumentd'une furie qui vit
encore, sans savoir ni pleurer pour lui ni rougir pour elle.
(i) Genlis.
POLITIQUE 2 25
Une curiosit fatale et je ne sais quel intrt ml d'ef-
froi nous attachent malg^r nous ces productions mons-
trueuses qui paraissent certaines poques; on se demande
des dtails sur ces tres pervers qui sont en ce monde le
scandale de la providence
;
je ne serais donc pas surpris
qu'on voult ici le portrait tout entier de celle qui fut l'i-
mag-e complte du vice. Je le ferai en deux mots : jeune,
elle usa de sa beaut
;
vieille, elle trafiqua de son esprit.
Mais le ciel ayant refus le charme de l'innocence sa jeu-
nesse et la mag-ie du talent ses productions littraires,
elle n'a trouv que dans la rvolution de quoi se ddomma-
ger des outrag-es du temps et de cette avarice de la nature.
GNRALITS
La puissance est la force org-anise, l'union de l'ore-ane
avec la force. L'univers est plein de forces qui ne cherchent
qu'un org-ane pour devenir puissances. Les vents, les eaux
sont des forces
;
appliqus un moulin ou une pompe,
qui sont leurs organes, ils deviennent puissances.
Cette distinction de la force et de la puissance donne
la solution du problme de la souverainet dans le corps
politique. Le peuple est la force, le gouvernement est
organe, et leur runion constitue la puissance politique.
Sitt que les forces se sparent de leur organe, la puissance
n'est plus. Quand l'organe est dtruit, et que les forces res-
tent, il n'y a plus que convulsion, dlire ou fureur; et, si
c'est le peuple qui s'est spar de son organe, c'est--dire
de son gouvernement, il
y
a rvolution
.
La souverainet est la puissance conservatrice. Pour
qu'il
y
ait souverainet, il faut qu'il
y
ait puissance. Or, la
puissance, qui est l'union de l'organe avec la force, ne peut
rsider que dans le gouvernement. Le peuple n'a que des for-
ces, comme on Ta dit, et ces forces, bien loin de conserver,
lorsqu'elles sont spares de leur organe, ne tendent qu'
dtruire; mais le but de la souverainet est de conserver;
donc la souverainet ne rside pas dans le peuple, donc elle
rside dans le gouvernement.
On ne jette pas brusquement un empire au moule.
La loi est la runion des lumires et de la force, le
i3.
2 20 RIVAROL
f)eiiple
donne les forces, et le pfouvernement donne les
umires.
Les droits sont des proprits appuyes sur la puis-
sance. Si la puissance tombe, les droits tombent aussi.
Il faut au peuple des vrits usuelles, et non des abs-
tractions.
Les coups d'autorit des rois sont comme les coups de
la foudre, qui ne durent qu'un moment; mais les rvolutions
des peuples sont comme ces tremblements de terre dont les
secousses se communiquent des distances incommensu-
rables.
Dans une arme, la discipline pse comme bouclier, et
non comme joug".
Le peuple donne sa faveur, jamais sa confiance.
Les peuples les plus civiliss sont aussi voisins de la
barbarie que le fer le plus poli Test de la rouille. Les peuples,
comme les mtaux, n'ont de brillant que les surfaces.
La philosophie,tant le fruit d'une longue mditation
et le rsultat de la vie entire, ne peut et ne doit jamais tre
prsente au peuple, qui est toujours au dbut de la vie.
Il faut plutt, pour oprer une rvolution, une certaine
masse de btise d'une part qu'une certaine dose de lumire
de l'autre.
Il faut attaquer l'opinion avec ses armes : on ne tire
pas des coups de fusil aux ides.
La volont est une esclave robuste qui est tantt au
service des passions et tantt au service de la raison
;
c'est
un rthisme de toutes nos facults trop souvent produit
par les passions, car on ne peut que les concevoir absentes
de la volont, et nous ne voyons que trop souvent la raison
abandonne par elle. L'envie, la cruaut, l'ambition, veu-
lent; la raison prie ou commande. Les femmes abondent en
volonts. Un faible rthisme s'appelle vellit. Quand on
est pass de l'ge des passions et des sensations celui des
ides, on a peu de volonts, et c'est pourtant alors qu'on a
la tte politique.
Dans le corps politique, le gouvernement est le moyen
POLITIQUE
227
et la flicit publique le but. Mais, en dmocratie, le moven
et le but tant clans les mmes mains, le peuple ne s'occiipe
que du premier : c'est l'tat de la France; il lui faut un
matre.
Le corps politique est une ide multiple, une ide
complexe
;
il faut bien s'accoutumer ces sortes d'ides,
puisqu'au fond l'homme n'en a pas d'autres. L'homme ne
pouvant exister sans la terre, le corps politique ne peut exis-
ter sans la terre et l'homme. Un cavalier ne peut se conce-
voir sans le cheval, et l'quitation ne peut se concevoir sans
l'un et l'autre. La forme de la bride est force par les pro-
portions de l'homme et du cheval, comme la forme du g-ou-
vernement est force par les proportions du territoire et de
la population.
S'il est vrai que les conjurations soientquelquefois tra-
ces par des gens d'esprit, elles sont toujours excutes par
des betes froces.
Quand l'arme dpend du peuple, il se trouve la fin
que le g-ouvernement dpend de l'arme.
Quand un gouvernement a t assez mauvais pour
exciter l'insurrection, assez faible pour ne pas l'arrter,
l'insurrection est alors de droit comme la maladie, car la
maladie est aussi la dernire ressource de la nature
;
mais
on n'a jamais dit que la maladie ft un devoir de l'homme.
Il
j
a dans le corps politique une g-radation de rivalit
et d'mulation qui en fait l'harmonie, depuis le manuvre
jusqu'au g-rand propritaire, et du simple soldat au mar-
chal de France. Dans la double hirarchie des rangs et des
fortunes, chacun n'ambitionne que l'homme qu'il a devant
soi et qui ne le spare que d'un degr des dignits ou de la
richesse. Cette ambition est trs raisonnable; mais les phi-
losophes ont brusquement rapproch les deux extrmes en
opposant le soldat au g-nral et le manuvre au propritaire
;
ce contre-coup a tout renvers.
Le corps politique a un ct mainmortable
;
tout
j
est
viag"er, usufruitier, et voil pourquoi on disait : Le roi est
toujours mineur, et le domaine inalinable.
Les philosophes fondent souvent l'g^alit sur des rap-
228 RIVAnOL
ports anatomiques; ils concluent de ce que les nerfs, les
muscles et la config-uration extrieure sont les mmes, que
deux citoyens doivent tre gaux; mais gal ne signifie pas
semblable
;
le croire est une erreur funeste.
Un peuple veut beaucoup, et, par consquent, beau-
coup de choses contraires la prosprit du corps politique;
car tout peuple est enfant. Si, comme les Juifs, il quitte sa
terre pour suivre un chef dans le dsert, il faut des presti-
g-es pour le sduire et des miracles pour le sauver. S'il
nomme un gnral ou un roi, il n'y a de politique dans ce
grand acte que ce qui est ncessaire et forc, je veux dire
la nomination d'un chef; mais le choix de tel ou tel, s'il est
purement volontaire, est ordinairement mauvais.
Une sret entire, une proprit toujours sacre de
ses biens et de sa personne, voil la vraie libert sociale.
La libert hors de la socit n'emporte pas l'ide de
sret, et celle-ci ne peut se comprendre sans libert et sans
socit.
On demande toujours si les rois sont faits pour les peu-
ples, ou les peuples pour les rois. La rponse est toute sim-
ple : Les peuples sont faits pour le corps politique : car,
dans l'Etat, si le peuple est la portion la plus considrable,
le gouvernement est la pice principale
;
l'un et l'autre sont
faits pour le tout. L'aiguille dans une pendule n'est pas
faite pour les roues, ni les roues pour l'aiguille : le tout est
fait pour la pendule.
A prince dvot, confesseur homme d'Etat.
Les Etats despotiques prissent faute de despotisme,
comme les gens fins faute de finesse.
Il
y
a grande distinction faire entre la majorit arith-
mtique et la majorit politique d'un Etat.
La nature nous condamne tuer un poulet ou mou-
rir de faim, c'est l le fondement de nos droits
;
et voici la
fnalogie
des ressorts politiques : les besoins fondent les
roits et les droits fondent les pouvoirs
;
mais en France on
a donn au peuple des pouvoirs dont il n'avait pas le droit,
et des droits dont il n'avait pas le besoin.
A mesure que les superstitions diminuent chez un peu-
POLITIOUE
2?.9
pie, le g-ouverncment doit aug-mentcr de prcautions et res-
serrer l'autorit et la discipline.
En Angleterre, res[)rit public est plus sain; en France,
l'esprit particulier vaut mieux : de sorte qu'en Ang^leterre
vous trouverez plutt un meilleur peuple, et, eu France, un
meilleur homme.
Politesse dans Vinfriear^ sine de son tat; dans
le suprieur, si^ne de son ducation : aussi, malp^r la
livolution, celui-ci continue pour n'avoir pas l'air d'avoir
perdu son ducation, tandis que l'homme du peuple cesse
d'tre poli pour prouver qu'il a chang d'tat. Il brave, il
insulte, parce qu'il obissait autrefois, parce qu'il flattait :
c'est ce signe qu'il reconnat l'galit.
Le prince absolu peut tre un Nron, mais il est quel-
quefois Titus ou Marc-Aurle
;
le peuple est souvent Nron,
et jamais Marc-Aurle.
Dans les temps calmes les rputations dpendent des
hautes classes; mais dans les rvolutions elles dpendent des
l)asses, et c'est le temps des fausses rputations.
On sait que de dessus notre terre les m.ouvements des
autres plantes paraissent irrguliers et confus, et qu'il faut
se supposer dans le soleil pour bien juger l'ordonnance de
tout le systme : ainsi un simple particulier juge bien plus
mal du corps politique o il vit que celui qui est plac dans
le gouvernement.
Les lois de la nature sont admirables, mais elles cra-
-entbeaucoup d'insectes dans leurs rouages, comme les gou-
vernements beaucoup d'hommes.
Le plus grand malheur qui puisse arriver aux parti-
culiers comme aux peuples, c'est de trop se souvenir de ce
qu'ils ont t et de ce qu'ils ne peuvent plus tre. Rome
moderne se donna des tribuns et des consuls. Le temps est
omme un fleuve, il ne remonte pas vers sa source.
Un grand peuple remu ne peut faire que des excu-
tions.
Il
y
a des temps o le gouvernement perd la confiance
230 RIVAROL
du peuple, mais je n'en connais pas o le gouvernement
puisse se fier au peuple.
Un gouvernement serait parfait s'il pouvait mettre au-
tant de raison dans la force que de force dans la raison.
C'est une bont sotte et cruelle que de consulter les
enfants sur l'tat qu'ils ont prendre : il faut choisir pour
eux, et ne pas les jeter dans des indcisions qui leur font
perdre toute confiance en nous, sans leur en faire trouver
davantage en eux-mmes. Il en est de mme des peuples et
de leur gouvernement.
SUR LA RVOLUTION
Nous sommes le premier de tous les Franais qui cri-
vmes contre la Rvolution avant la prise de la Bastille
;
Burke le reconnut lui-mme dans son excellente lettre mon
frre qui a t publie (i), et nous nous en faisons gloire. Nous
l'osmes, et ce ne fut pas sans danger et avec espoir de r-
compense, car nous la trouvions dans notre conscience et
notre raison, cette poque o chacun ne voyait dans la Rvo-
lution que le grand bienfait de la philosophie, la runion
de tous les vux, le concert de tous les efforts et le fruit
de toutes les lumires. L'Assemble, forte de la faiblesse du
roi et fire de l'insurrection de Paris, ivre de ses succs et
de l'encens qui fumait pour elle dans les provinces et chez
l'tranger, abusait de tout avec fracas, et, dans cet tat d'-
blouissement, ne prvoyait ni les consquences de ses prin-
cipes ni les successeurs qu'elle se prparait.
Nous crivmes et nous parlmes inutilement en faveur
de la religion, de la morale, de la politique, et au nom de
l'humanit et de l'exprience de tous les sicles. Notre voix
se perdit dans la destruction universelle, nous nous tmes.
Notrejournal politique ne contient, en effet, que l'his-
toire des six premiers mois de la Rvolution. Tous les
grands coups taient ports. La raison, d'abord inutile, tait
dj criminelle.
Le roi tait prisonnier dans Paris, la noblesse
et le clerg dtruits et fugitifs. Les lois faisant place aux
(i) Voir Appendice,
% 3,
POLITIOUE 23 1
dcrets et le numraire aux assis;"nats, les jacobins taient
assembls: quelle ressource restait-il aux curs honntes et
aux bons esprits, quand tout tait espoir et perspective pour
les tous et pour les brigands ?II fallut donc quitter la France,
l'poque o les jacobins prfraient encore notre fuite
notre mort, et aller montrer nos misres des peuples et
des rois qui n'en taient pas fchs.
il arriva dans le g'ros de la nation ce qui arrivait en
mme temps dans l'arme. Les officiers, tout nobles qu'ils
taient, voulaient plus ou moins un changement. Leurs sol-
dats n'taient alors qu'automates, et quand ceux-ci devin-
rent dmocrates, les ofHciers se firent aristocrates, comme
s'ils n'avaient favoris la Rvolution que pour s'en faire
craser. Ainsi, en gnral, le clerg, la noblesse, les parle-
ments, ainsi que tous les gens connus, voulaient une rvo-
lution quand le gros de la nation tait tranquille; et quand
celle-ci, cdant leur impulsion, s'est rvolte, ils ont pris
la fuite ou pass l'chafaud. Je n'approuvais pas l'mi-
gration, et je ne sortis de France qu' la fin de
1791.
Le
roi le voulut ainsi : ma plume pouvait tre utile ses frres.
Je m'attends la mconnaissance des services rendus.
Si les vnements rvolutionnaires se renouvelaient
encore, les opprims ne chercheraient pas des leons de salut
dans nos crits, et les malfaiteurs chercheraient des modles
dans les manuvres des jacobins. J'ai vu en
1789
des mem-
bres de l'Assemble constituante chercher et lire avec em-
pressement Clarendon, qu'ils n'avaient jamais lu, pour
y
voir comment se conduisit le Long-Parlement avec Char-
lesP^
Au reste, je suis convaincu, car l'amour de soi et les
passions vivent toujours, qu'il n'y a de leons ni pour les
peuples ni pour les rois, et que, si Louis XVI a des succes-
seurs de sa race, ses fautes et ses malheurs ne seront pas
mme des avertissements pour eux
.
Au lieu des droits de Z'Aommg, il fallait faire lesprin-
cipes du corps politique. C'tait la tche de l'Assemble
constituante, qui, comme on sait, ne constitua que nos mal-
heurs; -mais elle craignit que les publicistes n'entrassent en
discussion avec elle d'aprs ce titre; elle aima donc mieux
armer toutes les passions, et surtout la vanit, en prenant
232 RIVAAOL
pour texte les droits de Vhomme, sans songer que ce titre
excluait toute espce de constitution. Aussi la Rvolution et
le germe de toutes les rvolutions se trouvent-ils dans la
Dclaration des droits, et la constitution qui les suit n'a pu.
prvaloir contre eux. Tous les pouvoirs, et le roi lui-mme,
ont pri pour avoir suivi la lettre de la constitution contre
l'esprit de rvolution. L'Assemble, au lieu de dire : Hoc
est
Jus,
a dit: Jus esto, et depuis elle fit autant d'outrages
sa constitution qu' la royaut.
Comme roi, Louis XVI mrita ses malheurs, parce qu'il
ne sut pas faire son mtier; comme homme, il ne les mri-
tait pas. Ses vertus le rendirent tranger son peuple.
Dans les gouvernements reprsentatifs, on aura toujours
dans les Chambres. comme le disait d'Urf des Provenaux,
des gens riches de peu de biens, glorieux de peu d'hon-
neurs et savants de peu de science.
Le grand mtaphysicien Sievs a pris contre-sens tous
les principes de la mtaphysique, quand il a pos son axiome
insens de la raison universelle, m.atresse du monde; il
carte toute la thorie des passions et les effets de l'igno-
rance.
Grande distinction entre la proprit et la souverai-
net: les rois avaient dans leurs dits des formules de pro-
pritaires et de despotes plus absolus qu'ils ne l'taient en
effet. Tout cela est fond sur le droit primitif de la con-
qute, sur ce qu'ils tendirent peu peu sur le royaume le
ton qu'ils avaient pris sur leur domaine, sur ce que, les
hommes valant toujours plus, les mots se sont trouvs trop
forts. Il fallait tre plus matre encore et avoir des formes
plus modestes. C'est l la sottise des rvolutionnaires: ils
auraient d cacher au peuple leurs forces, en leur imposant
des formes respectueuses envers le prince, et ces formes
auraient leur tour dguis au roi sa faiblesse.
Si vous eussiez consult tous les Franais avant les
tats gnraux, vous auriez vu que chacun voulait un peu
de la rvolution actuelle. Il semble que la fortune n'ait fait
que recueillir les voix pour la donner tout entire
;
chacun'
part dit : Cest trop.
Les philosophes disent que ce n'est point une guerre
POLITIQUE
233
d'homme homme, une luUe des factions el des passions,
mais un grand mouvement dans l'esprit humain. 11 faut les
prendre au mot, et la Rvolution n'est plus qu'une grande
exprience de la philosophie qui perd son procs contre la
politique. Rvolution vient du mot revolvere, qui signifie
mettre sens dessus dessous.
Les Franais ont mis la libert avant la sret. Cepen-
dant l'homme quitte les bois, o la libert l'emporte sur la
sret, pour arriver dans les villes, o la sret l'emporte
sur la libert.
Il
y
avait dans la nation, et il
y
avait toujours eu dans
l'Assemble de ses reprsentants, une majorit d'envieux et
une minorit d'ambitieux : car c'est le grand nombre qui
dsespre d'avoir les places, et les prtentions fondes ne
sont que pour le petit nombre; mais l'ambition veut obtenir
son objet, et l'envie veut le dtruire; et c'est cette envie de
la majorit qui l'a emport sur l'ambition de la minorit.
Les passions sont les orateurs des grandes assem-
bles.
La joie des rois en voyant les malheurs de l'auguste
race des I3ourbons, et celle de leurs courtisans en voyant la
misre des migrs, a t ineffable. Frdric disait: Nous
autres rois du A'ord, nous ne sommes que des gentilshom-
mes
;
les rois de France sont de grands seigneurs. Il
y
en avait bien assez l pour que l'envie attirt la haine, et
celle-ci des crimes peut-tre.
Les puissances, en
1789,
taient comme les colons qui
jasaient Paris sur la Rvolution, sans la prvoir Saint-
Domingue.
Au commencement de la Rvolution, la minorit a dit
la majorit : Mets-loi dessous
;
ensuite la majorit a dit
la minorit : Soyons gaux, et il se trouve que la ven-
geance est terrible.
Voltaire a dit : Plus les hommes seront clairs et plus
ils seront libres. Ses successeurs ont dit au peuple que plus
il serait libre, plus il serait clair; ce qui a tout perdu.
La noblesse oublia ce principe : les eodem modo
conservantur quo generantur. Les nobles ont d'abord
234
RIVAROL
dfendu leur esprit avec leur pe, et leur tat avec des
brochures.
Il
y
a une sin^'ullre parit entre la rvolution d'An-
g-leterre et celle de France : le Long--Parlement et la mort
de Charles l^^
;
la Convention et la mort de Louis XVI
; et
puis Cromwell etpuis Bonaparte. S'il
y
aune restauration,
aurons-nous un autre Charles second mourant dans son
lit, et un autre Jacques second quittant son royaume, et
puis une dynastie trangre ? C'est une ide tout comme
une autre que cette prvision
;
mais il faut recommander
la prvoyance ceux qui gouvernent. Charles P'' etLouisXVI
en manqurent absolument, et malgr leurs vertus ils pri-
rent sur l'chafaud. Les vertus d'un monarque ne doivent
pas tre celles d'un particulier : un roi hoiinte homme, et
qui n'est que cela, est un pauvre homme de roi.
Si Louis XVI tait mort les armes la main au
10 aot, son sang et bien autrement fcond les lis. L'cha-
faud et le silence du peuple seront toujours fltrissants
pour la nation, pour le trne, pour Timagination mme.
Bonaparte ft rellement, au i3 vendmiaire, ce que
Louis XVI fut accus faussement d'avoir fait au lo aot. Il
succda Robespierre et Barras, et cela n'tait pas diffi-
cile.
Bonaparte rgne pour avoir tir sur le peuple et pour
avoir rellement fait le crime dont Louis XVI fut fausse-
ment accus. La France roulait, de prcipices en prcipices,
vers un abme
;
elle s'est accroche aux baonnettes d'un
soldat : une poigne de soldats suffisaient. D'ailleurs, Paris
tait bien chang, il n'y avait plus de public : ce n'tait
qu'un vaste repaire avec une police.
Les Franais, las de se gouverner, se massacrrent
;
las de se massacrer au-dedans, ils subirent le joug de
Bonaparte, qui les fait massacrer au-dehors.
Nos potes ont voulu faire de Bonaparte un Auguste,
|
Sersuads
qu'ils seraient aussitt eux-mmes des Virgiles et
i
es Horaces. Il a moins d'esprit et surtout moins d'esprit
de suite qu'Auguste. Ses discours lui ont toujours fait tort:
il devrait mettre parmi ses gardes un
officier
de silence...
La fortune fait des hommes extraordinaires
;
le gnie seul
POLITfOUE
235
ot la conduite politique et morale font les grands hommes,
i^onaparte a laiss concevoir dos esprances; mais on ne
[)Ciit exig-er qu'il ait une ide plus haute que sa place.
Ce qui prouve que Bonaparte est suprieur Lannes,
\ev, Soult, Moreau, Bernadette, c'est qu'ils le servent au
lieu de s'en dfaire.
Un pouvoir exorbitant donn tout h coup un citoyen
ms une rpublique forme une monarchie ou plus qu'une
iiionarchie. Quand on succde au peuple, on est despote.
Bonaparte place mal ses haines et ses amitis : les
rgicides et les rvolutionnaires le perdront, s'il s'en entoure.
Il a plus de pouvoir que de dig-nit, plus d'apparence que
le grandeur, plus d'audace que de gnie, et il est plus ais
le le fliciter que de le louer.
Si la rvolution s'tait faite sous Louis XIV, Colin
?iU fait g-uillotiner Boilcau, et Pradon n'et pas manqu
Piacine. En migrant, j'chappai quelques jacobins de
mon Almanach des grands hommes.
Les Franais ont toujours eu du ^ot pour les tran-
:i'ers : preuve de leur jalousie
;
tmoin : les Ornano, les
Lroglio, Rose, Lowendhal, Saxe, Necker, Besenval, Bona-
parte.
Le despotisme de Titus, de Trajan et de Marc-Aurle
Hait aussi grand que celui de Tibre, de Nron et de Domi-
Llen. D'un signe de tte, ils faisaient mouvoir le monde
Minu depuis l'Euphrate jusqu'au Danube : ils taient des-
fcs, mais n'taient point tyrans. Montesquieu s*est tromp
L .et gard.
On me demandait, en
1790,
comment finirait la P.-
volution. Je fis cette rponse bien simple : Ou le roi aura
une arme, ou l'arme aura un roi. J'ajoutai : Nous
iurons quelque soldat heureux, car les rvolutions finissent
toujours par le sabre : Sylla, Csar, Cromwell.
Les coaliss ont toujours t en retard d'une anne,
d'une arme et d'une ide.
Il serait plaisant devoir un jour les philosophes et les
apostats suivre Bonaparte la messe en grinant des dents,
2t les rpublicains se courber devant lui. Ils avaient pour-
2 36
RIVAROL
tant jur de tuer le premier qui ravirait le pouvoir. Il serait
plaisant qu'il crt un jour des cordons et qu'il en dcort
les rois
;
qu'il ft des princes et qu'il s'allit avec quelque
ancienne dvnastie... Malheur lui s'il n'est pas toujours
vainqueur (i
j
!
Tout philosophe constituant est gros d'un Jacobin :
c'est une vrit que l'Europe ne doit pas perdre de vue.
(i) Rivarol est mort le ii avril 1801.
LIVRE III
PHILOSOPHIE
LETTRES A M. iNECKER
SUR SON LIVRE DE l'iMPORTANCE DES OPINIONS
RELIGIEUSES
(1788)
(Extrait)
J'ai souhait cent fois que, si Dieu
soutient la nature, elle le marqut
sans quivoque; et que, si les mar-
ques qu'elle en donne sont trom-
peuses, elle les supprimt tout
fait ; qu'elle dit tout ou rien, afin
que je visse quel parti je dois suivre.
PASCAL
.
Monsieur,
Vouscrivez pour clairer le monde; j'ai cru pouvoir vous
crire pour m'clairer avec vous. Si l'opinion g-ouverne la
terre, ceux qui dirigent l'opinion ne parlent et n'crivent
jamais impunment : ils sont responsables de leurs ides,
comme les rois de leurs actions; et tout homme a droit de
marquer sa surprise, lorsque M. Necker publie un livre de
mtaphysique qui doit dplaire g-aiement aux prtres et
aux philosophes, et qui peut tre condamn le mme jour
dans Genve, dans Rome et Gonstantinople.
Il est probable qu'un tel livre, n'tant qu'une harang-ue
en faveur du disme, et une paraphrase de ce vers si connu,
si Dieu n existait pas il faudrait r inventer, il est
^
dis-je,
238 nivAROL
probable qu'il serait tombe de vos mains dans l'oubli, si
vous ne l'aviez sin; mais on n'a pu supposer que M. Nec-
ker et fait un livre inutile, ni qu'il et affect sans raison
d'viter toute ide neuve; et la nation, qui et craint de
vous humilier par son indiffrence, a marqu pour vous
lire un empressement que la lg-ret de son caractre rend
plus flatteur et plus cher l'austrit du vtre...
Ce n'est pas sans une extrme dfiance que j'entreprends
.,
cette discussion, et que je la soumets vos lumires et au I
jugement du public. Si je n'tais rassur par l'importance
du sujet, je n'aurais jamais oppos mon obscurit votre
clat, et la simplicit de mon stvle la solennit du
vtre (i).
Vous annoncez d'abord que ce qui vous a port faire un
volume sur Vulilit temporelle des religions^ c'est que
vous avez reconnu que les philosophes, ne pouvant ni per-
fectionner la morale ni lui donner une base solide, il tait
temps de prcher au peuple l'existence d'un Dieu et de sa
providence.
Heureusement qu'en 'attaquant les philosophes vous
n'avez pas nomm la philosophie. Paris, vous le savez, est
la ville du monde o l'on a le mieux spar ces deux mots : L
ce n'est point la philosophie, c'est un parti qui fait les phi-
losophes. Les langues sont pleines de ces dlicatesses :
c'est ainsi qu'on peut fort bien 'connatre l'homme, sans
connatre les hommes. Il est donc trs heureux que vous
j
\.
n'avez point accus la philosophie de ne pouvoir nous donner
un cours de morale
;
ce serait attaquer la raison dans son
fort; ce serait insulter l'espce humaine; et il serait triste
j
j;
que, malgr tant de sujets de division, vous et M. de
Galonn fussiez tous d'accord : lui pour nous annoncer le
DFICIT des finances, et vous celui des ides.
Mais avant
d'tablir que la philosophie, qui est la raison sans prju-
gs, peut seule, avec le secours de la conscience, donner
aux hommes une morale parfaite, souffrez, Monsieur, que
je vous demande qui vous en voulez, lorsqu'au dix-
(i) Il est peut-tre utile d'avertir les jeunes gens qu'outre le style
simple, le tempr et le sublime, si connus et si bien classs dans les
rhtoriques de collge, on est forc aujourd'hui d'admettre /e style miniS'
triel, et ce qu'on appelle la prose potique. R.
I'
PHILOSOPHIE
289
liiiltlme sicle vous proclamez un Dieu vengeur et rmu-
iKTateur.
Ce n'est point aux gouvernements que vous parlez
;
car
i! n'en est point sur la terre qui ne soit de connivence avec
un CJlerg-, et qui ne veuille tenir sa puissance du ciel. Ce
n'est point aux peuples que vous prcnez
;
car votre livre,
qui peut-tre est dj Ptersbourg, ne parviendra jamais
dans votre antichambre (i)
;
sans compter qu'un peuple,
qui non seulement croit en Dieu, mais en Jsus-Christ, re-
jellcra toujours un ouvrage qui n'annonce qu'un Dieu pur
et simple. Une nation sauvage, par exemple, passerait fort
Lien de l'ignorance absolue, qu'on appelle tat dp pure
nature, la connaissance d'un suprme architecte, et pour-
rait s'y arrter quelque temps
;
mais une nation avance,
qui a aj un culte, ne rtrogradera pas
;
qui a le plus, ne
veut pas le moins. Or le peuple sait fort bien que non seu-
lement il n'est point de morale sans religion, mais encore
que sans religion, il n'y a point d'honnte homme
;
et non
seulement sans religion, mais encore sans la religion chr-
tienne, et surtout sans la religion catholique : car tout cela
se tient, et c'est l qu'on vous mnera toutes les fois que
vous avancerez qu'il n'est point de morale sans religion. Il
jst plus consquent, en eflet, de croire tout ce que dit un
prtre que de lui nier un seul article.
Enfin, ce n'est point aux philosophes que vous vous
idressez
;
car ceux qui ne seraient pas de votre avis ne
iherchent pas faire secte, et savent d'avance tout ce que
.eus avez dire sur le disme. A qui en voulez-vous donc,
vous ne parlez ni aux princes, ni au peuple, ni aux gens
nstruits ?
Peut-tre direz-vous que votre livre tait ncessaire dans
m sicle et chez une nation o l'on a attaqu, tantt avec
lrision tantt avec violence, la religion chrtienne et mme
(i) Je n'aurais mme pas publi cette lettre, si je n'tais assur de
cite vrit, que le peuple ne lit point, et surtout qu'il ne lit point les
luvrages philosophiques. Les lecteurs de toutes les classes sont riches,
lisifs ou penseurs : un livre de philosophie ne leur paratra jamais
lani^ereux. Voil pourquoi, dans un pays o la presse n'est pas libre,
n choisit toujours, pour veiller la librairie, des mae:istrats qui ne
nt point : car on a observ que moins un homme a lu, plus il croit
livres dangereux, et plus il est tent de mettre tout le monde son
Lrime. R.
24o
RIVAROL
l'existence d'un premier tre. Il aurait donc fallu nous don-
ner quelque arg-ument nouveau en faveur de la relig-ion,
ou quelque nouvelle preuve de l'existence de Dieu. Mais
vous vous contentez de recommander la morale vang--
lique et les crmonies de l'g-lise
;
et vous n'tablissez
l'existence de Dieu que sur le g-rand spectacle de la nature
et sur
l'vidence des causes finales. Gicron, Snque et la
foule des rhteurs aprs eux n'ont jamais manqu une seule
occasion
d'taler toute leur loquence ce sujet, et de
cacher la pnurie des ides sous l'abondance des mots.
Mais Pascal vous et rejet bien loin avec vos preuves
tires du spectacle de la nature, lui pour qui Dieu tait
moins probable que Jsus-Christ, et qui concevait mieux
qu'on pt tre athe que diste.
Il savait bien que la relig-ion n'a rien craindre des pre-
miers, et qu'au contraire elle ne saurait trop redouter les
autres.
Supposons en effet qu'un homme, aprs vous avoir lu,
vous tnt ce discours :
L'ternit du monde ne m'a jamais rpug-n comme
vous
;
son immensit ne m'effraye point, et je dis la na-
ture : Si ta m'offres
des espaces sans bornes,
Je
t'oppose
des sicles et des gnrations sans
fin.
Plac entre ces
deux infinis, je ne me crois point malheureux: j'admets
pour lments ternels l'espace, la dure, la matire et le
mouvement. Les g-ermes sems partout me dfendent de
croire que la nature ait commenc, ni qu'elle s'puise
jamais. Je vois que le mouvement, en exerant la matire,
lui donne la vie, qui n'est elle-mme qu'un mouvement
spontan : je vois que l'exercice de la vie produit le senti-
ment, et l'exercice du sentiment la pense, ainsi que l'exer-
cice de la pense enfante les hautes conceptions. Or, vie^
sentiment et pense^ voil la trinit qui me parat rgir
le monde. Toutes les productions de la terre s'abreuvent
plus ou moins de ce fleuve de la vie qui en fertilise la sur-
face. L'organisation plus complique des animauxen retient
plus que celle des plantes, et l'homme en est encore plus
charg qu'eux
;
c'est le diamant qui absorbe plus de lu-
mire que le simple cristal. Je vois donc qu'il n'y a de
mortel sur la terre que les formes et tous ces assemblages
d'ides que vous nommez esprits et mes. Je vois que le
PHILOSOPHIE
241
premier rayon de lumire qui entre clans l'il d'un enfant
et la premire g-outte de lait qui tombe sur sa lanq-ue
y
forment un premier jugement, puisqu'il sent que l'un
n'est pas l'autre. Autour de ce jug-ement se rassemblent
d'autres ides; etcomme on n'oserait qualiHer du nom d'ar-
me une poigne de soldats, on ne commence donner le
nom d'esprit ei d'me qu' un certain nombre d'ides. L'en-
fant indique lui-mme celle poque, lorsqu'aid du senti-
ment de son existence et de la foule de ses souvenirs, il
commence se distinguer de tout ce qui l'environne et
dire moi. C'est une plante arrive l'tat de fleur. Que cet
enfant prisse, il n'y aura de dtruit que la somme de ses
ides : son corps ira subir d'autres formes. C'est ainsi
qu'en brlant un livre ou un tableau vous perdez relle-
ment et sans retour lesprit et le dessein qui
y
sont atta-
chs
;
mais le matriel du livre et du tableau tombe en cen-
dres et s'lve en vapeurs qui ne prissent jamais. Je suis
donc plus sr de l'immortalit des corps que de celle des
esprits : d'ailleurs, Tesprit et le corps sont vraisemblable-
ment une mme chose; et celui qui connatrait fond les
secrets de l'anatomie rendrait compte de toutes les opra-
tions de l'me, puisqu' chaque dcouverte qu'on fait la
nature laisse tomber un de ses voiles. Si j'ai plus de peine
concevoir l'ternit antrieure du monde que son ternit
postrieure, c'est que mon me, ayant rellement com-
menc et craig-nant de finir, se figure aisment que l'uni-
vers a commenc, et qu'il pourra bien ne pas avoir de fin.
Nous sommes en naissant jets sur le fleuve de la vie; nous
ne voyons et ne concevons bien que la pente qui nous
entrane, et notre imag-ination en suit le cours. Mais, si
nous la forons remonter le fleuve, la fatigue nous g-agne
d'abord, et notre pense ne peut supporter le poids d'une
double ternit. Ces vrits g-nrales me suffisent; et je ne
conois pas que vous en soyez assez mcontent pour tre
oblig de recourir un Dieu qui, aprs avoir cr le monde,
ne cesse de soutenir et de rparer son ouvrag-e. Et quand
cela serait, quelle preuve en auriez-vous? O sont les titres
de votre mission? Du moins les Juifs, les Chrtiens et les
Mahomtans avouent que Dieu leur a parl, et qu'il a trac
lui-mme le culte et les crmonies qui lui plaisent. Mais
vous, toutes vos preuves se rduisent un sentiment vag-ue
14
d'esprance et de crainte : vous me faites du Dieu que vous
dsirez un portrait de fantaisie, et vous croyez lui plaire :
tandis que moi, voyant les mystres dont il s'est environn,
comme d'autant de gardes qui me crient, n approchez pas!
je me retire et je crois entrer mieux que vous dans ses v-
ritables intentions. Observons aussi, entre nous, que lesort
de Dieu a vari comme celui des hommes : quand les peu-
ples taient ig-norants et barbares, ils se contentaient de faire
Dieu tout-puissant, et par ce seul mot ils tranchaient gros-
sirement toutes lesdifticults. Mais, mesure qu'ils ont t
plus instruits, Dieu lui-mme leur a paru plus intellig-ent :
ils ont expliqu par les lois de la nature ce qu'ils regar-
daient auparavant comme une opration immdiate de son
auteur, et Dieu a rellement gagn du ct de l'intelligence
ce qu'il semblait perdre du ct de la puissance. C'est en
ce sens que Dieu est toujours prs de l'ignorant, tandis
qu'il recule sans cesse devant le philosophe, qui de jour
en jour le place plus loin et plus haut dans la nature, et ne
l'appelle lui qu' toute extrmit. Si je venais donc
admettre ce Dieu votre manire et le distinguer du
Grand-Tout, je n'en serais pas moins athe vos yeux, puis-
que la Providence ne serait pour moi que le nom de bap-
tme du hasard (i), et que Dieu lui-mme ne me paratrait,
comme tous les esprits faibles et paresseux, qu'une manire
commode d'expliquer le monde. Vous croyez vainement
humilier l'homme en lui parlant des bornes de son esprit.
Un oiseau qui voit semer du chanvre prvoit tout au plus
qu'il viendra de cette graine une fort de plantes; mais il
ne prvoit pas qu'on tirera de cette plante de quoi faire des
filets
;
encore moins prvoit-il qu'on en fera du linge, et de
ce linge du papier et des livres. Tel est l'homme : tmoin
des dmarches de la nature, comme l'oiseau l'est des sien-
nes, il en prvoit ce qu'il peut. Tout ce qu'elle lui offre tant
une jouissance pour les sens et un tourment pour l'esprit,
il se livre et doit se livrer avec ardeur ce double besoin
de jouir d'elle et de rtudier(2). Le dsordre dumoral vous
[i) Cette expression heureuse et familire est d'une femme dont on
ne peut piller que la conversation, puisqu'elle n'crit jamais.. .(Madame
de Crqui.) R.
(2, Cfsi sans doute la seule envie de faire du bruit ou de se moquer
de l'inepte question d'une acadmie de province, qui fit avancer Rous-
PHILOSOPHIE 24^
parat inexplicable : mais considrez que tout est ordre, paix
et symtrie dans le monde physique II est vrai qu'en pas-
sant des plantes aux animaux, et surtout l'homme, on
':v3mmcnce trouver le dsordre et la c;"uerre, et que s'ilexis-
'lit quelque tre mieux or^-anis que l'homme, il aurait des
Tassions encore plus terrijjles. Chacun tend soi : voil
i'orig"ine du bien et du mal. Voudriez-vousque les hommes
fussent sur la terre, immobiles et ranq-s commodes arbres
il ct l'un de l'autre? La paix serait trop chre ce prix,
l'n tout il ne faut pas vouloir tre plus savant que la nature;
cl si dans la socit vous tiez trop choqu de l'ing-alitdes
( onditions, convenez du moins que le bonheur est mieux
t'istribu que les richesses. Quant moi, je mne une vie
conforme l'ordre en suivant les lumires de ma raison,
('ommc Epicure, j'ai plac la vertu dans la volupt, afin de
la rendre plus dlicate et plus aimable, et de faire le bien
pour le plaisir mme de le faire; tandis que vous nesong-ez
(]u' viter un chtiment ou obtenir un prix. Je suis seu-
l'-ment fch que le nom mme de la vertu fasse la satire
de l'homme, puisqu'il sig-nifie effort.
11 me semble. Monsieur, que si un incrdule avait l'im-
politesse de vous pousser ainsi, vous pourriez tre embar-
rass, quoi que vous fissiez pour surprendre son irrligion;
mais le peuple se moquerait d'un homme qui n'allg-ue pour
;
'^gle de morale que l'utilit g-nrale des socits, pour mo-
if que l'intrt et le plaisir qu'on trouve faire le bien. Ce
systme est si nu, il parle si peu l'imagination, il suppose
tant de rflexions et de connaissances, tant de noblesse et
de rectitude dans l'me, qu'il ne conviendra jamais la
multitude. Ce n'est point ainsi qu'on mne les nations en
laisse : il
y
a dans le cur humain une fibre religieuse qu'on
seau que les sciences taient un mal. Cet excellent esprit sentait bien
que l'homme est n pour se y,erfec(ionner, et qu'ici le droit est fond
sur le fait. Si nous pouvions marcher sur l'eau,
aurions-nous invent
les barques? Si nous pouvions grimper les murailles, aurions- nous
recours aux chelles? L'industrie suppL-e la puissance, et l'art aide la
nature. Demander si c'est l un bien ou un mal, c'est demander en
dernier rsultat si le monde lui-mme est un mal ou un bien, et s'il ne
vaudrait pas mieux qu'il n'existt pas : c'est demander si la rhubarbe
est un poison ou un aliment. La rhubarbe n'est ni l'un ni l'autre : c'est
un remde. Les sciences et les arts sont aussi des remdes contre l'igno-
rance, et des ressources contre les besoins. R.
244
niVAROL
ne peut extirper; et voil pourquoi d'un bout de la terre
l'autre on nous inocule si facilement d'une relig"ion. Or les
prtres ont craindre que les distes appuient leur morale
sur la mme base qu'eux. Ils prchent comme eux un Dieu
bon et juste : ils s'attachent les curs par les mmes esp-
rances, par les mmes consolations: Ils se mettent la por-
te de tous les esprits : Timag-ination ne peut rsister
l'imposant tableau qu'ils font de la Providence et de l'ordre
qu'elle entretient dans l'univers : ils persuadent facilement
que Dieu fera pour un autre monde ce qu'il n'a pas fait
pour celui-ci : ils ont enfin sur les prtres l'avantae de la
tolrance. Et voil pourquoi la profession de foi du Vicaire
Savoyard, laquelle est un trs beau prcis de votre Livre,
a sduit les mes honntes et douces
;
tandis que le Livre
du systme del nature, ni-' aussi attrayant qu'il est
ennuyeux, n'a d entraner personne. Un systme qui te
l'immortalit l'homme pour la donner l'univers, qui
tablit que le monde n'a ni commencement ni fin, et qui
veut que tout plie sous la ncessit, ne fera jamais fortune.
Les hommes sont intraitables l-dessus, et c'est une chose
plaisante qu'en fait de gnalogie ils tremblent toujours de
rencontrer leur origine, et qu'en mtaphysique ils s'pui-
sent pour en chercher une l'univers. Toutes choses, dit
Pascal, sont sorties du nant et portes jusqu' l'infini.
C'est--dire, l'infinie grandeur, l'infinie petitesse, et
l'infinie dure
;
tellement que si l'homme aime croire que
le monde a commenc, il ne dsire pas avec moins d'ardeur
<jue son me soit immortelle : il craint d'aborder le nant
au sortir de la vie, et il s'en figure une autre au bout de
celle-ci, comme dans ses jardins il fait peindre des ciels et
des perspectives, afin de donner la plus courte alle toute
l'illusion de l'immensit.
DISCOURS
PRELIMINAIRE
DU NOUVEAU DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANAISE
(1797)
Extraits (i)
I. DU SENTIMENT COMME PRINCIPE DE TOUT DANS
l'homme et DANS LES ANIMAUX
Traiter de la parole, c'est parler de l'homme : ainsi,
quoique la nature de l'homme ne soit pas le but de nos
recherches, je ne peux me dispenser de jeter ici quelque
jour sur ce qu'on entend par sentiment^ afin d'arriver aux
sensations, aux ides, aux besoins et aux passions qui ne
sont que les modifications du sentiment. Cet lment de la
vie et de la pense, une fois connu et bien dtermin, pourra
donner nos dveloppements la force et la suite qui rsul-
tent de la clart et de la fixit.
Le sentiment ne se dfinit point : il serait toujours plus
clair que sa dfinition
;
mais il sert dfinir tous les ph-
nomnes de l'me et du corps.
Point de contact ou lien de l'esprit et de la matire; source
'? plaisir et de douleur; base d'vidence, de certitude et de
ute conviction
;
effet ou cause; principe ou rsultat, le
iitiment, quelle que soit sa nature, estle premier en ordre,
l le plus g-rand de tous les dons que Dieu ait fait ses
cratures : sans lui, l'animal ne serait que machine, la vie
ne serait que mouvement.
Considr comme facult gnrale, le sentiment s'appelle
'nsibilit : il a pour org"anes tous les sens, et pour sig"e
(i) Ce Discours, presque tout de philosophie, a reij-udaas les uvres
compl'eles le litre, qui lui convient mieux, de : L'Homme intellectuel
et moral. Nous en avons dj extrait un morceau, le Gnie et le Talent,
et divers menus fras:ments; mais sa place, comme uvre spare, est
dans celte section philosophique.
i4.
246
RIVAROL
l'homme tout entier. Mais comme il comprend la fois les
besoins et les sensations, les passions et les ides, il
j
aurait
eu de la confusion, si on n'avait assig-n la sensibilit
divers dpartements. On a donc reconnu et nomm d'abord
les org-anes et les sig-es particiUiers des besoins et des sen-
sations. D'un ct, la faim, la soif, le dsir mutuel des deux
sexes; de l'autre, la vue, l'oue, l'odorat, le g"ot et le tou-
cher, ont eu leurs instruments et^leurs places : la douleur
et le plaisir physiques ont rg-n partout.
Mais quel lieu, quels org-anes assig-ner l'amour moral,
la soif de l'or, la joie, au chag-rin, enfin tout ce qu'il
y
a d'intellectuel dans les passions et dans les ides? Cha-
cun sentait, en effet, que les passions avaient un ct idal
que n'ont pas les besoins, et qu'il
y
avait dans les ides un
ct purement intellectuel que n'ont pas les sensations. Il
fut donc ncessaire de partag-er l'me en deux sig-es prin-
cipaux : les ^ens du monde lui assignrent V esprit et le
cur; les philosophes, Ventendement et la volont : l'es-
prit ou l'entendement, chez qui les sensations se changent
en ides
;
le cur ou la volont, chez qui les besoins devien-
nent passions.
]Mais, si les besoins et les sensations changent de nom en
perdant leur ct matriel, le sentiment ou la sensibilit en
gnral n'en change pas. On dit, un cur, un ouvrage, un
mot, une pense, un geste, un regard, pleins de senti-
ment ou de sensibilit. On s'exprime de mme sur les dif-
frentes parties du corps affectes par le plaisir ou la dou-
leur : on dit, la sensibilit de la peau, e Voeil, de Vesto-
mac; on a des sentiments de goutte, comme des senti-
ments d'amour ou de haine
;
on perd tout sentiment, tant
au physique qu'au moral. Et comme ce mot est commun
l'me et au corps, il prend toutes les pithtes propres
l'une et l'autre. Le sentiment est noble et vif, bas et fai-
ble, obscur, sourd, exquis, grossier, dlicat, tendre, violent,
etc. Ainsi l'homme tant eralenient sensible au dehors et
au dedans, le sentiment reste, au sein des fonctions, des
facults, des puissances, des modifications, et enfin de tous
les mouvements du corps et de l'me, principe universel et
particulier, matriel et intellectuel la fois.
C'est de l que vient l'universalit du verbe sentir, qui
s'applique tout, tant au moral qu'au physique. Je sens
l'HILOSOlMIlE
j.[\-J
que
f
ai raison, que
Je
souffre, que je meurs :
Je
sens
que ces corps sont durs; que ces fableau.T, ces bouquets,
CCS ragots, ces accords sont bons. Ainsi le verbe sentir
remplit lui seul les fonctions des verbes voir, toucher,
jlairer, our, goter
;
mais cela n'est pas rciproque; car
si le mot sentir est commun tous les sens, il est tellement
j).irticulier au sentiment que ce n'est que par emprunt
([uc l'odorat et le toucher paraissent s'en tre empares exclu-
sivement. 11 n'y a que l'il, l'oreille et le palais qui f^ent
I
iiacun un verbe pour exprimer leurs fonctions. Sentir par
1' s yeux, c'est voir : sentir par l'oreille, c'est our ouenten-
dre : sentir par la bouche, c'est goter. Mais comme on
l
ut Jlairer et toucher sans sentir, il est clair que l'odo-
rat et le tact manquent de verbe. Ils ont donc emprunt le
ihc sentir. Les Italiens dsoni sentir par l'oreille : ^ai
iti un bruit, j'ai senti dire. Quand on dit,
Je
sens quel-
>iiif odeur, ou
Je
sens un corps dur, c'est qu'on a dj
Jlair l'une et touch Vautre. Et pour en venir aux exem-
ples cits, je ne ne dirai pas plus :
Je
Jlaire ou
Je
louche
que
Je
suis malade et que
J^ai
raison, que je ne dirai :
/entends ou
Je
gote que
Je
suis malade et que
J'ai
rai-
vo/z,
parce que la douleur et la raison appartienent au sen-
timent en g-nral, et non tel sens en particulier. Donc le
verbe sentir n'appartient que par emprunt l'odorat et au
;cher. Il n'y a de privilg-i que le verbe voir^ qui s'em-
'i.e si souvent pour sentir, et rciproquement
;
puisqu'on
lit. /e vois ou je sens que ce btiment penche;
Je
vois
'1
Je
sens que
J'ai
raison,
-Je
vois ou
Je
sens que
Je
pris.
la vient de ce que l'il a t l'emblme de l'entendement,
iui
semble voir les objets quand il les sent; d'o sont dri-
^''s les mots clart et vidence, qui se disent d'une pro-
sition aussi claire l'esprit qu'un objet extrieur et bien
l'air l'est aux yeux.
Observez que les mots sentiment, sentir, sens, sensible
t insensible, sensibilit et insensibilit, s'appliquant
Dur tour au physique et au moral, ne sont jamais au
g'ur, tant qu'il s'afit des tres vivants, quelque matriel
)u quelque immatriel que soit l'objet dont on parle. Ainsi
'esens une belle rose, oi
Je
sens une bonne raison, sont
;galement au propre.
On demandera peut-tre si le sentiment, comme prd-
248
UIVAROL
cesseur des sens, leur a donn son nom
;
ou si c'est eux
que le sentiment doit le sien. Je rponds cela que le rg-ne
<u sentiment pur est trs courtdansl'enfantqui vient de na-
tre, et que Ihomme n'ayant form la parole qu'aprs avoir
exerc tous ses sens, ils ont d naturellement lui fournir
des mots et des expressions pour tout nommer, pour ex-
primer le sentiment lui-mme; comme ils en ont fourni
pour la raison appele sens commun, et pour la conscience
nomme sens intrieur on sens intime; comme ils ont fait
le verbe sentir et toute sa famille. Mais il n'en est pas
moins moins vrai que le sentiment a prcd toute sensa-
tion, quelles que soient l'poque et l'origine du nom qu'il a
reu.
Si je dis que le sentiment est antrieur toute sensation,
et par consquent toute ide, c'est qu'en effet il date de
l'org-anisation.
Ds qu'on admet qu'un animal nat sensible et affam,
tout autre phnomne compar celui-l n'a plus droit de
surprendre. Nous sommes tous, hommes et animaux, com-
poss de besoins et d'ides
;
mais les besoins ont prcd.
Tout animal souffre intrieurement avant de toucher ou
d'tre touch, par consquent avant d'avoir une sensation,
et enfin une ide. L'enfant peut avoir faim, avant d'avoir
got d'une nourriture quelconque; et le jeune homme,lev
loin des femmes, n'en serait pas moins tourment d'amour
l'poque indique par la nature. Ce double sentiment de
la faim et de l'amour serait puissant et vague la fois; il
serait, en un mot, besoin sans objet ou sans ide. On a
donn cet tat le nom d'inquitude.
S'il est vrai que l'animal qui vient de natre puisse souf-
frir autant de la privation de certaines choses, que jouir de
i
leur possession, il reste dmontr que le sentiment doit ga-
lement exister avec et sans objet; avant, pendant et aprs
les premires sensations. Mais le sentiment qui a lieu dans
la privation est, pour la premire fois, un sentiment sans
ide
;
ce n'est qu'un tat de malaise indtermin. En un
mot, les organes sont souffrants, mais ils sont sans em-
preinte : il
y
a sentiment et non pas sensation. L'estomac a
faim en gnral, sans avoir faim de telle ou telle chose en
particulier; aussi dit-on le sentiment et non la sensation
de la faim.
PHILOSOPHIE
249
Mais ds qu'une fois les sens ont livr passag-e un objet
M'Iconqiie
;
ds que l'iin pression s'est faite sur, le senti-
:it,il
y
a sensation dtermine, empreinte dans l'organe,
un mot ide.
'
>n voit de l que le mot sentiment appartenant deux
ts aussi opposs que la ralit des sensations et que leur
rivation absolue, ce mot a d ncessairement rester un peu
;iue, puisque, d'un ct, Tabsence, la privation et les
esoins; de l'autre, la prsence, la jouissance et les ides
rveillent g-alcment : mais s'il est vrai que toute sensa-
1 nous vienne du sentiment excit par les objets, il est
iiix que le sentiment ait les objets et leur action pour ori-
!ne : ce sont ses occasions et non ses causes. On connat
0110 les objets, les org-anes et les et'ets du sentiment
;
on
: nore jamais son poque, sa source et sa nature : elles
perdent dans l'intime union de l'me et du corps, c'est--
ire, dans la nature intime de l'homme (i).
Kn effet, sans l'me, le corps n'aurait pas de sentiment;
^ans le corps l'me n'aurait pas dcsensafions. Mais l'me
vantla majeure part dans ce commerce, on lui a fait pr-
iL de tous les g-enres de sensibilit intellectuelle Ainsi,
Il dit qu un homme a de l'me, qu il est lame d'une
ssemble, qu un ouvrage est plein dWme
;
les artistes
ix-mmes ont emprunt cette expression pour peindre
ut ce qui vivifie leurs productions, ou mme tout ce qui
1 aug-mente le ton et la vigueur, et comme il parat que
est dans le cur, ou autour du cur, que rg-nent, comme
ir un sig-e matriel, le sentiment et ses motions, la sen-
i)ilit et ses treintes, les passions et leurs orag:es
;
de l
nt venues tant d'expressions, tant de i^estes et de reg'ards,
le cur joue le premier rle
;
tandis que la tte, comme
t'ire matriel de l'entendement, a pour apanage l'esprit et
(i) On sent bien que les mots, esprit et matire, corps et me n'ont
c crs qu'en opposition l'un de l'autre. Si l'on n'et admis que la
Dominalion de realits, ou d'tres de choses, on aurait vu la nature
lie qu'elle est, pleine de choses tendues, divisibles, vivantes, sensibles,
c. Alors les mots opposs de matire el d'esprit tomberaieot, et ce
rait un ^rand pas en mtaphysique. Locke, en attaquant cette propo-
tion des cartsiens, que l'me pense toujours, dit fort scnRment :
ime aurait donc des ides que l'homme if/norerail? D'o Von voit
le le mot homme aurait mieux accommod Locke en tout et partout. Il
y
a en effet, dans l'homme, d'autre personne que l'homme mme. R.
25o niVAROL
les ides, la pense et le raisonnement , la mditation et le-
mthodes, c'est--dire, l'imag-ination et ses formes, 1
mmoire et ses sig-nes, le jug'ement et ses balances.
Puisque le sentiment nous a conduits si directement ;
l'union de Tme et du corps, je dois m'arreter un moment
sur les divisions connues de ces deux moitis de l'homme.
L"me, connue par ses effets et non par sa nature, est
dans nous, comme dans tous les animaux, ce qui anime le
corps. Elle emporte tellement l'ide de vie et de sentiment
que ces deux mots sont souvent synonymes avec elle. Comme
vie, elle entretient l'org-anisation
;
comme sentiment, elle
est, ainsi qu'on l'a dj vu, sig-e des besoins et des pas-
sions, des sensations et des ides. C'est elle qu'aboutis
sent les impressions : c'est d'elle que partent les volonts.
C'est l'me qui conoit, aime, dteste, craint, espre, dsire,
se souvient, imagine, compare, choisit, raisonne et juge
Ses fonctions sont si diffrentes qu'on en a fait autant d
facults, et, pour ainsi dire, autant d'tres distincts. Mai>
pour ne pas tomber dans cette erreur, il faut se bien dire
que Tme, aprs avoir sen ti l'impression des objets, les
retient comme mmoire,les retrouve ou les compose comme
imag-ination, les compare et prononce comme jug"ement :
que ces trois g-randes facults sont toujours l'me, et ont
pour nom commun la pense, qui ri'estqu'une long-ue appli-
cation du sentiment sur les ides : attribut d'ailleurs si
considrable que la pense est souvent prise dans le dis-
cours pour Pme elle-mme. Mais s'il n'y a que l'me qui
pense, l'me ne sent pas seule
;
le corps partag-e avec elle
le sentiment : ce mot ne lui appartient donc pas exclusive-
ment, comme la pense. En un mot, ce n'e.st point l'me,
ce n'est point le corps, c'est l'homme qui sent.
iMaintenant.pournepas s'g-arer dans ces dcompositions,
il faut se rsumer et revenir sur ses pas.
Nous avons dit que si Thomme s'analyse lui-mme, il
se partag-e d'abord en corps et en me
;
que s'il analyse
son corps, il
y
distingue les sens, les org-anes , les
be.soins et le sentiment : que, s'il analyse son me, il
y
trouve l'entendement et la volont, ou bien l'esprit et le
cur,et toujours le sentiment; que s'il poursuit ses ana-
lyses, il trouve dans le cur les dsirs et les passions de
toute espce
;
dans l'esprit, l'imag-ination, la mmoire et le
1
PHILOSOPHIE
25l
jugement, c'est--dire, tous les ^s^enrcs de pense
;
mais
toujours et partout le ^sentiment. Enfin, si l'homme, aprs
s'tre ainsi dcompos lui-mme, veut se recomposer; si
aprs avoir dit mon corps et mon me, mon esprit et
mon car^ il veut se nommer tout entier, il dit moi; et
c'est eneifct dans ce noi, qui runit le corps et lame, que
rside le sentiment. Les besoins et les sensations, les passions
et les ides ne sont que ses modifications : il est tout entier
dans chacune des divisions de l'homme, tout entier dans
le moi qui en est l'unit : car si l'me et le corps avaient
chacun un sentiment diffrent, comme l'assure Buffon, il
y
aurait deux personnes dans le moi, ce qui n'est pas (i).
Condillac dit trs-bien : Malg-r toutes les modifications
qui se succdent perptuellement dans moi, je sens pour-
ce tant que ce moi est un fonds certain qui ne chang-e pas.
Mais comment, aprs avoir si bien exprim cette vrit,
Condillac a-t-il pu errer, en accusant, d'ailleurs avec rai-
son, les cartsiens d'illusion, Locke d'obscurit, et Aristote
de n'avoir pas assez dvelopp son principe? Voici, en peu
de mots, l'tat de la question.
Aristote a dit qu'il n'y avait rien dans l'entendement qui
n'et pass par les sens : les cartsiens, au contraire, ont
soutenu que tout prexistait dansrme,et que les sensations
ne pouvaient que rveiller les ides. Locke a paru et a dit,
Bue
tout venait des sens et de la rflexion : Condillac a
montr, contre lui, que la rflexion n'tait pas pour les
'ides une source diffrente de la sensation; mais il veut, de
jplus, que le sentiment n'ait commenc qu'avec la premire
Sensation, et il ajoute: Si l'homme n'avait aucun intrt
s'occuper de ses sensations, elles passeraient comme des
ombres, et ne laisseraient pas de traces. Il serait, aprs
* plusieurs annes, comme au premier instant, sans avoir
acquis de connaissances, et sans avoir d'autres facults
<( que le sentiment. )) Comment cet excellent esprit, qui
pavait bien qu'une facult qui ne serait qu'branle par les
'objets, ne serait pas diffrente d'une corde de violon, qui
rend des sons dont elle ig-nore l'harmonie, comment, dis-je,
i) L'homme a deux principes intrieurs, l'un animal et l'autre spiri-
tuel, ce que dit Buffon, dans son Discours sur les Animaux. Mais
lia conscience dit que si l'homme est compos de deux substances, il n'a
qu'un principe pour les deux, et c'est le sentiment. R.
RIVAROL
n'a-t-il pas vu que cette facult sans intrt ne pourrai
s'appeler sentiment, et ne saurait s'associer rien? Il
y
plus; si le sentiment n'et commenc qu'aprs la premier
sensation, qu'aprs qu'on aurait, par exemple, senti un
odeur quelconque, chaque sens et son tour commenc
u;
sentiment particulier, et nous aurions eu autant de senti
menls diffrents que de sens, et par consquent cinq per
sonnes dans un corps : il n'y aurait donc pas eu de moi
Mais cela n'est pas vrai; nous avons des sensations diff
rentes, mais nous n'avons pour toutes qu'un sentiment
Cette facult premire a tout prcd dans nous, et n'y .
t prcde par rien, pas mme par l'existence. Del vieD
que nous avons le sentiment des ides, sans avoir l'ide di
sentiment; parce qu'en bonne mtaphysiquela pense arriv
de dfinitions en dfinitions jusqu' une chose qui ne s
dfinit pas
;
comme en physique on s'lve d'effets en effet
une cause qui n'est pas effet; et comme, en saine logi
que, on remonte de consquence en consquence, jusqu
un principe qui n'est pas lui-mme consquence.
Si Aristote revenait au monde, il pourrait dire GoD
dillac : Pourquoi m'accusez-vous de n'avoir pas senti tout
la fcondit dmon principe ? Je ne Tai pas dvelopp, j'e
conviens : mais vous qui n'avez pas ce reproche vous faire
vous qui vous tes dvelopp en plusieurs volum.es, vou
n'tes pourtant pas remont assez haut, et je vous accus
d'tre la fois insuffisant et prolixe.
Il rsulte de tout ceci deux vrits importantes : l'uu
que Condillac, que je viens de citer, a eu tort d'avance]
dans son Trait des Sensations, que l'homme apprend
sentir
;
car si cela tait vrai, l'homme apprendrait le plaisi
et la douleur
;
et chacun sent dans sa propre conscienc
|
combien un tel principe est faux. Ce jg-rand mtaphysicie
ne l'aurait point tabli, si, au lieu de commencer par L
sensations, il et dbut par le sentiment.
L'autre vrit est que si les sensations, et par consqu
e
les ides viennent du dehors, les besoins viennent du de
dans : d'o il suit que les besoins sont inns comme le ser
timent, et que les ides ne le sont pas comme lui : distine
tion qui peut seule concilier ceux qui disputent encore su
les ides innes : il ne faut souvent que diviser une questio
pour rapprocher les hommes.
PHILOSOPHIE
253
ir. DFS ANIMAUX
Me voici enfin parvenu la li^'-nc de dmarcation qu'a
cela nature entre nous et lesaiiiniaux
;
ptris des mmes
inents, sensibles comme nous au plaisir et la douleur,
iiime nous sujets la mort, et tour tour nos ennemis et
s victimes, nos esclaves, nos compag-nons et nos amis.
Oue riionime, debout sur la terre, s'enorg-ueillisse de ce
j>i)rt majestueux qui annonce son em.pire, et de cette raison
|ui lui en confirme la dure; mais qu'il ne mprise point
h s animaux, en allectant de la piti sur les bornes de leur
instinct, ou sur les formes dont la nature les a revtus :
iv ce n'est ni sur la beaut, ni sur le ^nie, qu'elle a me-
Niirc le bonheur.
\'oyez le sentiment jet dans les airs au fond des mers et
la terre, toujours content de son enveloppe et de ses
'
irmes; couvert d'corce, de plume, de poil ou d'caill
;
.ju"il vole ou qu'il nag-e; qu'il marche, qu'il rampe, ou qu'il
reste immobile; toujours heureux d'tre et de sentir, et
toujours rpug-nant sa destruction. Semblables des vases
liii^aux parleur forme et leur capacit, mais g"aux parla
plnitude, tous les tres anims sontg-alement satisfaits de
leur ])arlag'e; et c'est du concert de tant de satisfactions et
le flicits particulires que se forme et s'lve vers le pre
universel l'hymne de la nature.
(^e pre des hommes et des animaux a fait de tous ses
; fants d'industrieux esclaves qui trouvent leur bonheur
. mplir les commissions qu'il leur a donnes; et tel est en
llet le bonheur attach ces fonctions que, pour les mieux
orcer, les animaux ne craignent ni soins, ni peines, ni
illes, ni courses, ni dang-ers; et que, de plus, l'homme a
ept le travail qui le met en tat de les excuter. De sorte
1 il ne travaille que pour mieux obir; qu'il prit d'ennui
u de douleur, lorsqu'il ne peut remplir ces commissions
;
]u'il est l'aise et se croit libre en les remplissant, et que
malheur et l'esclavage commencent pour lui, ainsi que
lur les animaux, quand les commissions leur viennent
Tailleurs que de la nature, souveraine et mre la fois, qui
illie sans cesse la ncessit la libert
;,
les chanes aux
lsirs et l'empire l'amour !
Cependant, il faut que je l'avoue, assis au mme banquet,
i5
254
RIVAROL
l'homme et les animaux, irrits parleurs passions, se dvo-
rent les uns les autres, convives et victimes la fois.
Par celte anthropophagie universelle s'accomplit la grande
loi des compensations, qui, balanant l'exubrance des
reproductions par la frquence des destructions, et la vie
par la mort, retient dans ses justes limites la population de
l'univers.
Dieu, ayant donn ses cratures une norme impulsion
de fcondit, a d la restreindre dans ses effets, puisqu'il
ne voulait pas la borner dans ses causes, et absorber les
eaux dans leurs cours, plutt que de les tarir dans leur
source. D'ailleurs, puisqu'il ne fallait pas moins qu'une
pture anime pour entretenir la vie, la main qui cre et
nourrit a d prodiguer les animaux pour multiplier les
aliments. Sur larbre qui bourgeonne elle a fait clore l'in-
secte qui doit dvorer la fleur et loiseau qui doit dvorer
l'insecte. C'est ainsi qu'elle oppose la multiplication des
uns et la fertilit des autres, et qu'elle fonde l'conomie sur
l'ordre et 1 ordre sur l'abondance.
Aprs avoir gradu la douleur sur l'chelle de la sensi-
bilit, et conduit la vie et le sentiment par des passages
insensibles_, depuis la plante jusqu' Tanimal le plus parfait,
la nature, en arrivant l'homme, a tout coup rompu la
gradation, et laiss une lacune immense entre nous et les
animaux, de peur que Thomme, ayant la sensibiht par ex-
cellence, ne rpugnt trop dvorer des cratures qui sen-
tiraient et penseraient avec lui et comme lui. Nous sommes
(( trop heureux, s'crie un ancien, que Dieu nous aitinterdit
(( tout commerce d'esprit et de cur avec les animaux, en
leur refusant la parole: quel barbare voudrait plonger ses
(<: mains dans le sang d'un agneau qui lui dirait : que vous
ai-je Jait
(i)?
On objectera que, sans compter l'Amrique, qui tait toute
anthropophage lpoque de sa dcouverte, il est encore
des pays o les hommes se massacrent et se mangent. Je
rpondrai que ce ne sont point les besoins naturels, mais les
passions qui poussent l'homme cet norme outrage envers
l'humanit
;
et ces exemples s'expliquent, ainsi que les atro-
cits des guerres et des rvolutions, par le principe que
(i) Porphyre
;
ce philosophe plalonicien vivait au troisime sicle. R.
t>HiLosopHiE
a95
nous avons dj tabli, que la providence a mieux aim
exposer l'homme aux orales des passions que d'aflaihlir
dans leur source ces forces vivifiantes, sans qui ses cralu-
les n'auraient t que des automates," sansqui tout ne serait
(jue faiblesse ou lan^-ueur dans la nature anime. C'est ainsi
qu'elle aime mieux livrer les cits, les forts et les mers aux
(
"ups de la foudre et k la fureur des temptes, que de
iiminuer le ressort lastique de l'air et la puissante activit
(lu feu. Enfin ce n'est pas le compas et l'querre qui ont
prsid seuls l'or^-anisation des tres qui devaient sentir,
aimer, jouir et souffrir
;
et comme il n'y aurait pas de vic-
toire s'il n'existait pas d'ennemis, point de clmence sans
injure
;
de mme le monde sans passions et t sans vices
et sans vertus.
II
y
a plus : si, par la loi qui dispense et compense tout,
les passions ne se bridaient pas rciproquement, il
y
aurait
dj eu destruction d'espces, ou intervention de Dieu
pour arrter la dpopulation du g^lobe. Mais l'ouvrag-e n'a
]ias pri, l'ouvrier n'est pas intervenu;
ses plans taient
donc fonds sur la plus haute sag-esse.
Pour entrevoir, quoique d'un peu loin, cette providence
qui, selon l'expression de Snque, n'a command qu'une
lois pour gouverner toujours, il ne faut que comparer un
moment ses x)uvraes et les ntres. Si, par exemple, la pre-
mire montre sortie des mains de Ihomme et produitd'au-
ties montres, il n'aurait fallu qu'un horloger sur la terre:
mais nous ne donnons que le mouvement nos machines; la
nature donne aux siennes le mouvement, la vie et le senti-
r.ient.Lcs noires n'ont qu'un ///o/ extrieur, les siennes ont
la fois un moi extrieur et un moi intrieur : d'o il rsulte
que nous connaissons bien nos ouvrages , mais que les
siens
se connaissent eux-mmes; que les ntres servent et
prissent, et que les siens servent et se perptuent. Aussi,
tout ce que nous apercevons videmment du grand but de
la
nature, c'est qu'elle veut se perptuer; et que tout tend
en effet continuer l'univers.
C'est peu dire sans doute sur un si grand mystre et pour
notre curieuse avidit. Mais le matre de la nature nous
laissera plutt deviner ses lois que ses raisons, et l'a quoi-
boii de l'univers sera toujours pour nous le problme des
problmes. Je passe donc ce qu'il nous est permis de
256
RIVAROL
connatre sur la diffrence de l'homme et des animaux.
Quand on arrive cette Ijarrire, le commun des hommes
n'y est point embarrass: la privation de la parole et la dis-
tance de l'instinct la raison suffisent aux uns pour expli-
quer la difficult, et n'en donnent pas mme le soupon aux
autres.
Voyons donc ce que renferment d'ides la privation de
la parole et la diffrence de l'instinct la raison: la solu-
tion de la difficult sortira de son dveloppement.
Le sentiment ayant paru la pluralit des philosophes
tre de mme nature dans tout ce qui respire, et son plus ou
moins de perfection leur ayant sembl dpendre entire-
ment du sige qu'il occupe et des organes qu'il anime, ce
n'est plus alors ce que font les animaux, mais ce qu'ils ne
font pas; ce ne sont plus les leons qu'ils retiennent, mais
celles qu'ils ne peuvent retenir, qui devraient nous surpren-
dre. Car ce n'est pas le dfaut d'organes, ce n'est pas la
faute des sens qui borne leurs ides : il faut donc en venir
au sentiment.
Or, il est certain que, chez les animaux, le sentiment est
frapp
d'objets, et que ses mouvements, quoique trs vifs,
sont peu nombreux: tandis que, dans l'homme, tous les
objets, tant matriels qu'artificiels, frappent l'envi sur le
sentiment, et que ses mouvements sont prodigieusement
varis. Il faut donc convenir ou que, par son essence, notre
sentiment est de beaucoup plus puissant que celui des ani-
maux, ou que nous en avons reu une plus grande dose en
partage. Ce n'est en effet que par la qualit ou par l'exc-
dent qu'on peut expliquer les limites qui sparent la brute
de l'homme, et la supriorit des gens de gnie sur les
esprits vulgaires : clatante supriorit, limites inviolables
que ne peut nier la philosophie et que ne franchira jamais
l'ducation.
Lorsqu'Helvetius annona aux hommes qu'ils naissaient
tous gaux par l'aptitude au gnie, et qu'ils ne diffraient
que par l'ducation, il avana une proposition flatteuse
pour tous les amours-propres; les cerveaux borns pou-
vaient rejeter, non seulement leur dfaut d'instruction, mais
encore leur peu d'esprit naturel, sur la conduite de leurs
parents et de leurs matres. Cependant, telle fut la force de
la vrit, tel fut le cri de l'exprience contre ce principe,
PHILOSOPHIE
que les conspirations de la mdiocrit et tous les et'orts de
l'auteur n'ont pu tirer celte hypothse de lalig-ne des para-
doxes. Le systme d'Helvetius sur la puissance de l'du-
cation est vrai pour les nations et faux pour les indivi-
dus : il est inutile d'insister plus lon^-temps sur l'vidence.
Quant aux animaux, il est dmontr que ce n'est ni la
faute de leurs sens qui sont souvent trs exquis, ni le dfaut
d'org-ancs qui les empche de parler; car, sans compter ceux
qni articulent comme nous, tous pourraient varier leurs cris
et leurs g^estes et associer beaucoup d'ides ces varits;
et c'est ce qu'ils ne font pas. Les perroquets parlent sans
attacher d'ides aux mots; ils articulent comme nous, sans
converser avec nous
;
ils ont le ct matriel et non le ct
intellectuel de la parole, une simple imitation et non l'appli-
cation des signes la pense. Les cris et les g-estes multi-
plis du sing-e suffiraient seuls pour former une langfue assez
tendue : ils ne sont pourtant chez lui que des sig-nes sura-
bondants de quelques besoins peu nombreux, et surtout du
besoin de mouvement. Les regards et les cris expressifs du
chien ne sont aussi que des sig-nes de quelque affection du
moment, et non un commerce suivi d'ides; ce sont de trs
courts monolog"ues. Enfin les animaux les plus intelligents
ne parlent que par interjections, le plus vif et le plus born
de tous les sig^nes, tant chez eux que chez nous.
Les animaux ont pourtant le sentiment; ils ne manquent
ni d'imagination, ni de jug-ement, ni de mmoire, ni mme
de l'association des ides; et Condillac a trs bien prouv
que la diffrence de la raison l'instinct n'est que du plus
au moins. Il rsulte de ces observations que, tous les cas
tant imprvus pour l'homme et l'animal naissant, le senti-
ment dans l'un et l'autre n'est d'abord qu'une lumire vacil-
lante, une raison qui ttonne; mais ds qu'il s'est fait des
mouvements et des affections d'habitude, le sentiment devient
cette raison fixe, appele instinct chez les animaux, et bon
sens chez les hommes. Le mot instinct serait donc conve-
nable aux uns comme aux autres, si l'animal passait, avec
autant de bonheur que l'homme, l'examen et la solution
des cas imprvus. Mais cela n'est pas; et l'instinct est telle-
ment rest propre aux animaux qu'un homme du peuple
se croit insult quand on lui parle de son instinct.
Au reste, cet instinct des animaux n'est pas plus inn que
258 RIVAROL
nos ides, puisqu'il est, comme notre esprit, l'lve des sen-
sations et de l'exprience. C'est donc une vritable supers-
tition que cette croyance, que les animaux naissent dous
de la facult de fuir les plantes vnneuses; de choisir les
bienfaisantes; de discerner les purg-atifs d'avec les vuln-
raires; de nai^er et de voler sans apprentissag*e. Tout cela
n'est pas plus fond que le don de prdire l'avenir
;
et c'est
faute d'observation que le g-enre humain est tomb dans de
si transTCs opinions. Les animaux s'empoisonnent quelque-
fois, et s'empoisonneraient encore plus souvent, si les plan-
tes danci-ereuses taient plus communes, ou si elles n'taient
en gnral dsag-rables au g-ot. Les perroquets manent
avidement le persil, qui leur est mortel. Quant aux talents
divers que nous admirons dans les animaux, il faut se sou-
venir que leur ducation est si prompte, et leur sentiment
si vif que, pour peu qu'on les perde de vue, ils ont dj fait
des expriences dont le rsultat nous tonne. Observons
encore que leurs talents rsultent immdiatement de leurs
besoins et de leurs organes : il leur suffit de mouvoir les
jambes, les ailes et les nag-eoires, pour marcher, voler ou
nag-er, comme il suffit l'enfant d'ouvrir et de fermer la
main pour saisir les objets. Mais ds qu'il s'ag'it de leur
apprendre quelque exercice tranger leur nature, les ani-
maux exis^-ent encore plus de soin et de peines que les enfants
qu'on dresse aux arts et mtiers.
Nous avons dit plus haut que, pour acqurir quelque vraie
notion du sentiment, il fallait s'adresser aux besoins et aux
passions : mais si cette mthode est indispensable avec
l'homme,elle lest encore plus avec les animaux
;
car l'homme,
au moyen de la parole et de la clart de ses ides, peut jeter
quelque jour sur la nature du sentiment; tandis que les ani-
maux n'ont d'clat et d'nerg-ie que dans leurs besoins, et
que leurs ides sont la fois beaucoup moins nombreuses,
moins enchanes et moins brillantes que les ntres. Car,
l'animal ne pense que pour vivre, et l'homme subordonne
sa vie sa pense.
La plante a la vie, la nutrition, la fcondit et peu de
sentiment; la brute a la vie, la nutrition, la fcondit et
beaucoup de sentiment
;
l'homme a la vie, la nutrition, la
fcondit, le sentiment et la pense, de sorte qu'on admire
davantag-e la vie dans la plante, le sentiment dans l'animal
PHILOSOPHIE
269
et la pense dans Thomme. La plante ayant fix ses racines
dans la terre et dployant ses branches dans Tair, reoit de
ce double maq-asin une subsistance toujours assure
;
la na-
ture metne est sa pourvoyeuse. L'animal tant charj^ de
chercher sa pture, le sentiment est pour lui prcurseur et
sentinelle
;
mais l'homme, appel de plus hautes desti-
nes, a la pense pour directrice du sentiment. La nature
veille donc sur la plante, par elle-mme
;
sur l'animal, par
le sentiment; et sur l'homme, par la pense. Ces trois gran-
des familles ont en commun le besoin, la nutrition et la
fcondit : les deg-rs divers du sentiment et la pense font
leurs diffrences. Aussi dans tout ce qui est impossible
l'industrie de chaque espce, la nature est-elle intervenue.
L'animal qui jouit de sa manumission, court se dsaltrer
dans les eaux qui ne viendraient point lui
;
tandis que
les fleuves et les mers s'lvent en vapeurs, et, transforms
en nuag-es, vont abreuver la plante immobile et altre qui
les attend.
Mais la nature, ayant pourvu l'homme d'une industrie et
d'une libert indfinies, ne lui devait que des matriaux.
Voile, mais d'un voile entr'ouvert, elle lui cache et lui indi-
que tour tour les g'ag-es de ses promesses. Ce fut donc
nous prsa2;-er la fcondit de la terre dans l'emploi de
ses mtaux
;
deviner des maisons et des villes dans ses
carrires
;
demander des habits aux troupeaux, des na-
vires aux forts, et l'aimant la clef des mers : ce fut
nous disputer le sable aux vents qui le dispersent et le
fixer en cristal, qui devait un jour porter nos regards dans
la structure d'un ciron et nous ouvrir de nouveaux cieux.
Voil l'homme en effet : la simplicit de son origine se
perd dans la majest de son histoire
;
la nudit de ses l-
ments, dans la m*agnifcence de ses ouvrages
;
ses besoins
primitifs et ses passions premires ne sont rien auprs des
besoins et des passions dont il s'est fait depuis une si cla-
tante ncessit. L'arbre ne diffre pas autant de la graine
et l'animal du ftus, que l'homme social de l'homme pri-
mitif : c'est une seconde naissance, un autre accroissement
qui nous attend
;
l'animal et la plante ne naissent et ne
croissent qu'une fois.
Spectateur et scrutateur de la nature, l'homme sonde les
mers, gravit les monts, classe non seulement toutes les fa-
200 RIVAROL
milles, mais les mtaux et les pierres, interrog-e les volcans,
se passionne pour une suite de minraux comme pour une
collection d'insectes, s'enfonce dans la nuit de l'antiquit
comme dans les entrailles du globe, met contribution la
terre, l'air et l'eau, non seulement pour v trouver sa nour-
riture et ses vtements, mais pour ennoblir ces deux nces-
sits par les lgances du got et les pompes de la parure.
Car, dans l'homme, tout besoin devient art
;
toute sensa-
tion se prolonge et s'agrandit
;
toute fonction naturelle a
ses rgles, ses m^thodes et ses perfections; tout sens a ses
recherches, ses dlicatesses et ses lois. Les couleurs, les
parfums, les sons, les saveurs, tant de jouissances priodi-
ques, si passagres pour les animaux, l'homme les fixe et
les enchane sa destine, dont il gaye^ diversifie et trompe
artistement les longs dtails et la courte dure. Et pendant
que les animaux peuplent et dcorentla terre, l'air et l'onde,
l'homme fait entrer l'onde, la terre, l'air et les animaux
dans les riantes dcorations de sa demeure. C'est l qu'il
brave en paix les ardentes fureurs de l't et la sombre ri-
g*ueur des hivers. Quelle prodig-ieuse existence ! Quel exc-
dent de vie ! Quel immense cortge pour un si frle et si
phmre possesseur! Parlerai-je ici des passions, de cet ap-
ptit de gloire et d'empire qui nousa soumis la terre
;
et de
ces monuments dont l'espce humaine a couvert sa surface?
L'amour lui-mme, si imptueux dans les animaux, mais
s'allumant et s'teignant tour tour avec les saisons, ou
brlant sans choix pour l'objet qui l'excite, peut-il entrer
en comparaison avec ce sentiment tendre et fidle qui ne
voit qu'un homme entre tous les hommes, qu'une femme
entre toutes les femmes ? C'est cette prfrence, ce ct
moral et profond qui pure, consacre et divinise l'amour.
Si vous rapprochez maintenant ce rapide coup d'il sur
le genre humain, de l'histoire des animaux,vous les verrez,
acteurs subalternes de la nature et jamais ses spectateurs,
promener un regard indiffrent sur cette foule d'objets que
rhomme contemple avec avidit, qu'il tudie avec charme
et qu'il dcrit avec enthousiasme. Rduit la crainte, la
faim et l'amour physique, leur sentiment est pour ainsi
dire sans apptit sur tout le reste : rien ne peut le tirer de
son incuriosit. O prendraient-ils de nouveaux besoins, o
puiseraient-ils
de nouvelles passions, ces tres qui naissent
PHILOSOPHIE
261
vctiis et qui leur pture ne coilte que le soin de la trou-
ver? C'est lii, c'est vers cet unique but qu'ils dirig-ent leurs
etlorls, leurs finesses, leur sa2:acit, et toutes les pointes de
leur sentiment. La dig^estion n'amne pour eux que le som-
meil, et le sommeil ne ranK'^ne que le besoin; tout les re-
lient dans ce cercle ternel. Qu'une belle aurore, que le
printemps les rappelle la vie et aux jouissances, ces heu-
res fortunes n'obtiendront jamais d'eux un seul instant de
contemplation, un seul de ces reg^ards en arrire qui conti-
nuent le bonheur en l'alliant la rflexion. Le crpuscule
d'un beau soir n'est poureux qu'une invitation la retraite.
C'est ainsi que les jours, les saisons et les annes s'coulent
sans un moment de retour sur la vie, entre la faim et la
satit, entre la foug-ue du dsir etles lassitudes del jouis-
sance
;
et toujours plus prs du tressaillement de la joie ou
des cris de la douleur que du plus simple raisonnement.
Notre long-ue ducation, proportionne d'un ct nos
besoins, et de l'autre aux ricnesses qui nous attendent, con-
traste encore avec celle des animaux, chez qui l'apprentis-
sao'e du sentiment est si court. La nature a charg pour
nous l'nig-me du monde, au point de nous faire natre
l'envie de la deviner
;
elle ne nous et pas assez donn, si
elle ne nous et beaucoup refus
;
mais en multipliant nos
besoins, elle a mesur ses dons sur ses refus
;
en stimulant
le sentiment, elle a g-al la puissance la difficult. De
sorte que si nous avons des vaisseaux, c'est parce que nous
n'avons pu marcher sur la mer
;
si nous comptons, c'est
que les units nous chappent
;
si nous avons des horlog-es,
c'est pour n'avoir pu matriser le temps par la pense
;
si
nous fabriquons tant d'instruments et de machines, c'est
pour suppler notre impuissance. Ainsi, les arts, les
sciences et toutes nos inventions ne sont que des ressources
qui prouvent d'autant mieux nos embarras qu'elles sont
plus ing-nieuses. C'est vraiment dans l'homme que la force
est sortie de la faiblesse, et que la lumire a jailli des tn-
bres. Nous naissons borns, mais nos bornes sont amovi-
bles
;
celles des animaux sont immuables. Enfin, la nature
a rendu l'homme dig-ne et capable d'admiration.
Nous sommes, en effet, le seul animal qui soit surpris de
l'univers, et qui s'tonne tous les jours de n'en tre pas plus
tonn. La surprise, chez les animaux, ne roule que sur
i5.
l'apparition do quelque objet inconnu, et se termine brus-
quement par l'pouvante ou la fuite, et la lonsi^ue parla
familiarit ou loubli. Chez nous la surprise est mre de la
rflexion
;
elle se termine par la mditation, et nous con-
duit souvent des dcouvertes par l'heureux tourment de
la pense. L'tonncment mme que nous cause notre fai-
blesse est un si^-ne de g-nie
;
car se sentir petit est une
marque de 2;-randeur, comme se sentir coupable est une mar-
que de vertu. Enfin, nous sommes la fois tonnants et
tonns
;
les anim.aux ne sont qu'tonnants.
On dirait que la bte parcourt sa carrire en lig-ne droite,
et que l'homme s'arrte son
err, se replie et dcrit une
infinit de courbes. Nous fumes placs sur le seuil del
vie comme devant des routes sans fin qui aboutissent
nous et nous attirent tour tour
;
les animaux, comme de-
vant une ou deux routes seulement. Cette simplicit, cette
direction du sentiment chez les anim.aux, explique la plu-
part des phnomnes qu'ils nous offrent. Les mouches, et
mme les oiseaux sauvages, se heurtent des jours entiers
contre un carreau de vitre, sans rflchir un instant sur la
rsistance invincible et mille fois prouve de ce mur dia-
phane, sans aucune surprise sur la mag-ie de cette transpa-
rence. Ils voient au del Tcspace clair, et cette impression
est si dominante, qu'ils se laissent arrter, sans se laisser
avertir par la rsistance.
Le sentiment, dans les btes, tant donc, par sa nature,
attentif beaucoup moins d'objets, soumis beaucoup moins
d'inquitudes, de curiosits et d'ambitions de toute espce,
il en rsulte que leur imagination se peuple de moins d'ima-
g"es, que leur jugement compare moins de choses, et que
leur mmoire se charsTe de moins de souvenirs. La pense
est donc chez eux fonde sur moins de bases.
Et d'abord, ils manquent tout fait d'abstraction. Si les
enfants et les peuples sauvages ne sparent pas d'abord l'ob-
jet de la qualit, je veux dire, par exemple, la neisfe de sa
blancheur, les animaux n'en feront jamais la distinction.
Certains de l'objet qui les frappe, ils ne sparent pas de lui
les qualits dont il est revtu
;
voyant et saisissant les cho-
ses une une, ils ne peuvent les compter
;
assurs de leur
moi, ils n'en sentent pas la fixit
;
entrans par la succes-
sion de leurs ides, ils sont loin de rflchir ce mouve-
PHILOSOPHIE
263
mont : ils n'ont donc pas Title du temps qui rsulte de la
fixit du moi et de la succession des ides. Ils manquent par
consquent du rpertoire o se classent les poques des sou-
venirs. Lafi^-ure, la couleur, les saveurs et les sonsnerevion-
nent qu' leur imaj2:ination,et leur vie ne serait qu'un rve,
si leur mmoire ne t^i^ardait l'accord et la suite de ces im-
pressions sans si^-nes et sans poques. De l vient que leur
i ma;-i nation l'emporte sur leur mmoire, tandis que chez
l'homme la mmoire l'emporte tout fait sui l'imag-ina-
tion.
On ne peut cependant taxer les animaux de folie, puis-
que leur mmoire iji^uide leur ima^ination, en retenant
l'ordre des choses et la vrit des situations; car s'ils ne
conoivent pas le temps, ils sentent le mouvement et le
repos; s'ils n'ont pas l'ide de l'espace, ils srardent la fij^^-ure
des lieux et l'impression de la distance
;
s'ils ne sparent
pas les corps de leur tendue, ils sentent le besoin de les
parcourir.
Au reste, les enfants ne sont pas plus avancs que les
animaux sur toutes ces abstractions; leur imag-ination est
d'abord trs suprieure leur mmoire, et ce n'est qu'avec
Tag-e que celle-ci eragne du terrain et tinit par dominer et
dirig-er l'autre. Enfin, chacun sait par exprience que, pour
se souvenir d'un lieu, d'un corps, d'un vnement, d'un
plaisir et d'une douleur, on n'a pas toujours besoin du
temps; l'imag-ination excite les ides, et la mmoire qui
s'en empare aussitt, leur donne la suite et l'ordre qui rsul-
tent del fig-ureet de la position des objets, de la diffrence
des impressions et de l'entente des lieux et des circons-
tances. Les souvenirs sont alors comme des tableaux, sans
confusion, mais sans date.
C'est par l qu'on explique pourquoi certains animaux
reconnaissent les personnes, retrouvent leur demeure et
retiennent des suites d'actions souvent trs compliques.
Partout o le temps et les ides abstraites n'entrent pas
comme inq-rdients, l'animal peut ag-ir par lui-mme ou
imiter l'homme avec succs, et sur ceci il faut faire deux
observations.
La premire, qu'il
y
a des espces privilg-ies, telles que
les chiens ou les lphants, dans leurs relations avec nous;
et les abeilles ou les castors, dans leurs rapports entre eux
;
204
RIVAROL
et que, dans chaque espce, il
y
a encore des individus
plus ing-nieux les uns que les autres. On peut diviser les
animaux en personnes d'esprit et en personnes talent. Le
chien et l'lphant, par exemple, sont des gens d'esprit: le
rossig-nol, le ver soie, sont des g^ens talent. La diff-
rence entre le principe social qui unit les hommes et les
causes qui rassemblent certains animaux, a t si bien ta-
blie par quelques philosophes, que, si j'en parlais ici, je ne
pourrais que les rpter. Je dirai seulement qu'except les
abeilles, les castors et les fourmis d'Afrique (i), tous les autres
animaux ne savent que s'attrouper, s'accoupler et construire
des nids; mais des attroupements, et l'amour, et mme
l'tat de famille ne sont pas Tordre social. Ce sont des ren-
dez-vous assig-ns par le besoin, des appels et des cong-s
donns par les saisons. Quant aux trois espces qui vivent
et travaillent en commun, il est certain qu'elles poussent
d'abord la combinaison des ides premires jusqu' la divi-
sion du travail
;
mais une fois l'difice construit, toute
combmaison ultrieure cesse: ces rpubliques-l ne savent
pas enter la raison sur l'exprience; elles ignorent l'art
d'chafauder leurs connaissances, et de substituer des outils
et des instruments leurs organes
;
elles ne recueillent ni
ne laissent d'hritage, et l'industrie publique meurt et renat
tout entire chaque gnration. Une prompte et fatale
perfection les saisit au dbut de la vie, et leur interdit la
perfectibilit. Les animaux sont donc plus immdiatement
que nous les lves de la nature. L'homme part plus tard
pour arriver plus haut
;
mais cette immense carrire, c'est
la socit qui la lui ouvre: c'est l que l'homme se greffe
sur l'homme, les nations sur les nations, les sicles sur les
sicles. D'o rsulte cette incontestable vrit, que le genre
humain est toujours suprieur quelque grand homme que
ce soit; et que, chez les animaux, l'individu est toujours gal
l'espce. On peut dire encore des animaux que, s'ils n'aug-
mentent pas leur industrie par l'association, ils ne la perdent
pas dans la solitude. Le castor, lorsqu'il n'est pas gn par
la prsence de l'homme , retrouve ses talents en revoyant
h)
Il entend sans doute les termites, qui ne sont pas des fourmis,
quoique appels encore fourmis blanches. Le nombre des animaux so-
ciaux est bien ptus raud qu'on ne le croyait alors : mais cela ne change
rien aux raisonnements de Kivarol.
PHILOSOPHIE
265
ses dserts, ses bois et ses rivires. Il n'en est pas ainsi de
l'homme: il ne peut ^aj^ner beaucoup l'association,
sans
beaucoup perdre l'isolement; comme les diamants
et les
mtaux, Ihumine nat encrot; et comme eux, il ne doit
son clat qu'au frottement. Si la distance du sauva;5-e soli-
taire au sauvag-c en corps de peuple est dj prodi'j'ieuse,
que sera-ce si on le met en comparaison avec l'homme de
gnie dans Tordre social? Le sauvag-e en g-nral ne veut
pas de nos arts, parce qu'il ne les connat pas, et nous ne
voulons pas de son existence, parce que nous la connaissons.
En un mot, personne ne voudrait tre seul sur la terre
;
pas
mme l'avare, quoiqu'il eut tout; pas mme l'envieux,
quoiqu'il ne vt que des ruines,
La seconde observation, c'est que tous les objets de nos
perceptions ont toujours deux faces, celle qu'on sent et
celle qu'on s'explique. Le commun des hommes et tous les
animaux sans exception s'arrtent la premire. On a fait
des votes long-temps avant de songer leur thorie
;
on a
de tout temps vit les chutes, et les lois du mouvement et
de la pesanteur sont bien modernes. Le sauvag-e qui btit
une chaumire, n'a pas mme un soupon d'architecture
;
et un homme born, sollicit par deux dsirs contraires,
reste indcis, sans avoir l'ide du doute. Or, si tout cela
est vrai pour l'homme vulgaire, ou du moins pour les en-
fants, plus forte raison pour les btes. Leur jug-ement, ne
porte que sur le cot sensible, et pour ainsi dire matriel,
des objets qu'on leur prsente. On peut d'abord s'en con-
vaincre en offrant un chien, trs intellig-ent d'ailleurs, le
choix d'un pain ou d'un cu. Il
y
a plus; le chien que son
matre, par des chtiments et des caresses, aura dress
porter de l'arg-ent chez le boucher et rapporter de la
viande, ne fera jamais la commission pour lui-mme,
quel-
que arg-ent qu'il trouve dans la rue, parce qu'il n'a pas la
moindre ide des changes. Il porte et rapporte, mais il
n'achte pas. C'est ainsi que les orangs-outang-s qui aiment
le feu, ne savent ni l'attiser ni le nourrir : parce qu'ils ne
concluent pas de l'effet la cause. Semblable au valet d'un
philosophe, qui apporte des livres son matre, et qui ne
voit que ses g-ag-es dans ses fonctions, le chien ne voit entre
son matre et sa leon que le chtiment ou la
rcompense.
C'est ainsi qu'il mord la pierre qu'on lui lance
, s'arrtant
266 niVAROL
toujours ;i la premire ide, la sensation prcscnle,
l'effet immdiat, et ne remontant jamais au principe, c'est
ainsi qu'il ramasse la nourriture qui tombe devant lui sans
tourner les yeux vers la main qui la lui jette. Si l'homme
recueillait les fruits del terre sans lever ses reg-ards vers
la main qui les dispense, il n'aurait pas l'excuse des ani-
maux, qui peroivent sans rflchir, qui sont indiffrents
et oublieux sans ingTatitude, comme ils sont farouches sans
tre barbares, russ sans perfidie, tremblants et rampants
sans honte, doux et patients sans effort et sans mrite.
Tels sont en crnral les animaux : et cependant combien
de fois, sensibles aux caresses, fidles et capables d'attache-
ment, certains individus ont port le dvouement jusqu'
l'hrosme, et prouv que si leur sentiment a des limites
comme esprit, il peut, comme cur, tre sans bornes, et
leur mriter une larme de leur matre!
Pour avoir une ide juste des animaux, il ne faut donc
que diminuer l'homme
; notre raison trs limite devient
aussitt leur instinct. Mais si le sentiment restreint et
amoindri suffit pour expliquer leur intellig^ence, il est plus
que suffisant pourrepousser les philosophes qui l'ont accus
de pur mcanisme.
Buffbn, qui ne vit dans les abeilles que des machines
ncessites, par leur g-ne mutuelle, k faire des hexagones,
oubliait que les cellules qui terminent le g-teau, n'tant
pas g-nes, ont pourtant la mme forme; que l'hirondelle
btit son nid tantt en demi-cercle, tantt en quart de
cercle, selon l'exigence du lieu
;
que le castor est encore
plus libre dans ses constructions, et qu'enfin les hommes
seraient aussi des automates, si le sentiment ne suffisait pas
pour sauver l'animal d'une telle accusation.
Quand Descartes, si jaloux desa pense et de son immor-
talit, traitait les animaux de machines, il voulait jeter entre
eux et nous un espace incommensurable. Quand Buffon s'est
arm de la mme hypothse, il a bless l'esprit humain dans
son principe : sa philosophie quivoque convenait de l'me
avec la Sorbonne, et de la matire avec ses amis. De sorte
que l'opinion de Descartes est une flatterie pour l'homme,
et celle de Buffon une calomnie, un attentat contre le sen-
timent, ce rayon sacr qui brille dans tout ce qui respire, et
qui est la vie ce que la vie est au purmouvement. Devait-
pfrii.osopHiE 267
on s'attoncirc que le
nohl'.Oiistorlen dos animaux no rap-
porterait qu'uFie si abjecte tli/'orie de leur commerce? Con-
(lillac, indiq-n, l'a trait comme un prtrc qui tomberait
dans lathisme.
Il faut donc en venir au vrai. Paitout o le mouvement
et l'espace suffisent seuls aux
oprations que le besoin com-
mande, le sentiment est aussi net dans les animaux que
dans l'homme.
Mais, dira-t-on encore, si les animaux naissent orijaniss
et prpars par la nature construire un nid ou tel autre
t^-enre d'industrie, et si rien ne peut leur faire outrepasser
le point de perfection qu'ils atlciiiii-nent si vite, ils sont donc
des instrum.ents immdiats de la nature, et, pour tout dire,
de vrais automates! Et vous, hommes, rpondrai-je, n'arri-
vez-vous pas tout prts lier des ides et des sii^nes de
conventions, faire des abstractions, concevoir l'ide du
temps, celle des nombres, celle d'un Dieu? et si vous vous
tonnez des limites qui bornent tout coup l'industrie et le
raisonnement de la bte, je vous parlerai des barrires qui
arrtent votre gnie Vous avez devin le systme du
monde : quelle invisible main rprime toujours son essor,
(juand il s'ag-it de votre propre essence ? Oui sait si le
dfaut de la plus simple rflexion, ne vous spare pas
jamais de la plus haute et de la plus heureuse dcouverte (i)?
Les pig-es et les filets sont bien anciens, et pourtant les
poissons et les oiseaux s'y prennent toujours. Mais la flatte-
rie, la tyrannie et les superstitions sont aussi anciennes, et
le genre humain
y
est toujours novice. Si quelques grands
hommes, en purant leur raison, honorent quelquefois leur
espce, ils ne la corrigent point. On les compte, ce qui
prouve qu'on ne les imite pas; et si, de mme, certains
animaux acquirent en vieillissant assez d'exprience pour
se dfier de nos pig-es et de nos armes, ils ne la trans-
mettent pas faute de langage : la science de l'individu est
toujours perdue pour l'espce, qui reste jamais prive de
tradition et d'arcnives.
Enhn les btes, qui comparent peu de choses, ne dtachent
(i) Pourquoi Virgile n'a-t-il pas vu l'lectricit, lui qui a si bien
peint la fieche du roi Aceste s'enllammant, Nigra sub nube? V. liv.
5,
Enide. R.
208
RIVAROL
pas de leurs rapides comparaisons les ides abstraites de
grandeur et de petitesse, de pesanteur et de lg-ret. Si
elles prouvent et exercent le mouvement, si elles ont un
moi fixe et des ides qui se succdent, elles ne conoivent
pas le temps; encore moins peuvent-elles le mesurer et le
compter. Une suite de nombres n'est pour elles qu'une suite
de sons; mais le sauvasse qui entend une horlo^-e pour la
premire fois en jug-e-t-il autrement, quoiqu'il ait dj
l'ide du temps?
On peut mme dfier un philosophe de courir de toutes
ses forces et de raisonner de suite en mme temps. Il n'aura
que son but en tte, et ne saisira qu' peine les grandes
masses qui se rencontreront droite et gauche sur son che-
min. C'est ainsi que les animaux parcourent la vie, sans
tre pour cela plus automates que ce philosophe. Que si on
traite de machine l'tre qui sent, quel nom donnera-t-on
l'ouvrage de nos mains? On ne peut reculer d'une expression
les uvres de la nature, sans faire d'autant rtrograder les
noires : car il faut que les proportions et les distances res-
tent. A quoi sert donc de mettre des mots si clairs et si fixes
en contredit? On augmente la liste des fausses dnonciations
et des paradoxes; on gte la fois l'esprit humain et le lan-
gage.
Le prsent tant pour l'homme un instant fug-itif, un mou-
vement intellectuel et simple qu'il applique toute la nature,
et l'avenir une perspective de crainte ou d'esprance, il est
vident que ce n'est que sous la forme du pass que le temps
est n dans l'esprit humain : il accompagne la pense et lui
donne un espace de plus. Le complment de cette conception
du temps rsulte de la comparaison du pass avec le prsent
et l'avenir. Or, les ides, comme souvenir, se portent natu-
rellement vers le pass
;
les sensations appartiennent au
prsent, et c'est vers l'avenir que les passions se prcipitent.
On peut conclure de ceci que les besoins commes principes
des passions, inspirant des dsirs ou des craintes, nous in-
quitent sur l'avenir : ce qui explique pourquoi les animaux,
tourments par les besoins, sont plus prs du temps venir
que du pass, qui n'est jamais pour eux que l'image de tel
objet ou la trace de telle sensation, sans autre espace que
celui des lieux o l'objet s'est offert et o s'est pass l'v-
nement. Un vnement s'est passe hier, dans la rue, pour
PHILOSOPHIE
269
nous. Mais pour les animaux, il ne s'est pass que dans la
rue.
Les hommes ont observ de bonne heure ces craintes, ces
prcautions et cette tendance des animaux pour le temps
venir, qui semblent les faire aller au devant de la vie; et
peut-tre que la superstition des aug"uresn'a pas d'autre ori-
i^ine. L'avarice, qui n'a de son trsor que la crainte de le
perdre, ne sauve aussi de son existence que le temps qui
n'en est pas, puisqu'elle ne vit que dans l'avenir: malsaussi
l'avarice qui se croit raison n'est que passion.
La supriorit de l'imag-ination sur la mmoire, dans les
enfants et dans les animaux, fortifie encore cette observa-
tion, car on sait que la mmoire est toute au temps pass,
mais l'imag-ination est amie de l'avenir.
On sait aussi que les animaux et les enfants sont plus
frapps de leurs rves, que les ttes pensantes dans qui la
mmoire, arme de dates, d'abstractions et de souvenirs
classs et compts, spare tout fait les illusions du som-
meil des ralits de la veille. Chez eux, au contraire, les
rves diffrent si peu de la veille, que j'ai vu un chien qui
faisait alors quelque sone;-e effrayant, aboyer, se plaindre,
s'veiller en sursaut et quitter, en criant, la place o il dor-
mait, comme s'il
y
avait t battu. Tant rimag-ination est
puissante, quand la mmoire est sans force!
De l vient encore que, jouissant si rarement du calme
de la mmoire, le chien hurle de l'absence de son matre,
et trpig-ne de joie en le revoyant : pour lui, point de milieu;
les souvenirs de ce qu'il aime, sans cesse prsents son
imagination, finissent toujours comme au thtre, par des
dsespoirs ou par des reconnaissances mles de cris et de
larmes.
Concluons de ce parallle que les animaux s'arrtant
toujours la sensation, ou parvenant peine l'ide sim-
ple qui s'interpose entre la sensation et les ides complexes;
inattentifs aux oprations de leur esprit; ne dtachant pas
l'objet de ses qualits
;
ne concevant ni le temps, ni ses
divisions, et moins encore l'art de les compter; infiniment
})lus forts de passions qe d'ides; moins riches de mmoire
({ue d'imag-lnation
;
presque toujours sans rflexion et cons-
tamment sans abstraction; s'associant sans convention, et
n'ayant jamais conu les changes
;
concluons, dis-je, que
270
RIVAROL
les animaux n'ont pu inventer la parole et btir cet difice
del pense, dont l'analysi?, les abstractions, les conventions
et les chang-es sont les vritables fondements.
Cependant, les animaux jouissent de l'association des
objets et des sensations, sans quoi ils n'auraient pas le sens
commun, et recommenceraient la vie chaque instant.
C'est par cette puissance, commune tout ce qui respire,
qu'ils s'apprivoisent d'abord avec eux-mmes, ensuite avec
les objets extrieurs et enfin avec nous
;
c'est par l qu'ils
ont assez de suite dans leurs souvenirs, pour rg-ler leur
imaofination. Pourquoi sont-ils donc jamais privs de la
parole?
C'est que les animaux, en liant leurs souvenirs, ne les
associent qu' des sig-nes m.atriels,trs prochains, peu nom-
breux, indisponibles, invariables et invisibles. Il faut dve-
lopper ceci en peu de mots.
Il
y
a deux sortes d'associations : les naturelles et les
artificielles, qui sont de pure convention.
Ma prsence, ma voix et la nourriture que j'apporte s'as-
socient aralemcnt dans la tte des enfants et des animaux
que j'lve. La soif et l'eau ne se quittent plus dans leur
imag-ination aide de leur mmoire
;
et s'ils sont ncessits
chercher leur nourriture et leur boisson dans les champs,
ils n'oublieront ni la distance, ni les diffrents aspects des
lieux, ni le murmure du ruisseau qui doit les dsaltrer.
Tout son qui les frappe au moment o la pture arrive,
s'associe elle
;
et l'attention de l'animal, veille par le
besoin, se partag-e entre la proie et le bruit qui l'accompa-
g-ne.
C'est donc la nature et les hasards de la vie qui four-
nissent des sijgnes aux animaux, ce qui en circonscrit beau-
coup l'espce et le nombre. Il n'y a donc que l'homme qui
puisse leur fournir des sig-nes artificiels et varis, qui ne
sont ni les reprsentants, ni les compatrnons naturels de
l'objet.
Mais quand on en vient un tel commerce avec les ani-
maux, il se prsente aussitt un inconvnient insurmonta-
ble : on les a tirs de leur ordre, sans les transporter dans
le ntre
;
et l'extrme majorit de nos sig-nes exprime tou-
jours des besoins qu'ils n'ont pas, et des ides qu'ils ne
peuvent concevoir.
l'HILOSOPHIE 271
Il faut donc alors, prcmicrcmont, borner beaucoup le
Innij^ajtre qu'on essaye avec eux, et renoncer aux verbes, aux
.'oliectifs, et tous" les mots abstraits qui rappellent des
( lioses qu'on peut voir, ou des g-estes qu'on ne peut l'aire.
'
(st quoi on en est rduit avec les enfants qui commen-
it dnouer leur lang-ue. En disant aux uns et aux
1res, pain, joujou, bonbon, on leur montre d'abord ces
MS objets, et on se contente ensuite du mot seul, quand
i , ssociation de l'objet et du nom s'est faite dans leur cer-
^ au. Mais vous ne pourrez jamais leur prononcer avec
succs les mots sagesse et verfu, puisque vous ne sauriez
l(>s accompag-ncr d'un objet visible. C est ainsi que vous
aurez des g-estcs pour leur faire entendre ici et l, et que
Aous ne leur ferez jamais comprendre A ?"^r et aujourd'hui.
Si vous usez d'un ou de deux verbes tout au plus, vous ne
les emploierez qu' l'impratif, sig-ne instantan du com-
mandement, sans aucun g-ard au pass et l'avenir, et
V; us observerez que Texpression de ce mot est tellement
dans le ton de la voix que vous pourrez attirer l'animal
avec un mot de colre, et l'effrayer avec un mot de caresse,
l'intonation tant pour eux le ct sensible et matriel de
la parole. Vous n'oublierez jamais que les mots, quelque
sonores qu'ils soient, ne sont qu'un bruit plus ou moins
lung- pour eux, et que les monosyllabes leur conviennent
davantag-e. Pour nous, la phrase se divise en mots, les
mots en syllabes et les syllabes en lettres. Mais, pour eux,
[tuint d'analyse: c'est l que les bornes sont invincibles (i).
Secondement, vous accompagnerez toutes vos leons de
litiments et de rcompenses, afin d'attacher un intrt
iitable tant d'objets indilVrents pour eux; car les ani-
aux n'tant point frapps de vos paroles en elles-mmes,
le seront toujours de vos caressses et de vos menaces, qui
parlent droit leurs passions. Ce n'est point en eft'et avec
vous et vos ides qu'ils ont fait un pacte, c'est avecle plaisir
t la douleur dont vos menaces et vos caresses sontl'expres-
n sensible et directe. Aussi les trouverez-vous toujours
accessibles la vanit, ce besoin d'tre aux yeux d'autrui,
ion nomme />arrti7r<? .-leur g-osme est sansamour-propre,
i
vos sifflets et vos hues ne feraient que les pouvanter.
( i) La parole exige trois efforts :
1
la retenir.
2 l'appliquer,
?><^
l'ana-
yser. Les oiseaux s'arrtent au premier; le vul^aire, au second. M.
272
RIVAROL
Tout ce qui peut tre jug- entre dans la balance de la
raison humaine: celle des animaux n'admet que ce qui les
touche. C'est donc en vain que vous exig-eriez d'eux' quelque
ide de justice, puisque dans toute querelle, quand elle ne
leur est pas indit'rente, ils se font toujours partie et ne se
constituent
jamais tiers
;
et c'est pourtant l le vritable
caractre et Torig-inc de la justice. Encore moins leur pro-
poserez-vous des chang-es
;
car si vous mettez, d'un ct,
un signe de convention, tel que l'or; et de l'autre, une
denre qui leur convienne, ils ne cderont jamais celle-ci
pour l'autre; et si vous leur prsentez deux aliments agra-
bles, ils les prendront tous deux, ou se dcideront pour le
plus Gfros.
Toutes les ides indirectes qui rsultent d'une
convention passe, ou qui promettent un bien venir, leur
sont galement trangres : tandis que l'homme embrasse
le monde et attire toutes les denres, en rapprochant les
espaces par le commerce et les temps par le crdit.
S'il est donc impossible aux animaux de se dmler de
la varit de nos paroles, et si on est oblig- de se rduire
avec eux des cris et des sig-nes peu nombreux, c'est
qu'ils ont peu de besoins, et que nos mots rappellent une
foule de choses dont ils n'ont ni le dsir, ni l'ide, et dont
ils ne furent, ne sont et ne seront jamais touchs. Il faudra
mme que ce peu de signes soit accompag-n de l'objet, ou
qu'il rveille la crainte et l'esprance : les arrire-penses de
l'homme seront toujours un vrai labyrinthe pour les ani-
maux. Un sing-e qui l'on apprend l'exercice ne verra
jamais qu'un bton dans son fusil
;
le perroquet qui
vous aurez appris dire votre nom le prononcera pour
avoir manger ou pour avoir le plaisir de g-azouiller, et non
pour vous nommer; le chien que vous aurez longtemps
dress, et qui vous direz, ma montre! ira la chercher,
non pour que vous sachiez l'heure, car ceci ne le reg^ardc
pas; mais de peur d'tre battu, s'il ne refait pas les mou-
vements que vous lui avez inculqus par la douleur. Leurs
passions s'interposent donc toujours entre le mot et l'ide
complexe, et leur intellig-ence n'est qu'obissance.
Le lecteur peut maintenant rapprocher les deux opinion-
opposes sur les animaux : tant celle qui les gale a
l'homme que celle qui les rduit l'tat de pures machines,
et se convaincre que la vrit n'est pas dans ces extrmes.
PHILOSOPHIE
375
III. DE LA PHILOSOPHIE MODERNE
Conclusion.
Les clifTrents cultes qui remontent, par leur date, jus-
qu'au berceau des corps politiques, en ont trop souvent con-
sacr les purilits; ils ont batifi des fanatiques, plac la
vertu dans des actes insig-niliants, accord l'oisivet et
la virginit des honneurs qui n'taient dus qu'au mariae,
la chastet et au travail : il n'est donc pas tonnant que la
religion en gnral donne prise aux objections d'un sicle
raisonneur
;
et comme les religions visent minemment la
fixit, et que chez elles tout devient sacr, s'il se trouve,
par exemple, que Mahomet ait parl de sa jument, cet ani-
mal sera rvr dans toute l'Asie, et fournira un ample
sujet d'ironies aux philosophes, qui se moqueront et du
peuple crdule, et du lgislateur sans mfiance qui n'a pas
prvu leur arrive; et ces scnes scandaleuses dureront jus-
qu' ce que les philosophes comprenent enfin que ce n'est
pas pour attaquer les religions qu'il faut du gnie et du
courag-e, mais pour les fonder et les maintenir. Cette
rflexion si simple n'est encore tombe dans l'esprit d'au-
cun d'eux; ils ont fait au contraire grand bruit de leur
incrdulit; ils en ont fait le titre de leur gloire; mais dans
les ttes vraiment politiques, l'incrdulit ne se spare pas
du silence (i).
Il est encore vrai qu'au lieu de se contenter de dire que
Dieu rserve pour une autre vie l'ordre qui ne rgne pas
dans celle-ci, les prtres veulent qu'il se dclare quelquefois
et qu'il dploie sa justice et sa puissance en ce monde, pour
punir l'impit, sauver l'innocence ou rcompenser la vertu.
De l les miracles, et comme l'ordre de la nature est un
miracle perptuel, il a fallu que Dieu suspendt cet ordre
dans les grandes occasions
;
qu'il prouvt sa prsence dans
l'ordre moral par un moment d'absence dans l'ordre physi-
que, et qu'enfin un miracle ft une interruption de mira-
cles.
C'est trop : on s'expose par l la scne de Polyeucte, si
(i) Voltaire, en parlant des services qu'il croit avoir rendus au genre
humain par ses attaques multiplies contre la religion, dit trs-fastueu-
sement : Je vous ai dlivrs d'une bte froce .K.
274
RlVAROL
funeste toutes les relig-ions. Le peuple qui croit que Dieu
se veniTi-era s'attend un miracle; et, si le miracle n'ar-
rive pas, tout est perdu. De la neutralit de l'Etre suprme
dans les misrables dbats des hommes, l'incrdulit la
plus effrne, il n'est qu'un pas pour le peuple. Ce n'est
point alors le raisonnement qui fait des impies, mais le suc-
cs. La scne dont je parle s'est rpte dans le premier
temple de la capitale d'un grand royaume, et le peuple a
cru g-ai^'ner le mme jour une bataille contre son Dieu,
comme il l'avait gag-ne contre son roi.
J'observerai, en passant, que celui qui renverse
l'ancien
autel pour en lever un nouveau, est un fanatique; et que
celui qui renverse pour ne rien substituer est un insens.
Les philosophes ont mme tort de dire que les gouverne-
ments doivent fermer les veux sur les irrvrences et les
impits, sous prtexte que Dieu est au-dessus de nos insul-
tes
;
car il s'ensuivrait aussitt qu'il est au-dessus de notre
hommag-e, et alors point de relig-ion.
C'est, je l'avoue aussi, pour avoir cru que la divinit est
toujours prsente dans l'ordre moral que nos pres tabli-
rent le duel judiciaire qu'ils appelaient en consquence
jvfjement de Diea^ persuads que l'Etre suprme se dcla-
rerait ncessairement pour l'innocent, et que la victoire
serait toujours l'expression de sa justice
;
mais l'innocent
faible eut tant de fois le dessous, et le coupable robuste
triompha si souvent, qu'il fallut enfin renoncer cette
jurisprudence.
On reproche aux diffrents clerg-s d'avoir ml trop de
mtaphysique la tholog-ie, et d'avoir par l multipli les
hrsies : mais qu'est-ce que toutes les hrsies en compa-
raison d'un seul principe philosophique ? C'taient les
hommes qui empoisonnaient tel ou tel dog-me; mais aujour-
d'hui, c'est tel principe philosophique qui empoisonne les
hommes. Et si on m'objecte que les relig-ions ont multipli
les mendiants, je rpondrai que la philosophie moderne a
multipli les brig-ancls, et que si la relig-ion a eu le malheur
d'armer les peuples contre les peuples, la philosophie, plus
coupable encore, a crois les nations contre leurs g-ouverne-
ments, contre leurs lois, contre la proprit, contre la nature
ternelle des choses, et qu'enfin elle a mis le g-enre humain
dans la voie d'une dissolution universelle.
PHILOSOPHIE
275
Si on rapproche maintenant la conduite des prtres et
Ides philosophes, on trouvera qu'ils se sont galement trom-
ps dans l'art sublime de gouverner les hommes
;
les pr-
tres, pour avoir
i)ens
que la classe instruite croirait tou-
jours, et les philosophes, pour avoir espr que le peuple
s'clairerait.
Les uns et les autres ont parl de la religion comme d'un
moyen divin et de la raison, comme d'un moyen humain :
c'est le contraire qu'il fallait penser et taire.
Enfin, par je ne sais quelle dmence inexplicable, les
philosophes ont exig qu'on leur dmontrt la religion, et
les prtres ont donn dans le pige (i)
;
les uns ont demand
des preuves, et les autres en ont oll'ert : on a produit d'un
ct, des tmoins, des martyrs et des miracles
;
de l'autre,
un tas d'arguments et de livres aussi dangereux que fasti-
dieux. Le scandale et la folie taient au comble, quand la
Rvolution a commenc. Les prtres et les philosophes trai-
taient la religion comme un problme
;
tandis qu'il fallait,
d'un ct, la prcher, et de l'autre, la respecter. Ils n'ont
donc ni les uns ni les autres entendu l'tat de la question;
car il ne s'agit pas de savoir si une religion est vraie ou
fausse, mais si elle est ncessaire. On doit toujours, pour
ne pas sophistiquer, dduire les vrits dans leur ordre :
or, si telle religion n'est pas dmontre, et qu'il soit pour-
tant dmontr qu'elle est ncessaire, alors cette religion
jouit d'une vrit politique. Je vais plus loin, et je dis qu'il
n'y a pas de fausse religion sur la terre, en ce sens que
toute religion est une vraie religion, comme tout pome est
un vrai pome. Une religion dmontre ne diffrerait pas
de la physique ou de la gomtrie
;
ou plutt ce ne serait
pas une religion.
Malgr la diversit des langues, il n'y a qu'une parole
sur la terre : ainsi, malgr la varit des cultes, il n'y a
qu'une religion au monde : c'est le rapport de l'homme
Dieu, le dogme d'une providence, et ce qu'il
y
a d'admi-
rable, c'est que tout peuple croit possder et la plus belle
langue, et la vraie religion. Vouloir les dtromper, c'est
attenter leur bonheur, c'est le crime de la philosophie.
(i) Voir plus loin, page 29G, le Dialofjae entre un roi et un fonda-
teur de religion.
276
RIVAROL
Quand il est vrai qu'il me faut une croyance, il est g-ale-
ment certain qu'il ne me faut pas une dmonstration
;
et
comme ce serait tromper les peuples que de les assembler
sans
reli2:ion,ilest bien inepte auxphilosophesd'avancerque
la relig-ion trompe les peuples. Un peu de philosophie, dit
Bacon,
dcouvre que telle relig-ion ne peut se prouver, et
beaucoup de
philosophie prouve qu'on ne peut s'en passer.
Que les philosophes ouvrent donc les yeux (i): qu'ils
comprennent,
il en est temps, qu'on peut toujours avoir
abstraitement
raison, et tre fou
;
semer partout des vrits,
et n'tre qu'un boute-feu
;
qu'ils demandent des secours,
non des preuves au clerg^; qu'ils se souviennent que Dieu
s'en est repos sur nous de tous nos dveloppements
;
qu'il
n'a pas fait l'homme sans savoir ce que l'homme ferait
;
que c'est en le faisant relig-ieux que Dieu a rellement fait
la relig"ion, et que c'est ainsi que l'Etre suprme opre cer-
tains effets de la seconde main. Mais qu'ils ne traitent pas
cette politique d'hypocrisie, car n'est pas hypocrite qui Test
pour le bonheur de tous
;
qu'ils daig-nent au contraire se
micttre de
moiti dans le grand but de g-ouverner et de faire
prosprer les nations
;
qu'ils entrent au plus tt dans cette
g-nreuse et divine conspiration qui consiste porter dans
l'ordre m^oral l'heureuse harmonie de l'ordre physique de
l'univers.
* *
Les philosophes ne sont au fond que des prtres tardifs
qui, en arrivant, trouvent la place prise par les premiers
prtres qui ont fond les nations. Ils en conoivent de la
jalousie contre leurs rivaux
;
et comme ils ne paraissent
g-ure que vers le dclin des empires dont ils sont assez
souvent les avant-coureurs, les philosophes se servent
des lumires des vieux peuples pour tout renverser, comme
les prtres se servirent de l'ig-norance des peuples naissants
pour tout tablir. Car observez que tous se disputent le peu-
ple, ce magasin toujours subsistant de forces, de richesses
et d'honneurs : c'est l que puisent les ambitieux de toute
( 1 1 Les philosophes sont comme les vers qui piquent et qui percent
les disrues de Hollande : ils prouvent que ces ouvrages sont prissa-
bles, comme l'homme qui les construit
;
mais ils ne prouvent point
qu'ils ne soient pas ncessaires. K.
PHILOSOPHIE
277
espce, et qu'ils trouvent toujours des bras et des armes,
tantt au nom de la relisi^ion, et tantt au nom de la nature.
Nos aeux, dans leurs disputes relig-ieuses, citaient le mme
livre de part et d'autre
;
aujourd'hui, c'est la nature qu'on
invoque des deux cts. L'homme tant compos de besoins
et de passions, les deux partis prennent i^alcment tmoin
la nature de l'homme : nous naissons libres, dit l'un, on
ne peut donc enchaner nos passions sans attenter notre
libert; nous naissons ncessiteux, dit l'autre, il faut donc
donner aux besoins le pas sur les passions. Les uns sou-
tiennent que toute souverainet vient de Dieu qui fait et
conserve tout
;
les autres crient que le vrai souverain, c'est
le peuple qui peut tout dtruire. Ils renouvellent le combat
du bon et du mauvais principe, et les esprits mitoyens qui
crivent pour concilier les deux partis, sont enefl'et les
manichens de la politique.
On mnera toujours les peuples avec ces deux mots, ort^re
et libert : mai l'ordre vise au despotisme, et la libert
1 anarchie. Fatigus du despotisme, les hommes crient la
libert
;
froisss par l'anarchie, ils crient l'ordre. L'espce
humaine est comme l'Ocan, sujette au ;reflux : elle se ba-
lance entre deux rivages qu'elle cherche et fuit tour tour,
en les couvrant sans cesse de ses dbris.
Le plus ardent ennemi de l'ordre politique, Jean-Jacques
Rousseau, dit que l'homme est naturellement libre,
Juste
et bon
; mais ii entend l'homme solitaire
;
c'est se moquer :
il n'y a point de vertu sans relation. A l'gard de qui un
tre solitaire peut-il tre libre,
Juste et bon ? C'est pour-
tant avec cette ide fausse que ce philosophe se lana dans
Tordre politique, cherchant toujours l'homme parmi les
iiommes, l'indpendance entre les liens et les devoirs, la
solitude au sein des villes et accusant toujours une nation
de n'tre pas un homme,
Il Je vais parler en peu de mots de cette libert, de cette jus-
tice et de cette bont primitives de l'homme.
Mais la libert civile et politique n'tant pas de mon sujet,
il faut se contenter de poser ici la dfinition prcise de la
libert personnelle ou franc-arbitre, et l'appliquer en pas-
sant la politique.
Tout tre qui se dtermine lui-mme est puissance :
toute puissance qui n'est pas opprime par une autre est
16
ZyB RIVAROL
libre. Car, obir ses ides, ses passions ou tel autre
motif, c'est obir sa volont, c'est n'obir qu' soi, c'est
tre libre. La libert, pour l'homme, consiste faire ce qu'il
veut dans ce qu'il peut
;
comme sa raison consiste ne pas
vouloir tout ce qu'il peut. Les ides nous arrivent sans notre
consentement
;
mais il nous reste le pouvoir de nous arrter
celle qu'il nous plat. Tout tre qui est ainsi passif et actif
tour tour, n'a pas d'autre libert
;
mais tout tre qui peut
choisir entre un raisonnement et une passion ne doit ni con-
cevoir ni dsirer d'autre libert. L'homme est donc un m-
lang-e de pouvoir et d'impuissance: il
j
a donc dans chacune
de ses actions une partie libre et une partie qui ne l'est pas;
le reg"ret et le repentir tombent toujours sur la partie libre
de nos dterminations. Mais, puisque l'homme se dtermine
toujours par quelque motif, au lieu d'en conclure, comme
certains philosophes, qu'il n'est pas libre, et que par cons-
quent les supplices sont inutiles et injustes, il fallait plutt
convenir d'abord qu'un animal sans motif serait aussi sans'
volont, et ne sortirait pas de l'indiffrence qu'on a folle-
ment appele libert a indiffrence.
Un homme qui se
trouve, par exemple, devant deux routes qui se croisent,
sera-t-il minemment lil)re, parce qu'il ig-norera quelle est
la bonne? Il est, au contraire, enchan par l'indcision
;
sa
volont s'aite dans les tnbres, et cet tat est si pnible
qu'il cherche de toute sa puissance s'en arracher au plus
tt. Il fallait ensuite avouer que, puisque l'homme ne fait
rien sans motif, les supplices sont g-alement utiles et
lsritimes, car o trouver de motif plus puissant que la
crainte de la douleur et de la mort ?
On peut faire une question sing-ulire sur la libert, cet
inpuisable sujet de tant de sophismes
;
on peut, dis-je,
demander si l'homme, quand il doute et reste en suspens,
tient la balance, ous'il est lui-mme la balance? Je rponds
qu'il est la balance elle-mme
;
mais une balance anime
qui sent ce qu'elle pse, et qui ajoute au ct qu'elle pr-
fre le poids toujours victorieux de son consentement.
On connat le fameux problme qui consiste concilier
la libert de l'homme avec son obissance force aux lois
de la nature. La solution de cette difficult est dans la dfi-
nition mme de la sorte de libert dont nous jouissons. Ds
qu'il agit, l'homme commence le mouvement
;
mais il n'-
PHILOSOPHIE
^79
cliappe pas, pour cela, aux lois f^-nrales du mouvcinent
:
il est acteur dans une pice qu'il n'a pas fai(c. et les lg--
res variations qu'il se permet dans son rle ont t prvues
par le matre du spectacle. L'homme l'ait partie de la na-
ture
;
mais sa libert ne consiste pas heurter la nature. Il
obit, soit t^ son insu, soit volontairement, soit forcment,
une suite de lois qucles j;:;-ens inappliqus appellent /msr/rc/
on fortune, les esprits religieux providencp, et la plupart
des philosophes ncpssil : mais il sent qu'il fait ce qu'il
veut etcela lui suffit. Quand onveutcc qu'on dsire, lorsqu'on
un mot 1 on veut ce que l'on veut, on est libre. Ce senti-
ment ne remonte pas au del de la volont. Quelques dia-
lecticiens ont avanc que l'tre qui veut tre heureux n'est
pas libre, puisqu'il est irrsistiblement pouss vers le plai-
sir et le bonheur... Je ne rpondrai pas ces folles subtilits.
Mais une vrit importante qu'il ne faut jamais perdre de
vue, c'est que la libert a t donne aux animaux comme
moyen et non comme but. Ils ne naissent pas, ils ne vivent
pas pour tre libres, mais ils sont libres pour pouvoir vivre
et se perptuer. C'est ainsi que les plantes ont la Hxit : leur
sentiment ne veut pas quitter le sol qui les nourrit
;
celui
des animaux veut chansfcr de place selon le besoin. La
plante qui ne pourrait se fixer, et l'animal qui ne saurait
boug-er, priraient galement.
Expliquons maintenant pourquoi l'homme ne peut con-
server et dployer toute sa libert dans l'ordre social et
politique.
L'homme, en venant au monde, avait deux puissances
exercer, et par consquent deux sortes de libert : l'une,
intrieure, sur le mcanisme de son tre, soit qu'il et
dirig la digestion, la gnration, le cours des humeurs et
leurs scrtions, etc., ou qu'il et matris le jeu de ses ides
et le cours de ses passions
;
l'autre, extrieure, sur l'usage
de ses mouvements et de ses membres dans l'accomplisse-
ment de ses actions.
Mais la nature entre en partage avec l'homme naissant
;
elle se rserve les principales fonctions de la vie, et lui
abandonne la souverainet des autres. C'est dans le dpar-
tement qui lui est confi par la nature, que l'homme est
aussi libre que puissant : sur tout le reste, il est esclave.
C'est ainsi qu'en entrant dans l'ordre social l'homme est
280 RIVAROL
oblig- de compter avec un g-ouvernement, comme la nature
avait compt avec lui lorsqu'il vint au monde. Tout gou-
vernement fait donc avec les hommes le partage des fonds
que leur avait laisss la nature. Il vrifie les pouvoirs, il
tiquette les actions: les unes restent permises, et les autres
indues. L'homme est donc libre sur les premires et esclave
sur les secondes. Il prirait, s'il voulait tout faire dans l'or-
dre physique : et s'il voulait tout retenir dans l'ordre poli-
tique, cet ordre ne saurait subsister. Il est vrai que. pour
qu'un D:ouvernement soit bon, il faut qu'il soit aussi fixe
dans ses limites que la nature dans les siennes, et que les
transg-ressions soient aussi rares que les miracles.
La justice, que j'ai promis de dfinir, n'a pas d'autre
orig-ine que le jug'ement. Que l'homme prononce entre deux
ides, entre deux faits, entre deux individus; qu'il obisse
son g'ot, au rapport de ses sens, la voix de sa cons-
cience, il est g-alement jug-e, et voil pourquoi les lois ne
sont en effet que des juG^ements ports d'avance, des dci-
sions ventuelles applicables tous les cas. On les fait d'a-
vance, pour se donner le plus haut degr de dsintresse-
ment.
Chacun nat avec sa balance particulire; l'ducation et
la socit nous apprennent et nous forcent nous servir des
mmes poids. Car l'homme nat jug-e, mais il ne nat pas
juste dans le sens moral. L'enfant prend tout ce qu'il trouve
et pleure quand il faut restituer.
L'habitude constante de bien appliquer son jug-ement,
s'appelle /MS/essg on justice : justesse, quand nous n'em-
ployons jug'er les choses que nos sens, notre intrt et
notre esprit
;
justice, quand c'est la conscience morale qui
prononce.
Il n'existe et ne peut exister pour l'homme de justesse ou
de justice universelle : tous ses jugements sont relatifs
;
tout est humain dans l'homme; les vertus ne sont des ver-
tus que parce qu'elles sont utiles au g-enre humain. Quand
je prononce sur une cause qui semble m'tre trangre, la
dcision que je porte me regarde
;
car elle peut un jour
m'tre applique moi-mme. La justice universelle, incor-
ruptible, impartiale, est sans doute dans la balance qui a
pes les mondes : la ntre est ne de la crainte et du
besoin. Dieu ne peut donc tre juste de la justice des hom-
PHILOSOPHIE
a8i
mes
;
cl voil pourquoi il nous laisse dtourner noire raison
et noire conscience notre profit. Il n'y a de morale que de
riiunime riiomine.
N'esl-il pas incontestable, par exemple, que tous les ani-
maux ont le mme droit que nous aux bonts de la nature;
(jii'ils sont, comme nous, sensibles la douleur, et que leur
vie est aussi prcieuse que la ntre aux yeux du pre com-
mun ? Et cependant nous usurpons leur domaine, nous les
chassons, nous les tuons, nous vivons de leur chair et nous
buvons leur san" : que dis-je! nous leur tendons une main
perfidement prolectrice, nous leurprodig-uons la nourriture
;
el tantt favorisant leurs amours, tantt les privant des
urces et des plaisirs de la g'nration, nous multiplions et
'US perfectionnons nos victimes : la faim et Tamour, ces
deux g-rands bienfaits de la nature, ne sont entre nos mains
que des piges toujours tendus ces malheureux compa-
gnons de notre sjour sur la terre. Nous faisons tout cela
sans remords,voil qui est incontestable, ainsi que les arg-u-
menls contre la g-uerre
;
et, en attendant, les boucheries
et les champs de bataille sont et seront toujours ouverts aux
besoins et aux fureurs des hommes. C'est que celte vrit
qui nous assimile les animaux n'est pas de l'ordre o nous
vivons; c'est qu'il faut vivre avant de raisonner. Si la nature
produisait tout coup une race suprieure la ntre, nous
.^crions d'abord aussi coupables que les requins et les loups.
Quant la bont nave de l'homme, c'est un tre de rai-
son, si on entend par l une bont morale. L'homme nat
avec des organes physiquement bons et avec des besoins
utiles; mais il n'est l rien de moral : s'il naissait bon ou
mauvais, il natrait homme fait et dtermin
;
rien ne pour-
rait ni le convertir ni le pervertir. 3Iais l'homme nat propre
devenir juste ou injuste, surtout tre l'un et l'autre, et
en gnral, n'tre que mdiocrement bon et mdiocrement
mchant.
L'enfant exerce d'abord sa volont sur tout ce qui l'envi-
! onne : si on lui cde en tout, il devient tyran
;
si on lui
rsiste arbitrairement en tout, il devient esclave : point de
milieu. Mais une ducation dirige avec quelque bon sens
le conduit aux ides de libert et de vertu, tat raisonn o
il n'aurait su parvenir seul.
L'ducation se compose de rsistances ncessaires et de
i6.
282 RIVAROL
justes condescendances : c'est une transaction perptuelle
des volonts et des besoins d'un homme, avec les besoins et
les volonts des autres : c'est un fonds plac sur un enfant,
dont lui et la socit retirent les fruits.
La morale, la religion et les lois concourent ce grand
uvre de l'ducation de l'homme : mais la morale ne peut
que conseiller
;
la loi ne peut que protcg'er et punir
;
la re-
lig-ion seule persuade, rcompense, punit et pardonne : elle
suppose l'homme frasrile, le conserve bon ou le rachte cou-
pable. En un mot, l'homme nat volontaire et animal d'ha-
bitude : le gouvernement le protge, la ncessit le plie, le
monde le dirige, la morale l'avertit et la religion le ramne.
Sensible par nature et sans effort, ce n'est pas sans effort et
sans aider la nature qu'il devient enfin l'tre social et rai-
sonnable par excellence. Ce n'est qu' cette heureuse po-
que d'une ducation affermie, que la vraie philosophie peut
se montrer lui sans danger, et fixer ses regards sans
l'blouir. Jusque-l, elle n'a rien fait pour lui... Mais je me
trompe
;
c'est la vraie philosophie qui a mis en avant et le
monde et la ncessit et la morale et la religion, et quand
Tlmaque approche du but, c'est encore elle qui laisse
tomber ses voiles et lui dcouvre que Mentor et Minerve,
c'est--dire, l'instruction et la sagesse, ne diffrent pas d
la vraie philosophie.
Enfin l'homme de la nature, ce n'est pas l'homme soli-
taire, mais l'homme social : en voici la preuve. Il faut,
pour obtenir un homme solitaire dans un dsert, le priver
de son pre, de sa mre et d'une femme : et dans la socit
il faut ou qu'une certaine philosophie morose le rlgue
dans la solitude, ou que certaines ides religieuses le confi-
nent dans une cellule, ou qu'enfin la tyrannie ou les lois le
plongent dans leurs cachots. Il faut donc des efforts pour
obtenir l'homme solitaire
;
mais il suffit d'abandonner
l'homme lui-mme, pour le voir aussitt en socit. C'est
donc l'homme social qui est l'homme de la nature
;
l'tat
solitaire est donc un tat artificiel. Aussi, quand des indi-
vidus pars et sauva^-es se runissent quelque peuple que
|
ce soit, ils quittent, pour ainsi dire, le rgne animal, pour
i
s'agrger au genre humain. L'homme solitaire ne peut
figurer que dans l'histoire naturelle; encore ysera-t-il tou-
jours un phnomne. On rougit de perdre le temps et la
I
piin.osopniG
283
parole flfondrc fies vrits si triviales
;
mais la honte en
est ceux qui nous
y
rduisent : c'est que le bon sens est
riirore plus rare que la probit.
Ce n'est pas pour avoir ip^nor ces vrits que je prends
irtie les nouveaux pliloso})hes, mais pour les avoir com-
iltucs et presque tou fies sous la multitude de leurs para-
doxes
;
pour tre parvenus dgoter une grande nation
do son exprience et de son bon sens, la fatif^-uer de sa
])rosprit, lui Taire lionle de son ancienne gloire; pour
avoir, le jour mme de leur toute-puissance, compos leur
ff'claration des droits de ihoinmp, cette prface crimi-
nelle d'un livre impossil)le-, pour avoir oubli que, de toutes
les autorits, celle qui le peuple ol)it le moins, ou d'une
manire plus versatile, c'est lui-mme; pour avoir mconnu
la loi des proportions dans un empire, et confondu sans
cosse la souverainet avec la proprit; pour avoir tent
l'homme social avec l'indpendance de l'homme des bois;
])Our s'tre donn comme auxiliaires les brig-ands qu'ils se
jtlaig-nent d'avoir aujourd'hui pour matres; pour avoir cru
({u'on pouvait, sans corrompre la morale publique, honnir
el prostituer tour tour le serment, dpouiller deux cents
mille propritaires, et applaudir aux premiers meurtres qui
onsanglanlrent les mains du peuple; pour avoir cru ou
feint de croire qu'il
y
avait dans ce peuple plus de malheu-
reux que d'ig-norants et plus de misres que de vices (car,
(le ce qu'une rvolution s'opre par les fautes de la cour, il
no
faut pas conclure qu'elle se fait par les vertus du peu-
]!l(^); pour avoir dit: dshonorons Vhonneur et, nouveaux
Mzences, condamnons les hommes au supplice de
l'ffa-
Il t; pour avoir soutenu que, leur rvolution teint sans
exemple, on ne pouvait leur opposer ni le raisonnement, ni
l'histoire, ni l'exprience; pour avoir, en semant la dmo-
eiatie dans leur constitution, tabli un long- et sanglant duel
entre la population et le territoire de l'empire; pour s'tre
enfin dissimul que le plus norme des crimes, c'est de com-
promettre l'existence des corps politiques, puisqu'ils sont
la fois les g-rands conservatoires de l'espce humaine et les
plus g-randes copies de la cration.
En effet, aprs l'univers et l'homme, il n'existe pas de
plus belle composition que ces vastes corps dont l'homme
et la terre sont les deux moitis, et qui vivent des inventions
284
RIVAROL
de l'un et des productions de l'autre. Sublimes alliances
de
la nature et de l'art, qui se
composent d'harmonies et dont
la ncessit forme et serre les nuds! C'est l que l'espce
humaine se dveloppe dans tout son clat; qu'elle fleurit
^
fructifie
infatieablement; que les actions naturelles devien-
nent morales ;
que l'homme est sacr pour Ihomme; que sa
naissance est
constate, sa ^-ie assure et sa mort honore.
C'est l qu'il s'ternise, qu'il recommence, je ne dis pas
dans un enfant que le hasard lui aura donn, mais dans
l'hritier de son nom, de son rang-, de sa fortune et de ses
honneurs, enfin dans un autre lui-mme. L, ses dernires
volonts sont
recueillies; elles deviennent lois; un homme
mort est encore
puissance, et sa voix est entendue et res-
pecte. C'est l que chacun a la force de tous, le fruit du
travail de tous, sans craindre l'oppression de tous. C'est
dans le corps
politique que le erenre humain est toujours
eune. toujours
anim du double esprit de famille et de
proprit. C'est
enfin l que les peuples sont autant de
gants qui comptent leurs annes par les g-nrations, qui
aplanissent les monts, qui marchent sur les mers, embras-
sent, fcondent,
connaissent et matrisent le g-lohke qu'ils
habitent. C'est
pourtant cela que nos philosophes n'ont
pas respect.
En vovant l'homme nu, rduit ses seuls orgranes, sup-
posons qu'une voix se ft leve et et dit : u Donnons
cet tre une ^-itesse double de la sienne; qu'il parcoure U
terre sans se lasser ;
qu'il franchisse l'Ocan et fasse le
c tour du monde
;
qu'il emporte sa maison avec lui par mer
u et par terre
;
que les murs transparents et solides de cette
maison flottante ou roulante ne laissent passer que
k
({ lumire.et le dfendent de la pluie et des vents; qu'il ait
(( l'toile polaire sa disposition, le temps et la foudre dans
u ses mains ;
ou qu'ennn, immobile et paisible dans ssi
demeure, il fasse partir ses volonts et entendre sa pense
d'un bout de la terre l'autre. Le monde se ft cri:
c( Vous voulez donc en faire un Dieu I Et c'est cependant
l ce qui est arriv : l'homme mont sur un vaisseau, port
dans sa voiture, muni d'une boussole, d'une montre, d'uiir
plume et d'une arme feu, a ralis le prodiere
;
et ce grani
pas ne sera point le dernier : car, dans la carrire des art
o finit l'homme
qui prcde, commence l'homme qui suit.
PHILOSOPHIE 285
il, en peu de mots, l'abrsi- des merveilles qui rsul-
tent Je la runion politique des hommes; et c'est cela pour-
tant que nos philosophes n'ont pas respect.
Ah ! si du moins ils eussent report leurs yeux vers le
triste dbut du g-enre humain, ils auraient vu de combien
Je larmes et de sang- fut arros son berceau : car, en dcou-
vrant l'Amrique, nous avons assist l'^-e d'or; l'homme
la nature a t pris sur le fait. Ces g-rands mots ne peu-
nt plus nous faire illusion. Combien de sicles d'anthro-
!)ha2rie! que d'essais malheureux! que de petits corps po-
:ques avorts ou crass, avant qu'un lgislateur conqu-
:.t ou religieux leur et donn des formes fixes! Mais il
: du destin de nos philosophes de ne lire ni dans les archi-
>
du temps, ni dans les patentes de la nature : et ce qui
. bien plus digne de piti, leurs victimes ont partag leur
:-ugle dlire. L'homme prendra toujours pour ses amis les
nemis de ses ennemis. Les gouvernements n'taient pas
;is ; les philosophes les attaquaient, et le peuple les crut
-
amis! L'enchantement fut rciproque : les philosophes
Lirent aimer le peuple. Mais le pouvoir dont l'essence est
le s'allier la bont et la fixit dans les ttes saines fer-
nenta et s'aigrit dans celles Je nos philosophes. C'est inu-
ement qu'ristote avait dfini la loi, une me sans pas-
sas; les philosophes, devenus souverains, n'entendirent
:? l'a voix des passions et ne parlrent que leur langue.
is virent le monde, la raison et la postrit dans l'troit et
ougueux thtre de leurs tribunes; ils prirent la contagion
ur le succs; ils admirrent tout, jusqu'au jour o ils
mblrent. La mort et l'exil les ont surpris entre ce qu'ils
ulaient faire et ce qu'ils ont fait, je veux dire entre les
ves de l'ambition et les uvres de la sottise.
Vaincus ils
t mrit leurs revers, sans qu'on puisse dire que les vain-
leurs aient mrit leurs succs : on ne saurait parler d'eux
ec justice, sans avoir l'air J'en parler avec mpris. Que
user, en effet, d'un corps lgislatif qui dit sans cesse :
vh! si la nature et la ncessit nous eussent laisss faire!
Allgueront-ils aujourd'hui que le temps et la fortune
t manqu leur rgne ? Ouatre annes, je ne dis pas de
u mission, mais d'enthousiasme, l'ont signal. Se plain-
ont-ils du Jfaut Je lumires et d'avertissements? On leur
lera toutes les prdictions Jont ils se sont moqus
;
et les
286
RIVAROL
cris et les larmes des propritaires, dont ils ont ri
;
et les
efforts et les plans des monstres, qu'ils ont connus et favo-
riss. N'est-ce pas dans les assembles rvolutionnaires que
se concertaient les lois et les dcrets de chaque jour? N'est-ce
pas l que les dputs du peuple allaient s'armer del force
qu'ils dployaient dans le corps lsrislatif? Les titres de pa
iriote ei de rvolutionnairene devinrent-ils pas synonymes?
Mais nous n'avons gorg personne! diront-ils : plaisante
humanit que de laisser la vie qui on te les moyens de
vivre! Vous avez oubli dq^org-er : c'est dans la carrire du
crime le seul oubli qu'on vous connaisse, et on en est rduit
expliquer le mal que vous n'avez pasfait. Sivous prtendez
donc ne point tre responsables des crimes dmesurs de
vos allis, la postrit, qui sait mieux que nous placer ses
mpris et ses haines, prononcera
;
elle prononcera entre
ceux qui ont par la victime et ceux qui l'ont immole,
entre les conseillers du crime et ses excuteurs
;
elle verra
si les principes ne sont pas toujours plus coupables que les
consquences (car la philosophie moderne n'est autre chose
que les passions armes de principes] : elle verra, dis-je
s'il n'est pas dans l'ordre qu'on fasse trembler ceux qu'on
n"a pu faire roug"ir, et qu on rende odieux ceux qu'on n'a
pu rendre justes
;
si on doit quelque piti ou mme quelque
indulg"ence des esprits superbes qui se sont placs volon-
tairement entre un pass sans excuse et un avenir sans
espoir
;
si, en dernier rsultat, la raison ne prescrit pas de
ranger le jacobinisme parmi les ouragans, les pestes et les
flaux qui dsolent la terre. Il n'y a que la brute qui morde
la pierre qu'on lance
;
mais l'homme voit la main qui le
frappe, et les philosophes ne donneront pas le changea nos
douleurs. Enfin la postrit dira jusqu' quel point les
peuples eux-mmes ont mrit leurs malheurs: car ils furent
instruments avant d'tre victimes, inhumains avant d'tre
malheureux
;
et la prosprit les avait aveugls avant mme
que la puissance et gar leurs chefs.
FRAGMEiNTS ET PENSES PHILOSOPHIQUES
DU BONHEUR
On sait que les plaisirs naturels sont simples
;
on ne peut
!os analyser
;
mais on analyse le bonheur. Chaque g-e,
chaque imagination s'en compose un son g-r. Les plaisirs
physiques sont des instants que les sens drobent la
pense : mais on ne conoit pas le bonheur en dlire. Hobbes
dit que le bonheur serait de russir toujours : en effet,
chaque but atteint est moment de bonheur. Mais le charme
vient sans doute de la raret ou des obstacles
;
l'homme qui
russirait sans interruption et sans rsistance, se lasserait
d'enfanter dsir sur dsir. La volont, comme l'apptit, ne
peut se passer d'intervalles.
On appelle donc bonheurs les choses heureuses, les succs
accidentels. Il
y
a aussi des bonheurs ns^atifs, comme
d'chapper un pril, de n'tre pas aussi malheureux qu'on
pourrait l'tre, etc. Le nom de bonheur lui-mme prouve
?[ue nos pres n'ont port que fort tard leurs vues vers une
licit durable. Car le bonheur et le malheur ne sig-nifient,
au fond, que bonne ou mauvaise heure; et nous avons dit
lon^temp^3, bien heure et mal heure, pour heureux et
malheureux (i).
Le bonheur en gnral fait plus de flatteurs et d'envieux
que le mrite
;
parce qu'il blouit et irrite plus de monde;
le mrite ne frappe et ne blesse qu'une certaine classe.
D'ailleurs le mrite peut tre malheureux et l'est souvent
;
ce qui rconcilie avec lui.
C'est, d'un ct, une chose remarquable que la tranquille
inattention, l'ingratitude habituelle avec laquelle on jouit
(i) Un bon esprit parat souvent heureux,comme. un homme bien fait
parat souvent adroit. K. Hivarol ne pouvait savoir que heur dans
bonheur reprsente aujurium 'prsage, chance, et non hora.
288 RIVAROL
des dons essentiels de la nature, comme de la vue, par
exemple; et de l'autre, le dsespoir qui nous saisit, si quel-
que accident nous en prive. C'est tout le contraire pour les
choses de l'art : on jouit d'un bon spectacle avec des trans-
ports qui n'ont d'gal que la facilit de s'en passer.
Entre la jeunesse et la vieillesse, la dit'rence, pour le
bonheur, est du mouvement au repos, des esprances aux
souvenirs, du pouvoir l'impuissance. Le mouvement
attrape plus d'aventures bonnes ou mauvaises
;
le repos se
drobe mieux aux unes et aux autres. C'est donc dans la
jeunesse qu'on est minemment heureux ou malheureux:
|
le vieillard reste sous le bouclier de son insensibilit; il n'a
qu'un bonheur ng"atif.
On ne pleure jamais tant que dans Yage des esprances;
mais quand on n'a plus d'espoir, on voit tout d'un il sec,
et le calme nat de 1 impuissance. Les pavots de la vieillesse
s'interposent entre la vie et la mort, pour nous faire oublier
Tune et nous assoupir sur l'autre. Si on carte les infirmi-
ts de l'ge, il n'y aura de vieillards malheureux que ceux|
dans qui les dsirs survivent aux facults. La victime qui
se pare de roses rend son sacrifice plus douloureux, et les
souvenirs sans espoir ne sont que des regrets.
Il est triste d'avoir un grand nom et de manquer de for-
tune; d'avoir une grande fortune et de manquer de nais-
sance
;
d'avoir de la naissance et de la fortune, et de man-
quer d'esprit
;
d'avoir de l'esprit et de manquer de consid-
ration
;
d'avoir enfin une ducation distingue et de vivre
avec des gens du peuple. Il n'est pas moms vrai que, de
son ct, rhomme du peuple est la gne avec les hautes
classes
;
et que si la science gmit du voisinage de l'igno-
rance, celle-ci fuit son tour les communications avec le m-
rite. Il semble donc que le bonheur soit harmonie; et c'estl
en effet dans l'harmonie que se trouverait le bonheur, si les!
passions et l'ennui ne venaient trop souvent corrompre les
dons de la fortune et les fruits de l'industrie et de la sa-
gesse.
Comme les proportions sont mieux gardes dans les tats
mdiocres, parce qu'ils sont aussi loigns des grandes pros-
prits que des grandes infortunes, et qu'on n'y a, ni trop
nglig, ni trop fatigu son esprit, c'est l qu'on trouve sou
vent quelque image du bonheur. Les conditions mdiocres
PHILOSOPHIE
189
ne fournissent pas, il est vrai, des sujets l'histoire ou
l'pope; mais les hommes d'un certain ordre savent bien
ce qu'il en cote pour occuper les reg-ards de ses contempo-
rains et fixer Tattention de la postrit.
C'est donc une ide populaire et fausse que le bonheur
soit attach aux hautes conditions
;
et les philosophes, qui
ont si souvent consi^^n dans leurs livres 1 log-e de la m-
diocrit, qui l'ont si souvent applaudie sur les thtres,
devraient rougir d'avoir soulev le peuple, l'aide de cette
envie naturelle aux hommes, qui leur t'ait har ceux qu'ils
supposent heureux, et porter plus impatiemment les plaisirs
d'autrui que leurs propres peines.
On peut avoir g-ot de tout, tre couvert de gloire, com-
bl de biens, avoir mme connu le malheur, et soupirer de
fatigue ou scher d'ennui au sein de tant de flicits appa-
rentes. Mais si ia tristesse est si prs de la fortune, pourquoi
l'envie est-elle si loin de la piti ?
Qu'on ne s'tonne donc pas qu'il soit si difficile de dfinir
ce qu'il est si rare de rencontrer, ce qu'il est peut-tre impos-
sible de se bien reprsenter. Il est plus facile l'imagination
de se composer un enfer avec la douleur qu'un paradis avec
le plaisir (i). Il faut donc s'en tenir notre destin, et voir
si on ne trouverait pas dans le caractre des hommes ce
qu'on n'aperoit gure dans leurs conditions.
En gnral, les hommes aiment mieux tre insolents
qu'heureux, et opprims qu'humilis; et voil pourquoi les
gards font moins d'ingrats que les services, parce que les
gards parlent la vanit, et que les services ne s'adressent
u'aux besoins. D'o il rsulte que la hauteur se fait plus
'ennemis que la cruaut: cequi explique, en quelque sorte,
les revers des cours et les succs des rvolutions.
Ainsi le bonheur ou le malheur, et c'est une vrit d'ex-
)rience, dpendent presque toujours du caractre, tant pour
es individus que pour les peuples. (Discours prl.)
LE DISTE-THOLOGIEN
Diste-thologien : on s'est servi de cette expression pour
(i) Le dsir est la passion ce que le plaisir est au bonheur : mais
le dsir devient sourent passion, et nul plaisir n'est encore devenu
- bonheur. R.
7
foi
agO
RIVAROL
disting-uer M. Necker du diste-philosophe. Celui-ci n'osa
pas prononcer sur la ncessit d'un culte; il admet un Dieu
formateur de l'univers, qui doit runir toutes les perfec-
tions ncessaires son essence, et non telles que nous les
imag-inons. Il ne croit pas que la morale ait besoin des
promesses d'un paradis ou des peines de l'enfer, pour diri-
g-er
l'honnte homme, et le rendre heureux. Il ne croit pas
enfin que l'Evang-ile ait rien appris aux hommes en fait de
morale: le pardon des injures, la modestie, la charit, etc.,
tout cela est fortement recommand dans tous les anciens
moralistes. L'Evang-ile les a copis; et dire que sa morale
est plus parfaite que celle de Zenon ou de Cicron, est une
de ces fraudes pieuses qu'on ne devrait plus se permettre,
d'autant que la relig-ion chrtienne n'en a pas besoin, L'E-
vangile nous a appris que les Gieux s'ouvraient une
certaine hauteur
;
qu'il
y
avait trois personnes en Dieu
;
que
la troisime personne descendait en forme de colombe; que
la seconde personne viendrait jug-er les vivants et les morts;
que le diable entrait dans le corps des g"ens, etc.. Voil
incontestablement ce que l'Evano'iie nous a appris, et ce
que l'esprit humain n'aurait pu imaginer, tant la science
est impuissante et vaine! [Lettres M. Necker,)
LA LOI DES PROPORTIONS
Notre sensibilit pour tout ce qui respire et souffre comme
nous est sujette la loi des proportions. Nous paraissons
moins cruels en crasant un insecte qu'en tuant un oiseau,
un animal sang blanc qu'un animal sang rouge, et
nous engloutissons une hutre vivante sans horreur. Les
communications plus ou moins intimes de certains animaux
avec l'homme dcident aussi de son indiffrence
,
de sa
piti et de sa cruaut. Si vous tuez la poule d'un fermier,
un cu peut le satisfaire; mais si vous tuez son chien, un
cu, loin d'tre une compensation, peut lui sembler un
outrage de plus.
La gloire et la honte, le succs et la puissance dpendent
encore des proportions
;
elles sparent le meurtrier du hros
et le voleur du conqurant. Si vous ne trompez que quel-
ques personnes, vous ne vous tirerez pas du rang des
fourbes; mais celui qui trompe tout un peuple s'lve la
PHILOSOPHIE
291
lgislature et l'empire, et celui-l est matre des hommes,
qui enlve et non qui mrite les suffras'es.Il en est de mme
de l'or et Je ses corruptions: la quantit rend excusable,
dit La Fontaine. On jug-e encore des malheurs
comme des
vices, dont on rougit d'autant moins qu'on les partag-e avec
plus de monde. Il est prouv par les rvolutions des em-
fres
que les malheureux tirent toute leur consolation de
eur nombre. Enfin il est des vertus interdites la jiauvret
et on ne fait pas un mrite de la continence qui la nature
en fait une ncessit.
L'amour connat aussi la loi des proportions; une HUe
encore enfant ne dit rien nos sens.
Voyez un gant et nn nain partir ensemble : ils seront
du premier pas et pour toujours ing-aux
par les espaces,
quoique toujours dans des temps i^aux.
La jeunesse est plus timide dans le salon que dans la rue,
dans les petites villes que dans les g-randes capitales:
c'est
que dans les g-randes villes on ne se connat pas, et on est
moins accabl du regard public.
La vie tant un tout, c'est--dire ayant un commence-
ment, un milieu et une fin, il n'importe pas qu'elle soit
d'une longue ou d'une courte dure; mais il importe
qu'elle
ait ses proportions. Ce n'est donc
p
is de la brivet de la
vie qu'on a droit de se plaindre, mais d'une mort
prcoce,
puisqu'une telle mort n'est pas la fin, mais l'interruption
de la vie. Aussi Snque dit trs bien que les funrailles
d'un homme sont toujours prmatures lorsque sa mre
y
assiste.
La figure du globe que nous habitons s'est longtemps
drobe nos regards par l'efet de ses proportions.
L'homme
tait sur la terre comme un ciron sur une statue, sans en
souponner la forme; et, de mme que cette plante offre
l'homme des montagnes et des prcipices, tandis que la
lune, cause de sa distance, lui parat aussi ronde
qu'unie,
de mme il peut exister tel animalcule qui voie des creux et
des minences sur le marbre le plus poli.
C'est aussi par l'noriiiit de ses proportions et de ses
espaces que la terre rsiste nos consommations. Si nous
brlons dans un jour un arbre qui lui cote un sicle,
elle
oppose l'immensit de ses forets nos petits foyers,
comme
ses vastes et fertiles plaines nos estomacs troits et vora-
2Q2
I\IVAI\OL
ces. Aussi les armes, qui runissent 1 tendue la voracit,,
affament d'abord tout un pays.
Enfin les
proportions nous tirent des questions pineuses
sur les
nomenclatures. Par exemple, les genres et les classes
de Ihistoire
naturelle sont notre ouvrage : c'est donc nous
trouver des caractres bien distincts pour tablir nos m-
thodf'S et
soulager notre mmoire. La nature ne rpond que
des
espces et des individus, et, avec la fixit de ses sub-
stances
lmentaires, nous n'avons craindre ni la dispari-
tion des espces connues, ni d'en voir paratre d'inconnues.
Nous
appelons individus les tres organiss qui ne peuvent
tre diviss sans cesser d'tre la mme personne. Ainsi, l'aile
d'un oiseau n'est plus un oiseau; une branche n'est plus
l'arbre: mais une fraction de pierre est toujours une pierre.
Quant aux noms collectifs donns aux diffrents objets de
la nature et de l'art, c'ost nos proportions, el non la ri-
gueur
mathmatique, dcider la question. La diffrence
d'une montagne une colline, ou d'une arme un corps
de troupes, ne tient pas un srrain de sable ou un soldat
de plus ou de moins, et ce n'est pas une maison ou un
verre d'eau qui distinguent une ville d'un village, ou une
rivire d'un ruisseau : on ne juge les masses que par les
proportions.
Je ne saurais trop inviter le lecteur mditer sur l'effet
des proportions, non seulement de celles qui constituent les
formes et les diffrentes parties d'un animal, d'une statue
ou d'un tableau, mais encore de ces proportions universelles
de masses et de quantits qui rsultent de la comparaison
de tous les tres : car, si l'tude des premires forme le
got, la connaissance des autres agrandit l'esprit et lui fait
acqurir la facult de la rcrie et du compas, je veux dire la
facult de s'tendre sans s'garer. Les gnies indcis aiment
l'exai^'ration et s'puisent en conceptions extrmes et soli-
taires
;
mais la connaissance et l'amour des proportions dis-
tinguent les esprits justes et les conduisent aux dcouvertes
par les analogies. Ce n'est point de son imagination que
Newton obtint la dissection de lajumire et la cause des
lois astronomiques de Kepler. Il faut donc, comme lui et
tous les grands observateurs, s'attacher l'clatante certi-
tude des faits et des proportions, et mditer ensuite sur les
analogies, qui sont les articles de foi du gnie. Les faits,
PHILOSOPHIE
293
les proportions et les analog-ies conduisent Tordre gn-
ral, l'ordre g-cnral aux lois, et les lois au lj^islateur su-
prme. C'est alors que l'univers pse de tout le poids de sa
majest sur un esprit bien fait, tandis que pour l'homme
inattentif le svstrme du monde est comme ratmos[)hre,
qu'on porte et qu'on ne sent ^d.?,.( Discours prliminaire.)
SLR L EGALITli:
L'g-alit indfinie parmi les hommes, tant un des rves
les plus extraordinaires decette philosophie,mrite ici quel-
ques moments d'attention.
Au lieu de statuer que la loi serait gale pour tous les
hommes, ils dcrtrent que les hommes taient naturelle-
ment gaux sans restriction. ]Mais il
y
a une chose dont on
ne pourra jamais dcrter l'galit
;
ce sont les conditions,
les talents, les rangs et les fortunes. S'ils eussentdit que tou-
tes les conditions sont gales, on se serait moqu d'eux
;
ils
ne dcrtrent donc que l'galit des hommes, prfrant
ainsi le danger au ridicule : je dis le danger
;
car les hom-
mes tant dclars gafix, et les conditions restant ingales,
il devait en rsulter un choc pouvantable. Heureusement
que les dcrets des philosophes ne sont pas des lois de la
nature
;
elle a voulu des hommes ingaux avec des condi-
tions et des fortunes ingales, comme nous voulons des an-
neaux ingaux pour des doigts ingaux
;
d'o rsulte l'har-
monie gnrale. C'est ainsi qu'en gomtrie la pari t rsulte
des impairs avec les impairs, tandis que des impairs avec des
pairs ne produiraient jamais que des impairs. Qu'importe
donc aux hommes d'tre dclars gaux, si les conditions
doivent rester ingales ? Il faut au contraire se rjouir quand
on voit des hommestrs borns dans des conditions trs basses;
comme il faudrait s'affliger si la loi portait des brutes dans
les grands emplois, et repoussait l'homme de gnie vers les
Professions
serviles et mcaniques. L'ingalit est donc
me des corps politiques, la cause efiicientedes mouvements
rguliers et de l'ordre.
C'est que les philosophes ont confondu l'galit avec la
ressemblance. Les hommes naisseat en effet semblables,
mais non pas gaux. {lid.)
29^
IVIVAROL
L*nYPOCRISIE ET LE FANATISME
L'hvpocrisie est proprement le vice de Thomme en socit,
pour cleux raisons g-atement frappantes. L'une, que Thoin-
me est le seul animal chez qui le sentiment se replie sur
lui-mme,
pour
y
contrarier la vrit des sensations et la
navet des impulsions naturelles : cette facult est la fois
pour lui source de rflexion et de fourberie. L'autre, que
nous sommes la seule espce qui vive sous un pacte social,
et par consquent la seule qui puisse
y
manquer, en abu-
sant de la parole contre la vrit, du serment contre la con-
science et de la foi publique contre toute la socit.
Cet odieux sentiment qui fait prendre au vice les dehor
de la vertu
;
qui fait qu'un sclrat recommande la probit
son fils
;
qui force, en un mot, le crime n'ourdir sa
trame que dans l'ombre
;
ce sentiment, dis-je, est pourtant
une des sauveg-ardes de l'ordre social. Car, si le sclrat
lui-mme s'appelait hautement sclrat, si le brigand s'in-
titulait 6r/^a/ic/, tout serait perdu (i ).
Ce mensong-e du
crime, ces prcautions du vice sont, selon l'heureuse expres-
sion de La Pvochefoucauld, des hommages la vertu et des
mnagements pour le genre humain. xMais le fanatisme
menace galement et la vie de l'individu qui en est atteint,
et le salut des gouvernements qui le tolrent.
C'est un tat d'exaltation et de dlire rsultant du con-
cours d'une passion dominatrice et d'une ide qui s'asservit
toutes nos ides. Tout tat d'exaltation se prsente sous deux
faces.
Quand cet tat a pour cause une ide qui, pour nou
dominer, a besoin de se concentrer, alors il ne corrompt e
ne trouble que la raison et le repos de l'individu qui en est
malade. L'amour, parexemple, a son idoltrie : mais entr
deux amants dvors des mmes feux, chacun d'eux voit le
monde entier dans l'objet qu'il adore, et un cur plein de
sa divinit ne lui cherche g-ure d'autres adorateurs. On
a cependant vu des chevaliers errantsec quelques princes ga-
rs par la passion, forcer les hommages des passants et des
(i) C'est ce qui est arriv dans la Rvolution, quand les Jacobins ont
eu la franchise de s'appeler braves brigands.
PHILOSOPHIE
295
peuples entiers, en dressant des
temples l'objetdeleur culte
particulier ileuramourtait un fanatisme. Iln'enestpasainsi
de cette soif ardente, queVirg-ile a
pourtant nomme le
fana-
tisme de ior {auri sacra fames}\
cette passion ne cherche
pasde proslytes. Car ce n'est
pointauxopinions,ce n'est point
aux hommages qu'elle vise, mais l'or et l'accumulation
des proprits de toute espce, par toutes les routes de la
fortune, de l'industrie et ctu crime; ce qui la disting-ue du
fanatisme rclig-ieux, du fanatisme des conqutes et de l'a-
varice ordinaire, qui se contente de couver son trsor. Cette
ardeur, cette pret du lucre est le caractre dominant des
capitaleset des villescommcrantes : etsi, parmi tant d'hom-
mes qui se STorg-ent de richesses, il en est si peu d'heureux,
c'est que les moyens qui rendent un homme propre faire
fortune sont les mmes qui l'empchent d'en jouir.
Mais, quand une passion a besoin, pour s'exhaler, de
rg'ner ou d'tendre son empire, d'asservir ou de perscu-
ter, alors elle fait explosion, devient pidmique et occa-
sionne ces dplacements de peuples, ces fivres nationales
qui dsolent la terre et renversent des tats : de l les con-
qutes politiques et relig-ieuses.
S'il n'est point d'ide plus entranante ni de passion plus
raisonnable que celle de son bonheur dans une autre vie,
puisqu'alors c'est l'amour de soi sollicit par la perspective
de l'ternit, il n'est point aussi de passion plus forcene
que celle-l. quand elle se fonde sur l'ide que Dieu nous
tiendra compte de ses missions et de ses conqutes, de l'en-
vahissement des opinions et mme de l'oppression des cons-
ciences C'est le ct sacr de cette passion qui lui a valu le
nom t fanatisme.
Mais, lorsque les hommes s'gorg-ent au nom de quel-
ques principes philosophiques ou politiques;
lorsqu'ils font,
pour tablir la domination de leurs dog-mes, tout ce que le
fanatisme religieux a os pour les siens, alors, quoiqu'ils
bornent leur empire la vie prsente, il n'en est pas moins
certain que leur philosophie a son fanatisme, et c'est une
vrit dont les sag-es du sicle ne se sont pas douts. (Ibi-
dem.)
2g
DIALOGUE ENTRE UN ROI ET UN FONDATEUR
DE RELIGION (l)
LE ROI.
Comment, imposteur, tu viens fonder dans
mes Etats une fausse relig-ion?
l'aptre.
Sire, ma religion n'est pas fausse et ne peut
l'tre.
LE R.
Quoi, tu vas donc me prouver ta relig-ion?
l'a.
Non, Sire, je vais la prcher.
LE R.
Tu la prches donc sans la prouver, et peut-
tre sans la croire? Elle est donc fausse.
l'a.
Sire, il n'y a pas de fausse religion; j'en
appelle vos ministres; toute relig"ion est une vraie religion
comme un pome est vritablement un pome. Si je venais
dire vos sujets que ^ et 2
font
4,
qn il
faut
tre juste et
bon, etc., ce ne serait alors que de l'arithmtique ou del
morale queje leur apporterais, et vous pourriez vous fcher;
mais je viens leur annoncer que 2 et 2
font 5,
que
Je
suis
fils du Soleil, etc. Ainsi, accordez-moi protection et argent.
Laissez-moi prcher, btissons des temples. Car c'est vrita-
blement une religion que je vous apporte.
le r.
J'ai tort, il est vident que vous savez mieux
que m.oi ce que c'est qu'une religion. Les philosophes m'ont
tromp : ils m'ont dit que toute religion tait fausse : ils
n'ont pas entendu l'tat de la question. S'il
y
avait une reli-
gion vraie, elle serait unique sur la terre, comme la go-
mtrie, ou plutt, ce ne serait pas une religion. Il est vrai
que c'est la faute des prlres de tout pays qui veulent tou-
jours prouver leur religion, comme une action en justice
rgle ou une proposition de gomtrie. Ainsi, philosophes
et prtres ont galement tort. Vous m'avez clair. Il ne s'a-
git donc plus que de savoir si votre religion est bonne ou
mauvaise, et non si elle est vraie ou fausse.
l'a.
Sire, la mienne est bonne, car j'ai ml
mes dogmes et mes mystres toute la morale des Chinois,
des Grecs, des Romains, des Egyptiens, des Perses, etc., en
(i) Publi pour la premire fois d'aprs M. A. Le Breton {Riuarol,
p, 258j, qui l'a copi dans les carnets. La mme ide se retrouve dans
le Discours prliminaire . Voir pius haut, page 275.
PHILOSOJ'IlIt:
297
un mot la morale qui est une et par consquent vraie d'un
bout de la terre l'autre, puisqu'on dit bien les relig-ions;
mais il faut dire la morale.
LE R.
C'est trs bien; mais j'ai dj une relig^ion dans
mes Etats, et je ne me soucie pas d'lever autel contre
jiutel, de diviser mes sujets, de les cliarg-er de l'entretien de
plusieurs cultes.
l'a.
En ce cas, je vais offrir mes services aux
eu pies qui n'ont pas encore de religion, ou ceux qui les
dmettent toutes, car il en est de noiis autres aptres
omme des commerants : nous ne portons nos denres
qu'aux nations qui en manquent tout fait ou qui en font
beaucoup de demandes. A moins pourtant, Sire, que, mal-
gr vos prohibitions, je ne trouve le secret d'entrer chez vous
en contrebande.
LE R.
Essayez. Je vais veiller l'excution de mes
ordonnances, vous serez rudement chti.
l'a.
Ah : Sire, j'invoque ici la libert du commerce :
c'est l'me des corps politiques. Si vos sujets demandent
ma marchandise, elle passera malgr vous.
LE R.
Je vous prends ici en plein sophisme : les peu-
ples demandent les denres dont ils ont besoin, et vendent
celles dont ils n'ont que faire. Les g-ner sur ces deux
points est un reste de Tanciennc barbarie, une tyrannie
absurde dont, Dieu merci, je ne suis pas coupable : mais
il n'en est pas ainsi des relig"ions. Les peuples qui en ont
dj une n'en demandent pas deux; et ceux qui ont deux
n'en demandent pas trois. Mes sujets sont libres, d'ailleurs,
de croire, chacun en son particulier, tout ce qui leur plat,
et de rendre Dieu tel ou tel hommag-e. Mais prcher publi-
quement, fonder des temples, taxer le peuple, sont des
actes de souverainet que je ne souffrirai pas. Je punirais
de mme un philosophe qui renverserait nos autels, ou
prcherait l'incrdulit, sous prtexte que notre religion
actuelle n'est pas dmontre.
l'a.
Sire, il faut donc que je parte. Un prince qui
raisonne n'est pas mon affaire. Ah ! si Votre Majest m'a-
vait d'abord mpris, je me serais g-liss dans son empire;
ensuite, elle m'aurait perscut, et si enfin elle m'avait fait
pendre, mon succs et ma srloire taient infaillibles, et
dans un demi-sicle, j'avais des temples.
17-
298
NOTES
L'ide fondamentale de la relig-ion juive, c'est que
Dieu a prfr les Juifs tous les peuples. Par cette ide
seule, Mose leva un mur d'airain entre sa nation et toutes
les nations
;
il ft plus, il dvoua ce malheureux peuple
une vritable excommunication de la part de l'univers, et
ce qui est admirable, c'est que, par cette haine universelle,
il lui assura l'immortalit. L'amour ou mme l'indiOerence
des autres peuples auraient fait disparatre les Juifs depuis
lono;-temps, puisqu'ils se seraient fondus par les mariag-es,
par l'elfet des conqutes, par les dispersions
;
mais cette
haine du renre humain les a conservs, et c'est par elle
qu ils sont eiectivement imprissables.
Les Juifs disaient Dieu : a Seig-neur, faites tout pour
les vivants, car vous n'avez rien attendre des morts :
Non mortui laudabunt te, Domine.
La dvote croit aux dvots, l'indvote aux philosophes;
mais toutes deux sont galement crdules.
A mesure que la philosophie se propag-e, les crmo-
nies pour les morts diminuent, et la croyance d'une autre
vie s'affaiblit. Voil pourquoi on a donn le nom de supers-
tition cet article des croyances religieuses qui fait que
nous croyons nous survivre
;
et, cet article tant le plus
important, il a donn son nom aux crdulits de tout
g-enre.
Les potes nous ont plus intresss en donnant aux
dieux les faiblesses humaines que s'ils avaient donn aux
hommes les perfections des dieux
.
La plupart de nos impies ne sont que des dvots rvol-
ts.
Le martyr d'une vieille relig"ion a l'air d'un entt; le
martyr d'une religion nouvelle a l'air d'un inspir.
Les visions ont un heureux instinct : elles ne viennent
qu' ceux qui doivent
y
croire.
En gnral, les enfants et les jeunes gens conoivent
mieux la ralit des corps, et les hommes faits et les vieil-
lards celle des esprits. Ces deux penchants sont galement
PHILOSOPHIE
29g
naturels. Les premiers ont un esprit encore faible dans un
corps vigoureux; les seconds ont un esprit plus ferme dans
un corps qui dcline. Les sensations dominent dans les uns,
et les ides dans les autres.
Non seulement il ne faut pas cherchera dfinir ce qui
tombe directement sous les sens, mais il faut au contraire
nous servir des choses sensibles pour dfinir les intellectuel-
les. La matire, le mouvement, le repos et toutes les notions
des objets extrieurs servent nous entendre sur tout ce qui
ne parle pas directement nos sens.
La simple diffrence des sensations aux ides en jette
une immense parmi les hommes (i). Voyez de quel il
diflerent Apicius et Pline le naturaliste contemplent une
perdrix; voyez, lorsqu'il tonne, le superstitieux et le savant :
l'un oppose des reliques, l'autre un conducteur foudre
(2).
L'attention n'est qu'un sentiment sou tenu,tant de notre
corps que de notre esprit : on reg-arde, on coute, on
cote,
on manie, on pense attentivement. C'est cette puissance
qu'il faut rapporter les causes de notre supriorit sur les
animaux, et la diffrence d'homme homme. Mais il ne faut
pas croire, comme Helvtius et Condillac, que l'attention
dpende tout fait de nous, et surtout qu'elle produise les
mmes effets dans deux hommes g^alement attentifs. Com-
bien de gens que la rflexion et l'attention la plus profonde
ne mnent rien ! sans compter ceux qui n'en recueillent
que des erreurs.
Les enfants, par exemple, dont il est si difficile de fixer
l'attention, poussent des cris, aiment le bruit, cherchent la
foule
;
ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'avertir de leur
existence, et rassembler des sensations : le dedans est encore
(1 L'avare se moque du prodigue, le prodigue de l'avare; riocrdule
du dvot. le dvot de l'incrdule : ils se prennent rciproquement pour
des dupes. U.
(2)
La diffrence des passions aux ides est assez frappante dans le
fras;ment d'un dialogue que je vais citer.
On dit Voltaire dans les Champs Elyses : Fouv vouliez donc que
les hommes fussent gaux?... Oui... Mais savez vous qu'il a fallu
pour cela une rvolution effroyable ?... N'importe... On parle ses
ides. Mais savez-vous que le Fils de Frron est proconsul. et qu'il
dvaste des provinces?. . . Ah Dieux ! Quelle horreur ? On parle ses
passions. R.
3 00 RIVAROL
vide. On peut en dire autant du peuple en g-nral. Il n'y a
que les hommes habitus penser qui aiment le silence et
le calme; leur existence est une suite d'ides; le mouvement
est intrieur.
De l vient que les anecdotes sont l'esprit des vieillards,
le charme des enfants et des femmes : il n'y a que le hl des
vnements qui fixe leur sentiment et tienne leur attention
en haleine. Une suite de raisonnements et d'ides demandent
toute la tte et la verve d'un homme.
Matresse des lments et des masses, la nature tra-
vaille du dedans au dehors; elle se dveloppe dans ses u-
vres, et nous appelons /brme'S les limites o elle s'arrte.
L'homme ne travaille qu'en dehors
;
le fond lui chappe sans
cesse: il ne voit et ne touche que des formes.
L'homme, ici-bas, n'a pas reu des provisions pour
l'immortalit : c'est un voyageur qui finit avec sa route. Si^
par un concours de causes assez rare, sa carrire se pro-
long-e, le trsor des sensations et des plaisirs, des souvenirs
et des ides, s'puise, et l'homme, voyageur dpouill, va
se perdre et s'teindre dans les dserts.
La nature a mis l'homme sur la terre avec des pou-
voirs limits et des dsirs sans bornes : c'est cet excdent-
l, ce ressort, qui nous porte au del du but, qui change
les besoins en dsirs, et les dsirs en passions, et qui n'au-
rait peut-tre pas t assez fort s'il n'et t violent. Mais
est-ce donc aux hommes justifier la nature? Elle attend
l'hommage de leur soumission, et non les plaidoyers de
leur loquence.
La mmoire est toujours aux ordres du cur.
Les mthodes sont les habitudes de l'esprit et les co-
nomies de la namoire.
L'identit du but est la preuve du sens commun
parmi les hommes
;
la diffrence des moyens est la mesure
des esprits, et l'absurdit dans le but est le signe de la
folie.
Les enfants crient ou chantent tout ce qu'ils deman-
dent, caressent ou brisent tout ce qu'ils touchent, et pleu-
rent tout ce qu'ils perdent.
PHILOSOPHIE
3oi
La raison est historienne, mais les passions sont
actrices.
Il
y
aura toujours deux mondes soumis aux spcula-
tions des philosophes : celui de leur imaginalion, o tout
est vraisemblable, et rien n'est vrai, et celui de la nature,
o tout est vrai sans que rien paraisse vraisemblable.
On n'a pas le droit d'une chose impossible.
On peut dire que Locke et Condillac, l'un plus occup
combattre des erreurs et l'autre tablir des vrits,
manquaient galement tous deux du secret de l'expression,
de cet heureux pouvoir des mots qui sillonne si profond-
ment l'atlenlion des hommes, en branlant leur ima-ina-
tion.
La nature a fait prsent l'homme de deux puissants
org-anes : de la dis;-estion et de la gnration. Par l'un elle
a assur la vie l'individu, par l'autre l'immortalit l'es-
pce
;
et tel est en nous le rle de l'estomac que les pieds et
les mains ne sont pour lui que d'industrieux esclaves, et
que cette tte elle-mme, dont nous sommes si fiers, n'est
qu'un satellite plus clair : c'est le fanal de l'difice.
On ne fait point l'histoire de la nature. Si je mettais
chaque jour un masque, celui qui aurait dessin tous mes
masques n'aurait pas encore fait mon portrait.
L'admirable nature a voulu que ce que les hommes
ont de commun ft essentiel, et ce qu'ils ont de diffrent
peu de chose : il est vrai que ce qu'ils ont de diffrent change
beaucoup ce qu'ils ont de semblable.
L'homme est le seul animal qui fasse du feu, ce qui
lui a donn l'empire du monde.
Ceux qui demandent des prodiges ne se doutent pas
qu'ils demandent la nature l'interruption de ses prodiges.
Nos besoins sont fonds sur les proportions. Ce monde
tant une harmonie, et par consquent tout fond sur les
proportions, la sensibilit, dans le sens de piti, n'est entre
pour rien dans le plan de la nature.
Il fallait ncessairement que la nature donnt ladure
l'individu ou l'espce. Elle a suivi le premier plan pour
302 RIVAROL
les g-lobeset le soleil, et le second pour les animaux et les
plantes. Or-, dans ce cas-ci, il fallait bien que les formes
individuelles fussent passagres, pour que l'immortalit restt
l'espce.
J'ai toujours aim les mdecins: comme ils ont affaire
la matire vivante, ils sont, par le spectacle des causes
finales, toujours plus prs de la difficult.
La ncessit mtaphysique est qu'une chose est telle
que son contraire estimpossible, comme deux et deux font
quatre. La ncessit physique est l'existence actuelle des
choses : il est ncessaire que le soleil brille. La ncessit
morale est dans les choses qui ne sauraient tre autrement:
il est moralement ncessaire qu'une mre aime ses enfants.
Le vrai philosophe est celui C[ui se place, par le seul
effort de sa raison, au point o le commun des hommes
n'arrive que par le bienfait du temps.
Le dvot croit aux visions d'autrui : le philosophe ne
croit qu'aux siennes.
Dans le monde, celui-l est un vrai philosophe qui
pardonne la socit son dfaut de fortune avec autant
de calme qu'un tel, riche banquier, pardonne son dfaut
d'esprit la nature.
Rousseau a fait g-raver la tte de ses uvres poli-
tiques un satyre qui s'approche d'un flambeau,et il lui crie :
Satyre, rCapproche pas, car le
feu
brille: en quoiil amal
expliqu son allg-orie, carie satyre, tant encore loin, n'est
frapp que de la lumire. Il fallait donc lui crier : Rappro-
che pas, car la lumire brle; etc'estde quoi il s'ag-issait.
Nos philosophes ont donc jet la lumire nos satyres, sans
song-er qu'elle brle.
Ce n'est pas pour attaquer les relig-ions qu'il faut de
l'esprit, mais pour les fonder et les maintenir; car toutesles
pig'rammes contre Jsus-Christ sont bonnes. Quant au cou-
rage, il n'en faut pas plus, et souvent pas autant, un phi-
losophe qu' un aptre.
Si cette parole d'un sage : Quand tu doutes, abstiens-
toi, est la plus belle maxime de la morale, elle est aussi la
premire en mtaphysique.
pinLOSOPJiiE
3o3
Les philosophes n'ont ng'li^' aucune des routes de
l'erreur, expliquant tantt des apparences par des ralits,
et tantt des ralits par des apparences. Cicron avait
remarqu qu'il n'y avait rien de si absurde qui n'et dj
t dit par quelque philosophe.
Les philosophes sont plus anatomistes que mdecins :
ils dissquent et ne gurissent pas.
On no draisonne jamais mieux que lorsqu'on a beau-
coup de raison perdre
;
comme on ne se ruine jamais
mieux que lorsqu'on a beaucoup de fortune.
Le plus bel artifice de l'esprit humain, qui consiste
crer des termes collectifs, at la cause de presque toutes ses
erreurs.
Il faut que la raison rie, et non se fche. On sait l'u-
sai^e que Socrate faisait de l'ironie. Pascal a mle les deux
manires. Dieu lui-mme, aprs qu'il eut condamn Adam
au travail et la femme, lui fait une ironie. Ecce Adam
factiis sicut iinus ex nobis. Voil donc Adam devenu une
espce de Dieu.
Voyez les fruits qui tombent avant le temps : ils ont
une fausse maturit, une fausse couleur, une douceur fausse,
qui nous trompent. Les fruits qui doivent passer par toutes
les priodes de la belle saison ont une verdeur et une pret
qui contrastent avec ceux que je viens de peindre.
Voyez aussi les enfants qui meurent avant de devenir
hommes : ils mrissent tout coup
;
leurs g-estes, leurs
paroles, leurs reg-ards sont d'un autre g-e; ils tonnent
souvent par une tournure morale qui n'a plus rien de l'en-
fance. Au contraire, ceux qui doivent arriver l'tat
d'homme ont une enfance longue et turbulente. Et, pour
complter l'analog-ie, les parents abandonnent leurs enfants
quand ils sont g'rands, et les arbres leurs fruits quand ils
sont mrs.
Rien n'tonne quand tout tonne : c'est l'tat des
enfants.
Les sots, les paysans et les sauvag-es se croient bien
plus loin des btes que le philosophe. Raison de cela.
Le mouvement entre deux repos est limage du pr-
3o4 niVAKOL
sent entre le pass et l'avenir. Le tisserand qui fait sa toile
fait toujours ce qui n'est pas.
De mme que ce sont les imag-es des objets, et non les
objets mmes, qui frappent nos veux, ainsi nos mes sont
frappes des opinions qu'on a des choses, et non des choses
mmes.
La paresse n'est, dans certains esprits, que le dgot
de la vie
;
dans d'autres, c'en est le mpris.
Oui, tout est destin l'oubli, ce tyran muet et cruel
qui suit la g"loire de prs et dvore ses yeux ses amants
et ses favoris. Que dis-je? La g-loire elle-mme n'tant que
du bruit, c'est--dire de l'air agit, elle flotte comme Tat-
mosphre autour du globe, et son cours change et souffle
sans cesse, promenant les noms et les renommes et finis-
vsant par les disperser.
Il
y
a deux grandes traditions dans l'antiquit qu'on
n'a pas assez remarques : Satan, le premier des anges,
veut dtrner son bienfaiteur; le fruit de la science du bien
et du mal donne la mort. L'une enseigne que l'ingratitude
est inhrente tout tre cr, Fautre que les lumires ne
rendent pas les peuples heureux.
Les esprits extraordinaires tiennent grand compte des
cho.^es communes et familires, et les esprits communs
n'aiment et ne cherchent que les choses extraordinaires.
Il en est des malheurs comme desvices dont on rougit
'autant moins qu'on les partage avec plus de monde. L'mi-
gration m'a prouv, et l'infortune
y
tait au comble, que les
malheureux tiraient toute leur consolation de leur nombre.
La raison se compose de vrits qu'il faut dire et de
vrits qu'il faut taire.
Annuler les diffrences, c'est confusion; dplacer les
vrits, c'est erreur; charger l'ordre, c'est dsordre. La vraie
philosophie est d'tre astronome en astronomie, chimiste en
chimie, et politique en politique.
L'homme ne jouit jamais d'une libert plnire, mais
seulement d'une libert de second ordre; par exemple, il
est libre de manger de telle ou telle chose; mais il n'est
pas libre de ne pas manger du tout.
l'IIILOSOPHlE
3o5
Celui-l est toujours libre qui l'ait, quoique forc,
les
choses dont il a besoin, comme un valet sert pour vivre;
mais celui-l est esclave, qui est contraint de taire ce dont
il n'a aucun besoin.
Le spcclacle des mchants a fait les c^-ens de bien,
comme celui du ridicule a fait les gens de got : jura
inventa meta injusti.
Quand on a raison vingt-quatre heures avant le com-
mun des hommes, on passe pour n'avoir pas le sens com-
mun pendant vingt-quatre heures.
La fatalit ou prdestination est dans les choses, et
non dans nous. 11 est fatal que tout corps qui passera sur
telle pente glisse et tombe; mais il ne l'est pas que tel
homme
j
passera.
La peur est la plus terrible des passions, parce qu'elle
fait ses premiers ebrls contre la raison
;
elle paralyse le
le cur et l'esprit.
La distraction tient une grande passion ou une
grande insensibilit.
Se rvolter contre les maux invitables et souflrir ceux
qu'on peut viter, grand signe de faiblesse. Que dire d'un
homme qui s'impatiente contre le mauvais temps et qui
souffre patiemment une injure ?
Songez que ce grand est sujet toutes vos petites pas-
sions : timide ou insolent, avare ou faux, comme vous. O
rside donc cette grandeur ? Chez vous, et non chez lui. La
grandeur d'un homme est comme sa rputation : elle vit et
respire sur les lvres d autrui.
Ce qui fait que les gens du monde sont la fois
mdiocres et fins, c'est qu'ils s'occupent beaucoup des per-
sonnes et fort peu des choses : c'est le contraire dans les
hommes d'un ordre plus lev.
Les gens du monde emploient mieux leurs loisirs que
leur temps; les pauvres n'ont pas de loisirs.
Il ne faut pas dire: Mon esprii^ma
Jgure,
ne ni ont
servi de rien, dites plutt : Mon esprit, ma
figure, ne
m'ont conduit aucun malheur, et flicitez-vous au lieu
3o6
RIVAROL
de vous affliger : ces dons ne vous ont pas nui, ils ont fait
plus que vous servir. J'en appelle cette Maintenon qui
crivait : Le bien qu'on dit aujoard'ltui de mon esprit^
on l'a dit aut^-efois de mon visage. Elle ne trouva
qu'afflictions
d'esprit au comble des grandeurs. L'exp-
rience est donc faite, et, en vrit, le dgot ou l'ennui
attach aux succs peut entrer en comparaison avec l'amer-
tume
d'un revers.
Les
passions se font diffrentes issues: on voit des
hommes non seulement avouer leurs vices, mais s'en vanter,
et d'autres les cacheravec soin; les uns cherchent des com-
pagnons et les autres des dupes. Le plus grand goste n'est
pas toujours celui qui convient de son gosme; comme le
plus gourmand n'est pas celui qui se rcrie sur un bon plat,
mais celui qui le savoure et qui se tait de peur que tout le
monde ne lui en demande.
Il est certain que la possession d'une chose en donne
!
des ides plus justes que le dsir: d'o il rsulte que le sol-
|
dat et le voleur sont plus courageux que le propritaire.
L'homme a plus d'ardeur pour acqurir que pour conserver.
Les hommes ont rang sur la mme ligne ceux dont
ils se font une grande ide, ceux qui leur donnent de grandes
;
ides, et ceux qui ont fait de grandes choses ou opr de
grands vnements.
Il va des hommes si faciles proccuper, si indiff'rents
sur leur jus;"ement, et si entts d'ailleurs, qu'ils finissent
par mettre leur probit douter de celle des autres.
Rien ne rend misrable comme de se conduire dans un
tat par les rgles et les principes ou donnes d'un autre
tat. Un sauvage qui aurait nos lumires, un citoyen qui
aurait l'ignorance du sauvage seraient galement malheu-
reux.
Quand on se propose un but, le temps, au lieu d'aug-
menter, diminue.
Tout le monde s'agite pour trouver enfin le repos;
mais il
y
a des hommes si paresseux qu'ils mettent le but
au dbut.
Ce qu'il
y
a d'horrible en gnral dans ce monde,
PHILOSOI'HIE
307
c'est que nous cherchions avec une g^ale ardeur nous
rendre heureux et empcher les autres de Tetre. Beaucoup
d'hommes lancent sur nous autant de traits que de regards.
L'ambition et la volupt ont souvent le mme langag-e-
Csar avouait, au fate des grandeurs humaines, que les
prires lui chatouillaient l'oreille. J'ai connu une femme
qui disaitsonamant : Ali ! sollicitez-moi bien ! Lesprinces
parvenus jouissent mieux de l'empire que les princes hr-
ditaires.
Il faut faire, pour valoir quelque chose en ce monde,
ce qu'on peut, ce qu'on doit et ce qui convient.
J'ai connu un grand seigneur qui s'occupait beaucoup
des vols qu'on faisait chez lui : Un tel me voie tant, disait-
il, tel autre tant, et tous ensemble tant
;
mais je les g^arde,
j'en prendrais peut-tre de pires. Au reste, je suis assez riche
pour aller jusqu'au bout; mon fils s'arrang-era comme il
voudra. >) C'est Louis XV qui disait: La monarchie durera
autant que moi
;
je plains bien mon successeur : dernier
degr de l'insouciance et de Tg-osmc.
Il faut avoir l'apptit du pauvre pour jouir de la for-
tune du riche, et l'esprit d'un particulier pour jouir comme
un roi.
On a de la fortune sans bonheur, comme on a des
femmes sans amour.
Il
y
a des gens qui n'ont de leur fortune que la crainte
de la perdre.
Il est bien triste d'en tre dsirer le ncessaire
comme une chose sans laquelle on est malheureux, et avec
laquelle on n'est point heureux.
La nature, ayant crer un tre qui convnt l'homme
par ses proportions physiques, et l'enfant par son moral,
rsolut le problme en faisant de la femme un grand enfant.
Le cur est la partie infinie de l'homme
;
l'esprit a ses
limites. On n'aime pas Dieu de tout son esprit, on l'aime
de tout son cur. J'ai remarqu que les gens qui manquent
de cur, et le nombre en est plus grand qu'on ne croit, ont
tous un amour-propre excessif, une certaine pauvret dans
l'esprit, car le cur rectifie tout dans l'homme
;
qu'ils sont
3o8 UIVAROL
jaloux et ingrats, et qu'il ne s'ag-it que de les obliger pour
s'en faire des ennemis.
L'amour est un larcin que l'tat de nature fait l'tat
social.
L'amour, qui vit dans les orages et crot souvent au
sein des perfidies, ne rsiste pas toujours au calme de la
fidlit.
Pourquoi l'amour est-il toujours si iiicontent de lui,
et pourquoi Tamour-propre en est-il toujours si content?
C'est que tout est recette pour l'un, et que tout est dpense
pour l'autre.
Les jeunes gens auprs des femmes sont des riches
honteux, et les vieillards des pauvres effronts.
On corrompt la fille innocente avec des propos libres,
et l'amour dlicat sduit la femme galante : fruit nouveau
pour l'une et l'autre.
Piien ne prouve plus le peu destime que les hommes
ont pour leur espce que le mpris involontaire qu'ils tmoi-
gnent aux acteurs, et en gnral tous ceux qui les amusent
et qui servent leurs plaisirs; et la plupart des hommes
donnent pour raison de leur mpris pour une femme, qu'ils
l'ont eue.
L'amour-propre, en amour ou dans le malheur, prie
toujours maladroitement : car il parle toujours de lui-mme
l'objet aim, et de services rendus, au lieu de bienfaits
reus, la puissance qu'il implore.
L'amour naquit entre deux tres qui se demandaient
le mme plaisir.
L'amour, dans l'tat social, n'a peut-tre de raisonna-
ble que sa folie.
Pourquoi prfre-ton pour sa fille un sot qui a un
nom et un tat un homme d'esprit ? C'est que les avanta-
ges du sot se partagent, et que ceux de l'esprit sont incom-
municables : un duc fait une duchesse
;
un homme d'esprit
ne fait pas une femme d'esprit.
Semblables aux chevaliers errants, qui se donnaient
une matresse imaginaire, et se la figuraient si parfaite
PHlLOSOPHli:
3o9
qu'ils la cherchaient toujours sans la
trouver,
jamais
les
grands hommes n'ont eu qu'une thorie
d'amiti.
On sait par quelle fatalit les grands
talents
sont,
pour l'ordinaire, plus rivaux qu'amis
;
ils
croissent
et
brillent spars de peur de se faire ombrag"e.
Les
moutons
s'attroupent, et les lions s'isolent.
C'est de la familiarit que naissent les plus
tendres
amitis et les plus fortes haines.
Ene est le hros de la pit filiale pour avoir lui-mme
port son pre sur ses paules travers les flammes
;
mais
il ne le serait pas s'il l'et fait porter par des esclaves.
On
est hros qiiand on fait un sacrifice immense son roi ou
sa patrie. On peut tre un g-rand roi, un g-rand
homme, un
grand g-nral, sans tre hros.
En fait d'arts, si c'est la partie
laborieuse
d'une na-
tion qui cre, c'est la partie oisive qui choisit et qui r'^ne.
L'homme modeste a tout a g-agner, et l'org-ueilleux
a
tout perdre: car la modestie a toujours atl'aire la g-n-
rosit, et l'org-ueil l'envie.
^
Le mpris doit tre le plus
mystrieux
de nos sen-
timents.
En g-nral, l'indulg-ence pour ceux qu'on connat est
bien plus rare que la piti pour ceux qu'on ne connat pas.
Les sots devraient avoir pour les g-ens d'esprit une
mfiance g-ale au mpris que ceux-ci ont pour eux.
L'envie qui parle et qui crie est toujours
maladroite
;
c'est l'envie qui se tait qu'on doit craindre.
Un bon esprit parat souvent heureux, comme un
homme bien fait parat souvent adroit.
Un homme mdiocre qui prend bien son temps peut,
avec de l'adresse et de la patience, jouer un rle et faire
parler de lui.
L'estomac est le sol o g-erme la pense.
La propret embellit l'opulence et dg*uise la misre.
Les ronces couvrent le chemin de l'amiti, quand on
n'y passe pas souvent.
3 10
RIVAROL
Il
y
a des vertus qu'on ne peut exercer que quand on
est riche.
Dans l'tat sauvage, les espces sont belles, parce que
c'est toujours le mle le plus fort qui chasse les autres et
jouit de la femelle.
De mme que plus une fleur ou un fruit sont embellis
ou srrossis par la culture, moins ils portent de graines ou
de ppins : ainsi plus un homme cultive sa tte, moins il
est propre la gnration ou au travail des mains. Ce qui
prouve toujours que la nature n'est pas qu'une fleur soit
une belle fleur, ou un fruit un gros fruit, ou l'homme un
grand penseur.
Quelles raisons a-t-il eues de se tuer?
Il faut de si
fortes raisons pour vivre qu'il n'en faut pas pour mourir.
La nature n'ayant que ses quatre grandes dcorations
des saisons, le soleil, la lune et les autres acteurs clestes,
change les spectateurs et les envoie dans un autre monde.
Nous ne pouvons changer les spectateurs, nous changeons.
les dcorations et la pice.
Ce ne sont pas les peines d'un tat qui nous dgotent,
mais les plaisirs d'un autre.
Le chat ne nous caresse pas
;
il se caresse nous.
Il nat plus d'hommes que de femmes en Europe
;
cela seul
y
condamne les femmes l'infidlit.
Les mmes moyens qui rendent un homme propre
faire fortune l'empchent d'en jouir.
Il faut carter les sots; ce sont eux qui ont commenc,
ils ont fait vingt blessures avant d'en recevoir une (i).
Si les sots parvenaient prendre une ide des souf-
frances qu'ils nous font endurer, ils nous plaindraient.
Ce qu'il faut viter en morale, c'est de placer sa vertu
dans les actes indifl"rents, comme de garder sa virginit.
La plus grande illusion de l'homme est de croire que
le temps passe. Le temps est le rivage; nous passons, il a
l'air de marcher.
La plus mauvaise roue fait le plus de bruit.
(i) Cf.
p.
III.
LIVRE IV
LETTRES
(l)
I
A M, le chevalier de Cubires-Falnizeaux
(2).
Versailles
(1777).
Monsieur le chevalier, je vous prie en grce, si vous ne
l'avez dj fait, d'crire M. d'Alembert, et de lui dire en
ma faveur tout ce que votre bont pour moi voussug-g-rera.
Votre suftrag"e m'est essentiel dans ces circonstances. Faites
sentir, je vous prie, M. d'Alembert que je ne le mettrai
jamais dans le cas de se repentir de m'avoir accord sa
recommandation. A mon premier voyage Paris, j'aurai
l'honneur de vous prsenter mes remerciements.
Je suis, etc..
RIVAROL-DE-PARCIEUX.
(1)
Ces xxxiu lettres forment la correspondance complte ce jour de
Rivarol. liUe est runie ici pour la premire fois, d'aprs les divers
ouvrages, biographies, journaux, etc., o elle tait dissmine. Sur la
lettre l'abb de Villefort et celle Chnedolle, qui ne sont pas authen-
tiques, voir page 429. M. A. Le Breton, Rivurol page
875),
dit qu'une
lettre inconnue de Rivarol .Justet son frre de lait, Bagnols, a t
vendue par M. Charavay le
7
avril iS63. Il
y
a bien eu une vente Cha-
ravay cette date, mais le catalogue ne mentionne rien de Rivarol.
2) Cubires, Vie de Rivarol.
niVAROL
II
Au mme (i).
Paris, 20 octobre 1783.
Monsieur le chevalier, il n'y a que l'clat extraordinaire
qu'a eu Texprience d'Annonay,qui puisse justifier la libert
que je prends de vous cet envoyer cet opuscule
(2).
Il se res-
sent un peu trop de la prcipitation que j'ai mise l'crire;
mais, si le fruit n'est pashon,c'estdu moins uneprimeur qui
al'-propos du moment, et qui peut donner une ide lg're
|
des sensations, des propos, des dmls, des esprances
folles qui ont t dans Paris la suite de l'invention des glo-
bes. Il me fournit d'ailleurs l'occasion de vous assurer du
respect avec lequel j'ai l'honneur d'tre, etc.
A. DE RIVAROL.
Paris, rue de Grammont, n 22.
20 octobre 1788.
III
Aux auteurs du Journal de Paris
(3).
Paris, 15 octobre 1784.
Messieurs,
Les 5o.ooo exemplaires du Prospectus sur lAnatomie
de la langue yranaise,Tpndus gratuitement dans Paris,
ont donn lieu une petite erreur, sur laquelle je dois pr-
venir le public^ par respect pour la vrit et pour l'Acad-
mie de Berlin.
En disant que le Z)/scoMrs sur l' Universalit de la Lan-
gue franaise avait besoin d'tre traduit en franais,
quil tait
fcheux quon ne Veut point crit dans Ti-
aiome dont il traite
;
que cet ouvrage attendait quune
plume savanteenfit une traduction digne deson auteur^
etc., etc.. l'auteur du Prospectus ne prtend pas dire que
j'aie fait une traduction; il avertit seulement que le maa-
(i) Ibid.
(2)
La Lettre M. le Prsident de... sur le globe arostatique, etc.
(3)
Journal de Paris, i5 octobre
1784.
LETTRES
3l3
vais franais
dont je me suis servi dans ce discours a
liesoin d'tre traduit en bon franais, que mon lang-ag-e
'St barbare, etc.
;
ce qu'il prouvera aisment, puisque le
style de ce discours, ne ressemblant en rien celui du Pros-
pectus, ne peut plaire aux oreilles qui chrissent le bon
ton et le bien crit.
L'auteur du Prospectus a donc fait une plaisanterie trop
fine, puisque tout le monde en a t dupe. S'il arrivait pour-
tant qu'il et parl srieusement, je le prierais de prouver,
par la voie de votre Journal, que l'Acadmie de Berlin n'a
couronn qu'une simple traduction. En attendant, je me
dclare seul coupable du Discours sur l'universalit de la
lang^ue franaise.
J'ai l'honneur d'tre, etc.
Le comte de rivarol.
IV
A l'abb Roman (i).
Paris, 8 janvier 1785.
Aprs bien des ricochets, votre lettre m'est parvenue,
mon cher abb. Les choses ag*rables que vous me dites sont
un second prix donn au petit ouvrag-e sur la lang-ue, et
un encourag-ement de nouveaux essais. Souffrez que je
vous fasse encore un autre hommage. Vous recevrez peu
aprs ma lettre un exemplaire de la traduction du Dante,
ouvrage fort attendu et qui va tre jug la rig-ueur. Il
y
a
'jinq ans environ que je le tiens en captivit, et ce n'est pas
-^ans rpug-nance que je lai enhn mis en lumire. Avec le
uoiit que vous me connaissez pour le
far
niente, vous
serez surpris que je me sois livr un travail aussi pnible
que celui de la traduction, et que j'aie prcisment choisi
le plus bizarre et le plus intraitable des potes. Un dfi
de M. de Voltaire m'engagea, et une plaisanterie assez
piquante acheva de me dterminer. Ce grand homme dit
tout haut que je ne traduirais jamais le Dante en style sou-
tenu, ou que je changerais trois fois de peau avant de me
tirer des pattes de ce diable-l.
^0 uvres compltes, tome II.
\8
3i4
niVAuoL
Vous sentez que c'est un assez bon moyen de faire macour
aux
Rivarol d'Italie, que de leur traduire un pote qu'ils
idoltrent,
et qui va prendre une nouvelle vie en France.
Je vous
enverrai
dans peu un exemj)laire du discours sur
la lang-ue. Je
l'ai entour cette fois-ci de toutes les sduc-
tionstypog-raphiques,
la premire tant trop nglig-e. J'avoue
que je ne
m'attendais pas au succs qu'a eu cet opuscule.
Il m'a valu des
lettres de tous les souverains et de presque
tous les
savants de l'Europe. Les envieux lui ont pardonn
son succs en faveur de ses dfauts, et surtout en faveur du
bien que je
disais d'eux. Comme il est bien Franais,
comme il nous fait
valoir, disait-on Versailles. Enfin,
le roi de Prusse
m'a crit. Voil mon apothose. Quanta la
vie que je
mne, c'est un drame si ennuyeux que je pr-
tends
toujours que c'est Mercier qui l'a fait. Autrefois je
rparais dans une heure huit jours de folie, et aujourd'hui
il me faut huit gTands jours de sagesse pour rparer une
folie d'une
heure. Ah! que vous avez t bien inspir de
vous faire
homme des champs.
Il est
bien doux pour moi de sono-er que je ne suis pas
encore
teint
dans le souvenir de Madame Roussel. Je n'ou-
blierai
jamais les bonts qu'elle a eues pour moi, et je vous
prie de
m'envoyer l'adresse de M. d'Honorati, afin que je
puisse causer
avec lui de cette aimable maman. M. de
BufPon le fils (un des plus pauvres chapitres de l'histoire
naturelle de son pre), m'avait promis de me donner cette
adresse,
puisqu'ils servent ensemble dans le rgiment des
Gardes,
mais je ne l'ai pas encore.
Adieu,
mon cher abb
;
si je n'abhorrais pas l'criture,
je vous
servirais ici de correspondant et vous parlerais un
peu de
notre
pauvre rpublique de lettres qui n'est plus
qu'une
confrrie
d'acadmiciens. Figaro va paratre. Il n'a
pas eu
autant de reprsentations que les cocus et les battus
de
Jeannot, et il en mritait autant. Les comdiens fran-
ais, voyant que tout l'argent de Paris allait auxboulevards,
ont demand
Beaumarchais une pice de boulevards.
Chargs du
dpt du got, et mourant de faim avec des
chefs-d'uvre,
ils ont fait comme le chien qui portait
son cou le dner de son matre. Beaumarchais ne cherche
qu'
faire parler de lui; et, s'il venait tre pendu, il
LETTRES 3l5
demanderait, j'en suis sur, la potence d'Aman . Adieu,
encore une fois. Tous mes respects madame votre nice.
RIVAROL.
Htel Marigny, place du Lou^Te, 8 janvier 1785.
Ghampfort me parle beaucoup de vous.
Avez-vous reu la premire Lettre au prsident, le Chou
et le Navet, la deuxime Lettre au prsident, un Dialog^ue
entre Voltaire et Fonlenelle, etc., que je vous ai fait passer
dans le temps?
Aux auteurs du Journal de Paris (i).
Paris, 29 juillel 1785.
On vient d'imprimer, dans le Mercure de France, que
la traduction de l'Enfer du Dante n'tait pas fidle. On a
imprim ailleurs que le discours sur l'Universalit de la
langue franaise n'taitpas franais. Je dois, sans doute,
beaucoup d'g^ards et de reconnaissance aux deux crivains
qui m'ont successivement fait l'honneur de me critiquer,mais
je suis pourtant fch que l'un de mes critiques (M. de
Sausenilj ait cru devoir faire beaucoup de solcismes pour
mieux prouver que je ne savais pas le franais, et que l'au-
tre (M. Framery) ait si bien prouv qu'il ne savait pas
l'italien, pour mieux dmontrer que je n'avais pu traduire
le Dante.
A propos du vers,
Risposi lui con vergognosa fronte,
M. Framery pleure amrement sur une beaut de tous les
lieux et de tous les temps que j'ai, dit-il, sacrifie, et qui
peignait si bien cette pudeur de Virgile consacre par le
tmoignage de tous ses contemporains; mais quand
M. Framery saura que risposi lui signifie lui rpondis-je,
et non me rpondit-il. et que cette rougeur modeste se
trouve sur le front du Dante et non sur celui de Virgile,
alors il faudra bien qu'il retienne ses soupirs et qu'il sche
(i) Journal de Paris, ag juillet 1785.
3i6 RivArvOL
ses larmes. Une personne qui ne saurait pas conjuguer le
verbe rispondere s'apercevrait encore que c'est le Dante
qui parle avec tant de modestie Yirg-ile; et cela par
l'ordre seul du dialogue. Les autres critiques de M. Fra-
mery sont dans le mme grenre.
Au lieu de relever les mots, peut-tre et-il t plus
ao-rable et plus utile d'examiner si celui qui avait fait
l'histoire didactique de la langue franaise avait connu les
richesses potiques de cette mme langue
;
s'il l'avait
rajeunie par des expressions cres; s'il avait eu la fois
du got et de Vtrangei dans le style comme il en faut
pour traduire l'Enfer; s'il avait plus song rendre l'in-
tention que l'expression d'un pote qui est toujours vague,
impropre ou bizarre, et avec qui l'extrme fidlit seraitune
infidlit extrme, etc., etc., alors M. Framery aurait pu
voirque de toutes les traductions la plus fidle est celle d'un
tel pote, parce qu'on ne risque jamais de lui terune beaut
pourpeu qu'on sache crire et qu'on ait saisi son vrita-
ble sens
;
mais que s'il existe une traduction infidle, ce
era ncessairement celle de Virgile, de Piacine ou du
Tasse. La perfection ne se traduit pas.
J'aurais pu opposer au jugement de INL Framery celui
de Diderot, qui n'tait pas un contempteur du Dante, et
celui de M. le comte de Bu'on. Ils ont pens bien diffrem-
ment de la traduction de l'enfer, et leur opinion et balanc
'autorit de M. Framery; mais, en vrit, c'est trop parler
d'une traduction. Les gens de lettres pour qui surtout elle
a t entreprise la liront et la jugeron l indpendamment
de l'arrt du J/trrcre;et, sans doute qu'un journal qui n'a
point encore parl du discours sur la langue, ne devait pas
tre favorable la traduction du Dante.
J'ai l'honneur d'tre, etc.
YI
Au public (i).
Paris, 29 juillet 1783.
Il
y
a environ buit jours qu'il a paru et sans doute dis-
(i) Adress la Feuille du jour et reproduit dans la Chronique scan-
daleuse, n
9.
LETTRES
3
17
paru, une pctile brochure intitule : De la ncessite du mal
physique, relig"ieux, politique, etc., traduite de l'anglais;
l'auteur se nomme Jenyns, et le traducteur c'est moi. Bro-
clmre, auteur et traducteur, j'ig-norais tout; mais j'ai par-
couru le petit livre, car il faut du moins savoir ce qu'on nous
lgue; et j'ai vu que M. Jenyns disait qu'il
y
a du mal en
ce monde, et mme qu'il le disait mal
;
il se contente en effet
lie le dire, parce que la nature et la socit sont charg-es des
preuves, et il le dit mal, afin sans doute qu'on en voie
mieux qu'il
y
a du mal partout; mais comme cnacun ne sent
4ue trop bien tous les maux dont l'auteur parle, il en rsulte
([ue c'tait un livre inutile faire, et par consquent inutile
traduire. Ma sig-nature, que je n'ai jamais mise aucune
(le mes productions, ne peut rien contre un bon ouvrante, et
rien pour un mauvais. Je ne comprends pas l'intention du
mort.
RIVAROL.
On croit que le dfunt, c'est--dire le traducteur, s'appe-
lait Dmeunier, et que ses cendres, c'est--dire ses paroles,
sont dposes l'assemble nationale.
VII
A M. de Gasfe, maire Bollne (comtat Venaissin) (i).
Paris, avril 1792.
Je suis loin de vous blmer, mon cher de Gaste, d'avoir,
accept la place de maire de Bollne. Si les aristocrates
avaient tous eu le mme esprit, ils auraient rempli les muni-
cipalits, les directoires et mme les clubs : ce qui les et
rendus matres de la rvolution
;
ils ont mieux aim en tre
les victimes.
Il
y
a un mois que je vous dois une rponse, mais vous
savez que c'est ici le palais d'Atalante; on
y
passe la vie
la fentre, ou courir de chambre en chambre. Nous avons
encore plus besoin de piti que d'excuse. Barruel est venu
depuis quelque temps
y
aug-menter le nombre des paladins
et des fous. Je ne sais si quelque Astolphe montera dans la
(i) Alc^re, Xotices biograchiques du Gare/, ainsi que les trois autres
lettres M. de Gaste.
3i8 RivAnoL
lune pour ces g-eDs-l.En attendant, les jacobins prtendent
que le pre ternel est des leurs; le rovaumeest leurs pieds,
les empereurs meurent point nomm, etc., etc. Il n'y a que
les assignats qui, tout patriotes qu'ils sont, prissent de jour
en jour sous l'aristocratie des mtaux.
Vous me demandez quels papiers conviennent un homme
qui vit en province? 11 faut, je pense, avoir deux feuilles
opposes^afin de juirer 1 opinion et de mieux sentir l'tat des
choses Je vous conseille donc la partie politique du Mercure,
appele Journal de Genve, et celui de Lebrun ou le Moni-
teur. Mais ce que je vous conseille par-dessus tout, c'est de
venir faire un tour ici : cette rvolution vaut la peine qu'on
l'observe sa source. Je vous dirais dans quelques conver-
sations la valeur de plus d'un volume, et d'un volume qui
n'existe pas. Il va d'abord se faire un rand revirement dans
les ambassades, et si vous avez quelque envie de chang-er
de place et de manuvrer un peu sur Ttrang-e vaisseau qu'on
nous btit depuis trois ans, je ne crois pas qu'il vous ft
impossible d'tre employ, d'autant que vous vous tes com-
port avec prudence, et que je ne pense pas que les jacobins
invoquassent des notes contre vous. Adieu, tous mes hom-
mages Madame de Gaste.
VIII
A la Marquise de Coigny (i).
Bruxelles, 11 octobre 1793.
Cette jeune Bthisv(2), dont voire main lgre a touch en
passant le douloureux souvenir, tait en elet un tre trs
rare. Marie avant de s'tre dveloppe, elle est morte avant
d'tre connue. Elle est morte vingt ans, en trente-six heu-
res, avec un enfant dans le sein, trop persuade que les
maux de la France taient sans remde; ainsi vous voyez
que sa mort a t funeste. Convaincue qu'il fallait aimer peu
de rens et connatre beaucoup de choses, elle avait de bonne
heure concentr ses affections et agrandi ses ides. Son app-
tit de savoir s'alliait un grand got, et la varit de ses
(i
)
htscnre,Uivarol et la Socil franrGise,eic,a'nsi que les n"
g
19.
(2)
La comtesse Ch. de Bthisy.
LETTRES 3
19
connaissances s'tendait avec ordre et dessein. Dans les
sujets de mtaphysique, exercice qu'elle aimait beaucoup,
^es questions
abrtreaieut les dinicultcs;scs rponses redres-
saient souvent l'explication. Avant d'abord lun peu roma-
nesque, comme toutes les mes sensibles, mais ayant tout
aussitt rencontr des gens qui bavaient dsenchante, elle
avait tir de ce que les femmes appellent un revers des avan-
tages certains. L'indpendance et la fiert de son caractre
se fondaient dans une mlancolie douce et habituelle; mais
elle trouvait dans sori^exLrme jeunesse et dans sa belle ima-
gination des armes conlre celte mlancolie. Combien de gens
ont cherch inutilement en amour ce qu'on trouvait dans sa
tendre amiti! D'ailleurs, point de superstition,
quoiqu'il lui
et t facile d'tre une sainte Thrse; point d'garements,
quoiqu'elleet l'me d'Hlose. Environne d'esprit etd'int-
rts diffrents, tel se croyait entatde l'admirer qui ne savait
que l'aimer, et tel autrel'aimait qui ne croyait que
l'admirer.
Voil une faible esquisse de ce que le monde a perdu, et
n'oubliez pas que cette perte se fit cruellement
sentir au
milieu de tant de pertes.
IX
A David Cappadoce-Perreira (i).
Bruxelles, 12 octobre 4793.
Que vous est-il donc arriv, mon cher et trs aimable
disciple ? Je suis menac de votre absence pour tout l'hi-
ver
;
crivez-moi un mot pour m'instruire et me consoler
de ce contre-temps. Il
y
a longtemps que je vous ai rang
parmi ces excellentes choses qui embellissent la prosprit
et qui charment le malheur. Je n'tais point du tout
prpar
me passer de vous; songez que je ne suis pas homme
me payer de faibles raisons. Adieu. Je ne vous recommande
pas d'tre toujours aimable, mais de m'aimer toujours...
(i) Banquier Amsterdam, plus tard rfugie
Hambourg;. Rivarol
disait de cet homme aimable, bon lui-mme autant qu' ses amis
Son existence se compose des vilarmes de sa sant et des tmrits de
sa gourmandise; il ne connat d'autres remords que ceux de son esto-
mac.
Les lacunes, dans cette lettre, comme dans toutes celles de la
mme source, sont le fait de M. de Lescure.
320 niVAKOL
... Voici quelques traits mls de,' aiet et d'amertume,
vous verrez de quoi il s'ao^it. H
y
a assez de ridicule ici
et
assez d'infortune Paris pour qu'on puisse rire d'un il et
pleurer de l'autre. Le duc de Choiscul m'a charg-, en par-
tant pour la Suisse, de vous faire mille compliments.
X
Au mme (i)
Bruxelles, 10 novembre 1793.
Il faut g-arder vos cinquante louis, d'abord pour vous, et
ensuite pour moi, si Tdition que je me propose de faire
m'entranait des frais au-dessus de mes forces. En voici
le prospectus. Vous voyez avec quelle confiance je vous
parle. J'aurai le plaisir d'tre secouru par vous, et celui de
vous devoir une plus prompte expdition dans une affaire
qui doit dcupler mes avances. Mais tout ceci suppose deux
choses : Tune que je ferai en effet cette dition, et l'autre qu'on
me refusera du crdit, Londres, pour le papier qu'on ne
peut se procurer que l
;
car si quelque orage politique ou
militaire nous chasse d'ici, je ne pourrai me livrer une
entreprise qui exige trois g-rands mois de repos, et si on me
fait du crdit, je trouverai dans mes petits fonds de quoi
pousser l'entreprise bout, de sorte que j'aurai got la
double satisfaction de ne pas tre charge un ami, et
pourtant d'avoir compt entirement sur lui.
Pour sentir et partager avec vous la douceur de voir
une mre et de la voir revivre pour un fils tel que vous,
(i) M, de Lescure signale deux autres lettres, des i5 et i6 octobre
1798,
et les analyse vaguement. Rivarol
y
parle de la mort de la reine et de
celle de M^^ de B<'lhisy, de IVchec de ]M. de Cobourg, de l'anantisse-
ment de Lyon, de ses opuscules et de ses pamphlets
;
il tente de ngo-
cier prs de son ami un emprunt pour le duc de Choiseul. Il s'agit de
douze mille livres de Hollande : Si je ne cherche pas cinq cents louis
Bruxelles, c'est que nos jeunes et nos vieux ont fait ici de dtestables
affaires. Ils ont mis l'argent un prix si fou qu'ils l'ont rendu inacces-
sible. Le duc d'Uzs, par exemple, a emprunt trente mille livres et a
fait un contrat de soixante-six rnile.
)->
Il serait si simple, quand on a
en main des lettres indites de Rivarol de les publier avec soin, au lieu
d'en dissimuler la moiti et d'encadrer le reste de commentaires comme
ceci :
o ... Cet aimable Cappadoce, qui n'a jamais t pareille auarfff
pistolaire et littraire... >
LETTRES o21
non cher disciple, il ne faut que sentir avec tant d'amer-
ume et d'horreur l'tat o j'ai laiss la mienne en France,
t c'est donner une terrible mesure votre bonheur. Quoi-
jiie je n'aie pas eu celui d'tre prsent madame votre
11 re lors de mon passage Amsterdam, vous me faites
;pi cuver pour elle qu'on ne peut aimer un bon ouvrage
lans aimer aussi son auteur.
Voulez-vous que je vous envoie le portrait que j'ai es-
(uiss de cette touchante et malheureuse Blhisy (i)?
Malgr la malveillance, ou si vous voulez la bienveil-
ance
{2)
des puissances, notre horizon politique s'claircit
m peu. Je termine en ce moment un petit tableau de notre
L'volution et delEurope. Il vous offrira quelques clarts. Je
ou s en enverrai une copie manuscrite que vous ne com-
iiiniquerez qu' vos amis, mais sans jamais l'abandonner
l'orsonne: vous sentirez aisment la raison de ce secret.
Lciieu, mon trs-aimable disciple
(3).
XI
Au mme.
8 dcembre 1793.
M. de Gontaut a dii vous porter de mes nouvelles; il a
1 voulu se charger des intrts de ma cave et de ma
;
mais comme il faut vous taxer, de peur que vous ne
j:u]iez trop, peu prs comme nos Prussiens taxent, de
ur qu'on ne donne pas assez, je vous fixe six ou sept
jiileilles de vin du Cap, deux ou trois rouleaux d'huile
2 vanille et quelques petits btons de vieux alos pour
iiner. Voyez quelle tournure discrte je donne mon indis-
'Jlion.
Ouant aux cinquante louis que vous destinez me sou-
si'Y du poids des avances ncessaires mon dition, je les
cepts et je les accepte encore, parce que je suis dcid
j
ayer le papier comptant
;
c'est une conomie de cinq ou
:v louis. Ainsi, mon cher disciple, vous pouvez m'adresser
I ; La lettre VIII.
M. de Lescure rpte deux fois malveillance.
Cette lettre est tronque. M. de Lescure en a, de son aveu, esca-
le dbut.
i
322 RIVAROL
cette somme par telle voie qu'il vous plaira, et si cela vous
est indiffrent, parune traite sur M. Lys de Mulmester,ban-
quier de Bruxelles...
Dites-moi dans votre rponse si vous avez renonc
celte ville pour jamais
;
je vous avoue que j'en ai par-des-
sus les oreilles, et que j'y souffre autant de la prsence de
certaines g-ens que de votre absence...
XII
Au mme.
Bruxelles, Sjanvier 1794.
Je ne sais, mon cher -disciple, si vous avez reu ma
iii
dernire lettre. On me dit que vous tes Aix-la-Chapelle;
je hasarde ces quelques mots que M. de Morin se charge de
vous faire parvenir. C'est sous de bien tristes auspices que
cette anne commence. Pourquoi ne vous est-il pas tomb
dans le cur de venir nous voir ici un moment ? Rpon-
dez-moi le plus tt que vous pourrez sur ma dernire lettre.
Je ne suis pas avec vous comme madame de Svig-n avec
sa fille; je ne vous aime pas de si loin : le silence et l'ab-
sence qui embellissent les liaisons ordinaires font le mal-
heur de la ntre...
XIII
Au mme.
Bruxelles, 7 janvier 179-4
J'ai reu votre dernire lettre, mon cher disciple, et par
les inquitudes que vous a donnes la sant de votre char-
mante fille, et que vous me peig-nez si bien, je vois trop
qu'un homme sensible, qui devient pre, donne des otag-es
la fortune, et qu'au lieu de lui demander combien il
d'enfants, on pourrait lui dire : Par combien d'endroits
pouvez-vous tre blesis ?
Puisque le rtablissement de cette chre enfant vous
laisse le cur et l'esprit plus libres, je voudrais bien pour
voir vous faire le tableau de notre situation, et donner la
fois des bornes vos craintes et des bases vos espran-
LETTRES
828
ces.
Mais je voudrais vous tenir l, et nous en dirions plus
dans une heure que
je ne pourrais en crire dans vingt
jag'es. Vous voyez, en peu de mots, que la partie a t mal
ie entre les puissances, que celle-ci n'a voulu que des
frontires, celle-l que des colonies et l'autre, qu'un lopin
de la Pologne, de sorte que, pour avoir pch dans le but,
elles ont mrit d'errer dans les moyens. Au lieu de se par-
tager la difficult, elles se sont partag la France. L'Autri-
che, en particulier, sera la dupe del foipunico-britannique
et des tours de gobelet de la Prusse
;
je ne sais qui elle doit
le plus craindre, ou de ses allis ou de ses ennemis. Son
trait particulier avec l'Angleterre est illusoire, car Vienne
ne peut rien contre les possessions maritimes des Anglais,
et Londres ne peut pas garantir l'Autriche des usurpa-
tions continentales. Vous savez les grandes fautes de M. de
Wrmser
;
elles lui sont dj comptes pour des crimes. La
campagne qui va s'ouvrir et qui s'ouvre dj sera dcisive.
Je ne saurais trop vous remercier de votre obligeante
exactitude. M. Lys vous fera prsenter ladite lettre de
change selon l'arrangement convenu
;
votre petite caisse
sera la bienvenue, et si vous n'avez pas oubli le bon vieux
bois d'alos, je mlerai votre agrable souvenir son par-
fum dans la pipe que vous me connaissez, et tout mon plai-
sir ne s'en ira pas en fume...
XIV
Au mme.
Bruxelles, 21 f^Tie^ 1794.
Il vous est plus ais, mon cher disciple, d'envoyer cin-
quante louis vos amis que de leur crire quatre mots.
Pourquoi n'avez-vous pas rpondu ma dernire lettre ?
Vous saurez que le banquier a pris dix-huit livres de France
pour le change ou le simple transport des cinquante louis,
et comme c'est exorbitant, il a rejet la faute sur le banquier
hollandais.
Je ne sais pourquoi, toutes les fois que vous tes si long-
jjltemps sans m'crire, je me figure toujours que vous allez
|arriver. Il vous sera plus ais de vous expliquer que devons
jexcuser, mais qu'importe ? crivez-jnoi ce que vou?voudrez
324
niVAROL
et trompez-moi si vous voulez
;
mais promettez-moi
de
venir nous voir. Le prince de Lig-ne m"a donn la jouissance
d'un joli pavillon Bel-il, erarni
de livres et de meubles;
arrang-ez-vous pour me dcider
y
passer mai, juin et juil-
let, car je pourrai vous
y
donner un lit. Adieu, moucher
disciple. Si vous ne me rpondez pas, je ne serai ni votre
matre ni le mien, et je vous maudirai au nom de l'esprit
et de l'amiti.
XY
Au mme.
Bruxelles, U' SLxr' 1794.
Je reviens, mon cher disciple, d'une tourne de quel-
ques jours aux frontires, o j'ai t tmoin dune affaire
d'avant-postes et de la premire attaque des Garmaei^nols,
depuis le Gteau jusqu'au del de Cambrai, sur onze lieues
de front. Ces drles ont eu les prmices de la campag-ne et
ont d'abord emport deux redoutes
;
mais elles ont t re-
prises le mme jour, et le lendemain, ils ont t attaqus
leur tour. Il leur en a cot quatre ou cinq cents hommes et
cinq canons. Voil l'tat des choses
;
si vous tes tonn de
la stae^-nation de deux grandes et belles armes qui ont per-
du un mois en prsence de l'ennemi, sachez qu'Anglais et
Autrichiens comptaient g-alement sur une rvolution i
Paris. Mais voil le parti jacobin plus triomphant queja
mais, et c'est lui qu'il faut dsormais avoir affaire, sans
s'appuyer davantage sur des ngociations etdes trigauderies
intrieures. L'Empereur arrive dans quinze jours, et sa pr-
sence donnera plus d'activit et surtout plus de fixit aux
plans militaires et politiques...
XVI
Au mme.
Rotterdam, 30 aot 1794.
Je pars en ce moment, mon cher disciple, pour Helvoet
;
le vent a t absolument contraire jusqu'aujourd'hui. J'ai
LETIUES
325
attendu vainement depuis huit jours une rponse de vous
ma dernire lettre date de la Haye.
Le duc de Ghoiseul doit vous faire passer un effet de
dix louis, que vous aurez la bont de m'envojer en forme
de lettre de chani-e Londres, Sablonier's htel, Leicester-
field square, o je log-erai.
J'ai appris hier la mort de mon Mcne, le comte de
Mercy. Il est mort le 25, Londres.
Je me suis assur de Tillustre prisonnier (le comte d'Ar-
tois) qu'il existait une invitation formelle du roi d'Ang-le-
terre, mais il n'en est pas moins retenu ici par l'insig-ni-
liance des dernires dpches. J'arriverai donc Londres
avant lui, si je ne pris pas en route. Adieu, mon cher dis-
ciple; je vous embrasse de tout mon cur.
XVII
Aa mme.
Londres, 23 octobre 1794.
Est-il vrai, mon cher disciple, que vous sojez Ham-
bourg-? Votre dplacement et l'horrible situation o va se
trouver la Hollande, ainsi que la chert et l'eng-ag-ement de
la ville o vous tes, me font esprer que vous tournerez les
yeux vers l'Ang-leterre. Eng-ag-ez-y toute votre famille; je
crois le conseil bon, et c'est pourquoi je vous le donne; le
dsir de vous voir ici ne fait pas cette fois incliner ma rai-
son . Tout se runit ce que je vous propose. Car ou la
Hollande sera inonde d'eau ou de Carmagnols, et cette
dernire inondation aura lieu, qu'on fasse la paix ou qu'on
continue la guerre. Dans tous les cas, un homme sag-e ne
peut rester en Hollande, ni mme porte de la Hollande,
s'il a surtout sa fortune en Angleterre.
Je ne sais si ce bout de lettre vous parviendra. Adieu,
rpondez-moi, Broad-Street, n" i6, Golden-Square, Lon-
don...
P.-S.
Par les dernires lettres que je reois de la
Haye, il me semble qu'on se persuade que la Hollande ne
sera pas tout fait envahie
;
voil ce qu'on dit de plus favo-
rable. En attendant, les An^-lais ont quarante-trois vais-
seaux de transport Dost et leurs hpitaux Helvtsluis.
'9
320
niVAROL
XVIII
Au mme.
Londres, 23 dcembre 1794.
Il n'v a que vous au monde, mon cher disciple, qui me
fassiez"^
entendre la voix et le lang-age de l'amiti. Votre let-
tre,
pleine de sentiment, me consolerait de votre absence, si
je
pouvais vous pardonner de prfrer Hambourg Londres,
sur
d'aussi faibles raisons que celles que vous me donnez.
Je
g-ronderais bien M^^^ Preira, si je la tenais, et je vous
jure que si elle ne vient en Ang-leterre que l't prochain,
c'est moi qui serai le corsaire. J'irai l'attendre sur la Balti-
que, et elle n'en sera pas quitte pour la peur. Je pardonne-
rais plutt madame votre mre, elle aura cd aux con-
seils de la peur; mais les demoiselles sont ordinairement
plus courageuses, et je crois qu'il
y
a dans l'enfer de Dante
un petit vilain donjon pour les filles poltronnes. Voyez o
j'en serais, si j'tais son mari; dites-lui bien toute ma
colre.
Je vois d'ici l'aflreux tat o vous vous tes trouv
Osnabrck, avec votre joli enfant. Heureusement que vous
avez pour lui le cur d'une mre. Parlez-lui de moi, je
vous prie, et qu'il sache de bonne heure aimer ceux qui vous
aiment.
Vous me demandez mon avis sur la longue agonie de
l'Europe. Je travaille en ce moment lui composer un via-
tique. Pour avoir pch dans le but, les puissances ont m-
rit de prir dans les moyens. J'crivais dernirement un
ministre de ce pays qu'il ne fallait pas se donner un voisin
puissant et ruin, car s'il vient tourner ses armes vers la
conqute et sa marine vers la piraterie, il peut nous prsen-
ter la fois Rome et Alger. Mais quand on se l'est donn,
il ne faut rien pargner pour l'craser. Aussi fait-on ici les
derniers efforts
;
on a des intelligences sres et rapides avec
la France et mme avec les meneurs
;
ce malheureux pays
est aux abois
;
son dernier soupir sera un roi. En attenaant
vous tes le prix des colonies plus mal dfendues que mal
usurpes. Il parat que les Carmagnols ont pass le Wahal-;
ces geles leur pavent le chemin.
Je travaille beaucoup mon ouvrage; la mort inoppoiv
LETTRES
327
lune de M. de Mercy m'a beaucoup drang-, il devait m'a-
vancer les premiers fonds
;
mais je ne me rebute pas. Adieu;
mille compliments vos dames. Vous savez tout ce que je
vous suis.
XIX
Au mme.
Londres, 2G avril 1795.
Je n'entends rien vos rigueurs, mon cher disciple
;
voil deux lettres de moi sans rponse et une lacune de six
mois entre nous. Pylhag-ore recommandait le silence son
cole, et moi je n'aime pas ce rg-ime avec vous
;
toute
mtempsycose me tait peur
;
restons tous deux dans notre
ancienne enveloppe, les mig-rations ne valent rien. Rpon-
dez-moi donc, assurez-moi que vous tes toujours vous-
mme. Quant moi, j'ai toujours le mens sana in corpore
sano; et vous verrez que je n'ai pas cess d'tre votre
mule, et mme votre matre en amiti.
J'attends de vos nouvelles, de celles de vos enfants et
de vos deux dames. Ecrivez-moi sur-le-champ, si toutefois
cette lettre vous parvient, car je prsume qu'il s'en perd
beaucoup, toute 1 Ang-leterre s'en plaint. Vous savez le mal-
heur arriv notre pauvre duc de Ghoiseul et au comte de
Damas. Nous ne sommes pourtant pas sans espoir de les
sauver
;
ils sont dans les prisons de Dunkerque.
Comme vous pouvez prsumer, avec quelque probabi-
lit, que la Hollande sera vacue, peut-tre que vous aurez
renonc au voyage d'Ang-leterre; je n'en serai pas autre-
ment fch, car je me propose de quitter cette capitale de
l'migration; j'ai de fortes raisons de me rapprocher de
Monsieur. Je passerai donc par Hambourg-, et je vous pr-
viens qu'il pourra bien arriver que le comte de Prigord
vous laisse, en partant de cette ville pour venir ici, son cha-
riot de poste; je le fais avertir en ce moment de s'adresser
vous, et je compte sur votre amiti cet g-ard. Vous savez
que ces sortes de voitures sont indispensables pour voyag-er
en Allemag-ne; et si M. de Prig'ord ne me laissait pas la
sienne, je serais forc d'en acheter une autre, car ma dili-
g-ence est Rotterdam, entre les mains des Carmagnols,
328
RIVAROL
sans doute. Adieu, mon cher disciple, je vous embrasse de
tout mon cur.
XX
A M^^ Cromot de Foagy (i).
Hambourg, 27 octobre 1796.
Madame,
puisque vous ne m'envoyez pas votre flacon,
jeprends le parti de vous envoyer le mien; d'autant plus que,
rflexion faite, il me reste assez de baume pour le donner
tout, pas assez pour le partager.
Voil ce baume de la Mecque,
Dont l'Orient fait si grand cas,
A qui plus d'une beaut grecque
Doit le secret de ses appas,
Et qui sans vous ne quittait pas
Le coin de ma bibliothque.
J'ai pourtant hsit vous [l'envoyer, en songeant com-
bien les proprits de ce baume vous sont inutiles.
Car ce n'est point de l'Arabie
Que vous avez reu cette fleur de beaut
^
Qui ne vous sera pas ravie;
La nature vous fit dans un jour de gat.
Flore depuis vous a suivie.
Et le printemps ,son dput,
S'est charg seul de votre vie.
En si brillante compagnie.
Je conois bien en vrit
Que l'on ddaigne ou qu'on oublie
Un ingrdient invent
Pour les teints de la Gorgie;
Car au fond l'art le plus vant
N'est qu'un besoin
;
l'industrie
Est fille de la pauvret.
Votre opulence n'a donc que faire de cet ingrdient
;
il
ne vous faut ici ni drogue, ni recette, et j'en suis bien fch.
Ah! si vous ne saviez que feindre,
Si votre clat n'tait que fard,
(i) uvres compltes, tome IIL
LETTHES
32Q
Si votre esprit n'tait qu'un art,
Vous ne seriez pas tant craindre :
On peut braver les airs vainqueurs
Et les armes d'une coquette,
Qui n'a pour attaquer les curs
Que l'arsenal de sa toilette;
Mais vous plaisez sans
y
penser,
Et votre tranquille indolence,
Qui ne connat pas sa puissance,
Ne sait que trop bien 1 exercer.
C'est ainsi que vous me faites du mal paisiblement et
innocemment : il est vrai que le baume de la Mecque a la
proprit de fermer une blessure en moins de rien, que c'est
aveclui qu'on fait le vrai taffetas d'Angleterre, et que Maho-
met lui doit ses plus g"rands miracles, mais je vous dfie de
vous en servir avec autant de bonheur que lui.
Sachez, vous qui lancez des traits
Dont les atteintes sont si sres.
Qu'il n'existe point de secrets
Oui g-urissent de vos blessures.
Voil donc deux proprits de ce suc divin, aussi inutiles
vous qu'aux autres; mais il lui reste encore (car il faut que
je vante mon baume) d'tre le premier des aromates : l'anti-
quit lui donnait le pas sur tous les parfums.
A ce titre il vous tait d,
Vous n'en retes pas de plus doux sur la terre;
Mais avec vous c'est temps perdu.
Votre divinit svre
Se moquera de sa vertu :
Vous encenser n'est pas vous plaire.
A force de parler, je dcouvre pourtant cette fameuse
rsine une vertu votre usage; c'est qu'elle est admirable
Four
les poitrines dlicates. Sonerez que vous allez passer
hiver au cinquime degr de latitude nord : vos poumons
pourraient bien avoir souffrir de ce froid rigoureux qui
va, dit-on, jusqu' fendre les pierres.
Ainsi quand vos beaux yeux travers vos carreaux
Verront en clignotant sous leurs noires paupires
Nos humbles toits et leurs gouttires
Se charger de brillants cristaux
;
Quand les belles cle
",
au fond de leurs traneaux.
33o
Auront plac leurs gros derrires,
Et qu'elles
y
seront moins fires
De leurs amants transis que de leurs grands chevaux;
Quand vous lirez dans les journaux
Que les nayades prisonnires
Dans leur lit immobile ont suspendu leurs eaux,
Et que des chars tremblants ont trac des ornires
O voguaient d'agiles vaisseaux
;
Lorsqu'un des envoys des trois surs filandires
,
Le Catarrhe,viendra li\Ter ses fiers assauts
Au lourd habitant des bruyres
Que l'Elbe arrose de ses flots;
Alors gardez le coin de vos brlants fourneaux.
N'allez pas imiter les modes meurtrires
Des pais descendants des Teutons et des Goths,
Qui des deux ocans gardent mal les barrires,
Gens qui feraient fort propos
S'ils nous empruntaient nos manires
Et s'ils nous prtaient leurs lingots,
Mais dont les humides cerveaux.
Ns pour les fluxions et non pour les bons mots.
Ont la pesanteur des mtaux
Qu'ont entasss leurs mains grossires
;
Gens qui trafiquent de nos maux,
Fripons toujours anciens, fripons toujours nouveaux,
Nous volant tout hors nos lumires;
Qui se croyant subtils, quand ils ne sont que faux.
Veulent marcher sous deux bannires
Et, suivant du calcul les timides lisires.
Craignent la fois les panneaux
Des Anglais, leurs dignes rivaux,
Et les sanglantes trivires
Que Paris doit leurs travaux.
Quand la mort, confondant leurs mes financires,
Les fait enfin passer de leurs sales bureaux
Dans ses troits et noirs caveaux.
On les voit cheminer devers leurs cimetires,
En uniforme de corbeaux.
Et descendre pas lents dans ces tristes carrires,
A la lueur de cent flambeaux,
Escorts de porte-manteaux
Dont ils ont achet les pleurs et les prires,
Et les crpes et les chapeaux
.
Malheureux qui sont assez sots
Pour ne dcorer que leurs bires,
LETTRES
33l
Et qui sont mieux dans leurs tombeaux
Qu'ils n'ont t dans leurs tanires.
Comme vous n'avez ni leur mauvais
cot,
ni leurs robus-
tes fibres, et que vous n'tes pas femme vous consoler de
la mort, dans l'espoir que votre enterrement pourra nous
ruiner en difiant les Hambour^-eois, je me flatte que vous
laisserez l et leurs courses chariots dcouverts, et leurs
repas et leurs visites. Song-oz-y donc :
Le ciel dans sa maniticence
Vous aranlit votre beaut;
Le temps qui sina le trait
Rptera cette assurance
;
Mais il laisse votre sant
Entre les mains de la prudence.
Si vous n'oubliez pas mes avis, vous ferez frquemment
un air nouveau avec des fumig-ations aromatiques
;
cet air
artificiel que j'ai oppos avec succs aux brouillards de Lon-
dres, vous sera trs salutaire :
Il vous conservera cette louchante voix,
Dont les sons enchanteurs m'ont sduit tant de fois.,.
Ce dernier vers est de Zare,
Je n'ai pas craint de le citer;
On fait trs bien de rpter
Ce qu'on ne saurait si bien dire.
Sans doute, quand il fit ces vers brillants et doux,
Voltaire tait prophte, et ne peignait que vous.
Au reste, quand vous aurez brl, respir, aval tout le
baume, n'allez pas jeter la petite phiole; elle aura un emploi
que vous ne lui souponnez g-ure; g-ardez-I, je vous prie,
je pourrai en avoir besoin.
Il faut tout craindre; on peut tout croire :
Si jamais je perds la raison,
Comme le bon Roland, d'amoureuse mmoire.
Je prtends qu'elle ira loger dans ce flacon
,
Heureuse de troquer la gloire
Contre une si douce prison.
332 RIVAHOL
XXI (i)
A son pre.
(A Monsieur J. Rivarol, Bagnols^ prs le Pont-
Saint-Esprit).
Hambourg, le 12 mai 1797.
Mon frre m'a fait parvenir enfin de votre criture. Vous
auriez eu de mes nouvelles peu de temps aprs la mort de
Robespierre, si je n'avais eu affaire des ag-ents infidles
qui ont retenu l'argent que j'envoyais mon fils, et dispos
leur gr du paquet de lettres que j'envoyais mon frre.
Un honnte ngociant de Londres me rendit le service de
faire compter Paris l'argent ncessaire au voyage de cet
enfant
;
car vous sentez combien il tait dur pour moi de
voir ce petit malheureux, dans les rues de Paris, manquer
la fois de pain et dinstruction
;
et mon frre me l'envoya
ici l'anne dernire. Vous savez qu'il a pass ici six mois, et
j'aurais bien voulu qu'il
y
demeurt plus longtemps, il
m'aurait aid dans mon grand travail sur la langue, et
nous serions rentrs ensemble; mais Paris l'attirait, et il n'a
pu rsister. Me voil donc avec mon fils Hambourg; ma
sur qui demeure la campagne une demi-lieue de...
(2).
Mon frre doit vous avoir dit que je quittai Paris le
10 juin
1792,
fort propos; car on vint, sept jours aprs,
soit pour me massacrer dans sa maison, soit pour me mener
l'chafaud. Les brigands dirent en entrant chez moi: O
est-il ce grand homme ? Nous venons le raccourcir. C'est
un des caractres de la rvolution que ce mlange de plai-
santerie et de frocit.
J'ai, depuis, essuy bien des petits revers, et, entre autres,
deux naufrages. A quinze pieds dans l'Ocan, ma prsence
d'esprit ne m'a point abandonn et m'a sauv. Je vous con-
(i) Lescure. Complt, ainsi que le
no
XXIV, d'aprs Le Breton,
RivaroL.
(2)
Coupure dans le manr.scrit. La cause de cette coupure est certai-
nement la mention de P'ranroise de Rivarol, baronne de Beauvert, qui
tait la matresse de Dumouriez et demeurait avec lui, prs de Ham-
bourg.
LKTTKES
333
terai tout cela, car je n'ai point perdu l'espoir de vous
revoir encore.
Jetais Bruxelles, en
1792,
lorsque j'appris votre fuite
de Marseille
;
je vous fis passer cent francs en assig-nats
dans une lettre M. Matteras, Aix, je crois; car c'est l
qu'on m'avait crit que vous tiez rfu2:i; enfin, il ne faut
plus penser aux maux passs; les malheurs ne sont bons
qu' oujjlier . Il faut, au contraire, Lnir le sort qui a
voulu que, dans un massacre aussi g"nral, nous ayons
tous t parg-ns; il n'y avait pas pourtant parier pour
nous.
Je fais passer ce paquet par Bordeaux, nous verrons ce
qu'il en arrivera
;
j'ai remis en mme temps six louis qui
doivent vous tre compts par MM. Bascon et Branemann,
ng'ociants et banquiers Montpellier. Bag-nols est un trou
si recul qu'on ne peut le trouver sur la carte du commerce.
Au reste, le change tant contre la France, vous devriez
toucher un peu plus de six louis. Ds que vous aurez reu
ma lettre et cette petite somme, vous m'crirez directement
cette adresse : .4 M. Fauche, imprimeur-libraire
Hambourcf, et sous l'enveloppe : A l'auteur du Diction-
naire. Votre lettre m'arrivera plus vite et n'occasion-
nera... (i).
Pendant la longue dtention de mon frre et de sa femme,
ce pauvre enfant errait, morne, nu, dans les rues de Paris,
et recevait le pain des sections. On lui avait dj mis un
fusil sur l'paule, et je ne doute pas qu'il ne ft dj aux
frontires, si j'avais hsit plus longtemps l'appeler
auprs de moi. Je l'ai trouv extrmement rouill, le latin
oubli, et tout le reste proportion
;
nous travaillons
rparer tant de ruines
;
ce n'est plus un enfant, il court
sur sa dix-septime anne, et le voil haut de cinq pieds
quatre pouces et plus. 11 a de la douceur et de la noblesse
dans la figure, la taille et la jambe belles, et ce qui vaut
mieux, le cur sensible et Tesprit juste
;
il a un furieux
dsir de vous revoir : la plus belle mulation existe entre
lui et son cousin, qui est un trs aimable enfant. Il se pr-
pare battre mon fils en latin
;
celui-ci prpare ses batteries
en allemand, qu'il parle dj assez bien. Il monte cheval
(i) Coupure correspondant la premicre.
19-
334 HIVAHOL
et dessine passablement; mais point de musique, quoiqu'il
ait la voix belle; je me suis aperu que le chant ne faisait
que des hommes frivoles et des histrions. A propos de cou-
sin, Barruel m'a gratifi d'une douzaine de lettres; fatig-u
de sa fcondit, et peu jaloux de sa correspondance, je viens
de lui crire un mot qui n'exige pas de rponse. La nature
en avait fait un sot, la vanit en a fait un monstre.Je plains
bien sa mre.
Il me semble que ma tante l'ane doit tre mal l'aise
;
ses petites rentes ont d longtemps tre payes en chiffons,
et peut-tre qu'elle ne touche rien en ce moment. Je connais
votre cur, ainsi je ne doute pas que vous ne veniez son
secours. Il faudra, sauf meilleur avis, lui donner dix cus
par mois, mon intention tant de vous faire passer six louis
chaque mois, tant que ma position me le permettra . Je
voudrais que la route que je me suis ouverte par Bordeaux
et Montpellier ft sre et prompte; nous viterions parla
le 5 pour loo que la poste exige.
Si, comme je le prsume, vos deux botes n'ont pas
rsist aux rigueurs de la Rvolution, il faut qu^ je vous
dise que j'en ai encore deux autres que je vous rserve depuis
longtemps, une d'homme et une de femme
;
je n'attends
qu'une occasion sre, elles sont rares.
Je finis ma lettre, car je suis accabl d'ouvrage; vous
savez ce que c'est qu'une entreprise comme celle du Diction-
naire de la langue
;
il s'agit de refondre entirement cette
langue franaise et de la brasser jusque dans ses fonde-
ments. On prtend que cette opration me vaudra deux cent
mille livres. Dieu le veuille! J'ai, outre cela, sur le chantier,
une Hisioire de la Rvolution et un grand Trait sur la
nature du corps politique.
Si je n'avais pas craint de vous sparer trop de ma mre,
je vous aurais propos, en
92,
de venir Paris et de me
suivre; vous m'auriez t trs-utile; mais, rflexion faite, il
faut du repos votre ge, et je me suis priv de cette dou-
ceur. Au reste, voil la paix; j'espre que nous nousrappro-
cherons. Vous me parlez de la petite-fille de Paue (i); qui
donc a-t-elle pous? Se souvient-elle toujours de moi ?
Je vous embrasse tous de cur et d'me. A propos, mille
(i) Sur de Rivarol, qui avait pous M. de Faguet.
LETTJVES
335
tendres remerciements pour votre quatrain. Vous avez donc
drouill votre veine pour moi
;
je suis charm que vous
soyez toujours ami des Muscs. Qui n'aime point les vers a
l'esprit sec et lourd.
Quand vous applaudissez mes faibles crits,
De votre cur vous parlez le langage.
Mais vous ne song-ez pas qu'en louant votre fils
Vous ne louez que votre ouvrage.
Dites-moi en peu de mots jusqu' quel point la Rvo-
lution et la g-uerre ont dsj-arni votre pavs d'ouvriers et de
cultivateurs, et si la journe de travail est renchrie. Crovez-
vous qu'avec ving-t-cinq louis vous puissiez ranimer un peu
vos champs ?
Je voudrais savoir aussi ce qu'est devenu votre clerg-.
Le cur m'crivit, en
1789
ou
90,
en style
rvolutionnaire.
J'espre qu'il aura eu le temps de cuver la Rvolution et qu'il
doit tre bien dgris. Je finis tout de bon. Voici un mot du
petit et un autre de ma sur.
Extrait dune lettre du comte de Tillij Rivarol (i).
Hambourg, 6 juillet 1797.
... Cela veut dire, mon cher ami, que je voudrais avoir pour
vingt-quatre heures une dition de la nouvelle Hlose. J'ai une
incertitude fixer sur un passage qu'on me dit tre dans une
lettre du troisime volume, et que je crois, au contraire, dans
l'Emile : veuillez la remettre au porteur.
J'ai pass chez vous hier, et j'ai t bien aise de trouver la porte
hermtiquement ferme. J'ai suivi le prcepte de celui dontla mo-
rale tait pure et qui dit pul>'ate^ et je me suis rjoui de ce que
Vaperietiir vobis ne se vrifiait point. Je me suis flatt que vous
tiez en regard avec la postrit qui vous appelle, et que vous tra-
vailliez pour elle et pour vous.
Il est vident que c'est vous qu'il appartient de donner les der-
nires leons de cette langue immortelle, de fixer ce qui est en ques-
tion, de relever les erreurs, d'claircir les doutes, d'expliquer ce qui
est obscur, de dterminer les vritables significations, de prouver
lestymolo^ies, et dejeter enfin la clart d'une analyse savante sur
la gnalogie de cette grande et antique famille de mots,dont jus-
qu' prsent les preuves n'ont t que confusment faites.
(i) uvres compltes, t. III.
336
RIVAUOL
Je vous renvoie votre admirable discours, o le style le plus bril
lant et la raison la plus exacte se sont donn rendez-vous pour
charmer avec excs et instruire sans fatigue. Heureuse alliance
dont personne ne connat aussi bien que vous les conditions.
Je suis seulement
lch que vous aviez lou l'abb Raynal.
Votre note mme n'est pas un minoraiif de poids : c'tait un
pamTC diable qui n'a pas crit une ligne de cette histoire o il
y
a quelques
superbes
morceaux, et une dclamation si imposante
pour les jeunes
gens et pour tous les hommes dont le got n'est
pas sr.
J'ai vu dans ma jeunesse, Saint-Germain, un Monsieur Pe-
meja, auteur de Tlphe (dont mademoiselle Arnoud disait : Il
y
a telle f... que
j'aimais mieux quand j'tais jeune), qui lui avait
fourni beaucoup de morceaux, ainsi qu'un mdecin de ses amis
mort la fleur de son ge.
On connat les autres collabora-
teurs.
Ce prtre dbout n'a t, comme vous le dites trs bien, que
le rdacteur de cet ou\Ta2:e
;
les points de suture, seule part qu'il
V ait eue, s'y montrent l'il le moins exerc.
Son plus grand
talent fut son attrait irrsistible pour le beau sexe qu'il adora
indistinctement
jusqu'aux derniers temps de sa vie. Beau et
superbe talent qu'il aurait d cultiver sans partage!
Il est aussi plat de s'attribuer les ou\Tages des autres que d'en
crire de mauvais.
Mais j'cris un volume pour ne rien vous apprendre, si ce n'est
peut-tre que l'abb Piaynal tait un ne la ceinture.
Une lgre indisposition me fait garder la chambre: j'espre
sortir demain, je passerai chez vous.
Adieu, mon cher Tacite, macte animo ! point de distraction;
travaillez et vous aurez droit de dire : Exegi moniimentam re
perenniiis. Vous avez vaincu toutes les difficults et tous vos
rivaux, puisque vous avez vaincu la paresse.
Tuus ex animo.
XXII
Au comte de Tilly (i).
Hambourg, juillet 1797.
Quand on crit pour les femmes, on risque d'aller dpa-
reill la postrit.
Voil tout ce qui me reste de ce roman, mon cher comte.
Vous m'avez crit comme une acadmie tout entire;
(i) uvres compltes, t. III.
LETTRES
337
quant au sobriquet de Tacite, vous avez grand'raison, il
y
a lon2;-temps que je me tais.
Si je m'(5tais dout hier de ma bonne fortune, ma porte
aurait t ouverte : elle le sera toujours pour vous. Je la
ferme auxennuyeuxet ceux avec qui il n'y a que du temps
perdre. Frappez, quand vous reviendrez, deux coups seu-
lement, un peu fort la porte du fonds.
Prenez, si cela vous arranq-e, le moment qui suit le dner.
Il vous sied bien de dclamer contre la paresse, vous
tes le vrai coupable. Vous prodi^uez ici, comme Paris,
votre esprit et votre facilit un monde dont on doit tre
dg-ot votre g-e, quand on le connat autant que vous :
vous avez toujours la faim des vains plaisirs dont vous
devriez tre fatigu.
Vous avez tout ce qu'il faut pour aimer le travail et mme
pour ny trouver que de l'attrait. Croyez-m'en, reposez-vous
dans l'tude; elle vous rclame, et la dissipation n'est plus
dig-ne de vous.
J'oubliais l'abb Raynal. Vous avez absolument raison
;
mais il
y
a tant de g-ens de qui on peut dire ne jusqu'
la ceinture, que l'abb Raynal, qui l'tait de pied en cap,
aurait t ravi de votre lettre. Il faut parler des g-ens charge
et dcharge. Votre mdecin s'appelait Dubreuil
;
c'est la
fille ane du B. de T. qui l'a tu.
Adieu, nous pourrions faire commerce d'anecdotes et de
littrature, et les Hambourgeois nous laisseraient faire.
XXIII
A. M, de Gasie,
Hambourg-, 14 juillet 1797.
Il est bien doux pour moi, mon cher et ancien ami, de
voir que je ne suis pas mort dans votre souvenir. Je vois
par votre aimable lettre que vous avez sauv votre esprit
et votre cur de celte afi'reuse rvolution; si la sant est de
la partie, tout va bien, les malheurs ne sont bons qu'
oublier.
Je ne vous ferai pas ici le roman de nos longues courses,
malgr deux naufrages de ma personne et un de mes effets.
Malgr toutes mes portes, je suis peut-tre de tant de fugi-
338 RIVAROL
tifs celui que la fortune a le moins maltrait : ce qui le
prouve,c'est que j'ai pu prter pi us de dix mille francs depuis
ma sortie de France. Me voici maintenant occup vous
donner le dictionnaire de la lang-ue, sur un plan nouveau :
il faut que je vous dlivre des exig-ences du sphinx, duss-je,
comme dipe,
y
perdre les yeux. Au reste, je me suis
donn deux secrtaires pour allger le fardeau.
Vous avez bien raison de m-e dire que vous avez fait et
que vous croyez faire encore un rve dlectable
;
c'est la
faiblesse d'un homme qui nous a tous plongs dans cet ocan
de malheurs, et son infortune n'a pas amend le sort de la
France. Un corps politique est bien malade quand la popu-
lation crie : Je suis rpublique^ et le territoire : Je suis
monarchie. Vous savez, si vous avez lu le Journal politi-
que, de quel il j'ai vu cette Pivolution,etcela,ds le mois
dejuin
1789,
quand latte tournait toutlemonde. J'crivais
alors: Malheur qui remue le fond d'une nation ! Mais
j'tais la voix qui crie dans le dsert. Mon frre vient de
faire rimprimer la suite de ces numros; si cette collection
vous tombe entre les mains, relisez-la. Je cessai d'crire
en
1790
: tout tait perdu. L'assig-nat tait l pour payer
tous les excs et tous les bandits ce la Rvolution : je vis le
mal sans remde. C'est cette poque que j'crivis que les
Franais finiraient par s'intituler eux-mmes Brigands
et Sans-calottes, et qu'ils porteraient une galre en
triomphe; la chose s'est vrifie la lettre.
Quoique j'aie les matriaux de l'histoire de cette Rvo-
lution et une thorie du corpspolitique dans mon portefeuille,
je crois cependant le temps et les conjonctures si peu favo-
rables
que j'aime mieux, en ce moment, travailler pour la
langue que pour la nation. La premire partie du discours
prliminaire, concernant l'entendement humain, va paratre
vers la fin du mois.
Si vous avez un fils de i3 ans, j'en ai un de 16 : nous
nous faisons vieux
;
et voil 8 ans que la Rvolution nous
force rayer de notre bonheur. Ma fortune a t renverse
au moment o je mettais la dernire main l'difice
;
mais
vos terres vous restent et vous serez encore heureux, si les
levains qui sont toujours en France ne fermentent plus.
.
Vous me parlez d'un voyage en Languedoc, je ne le crois
possible que l'anne prochaine. J'espre aller philosopher
LETTRES
33^
quelques jours avec vous, la Rami6re, contre la philoso-
phie du sicle, celle funeste chimre qui s'est arme des pas-
sions du peuple, quand le peuple s'est arm de ses phrases.
Je vous expliquerai notre Rvolution et la conduite des puis-
sances, de manire vous confondre d'tonnement. \''ous
verrez que nos destines ont t ballottes entre les jacobins
sans-culottes et les jacobins couronns.
Adieu, mon cher ami, crivez-moi et dites-moi quelles
sont les personnes de ma connaissance qui ont t victimes
de la Rvolution
;
car depuis
1792
je n'ai pas la moindre
nouvelle de Bagnols. Tout vous, R.
XXIV
A sa tante, Franoise de Rivarol.
[Hambourg, 18 aot 1797.
Je voudrais, comme Csar, dicter quatre en mme
temps, pour rpondre la quadruple lettre que je viens de
recevoir. Je voudrais surtout que ma mre et vous, ma chre
et bonne tante, vous ne fussiez pas occupes de votre e
au point de dsesprer de me voir. Il n'y a que les mauvais
effets de votre g-ouvernement boiteux qui puissent mettre
obstacle mon voyag-e. Quoique nous soyons spars par
onze deg-rs de latitude, c'est--dire par plus de trois cents
lieues, rien ne pourra m'arrter ds que la terre ne trem-
blera plus sous vos pieds
;
mais votre g-ouvernement est un
peu trop l'ouvrag-e des hommes et de leur org-ueil pour
acqurir quelque fixit
;
et si j'attendais, je ne dis pas la
prosprit, mais le simple repos de ce pauvre royaume,
nous risquerions, en etet, de ne plus nous revoir. Je pro-
fiterai donc de quelque moment de rpit, d'un de ces inter-
valles qui sparent les temptes chez vous. Vous voyez qu'
l'heure o je vous cris, votre horizon se rembrunit
beaucoup.
J'attends le retour du correspondant de Montpellier pour
vous faire passer quelques fonds; il est Francfort. On ne
saurait prendre trop de prcautions dans un pays comme
celui-ci, peupl de tous les banqueroutiers de l'univers. J'ai
confi deux fois quinze louis pour mon frre, et deux fois
on m'a tromp. Si vous n'tiez pas dans un vilain trou ig-nor
3/jo
nivAnoL
de tous les commerants du monde, vous n'auriez qu' tirer
quelques traites sur moi, et vous sentez qu'elles seraient
fidlement acquittes.
Vous ne mdites pas un mot des Barruel et de vos prtres.
Le cur m'crivit en
1790
une lettre qui prouva qu'il s'tait
un peu eng-ou de la Rvolution : il doit tre dgris, ou il
est bien ttu. Dans quel tat est le culte chez vous? On peut
m'crirelibremcntsous l'enveloppe d mon libraire Fauche.
Vous
vovezque votre lettre m'est trs bien parvenue; il n'est
pas mrne ncessaire d'affranchir, ce que je crois.
Dites mon beau-frre que je suis trs sensible aux
assurances qu'il me donne de son amiti. Il sufft qu'il m-
rite la vtre pour tre sr de la mienne. Si on ne m'avait
pas pill ma bibliothque, je lui aurais adress une paco-
tille de livres
;
il faudra qu'il se contente de mes faibles
ouvrag-es que je lui ferai passer. La politique n'est pas la
science de la jeunesse; les conjonctures malheureuses o
je me suis trouv m'ont forc tourner mes vues de ce ct.
Mais je ne doute pas qu'avec son bon esprit, il ne parvienne
V prendre
cot.
L'artde g-ouverner les hommes sera tou-
jours le premier des arts
;
cette sotte espce est, en effet,
bien difficile mener. On a toujours affaire ou leur malice
dans les temps calmes, ou leur barbarie dans les temps
de troubles.
Ma sur, qui vous embrasse tous bien tendrement, doit
crire la petite Paule. Raphal, fier de ses seize ans et
de ses cinq pieds cinq pouces, partirait tout l'heure, si
je le laissais faire. Il veut absolument tter de la bise et des
fig-ues du Languedoc, et surtout voir ses grands parents
et en tre vu.
J'crirai ma mre avec quelques dtails, au premier
jour. La paresse de mon pre ne m'tonne pas; mais s'il
ne m'crit pas, il faudra qu'il me lise. Mon frre lui fera
passer 1 ouvrage que je viens de terminer. Adieu, ma trs
chre tante. Je suis toujours votre Antoine.
La pauvre Rose est donc toujours avec vous? Je lui sais
bon
err de son attachement pour vous et de son souvenir
pour mon compte. Dites-le lui bien.
LETTRES
341
\
XXV
A M. Dalville (i).
Hambourg, 1797.
Mon sjour
|
Hambourg- m'a prouv que l'on peut
y
de-
meurer long-temps sans tre tent d'y acqurir le droit de
Lourg-eoisie : nos usages sont si diflerenls de ceux des g-ens
du nord qu'il faut que la chane de la ncessit fasse sup-
porter ceux-ci, pour qu'on puisse s'y accoutumer. Tout est
ici commerant ou spculateur. L'homme qui a le plus de
ce qu'on appelle des marcs est l'homme par excellence.
Avec des tres de cette trempe, vous imaginez bien que le
titre d'homme de lettres est auprs d'eux la plus lgre
recommandation. On ne sait mme presque pas ce que cette
dnomination impose celui qui ose la prendre. Les soci-
ts se ressentent de l'esprit mercantile qui est la base de
l'industrie locale. Quelques maisons de ng-ociants mritent
cependant une exception particulire; mais leur lourde poli-
tesse tue le g"ot franais. Quant aux femmes, ce sont des
e>j)ces de momies imparlantes, dont la robuste enveloppe
interdit jusqu'aux dsirs. Le spectacle est dtestable, quoi-
qu'il cote beaucjup d'arg-ent. Les libraires meurent de
faim; mais en revanche les marchands de vin sont des mil-
lionnaires. Je mang-e quelquefois chez un mig-r titr, qui
s'est fait restaurateur : cet artiste cuisinier me chtie toutes
les fois que je suis forc de dner chez lui. Jamais Mignot
n'eut un rival plus digne de le faire revivre. Si Hambourg
ne roulait pas perptuellement sur un cercle d'trangers
qui se renouvellent, il faudrait ou prir de
consomption,
ou se faire hambourgeois pour en finir Ne pouvant voir ce
qu'on appelle le monde, il faut bien s'imposer la loi d'une
occupation qui remplisse le vide de la socit. Ma paresse a
beau me faire valoir ses anciens privilges, je la traite
comme une vieille connaissance
;
je travaille le plus que je
peux, mais jamais autant que je voudrais. Une tarentule
qu'on nomme Fauche
(2),
aussi avide d'une page de texte,
i) Suipice de la Platire, ainsi que les n^^ XXVI XXVllI et
XXXII.
'9.)
Libraire de Hambourg, diteur de Rivarol.
342 RIVAROL
qu'un chien de chasse l'est de la cure, est continuellement
ma piste. Mon ami, il faut faire son sillon d'angoisse
dans
ce bas monde, pour avoir des droits dans l'autre. J'ai,
je
pense, assez bien rempli le mien. Vivez heureux
;
jouissez
des charmes du beau climat que je regrette
;
n'ambitionnez
point de quitter les rives de la Seine, moins que vous
n'avez avec vous une Manette et un bon estomac.
Adieu : mes souvenirs me font vivre avec vous
;
mais
mon cur et mes yeux ne cessent de me dire que vous me
manquez.
XXVI
A un ami.
Berlin, 179 9 ou 4800.
Aujourd'hui, en rpudiant tout souvenir du pass, je
n'ai sauv du naufrage que mon indiscrte sensibilit et ma
bonne paresse. Condamn vivre en Allemagne, j'y ai tou-
jours l'me d'un Franais; l'injustice de quelques hommes
ne me dtachera jamais de ma patrie. Lorsque le tonnerre
gronde, il doit tre permis de chercher un abri; c'est ce que
j'ai fait. Si l'horizon politique change, je reverrai Paris; si
la mort, au contraire, me surprend avant, elle nivellera les
regrets de mes amis et la haine de mes perscuteurs.
XXVIl
A un ami.
Berlin, automne 1800.
Me voir en Prusse est une des choses qui m'tonnent le
plus. Je m'tais bien propos de faire une fois dans ma vie
un plerinage au temple de Mars; mais certes je ne pr-
voyais pas que les circonstances rendraient mon bnfice
sujet rsidence. Quoique tout ait ici l'aspect militaire de
Sparte, les Muses
y
ont aussi leur sanctuaire. Certaines soi-
res de Rheinsberg valent srement mieux que celles des
nouveaux riches de Paris. Ici, le matre, sans oublier les
LETTRES 3/}^
devoirs que son rang" lui impose, sait se faire aimer,
, sans cesser d'tre respect. Quiconque a des talents rels,
1 trouve en lui un protecteur
;
qui est malheureux, est sr
j
d'tre prvenu. Si la tactique militaire
y
a le pas sur les
]
philosophes, c'est qu'on prise plus les hommes qui font
I
mtier de tuer et de se faire tuer que ceux qui ne parlici-
'
pent point aux chances de la g'uerre
;
le Grand
Frdric,
a tellement accoutum l'lite de sa nation vivre pour
mourir et mourir pour vivre, qu'il en rsulte qu'on ne
voit presque point de g"cns qui ambitionnent d'autre {gloire
que celle des armes. Lorsque la puissance est toute
militaire,
il faut naturellement que l'esprithelliqucux
devienne l'esprit
national. La mme impulsion a e'ag-n votre France. Si
vous ne devenez pas le peuple le plus heureux du
monde,
i\n moins vous occuperez de long"ues et belles pag-es dans-
los fastes de l'histoire.
XXVIII
Au marquis Dlilly.
Berlin, automne 1800.
Tout comme vous, mon cher marquis, je pensais que la
Revocation de ledit de Nantes avait transplant nos arts
utiles en Allemagne, et qu'ils pouvaient se passer d'entre-
tenir avec la France des relations de premire ncessit;
j'avoue que j'ai t dupe de ma crdulit, et chaque jour me
prouve davantag-e combien on est loin de la perfectibilit
qu'ont acquise ajuste titre les manufactures cle Sedan, de
Louviers et d'Elbeuf. Les matires premires leur
parvien-
nent bien, mais le got et le talent des fabricateurs ne fran-
chissent pas la distance qui les spare de leurs modles.
La porcelaine qu'on fabrique Berlin ne peut tre com-
pare, ni celle de Svres, ni celle du duc
Wngoulme
;
la noblesse lgante des formes antiques est encore au ber-
ceau
;
on est mille lieues de distance pour le brillant du
coloris. C'est au clbre comte de Lauraguais, qu'on doit
en France la suprmatie que nous avons enleve la Chine
et au Japon; c est lui qui a cr cette branche de com-
merce immense, et en cela il a justifi l'emploi des sommes
normes qu'il a dpenses dans son laboratoire de chimie.
344
RIVAROL
J'io-nore si cet homme extraordinaire a survcu aux jours
convulsifs de la Rvolution, mais ce qui n'est pas suscepti-
ble de doute, c'est que son nom sera immortel dans les
fastes des arts.
L'architecture est en g-nral ici lourde; en voulant cal-
quer les palais italiens, on a imit sans g-ot des ori^-inaux,
qui ont dcel le larcin des copistes. Le ciseau arien des
artistes romains
y
est invisible. On rencontre pourtant
quelques belles statues, achetes au, poids de l'or, et quel-
ques tableaux des grands matres des premires coles :
mais ces collections disparates sont sans classification;
nulle mthode n'a prsid leur donner une valeur instruc-
tive.
Les jardins royaux se ressentent de la main qui les a tra-
cs; le climat a pourtant t quelquefois vaincu par l'art,
mais l'art son tour a aussi t vaincu par la rigueur du
climat.
La cour est toute militaire, les grades seuls nuancent les
rangs. Le peuple ne sait qu'obir, payer et craindre. Les
lois sont svres, mais justes, personne n'ose les braver.
Frdric envoya au Spando son chancelier, pour un acte
arbitraire. La diplomatie prussienne a le gnie du monar-
que qui Fa cre, son ombre veille encore sur son ouvrage,
et cette surveillance le fait respecter.
Les ministres du culte n'intriguent point
;
sans influence
politique, ils remplissent leurs fonctions, et ne sont que ce
qu'ils doivent tre.
L'acadmie, en perdant le Salomon du Nord, Voltaire et
Maupertuis, a escompt ses hommes clbres sur 1 ge
actuel. Une place l'Acadmie prussienne ressemble assez
un canonicat. Le chevalier de Boufflers a joui plusieurs
annes des honneurs du fauteuil; il s'y est tellement assou-
pi qu'il va, dit-on, en France, se rveiller, et mourir...
XXIX
A M. de Gaste.
Berlin, 24 janvier 1801.
Votre souvenir, mon aimable de Gaste, est toujours une
bonne fortune pour moi et les belles exemples de Rossi-
LETTRES
345
g-Dol (i) ne m'ont jamais fait autant de plaisir que les zig-s-
zag-s de votre criture. Oui,
j
'accepte votre rendez-vous la
Ramire. Quatre choses sont g-alement ncessaires mon
imagination malade, votre air, votre eau, vos fruits et
votre conversation. Je pris moralement et physiquement
dans ces pays du Nord. Je suis las de ces g'ens que le soleil
reiT;-arde de travers, Que faire d'un climat o les" lments
mmes ont tort? Ici l'air, la terre et l'eau sont vraiment
pervers et le feu, le seul qui soit innocent et pur, et en tat
de corriger les trois autres, ces misrables 1 emprisonnent
dans des poles, de peur de le voir. Je sors d'une maladie
qui a mis le comble mes dg-ots : toutes les voix de la
renomme et toutes les caresses des princes ne valent pas
un tour de promenade dans vos vergers. Sylvns aniem
inglorius.
C'est Dampmartin lui-mcme qui m'a remis votre lettre :
nous sommes lis depuis longtemps. Faites mes compli-
ments Marmier et dites Gombout que Monsieur d'En-
gestrom, qu'il a connu Stockholm et qui est actuellement
ambassadeur de Sude Berlin, a conserv de lui le souve-
nir le plus agrable... Madame de Gaste ne m'a donc point
oubli ! Elle est bien digne d'avoir des amis, et j'ose dire
que je ne suis point indigne de son amiti.
Adieu, mon cher ami, faites, je vous prie, passer le
paquet ci-joint mon pre... j'vite autant que je puis de
mettre mon nom sur les lettres... Vous dites que vous n'a-
vez pas tous mes ouvrages
;
mais si vous les aviez, vous
seriez plus avanc que moi : ce sont vraiment des feuilles
des sybilles, autant en emporte le vent R.
XXX
A son pre.
Berlin, 26 janvier 1801.
Je vous cris ce peu de mots pour vous prvenir que
Dampmartin, m'ayant remis vos lettres et celles de Gaste,
s'est aussi charg de vous faire parvenir ma rponse. Ce
paquet est l'adresse de M. de Gaste
;
prvenez-le que l'en-
(1)
Clbre calligraphe.
346
nivAuoL
Yeloppe contient d'abord uuecourte lettre pour lui, maisque
tout le reste, quoique sans adresse, est pour vous. J'espre
que, prvenu, il ne perdra
pasunmomentet vous fera passer
ce qui vous concerne bien envelopp. Dites-lui encore que le
pape Pie Yl tant mort dans son voisinag-e, sous la tyrannie
du Directoire, et que ce pontife tant vraiment un g-rand
homme,
j'ai imagin qu'une bonne tte de ce pape, grave
en Italie sur une espce de pierre imitant la sardoine, lui
ferait
plaisir; je la lui ferai monter en bag-ue qui fera
cachet :
qu'il m'envoie la m.esure de son doigt, ou par une
petite bande de papier, ou par une ligne qui sera le dve-
loppement du tour de son doigt.
Lorsque je passai d'Yarmouth Guxhaven, nous fmes
suivis de si prs par un corsaire franais, que je me vis,
mon g-rand regret, oblig de jeter un gros paquet de lettres
dans la mer. Il
y
en avait de bien importantes et de bien
honorables, entre autres un bref du Pape dont je viens de
vous parler.
Je vous fais, dans le paquet adress de Gaste, une
courte description de la maladie dont je sors peine. Jesuis
toujours mieux, mais il m'est rest un grand dg-ot pour
le vin
;
c'est un singulier rsultat, et c'est un peu fcheux
dans un pays o les eaux sont si vicieuses.
Ecrivez-moi M. Delke, sous les Tilleuls,
no
55,
Berlin, et donnez-moi pour vous rpondre l'adresse de
quelque Dumas, de quelque Flaiidrn, qui vous rendra le
service de vous prter son nom. Tant que le vtre et le mien
seront sur une adresse, vous pouvez tre sr que ces lettres
seront dcachetes, tant en France qu'en Allemag-ne. Adieu,
vous savez tout ce que je vous suis.
XXXI
A David Cappadoce-Perreira.
Berlin, 21 f^Ter dSOl.
Vous avez raison, mon cher ami, nous aurions besoin
d'une g-rande conversation sur cette
pauvreEurope. Je vous
ai souvent dit que M. Pitt, cocher de l'Europe, nous verse-
rait
;
il a tout perdu par ses lenteurs et ses hauteurs : les
premires ont envenim la Rvolution
;
les secondes ont
LETTRES
347
irrit les cabinets. Maisvoyezraveug-lement de ces derniers!
ils tournent contre l'Angleterre la haine qu'ils ne devaient
3u' la France; et la France, aprs avoir insult, brch,
truit la plupart des puissances, dit au peu qui reste :
Maintenant que je vous ai bien btonnes, vous allez me
servir de btons
;
vous serez les bras et les flaux dont je
(( me servirai contre rAnj^leterre. )) Et tout cela aprs les
proclamations hroques de Paul et de Gustave, aprs le sys-
tme obstin de neutralit de ce pays-ci. Milord Carisford
n'attend que son courrier pour nous quitter. Il faudrait
parler cent ans sur tout cela, et je n'aime pas les critures.
Il est de votre intrt et de celui de tout capitaliste de
courir mme fortune que l'Angleterre
;
il faut donc
y
aller,
vous pourrez bien m'y voir
;
car, ici, point de libert pour
un crivain. Le comte de Schul .. (embourg) a ri de votre
article sur notre querelle. Je le vois tous les jours
;
mais je
voudrais que vous vous assurassiez dextrement du ton sur
lequel le baron de Bre... (teuilj lui a parl de moi
;
ceci entre
nous.
Mille tendresses madame votre mre.
Comme vous aimez les choses piquantes, je vous dirai
que, l'autre jour, un masc^ue en chauve-souris a dit la
Reine, dont le front luisait toile d'un croissant de dia-
mants :
Puisque le sort me fait chauve-souris,
Je vois en vous le bel astre des nuits.
Il faut de sa mtamorphose
Que chaque tre e:arde le ton
;
Car si j'tais un papillon,
Je vous prendrais pour une rose.
On est ft, caress, applaudi, cit : mais pas d'autres
!
faveurs. Adieu.
XXXII
A Manette.
Berlin, 21 f\Tier 1801.
Mon projet est d'aller en France, ma chre petite
;
mais
il ne faut pas
y
aller pour tre perscut, et la sottise de
don Quichotte (son frre) me met dans l'embarras
;
il a
348 RIVAROL
rendu son nom suspect fort mal propos et pour rien. J'ai
t trs malade pendant un mois entier; me voil biea
remis. Une princesse(i)m'adit : Votre sant nous a prouv
que vous tiez trs aimable : et votre maladie que vous tiez
trs aim. On a eu effectivement des attentions infinies
pour moi, et d'Eni^estrom, ministre de Sude, que vous
avez vu Londres, s'est sig-nal. J'ai fait un petit impromptu
la Reine, qui a fort russi. C'est une masque en chauve-
souris qui lui parle au bal :
Puisque le sort m'a fait chauve-souris, etc.
(2)
La reine est trs jeune et trs jolie. Je serai certainement
sur les bords du Rhin aux premiers jours d'avril, et nous
voil plus prs de la moiti du chemin. Adieu, je suis
toujours bien fch que vous ne soyez pas venue Rerlin.
Cette course manque vos caravanes et votre petite g-o-
graphie.
XXXIII
A M. de Gaste.
Berlin, 14 mars 4805.
Vous tes une vritable coquette, mon cher ami, la des-
cription de votre ermitag-e est faite pour me raccrocher. Ds
que je serai rentr Paris, je vous ferai une pacotille de
graine et d'arbustes rares. En attendant, je vais prier la mer
Baltique de me cder un peu de son ambre jaune pour
assortir M^ de Gaste en reine du Nord
;
elle aura le collier,
les pendants d'oreilles, la plaque de ceinture et la bague;
c'est ici la grande mode, et il faut convenir que c'est d'un
bel effet... Vous aurez mon portrait ds que celui que j'ai
laiss Londres sera de retour. On en fera deux copies,
une pour vous, une pour mon pre...
Dampmartin a grande envie de revoir sa patrie
;
je ne
sais mme si nous ne partirons pas ensemble, mais je ne suis
pas si facile remuer que lui
;
j'ai des livres, des tableaux,
dont je veux me dfaire avantageusement avec les Polonais
(i) La princesse Doiorowki.
(2),
Voir la lettre prcdente.
LETTHES
340
et les Russes. Traner ce bag-ag-e Paris, ce serait s'craser
en frais de transport et porter de Teau la fontaine.
Je viens d'crire mon pre pour lui annoncer une petite
somme...
Je dne aujourd'hui chez M. d'Eng-estrom (prononcez
d'Enguestrum), il
y
sera fort question de Leusire. Ma liai-
son avec ce ministre date de Londres, o il tait ambassadeur
eng4. Je suis d'abord fort protg- par son roi qui m'a honor
de plusieurs lettres et de son portrait.
Si Marmier a la goutte, il l'aura bien mrite
;
c'tait la
consolation deMontaig-ne : faites-lui bien mes compliments.
Je partirai d'ici en avril ou en mai. J'irai Dresde voir
sa belle g-alerie, de l je descendrai sur le Rhin, pour faire
un peu ma cour au margrave de Bade, et c'est de l que
j'entrerai en France. Ce prince est fort bien avec le gou-
vernement franais, c'est un vieillard plein d'esprit et de
connaissances. La princesse hrditaire m'a crit une lettre
digne de M^^ de Svign. Elle a deux filles fort belles dont
l'une est reine de Sude, et l'autre grande-duchesse de
Russie. Vous ne sauriez vous faire une ide des bonts et
des grces de cette charmante famille pour tous les Franais
en gnral, et pour votre serviteur en particulier. Je vous
ferai un jour l'histoire de l'migration et je vous tonnerai.
Voil bien du bavardage. Mon ami, si l'amiti allonge
d'un ct, elle excuse de l'autre. Tout vous, Rivarol.
LIVRE V
RIVAROLIANA
I. NOTES, RFLEXIONS, PIGRAMMES
On est minemment malheureux quand on a des g-ots
opposs ses besoins. Par exemple, moi, j'ai le got du
repos et le besoin du mouvement.
Un malheureux jeune homme, s'tant pouss dans le
monde, profitait d'une circonstance heureuse pour envoyer
quelques secours son pre, et recommandait le secret
un ami qui l'aidait en cela : parce que, disait-il, le malheur
d'avoir un pre pauvre pouvait lui faire plus de tort que sa
piti filiale ne lui faisait honneur.
Il est bte, mais il coute les gens d'esprit avec
patience.
Le ciel vous prserve de l'amour d'une Anglaise !
C'est le scandale de la Providence que le bonheur des
enfants
;
car si ce monde tait une bonne chose, ce sont
ceux qui n'y comprendraient rien qui seraient le plus
plaindre.
A Manette qui le menaait, dans une querelle, d'aller
vivre de .sa beaut, Bruxelles : L'avarice chez les Belges
s'oppose aux mauvaises murs.
Le libraire : Je me serais montr honnte.
Moi :
Je n'ai pas voulu vous gner.
D'un joueur devenu courtisan : il ne vole plus depuis
qu'il rampe.
i
352
RIVAROL
Que m'importent
que quelques oisons femelles me
jugent nonchalamment en jouant au loto ?
Que croyez-vous, rpondis-je une duchesse qui disait
qu'elle voulait qu'on fouettt la reine, mais qu'il ne fallait
pas que la Rvolution allt plus loin, que croyez-vous qu'on
lera des duchesses, si les reines sont fouettes ?
Vous vous ennuyez, Monseig-neur?
Qu'importe que
je m'ennuie, pourvu qu'on m'amuse.
Sur un
p... chapp un homme fort sot : aimeriez-
vous mieux, dis-je, que monsieur et parl?
Pourquoi ce libertinag-e ternel? Toujours la fillel..
Eh! oui, flicitez-moi; ma matresse a toujours quinze ans
et je ne reois pas de billets du matin.
Je suis ne, me dit un jour la nlle naturelle du comte
de P..., de la folie sans esprit et de la btise sans bont.
Enferm dans ma paresse, je voyais crotre autour de
moi ma rputation de mchant, sans qu'il m'en cott d'au-
tres crimes que quelques gats, et je me disais : les Nron
et les Caiig-ula commettaient bien ces crimes pour se faire
craindre et har, tandis qu'avec quelques plaisanteries ils
auraient pass pour des monstres.
Au Caveau, vers
1780,
il se tenait des propos si srieux
que nous faisions prir d'ennui nos espions : on prit donc le
parti de vous donner un acadmicien, Suard (i).
La nature n'ayant plus rien de nouveau m'olrir et
la socit encore moins, je ne veux que l'air et l'eau, le
silence et l'absence, quatre lments de ma vie, quatre cho-
ses sans got et sans reproche.
Sur vingt personnes qui parlent de nous, dix-neuf en
disent du mal, et le vingtime, qui en dit du bien, le dit
mal.
Que faire entre des malveillants qui disenttourdiment
le mal dont ils ne sont pas srs, et des amis qui taisent
prudemment le bien qu'ils savent?
(i) Voyee plus haut, page ig3.
RIVAROLIANA
353
M. Dulens, auteur crun livre (i) o il dit que les
modernes ont tout tir des anciens; lui demander pourquoi
il n'a pas donn un fusil Apollon. Au reste, comme il
y
aura de nouvelles dcouvertes, et par consquent de nou-
veaux Dutens qui ne manqueront pas de les attribuer aux
anciens, je voudrais que celui-ci prvnt ses confrres et
trouvt tout d'un coup dans les anciens toutes les dcou-
vertes qui sont faire in scula scaloram. Amen.
Rg-le pratique : Ne jamais prter de livres aux fem-
mes, moins qu'elles ne soient enfermes.
Sur Mirabeau : L'argent ne lui cote que des crimes,
et les crimes ne lui cotent rien.
Histoire de
I\I^'e
Lag-uerre, qui ayant eu un dml
assez vif avec son amant, s'enfuit un soir de l'opra avec
ses habits de thtre, tout en pleurs, et perdant si bien la
tte qu'elle s'g-ara dans la campag-ne. Elle
y
passa la nuit
pleurer, et vers le matin (c'tait en t) elle se mit chan-
ter et saluer l'aurore d'un trs bel air qu'elle avait sou-
vent fait applaudir tout Paris. Les paysans qui aperu-
rent cette belle crature avec des habits d'une richesse et
d'un g-ot inconnus pour eux, tonns de ses gestes, de sa
superbe taille et de sa voix, la prirent pour la Vierg-e ou
pour un ange et se mirent genoux autour d'elle. Suppo-
sez qu'un char tel que celui que Charles enleva aux Tuile-
ries ft alors descendu pour prendre ]\I''^ Laguerre, l'erreur
n'tait-elle pas invincible? Les tmoins ne se seraient-ils
pas fait gorg-er pour soutenir l'apparition et l'ascension de
cette divinit? Y aurait-il eu dans aucune relig-ion un
miracle plus clatant et mieux prouv? C'est pourtant au
sicle des lumires que ceci s'est pass, en
1778
et Paris.
Non seulement le Dieu des hommes est un homme;
mais le Dieu des Juifs tait Juif, celui du Japon est Japo-
nais, etc.
Sur Laurag-uais : Les ides sont dans sa tte comme
des carreaux de vitre en caisse : claires chacune part et
obscures ensemble.
(i) Origine des dcouvertes atlribaes aux modernes
{1776).
20.
354 uiVAnoL
A un sot qui se vantait de savoir quatre lan^-ues : Je
vous flicite, vous avez quatre mots contre une ide.
Je dormais; l'vque dit cette dame : laissons-le
dormir, ne parlons plus.
Je lui rpondis : si vous ne par-
lez plus, je ne dormirai pas.
Les hommes ne sont pas si mchants que vous le dites.
Vous avez mis ving-t ans faire un mauvais livre, et il
ne leur a fallu qu'un moment pour l'oublier.
Vous parliez beaucoup avec des gens bien ennuyeux.
Je parlais de peur d'couter.
Je vous crirai demain sans faute.
Ne vous nez
pas, lui rpondis-je, crivez-moi comme votre ordinaire.
M. de Lauraguais a compar mon esprit un feu qui
brle sur l'eau. Expliquer cela (i).
Il
y
avait dans ma jeunesse, Paris, des hommes qui
donnaient beaucoup d'argent aux filles pour s'en faire
aimer. <(
C'est un homme, disait une de ces tilles, en parlant
du duc de
*'*,
qui veut tre ador, et c'est cher.
En
1872, quelques demoiselles de nom, ges de
quinze dix-huit ans, s'ennuyant l'Abbaye-aux-Bois, s'a-
visrent d'crire une belle lettre au Grand Turc pour le
supplier de les admettre dans son srail. La lettre, inter-
cepte, fut remise au roi, et on en rit beaucoup la cour.
L'ennui du couvent et le dsir de Tambour leur firent faire
une chose trs naturelle.
Une femmedisait un parvenu trs vain qui lui refu-
sait une grce : Fi! fi ! vous avez bien tous les dfauts
des grands. Et elle obtint tout ce qu'elle demandait.
Les journalistes qui crivent pesamment sur les
posies lgres de Voltaire sont comme les commis de nos
douanes qui impriment leurs plombs sur les gazes lgres
d'Italie.
(i) Cette premire srie de Xotes a t releve par M. Le Breton
dans les Carnets autographes de Rivarol.
RIVAROLIANA
355
Mirabeau tait l'homme du monde qui ressemblait le
plus sa rputation : il tait affreux.
Mirabeau est capable de tout pour de l'argent, mme
d'une bonne action.
La dissimulation peut mener l'esprit : G... dit si
souvent le contraire de ce qu'il pense que celalui fait attra-
per de jolies choses.
M. de Crqui ne croit pas en Dieu : il crainten Dieu.
Ma besogne du Dictionnaire de la langue franaise me
fait penser celle d'un amant mdecin, oblig de dissquer
sa matresse.
Un jour je m'avisai de mdire de
l'Amour
;
il m'en-
voya l'Hymen pour se venger. Depuis, je n'ai vcu que de
regrets.
Je ne suis ni Jupiter ni Socrate, et j'ai trouv dans
ma maison Xantippe et Junon (i).
Je ne connais gure en Europe que madame de Stal
qui puisse tromper sur son sexe.
LE CHOU ET LE NAVET
(2).
1782
Le Chou, l'abb D...
Lorsque sous tes emprunts masquant ton indigence,
De tous les crivains tu cherchais l'alliance,
D'o vient que ton esprit et ton cur en dfaut,
Du jardin potager ne dirent pas un mot ?
Il aurait pu fournir ta veine puise
Des \Tais trsors de l'homme une peinture aise:
Le verger de ses fruits et dcor tes chants,
Et mon nom t'et valu des souvenirs touchants.
N'est-ce pas moi, rponds, crature frag-ile,
Qui soutins de mes sucs ton enfance dbile ?
(i) Voir les Appendices
4
et 5.
(2) Ce dialogue fut, dit Cubicres, imprim et rimprim plus de trente
fois. Il donna mme lieu une superbe gravure o l'abb Delille tait
reprseut d'une manire burlesque, eu contemplation devant un panier
rempli de navels et de choux, avec ce vers crit au bas en gros carac-
tres :
SA GLOIRE PASSERA, LES NAVETS RESTERONT.
350
Le navet n'a-t-il pas, dans le pays latin,
Longtemps compos seul ton modeste festin,
Avant que dans Paris ta muse Iroide et mince
g-ayt les soupers du commis et du prince?
Enfant dnatur, si tu rougis de moi,
Vois tous les choux d'Auvercne levs contre toi !
Songe tous mes bienfaits, dlicat petit-matre :
Ma feuille t'a nourri, mon ombre t'a vu natre;
Tu reus du navet ta taille et ta couleur
;
Et, comme nos lapins, tu me dois ton odeur.
Le Nil me vit au rano; de ses dieux domestiques
;
Et l'auteur immortel des douces Gorgiques,
De ses grandes leons interrompant le fil,
S'arrta dans son vol pour chanter le persil.
Que ne l'imitais-tu ! mais ta frivole muse
Qutant un sentimentaux chos de Vaucluse,
De Ptrarque en longs vers nous rabche la foi,
Et ne rserve pas d'hmistiche pour moi.
Rponds donc maintenant au cri des chicores,
Aux clameurs des oignons, aux plaintes des poires,
Ou crains de voir bientt, pour venger notre affront,
Les chardons aux pavots s'enlacer sur ton front.
Le Navet, au chou.
J'ai senti, comme toi, notre commune injure
;
Mais ne crois pas, ami. que par un vain murmure,
Des oignons irrits j'imite le courroux :
Le ciel fit les navets d'un naturel plus doux.
Des mpris d'un ingrat le sage se console.
Je vois que c'est pour plaire ce Paris frivole,
Qu'un pote orgueilleux veut nous exiler tous
Des jardins o Virgile habitait avec nous.
Un prtre dans Memphis, avec crmonie.
Et conduit au bcher le candidat impie :
Mais le temps a dtruit Memphis et nos grandeurs :
Il faut son tat accommioder ses murs.
Je permets qu'aux boudoirs, sur les genoux des belles,
Quand ses vers pomponns enchantent les ruelles
;
Un lgant abb rougisse un peu de nous.
Et n'y parle jamais de navels et de choux.
Son style citadin peint en beau les campagnes
;
Sur un papier chinois il a vu les montagnes, -
La mer l'opra, les forts Lon-Champs,
Et tous ces grands objets ont anobli ses chants :
Ira-t-il, descendu de ces hauteurs sublimes,
RIVAROLIANA ^0"]
De vinjt noms roturiers dshonorer ses rimes,
Et pour nous renonant au musc du parfumeur,
Des choux qui l'ont nourri lui prfrer l'odeur ?
Papillon en rahat, coiff d'une aurole.
Dont le manteau pliss voltie^e au r d'Eole,
C'est assez qu'il effleure en ces leaders
propos,
Les bosquets et la rose, et Vnus et Paphos :
La mode, l'il changeant, aux mobiles aic^rettes.
Semble avoir pour lui seul fix ses jL^iroueltes
;
Sur son char fugitif o brillent nos Las,
L'ennemi des navets en vainqueur s'est assis;
Et ceux qui pour Jeannot abandonnent Prville,
Lui dcernent dj le laurier de Virgile.
Le Chou.
Qu'importent des succs par la brig-ue surpris
;
On connat les dgots du superbe Paris.
Combien de grands auteurs dans leurs soupers brillrent.
Oui malgr leurs amis, au grand jour s'clipsrent I
Le monde est un thtre, et dans ses jeux cruels.
L'idole du matin le soir n'a plus d'autels.
Xous
y
verrons tomber cet esprit de collge,
De ces dieux potagers dserteur sacrilge.
Oui, la fortune, un jour, vengera notre affront :
Sa gloire passera, les navets resteront
.
A MANETIE
(!)
Vous dont l'innocence repose
Sur d'inbranlables pivots.
Pour qui tout li^Te est lettre close.
Et qui de tous les miens ne lirez pas deux mois;
Oui, loin de distinguer les vers d'avec la prose,
Ne vous informez pas si les biens ou les maux
Ont l'encre et le papier pour cause;
S'il est d'autres lauriers ou bien d'autres pavots
Que ceux qu'un jardinier arrose;
Et qui ne souponnez de plumes qu'aux oiseaux;
Vous qui m'offrez souvent l'aide de vos ciseaux
Dans les difficults que l'tude m'oppose.
Ou quelques bouts de fil pour coudre mes propos
;
Ah! conservez-moi bien tous ces jolis zros
Dont votre tte se compose.
Si jamais quelqu'un vous instruit,
(i) Sulpice de la Plalire, Vie de Rivarol.
358
RIVAROL
Tout mon bonheur sera dtruit
Sans que vous
y
^aniez grand'chose.
Ayez toujours pour moi du got comme un bon fruit,
Et de l'esprit comme une rose.
SUR FLORIAN
(1)
Ecrivain actif, gnerrier sage,
Il combat peu, beaucoup crit
;
Il a la croix pour son esprit
Et le fauteuil pour son courage.
sur l'acadmie
Si tu prtends avoir un jour ta niche
Dans ce beau temple o sont quarante lus,
Et d'un portrait guind vers la corniche
Charmer les sots, quand tu ne seras plus.
Pas n'est besoin d'un chef-d'u%Te bien' ample :
II faut fter le sacristain du temple.
Puis ce monsieur t'ou\Tira le guichet,
Puis de lauriers tu feras grande chre
Puis immortel seras comme Porchre,
]Maury, Cotin, et La Harpe, et Danchet.
Un a!?ioteur disait trs srieusement de Mirabeau :
C'est rhomme le plus net de l'Assemble; il dit : je veux
tant, et il n'y a pas marchander
;
j'aime traiter avec lui.
Les filles de Venise, ajoutait Rivarol {Journal poL, III,
n^ 6', ont aussi leur prix sur leur porte.
Il V a des gens qui sont toujours prs d'ternuer; Gart
est toujours prs d'avoir de l'esprit et du bon sens.
Certains auteurs ont une fcondit merveilleuse; Gart
a une
malheureuse fcondit.
Les ouvrages de Cubires, qui se vendent sur le titre,
sont comme ces ballots que les Hollandais expdient pour
Batavia, et qui reviennent, d'aprs l'tiquette, sans avoir
t
ouverts.
Le Franais cherche le ct plaisant de ce monde,
l'Ang-lais semble toujours assistera un drame, de sorte que
ce que l'on dit du Spartiate et de l'Athnien se prend ici
la
(ij Esprit de Rivarol.
niVAUOLi.w.v
359
tire. On ne g'ag'ne pas plus ennuyer un Franais qu'
vertir un Anglais.
J'ai quitt TAngleterre pour deux raisons : c'est que
l'abord
le climat ne me convient pas, et qu'ensuite j'ai
lesoin d'tre sur le continent pour mon dictionnaire de la
iingue. D'ailleurs, je n'aime pas un pays o il
y
a plus
'apothicaires que de boulang-ers, et ou 'on ne trouve de
ruilsmrs que les pommes cuites. Les Anglaises sont belles,
lais elles ont deux bras gauches.
Et la grce plus belle encor que la beaut,
dit notre la Fontaine, qui a dit tant de choses; les Fran-
aises doivent trouver ce vers charmant (i).
Mon pitaphe :
LA PARESSE NOUS l'aVAIT RAVI AVANT LA MORT.
II. ANECDOTES ET BONS 3I0TS
Il racontait cette anecdote : Un courtisan (et je ne
irois pas qu'il
y
ait quelque chose au monde de plus sot
'ju'un courtisan) rpondit Louis XV, qui lui demandait
[heure : Sire, l'heure qu'il plaira votre Majest.
Dans une dispute littraire, Mirabeau s'emporta contre
\ivarol et lui dit qu'il tait une plaisante autorit, et
lu'il devait observer la diffrence qu'il
y
avait entre leurs
eux rputations.
Ah ! monsieur, rpondit Rivarol, je
l'eusse jamais os vous le dire
(2).
Il disait de Rulhires, mais le mot a aussi t attribu
Chamfort : Il reoit le venin comme les crapauds et le
end comme les vipres
(3).
Il disait des vers de Franois de Neufchteau : c'est de
a prose o les vers se sont mis.
Rivarol avait dit un mot sale sur le baron deKrudner,
1
(i) Ce passage, tir de la fausse lettre l'abb de Villefort (voir plus
{oin, pa:e
429 ,
semble bien de Rivarol.
I (2)
Malletdu Pan.
i
(3)
Sur le cas qu'il faisait de Rulhires, voir Dialogue des morts,
bae 193.
36o
nivAROL
mot qui, je crois, lui avait dplu. Je ne mets plus le nez l
il pte son esprit. Il faut savoir que M. de Krudne
jetait pour ainsi dire les sons de sa bouche : ce n'tait pa
un
bgaiement,
c'tait une sorte de difficult (i).
L'autre
jour, un pauvre diable de dmocrate, un
manire de Peti...
poursuivait de questions M. de Riva
qui ne lui
rpondait
jamais rien. A la fin, il lui dit : Est
ce que vous me
mprisez?
Non, dit M. de Riva..., je a
m'en soucie
pas
(2).
Le
Rivarol par excellence
Dinait avant-hier chez Conti.
Conti s'est amus, je pense;
Mais Rivarol s'est diverti
(3).
Dans un cercle, une dame qui avait de la barbe ai
menton ne
dparla pas de toute la soire. Cette femme
dit enfin
Rivarol, est homme parler jusqu' demair
matin.
Un jour
Rivarol avait discut trs vivement sur Is
politique avec M. de B..., son secrtaire. Celui-ci lui dit :
Je suis bien aise,
monsieur de Rivarol, que vous vous rap-
prochiez en'fin de mes ides.
Et moi, je suis charm d<
voir que vous vous
rapprochiez enfin de mon genre.
A un nomm
Duhamel, homme trs obscur, qui se
plaignait
d'avoir t cit dans le Petit Almanach de noi
grands hommes
(4)
Voil lesinconvnients__de la clbrit!
Rivarol avait emprunt M. de Sgur le jeune une
bague o tait la tte de Csar. Quelques jours aprs, M. de
Sgur la lui redemanda.
Rivarol lui rpondit : Csar ne
rend pas.
A
propos de la Fayette : A force de sottises, il vint
bout de ses amis, et sa nullit triompha de sa fortune.
Quand Rivarol fut prsent Voltaire, ils eurent une
conversation sur les
mathmatiques, et entre autres sur
l'algbre. Voltaire lui dit, avec le poids et l'ironie de son
(i) Mmoires de Tilly, III,
p.
266.
(2)
La Chronique scandaleuse, n 26.
(3)
Peltier.
(4)
Sa notice est insignifiante.
nn'AnoLiAVA
3fti
ge: f( Eh bien, qu'est-ce que c'est que celte algbre o l'on
marche toujours un bandeau sur les veux? Oui, reprit
Rivarol avec toute la vivacit d'une jeune imagination, il
en est des oprations de l'algbre comme du travail de
nos dentelires,qui, en promenant leurs fils au travers d'un
labvrinthe d'pingles, arrivent, sans le savoir, former un
magnifique tissu.
Quelqu'un venait de lire Rivarol un parallle entre
Corneille et Racine, fort long et fort en nuveux : Votre pa-
rallle est fort bien, mais il est un peu long, et je le rdui-
rais ceci : L'un s'appelait Pierre Corneille, et l'autre
s'appelait Jean Racine.
De Champcenetz : Il se bat pour les chansons qu'il n'a
pas faites, et mme pour celles que ses ennemis lui accor-
dent.
DeM.M... (i): Son A niant bourru ostun des ioyauxda
Thtre-Franais
;
ses Amours de Bayard se sont empars
d'un public encore tout chaud du Mariage de Figaro, et
en ont obtenu les mmes transports. C'est le thtre des Va-
rits qui a donn l'ide de ces normes succs. MM. M... et
Reau marchais doiventbieu entre eux se moquer de Molire,
qui, avec tous ses efforts, n'a jamais pass les quinze repr-
sentations I Se moquer de Molire est bon
;
mais en avoir
piti serait meilleur.
D'un article de YEncyclopdie sur l'vidence, par
Turbot,
article fort obscur : C'est un nuage charg d'crire
sur le soleil.
Sur M. de S... : C'est un homme qu'on fuit dans les
temps calmes, et qui fuit dans les temps d'orage.
A quelqu'un qui lui disait : Connaissez-vous la Mes-
siade de Klopstock"? Oui, c'est le pome o il
y
a le plus
de tonnerres.
D'un madrigal et d'une pigramme galement inno-
cents : Il
y
a un peutrop de madrigal dans son pigramme,
et un peu trop d'pigramme dans son madrigal.
De M. R... : Ses pigrammes font honneur son
cur.
(i) Boulet, dit de Monvel.
'602 RIVAUOL
Targ-et avait dit l'Assemble : Je vous eng-a^e,
messieurs, mettre ensemble la paix, la concorde, suivies
(lu calme et de la tranquillit. Rivarol parodiait ainsi
plaisamment
l'loquence un peu niaise de cet orateur : Et
n'allez pas mettre d'un ct la paix et la concorde, et de
l'autre le calme et la tranquillit; mEtis mettez tout ensemble
la
paix et la concorde, suivies de la tranquillit.
L'abb Delille s'tait fait suivre, dans l'migration,
d'une nice, d'un caractre assez dsag-rable : L'abb,
lui dit un jour Rivarol, puisque vous aviez le droit de
vous choisir une nice, vous auriez bien d la choisir plus
polie. ))
Le duc de Guiche, un souper chez
M"^e
de Polinac,
tonn de la considration particulire qu'on tmoignait
Rivarol, dit un de ses voisins : Si cela dure, les salons vont
devenir des acadmies. Monsieur le duc, rpondit R.iva-
rol, avant que cela n'arrive, il faudra que les salons soient
composs de gens dignes de tenir leur place dans les aca-
dmies.
Un jour, Hambourg, Taileyrand entre dans un
salon o l'on parlait prcisment de lui. Il s'informa du
sujet de la conversation : (c Nous parlions, dit Rivarol, de
quelqu'un que l'on pourrait prendre pour la justice
d'Horace (i), si ce n'tait elle qui, depuis longtemps, court
aprs lui.
Il disait des mi2:rs, la plupart si dchus dans l'exil :
Les papillons sont devenus chenilles.
Une dame, Londres, lui montrait avec complaisance
des bijoux prcieux, qu'il reconnut pour avoir fait partie du
mobilier de Versailles: Madame, dit R.ivarol, je suis bien
fch pour vous que vous ne possdiez cela que de seconde
date.
Sur l'abb Giraud, qui s'tait fait dnigreur de son
mtier, et qui avait coutume de dire de tous les livres qu'il
lisait : C'est absurde ! Il va laissant tomber sa signature
partout
.
De l'archevque de V..., qui, ayant embrass dans
(il. Pcde pna claudo.
nivAnoi.iAN'A 363
rAsscmblcc constituante les principes pliilosophiqiies qu'il
avait vivement combattus toute sa vie : Il s'est fait l'cxccu-
tcur testamentaire de ses ennemis.
Lorsqu'il apprit que l'archevque de Toulouse s'tait
empoisonn : C'est, dit-il, qu'il aura aval une de ses
maximes.
Son frre vint lui annoncer un jour qu'il avait lu sa
Irag-die devant M. F... : Hlas ! je vous avais dit que c'tait
un de nos amis.
Le comte et la comtesse de T. .
.,
oldii^-s de quitter
la
I^rancedans des temps ora;;5-eux, aprs avoir err long-temps
en Allemagne, arrivrent enfin Hambourg*. Ne sachant
o porter leurs pas dans cette ville o le nom d'mig-r et
celui de proscrit taient synonymes, le dsespoir tait au
comble pour ces deux infortuns, lorsque, par un hasard
heureux, le comte de T... rencontre, prs de l'hlel du minis-
tre d'Espag"ne, Rivarol, dans un moment o il se disposait
monter en voiture, pour aller passer quelques jours la
campagne. Pvivarol, au premier coup-d'ceil, lit dans les
yeux de son ancien ami tout ce qu'il avait lui apprendre:
A en prvient les douloureux dtails par une amabilit
pleine de g-rces; son cur, cette fois, avait devanc son
esprit. Cette voiture est vos ordres, leur dit-il, allons
chez vous, et de l chez moi
;
vous
y
resterez jusqu' ce que
vous trouviez mieux Le comte et la comtesse de T...,
pntrs des soins dlicats de leur bienfaiteur, exaltaient
partout la noblesse de ses procds. Rivarol disait encore
iiu bout de six mois de leur rsidence chez lui, ceux qui
Jiii en parlaient : Dans d'autres temps ces braves gens-l
m'ont combl d'honntets. La roue a tourn contre eux;
ils en sont moins tonns srement que de toir un pote
qui leur donne dner (i).
Dumouriez, aprs avoir un moment tonn l'Europe
par ses victoires, a fini par tre oblig de se confiner dans
un village prs d'Hambourg. C'est de l qu'il a publi tous
rves politiques qui, sans aucune utilit pour les cabinets ].
_ _ _
(les souverains, n'en remplissent pas moins le but de faire
)
Sulpicc de la Plaicre,
3 34
RIVAROL
parler de lui. La baronne d'Ang-el (i), sur de Rivarol, qui
avait joui de la g-loire de Dumouriez, voulut g"alement
partag-er sa mauvaise fortune. Elle crivait souvent son
frre : (c Tirez donc Damouriez de son tombeau; parce
qu'il a fait, on doit juger de ce qu'il fera encore. Rivarol,
lass apparemment d'tre importun pour une chose qui
tait peut-tre au-dessus du crdit dont il jouissait prs
d'une g-rande puissance du Nord, rpondit sa sur: k Si
les prires flchissent le courroux du ciel, c'est ceux qui
ont la foi de prier : pour moi, ma chre, qui n'ai prcis-
ment que celle qu'il me faut, je suis trs loin d'aspirer
faire un miracle : l'opinion a tu Damouriez, lorsqu'il a
quitt la France. Dites-lui donc en ami de faire le mort :
c'est le seul rle qu'il lui convienne de jouer; plus il crira
qu'il vit, plus on s'obstinera le croire mort
(2).
Rivarol et l'abb Sabatier avaient t invits d-
jener chez Ja princesse de Vaudemont. On offrit du sau-
cisson d'non l'abb Sabatier, qui hsitait. Inutile d'in-
sister, dit Rivarol, l'abb n'en mangera pas; il n'est pas
anthropophage.
Il fut un moment o M^ de Genlis faisait paratre,
tantt un thtre l'usage des enfants, tantt un ouvrage
asctique, puis des romans; les gens de lettres, bien ou mal
accueillis chez la gouvernante des enfants du duc d'Orlans,
embouchaient la trompette de la renomme, pour exalter ou
dprcier cette femme auteur. Rivarol, consult sur ce qu'il
pensait des ouvrages de
M^e
de Genlis, rpondit au ques-
tionneur : (( Monsieur, j'ajourne ma rponse jusqu' ce que
((
Mme
Je Genlis ait fait un ouvrage de femme; je n'aime
que les sexes prononcs
(3).
Rivarol causant un jour avec d'Alembert qui n'aimait
pas Bufl"on,le secrtaire de l'Acadmie, lui disait : Ne me
(f
parlez pas de votre Buffon, de ce comte de Tuffires, qui,
au lieu de nommer simplement le cheval dit : La plus
(( noble conqute que l'homme ait jamais faite,
est celle
de ce
fier
et fougueux animal,etc., que ne dit-il le che-
(i) Plus connue sous le nom de baronne de Beauvert,
(2)
Sulpice de la Flatire.
{'j Ibid.
RIVAROLIANA
365
(( val?
Oui, reprit Rivarol, c'est comme ce sot de Jean-
(( Baptiste Rousseau, qui s'avise de dire :
Des bords sacrs o nat l'aurore
Aux bords enflamms du couchant.
Au lieu de dire de est Vouesl (i).
Le secrtaire de Rivarol ne se rappelait plus le soir ce
qu'il avait crit le malin. Aussi Rivarol disait de lui : Ce
serait un excellent secrtaire de conspiration.
Il disait, propos de Tabb de Vauxcelles, auteur de
plusieurs oraisons funbres : On ne sent jamais mieux le
nant de l'homme que dans la prose de cet orateur.
Rivarol disait de son frre : Il serait l'homme d'esprit
d'une autre famille, et c'est le sot de la ntre.
Il disait de Palissot, tour tour transfug-e de la reli-
gion et de la philosophie : Il ressemble ce livre qui,
s'tant mis courir entre deux armes prtes combattre,
excita tout coup un rire universel.
Il disait de Gart qui dfig"urait un de ses bons mots,
en le rptant : Il ne tient pas lui que ce ne soit plus un
bon mot.
Il disait de Thibault qui faisait Hambourg- des lectures
trs peu suivies : Il paie les huissiers, non pas pour empo-
cher d'entrer, mais pour empcher de sortir.
Au sujet des accroissements de Paris, il disait : Paris
ressemble une fille de joie qui ne s'agrandit que par la
ceinture.
Beaumarchais,le jour de la premire reprsentation de
Figaro, disait Rivarol, qui se trouvait ct de lui au
spectacle : J'ai tant couru ce matin Versailles, auprs de
la police, que j'en ai les cuisses rompues.
C'est toujours
cela, reprit Rivarol.
Le duc d'Orlans, au commencement de
1789,
jeta les
yeux les yeux sur Rivarol, et lui dpcha le duc de Biron,
pour l'engaifer publier une brochure sur ce qu'on appelait
les dilapidations de la cour. Rivarol parcourut d'un air
(i) Esprit d Riuarol. L'pigraaame est contre d'AIcmbert.
366 RIVAROL
ddaigneux le canevas qu'on lui prsenta. Aprs un moment
de silence, il dit au plnipotentiaire : Monsieur le duc,
(( envoyez votre laquais chez Mirabeau
;
joig-nez ici qucl-
ques centaines de iouis, votre commission est faite.
L'abb de Balivire lui demandait une pigraphe,
pour une brochure qu'il venait de composer : Je ne puis,
rpondit-il, vous ofl'rir qu'une pitaphe.
Quelqu'un lui demandait son avis sur un distique :
C'est bien, dit-il; mais il
y
a des longueurs (i).
M. de L*** avait dit dans une socit l'abb de Bali-
vire : mettez-vous l, ct de moi, Tabb
;
vous direz
force btises, et cela rveillera mes ides. Rivarol retournait
plaisamment ce mot de M, de L'*% en disant son secr-
taire : M. de B***, mettez-vous l, je vous dirai force bti-
ses, et cela rveillera vos ides.
Il disait du chevalier de P**% d'une malpropret re-
marquable : Il fait tache dans la boue.
Un jour, traversant le Palais-R.oyal, il rencontra Flo-
rian qui marchait devant lui, avec un manuscrit qui sortait
de sa poche, il l'aborda, et lui dit : Ah! Monsieur, si l'on
ne vous connaissait pas, on vous volerait
(2).
L'abb de Balivire disait Rivarol, au sujet de la
Rvolution : oui, c'est l'esprit qui nous a tous perdus. Il lui
rpondit: Que ne nous offriez-vous l'antidote?
Il disait des laquais enrichis : Ils ont saut du derrire
de la voiture en dedans, en vitant la roue.
Il dit, en apprenant la nomination de Chamfort
l'Acadmie franaise : C'est une branche de mug-uet ente
sur des pavots.
Il disait de Cubires, qui singeait Dort : C'est un
ciron en dlire qui veut imiter la fourmi.
Le marchal de Sgur, qui tait manchot, venait de
solliciter une pension de l'assemble constituante. Rivarol
dit ce sujet: Il tend l'assemble jusqu' la main dont le
bras lui manque.
()
Le mot est sous une autre forme dans le Petit Almanach,
p.
05.
(2)
Journal Royaliste, 2 juin
1792.
RIVAHOLIVNA BO
Qaclqirun lui disait: connaissez vous le vers du si-
cle:
Le trident de Neptune est le sceptre du monde.
Oui, rpondit-il, c'est un ver solitaire.
Sur M. deChauipccnolz l'an, homme trs mystrieux :
Il n'entre point dans un appartement, il s'y glisse, il longe
le dos des fauteuils, et va s'tablir dans l'angle d'un appar-
tement; et quand on lui demande comment il se porte:
Taisez-vous donc; est-ce qu'on dit ces choses-l tout haut?
Que pensez-vous de mon fils, demandait un jour
BulFon Rivarol? Il
y
a une si grande distance de vous
lui, rpondit-il, que l'univers entier passerait entre vous
deux.
Il disait un de ses amis presque aussi malin que
lui (i): Pour peu que cela dure, avec nous il n'y aura plus
un mot innocent dans la langue.
Il disait de Beauze : C'est un bien honnte homme,
qui a pass sa vie entre le supin et le grondif.
M. de Maurepas, ayant dsir connatre Rivarol, se le
fit prsenter. Ce dernier soutint dignement la rputation
qui l'avait devanc chez le vieux ministre. M. de Maurepas,
dans un moment d'enthousiasme, dit : C'est honteux qu'un
liomme de votre mrite soit ainsi oubli; on ne donne
plus rien qu'aux oisifs.
Monsieur, rpliqua Rivarol,
de grce ne vous fchez pas; je vais l'instant me faire ins-
crire sur la liste : dans peu, je serai un personnage.
Quelqu'un lui disait de l'abb Giraud, qui avait fait
une comdie intitule le Bourgeois rvolutionnaire : \\
trouve sa pice g^aie.
Je le crois bien, rpondit Rivarol,
c'est l'homme le plus triste de son sicle !
Rivarol se plaisait raconter que deux voques trs
\;s se promenaient ensemble au parc de Bruxelles, en
1792,
tous les deux appuys sur leurs cannes pomme d'or
et bec corbin. L'un d'eux, aprs un long silence, dit
l'autre : Monseigneur, croyez-vous que nous soyons cet
(i) Champcenelz, sans doute.
368 RIVAROL
hiver Paris? L'autre reprit d'un ton fort g-rave: Monsei-
g-neur, je n'y vois pas d'inconvnient (i).
Il disait, en parlant des orateurs de TAssemble cons-
tituante, fort inconnus avant leurs motions: Ce sont des
champig-nons politiques et littraires, ns tout coup dans
les serres chaudes de la philanthropie moderne.
L'abb Delille, aprs son raccommodement, Ham-
bourg-, avec Rivarol, lui dit de ces choses aimables qui lui
sont naturelles, et termina par ce vers :
Je t'aime, je l'avoue et je ne te crains pas.
Un Allemand, prsent cette conversation, s'cria : pour
moi, je retourne le vers :
Je te crains, je l'avoue, et je ne t'aime pas.
Rivarol rit aux clats de cette remarque nave.
A l'poque de l'affaire des parlements, en
1788,
le duc
d'Orlans fut exil Villers-Gotterets. Ce prince parut
acqurir alors une espce de popularit, et se relever dans
l'estime publique,sur quoi Rivarol dit : Ce prince, contre les
lois de la perspective, parat s'agrandir en s'loignant.
Dans un souper de Hambourgeois, o Rivarol prodi-
guait les saillies, il les voyait tous cherchera comprendre un
mot spirituel qui venait de lui chapper. Il se retourna vers
un Franais qui tait ct de lui, et lui dit : Vovez-vous
ces Allemands ! ils se cotisent pour entendre un bon mot.
Rivarol avait t invit djeuner chez Madame de
Vaudemont. On s'attendait qu'il ferait beaucoup de frais
d'esprit, il ne dit pas un mot. Enfin, harcel par ses voisins,
il dit une grosse btise. On se rcria, et il reprit : Je ne peux
pas dire une btise que l'on ne crie au voleur.
Je veux bien, disait-il une dame, vieillir en vous
aimant, mais non mourir sans vous le dire.
Une femme, aprs avoir entendu son morceau sur TA-
miti, lui demanda pourquoi il n'avait pas peint les femmes
aussi susceptibles d'amiti que les hommes. C'est, dit-il,
(i) L'anecdote est dans les Mmoires cVOatre-tombe, II,
p. 125 (d.
Bir).
RIVAROLIANA
869
qu'tant la perfection de la nature, comme l'amour est la
])(Tfection de l'amiti, vous ne pouvez prouver d'autre sen-
timent que celui qui vous est analog-ue.
Sur une femme qui perdait ses amants : Elle s'aji^ran-
dit, sans g-arder ses conqutes.
Voltaire disait de Rivarol: C'est le Franais par excel-
lence.
Il fitmettre cette Note de rclileiirkla brochure De la
f'Iiilosophie moderne
(1799)
qui est un extrait de son Dis-
iiirs Prliminaire, publi deux ans plus tt: Ce i^rand
iivrati'e n'a pas pu pntrer en France, g-rce la protec-
tion puissante queFranois (de Neuf-chteau) accordait aux
lettres et aux arts .
Fontanes lui avait communiqu, en 1800,
quelques
j)onnes feuilles de la premire version du Gnie du
(^christianisme, probablement le chapitre sur les Tombeaux
(le Saint-Denis. Il crivit ce propos cette note : On me
litlire Hambourg- une esquisse sur le Gnie du Christia-
nisme, imprime Londres, qui annonce un ouvrasse plus
complet et plus tendu. Il
y
a du Fnelon et du Bossuet
dans cette esquisse et l'auteur, qui est jeune encore, nous
promet un homme religieux et un grand crivain.
On proposait Lauraguais un exemplaire de VEncy'
clopdie : A quoi bon, dit-il, Rivarol vient chez moi (i).
Peltier, dans son Dernier Tableau de Paris, a not,
en passant, quelques traits ducaractrede Rivarol : M. de
II... est prcisment ennemi de toute dclamation.
^ M. de R... ne s'est ml d'aucune lection; il n'a jamais
port la cocarde nationale.
Invit dner avec lui, on oubliait de se mettre
table pour l'entendre. Il nV avait pas auprs de lui de ven-
tre atlamqui tnt, les sens devenaienttout oreilles, le cur
tait dans l'extase et l'esprit dans l'enchantement
(2).
Unique en propos, Rivarol avait un trait, une pi-
^ ranime pour chaque vnement littraire ou politique
;
il
attachait un mot la tragdie ou la comdie nouvelle, au
(i) Alg:re.
(2)
Cubires.
SyO
RIVAROL
sermon la mode, racadmicien du jour, et ce mot restait,
c'tait un stigmate inefFaable (i).
Tout l'esprit de
Me
de Stal tait dans ses yeux,
qui taient superbes. Au contraire, le regard de Rivarol
tait terne
;
mais tout son esprit se retrouvait dans son sou-
rire, le plus fin et le plus spirituel que j'aie vu, et dans les
deux coins de sa bouche qui avaient une expression unique
de malice et de grce
(2).
III. CONVERSATION DE RIVAROL
Note par Chnedoll.
On retrouve, dans les papiers de Chnedoll, la plupart
des bons mots de Rivarol et de ses penses, mais dans leur
vrai lieu, dans leur courant et leur source
(3).
On en jugera
par le rcit suivant de sa premire visite Rivarol, que
nous donnons ici sans rien retrancher la navet d'adm.i-
ration qui
y
respire
.
Rivarol venait d'arriver de Londres Hambourg, o
je me trouvais alors. J'avais tant entendu vanter son esprit
et le charme irrsistible de sa conversation par quelques
personnes avec lesquelles je vivais, que je brlais du dsir
de faire sa connaissance. Je Pavais aperu deux ou trois fois
dans les salons d'un restaurateur franais nomm Grard,
alors fort en vogue Hambourg, chez lequel je m'tais
trouv table assez prs de lui, et ce que j'avais pu saisir
au vol decetteconversation prodigieuse, de cet esprit rapide
et brillant, qui rayonnait en tous sens et s'chappait en
continuels clairs, m'avait jet dans une sorle d'enivrement
fivreux dont je ne pouvais revenir. Je ne voyais que Rivarol,
je ne pensais, je ne rvais qu' Rivarol : c'tait une vraie
frnsie qui m'tait jusqu'au sommeil.
Six semaines se passrent ainsi. Aprs avoir fait bien
(i) Chnedoll.
(2)
Idem.
(3)
Et c'est pourquoi ce morceau doit tre conside'r comme du Ri-
varol, bien plutt que du Chnedyll. Voir une autr coiversation
l'Appendice u.
RIVAROLIAN
37!
des tentatives inutiles pour pntrer jusqu' mon idole, un
de mes meilleurs amis arriva fort propos d'Osnabruck
Hambourec pourme tirer de
cettatviolent qui, s'il et dur,
m'et rendu fou. C'tait le marquis de la Tresne, homme
d'esprit et de talent, traducteur habile de Vire;-ile et de
Klopstock; il tait liavecRivarol : il voulut bien se charo-er
de me prsenter au grand homme et me servir d'introduc-
teur auprs de ce roi de la conversation. Nous prenons jour,
et nous nous mettons en route pour aller trouver Rivarol,
qui alors habitait Ham, villac^e une demi-lieue de Ham-
bourg-, dans une maison de campagne fort aijrablc. C'tait
le 5 septembre
1795,
jour que je n'oublierai jamais. 11 fai-
sait un temps superbe, calme et chaud, et tout disposait
l'me aux ides les plus exaltes, aux motions les plus vives
et les plus passionnes. Je ne puis dire quelles sensations
j'prouvai quand je metrouvai la porte de la maison : j'tais
mu, tremblant, palpitant, comme si j'allais me trouver en
prsence d'une matresse adore et redoute. Mille senti-
ments confus m'oppressaientla fois : le dsir violent d'enten-
dre Rivarol, de m'enivrer de sa parole, la crainte de metrou-
veren butte quelques-unes de ces pigrammes qu'il lanait
si bien et si volontiers, la peur de ne pas rpondre la bonne
opinion que quelques personnes avaient cherch lui donner
de moi, tout m'agitait, me bouleversait, me jetait dans un
trouble inexprimable. J'prouvais au plus haut degr cette
fascination de la crainte, quand enfin la porte s'ouvrit. On
nous introduisit auprs de
Rivarol, qui, en ce moment,
tait table avec quelquesamis. Il nousreut avec uneaffa-
bilit caressante, mle toutefois d'une assez forte teinte
de cette fatuit de bon ton qui distinguait alors les hommes
du g-rand monde. (Rivarol, comme on sait, avait la prten-
tion d'tre unhomme de qualit. )Toutefois ilmemit bientt
mon aise en me disant un mot aimable sur mon ode
Klopstock, que j'avais fait paratre depuis peu. et J'ai lu
votre ode, me dit-il; elle est bien: il
j
a de la verve, du
mouvement, de l'lan. 11
y
a bien encore quelques jave-
nilia, quelques images vag-ues, quelques expressions ter-
ncs, communes ou peu potiques, mais d'un trait de
(( plume il est ais de fa ire disparatre ces taches-l. J'espre
que nous ferons quelque chose de vous : venez me voir,
nous mettrons votre esprit en serre chaude^ et tout ira
872
RIVAROL
*: bien. Pour commencer, nous allons faire aujourd'hui une
(( dbauche de posie.
(( Il commena en effet, et se lana dans un de ces mo-
nologues o il tait vraiment prodi^^ieux. Le fond de son
thme tait celui-ci : Lepote n'est qu'un sauvag^e trs ing--
nieux et trs anim chez lequel toutes les ides se prsentent
en images. Le sauvage et le pote font le cercle
;
l'un et
l'autre ne parlent que par hiroglyphes, avec cette diffrence
que le pote tourne dans une orbite d'ides beaucoup plus
tendue. Et le voil qui se met dvelopper ce texte avec
une abondance d'ides, une richesse de vues si fines ou si
profondes, un luxe de mtaphores si brillantes et si pittores-
ques, que c'tait merveille de l'entendre.
(( Il passa ensuite une autre thse, qu'il posa ainsi :
L'art doit se donner un but qui recule sans cesse et mette
(( l'infini entre lui et son modle. Cette nouvelle ide fut
dveloppe avec des prestiges d'locution encore plus ton-
nants : c'taient vraiment des paroles de ferie.
Nous
hasardmes timidement, M. de la Tresne et moi, quelques
objections, qui furent rfutes avec le rapide ddain de la
supriorit. (Rivarol, dans la discussion, tait cassant, em-
port, unpeudurmme).
Point d'objections d'enfant,
nous rptait-il, et il continuait dvelopper son thme avec
une profusion d'images toujours plus blouissantes. Il passait
tour tour de l'abstraction la mtaphore, et revenait de
la mtaphore l'abstraction avec une aisance et une dext-
rit inoues. Je n'avais pas d'ide d'une improvisation aussi
agile, aussi svelte, aussi entranante. J'tais toutoreille pour
couter ces paroles magiques qui tombaient en reflets ptil-
lants comme des pierreries, et qui d'ailleurs taient pro-
nonces avec le son de voix le plus mlodieux et le plus
pntrant, l'organe le plus vari, le plus souple et le plus
enchanteur. J'tais vraiment sous le charme, comme disait
Diderot.
Au sortir de table, nous filmes nous asseoir dans le
jardin, l'ombre d'un petit bosquet form de pins, de til-
leuls et de sycomores panachs, dont les jeunes et hauts
ombrages flottaient au-dessus de nous. Rivarol compara
d'abord, en plaisantant, le lieu o nous tions aux jardins
d'Acadme^ o Platon se rendait avec ses disciples pour
converser sur la philosophie. Et, vrai dire, il
y
avait bien
RIVAROLIANA
S'jZ
quelques points de ressemblance entre les deux scnes, qui
jiouvaient favoriser l'illusion. Los arbres qui nous couvraient,
aussi beaux que les platanes d'Athnes, se faisaient remar-
quer par la vigcueur et le luxe extraordinaire de leur vg--
l<ilion. Le soleil, qui s'inclinait dj l'occident, pntrait
jusqu' nous, malg"r l'opulente paisseur des onibrag-es, et
^^ jii disque d'or et de feu, descendant comme un incendie
(l.'rrire un vaste g"roupe denuaci-es, leur prtait des teintes
^i chaudes et si animes, qu'on et pu secroire sous un ciel
(le la Grce... Rivarol, aprs avoir admir quelques instants
If radieux spectacle et nous avoir jet l'imaii nation deux
ou trois de ces belles expressions j)oliques qu'il semblait
( rer en se jouant, se remit causer littrature.
Ki II passa en revue presque tous les principaux personna-
s littraires du dix-huitime sicle, et les jug-ea d'une ma-
;
-re pre, tranchante et svre. Il parlad'abord de Voltaire,
1 intre lequel il poussait fort loin la jalousie; il lui en vou-
lait d'avoir su s'attribuer le monopole universel de l'esprit.
C'tait pour lui une sorte d'ennemi personnel. Il ne lui par-
donnait pas d'tre venu le premier et d'avoir pris sa place.
(c II lui refusait le talent de la grande, de la haute posie,
mme de la posie dramatique. Il ne le trouvait suprieur
tjue dans la posie fug-itive, et l seulement Voltaire avait
}iu dompter l'admiration de Rivarol et la rendre obissante.
a Sa Henriade, disait-il, n'est qu'un maigre croquis, un
a squelette pique o manquent les muscles, les chairs et les
couleurs. Ses trag-dies ne sont que des thses philosophi-
ques, froides et brillantes. Dans le style de Voltaire, il
y
a
M
toujours une partie morte: tout vit dans celui de Racine
et de Virg"ile. UEssai sur les murs et l'esprit des
nations, mesquine parodie de l'immortel discours de
Bossuet, n'eit qu'une esquisse assez clg-ante, mais terne
et sche et mensongre. C'est moins une histoire qu'un
(( pamphlet en g-rand, un artificieux plaidoyer contre le
{( christianisme et une long-ue moquerie de l'espce humaine.
Quant son Dictionnaire p/iilosop/tique, si fastueuse-
ment intitul la /?/7/5on par alphabet, c est un livre d'une
(( trs mince porte en philosophie. Il faut tre bien mdio-
cre soi-mme pour s'imag-iner qu'il n'y a rien au del de
la pense de Voltaire. Rien de plus incomplet que cette
pense; elle est vaine, superficielle, moqueuse^ dissolvante,
374 RIVAROL
(( essentiellement propre dtruire, et voil tout. Du reste,
(( il n'y a ni profondeur, ni lvation, ni unit, ni avenir,
rien de ce qui fonde et systmatise. Ainsi disant, il fai-
sait la revue des principaux ouvrag-es de Voltaire, et les
marquait en passant d'un de ces stig-mates qui laissent une
empreinte ineffaable, semblable la g-outte d'eau-forte qui
creuse la planche de cuivre en
y
tombant. Il finit par se
rsumer dans cette phrase, que j'ai dj cite ailleurs :
(( Voltaire a employ la mine de plomb pour l'pope, le
crayon pour l'histoire, et le pinceau pour la posie fugi-
a tive.
Enhardi par l'accueil aimable que Rivarol me faisait,
je
me hasardai lui demander ce qu'il pensait de Buffon,
alors pour moi l'crivain par excellence.
Son style a de
la pompe et de l'ampleur, me rpondit-il, mais il est diffus
et pteux. On
y
voit toujours flotter les plis de la robe
d'Apollon, mais souvent le dieu n'y est pas. Ses descrip-
tionsles plus vantes manquent souvent de nouveaut, de
cration dans l'expression. Le portrait du Cheval n du
(( mouvement, de l'clat, de la rapidit, du fracas. Celui
(( du Chien vaut peut-tre mieux encore, mais il est trop
long"; ce n'est pas l la splendide conomie de style des
grands matres. Quant VAigle, il est manqu; il n'est
(( dessin ni avec une vigueur assez mle, ni avec une assez
sauvage fiert. Le Paon aussi est manqu : qu'il soit de
Buffon ou de Gueneau, peu importe; c'est une descrip-
tion refaire. Elle est trop longue, et pourtant ne dit pas
tout. Cela chatoie plus encore que cela ne rayonne. Cette
peinture manque surtout de cette verve intrieure qui
anime tout et de cette brivet pittoresque qui double
c( 1 clat des images, en les resserrant. Pour peindre cetopu-
lent oiseau, il fallait tremper ses pinceaux dans le soleil
et jeter sur ses lignes les couleurs aussi rapidement que le
g"rand astre jette ses rayons sur le ciel et les montagnes.
(( J'ai dans la tte un paon bien autrement neuf, bien au-
(( trement magnifique,
et je ne demanderais pas une heure
pour mieux faire.
(( Le portrait du Cygne est fort prfrable : l il
y
a vrai-
ce ment du talent, d'habiles artifices d'locution, de la lim-
(( pidit et de la mollesse dans le style, et une mlancolie
d'expression qui, se mlant la splendeur des inag"es,ei|
ftlVAROLIANA
875
tempre heureusement l'clat. Un morceau encore sans
reproche, c'est le dbut des Epoques de la Nature. Il
y
rcerne de la pompe sans emphase, de la richesse sans diF-
fusion et une mai^nilicence d'expression, haute et calme,
qui ressemble la tranquille lvation des cieux. Buffon
ne s'est jamais montr plus artiste en fait de style. C'est
la manire de Bossuet applique l'histoire naturelle.
Mais un crivain bien suprieur Butfon, poursuivait
Rivarol sans s'interrompre, c'est Montesquieu. J'avoue que
je ne fais plus cas que de celui-l (et de Pascal toutefois!)
depuis que j'cris sur la politique; et sur quoi pourrait-on
crire aujourd'hui ! Quand une rvolution inoue branle
les colonnes du monde, comment s'occuper d'autre chose?
La politique est tout; elle envahit tout, remplit tout, attire
tout : il n'y a plus de penses, d'intrt et de passions que
l. Si un crivain a quelque conscience de son talent, s'il
(( aspire redresser ou dominer son sicle, en un mot s'il
veut saisir le sceptre de la pense, il ne peut et ne doit
(( crire que sur la politique. Quel plus beau rle que celui
de dvoiler les systmes de l'org-anisation sociale, encore
si peu connue ! Quelle plus noble et plus clatante
(( mission que celle d'arrter, d'enchaner, par la puissance
(( et l'autorit du talent, ces ides envahissantes qui sont
(( sorties comme une doctrine arme des livres des philoso-
{( phes, et qui, atteles au char du soleil, comme l'a si bien
(( dit ce fou de Danton, menacent de faire le tour du
(( monde! Pour en revenir Montesquieu, sans doute, en
politique, il n'a ni tout vu, ni tout saisi, ni tout dit, et
(( cela tait impossible de son temps. Il n'avait point pass
au travers d'une immense rvolution qui a ouvert les
(( entrailles de la socit et qui a tout clair, parce qu'elle
a tout mis nu. Il n'avait pas pour lui les rsultats de
cette vaste et terrible exprience qui a tout vrifi et tout
(( rsum; mais ce qu'il a vu, il l'a suprieurement vu, et vu
sous un an2;-le immense. Il a admirablement saisi les
(( g-randes phases de l'volution sociale. Son reg-ard d'aig-le
pntre fond les objets et les traverse en
y
jetant la
lumire. Son gnie, qui touche tout en mme temps,
(( ressemble l'clair qui se montre la fois aux quatre
points de l'horizon. Voil mon homme ! c'est vraiment le
(c
seul que je puisse lire aujourd'hui. Toute autre lecture
376 RIVAROL
lano-uit auprs de celle d'un si ferme et si lumineux g-nie,
et je n'ouvre jamais VEsprit des lois que je n'y puise ou
(( de nouvelles ides, ou de hautes leons de style.
Ghnedoll, qui Ton doit cette vive reproduction du dis-
cours de Rivarol (discours qui n'est pas encore sa fin),
s'arrte ici un moment pour noter les sentiments divers qui
se pressaient en lui devant ces flots et celte cascade toujours
rejaillissante du torrent sonore. A propos de la tirade sur
Bufion : Jetais, dit-il, confondu, je l'avoue, del svrit
de ces ju^-ements et de ce ton d'assurance et d'infaillibilit
avec lequel ils taient dbits; mais il me paraissait impos-
sible qu'un homme qui parlait si bien se trompt. Et,
faisant comme les jeunes g-ens qui, dans leur curiosit, n'ont
pas de cesse qu'ils n'aient questionn tour tour sur tous
les objets un peu ingaux de leur prdilection secrte, il
profita d'un moment o Rivarol reprenait haleine : (( Et
Thomas! )) demanda t-il.
(( Thomas est un homme manqu, repartit d'un ton bref
Rivarol; c'est un homme qui n'a que des demi-ides. Il a
une assez belle phrase, mais il n'en a qu'une. Il n'avait pas
(( ce qu'il fallait pour faire l'loge de Descartes : c'est
un ouvrag-e compos avec la science acquise de la veille.
Cela n'est ni digr, ni fondu. Il aurait fallu l'auteur les
connaissances positives de Fontenello, l'tendue de la pn-
tration de son coup d'il scientifique. L'loge de Marc-
Aurle vaut mieux : il
y
a dans cet loge des intentions
dramatiques qui ne sont pas sans effet. Le style en est
meilleur aussi, bien que l pourtant, comme ailleurs, ce
(( style manque d'orig-inalit. Ce n'est pas l un style cr.
Et puis il est trop coup, trop hach, ou, par endroits,
(( dmesurment long. Thomas ne s'entend pas parcourir
avec grce et fermet les nombreux dtours de la priode
(( oratoire. Il ne sait pas enchevtrer sa phrase. Quanta
<( son Essai sur les
Etoffes,
il
y
a de belles pages^sans
doute; mais quoique les dfauts
y
soient moindres et qu'il
(( ait dtendu son style, il
y
rgne encore un ton d'exag-
(( ration qui gte les meilleurs morceaux. Thomas exagre
ses sentiments par ses ides, ses ides par ses images, ses
images par ses expressions. .
((
Et Rousseau? monsieur de Rivarol.
((
Oh ! pour celui-l, c'est une autre affaire. C'est un
RIVAIVOLIANA
877
a matre sophiste qui ne pense pas un mot de ce qu'il dit
ou de ce qu'il crit, c'est le paradoxe incarn,
grand
(( artiste d'ailleurs en fait de stvle, bien que, mme dans
(( ses meilleurs ouvrag^es, il n'ait pu se dfaire entirement
( de cette rouille g-enevoise dont son talent reste entach. Il
parle du haut de ses livres comme du haut d'une tribune;
(( il a des cris et des g-estes dans son style, et son loquence
K pileptique a d tre irrsistible sur les femmes et les
(( jeunes g-ens. Orateur ambidextre, icvli^an^ conscience,
uu plutt il laisse errer sa conscience au Q;r de toutes ses
(( sensations et de toutes ses alfections. Aussi passlonne-t-il
tout ce qu'il touche. 11
y
a des pag'es, dans la Nouvelle
u Hloi'se, qui ont t touches d'un rayon du soleil. Toutes
.1 les fois qu'il n'crit pas sous l'influence despotique d'un
(( paradoxe, et qu'il raconte ses sensations ou peint ses pro-
(( prs passions, il est aussi loquent que vrai. Voil ce qui
, donne tant de charme quelques tableaux de ses Confes-
(( sions, et surtout ce prambule qui sert d'introduction
H ia Profession du Vicaire savoyard, et o, sous le voile
d'un jeune homme qu'il met en scne avec le Vicaire, il
i(
raconte sa propre histoire. C'est, avec quelques Lettres
Provinciales et les chapitres sur VHomme de Pascal, ce
(( que nous avons de mieux crit en notre lang-ue. C'est fait
(( point.
Le reste de la conversation se passa en un feu roulant
d'pig-rammes lances avec une verve intarissable sur d'au-
,tres renommes politiques et littraires. Jamais Rivarol ne
justifia mieux son surnom de Saint-Georges de l'pi-
ifframme.
Pas un n'chappait l'habilet dsesprante de sa
jpointe. L passrent tour tour, transpercs coup sur coup,
et l'abb Delille, qui n'est qu'un rossig-nol qui a reu son
(( cerveau en g-osier ; et Cerutti, qui a fait des phrases
(( luisantes sur nos grands hommes de l'anne dernire,
espce de limaon de la littrature qui laisse partout o il
passe une trace arg-ente, mais ce n'est qu'cume et bave
;
(( et Chamfort, qui, en entrant l'Acadmie, ne fut qu'une
. branche de muguet ente sur des pavots
;
et Roucher,
qui est en posie le plus beau naufracre du sicle
;
et
((. Chabanon, qui a traduit Thocrite et Pindare de toute sa
(( haine contre les Grecs
;
et Fontanes, a qui passe son
a style au brunissoir et qui a le poli sans l'clat
;
et Le-
378 niVAROL
brun, qui n'a que de la hardiesse combine etiamahQ
(( la hardiesse inspire; ne le voyez-vous pas d'ici, assis sur
sou sant dans son lit, avec des draps sales, une chemise
ce sale de quinze jours et des bouts de manche en batiste un
a peu plus blancs, entour de Virg-ile, d'Horace, de Gor-
neille, de Racine, de Rousseau, qui pche la lig'ne un
ce mot dans Tun et un mot dans l'autre, pour en composer
ce ses vers, qui ne sont que mosaque ? Et Mercier avec sou
Tableau de Paris, ouvrage pens dansia rue et crit sur
la borne
; et l'abb Millot, qui n'a fait que des com-
(( missions dans l'histoire
;
et Palissot, qui a toujours
un chat devant les yeux pour modle; c'est pour lui le
(( torse antique
;
et Condorcet, u qui crit avec de l'opium
sur des feuilles de plomb >;
;
et Target qui s'est no3'
dans son talent . Chaque mot tait une pigramme con-
dense qui portait coup et perait son homme. Mirabeau
obtint les honneurs d'une pigramme plus dtaille :
La tte de Mirabeau, disait-il, n'tait qu'une grosse
ponge toujours gonfle des ides d'autrui. Il n'a eu quel-
(( que rputation que parce qu'il a toujours crit sur des
matires palpitantes de l'intrt du moment. Ses brochu^
(( res sont des brlots lchs au milieu d'une flotte : ils
y
a mettent le feu, mais ils s'y consument. Du reste, c'est un
barbare efl'royable en fait de style; c'est l'Atlila de l'lo-
quence et s'il
y
a dans ses gros livres quelques phrases
bien faites, elles sont de Chamfort, de Cerutti ou de moi.
(( Trois heures, continue Chnedoll, s'coulrent dans
ces curieux et piquants entre-tiens, et me parurent peine
quelques instants. Le soleil cependant avait disparu de
l'horizon, et la nuit qui tombait nous averlit qu'il tait
temps de nous retirer.
(( Nous prmes donc cong de Rivarol, qui, en nous quit^
tant, nous dit quelques-uns de ces mots aimables qu'il
savait si bien trouver, et nous fit promettre de revenir. Puis
il me remit sa traduction du Dante, en me disant : Lisez
ce cela ! il
y
a l des tudes de style qui formeront le vtre et
(( qui vous mettront des formes potiques dansia tte. C'est
une mine d'expressions o les jeunes potes peuvent pui-
(( ser avec avantage.
Nous reprmes la route de Hambourg, M. de la Tresne
et moi, confondus, terrasss, blouis par les miracles d
niVAROLIANV
879
celte parole presque fabuleuse. Le jour avait tout fait dis-
paru
;
il faisait une de ces belles nuits si communes en
cette saison dans les climats du Nord, et qui ont un clat
cl une puret qu'on ne voit point ailleurs. Une lune d'au-
tomne Drillait dans un ciel bleu ma^-nifique et sa lumire,
jbrise en rseaux de diamant, lincelait dans les hautes
cimes des vieux ormes qui bordent la route, en projetant
divant nous de long-ues ombres. L'oreille et a ttc encore
])l(incs de la conversation de Rivarol, nous marchions silen-
cieusement sous cette magique clart, et le profond silence
n'tait interrompu que par ces exclamations rptes vingt
fois : Il faut convenir que Rivarol est un causeur bien
extraordinaire ! De tout ce soir-l, il nous fut impossible
de trouver d'autres paroles.
Si j'avais moins longuement cit, on n'aurait pas une
ide aussi complte, ce me semble, de ce que fut rellement
jUivarol, le grand improvisateur, le dieu de la conversa-
\tion cette fin d'un sicle o la conversation tait la
suprme
gloire. On n'avait qu' le toucher sur un point,
'qu' lui donner la note, et le merveilleux
clavier rpondait
l'instant par toute une sonate.
(Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe littraire,
tome II.)
APPENDICE
DOCUMENTS BIBLIOGRAPHIE
Notice biographique
Rivarol (Antoine, comte de), n Banols en Lansfuedoc (i),
vers 475i
(2),
fut l'un des plus brillants esprits de la fin du
xvni9 sicle, qui fut le sicle de l'esprit
; homme la mode, di2:ne
do la s^loire, que les salons reg-ardrent comme un prodig-e, que
la politique europenne aurait pu compter comme un oracle, et
que la postrit doit adopter aujourd'hui comme un de ces c^nies
I heureux et incomplets tout ensemble, qui n'ont fait que montrer
! leurs forces. Rivarol vint fort jeune Paris. II parat qu'il n'a-
vait pas eu d'autre ducation que celle de la maison paternelle,
mais que cette ducation suffit dfrayer son dbut dans la capi-
tale, et mme son entre dans la socit des beaux esprits et des
savants. Accueilli d'abord par d'Alembert comme parent de M. de
Darcieux, de l'Acadmie des sciences, il obtint bientt par lui-
mme d'autres recommandations que cette parent, qu'on l'accusa
quelquefois d'avoir usurpe. L'homme suprieur est tellement
dans le monde l'ennemi commun que ce n'est pas trop de toute
une vie de caresses et de mnag-ements envers les autres pour se
faire pardonner; et les sots ne cdent mme pas toujours cette
prcaution. Qu'on ju2;e de ce qui dut advenir Rivarol qui la
no^li^ea; qui montra son esprit, et tout de suite, et avec une sorte
d'audace; qui ds ses premiers succs fut, pour les jaloux, une
vritable perscution. Le monde le lui rendit, et de l ces incul-
pations, ces contes, ces sarcasmes, toute cette raction d'une
malignit jalouse, qu'il lui fallut subir pour la noblesse de sa
naissance dont on contestait et dont on refusait de reconnatre
(i) Aujourd'hui dans le Gard.
(3)
La vraie date est : le 26 juin 1753.
382 RIVAROL S
les titres italiens dans leur voyage en LanCT-uedoc
(1).
Son alliance
avec M. de Parcieux, l'emploi de ses premires annes Paris,
le
secret de ses premires ressources pcuniaires, tout cela forme un
voile de mdisances, de doutes et d'incertitudes que nous n'avons
pas besoin d'carter avec art. Rivarol vaut bien la peine qu on
ne s'occupe pas laborieusement de purger sa naissance, le com-
mencement de sa carrire et mme le reste de sa vie, de tous les
reproches malins qu'il n'a lui-mme rfuts que par des bons
mots. Avant d'avoir crit une ligne, Piivarol tait dj clbre
dans les cercles de Paris, o Ton tait bien vite un grand homme
avec des pigrammes, avec des contes, avec le talent de la con-
versation et le gnie de l'anecdote. La socit ne voulait alors
qu'tre amuse; et elle tait, cet gard, d'une exigence et d'une
facilit tout ensemble que nous avons peine comprendre. Il
y
avait un certain art de causer, surtout de raconter, qui se recher-
chait beaucoup, s'obtenait fort peu, et suffisait la fortune litt-
raire de celui qui ne pouvait pas se vanter d'un seul mot de lui
imprim. Les contemporains de Ptivarol l'ont admir d'al^ord
ce titre
;
et l'on assure qu'il tait vraiment extraordinaire pour sa
lgret brillante, sa vivacit railleuse, la soudainet intarissable
de ses ides, le bonheur et l'clat de ses expressions. C'tait de la
faconde grecque, de l'improvisation italienne, et quelque chose
de la grce franaise, trs bien servie par les avantages d'une
fort belle figure. Cette gloire commode, qui se recueillait tous les
soirs et qui n'avait besoin pour se renouveler que des mdita-
tions faciles d'une paresse lgrement occupe, ravit Ptivarol
ses plus belles annes. Sa vie et son talent se dpensrent en sail-
lies
; et malgr l'empreinte vigoureuse que son esprit profond et
mri laissa sur quelques pages clatantes, on ne peut gure le
considrer que comme un de ces paresseux pleins de gnie, qui,
ne faisant pas assez pour tre eux-mmes, restent au-dessous de
leur propre renomme. Quoi qu'il en soit de l'abandon volontaire
de son talent, de la ngligence de ses forces, on peut encore le
deviner quelques morceaux pars, ou prendre dans ses u\Tes,
composes de riens spirituels ou de grandes bauches, une admi-
ration qui s'agrandit par les regrets. Essayons de suivre cet
esprit brillant et lger, cette imagination vive et forte, travers
les feuilles o elle n'a fait qu'arrter un premier vol. Le Discours
sur l'universalit de la langue franaise, qui partagea le prix
propos par l'Acadmie de Berlin en 4784, valut Rivarol de
nombreux loges, l'estime de Buflon, et les remerciements du grand
Frdric. La chancellerie de Berlin mit ce discours ct des
(i) Pour tre garde du corps, pour tre officier, il fallait faire preuve
de noblesse sur titres originaux . Or le frre de Rivarol, Claude-Fran-
ois, fut nomm, en
1780, lieutenant aux chasseurs de Maillebois et, en
1786. garde du corps; il tait capitaine d'tat-major en 1788,
APPENDICE
383
ivrages de Voltaire, dans une lettre officielle sig-ne du roi.
;)utes les acadmies auraient t heureuses de le couronner;
^''<
il est peut-tre plus piquant et plus juste que ce soit un corps
j^er qui ail fait rendre un si clatant hommage la lans^ue
. nre patrie. Ce premier ouvrasre, compos trente ans, porte
K tous les traits du talent do Kivarol, (juoiqu'il n'en porte pas
ute la mesure; c'est bien l le ton et l'esprit d'un Franais par
^cel/ence
;
et les dfauts de la jeunesse, qui s'y font un peu sen-
'.
ajoutent peut-tre la ^rce et la vrit du caractre. On
irait pu se livrer une comparaison plus rudite, plus cons-
iicleuse des idiomes et des littratures, on aurait pu tre moins
. moins court; mais on ne pouvait pas tre plus fin, plus
lieux, plus fcond en apercjus, plus riche de ces sortes d'i-
s qui dveloppent la pense en la colorant. La traduction de
'cr du Dante parut la mme anne que le Discours sur les
>'\ de Vuniversalit de la langue
franaise. Bufton dit
! auteur que traduire ainsi, c'tait crer; mais le public, qui
lit plus l'esprit de Rivarol qu' son instruction, ne lui
(la pas le mrite d'une fidlit littrale. Il ne l'avait point
lie; il a plutt sacriti l'eilet des grands morceaux
;
et l'on
nt disconvenir que quelques-uns ne reproduisent, en partie,
.M r;j^ie bizarre et l 'ori^- inalit pittoresque du peintre d'L'ii-olin.
^^s Lettres sur la religion et la morale, publies l'occasion de
)uvrae de Necker sur l'importance des opinions religieuses, ne
nt Gnre que des conversations vagues, sans doctrines, sur un
re assez vague lui-mme. On
y
devine peine cette sagacit
nclrante de Rivarol, qui depuis illumina la mtaphysique du
naa^^e et la politique des Etats de tant de clarts brillantes.
Lielijues plaisanteries assez faciles commencent, sur Necker, une
icrre que Rivarol devait, plus d'un titre, continuer contre sa
mille. Mais de toutes ces productions, caprices d'un esprit indo-
nt et moqueur, de toutes ces improvisations de critique et de
tire, chappes la dsig-nation et aux succs du monde, le
l'tit alnianach de nos grands hommes fut encore le plus impor-
nt dans sa frivolit. C'tait pour ce temps plus qu'un coup d'E-
t. temps de repos, avide de vers, rassasie et toujours curieux de
-auces littraires, o l'entreprise de Rivarol devenait un vri-
bienfait puljlic par l'espce de rajeunissement qu'elle don-
II. au plaisir de l'pis^ramme. L'ouvra:e, publi d'abord sans
m\ d'auteur, fut avou par Rivarol quand il vit qu'on l'attri-
lail d'autres, surtout Champcenetz. Qu'on juE^e du succs
ir le scandale, et du mrite par le succs. On ne s'tait jamais
oqu de tant de s^ens la fois, et l'on ne s'en tait jamais moqu
ec une malice plus impartiale, en mme temps que plus amre;
ir pas un seul auteur n'tait oubli ; et il en est bien peu qui
ent, plus tard, purg la sentence par eux prononce
;
le volume
grossissait chaque dition, et quelque nouvel avertissement
retrempait encore les traits de la satire. On a fait une liste
de
tous ceux qui se prtendaient injustement raills par Rivarol,
ainsi que des ou\Tao-es qui les venijent. Nous ne devons pas
nous
amuser la parcourir; il nous suttira d'en citer un, Delille,
avec
lequel le malheur et la justice le rconcilirent Hambourg,
quoiqu'il ft coupable envers lui, non- seulement d'une plaisante-
rie en prose, mais encore d'une plaisanterie en vers {le Choa et le
navet). La rvolution vint bientt couper court ces jeux d'une
socit paisible et lever Rivarol l'loquence par le courage.
Personne n'aperut aussi vite que lui les consquences d'un pre-
mier branlement. C'est dans son Journal politique national,
concert avec un dvou serviteur du trne, M. de la Porte,
qu'clata son incroyable prvision des vnements, qui devana
le gnie de Burke lui-mme, et lui inspira peut-tre cet anathme
conservateur rpt par toute l'Europe. Les feuilles de ce journal,
rapidement crites sous l'intrt palpitant du moment, se revoient
aujourd'hui avec curiosit et mme avec une sorte de surprise
nouvelle. On sent toujours que c'est un contemporain qui peint,
et souvent que c'est la postrit qui juge. Un seul loge fera sui-
fisamment apprcier la raison, la finesse, la vigueur des ides
politiques : c'est que l'auteur ne croyait faire qu'un journal et
qu'on croit lire une histoire. C'tait la mme poque qu'il con-
courait, avec M. Peltier et Champcenetz, la rdaction de l'in-
gnieux recueil intitul /es Acte^ des Aptres, qui eut un si
grand succs par l'esprit et la gaiet avec lesquels il dversait le
ridicule sur les partisans de la rvolution. Ces crits taient trop
couraffeux, trop ouvertement contraires aux tendances de ce
temps-l pour n'tre pas trouvs coupables; les perscutions arri-
vrent, et Rivarol, aprs avoir continu ses philippiques, pleines
d'une verve si indiscne, dans un village prs de Noyon sous le
nom de Salomon de Cambrai, fut enfin contraint de quitter la
France. Il se rfugia d'abord Bruxelles. C'est l qu'il crivit
ses Lettres au duc de Brunswick et la noblesse franaise mi-
gre, au moment o la coalition entrait en Champag-ne. Les pre-
mires dmonstrations de la Prusse se fondirent bientt
;
la
monarchie de LouisXVI, fu2:itive, fut rduite l'pe impuissante
de quelques preux; et par une double drision de la fortune, le
talent et l'loquence ne purent pas plus la soutenir que le courage
et la loyaut. Pvivarol, abandonn toutes les vicissitudes e
l'exil, passa quelque temps Londres, o il vit Pitt et Burke, ces
deux ennem.is de la rvolution franaise, qui l'accueillirent avec
distinction, mais qui ne l'empchrent pourtant pas d'aller cher-
cher un autre abri Hambourg en 1796. Il esprait s'y faire une
ressource de sa plume et surtout de la publication d'un nouveau
Dictionnaire de la langue franaise, conu sur un plan plus
APPENDICE 385
simple et plus vaste en mme temps que celui de racadmie.
MaJL^r les perscutions du libraire avec le({uel il avait trait,
Hivarol n'a fait imprimer que son discours d'introduction
;
mais
dj il avait achev une nouvelle thorie i^rammalicale, d'innom-
hrables observations sur les synonymes, sur la sio;-nification des
mots, leur classement mthodique, leur dfinition analytique et
consquente. Le discours sur les facults morales et intellectuelles
de l'homme est une masrniHque prface dans laquelle l'auteur a
voulu rappeler la parole la pense, l'homme Dieu. Le style de
Hivarol a de l'clat et de l'harmonie, un tour libre et vari, enfin
les formes de la belle prose franaise; mais ce qui le caractrise
essentiellement, c'est un jet rapide dans les ides, de frquentes
surprises, et une peinture continuelle de la pense par l'iniac^e.
Il
y
a tout la fois chez lui quelque chose de la pompe de Buf-
fon, de l'nerofie de Tacite, ou plutt de l'ori^-inalit du cardinal
de Retz..Mais ces qualits ne sont pas compltes
;
son lvation ne
va pas jusqu' la gravit, sa vhmence jusqu'au sentiment, son
esprit jusqu'au naturel. De l un peu de fati^ue et d'blouisse-
nient; c'est cependant toujours un crivain asrrable, et c'est sou-
vent un ^rand peintre. Kivarol est mort Berlin le 11 avril 1801.
(Armand Malitourne
(1),
dans la Biograghie Michaud.)
2
Notice littraire
Une figure aimable, une tournure lgante, un port de tte
sure, soutenu d'une facilit rare d'locution, d'une originalit
une et d'une urbanit piquante, lui valurent la faveur des salons
et cette premire attention du monde que le talent attend qucl-
(]uclbis de longues annes sans l'obtenir. Rivarol semblait ne
i.iener qu'une vie frivole, et il tait au fond srieux et appliqu.
Il se livrait la socit le jour et il travaillait la nuit. Sa
lacilit
(le parole et d'improvisation ne l'empchait pas de creuser solitai-
rement sa pense. Il tudiait les langues, il rflchissait sur les
jirincipes et les instruments de nos connaissances, il visait la
gi(:)ire du style. Quand il se dsignait sa place parmi les crivains
du jour, il portait son regard aux premiers ran^s. Il avait de
l'ambition sous un air de paresse. Cette ambition littraire se
marqua dans les deux premiers essais de Rivarol, sa traduction
deVnfer de Dante (l"85),et son Discours sar Vuniversalit de
(i) ChoedoII n'a pas t tranger cette notice, et c'est pourquoi on
l'a choisie, malgr ses imperfections. Elle reprsente l'ide qu'on se fai-
sait de Rivarol, dans le groupe des royalistes libraux, vers 1828.
383
PIVAUOL
la langue
fi-antaise, couronn par rAcacicmie de Berlin
(1784).
Traduire Dante lait pour Rivarol un bon moyen, disait-il
assez avantageusement, de Taire sa cour aux Rivarol d'Italie
et une faon de payer sa dette la patrie de ses pres
;
c'tait
indirectement laire preuve de sa noblesse d'au del des monts
;
c'tait surtout aussi une manire de s'exercer sur un beau thme
et de lutter avec un matre. Rivarol, nommons-le tout d'abord
par son -vTai nom, est un styliste: il veut enrichir et renouveler
la lang-ue franaise, mme aprs Buton, mme aprs Jean-Jac-
ques. N'ayant pas d'abord en lui-mme un foyer d'inspiration et
un jet de source suffisants pour lui faire trouver une originalit
toute naturelle, il cherche cette orioinalit d'expression par la
voie littraire et un peu par le dehors. Il s'attaque Dante, dont
il apprcie d'ailleurs l'austre nie . Quand il est beau, dit-il,
rien ne lui est comparable. Son vers se Tient debout par la seule
force du substantif et du verbe, sans le secours d'une seule pi-
thte. C'est en se prenant ce style aJEam de posie, qui
est riche et point dlicat, plein de 'mles fierts et de rudesses
bizarres, qu'il espre faire preuve de ressources et forcer la lan-
gue franaise s'ingnier en tous sens. <(
Il n'est point, selon
lui, de pote qui tende plus de piges son traducteur
;
il
compte parmi ces piges les hardiesses et les comparaisons de
tout genre dont quelques-unes lui semblent intraduisibles dans
leur crudit.. Il se pique d'en triompher, de les luder, de les
faire sentir en ne les exprimant qu' sa faon. Un idiome tran-
ger, dit-il, proposant toujours des tours de force un habile tra-
ducteur, le tte, pour ainsi dire, en tous sens : bientt il sait
tout ce que peut ou ne peut pas sa langue
;
il puise ses ressour-
ces,mais il augmente ses forces. Ains'i ne demandez pas Riva-
rol le -vTai Dante
;
il sent le gnie de son auteur, mais il ne le
rendra pas, il ne le calquera pas religieusement. En et-il l'ide,
le sicle ne le supporterait pas un moment. Voltaire avait mis
Rivarol au dfi de russir; il lui avait dit en plaisantant qu'il ne
traduirait jamais Dante en style soiilenn, ou qu'il changerait
trois fois de peau avant de se tirer des pattes de ce diable-l.
Rivarol n'a garde de vouloir changer de peau, il est trop content
de la sienne. Il vise, en traduisant, ce style soutenu dclar im-
possible
;
et, dans cet effort, il ne songe qu' s'exercer, pren-
dre ses avantages, rapporter quelques dpouilles, quelques
trophes en ce qui est du gnie de l'expression. Telle est son
ide, qui nous parat aujourd'hui incomplte, mais qui n'tait pas
vu! ovaire.
L'Acadmie de Berlin avait propos, en 1783, pour sujet de
prix, la rponse ces questions :
Qu'est-ce qui a rendu la
langue
franaise universelle?
Pourquoi mrite-t- elle cette
prrogative?
Est-il prsumer quelle la conserve?
Le
APPENDICE
38^
discours de Rivarol qui obtint le prix a de l'clat, de l'lvation,
nombre d'aperrus justes et fins exprims en imas^-es boureuses.
C'est un esj)rit fait et dj mr qui dveloppe ses rflexions, et
>ar endroits c'est presque un s^rand crivain (jui les exprime.
1 insiste sur la qualit essentielle de la lansruc franaise, qui est
la clart, tellement quf, quand cette lans^ue traduit un auteur,
elle l'explique vritableinont... Ce remarquable discours, qui d-
passait de l)ien loin, par le style et par la pense, la pliqiart d<'S
ouvraccs acadmiques, valut Rivarol l'estime de Frdric le
Grand et obtint un vrai succs en France et en Europe,
On peut penser qu'il eut de l'influence sur la direction de R.iva-
rol. Esprit la fois philosophique cl littraire, il se voua ds lors
l'analyse des langues et de la sienne en particulier, a II est bon,
avait-il dit, de ne pas donner trop de vtements sa pense, il
faut, pour ainsi dire, voyasrer dans les langues, et, aprs avoir
savour le s^ot des plus clbres, se renfermer dans la sienne.
Rivarol ne s'y renferma (jue pour l'approfondir, et, ds ce temps.
il conut le projet d'un dictionnaire de la lano:ue franaise, qu'il
caressa toujours en secret, travers toutes les distractions du
monde et de la politique, auquel il revint avec plus de suite dans
l'exil, et dont le discours prliminaire est rest son titre le plus
recommandable aux yeux des lecteurs attentifs.
Cependant il vivait trop de la vie brillante, dissipe, mondaine^
de la vie de plaisirs, et, peine
^ de vingt-huit ans, il se disait
lass et vieilli. ..
Les salons distrayaient Rivarol et le dtournrent trop de la
gloire srieuse. Il
y
primait par son talent naturel d'improvisa-
tion, dont tous ceux qui l'ont entendu n'ont parl qu'avec admi-
ration et comme blouissement. C'tait un virtuose de la parole.
Une fois sa verve excite, le feu d'artifice, sur ses l\Tes, ne ces-
sait pas. Il ne lanait pas seulement l'piramme, il rpandait les
ides et les aperus
;
il faisait divcrg-er sur une multitude d'o])iets
la fois les faisceaux tincelants de son loquence. Lui-mme,
dans des pages excellentes, en dfinissant l'esprit et le got, il n'a
pu s'empcher de dfinir son propre got, son propre esprit
;
on
ne prend jamais, aprs tout, son idal bien loin de soi...
Il ne se dissimulait pas que ce talent brillant qu'il portait avec
lui, qu'il dployait avec complaisance dans les cercles, et dont
jouissait le monde, lui attirait aussi bien des envies et des ini-
mitis. Mais R^ivarol, en causant, obissait un instinct mridio-
nal irrsistible. Il n'y trouvait aucune peine, aucune fatigue de
pense, et sa paresse s'accommodait de ce erenre de succs, qui
n'tait pour lui qu'un exercice de sybarite dlicat et qu'une jouis-
sance.
Sa vanit s'en accommodait aussi, car, en causant, il se trou-
vait tout naturellement le premier
;
personne, lui prsent, ne
388
HIVAROL
songeait lui disputer cette prminence.Ses amis (car il en eut)
assurent qu'en s'emparant ainsi du sceptre il n'en tait nullement
oro^ueilleux au fond
: Ne se considrant que comme une com-
binaison heureuse de la nature, convaincu qu'il devait bien plus
son organisation qu' l'tude ou au travail, il ne s'estimait que
comme un mtal plus rare et plus fin. C'tait sa manire de
modestie. Semblable en cela aux artistes, il se sentait pourvu d'un
prodigieux
instrument, et il en jouait devant tous. Il vocalisait.
Pourtant ce qui se pardonne aisment chez un chanteur, un pia-
niste ou un violoniste, chez un talent spcial, se pardonne moins
dans l'ordre de l'esprit. Cette parole aux mains d'un seul semble
bientt une usurpation, et Rivarol, tranchant, abondant dans son
sens, imposant silence aux autres, n'a rien lait pour chapper au
reproche de iatuit qui se mle invitablement jusque dans l'loge
de ses qualits les plus belles. Il s'talait d'abord et partout, dans
toute la splendeur et l'insolence de son esprit. Le sens moral et
sympathique ne l'avertissait pas.
"
Sur tout le reste, son got tait fin, vif, pntrant, et, bien
qu'il ne rsistt point assez une teinte de recherche et d'apprt,
on peut classer R.ivarol au premier rang des juges littraires
minents de la fin du dernier sicle. Il avait des parties bien
autrement leves et rares que la Harpe, Marmontel et les autres
contemporains
;
il avait de la porte et de la distinction, jointes
la plus exquise dlicatesse. Dans ses jugements, il pensait sur-
tout aux dlicats, et l'on a pu dire qu'il avait,en littrature,
plus
de volupt que d'ambition. Son got pourtant tait trop sen-
sible et trop amoureux pour ne pas laisser clater hautement ce
qu'il prouvait.
<c On dit qu'un homme a l'esprit de critique lorsqu'il a reu du
ciel non-seulement la facult de distinguer les beauts et les d-
fauts des
productions qu'il juge, mais une me qui se passionne
pour les unes et s'irrite des autres, une me que le beau ravit, que
le sublime transporte, et qui, furieuse contre la mdiocrit, la
fltrit de ses ddains et l'accable de son ennui.
(1)
Cette dfinition si bien sentie, il a pass sa vie la pratiquer,
et presque toutes les inimitis qu'il a souleves viennent de l.
Quand Rivarol dbuta dans la littrature, les grands crivains
qui avaient illustr le sicle taient dj morts ou allaient dispa-
ratre : c'tait le tour des mdiocres et des petits. Comme au
soir d'une chaudejourne d't,une foule d'insectes bourdonnaient
dans l'air et harcelaient de leur bruit les honntes indiffrents.
(i) Toute cette partie de l'tude de Sainte-Beuve est l'analyse du cha-
pitre du Discours prliminaire que nous donnons sous le titre de Le
Gnie et le Talent. On
y
renvoie pour les citations,qu'on a d, ici,ccour-
ter ou supprimer.
APPENDICE
389
fout le sicle ayant tourn la littrature, on se louait, on se
critiquait outrance: mais le plus souvent on se louait. A Paris,
pn n'en tait pas dupe. En vain les trompettes de la renomme
pnt proclam telle prose ou tels vers, il
y
a toujours dans cette
tapilale, disait Rivarol, trente ou quarante ttes incorruptibles qui
pe taisent
; ce silence des j^-ens de s^ot sert de conscience aux
pauvais crivains et les tourmente le reste de leur vie. Mais,
m
province, on tait dupe. Il serait temps enfin, conseillait-il,
[jue plus d'un journal chans^et de maxime, il faudrait mettre
lans la louaniicc la sobrit que la nature observe dans la produc-
ion des s:rands talents, et cesser de tendre des pices linno-
'cncc des provinces. C'est cette pense de baute police qui fit que
livarol, un matin, s'avisa de publier son /*tit Almanach de
los grands hommes parw l'anne iy88,o\i tous les auteurs ph-
)hmres et imperceptibles sont rangs par ordre alphabtique,
ivec accompagnement d'un loe ironique. Il avait port la
ruerre dans un s^upier, et il eut fort lairc ensuite pour se
llrober des milliers de morsures.
Ce Petit Almanach des grands hommes, qui avait pour pi-
graphe : Dis ignotiii (aux dieux inconnus), est une de ces plai-
santeries qui n'ont de piquant que l'-propps. On peut remarquer
ju'il commence par le nom d'un homme qui a depuis acquis une
rertaine clbrit dans la mdecine, Alibert, et qui n'tait connu
lors que par une table insre dans un R.ecueil des muscs pro-
iucialcs. Andrieux, (juins^uen, qui n'avaient dbut jusqu'alors
pie dans la littrature lg-re,
y
sont mentionns, ainsi que
daric-Joseph Chnier, qui se vengea aussitt par une satire
Irulente.
Quand Rivarol eut quitt la France, en 1791
(1),
il disait avec
)lus de raiet que d'in\Taisemblance : Si la Rvolution s'tait
lilc sous Louis XIV,Cotin et iait s^uilIotinerBoileau, et Pradon
l'et pas manqu Racine. En migrant, j'ai chapp quelques
acobins de mon Almanach des grands hommes
(2),
Rivarol, ds 1782, s'tait attaqu l'abb Delille, alors dans
out son succs. Dans un crit anonyme, mais qu'on savait de
ui, il avait critiqu le pome des Jardins, nouvellement im-
prim.
Il vient enfin de franchir le pas, disait Rivarol de ce pote
;
1 quitte un petit monde indulgent, dont il Aiisait les dlices de-
puis tant d'annes, pour paratre aux regards svres du grand
nonde, (}ui va lui demander compte de ses succs : enfant gt,
\\n passe des mains des femmes celles des hommes, et pour
(i) En
1793
seulement, le 10 juin.
(2)
Us
y
foisonnent : Goliot d'Herbois, Frcron fils. Pons de Verdun,
parmi les plus connus.
3 go RIVAROL
qui on prpare une ducation plus rigoureuse, il sera trait comm<
tous les petits prodig'es.
Suit une critique qui semblait amre et excessive alors, et qui
n'est que trop justifie aujourd'hui. En G:nral, il
y
a dans Riva-
roi le commencement et la matire de bien des hommes que nou
avons vus depuis se dvelopper et grandir sous d'autres noms. Il
y
a le commencement et le pressentiment d'un grand crivain
iQOvateur, tel que Chateaubriand a paru depuis
;
d'un grand criti-
que et pote, tel qu'Andr Chnier s'est rvl : par exemple, il
critique Delille tout fait comme Andr Chnier devait le sentir.
Nous verrons tout l'heure qu'il
y
eut aussi en lui le commence-
ment d'un de Maistre.Mais toutes ces intentions premires furent
interceptes et arrtes avant le temps par le malheur des cir-
constances et surtout par l'esprit du sicle, dans lequel Rivarol
vcut trop et plongea trop profondment pour pouvoir ensuite,
mme force d'esprit, s'en affranchir.
Rivarol n'a t qu'un homme de transition
;
mais ce titre il
a une grande valeur, et nous osons dire qu'il n'a pas encore t
mis sa place. Ses bons mots, ses saillies, ses pigrammes, sont
connus et cits en cent endroits: il
y
a lieu d'insister sur ses
tentatives plus hautes.
M. Xecker avait publi en 1787 son li\Te sur Vlmporlance des
Ides religieuses . Rivarol lui adressa deux lettres pleines de har-
diesse et de pense, dans lesquelles il le harcle sur son disme.
Dans ces lettres, o il cite souvent Pascal et o il prouve qu'il l'a
bien pntr, R.ivarol se place un point de vue dpicurisme
lev qu'il aura modifier bientt, quand la Rvolution, en cla-
tant, lui aura dmontr l'importance politique des religions.
Ds les premiers jours o la R.volution se prononra, Rivarol
n'hsita point, et il embrassa le parti de la cour, ou du moins
celui de la conservation sociale. Ds avant le 14 juillet, il avait
dnonc la guerre dans le Journal dit politique national, publi
par l'abb Sabatier. Ces articles de Rivarol ont t depuis runis
en volume, et quelquefois sous le titre de Mmoires
;
mais ce
recueil s'est fait sans aucun soin. On a supprim les dates, [les
divisions des articles
;
on a mme supprim des transitions
;
on
a supprim enfin les pigraphes que chaque morceau portait en
tte, et qui, empruntes d'Horace, de Virgile, de Lucain attes-
taient, jusque dans la polmique, un esprit minemment orn :
Rivarol, mme ea^donnant des /coups d'pe, tenait ce que la
poigne laisst voir quelques diamants.
Dans ce journal, dont le premier numro est du 12 juillet 1789,
Rivarol se montre, et avant Burke, l'un des plus vigoureux cri-
vains politiques qu'ait produits la Rvolution. Il raconte ce qui
s'est pass aux tats gnraux avant la runion des ordres, et il
suit ce rcit mesure que les vnements se dveloppent. Il n"y
APPBNDtC 89*
a rien dans le monde qui n'ait son moment dcisif, a dit le car-
dinal de lletz, et le cher-d'ccuvre de la bonne conduite est de
: natre et de prendre ce moment. Rivarol fait voir que, s'il
!^ta jamais, ce moment fut manqu ds l'abord dans la Rvo-
lu'iion franaise. Parlant de la dclaration du roi dans la sance
royale du Sjuin, il se demande pourquoi cette dclaration, qui,
: peu modiHe, pouvait devenir la grande Charte du peuple
fiuis, eut un si mauvais succs; et la prcmicne raison qu'il
trouve, c'est qu'elle vint trop tard. Les oprations des hom-
s ont leur saison, dit-il, comme celles de la nature; six mois
i'\a:i tt, cette dclaration aurait t reue et proclame comme
11'
plus i^rand bienfait qu'aucun roi et jamais accord ses pcu-
jilrs
;
elle et fait perdre jusqu' ride,jus(iu'au dsir d'avoir des
riats c^nraux. Il fait voir d'une manire trs sensible com-
ment les questions chans:rcnt bien vite de caractre dans cette
'l)ilit, une fois souleve, des esprits : Ceux qui lvent des
j^stions publiques de^Taient considrer combien elle se dnatu-
rent en chemin. On ne nous demande d'abord qu'un ler sacri-
lice, bientt on en commande de trs grands; enKn, on en exige
d'impossibles...
L'miage chez lui s'ajoute l'ide pour la mieux faire entrer
;
il ne dit volontiers les choses qu'en les peignant. Ainsi, pour
rendre cette fureur de nivellement universel : On a renvers,
(lit-il, les fontaines publiques, sous prtexte qu'elles accaparaient
les eaux, et les eaux se sont perdues.
... Dans tout le cours de ce journal, Rivarol se dessine avec ner-
L'ie, clat, indpendance, et comme un de ces crivains (et ils
-)ut en petit nombre) que a l'vnement n'a point corrompus .
! )s les premiers numros du journal, et dans l'intervalle du
i 4 juillet au retour de M. Necker, on avait accus le rdacteur
d'tre vendu au ministre.
K Si cela est, s'criait Rivarol, nous sommes vendus et non
juives, ce qui doit tre quand l'acheteur n'existe pas; et, en ellet
il n'y a point de ministre en ce moment... Les cours, la vrit,
ajoute-t-il en se redressant, se recommandent quelquefois aux
iicns de lettres comme les impies invo((uent les saints dans le
pril, mais tout aussi inutilement: la sottise mrite toujours ses
malheurs.
Si nous trouvions redire ce langage, ce serait plutt l'iro-
nie du ton et cet accent de ddain envers ceux mmes qu'on
dfend, accent qui est trop naturel Rivarol, que nous retrou-
vons plus tard Chateaubriand, et qui fait trop beau jeu, -vTai-
ment, l'amour-propre de celui qui parle. Le vrai conseiller po-
litique sait se prserver de ce lger enttement tout littraire...
Sorti de France en 1791
(1),
Rivarol sjourna d'abord Bruxelles,
(i) En
1792.
3
92 RIVAROL
puis en Ansrleterre, et ensuite Hambourg. C'est dans cette
dernire ville qu'il parvint tablir une sorte de centre de socit
et d'atelier littraire; tout ce qui
y
passait dp distingu se grou-
pait autour de lui. On peut dire qu'il
y
trnait..
.
Esprit tout littraire, la ncessit l'avait fait triompher de sa
paresse, et il se remit pendant son sjour Hambourg la com-
position de son dictionnaire de la langue franaise, dont le Dis-
cours prliminaire parut en 1797.
Jamais prospectus ni prface de dictionnaire n'a renferm tant
de choses en apparence tranerres et disparates. Piivarol
y
fait
entrer toute la mtaphysique et la politique. Il considre la pa-
role comme la physique exprimentale de l'esprit, et il en
prend occasion d'analyser l'esprit, l'entendement et tout l'tre
humain dans ses lments constitutifs et dans ses ides principa-
les
;
il le compare avec les animaux, et marque les diirences
essentielles de nature : puis il se li^Te, en finissant, des consid-
rations loquentes sur Dieu, sur les passions, sur la religion, sur
la supriorit sociale des croyances religieuses, comparativement
la philosophie. C'est dans cette dernire partie qu'on trouve des
tableaux de la Rvolution et de la Terreur, qui, au point de vue
moral, rappellent parfois l'ide, la plume, et, j'ose le dire, la verve
d'un Joseph de Maistre.
Il n'est ni de mon objet ni de m.a comptence d'entrer avec Ri-
varol dans l'analyse la Condillac qu'il tente de l'esprit humain.
Je me bornerai
"^
dire ceux (comme j'en connais) qui seraient
disposs ddaigner son effort, que, dans cet crit, Rivarol n'eS'
pas un littrateur qui s'amuse faire de l'idologie et de la m-
taphysique; c'est mieux que cela, c'est un homme qui pense, (jiii
rflchit, et qui, m.atre de bien des points de son sujet, exprime
ensuite ses rsultats, non pas au hasard, mais en crivain fiabile
et souvent consomm. Ceux qui connaissent la philosophie de
M. de la R.omiguire, et qui prendront la peine de lire Rivarol,
trouveront que c'est l que ce professeur distingu et lgant a d
emprunter son expdient de la transaction entre la sensation et
Vide, entre Condillac et M. R.oyer Collard, et de ce terme mi-
toyen qui a longtemps eu cours dans nos coles sous le titre de
sentiment. C'en est assez sur ce sujet. L'honneur de Rivarol,
selon moi, est, dans quelque ordre d'ides qu'il pntre, d'y rester
toujours ce qu'il est essentiellement, un crivain prcis, brillant,
anim, prompt aux mtaphores. Jamais il ne consent admettre
le divorce entre l'imaq-ination et lejugement.il nous prouve trs
bien, par l'exemple des langues, que la mtaphore et l'image sont
si naturelles l'esprit humain, que l'esprit mme le plus sec, et
le plus frugal ne peut parler longtemps sans
y
recourir, et, si
l'on croit pouvoir s'en garder en crivant,c'est qu'on revient alors
des images qui, tant vieilles et uses, ne frappent plus ni l'au-
APPENDICE SqS
ur ni les lecteurs. Ouc si Locke et Condillac manquaient
cii^a-
ment tous deux du secret de l'expression, de cet heareiix poa-
yir des mots qui sillonne si profondment fattention des
ommes en branlant leur attention, leur saura-t-on gr de cette
iipuissance V Et il conclut en disant : Les belles images ne
essent ([ue lenvie.
Il n a manque plus d'une de ces pages de Rivarol, pour frap-
"r davantage, que de natre quelques annes plus tt, en pr-
nce de juges moins disperss etsous le soleil mme del patrie,
e sentiment (jui anime les derniers chapitres, et qui lait (jue cet
)mme au cur trop dessch par l'air des salons se relve et
image par l'intelligence du milieu de la catastrophe universelle,
c rappelle (juelque chose du mouvement d'un naufrag qui s'at-
che au mt du navire et qui tend les bras vers le rivage...
Venant aux passions des hommes, Rivarol les analyse et les
jfinit avec une prcision colore qui lui est propre. Il fait bien
ntir quel point les hommes se conduisent plus d'aprs leurs
issions que par leurs ides .
.
II aborde, en finissant, la grande et nouvelle passion qui a pro-
lit la fi\Te nationale et le dlire dont la France a t saisie :
?st la passion philosophique, le fanatisme philosophique. On
oyait jusqu'alors que le mot
i\
fanatisme ne s'appli([uait qu'aux
es et aux croyances religieuses : il tait rserv la fin du dix-
litime sicle de montrer qu'il ne s'appliquait pas moins la
lilosophie, et il en est rsult aussitt des effets monstrueux.
Et ici, dans une diatribe d'une verve, d'une invective incroya-
es, Rivarol prend partie les philosophes modernes comme les
res du dsordre et de l'anarchie, les uns leur insu, les autres
sachant et le voulant. Il les montre possds d'une manie d'a-
lyse qui ne s'arrte et ne recule devant rien, qui porte en toute
alire sociale les dissolvants et la dcomposition.
Dans la physique, ils n'ont trouv que des objections contre
uteur de la nature, dans la mtaphysique, que doute et subti-
s : la morale et la logique ne leur ont fourni que des dclama-
>ns contre l'ordre politique,contre les ides religieuses et contre
i lois de la proprit
;
ils n'ont pas aspir moins qu' la re-
nstruction de tout par la rvolte contre tout, et, sans songer
"ils taient eux-mmes dans le monde, ils ont renvers les co-
ines du monde...
Que dire d'un architecte qui, charg d'lever un difice bri-
[ait les pierres pour
y
trouver des sels, de l'air et une base ter-
use, et qui nous ollrirait ainsi une analyse au lieu dune raai-
n
9
La \Taie philosophie est d'tre astronome en astronomie, chi-
iste en chimie, et politique dans la politique.
Ils ont cru cependant, ces philosophes, que dfinir les hom-
3^4
RIVAROL
mes, c'tait plus que les runir
;
que les manciper, c'tait plus
que les eouverner, et qu'enfin les soulever, c'tait plus que le
rendre heureux. Ils ont renvers des Etats pour les rgnrer,
et
dissqu des hommes vivants pour les mieux connatre...
En crivant ces pag-es loquentes et enflammes (et il
y
en
a
juatre-ving-ts de suite sur ce ton-l),Rivarol se souvenait videm-
ment de ces hommes avec qui il avait pass tant d'annes et dont
il connaissait le fort et le faible, des Chamfort,des Condorcet, des
Gart. Il
y
a des traits persomiels qui s'lancent de toutes parts
|(j
comme des flches, et qui s'adressent autre chose qu' une ide
'
et une thorie. Sans qu'il les nomme, on voit bien l'clair de ^-
son regard, la certitude de son este, qu'il est en face
de '[^
tels ou tels adversaires. Mais aussi ce qui honore en Rivarol Fin-
;,
telligence et l'homme, c'est qu'il s'lve du milieu de tout cela
comme un cri de la civilisation perdue, l'angoisse d'un puissant
et noble esprit qui croit sentir chapper toute la conqute sociale...
(Sainte-Beuve, Causeries du lundi, tome V.)
3
Opinion de Burke
. . . J'ai vu trop tard pour en profiter les admirables annales de
de M. votre frre {le Journal politique national); on les mettra
]
un jour ct de celles de Tacite. Je conviens qu'il
y
aune grande
p
ressemblance dans notre manire de penser; cet aveu dt-il vous
!^
paratre aussi prsomptueux que sincre, si j'avais vu ces annales '^
avant que j'crive sur le mme sujet, j'eusse enrichi le mien de
p
plusieurs citations de ce brillant ou\Tage, plutt que de m'aven- !^-
turer d'exprimer ma manire les penses qui nous sont com- I*
munes. [Lettre de M. Burke sur les ajjfaires de France et des
*^
Pays-Bas, adresse M. le vicomte de Rivarol. Paris, 1791.)
Madame de Rivarol
... Ce mariage, c'est la seule sottise d'une vie si spirituelle.
C'est la seule des folies de Rivarol qui n'ait pas t gaie . Malheur L
unique, en effet, puisqu'il est de ceux dont il est de mauvais got L
de se plaindre; faute terrible, puisqu'elle est de celles que rien ne L
rpare, que tout aggrave au contraire. W
Aussi Rivarol n'en parlait pas. Tout au plus dvoilait- il parfois, k
APMNDICE 895
dans une rapide allusion, la plaie secrte, affeclant alors de se
moquer de son sort, de peur d'en pleurer.
Dans une lettre date des premiers jours, il crivait M. de
Laura^uais, bien lait pour ai)prcior une telle confidence : Je
m'tais avis de mdire de l'amour; il m'a envoy l'hymen pour
se venger.
Une autre fois, il disait ses amis : Je ne suis ni Jupiter, ni
Socrate, et j'ai trouv dans ma maison Junon et Xantippe.
C'est tout
;
mais un biographe et un moraliste doivent en savoir
et en dire plus long.
llivarol avait rencontr, en 1780 ou 4781, dans les hasards
parfois perfides de sa brillante vie mondaine, une jeune femme
romanesque, aventureuse et quelque peu aventurire, plus ge
que lui, et qui n'avait gure d'autre mrite que sa beaut. Assez
instruite pour tre pdante, elle possdait pour toute dot cette
rudition d'institutrice et des prtentions nobiliaires peut-tre
moins justifies que celles de son mari. Elle lui plut
;
il le lui dit.
Elle le prit au mot
;
il l'pousa. Ils s'en flicitrent un jour, et
'en repentirent toute la vie.
Elle s'appelait Louise-Henriette Mather-Flint, d'une famille
Ecossaise, qui avait eu des malheurs sous les Stuarts, et se van-
nait de cette honorable misre, due la fidlit...
La Prface des Penses indites de Rivarol, o, sous le
rapport du caractre, sa veuve est assez maltraite, prend sa
jciense au point de vue gnalogique.
"
Le beau-pre de Hivarol est auteur d'une grammaire
iaise, trs estime, et il n'tait point professeur de langue
-..glaise, comme on l"a dit. La famille Mather-Flint est trs
nncienne et trs connue dans le pays de Galles, et il
y
a eu un
Jiplomate de ce nom, cousin de madame de Rivarol, connu dans
uutes les cours de l'Europe dans le dernier sicle. .. Les aeux
It" mademoiselle IMather-Flint avaient suivi en France le roi
lao((ues. ))
( omme nous l'avons dit, madame de Rivarol se piquait de bel
it. Elle figure parmi les admiratrices de Restif de la lre-
ic, qui a donn quelques-uns de ses billets la compromet-
aiite hospitalit de ces ouvrages o, pour allonger la sauce ou
)!([uer par un ragot de plus la curiosit dont il vivait, le fameux
)ornographe vidait sa correspondance
(1).
Madame de Rivarol
On trouve, au tome XIX des Contemporaines, sous le numro i38,
m biliet de la comtesse de Rivarol. La Paysanne pervertie ya\ni son
luteur, le
i*r
dcembre 1780,
le billet suivant : La comtesse de Riva-
[ol prie M. Restif de vouloir bien lui faire l'honneur de passer chez
|lle, demain vendredi dans la journe, ou samedi s' cela lui convient
luieux. Elle a l'honneur de lui bouhailer le bonjour, et de lui faire mille
Sg RIVAROL
I
ne se bornait pas ce commerce avec les lettres. Elle
crivait
j
aussi pour son propre compte, et il existe d'elle plusieurs
traduc-'
lions de circonstance, plusieurs ou\Tao^es de littrature
subalterne'
et mercenaire dont on trouve la liste dans les bibliographes
(1).
(M. de Lescnre, Riuarol et la Socit franaise.)
Manette
... Il fonda un autre intrieur avec Manette,
dont le babil rieur
et l'entrain lger le charmrent certaines
heures. Cet autre
intrieur n'tait pas exempt d'orage. Manette avait beaucoup
voyag. Elle avait laiss des traces de son pied lger en Italie
et
jcn Angleterre. Femme qui voyage laisse
voyager son cur.
Rivarol tait volage, mais jaloux. Il lui arriva
plus d'une fois,
selon Gart, de prendre aux cheveux sa
douce amie, et delaj
vouloir bien tendrement jeter par la fentre
; mais il se ravisait
temps. Manette tait tout simplement
une
aimable copie de ^Manon
Lescault, venue de sa province,
ignorante et
pauvre, mais jolie et
perverse. Elle avait de l'esprit, mais
surtout
i'esprif de l'amour.
D'ailleurs elle avait t l'cole
de Sophie
Arnould. (Arsne
Houssaye, Galerie du xvui' sicle.)
Rivarol lui disait, la veille de son dpart pour Bruxelles :
Ma chre, si vous voulez tre souveraine, restez Paris. Si, au
contraire, vous voulez tre toujours Manette, il faut me sui^Te.
Manette
y
consentit, courut le monde, vit des princes par la
grce de Dieu soupirer pour ses charmes, fut sage, quoique jolie,
couta les vers et la prose de Rivarol, fit les honneurs de plusjK
d'un grand souper, fut aime partout, partagea les chances desal/e
bonne et de sa mauvaise fortune. Enfin Manette fut pour lui unejf
providence de soins dlicats. (Sulpice de la Platire, Vie de'"
Rivarol.)
On avait pardonn Dufresny et Boissy d'avoir pous leuTiCu.
blanchisseuse, Diderot d'avoir pris pour femme sa gouvernante; 4;
enfin on savait que Le Brun avait contract mariage avec sa cui-
compHments sur la Paysanne. Cet admirable ouvrage l'a fait revenir
de sa prvention contre les hommes, puisque c'est un homme qui a su
peindre avec tant d'nergie 1 ame sublime de deux femmes naturelles,
Fanchon Berthier et sa belle-mre, ainsi que l'me sublimatroce {sic) de
Gaudet. A.
(i) Il
y
a des dtails utiles dans sa Notice sur Rivarol. Elle mourut
en 1821.
APPENDICE
897
sinire, appele malis^neincnt par (piclqu'un son Pgase. Le pre-
mier de nos coniicjues avait illustr sa servante La Fort et Jean-
Jacques sa Thrse. Hivaroi, soit qu'il voult ou non s'autoriser
de ces exemples, montrait ses amis, peut-tre mme ses enne-
mis, une certaine Manette, espce de bonne qui occupait chez lui
une place dans le salon; mais elle finit par quitter son matre
deux ou trois ans avant (ju'il mourt, et s'en revint de Ham-
bour en France. .
.
... Il
y
avait beaucoup dire sur la fracheur de Manette, et
trs peu sur son esprit. In jour qu'elle tait malade, et (ju'elle
tmoignait Rivarol une incjuilude de ce qu'elle deviendrait dans
l'autre monde : Laisse Taire, lui dit-il, je le donnerai une
lettre de recommandation pour la servante de Molire.
(H. de la Porte, Notice.)
6
Rivarol Hambourg
... Bientt le Spectateur du Nord
(1)
compta parmi ses rdac-
teurs tous ceux qui, dans l'migration de Hambourg-, savaient
<juel<jue peu tenir tenir une plume.
Rivarol ne collabora ce recueil que peu de temps, et n'y
donna gure que les rognures de son esprit. 11 l'ut de bonne heure
accapar par son Dictionnaire, doni les travaux prliminaires ont
l'ampleur des portiques d'un monument malheureusement demeur
inachev, et il eut assez de peine disputera ses travaux le temps
<lt' ses plaisirs, pour pouvoir consacrer au Spectateur des inspi-
rations fraches et des loisirs dsintresss. Nous trouvons dans
le Spectateur de 1797 inscrire au bilan de Rivarol, outre deux
extraits raisonnes qui ne sont pas de lui, de son Discours prli-
minaire du Nouveau Dictionnaire de la langue franaise, un
Essai sur famiti, prcd de celte courte et mordante Note :
^<
Feu Mirabeau, dont le portefeuille tait, comme celui des
C( lurtiers, rempli des effets d'autrui, ayant eu quekpie temps sa
disposition le morceau suivant, le donna comme sien ses amis
(l'Allemagne. (Voyez le recueil de ses lettres M. Mauvillon,
])rofesseur Brunswick, qui lui faisait sa Monarchie prussienne.)
Mirabeau, n'ayant qu'une copie manuscrite de cet Essai sur
i amiti, ignorait qu'on l'avait insr dans le Mercure prs d'un
ans auparavant, retouch par l'auteur.
Nous trouvons la page -ilti du tome
1er
un morceau intitul :
De la littrature franaise en I/88, l'occasion d'un ouvrage
(i) Recueil fond par Baudus, dit par Fauche.
a3
SgS niv.vnoL
de M. de Florinn
;
et la suite un aiilre article qui peut lui
ttre attribue, si^n : Liiciiis Apiileius, et intitul : Lp.ttrc aa
Spectateur^ sur Pouvrag-e de in;u:lame de Stal : De l'influence
des passions. 11^ ne faut pas oublier non plus quelques essais de
traduction de VEnide avec des remarques et des notes...
Ds 1798, Faucbc et Rivarol ne semblent plus prendre au suc
ces de Spectateur du Nord qu'un mdiocre intrt. Ce que l'un
et l'autre en voidaient surtout, et ils l'avaient obtenu, c'tait le
concours de sa publicit pour la propagande du Nouveau Dic-
tionnaire de la lanrjue franaise. Or, l'affaire inaugure par l;i
publication de la premire partie du Discours prliminaire, qui
contenait toute une thorie philosophique du langage et tout un
systme de critique philologique, tait dsormais lance et absor-
bait imprieusement tous leurs soins.
C'tait une entreprise complique, car Fauche
y
avait ajoud'
des rouages qui tmoig^nent d'une exprience consomme d''
faiblesses du public et des appts avec lesquels on l'attire. On
trouve, au tome III du Spectateur, et en tte de chaque exem-
plaire du Discours prliminaire, un prospectus dont les annonces
appartiennent au mercantilisme le plus raffin, et dont les combi-
naisons n'ont rien envier aux plus belles inspirations du
puf~
fisme contemporain. Fauche s'engage remettre tout sous-
cripteur ce Dictionnaire
(3
vol. in-l^)^ rvlateur de tous les
mystres de la langue franaise, rparateur de tant d'injures qui
lui sont sont faites, librateur d'un joug qui de lger est devenu
si dur, vengeur de l'indigne tyrannie de la routine acadmi({u('
(l'Acadmie, n'ayant pas repris la parole, ne pouvait se dfendre,
et Rivarol ne l'pargnait pas plus que Chamfort), Fauche, donc,
s'engage remettre tout souscripteur un billet numrot de
loterie donnant droit un lot de cinq cents livres tournois, qui
cherra par la voie du sort chaque centime billet sorti de la
roue. Un lot de six mille livres tournois appartiendra au porteur
du billet correspondant chaque millime numro. Mais l o la
rouerie allemande se mle la finesse franaise et
y
clate, non
sans un discret sourire, c'est dans la disposition qui porte que
l'affaire n'intressant que des lecteurs au-dessus d'une pense
de lucre, c'est non en
francs qu'on les soldera, mais en Hures
de la librairie Fauche, choisir dans son catalogue de quatre
mille numros. Rien ne manque cette
combinaison digne des
plus beaux jours de la spculation livrescjue parisienne, pas
mme les remises exceptionnelles de 40 pour 40U qui placera
42 exemplaires
;
45 pour 400, de treize vingt-quatre exemplaires;
20 pour
400, de vingt-cinq cinquante, etc..
Nous avons sous les yeux le trait conclu entre M. Antoine,
comte de Rivarol, de l'Acadmie royale de Prusse, etc.. d\uie
part, et Af.
Pierre-Franois Fauche, imprimeur-libraire, domicili
AtPENt3lC8
3^
.1 Hamboiirc:, cVanlre pari . Il nous montre Klvarol en affaires,
l(*s traitant avec une dsinvolture de c^rand seigneur qui n'exclut
l)i)int les vues fines et les calculs judicieux. Par cette convention
(lu :26 mars 1790, Fauche s'ens^a^e payer Rivarol
par anti-
cipation sur ses droits d'auteur, fixs la moiti des bnficcs,
;i[)rs prlvement fait, sur le produit tles ventes, de toutes les d-
jicnses spcialement relatives l'entreprise
une somme de cin-
(juante louis par mois. Ces avances mensuelles de rdaction pour
Hivarol et ses collaborateurs, (ju'il demeure seul char^- de choisir
t de paver, courront pendant un an. L'auteur s'obliij^e, peine
dnn ddit de douze mille livres tournois, fournir, dans les six
mois de la date du trait, le manuscrit du Discours prliminaire
et celui des six premires lettres. Fauche demeure aussi tenu de
j)lusieurs obligations, notamment la fourniture s^ratuite des livres
ncessaires la rdaction. Enfin, en cas de difficult entre les
j>arties, elles stipulent que le diflrend sera rgl l'amiable par
des arbitres.
Comme nous le verrons, le Dictionnaire ne fut qu'un de ces
magnifiques chteaux en Elspagne, sur lesquels la complaisante
imagination de Rivarol donnait de trs bonne foi des
hypoth-
(jnes, dont le gage ne consistait gure que dans les portes,
relle-
ment existantes, d'un tlomaine pour tout le reste idal. Mais le
succs du Discours prliminaire suffit certainement indemni-
ser Fauche de ses avances, et il ne parat pas qu'il
y
ait eu diffi-
cult entre lui et les hritiers de son pensionnaire, quand une
mort prmature brisa sa plume et qu'd ne fut plus permis d'es-
prer l'achvement d'un monument qui avait t srieusement et
<r)nsciencieusement fond, et qui n'tait pas de ceux qu'on impro-
vise. (M. de Lcscurc, ouvr. cit.)
7
Mort de Rivarol
Le comte de Dampmartin Claude-Franois de Riuaroi.
Montsgur,par Saint-Paul-Trois-Chtcaux, le 26 octobre i8o3.
I
... Tous les rcits de la mort de votre illustre frre sont sur-
'' chargs de circonstances romanesques dont la plupart n'ont pas
!(^
moindre fondement. Celui (jui se lit dans le Journal des Dbats
l'-t fort bien fait, quant au style et quant aux sentiments, mais
il n"a pas la moindre exactitude. Il a t cause que je n'ai rien
'lit de positif et de clair sur cet vnement, d'aprs l'ide que
/JOO
RIVAnOL
vous
approuviez cette rdaction dans laquelle on vous cite, ainsi
que votre fils; cela suftisait pour m'iniposcr de justes g-ards.
Rivarol ne s'est nullement fait transporter la campagne
;
il
a souffert et il est mort dans sa chambre garnie, au milieu de
Berlin, d'o l'on ne pouvait assurment voir ni campagne ni ruis-
seau ;
mais ses htes lui ont montr un attachement, un zle digne
d'loges.
N'ayant pas ^ecou^T sa tcte les deux premiers jours, il n'a
point pu prononcer les discours qu'on lui prte. A l'instant de sa
mort, il n'y avait prs de lui que le cur, son clerc Donadei,
l'hte, son fils et moi.
Madame la princesse Dolgorowki prenait le plus vif intrt
votre frre, et je ne doute pas de ses regrets, mais elle ne ft
pas mettre dans les journaux qu'elle payerait les dettes de Riva-
rol. Une telle annonce et t fort extraordinaire, puisqu'il avait
vcu fort dcemm.ent et qu'il n'avait puis que dans la bourse de
Donadei
;
ce qui tait un secret entre ces deux vritables amis.
Bien plus, la princesse devait encore trente-cinq louis Rivarol
;
et son amie,
Mme
de Galitzin, vingt-cinq pour l'achat de sa petite
bibliothque. Les deux sommes ont t payes avec promptitude;
mais, certes, ce n'tait pas le cas d'annoncer qu'on payerait des
cranciers imaginaires.
Tous les effets et tous les manuscrits ont t soigneusement
runis et placs sous un scell que l'on n'avait pas encore lev
lors de mon dpart de Berlin. D'aprs les intentions de Rivarol,
j'crivis au gnral Dumouriez pour l'instruire de l'vnement et
le charger d'en faire part au fils. L'un et l'autre m'crivirent. Ils
dsiraient que l'ambassadeur de Danemark obtnt la suppression
des formes de la justice : mais la chose ne fut pas possible, parce
que Fauche prenait sur les manuscrits une opposition pour cinq
cents louis. Sur ces entrefaites, il arriva des lettres de la veuve au
gnral de Beurnonville, ainsi qu'au doyen de l'Acadmie. Ces
Messieurs, qui croyaient la dame morte, furent fort tonns et
me chargrent de la voir Paris, surtout de la dtourner de son
projet de voyage Berlin, qui lui serait aussi dispendieux qu'inu-
tile. Je me suis prsent chez cette dame, et quoique je me sois
efforc, comme de mon devoir, d'tre honnte, j'ai eu le malheur
de la mcontenter
;
car elle a voulu faire insrer dans plusieursjour-
naux des plaintes contre moi. Que pouvais-je lui dire de fort con-
solant lorsque Rivarol, tant en bonne sant que durant sa maladie,
n'avait fait aucune mention d'elle? J'ai su de Berlin qu'il
y
avait
eu un procs entre la mre et le fils, que ce dernier a gagn.
L'opposition du libraire Fauche est galement leve
;
j'ignore
par (juels sacrifices.
Je crois que votre frre ne prvoyait pas qu'un jour on
ajouterait ses ou^Tages. Cette hardiesse pntre de surprise.
APPENDICE
40I
Vous, possesseur des flches, c'est vous de vene^er sa mrmoire.
Je vous fais parvenir une Relation sur l'exactitude de laquelle
vous pouvez compter. Je la ecaranfis sur ma parole d'honneur.
J'crirai demain INI. d'Azmar, quoique bien persuad que
cet excellent homme n'a besoin (pie de consulter son cur pour
vous rendre service; il a, d'ailleurs, reu du prfet de l'Isre la
lettre la plus pressante. Il est bien essentiel que vous acheviez
l'ducation de son Hls, dont Hivarol avait conu la plus haute
Ide; il le regardait comme un sujet fait pour parvenir tout.
^'ous aurez sans doute un puissant support dans M. le marquis
de Lucchesini, l'ami de votre frre.
Voulez-vous bien dire les choses les plus empresses monsieur
votre pre, prsenter mes respects madame votre mre, et
croire (jue je garderai comme un bonheur d'ac(jurir de nou-
veaux droits votre amiti, que je payerai d'un sincre retour?
DAMPMAKTIN.
Relation
Rivarolse sentit lgrement incommod, le samedi 4 avril 1801.
Le dimanche, il garda la chandjrc et se mit au rgime. Le lundi,
son indisposition continua, mais sans prendre de caractre
srieux. Ce fut plutt titre d'homme d'esprit et d'ami qu' celui
de mdecin que, le soir, il reut le docteur Formey. Le mardi,
Dampmartin
,
qui venait de passer deux jours Potsdam, le
trouva, comme son ordinaire, faisant les dlices d'un cercle
nombreux d'auditeurs. Il parlait peu de son malaise, mais il le
faisait d'une manire lumineuse en l'attribuant deux causes : la
Jatigue de son estomac que l'on prouvait sans cesse par de grands
dners et par de grands soupers; la fantaisie qu'il avait eue, plu-
sieurs jours de suite, de se promener fort avant dans la nuit.
Le mercredi matin, il se plai^-nit d'une mauvaise nuit et
demanda Formey. Celui-ci vint et dit en sortant de sa chambre :
Messieurs, je vous annonce avec regret que Rivarol est attaqu
u d'une maladie trs dangereuse. Ouoi([ue ce discours part
tre un peu forc, l'alarme devint cependant fort vive. De cet ins-
tant le malade fut entour et servi par ses compatriotes, qui se
relevaient avec un zle bien dis^ne d'loges, car quelques-uns ne
le connaissaient que sur sa brillante rputation. Nul ne se distin-
gua davantage que le savant et vertueux Donadei, dont l'amiti
constante est un des plus beaux loges de Rivarol. Un jeune
Franais, dont le nom nous est inconnu, mais qui runit fissure,
esprit et sensibilit, suspendit le cours d'un grand voyage pour
rendre des soins empresss au malade
(1).
Les habitants de Ber-
[
(i) Ce jeune Fianais doit cire le comte d'Adhmar, qui crivait de
402
niVAROL
lin de tous les rangs donnrent des preuves flatteuses d'intrt.
Le major Gualticri, maintenant envoy de Prusse en Portus^al, ne
cessa point de se montrer ai dent enthousiaste ainsiqu'ami sincre.
M.
d'Eno;estrocm, envoy de Sude, eut tous les procds d'un
homme sensible et gnreux. Dampmartin veilla seul le malade.
Les douleurs lurent cruelles
;
plusieurs reprises , il s'cria :
Moi seul suis capable de soutenir de telles souffrances
;
heureu-
sment, mes poumons sont de bronze. Dans des instants de
relche, il parla d'une manire bien touchante de sa famille et de
ses amis.
Cet homme, si redoutable pour les sots, tait bon et poss-
dait, en un mot, une me de niveau avec son esprit, la nature
ayant voulu, sous tous les rapports, le combler de ses dons les plus
riches. Les mots malins taient les tincelles dune imao^ination
brlante et les plaintes d'un got excessivement dlicat
;
mais ils
ne partaient pas du cur. A plusieurs reprises, il annona sa
ferme rsolution de revoir la France : Nous irons respirer pen-
ce dant six mois le bon air du Languedoc, nous nous rendrons
(. ensuite Paris; vous prouverez qu'il n'y a personne au monde
{( avec qui il soit plus facile de vivre.
La journe du jeudi fut orageuse
;
le docteur pronona que
la maladie tait une fluxion de poitrine bilieuse. Les grandes dou-
leurs de la nuit prcdente taient provcnucs de la gangrne qui
rongeait les poumons. Sur le soir, Rivarol voulut tre quelques
instants seul avec Dampmartin. Sans paratre alarm de son tat,
il s'entretint avec beaucoup d'motion de son pre, de sa mre^
de son fils, de son frre, de son neveu et de ses deux s^urs.
Dampmartin, tant entr dans la pense que le docteur exagrait
le danger de sa situation, lui conseilla de rgler nanmoins ses
aTaires. 11 rpondit
: Tout ce que je possde^ appartient mon
(i fils
;
je souhaiterais seulement que mon pre toucht vingt louis
qui doivent, au premier jour, ra'arriver pour une Bible pr-
Berlin, le 35 mai 1801, la comtesse de Neuilly, sa cousine:
... Vous
me demandez quelques dtails sur ce pauvre Rivarol
;
vous l'aviez trs
bien jug, son cur tait aussi bon que sa langue quelquefois l'tait
peu. Bon fils, bon pre, bon ami, c'est un hommage que je lui dois, et
sa socit journalire tait aussi douce qu'aimable
;
ft, caress par
toutes les belles dames de notre superbe ville, il a t victime des cou-
lis truffs et des bonbons qu'on lui prodiguait. 11 est mort comme Vert-
Vert.
Attaqu d'un rysiple la tte, malgr tout ce que j'ai pu lui dire,
il ne s'est pas assez scigii dans sa convalescence; l'humeur bilieuse
qui le dominait, dtermine par un gros rhume, s'est jete sur sa poi-
trine, et ds les premiers jours de sa seconde maladie, il n'y avait plus
moyen de le sauver. Sa tte tait prise
;
il n'a point eu connaissance de
son tat, et a trs peu souffert.
A.
AI^PENDIGE
4o3
f<
cietiflc qiio j'ni cde un prince. Il termina rcnfretien.
" Oii('l(jm' douleur (|iJ', je souilVe dans ma position, je im |)iiis me
fcher contre mon lit, j)nisque c'est o j'ai con(ii toutes mes
ides. Mon ami, je n'ai jamais couru aprs l'esprit, il est toujours
venu me chercher.
Le vendredi malin, le malade se sentit beaucoup mieux et
demanda d'tre lev. Pour le satisfaire, on l'approcha des fene-
Ires. Ce fut alors qu'il dit avec un sourire charmant: Ce cher
docteur Formey a eu bien peur de me dformer. Il donna
/lehpies ordres relatifs la propreti'; de sa personne ainsi qu'
ci'ile de son appartement, ensuite il demanda Donadei. Mais lors-
(jue cet ami vint, Kivarol le mconnut. De cet instant
l'usasse de
sa raison lui fut jamais ravi. Le reste de ce jour se passa dans
im tal de dlire qui se prolongea durant la nuit. Ds les premiers
signes d'ii^'arement, les clefs du bureau et celles de l'armoire furent
remises deux hommes recommandables par leur rang- et plus
encore par leur mrite personnel.
Le samedi matin, le malade tomba dans un affaissement
qui
lie lui permettait plus que de respirer avec peine. Ses yeux taient
ierms ou bien hagards, s'ils s'ouvraient. Une sueur abondante ne
discontinuait pas. Les docteurs Brown et Hocm, hommes fort
clbres, joiij^nirenl leurs lumires celles de Formey, mais sans
aucun succs. On fit, sur les trois heures, appeler le cur, qui lui
iit des exhortations et qui l'administra. Ce prtre dit, sur les qua-
tre heures: Dampmartin, quittez votre position, car vous ne
<( tenez dans vos bras qu'un cadavTC.
Celte mort, arrive le 11 a-vTil 1801, produisit une i^ande
sensation. L'illustre Ancillon, arriv quekjues minutes aprs dans
<a chambre, s'cria de l'accent le plus douloureux: Quel gnie
nous venons de perdre !
La socit qui se rassemblait chez la princesse Dolgorowk
fit prendre son pltre pour faire excuter son buste en marbre.
Oonadei et Dampmartin remplirent les fonctions testamentaires;
l's scells d'excuteurs furent poss sur tous les effets. On s'em-
iiressa de lui rendre avec dcence les derniers devoirs. La pompe
funbre offrit un spectacle touchant. La douleur tait peinte sur
tijus les visages; on voyait que les trani^ers, aussi bien que les
Franais, sentaient que nous venions de faire une perte irrpara-
ble. Kivarol a laiss d'immenses matriaux pour son Dictionnaire,
mais je les crois informes. Il crivait beaucoup de notes margi-
nales au Dictionnaire de l'Acadmie. Son ouvrage sur la politique
contre la souverainet du peuple est achev. Son Trait de gram-
maire aurait bientt paru. Son bel ou'STage sur l'intelligence hu-
maine est corrig, augment. La seconde dition, j)rte para-
li'c, ajoute de beaucoup sa rputation. Les pices fugitives sont
4^4 RIVAROL
I
en grand nombre. La Bible fut renvoye trois jours aprs la
mort (d). Rien donc redonner pour le bon pre (2).
(Papiers communiqus M. de Lescure par la famille Tollin de |
Rivarol.)
8
Note du major Gualtieri(3)
Rivarol, mon cher Rivarol n'est plus ! La mort vient d'enle-
ver la fleur de son o-e,
cet homme dont le monde a connu
l'esprit, mais dont peu d'hommes ont connu le cur. Que n'ai-
je t du nombre de ceux qui n'ont regretter que ses lumi-
res, et n'ont point pleurer un ami !
Y aurait-il de l'amour-propre dire que je n'ai jamais trouv
un homme avec lequel je me sois plus parfaitement rencontr
dans mes plus chres opinions? Toujours prt l'couter,je ne le
perdais pomt de vue dans le bruyant cahos du monde. Son aima-
ble caractre ne le quittait jamais : partout le premier, toujours
oblig de descendre pour se mettre au niveau des autres. Cet
homme tait comme un bon fruit, qui pouvait n'tre pas du got
de tout le monde, mais qui personne ne pouvait disputer la
saveur.
Il dominait par tout, et sa domination dans la socit ressem-
blait celle de bonnes lois dans une rpublique bien organise
;
quoique matre du gouvernement, il avait l'indulgence de la su-
priorit et la modestie du mrite. S'il tait peu fier de ses avan-
tages, c'tait par systme
;
ne se considrant que comme une
combinaison heureuse de la nature
;
convaincu qu'il devait plus
son organisation, qu' l'tude, il ne s'estimait que comme un
mtal plus rare et plus fin. Aussi, quoiqu'il juget svrement
les autres, il ne mprisait personne.
Prodigue de son esprit, il le rpandait pleines mains; tout
le monde pouvait en prendre sa part
;
et si quelquefois il le
revendiquait, c'tait moins par avarice que par esprit de justice.
Paresseux comme un homme riche, il ne craignait ni l'avenir ni
Cl) Nous lisons encore, dans la lettre du comte d'Adhmar, dj cite,
M'^^ de Neuilly :
a
Je ne l'ai pas quitt ; entour de ses amis et des miens, il a fini en
nous souriant. Son masque, que j'ai fait prendre, en g:arde l'empreinte.
Pour ses papiers et ses affaires, il n'y avait aucun ordre... A.
(2'
Dampmartin rcple la mme chose, mais trs brivement, dans ses
Mmoi?'es.
i'6j
Diplomate au service de la Prusse, alors ministre en Portugal.
APPENDICE 4o5
1.^
besoin. Sir du trsor qu'il portait, il risquait de mourir de
f.iim au milieu de son or, parce qu'il ddaii^niit de le porter la
monnaie et de convertir ses linj^ots en espces.
Artiste de la parole, il ne s'amusait pourtant point crer
(les mots
;
mais mettant, pour ainsi dire, toute la nature contri-
1 iition dans ses crits et sa conversation, il formait une lang-ue
luvelle avec des mots convenus; son nie les broyait son gr
'
savait s'arrter l o le bon oiit avait mis une borne.
Comme celle d'un cbimisfe habile, son amalfi;'ame avait tou-
jours un but, et n'alliait que les matriaux qui pouvaient produire
un rsultat utile ou agrable.
Caustique sans tre mchant, il n'attaquait que les ridicules;
et cette disposition la causticit tait une habitude de l'esprit,
])lutt qu'un dfaut. L'objet de ses satires n'tait pas celui de son
animosil personnelle.
Comme il s'tait beaucoup occup de la lanarue, les jeux de
mots et les calembours mmes avaient quel(jue chose de piquant
pour lui, et se prsentaient son esprit sans qu'il les chercht. Il
avait un luxe d'esprit, une exubrance d'ides, qui le faisaient
jouer avec les penses, comme un nmsicien habile sur les cordes
ou sur les touches de son instrument.
Quoiqu'il ft bien facile avec ces qualits de s'adonner au
dang-ercux amusement du sarcasme, il savait tre dans l'occasion
l'ami de ses amis, le dfenseur de ses absens, et si j'ose m'expri-
ni(T ainsi, le ^/"a/c/ justicier du vrai mrite. (Sulp.de la Platire,
Vie de Rivarol.)
9
Extrait du Mercure de France
(1).
Les journaux, en annonant la mort de Rivarol, ont port les
uns la louano-e jusqu' la flatterie, les autres la critique jusqu'
la satire : j'viterai ces deux excs.
Rivarol est un des premiers hommes de lettres que j'aie con-
nus; je l'avais rencontr chez Dort, il resta ma connaissance,
mais il ne fut jamais mon ami; je puis en parler avec impartia-
lit, sans affection et sans humeur.
Il avait reu de la nature une figure aerrable, des manires
distingues, une locution pleine de fficilitc et de srcc ;
il dut
ces dons extrieurs ses premiers succs dans quel(|ues cafs litt-
rair.es et principalement celui du Caveau. Coll, Favart et Piron
n'taient plus, ou du moins ils vivaient retirs du monde
;
avec
eux le Caveau avait perdu cette gat franche et ces saillies bril-
(i) 5 floral an X.
23.
46 RIVAROL
lantes, qui sont comme les clairs de l'esprit; mais ChampfortJ
Durufl, et quelques autres gcDs aimables lui conservaient encore]
quelque renomme.
Rivarol s'y fit bientt remarquer. Son talent pour la raillerie
lui attira quelques ennemis et beaucoup
de
partisans; car nous
naissons presque tous avec un penchant secret la mchan-
cet. Il ne manque la plupart des hommes que de l'esprit pour
tre malins; et, lorsqu'il parat un homme dou de ce talent:
malheureux, les s^ens mdiocres et jaloux le flattent et l'excitent
comme un champion propre servir leur impuissante malignit,
mais ils le caressent sans l'aimer. Ils se rjouissent sralementi
des coups qu'il porte et de ceux qu'il reoit. Eprouve-t-il quelques]
revers, ses plus zls partisans sourient son humiliation. C'est]
toujours ce public inconstant dont parle Voltaire :
Oui flatte et mord, qui dresse par sottise
Une statue, et par diot la brise.
Rivarol fut en butte aux plus sottes calomnies. On fit sur sl
naissance des volumes de plaisanteries, tantt niaises, tantt assert
gaies.
Mais qu'importe son mrite littraire qu'un auteur ait t cj
qu'on appelait autrefois un homme de qualit? Nanmoins il
y
avait peu d'adresse annoncer la fols deux espces de prten-
tions diffrentes; le monde a tant de peine pardonner un seulj
genre de supriorit !
Au reste, il aimait la guerre, et la faisait volontiers sur le plus
|
lger prtexte. J'ignore en quoi l'avait offens
Mme
de Genlis:
mais rien de plus insignifiant que son sujet de plainte sur l'abb
j
Delille et sur Gart, contre qui furent dirigs ses premiers pam-
phlets.
Enfin, je ne dirai pas fatigu du grand nombre, mais ennuy
du petit nombre de ses ennemis,il attaqua tout le peuple littraire
la fois; on voit que je veux parUr du Petit AImanach des ffi^ands
hommes. L'ide en tait ingnieuse, et offrait la plupart des lec-
teurs le mrite d'un secret dvoil. N'tait-il pas piquant, en effet,
de rvler au public, en un seul jour et dans quelques pages, les
noms de tant d'hommes qui, depuis tant d'annes, malgr leurs
nombreux ouATages, chappaient la renomme !
La premire partie de la prface offrait le meilleur ton deplai-j
santerie; mais l'auteur emploie toujours la mme ironie, et n'en!
rachte point assez l'uniformit par la varit des formes et desi
tournures. (iVo//ce, par Fiins des Oliviers.)
APPENDICE
407
I
10
Gbampcenetz
l\cn-Ferclinand, chevalier de Champcenelz, tait le frre de
L')iis-Pierre-Oueiiii!i de KiclieboLir^-, gouverneur de Bellevue et
' !!!
des premiers valets de chamjjre du Roi, enfin eouverneur
^ Tuileries, qui avait pous, en mars 1777, une des femmes
plus clbres par leur beaut la lin du rg-ne de Louis XV
au commencement du r2:nc de Louis XVI, la Hollandaise
''
Pater, connue, depuis la dissolution de son premier mariasse,
is le nom de Baronne de Niewerkerke.
'
e frre an du chevalier tait, au contraire de son cadet,
ne humeur sombre, d'un caractre circonspect, et Rivarol a
'l ses habitudes de mystre. Il n'entre point dans un salon,
"v glisse, il longe le dos des fauteuils et va s'tablir dans l'an-
Ic plus obscur, et quand on lui demande comment il se porte:
Taisez-vous donc! est-ce qu'on dit ces choses-l tout haut?
("(
malin croquis de Rivarol s'assombrit d'une ombre tragique
1 rs(ju'on le rapproche des pages frissonnantes et mouvantes o
ini -s Elliott raconte avec quelle peine et au prix de quelles angois-
elle parvint arracher aux perquisitionnaires du 10 aot le
1 heureux et assez pusillanime gouverneur des Tuileries, qui
-
'iait rfugi chez elle.
Son frre, l'ami intime, le compagnon, le complice, le Sosie, le
-Mercure de Rivarol, qui l'appelait son clair de lune et qui di-
rait de lui : Je le bourre d'esprit, c'est un gros garon d'une
uaict insupportable
,
tait un tout autre homme que son an.
(l'est avec lui et peut-tre grce lui que Rivarol supporta les
iiursailles que lui valut de toutes parts son provocateur Alma-
fia'^Ii. Il partagea avec Champcenetz, auquel il donnait, dusuper-
!l 1 de son esprit, l'esprit ncessaire, l'ennui de cette grle de m-
disances acres, d'une porte et d'une pointe fort ingales, mais
d i!it le nombre ne laissait pas d'tre embarrassant.
Cet ami, side jovial de Rivarol,son satellite infatigable, espce
di" Sancho de son don-quicholtisme littraire, force de se frot-
\'-v au grand improvisateur, s'tait fait, avec ses bribes d'pigram-
!ii vs et ses bons mots de rebut, une assez jolie provision de suc-
eurs et d'ennemis. Homme, du reste, aussi intrpide qu'inipertur-
l.ial)Ie, qui prenait volontiers sa charge les crimes de sa mmoire
et (pii, poussant juscju'au bout ses bonnes fortunes, ne refusait
jamais de se battre, mme pour les mots qu'il n'avait pas faits.
u II se bat, disait de lui Rivarol avec une admiration un peu
goste, pour les chansons qu'il n'a pas laites et mme pour cel-
les que ses ennemis lui accordent.
On lui faisait, dit dans ses Mmoires Tilly, qui l'a peint
/}08 RIVAROL
merveille, honneur d'une infinit de bons mots que d'autres avaient
dits. Jamais on ne vit une telle audace prendre le bien d'autrui
dans ce erenre, une telle persvrance colporter l'esprit des autres;
tout cela soutenu d'un bg-ayement qui le servait miracle. Le che-
valier de Boufilers a sur la conscience un coup d'cpe que le vicomte
de Roncheroles donna Champcenetz pour la chanson des Jeunes
Gens que Boufflers avait faite, et qui mit Champcenetz dans son
lit, trouvant tout simple d'avoir un coup d'pe bien lui pour
des vers qui n'taient pas de lui... Le fait est qu'avec une figure
qui prtait au rle qu'il avait adopt, il avait quelques saillies et
de temps en temps du bonheur. II hasardait tout, retenait tout,
prenait tout. Il tait dou d'une gaiet intarissable... Cette gaiet
tait son esprit.
On va juger jusqu' quel point Champcenetz garda, jusqu'
quel degr il leva ce courage de l'esprit et de la gaiet dont il
fut d'abord l'enfant perdu, l'enfant prodigue, puis enfin le hros
et jusqu' un certain point le martyr.
Aprs avoir eu le tort de chansonner Marie-Antoinette et de
prter des armes contre une reine et contre une femme aux mali-
gnits du peuple et de la cour, Champcenetz expia cette faute en
se jetant la plus tmraire avant-garde des dfenseurs de la
royaut. Il fit jusqu'au bout le coup de feu de la satire politique
dans le pamphlet priodique des Actes des Aptres. Le sort tra-
gique de Suleau, victime de ses plaisanteries contre Throigne de
Mricourt, immol aux rancunes de l'amazone rvolutionnaire
par ses farouches adorateurs, ne le rendit ni plus circonspect, ni
plus triste. Il refusa de fuir; comme Tilly, comme Rivarol, il
refusa de se cacher, de se taire. Il se trahit par une pigramme,
se dnona par un bon mot et se condamna lui-mme, en se mo-
quant, la barbe de ses bourreaux, de leur prtention poser
pour des juges. A Fouquier-Tinville, qui requrait sa mort, il
demanda en riant: Peut-on se faire remplacer (1)?
)> Mont sur
la charrette du supplice, il disait en riant au bourreau : a Mne-
nous bien, tu auras pour boire. En prsence de l'chafaud, il
fermait la bouche en riant son compagnon d'infortune, Parisot,
qui l'importunait de ses protestations et de ses plaintes.
Je
meurs rpublicain, s'criait Parisot au pied de la sinistre machine.
N'en croyez rien, citoyens, s'criait Champcenetz, qu'indi-
gnait la faiblesse de cet appel suprme la justice ou plutt la
(i) L'anecdote, toujours courte, est complte dans Tilly
(1, p.
2C6) :
Condamn mort par l'horrible Fouquier-Tinville, il lui demanda si
ce n'tait point comme l'Assemble, o il
y
avait des Sapplans?
Pourquoi ? dit le monstre.
C'est que je me ferais remplacer par
vous. ))
APPENDICE
409
piti populaire; n'en croyez rien, c'est un charlatan; il est aris-
tocrate comme moi
(1).
Et il se livrait en riant l'excuteur, enchant de finir sur un
rire et un bon mot.
Vivre en riant n'est "pas d'un homme extraordinaire, mais
mourir en riant n'a rien de vuli^aire. Cette gaiet hroque de
sa mort ennoblit l'image de Champcenetz
;
et une rvlation
r(;cente ajoutera aux sentiments ({u'excite une telle fin les regrets
de tous les bibliophiles, s'il est vrai que Champcenetz prit vic-
time de cette noble passion : l'amour de sa bibliothque.
Le chevalier de Champcenetz en avait une trs belle, parat-il,
o chaque exemplaire tait marqu d'un ex-libris reprsentant
son blason sur un amoncellement dnues au centre d'une gloire
rayonnante, pice enleve au burin et typique dans le style
Louis XVL
Rfugi Meaux, le malheureux ne put rsister la pire de ses
privations d'exil, la nostalgie de ses livres. C'est surtout pour
revoir sa chre bibliothque, ce qu'il dit son ami le chevalier
Journiac de Saint-Mard, dont on connat l'mouvante relation
de captivit, qu'il rentra Paris, o il fut arrt en novembre
1792. C'est sept mois plus tard qu'il fut excut. La vente de ces
livres qui lui avaient cot si cher, commence son domicile,
rue du Mail,
no
19, le quintidi 5 frimaire an IV (jeudi 26 novem-
bre
4795), demanda quinze vacations; le catalogue se composait
de 1293 numros. (Lescure, ouvrage cil.)
MH
Dufay dbutait l'Opra-Comique. On donnait la Fausse
Magie dont le morceau principal est Comme un clair, etc. Ar-
rive tout essouffl M. de Narbonne, que la chose intressait. II
demanda vivement Champcenetz :
Mademoiselle Dufay a-t-elle chant Comme un clair?
Non, mon cher, comme un cochon.
Il disait d'un conventionnel envoy en mission dans les Pyr-
nes : Il va btir des cachots eu Espagne. (Louise Fusil, 5^ok-
venirs d'une actrice.)
11
Conversation entre Rivarol, Ghamfort, Champcenetz
et Tilly.
Un soir, j'arrivai chez Rivarol (c'tait, je crois, vers la moiti
de l'anne 1791, rue Notre-Dame des Victoires). II tait dans un
(1)
Mmoires el correspondance de Mallel du Pan, t. II,
p.
4oa.A.
4 10 RIVAROL
aijpai'tement assez mal clair, avec MM. de Champcenetz etCham-
iort. Je parvins dans la pice voisine, sans tre aperu
;
lui, par-
lant avec son bonheur, sa rapidit et sa maj^ie accoutumes; eux
l'coutant avec une attentive admiration. La conversation, qui
avait certainement commenc par quelque dissertation sur la sou-
verainet du peuple (sujet ternel de ses penses et de ses discours
alors, comme lasrrammaire et la langue l'taient devenues dans les
dernires annes de sa vie), s'tait porte sur les obligations
que
les modernes ont aux anciens, et je me rappelle que Rivarol, par
une de ses phrases dont le tour est si facile reconnatre, pour
ceux qui ont vcu avec lui, s'tait rsum par ces mots: Et c'est
un bonheur pour la plupart des crivains d'aujourd'hui, d'avoir
de la mmoire, comme c'est un malheur pour leurs lecteurs.
Je crois que je ierais mieux de rapporter, peu prs, tout le
dialogue de ces messieurs, et de lui donner, autant que je le
pourrai une telle distance, l'ordre et la forme qu'ils lui donn-
rent eux-mmes
;
car je ne me dfends point d'avoir de la m-
moire (quoique j'en aie perdu, peu prs de quarante ans, la
meilleure partie). J'en ai comme en ont et doivent en avoir tous
les gens qui ont quelque esprit, et j'expliquerai tout l'heure mon
ide, en disant ce que je crois qu'est la mmoire.
Champcenetz . Ah ! ah ! ah ! il serait bienheureux que M. de
la Harpe n'et jamais rien lu, et que le vicomtede Sgur et l'abb
Dilla n'eussent jamais caus ensemble !
Cliumjort. Vous tes trop svre pour La Harpe, mon cher
marquis.
Riuarol.
Et trop indulgent pour les deux autres.
Champcenetz.
Pourquoi donc ?
Rivarol.
C'est que vous parlez d'eux.
Champcenetz.
Une fire mmoire, c'est Tilly
;
on n'a pas
d'ide de tout ce qu'il a retenu !
Chamfovt.
Il a mieux que cela
;
beaucoup d'esprit et d'ima-
gination, du feu, et de la force.
Champcenetz.
Observez, je vous prie, que la plus grande
partie de tout cela se passe en citations. Ce sont, au jargon des
femmes prs, des lambeaux de posie, des morceaux de prose
;
et
puis, pour se donner l'air d'un savant en ns
,
il vous cite Horace,
A'irgile, et des passages de Tacite, o Martin l'a assur l'autre
jour qu'il
y
avait un barbarisme dont ce pauvre Tacite n'tait pas
complice.
Rivarol (en se frottant le visage) .
Au moins n'est-ce pas
l un effort de mmoire?
Champcenetz.
Il vaudrait mieux tre Tacite que de citer
Tacite comme a.
Chamfort.
Le comte de TilIy n'aurait pas dit cela !
Champcenetz (riant).
Vous le protgez,
1
APPENDICE
^11
Chamfort .
Cela ne me conviendrait pas, mais
je lui recon-
nais de l'esprit; et s'il tait n dans une classe
obscure, et (ju'on
j)t lui donner srieusement le e:ot du travail et la patience de
rupj)lication, je suis convaincu ju'il serait un crivain
distingu,
cl lui-mme un homme citer. Est-ce que vous trouvez sa con-
versation trs ordinaire
'!
Champcenetz.
iMoi ! point du tout
;
je la trouve souvent fort
extraordinaire.
Rivarol. Bravo ! appuyez mon neveu
;
vous faites des mer-
veilles !
Chamfort.
Je vous ai cru de ses amis.
Rivarol.
Il vous demandera ce que c'est que cela.
Champcenetz.
Mais oui, assez. Est-ce
qu'on est l'ennemi
d'un homme pour lui trouver plus de mmoire
que d'esprit ?...
(juoique je ne dise pas qu'il en manque.
Chamfort.
N'allez pas vous brouiller,
car il vous contestera
)eut-tre l'une et l'autre.
Champcenetz. Je dirai du mal de vous dans\e Petit Gautier.
Chamfort.
Et si aprs vous avoir lu,
je ne trouve pas que
vous ayez dit du mal de moi?
Champcenetz. C'est trs joli! Mais
que diable,Rivarol,vous
ne dites rien : il n'y a pas de plaisir. J'avais
commenc pour vous
mettre en train.
Rivarol.
Les ^ens qui sont livrs aux femmes ne font rien
qui vaille. Tant de mollesse et de dissipation
tueraient le talent le
])lus robuste. Il est clair que Tilly n'est pas n sans moyens et
sans facilit : il a surtout de la force. Vous le vovez bien, vous
dont il rit quand vous ne voulez pas, et qui ne le faites pas rire
({uand vous voulez. Il a d'ailleurs assez d'instruction
pour vous
donner l'air d'un ignorant... Allons, n'en dites pas trop de mal,
car je ne veux pas que l'esprit de contradiction
m'gare jusqu'
prendre son parti.
Chamfort.
Ah ! ah !
Champcenetz. Me voil bien arrang!
C'tait bien la peine
1'
vous demander votre opinion.
Tilli/ (entrant). Tu dis donc que je n'ai que de la mmoire,
toi dont tout le mrite se compose des larcins
de la mienne !
Rioarol. Ah! bonsoir.
J'illy. Oui te l'a dit ? Tu ne sais pas lire : tu parles de cita-
tions, t'y connais-tu ?
Champcenetz (Tiam).
Je te prviens que tuesfch,et qu'une
plaisanterie...
Tilly. Ton rire est pais comme toi, et tes plaisanteries
minces comme ton esprit. Au reste, je te dirai que j'en fais peu
de cas, de cet esprit... Je le mprise mme, depuis qu'on t'en
trouve,
4
1 2
rtIVAROL
Rivarol.
Messieurs !
Champcenelz.
Laissez donc, c'est amusant.
l'illy.
Je te dfie de me le rendre, car un sot m'ennuie tou-
jours
Champceneiz .
C'est de bon ton.
Tilly .
C'est tout ce qu'il faut pour aller son adresse.
Champceneiz.
Monsieur de Tilly, vous me ferez raison.
Tilly.
Monsieur de Champcenetz^jevous ferai raison, et, qui
plus est, je vous ferai justice.
Ckamfort.
Mais, messieurs, c'est une scne...
Rivarol.
D'honneur, c'est le comble du ridicule. Comment
vous fchez-vous d'une chose qui dans le fond ne signifie rien?
et puis... On n'coute point.
Tilly.
On ne peut faire que cela avec vous qui parlez tou-
jours. C'est une espce d'usurpation qu'au moins ce que vous
dites justifie.
Rivarol.
La louante est un charmant correctif.
Champceneiz.
Oui, oui
;
mais vous tes un u... u... u.
.
.
usurpateur.
Rivarol (riant). Et vous un bgayeur, mais cela vaut encore
mieux que de prendre de l'humeur.
Chamf'ort.
Personne ici ne songe en avoir.
Chumpcemtz.
Nous jouions au proverbe.
Rivarol (s'adressant moi). Riez donc.
Tilly.
De quoi?
Rivarol.
De vous, pour vous tre mis fort mal propos en
colre.
Champceneiz.
Qui t'empche de rire de moi ?
Chamfort.
On ne saurait se sacrifier de meilleure grce.
Tilly.
C'est sa tactique ordinaire, defyire les honneurs de sa
personne, pour ne rien pargner dans celle des autres.
Champceneiz.
Eh bien ! il faut me prendre au mot, sur ce
que je dis de moi-mme.
Rivarol.
Et regarder tout le reste comme une fiction.
Champceneiz .
Mais voil une affligeante ralit ! il pleut
verse.
Rivarol.
Le comte de Tilly est en cabriolet : je suis sr qu'il
vous ramnera.
Tilly. Et M. Chamfort aussi.
Rivarol.
C'est inutile; la pluie le connat.
Tilly.
Le moyen d'tre trois dans un cabriolet, avec M. de
Champcenetz !
Champceneiz.
Une pigramme ! Cesi un rien... mais a
plat.
Tilly (riant).
Je vous ramnerai ce soir; mais je te tuerai
demain.
APPENDICE
4*3
Champcenetz.
J'aime mieux que tu me tues ce soir, et que tu
me ramnes demain.
11 fallait rire et s'embrasser; ce fut la fin de cette ridicule soi-
1' e
; ridicule, parce que j'eus celui de me pi({uer, dans un accs
de cette sotte vanit, de ce dont j'aurais d m'accuser, et faire
mon profit en cultivant davantage ma mmoire, s'il avait raison,
ou en montrant un autre jour plus d'esprit, s'il avait tort.
(Tilly, Mmoires.)
12
Dialogue entre le comte de Lauraguais
et l'abb Sabatier de Castres
M. de L.
... A propos, que pensez-vous du silence de l'au-
teur du Journal politique national?
L'abb.
C'est que je ne suis plus avec lui; j'tais le soufflet
(|ui excitait le feu.
M. de L.
Beaucoup de curs de province s'imaginent que vous
y
avez travaill.
L'abb.
C'est qu'il
y
avait mon nom.
M. de
L.
Ou ils sont btes!
L'abb.
Je crois que vous m'insultez, monsieur le comte ?
^f. de L.
Je suis sr du contraire. Mais savez-vous que j'ai
rellement travaill ce journal ?
L'abb.
Vous, monsieur le comte ?
M. de L.
Moi. L'auteur est rest chez moi un au, ]\ani-
camp.
L'abb.
Qu'est-ce que cela prouve ?
M. de L.
Tout, quand on a le ^'nie que j'ai.
L'abb.
Mais, n'avez-vous pas fait Jocaste ?
M. de L.
Et vingt autres ouvrages, en littrature et en poli-
tique. Je suis aussi bien connu Londres qu' Paris.
L'abb.
Oui, monsieur le comte, votre nom est fort connu
;
mais, permettez-moi de vous le dire, je doute un peu que l'auteur
du journal ait laiss mler votre style au sien; il est dlicat sur
le style.
M. de L.
Il l'a bien fallu; moi, c'est lui; lui, c'est moi;
nos deux esprits n'en font qu'un
;
c'est un mariage spirituel, une
homognit parfaite.
L'abb.
Mais prsent que vous ne le voyez plus?
M. de L.
C'est gal
;
ce qu'il fait est moi
;
c'est toujours
nini. Il n'a pas une ide qui ne m'appartienne
;
c'est une inspa-
rabilit inconcevable.
4l4 RIVAROL
Vabb.
Je la conois trs bien. Mais pensez-vous qu'on voi
croie dans le monde?
M. de L.
Personne n'en doute
;
je le dis qui veut m'en-]
tendre.
L'abb.
Tenez, monsieur le comte, je suis gascon : conve-
nons d'un fait. Avouez-moi que vous trompez vous-mme et qu<
vous avez voulu partager les succs de l'auteur du journal, e(
moi je vous avouerai autre chose.
M. de L.
Quoi ?
Vabb.
Allons, monsieur le comte, vous avez du s^nie,]
l'auteur n'a que de l'esprit : laissez-le-lui et gardez l'autre. Avouez.
M. de L.
Je conviens que... j'ai du gnie, mais il est pni-
ble de dire que... cependant, quant au style, je n'y suis pour
rien, mais pour les ides, je n'en conviendrai jamais. Je fais un
ouvrao'e qui prouvera...
Vabb.
Ce qui est prouv. Tenez,voici le mot, je suis franc :
vous avez voulu partager ses succs, et moi son argent. N'en
parlons plus. Je suis votre valet, monsieur le comte.
M. de L.
... Adieu, monsieur l'abb.
[Le Journal-Pie, 28 janvier
1792.)
13
Pamphlets contre Riva,rol
I
Antoine Rivarol, ayant fait d'assez bonnes tudes, fut destin
de bonne heure par son pre l'tat ecclsiastique. Son pre,
malgr sa dtresse, avait fait de grands sacrifices pour son du*
cation
;
il fut envoy au sminaire de Sainte-Garde Avignon, lors-
que j'tais moi-mme celui de Saint-Charles de la mme ville.
J'obtins la permission de l'aller voir, comme tant du mme pays,
et surtout pour lui demander des nouvelles des respectables pa-
rents que j'ai encore Bagnols
;
il m'en donna de satisfaisantes
;
il vint me voir son tour. Nous emes l'un pour l'autre non pas
une troite amiti, le temps ne nous permit pas d'en resserrer les
nuds, mais une estime rciproque et sentie.
Quelquefois nous nous pi-omenions sur les remparts d'Avignon,
si bien conservs et si clbres dans toute la province; et comme
Pvivarol avait la plus belle figure, la plus belle taille et la dmarche
la plus noble, quelques dames s'criaient en le voyant- passer :
(( Voil le bel abb du sminaire de Sainte-Garde. Il yen
avait mme qui, entranes par l'admiration, le suivaient des yeux
en soupirant, et d'autres qui l'accompagnaient jusqu'aux portes de
son austre demeure.
APPENDICE
4 '5
On trouvera peut-tre minutieux que je parle ici de la figure
de Rivarol
;
mais une belle figure intlue plus qu'on ne le pense
Bur les destines d'un homme; et celle de Rivarol lui valut des
bonnes fortunes, que je raconterais s'il n'avait pas eu d'autres
mrites, et s'il n'eut t qu'un hros de ruelles ou un petit-matre.
Plutarque, d'ailleurs, ne parlc-t-il pas plus d'une fois de la beaut
d'Alcibiade ? Kivarol avait avec ce dernier plus d'une ressem-
blance
;
il tait loquent comme lui, et comme lui, il savait se plier
aux murs et aux usac^es de tous les pays o il allait...
... Rivarol avait connu Versailles une dame ({ui n'tait ni jeune
belle, et l'avait trouve fort jeune et fort jolie; elle s'tait arran-
Ee
avec lui comme alors s'arrans^eaient certaines dames
;
elle lui
onnail la table, le loE^cment : bref, ils partageaient ensemble tout
qui tait susceptible de partage. Ce enre de vie plaisait assez
Rivarol, qui, naturellement paresseux, aimait cueillir des roses
pourvu qu'elles fussent sans pines. Un incident (ju'il aurait d
prvoir, vint tout coup troubler son bonheur, et lui prouva qu'on
pique le bout des doigts, mme en cueillant les roses les plus
les. Ce fut un rival qui causa son infortune, et quel rival encore !
apothicaire!... Oui, le croira-t-on
'?
Ce fut un apothicaire qui
lui enleva sa conqute suranne, et qui, jaloux de ses succs, vou-
lut mme lui enlever la vie... Rivarol hassait autant les procs
criminels qu'il aimait le repos
;
il aurait pu traduire devant les
tribunaux un homme qui l'avait attaqu avec un tube beaucoup
plus dans^ereux qu'une serini^ue
;
il lui cda sa Dulcine, et vint
Paris rire avec ses amis de son aventure. Il tait pauvre ccpen-
iant, et presque dans l'indii^ence
;
ses amis lui prtrent de l'ar-
Bpent, et il leur tmoigna sa reconnaissance avec tant de grce,
qu'ils le remercirent de l'avoir accept. (Cubires-Palm-'eaux,
Vie d'Antoine Rivarol)
(1).
II
Ce grand seigneur pimontais, n en Languedoc, et perdu
dans Paris depuis quinze ans, n'est pas encore aussi connu qu'il
le mrite. On sera bien aise de trouver ici quelques dtails sur sa
personne.
Les grands hommes du dix-septime sicfe allaient au cabaret;
eelui-ci
y
est n
(2).
11 en sortit pour former son gnie adolescent
(i) Cet crit de Cubires, sans on avoir le ton. est un pamplilet; du
moins est-il difficile d'accepter des anecdotes connues par celte unique
source. Toujours les suites du Petit Alnwniclt.
(a) Le nomm Riverot, pre de >L le comte de Rivarol, tait auber-
^ste dans le bourtj de Ba^nols. Il a exerc cette profession hospitalire
avec une noblesse qui prparait celle de son fils. A.
4l6
RIVAfVDL
dans une tude de procureur. C'est ainsi que dbutent les nobles
srnois et les patrices romains. Du silence de l'tude il passa au
bruit des armes, et, malor sa baute naissance, il voulut, comme
Pierre le Grand, commencer par lre simple soldat.
Ami prcoce le l'antithse et des travestissements, aprs avoir
quitt la plume pour l'pe, il quitta l'pe pour le petit collet :
il fut prcepteur Lyon, puis bourg-eois Paris, puis grand sei-
gneur Versailles, puis journaliste en Amrique, puis mari en
Angleterre
(1).
On voit qu'il a, pour parler sa langue, voyag dans toutes les
conditions. L'empire de Sottise n'a pas un coin qui ne lui soit
familier, avantage inestimable pour piquer les e^ens l'endroit
sensible. La fortune s'est plu lui donner l'ducation de la satire,
comme la nature lui en avait form l'heureux temprament.
Aussi sa vie n'est qu'une raillerie continuelle. 11 serait facile de
rapporter toutes les bonnes plaisanteries qu'il a faites une foule
d'amis, de bienfaiteurs, de cranciers (2), mais c'est del gaiet
de ses crits, et non de ses actions, que le public a besoin.
Et d'abord, il est sr que M. le comte n'a pas se reprocher
d'avoir jamais crit autre chose que des satires. Son discours sur
la langue franaise n'est au fond qu'une longue ironie, une cari-
cature bizarre, dans laquelle il se moque de la langue italienne,
de la langue espao^nole. et encore plus de la langue franaise.
Plusieurs personnes le devinrent la bigarrure des styles, aux
anachronismes, aux plagiats, au tortillage des ides et au gro-
tesque des expressions
;
mais le grand nombre prit la lettre
celte bouffonnerie srieuse. 11 faut convenir ({u'il est bien gai un
jeune gentilhomme de mystifier, pour son dbut, deux grandes
villes comme Paris et Berlin.
Sa traduction du Dante tait un nouveau persiflage contre l'Ita-
lie et la France
(3).
Celle plaisanterie n'eut point le succs de l'au-
{i) \\ pousa la fille d'un matre de langue anglaise : elle lui apporta
en dot la grammaire de son pre
;
mais elle ne s'en tint pas l, jI se
trouva qu'elle desccndaiL de la maison de Saxe, comme son mari des-
cendait d^ la maison de Savoie. A.
(2)
Voici l'espieLjderie qu'il a (aile la dame Meunier, aubergiste de
Fontainebleau. M. le comte, sa disne pouse, son noble fils et une ser-
vante taient lo'z.s et nourris chez elle depuis six semaines. Tout
coup, M. le comte va Paris pour un jour et ne revient point; huit
jours aprs, madame la comtesse part et ne revient plus : l'enfant reste
seul pour caution. Les Esryptiens mettaient en e:a:^e les momies de leurs
anctres: le vaillant Albu juerque
y
mit sa moustache. M. le comte n'a
ni moustache ni momie
;
mais il a un fils qu'il expose dans les grandes
occasions. A.
(3) M. le comte disait plaisamment qu il avait traduit ri^/i/e/' duDante
parce qu'il
y
retrouvait ses anctres. A.
appi;ndick
/jiy
tre; les Italiens et les Franrais en curent le vent, et ne la lurent
point de peur d'tre attraps.
Nous ne parl<M'ons pas ici rie son dialo2^ue entre le chou et le
navet : c'est une sorte de fumier (ju'il jetait sur les Jardins de
M, Delille pour les faire mieux fructifier; mais il cacha trop hien
-ts intentions amicales, et on prit btement cette espiglerie pour
1 radotasse de l'envie et du mauvais ot.
Opendant VincofjnHo de ses malices l'ennuya, et, renonant
^jouissances obscures, il voulut rire des
cens en plein jour :
alors parurent ses admirables parodies, g-enre si noble et si difH-
( ile, comme chacun sait. On distini^ua celle iVAthalie; clic avait
h' mrite de tuer en mme temps Racine et BufTon.
C'est de l que, par une ascension inconcevable, il s'est lev
Jusqu'
la haute conception de son Petit Almanach. Sa maie
cra tout coup un peuple de grands hommes. Deucalion jetant
des pierres derrire lui, et Jupiter transformant les fourmis en
hommes pour repeupler l'le d'Egile, parurent moins fconds
;
fcondit d'autant plus merveilleuse qu'elle ne lui cota qu'une
seule plaisanterie . une seule plaisanterie a rempli deux ou trois
cents pages. Son talent procde comme la nature : conome dans
les moyens, prodiscue dans les formes.
Cependant,quelle que soit sa facilit, il ne se repose point sur elle
^t^ule, et il se prpare de loin la moindre bagatelle. Croirait-on
o'il a, pendant neuf mois entiers, couv la prodigieuse nomen-
iurc de son Petit Almanach? Ses ides s'laborent en secret,
isuite il les passe la filire de la conversation : il essaye ainsi
Ji's petites gaiets qu'il destine la presse
;
il rcite son esprit
avant de le vendre
;
il babille d'avance tous ses pamphlets, et il
improvise le libelle avec une prestesse qui laisse bien loin de lui
les Corilla et les Baldinotti.
Comme toutes les grandes plantes, il a ses satellites. Le prin-
cipal satellite de M. le comte est le marquis de Champcenetz. On
sait combien son gros rire est encourageant pour un homme
d'esprit
;
et, dans ce sens, il est fort utile notre auteur : c'est
tantt un prlude qui l'inspire, et tantt un accompagnement qui
le soutient.
C'est ainsi qu'il a coopr au divin Almanach
;
il
y
a mme
fourni de compte fait trois calembours et six des noms les plus
baroques
(4).
^(Crutti, Satires des Satires.)
(i) La critique que Cnitli fait du style de Rivarol tmoicrne de la
surpriseque provoquait son oricrinalit de pamphltaire: il numre, avec
des intentioDs mchantes, d'excellents motifs d'admiration :0n connat
ce style : on sait qu'il s'est fait une lanue neuve, rare, leste, et pour
ainsi dire sans prjugs : ce n'est point celle qu'on a parle, pas plus
48 f^fVAROL
III
Crutti et Cubires ont crit ensemble un autre libelle contre
Rivarol, Les Bagnolaises ou Etrennes deM. le comte de Rivarol
prsentes Son Excellence par une socit de grands homme*
{ij8g). Ce livret est trs rare. M. Andr Le BVeton, qui en a
donn l'analyse {Rivarol,
p. 165), le juge tel qu'un a tissu, d'in-
ventions ou d'insinuations sclrates , une vilenie )>, d'ailleurs
drle.
(I
Les Bagnolaises, dit-il encore, pourront passer pour le
f)lus
bel effort intellectuel dont des gueux de lettres, atteints dans
eur vanit, aient jamais t capables. Mais Rivarol a tenu tle
tout, seul contre la canaille littraire, sous une grle d'injures
ou de menaces, sans autres armes que son esprit et sa gat.
Chnier, le frre d'Abel, comme disait plus tard Rivarol, s'est
galement veng des pigrammes bien modres du Petit Alma^
nacli dans un violent Dialogue du public et de Vanonyme. Les
. C. le donnent, tome Y, ainsi que la Confession du comte
Grifolin, autre libelle, crit par Cubires sous la direction de
Beaumarchais, et plusieurs autres pices, plutt sottes que
mchantes. C'est ces crits agaants que s'adresse le morceau
des Aveujc ou rArche de Noe, qui figure dans les rditions
du Petit Almanachy et que nous donnons
p.
100.
Universalit de la langue franaise.
Le discours de Rivarol n'a plus gure qu'un intrt littraire et
philosophique. Sur l'universalit de notre langue depuis les temps
anciens, voici des tmoignages prcis, tirs de l'excellente
Grammaire historique de Kr. Nyrop (Copenhague et Paris,
4899) :
I
PRIODE ANCIENNE
On connat le sort merveilleux de l'ancienne littrature
franaise. Admire et envie par toute l'Europe, elle fut vite
traduite en beaucoup de langues, et les fiers hros des chansons
que celle qu'on parle, mais c'est probablement celle que l'on parlera un
jour. On est sr d'y trouver celte foule de termes scientifiques usurps
sur les arts, ces msalliances fantasques, ces tmrits libertines du
nologisme, enfin ces dbauches du lanerage qui nous sauvent de la sa-
tit du bon g'ot et de l'ennui du naturel.
(le
i^estcs
et les gracieuses, hrones des fornans d'aventures
lurent connus des les lointaines de l'ocan Atlantique boral jus-
(ju'aux pays indilerranens.
Voici quchjucs tmoinag'es (jui attestent l'universalit de la
langue fran(;aisc au moyen-j^e.
En Angleterre, que les Normands avaient conquise en chan-
tant la chanson de Uoland, le franais gagna vile du terrain,
surtout dans les classes leves. On lit dans la Chronique de
Robert de Gloucester (xiip s.) :
(( Ainsi l'Angleterre vint au pouvoir des Normands.
Et les
Normands ne savaient parler que leur propre langue.
Et ils
riaient comme chez eux, et apprirent la mme langue leurs
l'ants.
De sorte que les grands seiG;neurs de ce pays, qui
cil scendent d'eux,
maintiennent tous la langue qu'ils firitrent
d'eux.
Car si un hommene sait pas lefranrais, on le mprise.
(( Le franais d'Angleterre, l anglo-normand, tait regard
comme assez grossier en comparaison du franais du continent.
Cilons, parmi d'autres tmoignages, quelques vers de l'introduc-
lioii des Canterbiiry Taies o Chaucer dit de la Priorvss:
a Et franais elle parlait trs bien selon l'cole de Stratford, car
le franais de Paris lui tait inconnu.
Le prestige du franais tait si grand que mme des auteurs
ulais s'en servent, en abandonnant leur langue maternelle. C'est
.i l'ranais que Mandeville a cont ses voyages et que Gower a
r.iit plusieurs de ses posies. Encore sous Edouard
1er
(1272-
ioOl), le franais tait la langue officielle...
En Italie, o les chansons de geste pntrrent de trs bonne
heure, Brunetto Latini, le matre de Dante, se sert du franais
en rdigeant sa grande encyclopdie Li Trsors (environ
1265)...
lu autre Italien de ce temps-l, Martino da Canale, dit dans
l'introduction de la Chronique vnitienne : Par ce que lengue
Iranceise cort parmi le monde et est la plus delitable lire et
or que nule autre, me sui je entremis de translater Tanciene
estoire des Veneciens de latin en franceis. Rappelons encore
que les voyages de Marco Polo et les compilations des romans de
la Table roncle par Rusticien de Pise sont galement en franais.
Pour l'Allemagne, nous avons les vers d'Adenet le Roi, o il
nous raconte que les enfants d'outre-Rhin avaient des prcepteurs
franais:
Avoitune coutume eus le tiois(i) pais
Que tout li e:rant seignor, li conte e li marchis,
Avoicnt cntour aus gcnt Franoise tous dis
Pour aprcndre franois lor tilles et lor fils.
Berthe aux grands pieds (v. i48).
() Ancienne forme franaise de deatch.
^20
RIVAROL
Pourtant le tmoignage le plus curieux de l'universalit
de
la langue franaise se trouve dans le Komings-Skiiggsj
{Sp-
culum re^a/e). L'auteur de cette encyclopdie pdagogique, crite
en Norvge vers la fin du xiir- sicle, fait dire au pre qui enseigne
son fils: Et si tu veux tre parfait de science, apprends toutes
les langues, mais avant tout le latin et le franais, parce qu'ils
ont la plus grande extension.
(( Avec la conqute de Constantinople
(1204),
le domaine du
franais s'tend dans l'Extrme-Orient de l'Europe; une grande
partie de la pninsule des Balkans est sous la domination de
princes franais, et le chroniqueur catalan Ramon Muntaner
constate (environ
1325)
qu'on parle dans la More un franais
aussi pur qu' Paris:
.
.. E parlanen axi bell frances com dins
en Paris.
Le franais se rencontre aussi hors des limites de l'Europe;
il est parl ds le commencement du
xiie sicle dans le royaume
franais de Jrusalem et en Chypre. Philippe de Xovarre, italien
de naissance et domicilie en Orient, compose en franais tous
ses omTages : Assises de JrusalerUy Gestes des Chiprois, les
Quatre ges de l'homme.
a Ajoutons que ce n'est pas seulement pour la langue et la
littrature que la France donne le ton, c'est aussi pour les modes
et les manires de vivre. Dans Girart de Jioussillon, un chevalier
est conr (quip) la guise de France y>
;
un roi anglais prend
pour chapelain un clerc franais, quia francicam eiegantiam
TiO/'a/ (Guibert deNogent(i).
II
PRIODE MOYENNE
Hors de France, la connaissance du franais tait trs rpan-
due, surtout au xvie sicle
;
ainsi qu'au moyen-Age, on le regar-
dait toujours comme la langue la plus dlitable our. En 1.549,
Pelletier crit : En Angleterre, au moins entre les princes et en
leurs cours, ils parlent franais en tous leurs propos. En Espa-
gne, on
y
parle, ordinairement franois es lieux les plus clbres.
A la cour de l'empereur, on n'use, pour le plus, d'autre langage
que franois. Que dirai-je de l'Italie, o la langue franoise est
toute commune ?
(2;
Un autre grammairien, Pillot, crit dans
(i) A la mme poque, des mots franais pntrent en grand nombre
dans les autres lanerues europennes, notamment dans l'allemand, qui
nou9 emprunte mi'-m un sn^xederen). On peut encore crire en anglais
en n'usant presque que de mots d'origine franaise.
(2^ On n'a pas respect, en citant M. Nyrop, lorthographe rforme de
Pelletier.
APPENDICE
421
sa Gdllic lanffii inslilaUo
i
l.joO) : On ne rencontre aujoiir-
dhni, non seulement en Allemagne, mais encore dans tonte
lliropc, ({ue trs peu d'hommes qui ne veulent pas que leurs
cnlants apj)rennent le fran(;ais. Ceux (jui sont nobles compren-
nent que rien n'est plus utile pour accrotre la considration,ceux
qui ont quelque fortune
y
voient un moyen d'arriver aux honneurs,
ceux qui sont pauvres pensent aui^menter par l leur avoir. A
]a Hn du sicle, le flamand Mellma dit en tte de son diction-
naire flamand-fran(;ais : La trs noble et trs parfaite lantue
Iranroise rgne et s'use pour la plus commune, la plus facile,
\ oir la plus accom[)lie de toutes les autres en la chrtient .. Si
nous en voulons juger sans passion, il nous faudra confesscrquc
tous les Flamengs, avec leur seize provinces nommes le Pays
Jias, s'en servent, quasi comme les Valons et Franois mesmes,
(S marchs, es foires, es cours, les paysans en assez grand nom-
bre, les citoyens et les marchands pour la plus part, les gentils-
Iiommes : brief les parlements et secrtaireries, le clerg avec les
<^studiens. Ouelqu'uns en Canarie, aucuns en Perse, et en Afri-
ijuc, comme Tripoli, Alger et Faiz, l'usurpent par ouy dire.
Puis grande partie d'Alcmaigne, du pays de Levant, de Masco-
vie, de Pologne, d'Angleterre et d'Ecosse usent de ladite langue.
Le mcsme se fait en Italie en maincts endroicts, mesmement en
Insubria, Piedmont et Lombardia, sans que je di de la Turfjuie
t't d'Egyj)te, comme Caffa, Pera, Tripoli asiatique, Aleppo
et Alcaire ou Alexandrie.
III
PRIODE CLASSIQUE
Pendant la priode classique, o la civilisation franaise est,
pour toute l'Europe, lacivilisalion, et o Paris est la capitale de
l'intelligence, le prestige de la langue est aussi universellement
(iabli. Grimarest, le biographe de Molire, n'exagre rien quand
il dit : La langue fran(;aise est aujourd'hui de tous les pays et
(le toutes les cours trangres : et il ajoute sagement : L'on
ne saurait se donner trop de soins pour la perfectionner, de ma-
nire qu'elle soit toujours prfre, comme la plus propre pour
sexprimer naturellement. Toutes les belles qualits qui distin-
guent la langue du grand sicle taient si gnralement reconnues
(ju'en 1784 une acadmie trans^re, celle de Berlin, mit au con-
cours les trois questions suivantes : Qu'est-ce qui a rendu la
langue franaise universelle ? Pourquoi mrite-t-elle cette prro-
u^'^tive ? Est-il prsumer qu'elle la conserve ? ^) Rivarol rpondit
ces trois questions par son Z>/5C0Mr5 sur l'universalit de la lan-
gue franaise, qm gagna le prix. Il formulait ainsi sa thse : La
24
42 2
RlVAtlOL
langue franaise est de toutes les langues la seule qui ait une
probit attache son gnie. Sre, sociable, raisonnable, ce n'est
plus la langue franaise. C'est la langue humaine. )) En effet la
langue franaise jouit aux xvii* et
xviiie sicles de l'universalit
dont jouissait au moyen-ge le latin. Elle l'a remplac, dit M.A.
Rambaud, comme langue de la diplomatie, des cours, de la
philosophie, des sciences, de la socit, au point que les aristocra-
ties europennes en oublient leur langue nationale. Quelques-
unes des belles ceu^Tes des sages trangers, comme la Thodicc
de Leibnitz, beaucoup de mmoires scientifiques des acadmies de
Prusse, d'Italie, de Russie, sont rdigs en franais. La langue
la plus familire Frdric II ce n'est pas l'allemand; Cathe-
rine II, ce n'est pas le russe
;
au roi Stanislas Poniatowski, ce n'est
pas le polonais
;
Gustave III, ce n'est pas le sudois. Presque
toutes les uvres du roi de Prusse, ses posies, sa correspondance
politique et littraire, ses dialogues, ses prcieux mmoires sur
son propre rgne, sont rdigs en un franais lgant et prcis.
C'est la langue que la jeunesse apprend dans les collges de tous
les pays, immdiatement aprs la lanoue maternelle et parfois de
prfrence aux langues classiques. Surtout elle est la langue de
la raison, cette matresse des temps nouveaux, une sorte de lan-
gue sacre pour les libraux de tous les pays, comme l'arabe l'est
encore pour tous les sectateurs du Koran.
IV
PRIODE MODERNE
Le prestige de la littrature franaise est, dans notre sicle,
peut-tre encore plus rand qu'au sicle prcdent. Les grands
matres modernes jouissent partout d'une rputation incontes-
te
;
ils sont lus, tudis et apprcis, non seulement en Europe,
mais dans toutes les cinq parties du monde, et leur influence sur
les ides est incalculable. Quant la langue elle-mme, son
emploi parat un peu moins gnral qu'autrefois
;
nombre de ses
langues nationales, qui ont pris conscience d'elles-mmes au
commencement de notre sicle, s'opposent nergiquement l'in-
vasion du franais et sa prpondrance; hors de l'Europe, l'an-
glais et l'espagnol font une rude concurrence au franais comme
langue universelle . Mais si le franais n'est pas la langue inter-
nationale des relations scientifiques et commerciales, il soutient
firement sa prdominance dans tous les autres domaines, mal-
gr bien des attaques
;
il est encore, comme dirait Rivarol, la
langue humaine et ce prestige est fond sur des causes natu-
relles et profondes : a elle se prsente, a dit un lettr du cleste
Empire, comme une belle femme, toujours gracieuse et aimable,
APPENDICE
4^3
qui, sans laisser voir que telle est sa prtention, sait qu'elle a droit
au succs, parce qu'elle est souverainement charmante.
uvres de Rivarol
Le catalogue critique des uvres de Rivarol a t dress avec
beaucoup de soin par M. Le Breton. Nous lui empruntons les
lments de cette liste, en
y
ajoutant quelques remarques nou-
velles .
4o
Mercure de France.
De 1779 1782, quelques conqitcs-rendus de livres peuvent
tre attribus Rivarol. Voici les plus certains :
25 fvrier 1779 : Thtre de AL Laus de Boissy.
25 septembre 1779 : Essais historiques, littraires et criti-
ques sur Vart des accouchements, etc., par M. Suc le jeune.
Article amusant.
23 et 30 dcembre 1780 : Rcrations dramatiques ou choix
des principales tragdies du grand Corneille, auxquelles on s'est
permis de faire des changements, etc., prcdes de quatre tra-
gdies de Vditeur.
L'une de ces trai^dics nouvelles. Les Comnnes, est un plagiat
iIrne. L'auteur dit, en note : Les deux productions n'ont de
commun que le nom de quelques personnages. Le critique
rpond : Nous pensons comme lui.
De la seconde tragdie, Terentia, il cite ce vers.
11 aime en vain; que peut importer?
Il importe,
et ajoute : Que peut importer? Il importe. On ne s'attend pas
ces coups de force, ces traits sublimes de dialogue. Mais
ces ressources sont familires l'auteur.
Plus loin, sur un dlayage d'un passas,e de Britannicus : On
ne peut pas se mprendre cette imitation. Nous observons seu-
lement que Racine a mis beaucoup moins de vers. Racine avait
moins de fcondit.
17 f\Tier 4781 : Sur une Traduction en vers de TAriosle.
16 juin 1781 : \JArchitecture, pome en trois chants, par
M. Maillier.
1-4 juillet 1781 : Le Nouveau Monde, pome pique, par M. Le
Suire.
2o
Lettre de M. le prsident de
'"
M. le comte de
'"
sur
le Pome des jardins (1782). uvres compltes, t. IL
3o
Le Chou et le Navet, A la suite d'une rimpression du pr-
cdent opuscule : Lettre critique sur le Pome des Jardins,
4^
RlVAROl
sairie dn Chon rt tin Xarrt, pnr M. le ronie do Barrnd (!7S:
. C, t. m. Pins: nrihs Pn^es,
p.
:\H5.
4'^
Ltttrf i) .V. /r Prrsiiirnt de
**
sur le Oiob<' afrsfatt:::
.
^nr irs tHfs pt7 rici rites et sur rtiit prcsfnf dr ropinior:
.
ne Ptiris [J-S,'^),
Osi l qu'on trouve ce jcJi mot : llnViil riei de si ah^t ...
.j
..
la pre.^enoe d'esprit .
>>
;>*'
Dissertations sur rrnversahf He la Lan^jne franais:
.
qn ont partaij ie pn\r adjug par rAi^adnnie roi/nle dis
sciences et heIIes-lettres le S juin i^S4 (Berlin, Deeker. 1\.;
onlre de l'Aendi^nie, 1784^
Li seconde dition parut Pari>
en 1785; la troisime lambonrsc en 17*.^.
C'est ce dernier te\ r
qui e^t donn dans , C. II. et dans /.
B. /*.,
p.
i.
i^^" DialO(jne entre Vo/ta ire et Fontenelle. La premire diti.i.
e^i perdue. Hrimprim par Fayolle (Mlana;>e.s litirairei;, 1SU>\
et par P. Malassis ^^Ecrifs et Pamphlets de Birarol^ 187T .
p, B, />..
p.
;^^.
70
L'Enfer, pome du Dante, tradueiion nouvelle
(1785). ,C.,
m.
'
8*
Epfire au Roi de Prnsse. Ecrite en 1785. Insre, sans T.i-
veu de laueur, dans VAlrnanach des Musej:^ 1786, . C, Hi.
9o
5'//r r ft Epi'tre rAmiti ^>, ine rAdidniie /rancaisc
par M. Dncis. Insr dans le Mercure de France du 80 dceau-
bre 178t. Spectateur du Xord (1797),
premire partie de lani-
ele, rcNiie et corrifi;e; . C, 11, l'article entier mais scinde ci;
deux fraarment^.
lOi^ Sur les Xourean.v Synon./mes franain de M. l'abb Rou-
b.Hud {Mercure de France, 80 dcenlire 1786). . C, 11.
11^ Sur le Discours sur le droit romain destin tre pr.-
nonc derant la facult de droit d'Orlans, par M* Lamb: : :
{Mercure de France, 7 juillet 1787). CE. C, 11.
ii^^ Rcit du Portier du sieur Pierre-Augustin Ca-
.
Beaumarchais
(1787).
Grimm, Correspondance, juin 1787 ; U.
.
cm.
L'exemplaire de la B. N. contient une clef manuscrite de ^ l
petit pamphlet qui est une p.irodie du rcit de Thramne.
13o
Le Somje d'Athalie, par M. G. R. /. M... de la R. E.
y.N.,. (1787\ . C, II.
Cette parodie fut suivie de deux brochures: Dsaveu du sieur
Grimodde la Rci/nire ci Le Vrai dsaveu de la parodie du
sonje (fAthalie et de son dsaveu. On les attribue gnralement
Rivarol, mais eJles contiennent bien de la grosse gal la
Champcenei.
14*^
Le Petit Almmach de non grands hommes, anne lySS
[ilSSy (T. c, V.
; P. B. P..
p.
46.
t
APPEMDICE /}25
i.V Ullre M. Necktr (1788;.
Deux brochures. . C, Il
/^ /?. /'.,
p.
2:7.
I6'> Journal. polUif/ne national ( \'iW.)-WM) . Trois sries. f>a
'.*
(qui n'a que 8
0*^",
au lieu fJe 24)
esf trs rare.
fresque ehaque n'> contienf,, sous le titre rJe lixam,nr\ chapi-
re de I histoire de la rvohjtion, depuis les dbuts jusqu'un peu
pprs les journes d'octobre. Ilivarol a jus qu' ce moment la
royaut tait finie. Ces rsums ont t rimprims en W.fl sous
[le titre de Tableau hf.xtorique et politique des travanx. de
irasuemble, etc. T'er^/ille les a donnn dans sa collection en les
ippelant faussement M^n^oire.t de Rioarol {Wii). Ils sont dans
k^. C, IV'. Les
/"',/?.
P.cji donnent plusieurs extraits,
p.
129
suiv. Le
no
24 de la premire srie est intitul Lettre sur la
ipiure de Vahb Maurrj. f*. fi. P.
p.
175.
Mo
A ctes des Aptres
(1
78r>-i
702 ).
Malgr la tradition qui accole le nom de Rivarol celui de ce
journal, il n'y a presquepas collabor. Il faut laisser la jrloire de ce
)ng et amusant pamphlet aux Peltier,Suleau, Mirabeau, Champ-
frenetz, etc. On lui attribuera avec certitude: len'> 1 tout entier
;
les deux articles sur Robespierre
(nos
5 et
7) ;
Explication
'l'une charade
(no
94; ;
Grande trahison de M. hinochaa
. '
138) ;
hialorjae des morts n*
163);
/.e//re </e M. Villette
f. Pqaet--VEnchre
(no
181),et deux articles qui figurent
ma-
nent dans le Journal politique national. Nous reproduisons,
iir la premire fois, le Dialofjne des morts,
p.
193, les deux
'icies sur Robespierre,
p.
187, Explication d'une charade,
^
. 190, et des fragments,
p.
197.
18o
Petit dictionnaire, des grands hommes de la Rvolution,
par an Citoijen actif, ci-devant Rien (17rX)). Nous en rimpri-
mons, partiellement, pour la premire fois, les meilleurs articles,
p.
201.
19o
Conseils donns S. M. Louis XVI, en i/Qr, par l'in-
termdiaire de M. de la Porte, etc. ;
ouvrage indit dt M. le
comte de Rivarol {\'m)).
Ces Lettres et Mmoires avaient en grande partie t imprims
dans le Recueil des papiers trouvs dans l'armoire de fer
(1793).
Rdit par P. Malassis, Ecrits et Pamphlets de Rivarol. M. Le
Breton a donn dans son Rivarol un mmoire indit qui rentre
dans cette srie. Deux extraits dans les P. R. P.,
p.
219.
20<*
Lettre la noblesse franaise, etc. (1792). Publie par
Peltier dans son dernier tableau de Paris. Vdiilon originale est
perdue.
21
Dialogue entre M. de Limon et an homme de got (1792).
Entirement perdu.
Mm
de Coigny disait de cet crit : . C'est
plus fin que le comique, plas gai que le bouffon, plus drle que
le burlesque.
34.
426
RIVAROL
22o
De la vie publique^ de la fuite et de la capture de M. de
La Fayette [M''l) . . C,
V.
23o
Adresse du peuple belge S. M. l'empereur (1793).
Six pages de style noble, o il n'y a rien du gnie de Rivarol.
2P Portrait du duc d'Orlans et de
J/me
de Genlis (1793). .
C,
V.
;
P. B. A, p. 224.
25
De la littrature franaise en 1788,
Voccasion d'un
ouvrage du
feu
M. de Florian. Ecrit en 1788. Publi en 1797
dans le Spectateur du Nord (t.
^r).L'article, quoi que dise M. Le
Breton, est sign ainsi : Cet article est de M. le comt de Riva-
rol. . C.,ll,P. B. P.,
p.
119.
260 Letti^e sur l'ouvrage de
i^me
de Stal intitul : De Vin-
fluence
des passions. Publi dans le Spectateur du Nord (1797.
t.
Pr)
et sign : Lucius Apuleias. OE. C,
U.P. B. P.
p.
103.
27
Traduction en prose et en vers de quelques fragments de
l'Enide. Dans le Spectateur du Nord, avril 1797.
28
Discours prliminaire du nouveau dictionnaire de la
langue franaise; Hambourg, Fauche, 1797,
in-4.
Rimprim sous le titre de : De l'homme^ de ses facults intel-
lectuelles et de ses ides premires et fondamentales; Paris,
Pougens, 1800, in-4. . C,
L Les P. B. P. en donnent plusieurs
chapitres,
pp.
108, 245 ctsuiv., 287, etc.
29o
Prospectus d'un nouveau dictionnaire. En titre du Dis-
cours , dition de 1797. D'aprs Cubires, il aurait paru spar-
ment ds 1796. . C.,l. (Voir sur ce Prospectus, appendice
no6.)
30o/)e la philosophie moderne, par Rivarol. Seconde dition.
S. 1. n. d. Probablement Hambourg, 1799. Accompagn d'une
Note de l'diteur qui est bien de Rivarol (voir
p. 369). C'est une
rimpression fragmentaire du Discours
;
elle se compose de la
fin du chapitre des Passions et de celui de La Religion, moins
les trois dernires pages. La Prface
n'est que le morceau des
Passions prcdant le passage o commence la brochure. La note
de la fm sur Condorcet et Robespierre est scinde en deux et
lgrement modifie. Une autre dition est date de Paris, 1802.
31o
De la Souverainet du peuple (1831).
Cet ouvrage, publi par Claude Franois, ne peut tre attribu
Rivarol que pour le fonds. Il semble en effet rdig par une
main trangre d'aprs une premire rdaction.
320
De la Souverainet, connaissance des vrais principes du
Gouvernement des peuples, par l'abb Sabatier de Castres
;
Al-
tona, 1805.
Cet ouvrage est un mlange de deux crits indits de Rivarol,
De la souverainet du peuple et Thorie du corps politique,
amalgams avec les ides peu originales de l'ancien associ de
Rivarol au Journal politique. Il contient des pages admirables.
Un critique, bien habitu aux ides et au style de Rivarol, en tire.
APPENDICE
4^7
i;iil des fratmcnls prcieux. Le Iri, nous nous en sommes assur,
n'est pas impossible.
On lit, pa^e 15, une note bien amusante :
(( Dans letemps que cet crivain logeaitchez moi, Versailles:
NOUS avez, me uisait-il, de l'esprit et beaucoup d'ides; mais il
M Mis manque le talent (pii fait le gnie, et c'est ma partie. Vous
trouvez l'or en linu;ols; laissez-moi faire : je le faeonnerai en
meubles, en bijoux et en monnaie.
Rivarol a dit cela eu elVet. C'est un passa;e du Discours pr-
liminaire. Voyez P. 13 . /^.,
p.
Ho.
31 Penses indiles (i836). Rivarol avait laiss quatre Car-
nets de notes, rtlexions, remarques sur toutes sortes de sujets :
telle est la matire originale des Penses indites
;
main l'diteur,
( .laude-Fran(;ois, a remani le texte presque partout, afin d'obte-
nir un Rivarol sage et bien pensant. JM. Le l3reton, (jui a eu les
(Idrnets entre les mains, en a tir d'autlientiques citations
;
on
les trouvera rparties dans les quatre chapitres des P. B . P. o
sont classs des fragments et penses de Rivarol
.
33o
Mmoire politique et philosophique sur la rvolution
des lettres. Ce manuscrit, envoy au roi de Prusse en 1785, n'a
jamais t publi.
3-io
Lettres. Elles sont dissmines dans Cubires, La Pla-
tire, Algrc, Lescure, etc. M. Le Breton a retranscrit cellesque
-M. de Lescure, qui les eut pour la premire fois entre les mains,
s'est amus couper en petits morceaux pour en truffer son
'AYus Riuarol. Les P. B. P. runissent pour la premire fois
toutes les Lettres connues de Rivarol,
33'^
Fiivaroliana. Les mots de Rivarol sont pars dans les
crits contemporains, les journaux,les mmoires, les biographies.
Les . C.,y, en ont recueilli un certain nombre.
Nous en donnons un choix trs tendu et trs au2:ment par nos
recherches personnelles, en distinguant ce qui semble maner
directement de Rivarol, et ce qui est anecdote. La distinction,
parfois arbitraire, a du moins un mrite de clart.
36o
Conversation de Rivarol, note par Chcncdoll, publie
dans le Chateaubriant et son groupe, de Sainte-Beuve. Les
papiers de Chnedoll en contiennent plusieurs autres; on ne sait
ce qu'ils sont devenus. P, B. P.,
p.
370.
37o
uvres compltes. Paris, 1808, o vol. in-8. Ce recueil,
qui devrait plutt s'appeler uvres incompltes, contient en
revanche des morceau apocryphes. La notice qui les prcde est
insignifiante.
38o
crits et Pamphlets de Rivarol, recueillis par A. -P.
Malassis (1877). Les pices rdites dans cette brochure ont t
signales leur date.
39o
uvres de Rivarol (1857), Sous ce titre fallacieux furent
428 RIVAROL
runis par Delahavs des fra2:ment informes et minuscules
de
Rivarol : un vrai dchiqueiage. On en a tir un Rivarol encore
plus hach : Chamfort et Rivarol DentuV
40o
uvres choisies de Rioarol, puhlies par M. de Les-
cure (Collection Jouaust, maintenant Flammarion)
;
2 vol. Le
tome II rdite les deux premires sries du Journal Politique
National.
%
16
Ecrits apocryphes.
M. A, Le Breton a dress la liste curieuse des crits fausse-
ment attribus Rivarol par divers diteurs, Ourard, la Biblio-
thque Nationale, le Britisth .Musum, etc. La voici :
lo
Dialogue entre le xix^ et le xx^ siele (1780). . C, III.
1^
B.
flexions sur une Question dramatique. . C, II.
30 Rponse de la couleuvre aux loges que
J/me
de G. . . lai
adresse. . C.,III.
40 Petit Almanach des grandes
femmes (1789).
50 Sance extraordinaire et secrte de l'Acadmie
franaise^
tenue le 30 mars 1789 (Voir Grimm, mars 1789).
Go Mmoire sur la nature et la valeur de Vargent, par M.de
Rivarol {i'im.
lo Rponse la rponse de M, de Champceneiz au sujet de
Vouvrage de M^^ la I. de S... (1789;.
80 Les Ph Hippiques on les crimes de Paris (1789).
L'auteur
est Claude-Franois de Rivarol.
90 La Galerie des Etats Gnraux
(1789) et la Galerie des
dames franaises, par le mme auteur
(1790).
Attribu tout le n onde,successivement ou en mme temps:
RivaroljChampcenetz, Luchet,Snac de Meilhau,Mirabeau,Laclos,
Chamfort, etc. S'il faiit en croire rou\Ta2;e lui-mme, les deux
ouvra^ces seraient d'un seul et unique auteur. Le premier portrait
celui de Cnis, dbute ainsi : Il nous a paru plaisant et utile
peut-tre de mler ces portraits celui du peintre del s:alsrie.
Suit un portrait qui n'est assurment ni Rivarol, ni de Rivarol.
Il a d'ailleurs, quoiqu'en termes nigmatiques, dsavou l'omTage
(Journal politique national,
Ire
srie,
no
16) : <( Il a paru, ces
jours derniers, une Galerie des Etats-Gnraux. lUoiUi que l'ou-
vrage soit bien mal crit, puisqu'on l'attribue M. de Luchet, ou
que M. de Mirabeau n'y soit pas peint au naturel, puisqu'on l'en
a souponn l'auteur... Ces Galeries sont-elles aussi mdiocres
que le dit M. Le Breton ? Nullement, et sauf Rivarol, qui a un
style, tous les crivains cits plus haut^ et d'autres,
y
pourraient
prtendre.
APPENDICE
/|2Q
lOi
Lettre au comte de Mirabeau sur son rapport l'Assern-
)le nationale au nom du comit diplomatique, dans la sance
lu 5.7 aot
/7.90,
sur
l'aff'aire
d' Espagne
(1790).
Attribution suspecte, l'opuscule tant inconnu.
llo
Epitre de Voltaire
MHe
Raucour
(4790).
1:20 Essai sur la ncessit du mal, etc., par Soume Jenijens.
n-iiduit de l'anglais, par M. de //yaro/ (1791).
I '-V Rponse du baron de Grimm..., la lettre de .V. de Chas-
ehnnifde Vo/^iey
(1792.)
I io
La Reine lu Conciergerie. Stances
(1793).
i.j'> Eloge deMinetta Ratoni,chat du pape {Benoit XlV^en
on vivant, et premier soprano de ses petits concerts
(1795).
^apier rose.
\^
Histoire secrte de Coblence dans la Rvolution des Fran-
ais, etc.
;
attribue M. de Rivarol (1795).
17o
Lettre au libraire Maradan (dans le Magasin Encyclo-
)dique,
1798).
18
Lettre au Spectateur sur Bonaparte (dans le Spectateur
lu Nord, a\Til 1797).
i9 Lettres l'abb de Villefort et Chnedoll (dans les Pen-
es indites).
(les lettres ont t faites par Claude-Franrois
;
il
y
insra un
)assao;e
sur l'Anleterrequi semble authentique {P. B.P.
p. 339).
1. Le Breton a expliqu les mobiles de cette fraude innocente.
-Oo
Dictionnaire de la langue franaise (1802). Rivarol n'y
st
pour rien. L'abb Sabatier en avait annonc un, o Ri-
;-i '>]
aurait sans doute t pour quelque chose, puisqu'il avait
olc ses papiers; il n'a pas paru.
i
17
Bibliographie
(1)
ulpice de la Platire, Vie philosophique, politique et litt'
raire de Rivarol (AnX-1802).
ubires-Palmzeaux, Fontenelle, Colardeau et Dort, ouvra-
ge suivi d'une Vie d'Antoine Rivarol (An XI-1803).
ivarol
(M'e
de), Notice sur la vie et la mort de M. de Riva-
ro/dSOl).
ampmartin. Notice sur Rivarol, lue dans la sance publique
de L'Acadmie du Gard, le j6 janvier i8og
(2).
(i"; Celte liste est bien loin d'puiser la liste des ouvrases que nous
i^ons consults. Elle n'est qu'une indication. Le seul livre de M. Le
peton est indispensable pour iudier Rivarol.
(3)
Cite par M. le Breton. iN'exisle, notre connaissance, qui ltat
430 RIVAROL
Dampmartin, Relation de la mort de
Rioarol (dans M. de les-
cuRE ;
voir plus loin).
Dampmartin,, Mmoires sur divers
vnements de la Rvolu'
lion et de VEmigration
(1825).
Rivarol (Claude-Franois dej. uvres littraires [1813).
La Porte (H. de), Notice sur Rivarol (1829).
Cousn d'Avallon
(1),
Rivaroliana
(1812).
Tillv .Comte de), Mmoires
(1828).
Sainte-Beuve, Rivarol. Le Constitutionnel, 1851,
et Causeries
du Lundi, tome V. Voir aussi la table des
Causeries.
Sainte-Beuve, Chateaubriand et son r/roupe littraire; tome II.
Houssaye (Arsne), Galerie du XVYII" sicle; i^^' srie : Les
hommes d'esprit.
Lef^Te-Deumie^, Clbrits d'autrefois (1853).
Curnier (Lonce), Rivarol, sa vie et ses uvres (1858).
Alre, Notices biographiques du Gard (1880;.
Lescure (M. de;, Rivarol et la socit franaise pendant la
rvolution et Vw.i
g
ration
(1883).
Le Breton (Andr), Rivarol, sa vie, ses ides^ son talent, d'a-
prs des documents nouveaux
(1895).
de compte-rendu dans les Notices des travaux de VAcadmie du Gard.
(Voyez Lasteyrie,
|
Gard.)
(i) Rivaroliana conlient l'un des deux seuls bons portraits de Riva-
rol; il est de Carmontelle. L'autre, de Wyrsch, a el reproduit par
M. Le Breton. Les autres, uvres compltes, uvres
(1857),
CEa-
vres choisies (Lescure) ^sont absurdes. Nous reproduisons, en frontis-
pice, le Carmontelle.
TABLE DES MATIRES
LIVRE PREMIER
LITTRATURE
I. DE L'UNIVEnSALIT DE LA LANGUE FRANAISE I
II. DIALOGUE ENTRE VOLTAIRE ET FONTENELLE.
38
II.
LE PETIT ALMANACH DE NOS GRANDS HOMMES
'
/}G
Avis sur cette nouvelle dition /jG
A M. de Cailhava de TL^slandoux.
48
Post-scriptum
^9
Prface oo
Le petit almanach de nos grands hommes 5/|
Supplment
,
. 9-^
Errata .
. .
.
09
Les aveux ou l'Arche de No 100
LETTRE SUR l'oUVRAGE DE M^ DE STAL INTITUL I
DE l'influence DES PASSIONS, ETG I03
V. LE GNIE ET LE TALENT
,
lOQ
n. FRAGMENTS ET PENSES LITTRAIRES I IQ
*
Sur Florian
-
119
Sur le style 122
Des traductions 1 23
Notes 1
24
LIVRE II
POLITIQUE
I.
JOURNAL POLITIQUE NATIONAL
I29
Les premires fautes
129
La Dclaration des Droits de l'Homme i44
432
Les journe d'octobre i5
Lettre sur la capture de .M. l'abb iMaury P-
ronne 17I
Notes et Petits articles
18
ACTES DES APOTRES
l8
Sur Robespierre . ,
18
Rponse de M. Robespierre M*", qui l'avait
relev sur le mot aristocrassique
18
Explication d'une charade.
ig
Nouveaux Dialogues des morts
i
Noies et petits articles
i
PETIT DICTIONNAIRE DES GRANDS HOMMES DE LA RE-
VOLUTION
20
Eptre ddicatoire
20
Prface
20
Petit Dictionnaire des rands hommes 20
Table de tous les grands hommes de la Pivolu-
tion
21
FRAGMENTS ET PENSEES POLITIQUES 21
Premier mmoire M. de La Porte 21
Lettre M. de la Porte
22T
Portrait du duc d'Orlans et de
Mme
de G 22
Gnralits
22
Sur la Rvolution
20
LIVRE m
PHILOSOPHIE
1.
LETTRES A M. NECKER SUR SON LIVRE DE l'iMPOR-
TANCE DES OPINIONS RELIGIEUSES
II. DISCOURS
PRLIMINAIRE DU NOUVEAU DICTIONNAIRE
DE LA LANGUE FRANAISE .
2^
Du sentiment comme principe de tout dans l'hom-
me et dans les animaux
24]
Des animaux
251
De la philosophie moderne. 27!
II.
FRAGMENTS ET PENSEES PHILOSOPHIQUES
2^
Du bonheur
28
Le diste hologien
28
La loi des proportions
2q^
Sur l'galit
2
L'hypocrisie et le lanalisrae.
2
TABLE DES MVTIHES
433
Dialogue entre un roi et un fondateur de reli-
gion
296
Notes
2(j8
LIVRE IV
LETTRES
I.
A M. le chevalier de Cubires-Palmzeaux 3i i
11.
Au mme 3i2
m.
Aux auteurs du Journal de Paris 3 12
IV.
A l'abb Roman 3 1
3
V.
Aux auteurs du Journal de Paris 3i5
M.
Au public oiO
vil.
A. M. de Gastc, maire Bollne
Siy
VIII.
A la marquise de Goigny
3 18
IX.
A David Cappadoce-Perreira
319
X.
Au mme 320
XI.
Au mme 32
1
XII.
Au mme
322
xn.
Au mme 322
XIV.
Au mme 323
XV.
Au mme
324
XVI.
Au mme.
324
XVII.
Au mme - 325
: VIII .
Au mme
.
32G
XIX.
Au mme
327
XX.
A
Mme
Gromot de Fougy 828
XXI .
A son pre 332
(Extrait d'une lettre du comtedeTilly Rivarol.)
XXII.
Au comte de Tilly 336
xiii.
A M. de Gaste
337
<xiv.
A sa tante Franoise
339
xxv. A M. Dalville.
.
34i
XXVI.
A un ami 342
:xvii.
A un ami 342
:xviii.
Au marquis Dtilly 343
XXIX.
A M. de Gaste
344
XXX.
A son pre 345
XXXI.
A David Cappadoce-Perreira. 346
;xxii.
A Manette
347
jfxiii.
A M. de Gaste
.
. .. 348
434
RIVAROL
LIVRE T
RIVAKOLTANA
I.
Noies, Rflexions, Epigrammes.
Soi
II.
Anecdotes et bons mois
869
III.
Conversation de Rivarol
870
APPENDICE
Notice bibliographique
3
Notice littraire
38
Opinion de Burke
\
Madame de Rivarol
89^
Manette
39(
Rivarol Hambourj^
89^
Mort de Rivarol
, 39c
Note du major Guallieri l^ol
Extrait du Mercure de France 4o5
Champcenetz
4^7
Conversation entre Rivarol, Ghamfort, Champce-
netz et Tilly
409
Dialogue entre le comte de Laurap^uais et l'abb
Sabatier de Castres
4
1
3
Pamphlets contre Rivarol
4^4
Universalit de la langue franaise l\\%
uvres de
Rivarol
423
Ecrits apocryphes 428
Bibliographie
429
ACHEVE D'IMPRIMER
le Tngt dcembre mil neuf cent cinq
PAR
BLAIS ET ROY
A POITIERS
pour le
MERCVRE
FRANCE
MERCVRE
DE FRANCE
XXVI, RVE DE COND PARIS-V
Parat le i^^" et le i5 de chaque mois, et forme dans l'anne six volumes.
Littrature, Posie, Thtre, Musique, Peinture, Sculpture
Philosophie, Histoire, Sociologie, Sciences, Voyages
Bibliophilie, Sciences occultes
Critique, Littratures trangres, Revue de la Quinzaine
La Revue de la Quinzaine
s'alimente l'traner autant qu'en France:
elle offre un nombre considrable de documents, et constitue une sorte d* en-
cyclopdie au jour le jour du mouvement universel des ides. Elle se compos.:
des rubriques suivantes :
Epilogues (actualit) : Remy de Gour-
mont.
Les Pomes : Pierre Ouillard.
Les Romans : Rachilde
.
Littrature : Jean de Gourmont
.
Littrature dramatique : Georges
Polti.
Histoire : Marce Coilire, Edmond
Barthlmy
.
Questions morales et religieuses :
"
Louis Le Cardonnel.
Science sociale: Henri Mazel.
Philosophie : Louis Weber.
Psychologie : Gaston Banville.
Sciences: D' Albert Prieur.
Archologie, Voi/ages : Charles Merki.
Ethnographie, Folklore : A, van
Gennep.
Questions coloniales : Cari Sie:er.
Esotrisme et Spiritisme : Jacques
Brieu.
Les Bibliothques : Gabriel Renaud,
Les Revues: Charles-Henry Hirsch.
Les Journaux: R. de Bury.
Les Thtres : A.-Ferdinand
Herold.
Musique : Jean Marnold.
Art moderne: Charles Morice.
Art ancien: Tristan Leclre.
Muses et Collections : Autiste Mr-
guillier.
Chronique du Midi : Paul Souchon
.
Chronique de Bruxelles : G. Eekhoud.
Lettres allemandes : Henri Albert.
Lettres anglaises :lenry.-D. Davray.
Lettres italiennes : K\ccotio Canudo,
Lettres espagnoles : Goraez Garrillo.
Lettresportugaises : Phil'asLebesgue.
Lettres hispano-amricaines: Eu^c-
nio Diaz Romero.
Lettres no-grecques : Demetrius As*
teriotis.
Lettres roumaines : Marcel JMontan-
don.
Lettres russes: E. SmnofF.
Lettrespolonaises : Michel Mutermilch.
Lettres nerlandaises : H. Messet.
Lettres Scandinaves : P. G. La Ghes-
nais.
Lettres hongroises : Zrinyi Jnos.
Lettres tchques : William Ritter.
La France juge l'Etranger : Lucile
Dubois.
Varits: X...
La Curiosit : Jacques Daurelle.
Publications rcentes : Mercure.
Echos : Mercure.
Les abonnements partent du
premier des mois de janvier, avril,
juillet et octobre
France
tranger
Un NUMERO ,
1.25
Un AN
,. 25 fr.
Six mois
Trois mois
14
8
Un numro 1.50
Un AN 30 fr.
Six mois . .
.
Trois mois.
17
10
Poitiers. Imprimerie du Mercure de France, BLAIS et ROY, 7, rue Victor-Hugo.
La
Bibliothque
niversit
d^Ottawa
Echance
The Library
University
of
Ottawa
Date
Due
Illlll
a39003 00255800i4b
CE
PQ
2027
R35A6
1906
COO
^CC#
1366140
RI
VARCL
S-ar putea să vă placă și
- Rivarol PDFDocument166 paginiRivarol PDFAlfredo AjenjoÎncă nu există evaluări
- Boisdefeu Jean Marie La Controverse Sur L Extermination Des Juifs Par Les Allemands Tome 2Document140 paginiBoisdefeu Jean Marie La Controverse Sur L Extermination Des Juifs Par Les Allemands Tome 2ektor2011Încă nu există evaluări
- Leon de Poncins - La Prise de La BastilleDocument46 paginiLeon de Poncins - La Prise de La BastilleZamoum SaidÎncă nu există evaluări
- Yourcenar Hadrien Margot PLDocument6 paginiYourcenar Hadrien Margot PLAnonymous KWqsRLÎncă nu există evaluări
- BLOY, L. Dans Les Ténèbres (1918) PDFDocument290 paginiBLOY, L. Dans Les Ténèbres (1918) PDFJose MuñozÎncă nu există evaluări
- François-René La Tour Du Pin - Vers Un Ordre Social Chrétien Jalons de Route, 1882-1907 (1917)Document536 paginiFrançois-René La Tour Du Pin - Vers Un Ordre Social Chrétien Jalons de Route, 1882-1907 (1917)CarlosJesus100% (1)
- Roger Caillois Et Les Approches de Limaginaire.Document16 paginiRoger Caillois Et Les Approches de Limaginaire.alexÎncă nu există evaluări
- Biographie de Charles MaurrasDocument106 paginiBiographie de Charles Maurrasmimor33Încă nu există evaluări
- Napoléon aura-t-il lieu ?: La Fortune et la volonté. Mai 1798 - Décembre 1800De la EverandNapoléon aura-t-il lieu ?: La Fortune et la volonté. Mai 1798 - Décembre 1800Încă nu există evaluări
- La Controverse de L'Extermination Des Juifs Par Les Allemands T IDocument115 paginiLa Controverse de L'Extermination Des Juifs Par Les Allemands T IFAURISSON'S TRUTH100% (1)
- L'AretinDocument358 paginiL'AretinBertrand Chavarria-Aldrete100% (1)
- Francis Delaisi - La Revolution Europeenne (1942)Document295 paginiFrancis Delaisi - La Revolution Europeenne (1942)NunusseÎncă nu există evaluări
- Robert Brasillach - Je Suis Partout - 1936Document48 paginiRobert Brasillach - Je Suis Partout - 1936luizdecarvalhoÎncă nu există evaluări
- Coston Henry - La Trahison de Vichy 1940Document32 paginiCoston Henry - La Trahison de Vichy 1940Pierre PierreÎncă nu există evaluări
- La grande Guerre en caricatures: Une autre approche de l'HistoireDe la EverandLa grande Guerre en caricatures: Une autre approche de l'HistoireÎncă nu există evaluări
- Antony Sutton - Wall Street Et La Montée en Puissance D'hitlerDocument41 paginiAntony Sutton - Wall Street Et La Montée en Puissance D'hitlerinsanelkamil100% (1)
- Les bouquinistes et les quais de Paris tels qu'ils sont: Réfutation du pamphlet d'O. Uzanne, le monsieur de ces dames à l'éventail, à l'ombrelle, etc.De la EverandLes bouquinistes et les quais de Paris tels qu'ils sont: Réfutation du pamphlet d'O. Uzanne, le monsieur de ces dames à l'éventail, à l'ombrelle, etc.Încă nu există evaluări
- Les plus sombres histoires de l'histoire de Belgique: Secrets et anecdotesDe la EverandLes plus sombres histoires de l'histoire de Belgique: Secrets et anecdotesÎncă nu există evaluări
- Montandon George - L'Ethnie FrançaiseDocument271 paginiMontandon George - L'Ethnie FrançaiseHans Cany100% (1)
- Moncomble Yann - L'irrésistible Expansion Du Mondialisme PDFDocument252 paginiMoncomble Yann - L'irrésistible Expansion Du Mondialisme PDFSérgio Renato Del Rio100% (1)
- La Critique Du Libéralisme (Tome 3)Document732 paginiLa Critique Du Libéralisme (Tome 3)IHS_MA100% (1)
- "Le Sionisme: Un Rêve Magnifique Ou Un Terrible Fiasco", Par L'abbé Curzio NitogliaDocument30 pagini"Le Sionisme: Un Rêve Magnifique Ou Un Terrible Fiasco", Par L'abbé Curzio NitogliavbeziauÎncă nu există evaluări
- Pierre Magnard - Singulier UniverselDocument7 paginiPierre Magnard - Singulier UniverselMark CohenÎncă nu există evaluări
- J'Accuse Le ConcordatDocument244 paginiJ'Accuse Le ConcordatMarco Rui AlonsoÎncă nu există evaluări
- Cathares 2Document316 paginiCathares 2santsetesh100% (1)
- Robert Brasillach, Lettres A Une ProvincialeDocument151 paginiRobert Brasillach, Lettres A Une ProvincialeΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 2Încă nu există evaluări
- Simon Epstein - Entretien Avec B. La RichardaisDocument5 paginiSimon Epstein - Entretien Avec B. La RichardaisCobaj2014Încă nu există evaluări
- Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome II. by Bonaparte, Napoléon, 1769-1821Document317 paginiOeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome II. by Bonaparte, Napoléon, 1769-1821Gutenberg.org100% (2)
- 2857 RivarolDocument12 pagini2857 RivarolboudardÎncă nu există evaluări
- Les Juifs Et L'antisémitisme - REBATET Lucien - Livre ScannéDocument216 paginiLes Juifs Et L'antisémitisme - REBATET Lucien - Livre ScannéBibliothequeNatio33% (3)
- La Nouvelle Droite, Ses Pompes Et Ses Œuvres: D'Europe Action (1963) À La NRH (2002)Document56 paginiLa Nouvelle Droite, Ses Pompes Et Ses Œuvres: D'Europe Action (1963) À La NRH (2002)derfghÎncă nu există evaluări
- La Mission Posthume de La Bienheureuse Jeanne D Arc Et Le Regne Social de Notre-Seigneur Jesus-Christ 000000662Document528 paginiLa Mission Posthume de La Bienheureuse Jeanne D Arc Et Le Regne Social de Notre-Seigneur Jesus-Christ 000000662jean rené marniauÎncă nu există evaluări
- Histoire socialiste de la France contemporaine 1789-1900: Tome 3 La Convention I 1792De la EverandHistoire socialiste de la France contemporaine 1789-1900: Tome 3 La Convention I 1792Încă nu există evaluări
- Faurisson Robert - A Propos de L'arrêt Touvier L'affaire Des Juifs BrunsDocument14 paginiFaurisson Robert - A Propos de L'arrêt Touvier L'affaire Des Juifs BrunscsalmeeÎncă nu există evaluări
- Pemjean Lucien - La Presse Et Les JuifsDocument74 paginiPemjean Lucien - La Presse Et Les JuifsOmer AntiizionÎncă nu există evaluări
- Emmanuel Berl, La Fin de La IIIe RépubliqueDocument22 paginiEmmanuel Berl, La Fin de La IIIe RépubliqueAnonymous va7umdWyhÎncă nu există evaluări
- Mémoire Ethno Master1 SDADocument47 paginiMémoire Ethno Master1 SDAiduun34Încă nu există evaluări
- Gobineau Essai Inegalite Races 2Document338 paginiGobineau Essai Inegalite Races 2Sergio David Díaz YaguaranÎncă nu există evaluări
- Pline Le Jeune. Lettres Vol 2, Livres 6-10Document195 paginiPline Le Jeune. Lettres Vol 2, Livres 6-10Madalin MaticaÎncă nu există evaluări
- Mitterrand Et La CagouleDocument11 paginiMitterrand Et La CagouleRaibaut PamiÎncă nu există evaluări
- Histoire Partiale Histoire Vraie Vol.02 by Guiraud, Jean, 1866-1953Document490 paginiHistoire Partiale Histoire Vraie Vol.02 by Guiraud, Jean, 1866-1953Jorge Candido da SilvaÎncă nu există evaluări
- L'enfer (1 of 2) La Divine Comédie - Traduit Par Rivarol by Dante Alighieri, 1265-1321Document82 paginiL'enfer (1 of 2) La Divine Comédie - Traduit Par Rivarol by Dante Alighieri, 1265-1321Gutenberg.orgÎncă nu există evaluări
- Séverin Jules - Le Monopole Universitaire (1905)Document148 paginiSéverin Jules - Le Monopole Universitaire (1905)NunusseÎncă nu există evaluări
- Les Origines de La France Contemporaine TaineDocument351 paginiLes Origines de La France Contemporaine TaineMarcelo VieiraÎncă nu există evaluări
- Rebatet Lucien Dialogue de VaincusDocument238 paginiRebatet Lucien Dialogue de VaincusJiko Kopi100% (1)
- Norman Cohn, Simone Clémendot, Michel Fuchs, Paul Rosenberg-Les Fanatiques de L'apocalypse - Courants Millénaristes Révolutionnaires Du XIe Au XVIe Siècle-Les Editions Aden (2010) PDFDocument486 paginiNorman Cohn, Simone Clémendot, Michel Fuchs, Paul Rosenberg-Les Fanatiques de L'apocalypse - Courants Millénaristes Révolutionnaires Du XIe Au XVIe Siècle-Les Editions Aden (2010) PDFPatricio ArriagadaÎncă nu există evaluări
- Réhabiliter Maritain Par Damien TheillierDocument14 paginiRéhabiliter Maritain Par Damien TheillierNicomaque IIÎncă nu există evaluări
- Faurisson Robert, Chronique Sèche de L'épuration PDFDocument26 paginiFaurisson Robert, Chronique Sèche de L'épuration PDFStephanie HernandezÎncă nu există evaluări
- MonzatlittantisemDocument5 paginiMonzatlittantisemsoubiseboisdeboutÎncă nu există evaluări
- Louis XVI Marie-Antoinette Et Madame (... ) Louis XVI bpt6k205744t PDFDocument598 paginiLouis XVI Marie-Antoinette Et Madame (... ) Louis XVI bpt6k205744t PDFJiko KopiÎncă nu există evaluări
- Moeurs intimes du passé: Usages et coutumes disparus - Série IDe la EverandMoeurs intimes du passé: Usages et coutumes disparus - Série IÎncă nu există evaluări
- Bub GB AzwuaaaayaajDocument450 paginiBub GB AzwuaaaayaajDylan NkÎncă nu există evaluări
- Biographie de RobespierreDocument2 paginiBiographie de RobespierreJustine Rey100% (1)
- La Censure Pendant La Première Guerre MondialeDocument38 paginiLa Censure Pendant La Première Guerre MondialeAnonymous HLBjNdHuÎncă nu există evaluări
- Histoire Des Sectes Dans L'occident Médiéval (Ch. Thouzellier)Document8 paginiHistoire Des Sectes Dans L'occident Médiéval (Ch. Thouzellier)AdsoÎncă nu există evaluări
- La Révolution (Tome 2)Document309 paginiLa Révolution (Tome 2)IHS_MAÎncă nu există evaluări
- Charles Baussan - Joseph de Maistre Et L'idée de L'ordreDocument154 paginiCharles Baussan - Joseph de Maistre Et L'idée de L'ordreOCorpoNegro100% (1)
- François Descontes - Joseph de Maistre - Avant La Révolution - Souvenirs de La Société D'autrefois 1753-1793 - IDocument356 paginiFrançois Descontes - Joseph de Maistre - Avant La Révolution - Souvenirs de La Société D'autrefois 1753-1793 - IOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- François Descontes - Joseph de Maistre - Avant La Révolution - Souvenirs de La Société D'autrefois 1753-1793 - IIDocument428 paginiFrançois Descontes - Joseph de Maistre - Avant La Révolution - Souvenirs de La Société D'autrefois 1753-1793 - IIOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- Edmund Burke - Réflexions Sur La Révolution de FranceDocument493 paginiEdmund Burke - Réflexions Sur La Révolution de FranceKoltchak91120Încă nu există evaluări
- Wenceslaus Hollar, Hans Holbein - Le Triomphe de La MortDocument104 paginiWenceslaus Hollar, Hans Holbein - Le Triomphe de La MortOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- E. Spenlé - Novalis - Essai Sur L'Idéalisme Romantique en AllegmaneDocument500 paginiE. Spenlé - Novalis - Essai Sur L'Idéalisme Romantique en AllegmaneOCorpoNegro100% (1)
- Paul Bourget - BonaldDocument384 paginiPaul Bourget - BonaldOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- Antonio Gallonio - Traité Des Instruments de Martyre Et Des Divers Modes de Supplice...Document345 paginiAntonio Gallonio - Traité Des Instruments de Martyre Et Des Divers Modes de Supplice...OCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- Vogel - L' Assiette Au Beurre - Pamphlétaire, Satirique Et IllustréDocument24 paginiVogel - L' Assiette Au Beurre - Pamphlétaire, Satirique Et IllustréOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- Antoine Rivarol - Esprit de RivarolDocument312 paginiAntoine Rivarol - Esprit de RivarolOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- Henry Moulinié - de Bonald - La Vie-La Carriére Politique-La DoctrineDocument486 paginiHenry Moulinié - de Bonald - La Vie-La Carriére Politique-La DoctrineOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- Fagus - La Danse Macabre - PoèmeDocument166 paginiFagus - La Danse Macabre - PoèmeOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- Jules Claretie - Petrus Borel - Le Lycanthrope - Sa Vie, Ses Écrits, Sa Correspondance, Poésies Et Documents InéditsDocument158 paginiJules Claretie - Petrus Borel - Le Lycanthrope - Sa Vie, Ses Écrits, Sa Correspondance, Poésies Et Documents InéditsOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- Luis de Bonald - Considérations Sur La Révolution FrançaiseDocument332 paginiLuis de Bonald - Considérations Sur La Révolution FrançaiseOCorpoNegro100% (1)
- Felix Schneider (Ed.) - La Danse Des Morts - Gravée D'après Les Tableaux À Fresque Qui Se Trouvaient Sur Le Mur Du Cimitière de L'église de St. Jean À BâleDocument94 paginiFelix Schneider (Ed.) - La Danse Des Morts - Gravée D'après Les Tableaux À Fresque Qui Se Trouvaient Sur Le Mur Du Cimitière de L'église de St. Jean À BâleOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- Benjamin Pifteau - Ars Bene MoriendiDocument68 paginiBenjamin Pifteau - Ars Bene MoriendiOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- Vicomte D'arlincourt - Le SolitaireDocument498 paginiVicomte D'arlincourt - Le SolitaireOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- Edmund Burke - Réflexions Sur La Révolution de FranceDocument493 paginiEdmund Burke - Réflexions Sur La Révolution de FranceKoltchak91120Încă nu există evaluări
- Bourneville, E. Teinturier - Le Sabbat Des SorciersDocument46 paginiBourneville, E. Teinturier - Le Sabbat Des SorciersOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- P. L. Jacob - La Danse Macabre - Histoire Fantastique Du Quinziéme SècleDocument386 paginiP. L. Jacob - La Danse Macabre - Histoire Fantastique Du Quinziéme SècleOCorpoNegro100% (1)
- Maurice Rollinat - L'AbimeDocument304 paginiMaurice Rollinat - L'AbimeOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- Jean Lorrain Histoires de MasquesDocument312 paginiJean Lorrain Histoires de MasquesWinston KurtzÎncă nu există evaluări
- Auguste Cabanès - Poisons Et SortilègesDocument344 paginiAuguste Cabanès - Poisons Et SortilègesOCorpoNegro100% (3)
- A. Lyon - Les Simulacres & Histories Faces de La Mort, Autant Elegammet Pourtraictes, Que Artificiellment ImaginéesDocument120 paginiA. Lyon - Les Simulacres & Histories Faces de La Mort, Autant Elegammet Pourtraictes, Que Artificiellment ImaginéesOCorpoNegroÎncă nu există evaluări
- Administration LinuxDocument121 paginiAdministration LinuxbolathebearÎncă nu există evaluări
- Migration Inter-Foret Windows 2003 Vers 2008 Avec ADMT 3.1Document103 paginiMigration Inter-Foret Windows 2003 Vers 2008 Avec ADMT 3.1jérôme carbel100% (1)
- Suite Geometrique ExerciceDocument7 paginiSuite Geometrique Exercicethiecouramorydoumbia902Încă nu există evaluări
- Padlet NOURaDocument2 paginiPadlet NOURaNouraÎncă nu există evaluări
- Liste FicDocument3 paginiListe FicFarhat ThamerÎncă nu există evaluări
- Cours Suites Numériques Partie1Document2 paginiCours Suites Numériques Partie1samvipÎncă nu există evaluări
- Y Vermeren Outils Informatiques Service Auditeurs Controleurs Internes PDFDocument3 paginiY Vermeren Outils Informatiques Service Auditeurs Controleurs Internes PDFAmmar DjoudiÎncă nu există evaluări
- Musique-Numerique DecryptageDesPrincipauxMarchesNumeriquesDeLaMusiqueDocument242 paginiMusique-Numerique DecryptageDesPrincipauxMarchesNumeriquesDeLaMusiquevaljfxÎncă nu există evaluări
- RasismDocument102 paginiRasismAmwin minm100% (1)
- Article Maskini REMFO PDFDocument16 paginiArticle Maskini REMFO PDFlahyanimedÎncă nu există evaluări
- Rapport PFEDocument51 paginiRapport PFERachid Richard100% (1)
- Les ImmatériauxDocument45 paginiLes ImmatériauxLeslie Veisse100% (1)
- Документ Microsoft Office WordDocument1 paginăДокумент Microsoft Office WordMaria PelevaniucÎncă nu există evaluări
- Travaux PratiqueDocument5 paginiTravaux PratiquerakolovaÎncă nu există evaluări
- Devoir de Contrôle N1 Technologie 2ème Sciences 2012 2013 MR Abdallah RAOUAFIDocument3 paginiDevoir de Contrôle N1 Technologie 2ème Sciences 2012 2013 MR Abdallah RAOUAFIArwa BerrichÎncă nu există evaluări
- SerDocument53 paginiSeranibelsoulÎncă nu există evaluări
- Analyse Des Besoins D'un Commissariat de Police PDFDocument3 paginiAnalyse Des Besoins D'un Commissariat de Police PDFʚĩɞ IkRàm AkCha ʚĩɞÎncă nu există evaluări
- SudokuDocument9 paginiSudokuch kbsÎncă nu există evaluări
- Acquérir Du Lexique - DeLF B2Document8 paginiAcquérir Du Lexique - DeLF B2Carlo Tellez Withbrown50% (2)
- Fixation de L'azoteDocument12 paginiFixation de L'azoteNana LabelleÎncă nu există evaluări
- Le+ºon-1Document8 paginiLe+ºon-1Mohammed Ilyass HadineÎncă nu există evaluări
- CFM S5Document1 paginăCFM S5AMINE CHERQIÎncă nu există evaluări
- Dessin Technique Veste CuisineDocument19 paginiDessin Technique Veste CuisineDelhoum FadélaÎncă nu există evaluări
- Apprendre L Anatomie Musculaire FonctionnelleDocument2 paginiApprendre L Anatomie Musculaire FonctionnelleMohamed Cherrak43% (7)
- Faire Des Sciences Sociales, ComparerDocument324 paginiFaire Des Sciences Sociales, ComparerLes Yeux OuvertsÎncă nu există evaluări
- 5-Intro Des Modeles A Equations SimultaneesDocument24 pagini5-Intro Des Modeles A Equations SimultaneesTarik AmalouÎncă nu există evaluări
- TP FlammeDocument3 paginiTP FlammeIkhlass DridÎncă nu există evaluări
- PUG Extrait Ebook Statistiques-Descriptives-Cours 2Document26 paginiPUG Extrait Ebook Statistiques-Descriptives-Cours 2takeshirohÎncă nu există evaluări
- Le Coaching Et L'art Du ManagementDocument21 paginiLe Coaching Et L'art Du ManagementIssycoachÎncă nu există evaluări
- CESER Reunion Un Nouveau SAR Pour Repondre Aux BesoinsDocument32 paginiCESER Reunion Un Nouveau SAR Pour Repondre Aux BesoinsalonzeauÎncă nu există evaluări