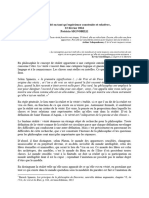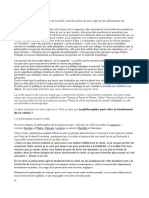Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Alfred Fouillée Platon
Încărcat de
gustavog1956Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Alfred Fouillée Platon
Încărcat de
gustavog1956Drepturi de autor:
Formate disponibile
Alfred Fouille
La philosophie de Platon
PREMIRE PARTIE
EXPOSITION DE LA PHILOSOPHIE PLATONICIENNE
LIVRE PREMIER.
EXISTENCE DES IDES.
CHAPITRE PREMIER.
MTHODE DE DMONSTRATION PLATONICIENNE.
I. Platon dmontrait-il l'existence des Ides? - II. Mthode de dmonstration platonicienne.
Preuves indiques par Platon et par Aristote. Classifcation des preuves inductives et
dductives. - III. Dogmatisme de Platon. Comment sa doctrine enveloppe la fois des
thses ngatives et des thses afrmatives. Quadruple aspect sous lequel Platon envisag
les questions.
I. Platon dmontrait-il l'existence des Ides?
Aristote reproche Platon de ne pas avoir tabli scientifquement l'existence des Ides. On
ne trouve pas en efet dans les dialogues de dmonstration proprement dite. Souvent
mme Platon pose comme vidente l'existence de la vrit absolue, de la beaut, de la
justice.
Je ne vois rien de si vident que l'existence, au plus haut degr possible du beau, du bon, et
de toutes les autres choses de ce genre; et elle m'est sufsamment dmontre (01). ....
Dirons-nous qu'il y a quelque chose qui est la justice mme, ou qu'il n'y a rien de tel? -
Par Jupiter, nous le dirons. - N'en dirons-nous pas autant du beau et du bon ? ... (02)
N'est-ce point par la justice que les choses sont justes, par la beaut que les choses sont
belles? La justice n'est-elle pas quelque chose de rel?... (03)
Cette absence de preuves rgulires ne tient pas seulement la forme libre et potique des
dialogues (04). Elle a des causes plus profondes, soit dans le caractre mme de Platon, soit
dans l'opinion qu'il s'tait faite de la valeur des preuves logiques.
Le principal trait du gnie de Platon, celui qui frappe tout d'abord la lecture de ses
ouvrages, c'est prcisment la foi aux Ides, c'est--dire la vrit, la beaut, la justice.
Toute me, dit-il, s'lance naturellement vers ce qui est immuable et ternel, comme tant
de la mme nature, , et plus une me est grande, plus sa foi est vive.
Aussi, ce qui parat Platon digne d'tonnement, ce n'est pas l'existence de l'idal et du
parfait ; mais bien plutt celle du monde sensible o le laid se mle au beau, le non-tre
l'tre, le mal au bien. Si la vrit, la beaut, la justice, la perfection, ne sont pas relles, o
sera la ralit? La plnitude de l'existence est-elle donc le contraire de l'existence ! Platon
s'crierait volontiers, lui aussi : Pourquoi l'imparfait serait-il, et le parfait ne serait-il pas?
La perfection n'est pas un obstacle l'tre, c'est la raison d'tre.
D'ailleurs, quelle est la vritable porte des dmonstrations logiques ? Seraient-elles
capables de nous donner les Ides, si nous ne les portions pas dj dans notre me? Platon
ne le croit pas : la rfexion, bien interroge, ne fait que montrer l'insufsance de la
rfexion mme et la ncessit d'un procd suprieur : L'intuition primitive, la . La
raison et les Ides sont intimement unies ; l'intelligible et l'intelligence se pntrent l'un
l'autre dans une intuition immdiate, mais confuse : L'me, disait Socrate, est grosse de la
vrit (05). Seulement il faut que cette vrit apparaisse au grand jour. La rfexion et la
logique doivent claircir et dvelopper ce qu'enveloppe l'obscurit de la foi instinctive. Il y
a donc un genre de preuves qui loin d'tre inutiles, confrment la croyance aux Ides en
l'levant la hauteur d'une science.
Comment Platon conoit-il ces preuves? par quelle mthode les aurait-il tablies, s'il avait
entrepris une dmonstration rgulire de sa doctrine? Ne trouve-t-on dans les dialogues
aucune trace de cette mthode et de ces preuves?
II. Mthode platonicienne pour prouver l'existence des Ides.
Le Time et la Rpublique contiennent l'indication d'une preuve positive de l'existence des
Ides.
Les objets que nous voyons, et tous ceux que nous sentons par nos sens corporels, sont-
ils les seuls qui aient une ralit propre, et n'y en a-t-il absolument. aucune autre que celle-
l? Est-ce faussement que nous disons toujours qu' chacun d'eux correspond une espce
intelligible, et ne seraient-ce l que de vaines paroles?... Si nous pouvions nous renfermer
dans de justes limites, de manire paratre dire beaucoup de choses en peu de mots, ce
serait sans doute ce qui conviendrait le mieux la circonstance. Voici donc, sur cette
question, mon avis personnel; si l'intelligence et l'opinion vraie sont deux choses
difrentes, il faut absolument croire l'existence en soi de ces espces qui ne tombent
point sous nos sens, et que notre intelligence seule peut comprendre ; mais si, au contraire,
comme il parat, quelques-uns, l'opinion vraie ne difre en rien de l'intelligence, toutes
les choses que nous sentons par le corps doivent tre juges les plus solides. Mais il faut
dire que ce sont deux choses distinctes; car elles se forment sparment et elles sont
dissemblables (06).
Dans ce passage du Time, l'existence des espces intelligibles est tablie par une preuve
toute psychologique : la distinction, dans l'intelligence humaine, de deux facults
difrentes par leur nature, et consquemment par leurs objets : la raison et l'opinion ; ou,
dans le langage moderne, la raison et l'exprience.
Cette preuve est galement indique dans la Rpublique. -- Les facults sont une espce
d'tres qui nous rendent capables, nous et tous les autres agents, des oprations qui nous
sont propres. Par exemple, j'appelle facult la puissance de voir, d'entendre... Je ne vois
dans chacune de ces facults ni couleur, ni fgure, ni rien de semblable ce qui se trouve en
mille autres choses, sur quoi je puisse porter les yeux pour m'aider faire les distinctions
convenables. Je ne considre en chaque facult que son objet et ses efets ; c'est par l que je
les distingue. J'appelle facults identiques celles qui ont le mme objet et produisent les
mmes efets, facults difrentes celles dont les objets et les efets sont difrents (07).
Suit la distinction de l'opinion et de la science, qui aboutit l'afrmation des Ides.
Platon a consacr tout un dialogue au dveloppe-ment de cette preuve psychologique : le
Thtte. Aristote, au XIIIe livre de la Mtaphysique, lorsqu'il entreprend de rfuter Platon et
rduit deux preuves principales la dmonstration de l'existence des Ides, cite en premier
lieu la preuve tire de la ncessit des Ides pour la science.
On est en droit de conclure que Platon, dans une exposition, rgulire et didactique de son
systme, aurait plac au premier rang la preuve psychologique. Fidle la mthode de
Socrate, qui prend pour point de dpart l'observation de soi-mme, Platon faisait reposer
sa doctrine sur l'analyse de la connaissance et de ses divers degrs. Le Thtte et le Vle
livre de la Rpublique en sont la preuve. Aucune dmonstration logique, aucune srie de
dductions, n'est suprieure, pour Platon, la simple analyse psychologique de nos
facults intellectuelles.
La seconde raison de l'existence des Ides, indique par Aristote dans sa Mtaphysique, est
la considration de l'unit dans la pluralit. Les objets sensibles, divers et changeants
supposent au-dessus d'eux l'unit immuable oit ils ont leur raison et leur essence. Cette
preuve se retrouve chaque page dans Platon; et elle forme.le complment naturel de la
prcdente. Aprs avoir considr le sujet pensant, Platon considre l'objet de la pense.
L'observation de nous-mme avait abouti cette vrit : l'me n'est intelligente que parles
Ides; l'observation du monde extrieur aboutit une vrit insparable de la premire : la
Nature n'est intelligible que par les Ides.
Toutes les preuves possibles se ramnent donc ces deux grandes propositions que
dveloppera le VIe livre de la Rpublique. - Il y a de la pense ; il y a de l'tre; or l'Ide est le
principe ncessaire de toute pense et de toute existence ; elle est donc la suprme ralit,
dans laquelle s'unissent ternellement la: pense et l'tre.
Ces preuves, qui remontent de la pense et de l'tre, de l'me et de la nature, un principe
suprieur, l'antiquit les nommait preuves inductives : elles contiennent ce qu'on pourrait
appeler la dialectique ascendante. Mais elles ne sont pas les seules. Les preuves
dductives, qui appartiennent la dialectique descendante, sont comme, la contre-partie
et la vrifcation des premires. La logique, dans Platon; prte son appui la psychologie
et la mtaphysique.
Dgage par l'induction, et comme pose sous le regard de l'intelligence, l'Ide semble
conserver encore le caractre d'une hypothse (), tant qu'elle n'a pas t soumise
une vrifcation logique. Il faut que le raisonnement analyse toutes les consquences de
l'Ide, afn de voir si elles se contredisent entre elles et, si elles contredisent leur principe. -
Que si on venait attaquer le principe lui-mme, ne laisserais-tu pas cette attaque sans
rponse, jusqu' ce que tu eusses examin toutes les consquences qui drivent de ce
principe, et reconnu toi-mme si elles s'accordent ou ne s'accordent pas entre elles (08) ?
Ainsi, pour enlever 'l'Ide tout caractre hypothtique, il faut tour tour remonter aux
principes et descendre aux dernires consquences. Le Sophiste et le Parmnide sont les
principales applications de cette mthode. L'Ide, pralablement pose par la raison, est
vrife par le raisonnement. L'intuition spontane est soumise l'preuve de la rfexion
et de la pense discursive. A vrai dire, pour prouver l'existence des Ides, il faut la thorie
des Ides tout entire, dans ses premiers principes et dans ses dernires consquences. Si
cette thorie claire toutes choses, si elle vient bout de toutes les difcults, si elle rsiste,
tous les eforts de la dduction, alors l'objet de la foi naturelle aura pour ainsi dire reu
ses titres de lgitimit scientifque. La science et la logique auront confrm ce que la
pense et l'amour, par une induction rapide quoique rgulire, avaient dj saisi. L'Ide,
objet de croyance, sera devenue objet de science. Ce ne sera plus une hypothse, mais un
principe vident.
Toute la thorie des Ides est donc une preuve des Ides. Platon veut faire voir que sa
doctrine est la vraie, qu'elle seule est vivante, qu'elle seule assure le progrs de l'esprit ;
pour cela, il rpond aux objections comme Diogne Znon d'Ele: en marchant.
De l la ncessit d'tablir, dans tout travail sur les Ides, une gradation continue qui,
partant de la naturelle, aboutisse la conviction raisonne, aprs avoir tour tour remont
ou redescendu la longue srie des principes et des consquences. Ce n'est pas trop de tous
les procds de l'esprit et de toutes les ressources de la science pour dmontrer les Ides;
car les Ides sont la science mme; et c'est en se constituant, en vivant, en marchant, que la
science dmontre sa propre valeur.
En rsum, la vritable mthode philosophique, d'accord avec la doctrine de Platon et avec
le tmoignage d'Aristote, aboutit . la division suivante des preuves de l'existence des
Ides
1 Preuve psychologique par l'tude des conditions de la connaissance (le Thette).
2 Preuve ontologique par l'tude des conditions de l'existence (le Phdon, le Philbe, la
Rpublique, etc.). Cesont les deux preuves inductives.
3 Preuves logiques par l'analyse des consquences ; ou vrifcation de la thorie par ses
applications de toute espce, mtaphysiques, morales, politiques, esthtiques.
III. Dogmatisme de Platon.
L'ensemble de ces preuves, aux formes extrmement libres et varies, et dont la porte
semble parfois toute ngative, n'en constitue pas moins un dogmatisme trs rel, mais trop
comprhensif pour tre rduit aux troites proportions des systmes ordinaires. On a
souvent mis en doute le dogmatisme de Platon ; parfois mme la libre allure de son gnie,
sa dialectique ondoyante et diverse ont fait 'souponner de scepticisme l'esprit le plus
spculatif, le plus hardi et le plus croyant de l'antiquit. Un de ses plus rcents. et de ses
plus habiles commentateurs, M. Grote (09), n'a gure aperu ou du moins n'a gure
apprci que ce qu'il appelle la veine ngative de Platon (the ngative vein) et sa mthode
d'examen contradictoire, d'examen en croix (cross-examination) (10). C'est l assurment
une des parties les plus admirables du Platonisme; c'est la pense grecque dans toute sa
libert d'investigation scientifque, aimant dployer sa vigueur et sa souplesse aux luttes
intellectuelles; mais enfn, c'est le ct socratique et znonien, parfois mme sophistique,
plutt que platonicien. Ce n'est l pour Platon qu'un procd d'essai pralable et comme
d'exprimentation dialectique; mais sa mthode embrasse, noms le verrons, une foule
d'autres procds. Nous pouvons l'appeler, avec M. Grote, mais dans un autre sens, une
mthode. d'examen en croix. Il y a presque toujours, en efet, dans la doctrine de Platon,
quatre thses opposes qui se croisent pour ainsi dire, et qui nous font voir chaque
question sous quatre aspects principaux et galement ncessaires une solution complte.
Le Parmnide est l'exemple le plus rigoureux de ce quadruple procd auquel Platon
soumet toute question ; mais, en lisant les autres dialogues dont la forme est moins
rgulire, il ne faut pas oublier de complter la pense parfois inacheve de Platon d'aprs
la mthode qu'il emploie clans le Parmnide, dans le Sophiste et dans le Philbe, et dont il a
toujours t plus ou moins proccup. Dans le Parmnide, Platon pose successivement la
thse, l'antithse, la ngation de l'une et de l'autre ( ), et,
enfn l'afrmation simultane de l'une et de l'autre ( ). Ce sont l, comme on
dirait aujourd'hui, quatre moments ncessaires de la pense qui forment, si l'on veut, un
examen en croix de la question.. A vrai dire, c'est plutt une trilogie comprenant une thse
afrmative, une antithse ngative, et une synthse, d'abord ngative, puis afrmative.
Sans doute, Platon n'emploie pas ces trois procds d'une manire constante, uniforme et
comme systmatique; mais il n'en a pas moins compris que sa thorie des Ides aboutissait
ncessairement cette suite dialectique d'afrmations et de ngations. Nous verrons dans
le Sophiste que chaque Ide contient beaucoup d'tre et beaucoup de non-tre. Une Ide
est ce qu'elle est, et n'est pas une multitude d'autres choses ; ct de sa dtermination
positive, de son unit et de son identit, elle contient toujours une multiplicit de
difrences ngatives; c'est ce qui rend ncessaire l'apparition d'une Ide suprieure qui
embrasse dans une synthse plus large, dans une dtermination plus comprhensive, les
Ides infrieures qui ont servi de point de dpart. La dialectique consiste. dans cette srie
d'analyses et de synthses faisant d'un plusieurs, de plusieurs un. Platon applique cette
mthode aux systmes de ses devanciers : il les pose, les oppose et les concilie: Par
exemple, dans le Sophiste, il met en contraste le systme de l'universel mouvement et celui
de l'universel repos (thse et antithse); puis il conclut que ni l'un ni l'autre n'est la vrit
(synthse ngative ou double ngation, ), parce que l'un et l'autre sont vrais la
fois sous divers rapports (synthse afrmative ou double afrmation, ).
Dmontrer, pour Platon, ce n'est, pas s'attacher un principe exclusif et se contenter d'en
dduire les consquences logiques; c'est complter un principe par un autre, une
consquence par une autre, une Ide par une Ide; dmontrer, c'est montrer les Ides sous
tous leurs aspects; c'est ne ngliger aucune ngation comme aucune afrmation ; c'est
tourner et retourner l'objet en tous sens sous le regard de la pense. Dmontrer, c'est faire
voir une Ide, comme un rayon de lumire, se rfchissant dans tous les sens et dans tous
les milieux, dveloppant toutes ses nuances et ses ombres comme ses clarts; puis le
dialecticien runit tous les rayons en un mme faisceau; les concentre en une mme
lumire et les rattache au foyer universel, au soleil intelligible, unit suprme d'o drive la
multiplicit infnie des essences et des intelligences. En un mot, dmontrer, c'est
comprendre ; et comprendre, c'est embrasser la multiplicit tout entire dans l'unit.
Platon n'est pas de ceux qui disent : qui trop embrasse, mal treint; il dirait plutt: qui
n'embrasse pas tout, n'treint rien ; la vrit, qu'il croit alors tenir d'un ct, lui chappe de
l'autre. De l une critique impitoyable des systmes troits qui osent dire : je suis la vrit,
toute la vrit; mais cette critique n'est ngative qu' l'gard des ngations mmes, et ce
que Platon laisse toujours entrevoir au del, c'est l'afrmation des Ides (11).
Beaucoup de dialogues ont ce caractre ngatif, mais, il en est aussi beaucoup qui sont
ouvertement dogmatiques. Il est du reste certain que les dialogues crits avaient presque
toujours aux yeux de Platon un caractre plus ou moins sotrique il les considrait
comme une prparation un enseignement plus intime et. plus rgulier, c'est--dire aux
leons orales - (12) Il n'y avait aucune contradiction entre
l'enseignement crit et l'enseignement non crit (13) ; mais il est clair priori, et d'aprs le
tmoignage d'Aristote, que les leons orales taient plus systmatiques et plus hardies
dans leurs afrmations. Aussi Aristote ne traite-t-il jamais Platon comme un sceptique: il
lui reproche beaucoup plutt de trop afrmer que de trop nier; pour lui, Platon est tout
entier dans la thorie des Ides et toutes les parties de sa philosophie s'y ramnent ; toutes
ses penses convergent vers ce point.
Nous ne prterons donc pas Platon un dogmatisme tranger ses habitudes en ramenant
sa philosophie la thorie des Ides; nous montrerons dans tous ses dialogues, ou
d'videntes allusions cette thorie, ou des arguments directs tendant 'l'tablir et la
confrmer. Nous serons seulement obligs de mettre dans les diverses parties du systme
un ordre plus rgulier que les dialogues ne peuvent l'ofrir.
Nous ne ferons que recomposer ainsi l'aide des dialogues eux-mmes et avec le secours
d'Aristote l'enseignement oral des . Par l, nous appliquerons
Platon lui-mme sa propre mthode : embrassant dans le dtail de ses parties et dans
l'unit de l'ensemble sa vaste doctrine, nous ferons d'un plusieurs, et de plusieurs un; ce
que nous mettrons sous les yeux du lecteur, ce ne sera pas seulement la forme extrieure
du platonisme et ses apparences multiples; ce sera son intime unit et comme sa ralit
intelligible ; en un mot, ce sera l'Ide de la philosophie platonicienne.
CHAPITRE II.
PREUVE DE L'EXISTENCE DES IDES PAR L'ANALYSE DES CONDITIONS DE LA
CONNAISSANCE.
I. La sensation. Rfutation d'Hraclite et de Protagoras dans le Thtte. II. L'opinion.
Analyse des jugements mdiats et comparatifs. La dfnition. - III. La pense discursive et
le raisonnement dductif. lments de la mthode gomtrique : les fgures, la
dmonstration, les principes et les axiomes. - IV. La pense intuitive. L'induction et les
vrits gnrales. Caractres de ces vrits. Rapport de l'universalit et de la perfection. En
quoi consiste la puret et la simplicit d'une notion. Qu'est-ce que la science? Comment
elle a pour principe les Ides.
Il est une question qui domine toutes les autres, qui rsume tous les problmes en un seul,
et dont les sciences particulires supposent la solution sans pouvoir elles-mmes la donner
: - Qu'est-ce que la science?
Une rponse complte cette question, si elle tait possible, nous rvlerait, avec les
principes de la connaissance, les principes mmes de l'tre, et nous serions en possession
de la sagesse absolue, sagesse plus qu'humaine, sans doute. Cependant, l'homme peut sen
rapprocher sans cesse; son me enveloppe la science infnie, et il n'y a de limit que le
dveloppement actuel de cette science. Ne possdons-nous pas une partie de la vrit, et
d'autre part, la vrit n'est-elle pas une en elle-mme? S'il en est ainsi, nous la possdons
implicitement tout entire. La pense, dit Socrate Thtte, porte dans son sein la vrit
et l'tre ; elle voudrait les produire au dehors, et dans son efort laborieux, elle prouve
toutes les douleurs de l'enfantement.
Qu'est-ce que la science? qu'est-ce que la pense? - Pour rpondre cette question,
l'intelligence se replie sur elle-mme, et ce qu'elle aperoit tout d'abord en elle, pour -ainsi
dire sa surface, c'est la sensation.
I. La sensation.
Avant la sensation, l'intelligence tait comme endormie, renfermant en elle-mme la vrit,
mais sans le savoir et sans prouver le besoin de la mettre au jour. Par la sensation le
monde extrieur agit sur elle, la provoque, la rjouit ou la tourmente ; la tire enfn de s'a
torpeur et de son sommeil. Elle voit, elle entend, elle sent, elle connat. Supprimez la
sensation, vous supprimez la connaissance. Savoir, dit Thtte, n'est autre chose que
sentir. Ce qui est pour nous, c'est ce qui nous apparat. Comment donc faire une distinction
entre l'apparence et la ralit? Cette ralit que vous supposez derrire le phnomne,
comment vous est-elle rvle, si elle ne vous apparat pas? La substance mme n'est
accessible la pense que si elle devient une apparence; le paratre est donc identique
l'tre, et l'homme, par la sensation, est la mesure de toutes choses, de l'existence de celles
qui existent, et de la non-existence de celles qui n'existent pas (14). La sensation est un
changement produit dans l'me ; c'est cette transformation intrieure par laquelle nous
apparat ce qui nous tait d'abord cach. La sensation succde la sensation, l'apparence
l'apparence, et ce mouvement sans fn est la pense.
L'apparence tant identique l'existence, le mouvement de la premire se retrouve
ncessairement dans la seconde : tout change, tout s'coule, et Hraclite avait raison de
dire avec tristesse : On ne se baigne pas deux fois. dans le mme feuve. Dans ce fux et
refux perptuel des choses, rien n'est absolument. - On ne peut attribuer quoi que ce
soit aucune dnomination, aucune qualit ; si on appelle une chose grande, elle paratra
petite ; pesante, elle paratra lgre, et ainsi du reste ; rien n'est un, ni afect d'une qualit
fxe ; mais du mouvement rciproque et du mlange de toutes choses se forme tout ce que
nous disons exister, nous servant en cela d'une expression impropre ; car rien n'est, mais
tout se fait. Les sages, l'exception de Parmnide, s'accordent sur ce point : Protagoras,
Hraclite, Empdocle ; les plus excellents potes dans tous les genres de posie; Epicharme
dans la comdie (15), et dans la tragdie, Homre. En efet, Homre n'a-t-il pas dit : -
L'Ocan, pre des dieux, et Thtis leur mre; - donnant entendre que toutes choses sont
produites par le fux et le mouvement?
Telle est l'antique doctrine des Ioniens, que Protagoras avait expose dans son livre de la
Vrit. N'est-elle point la ngation de la Vrit mme ?
Puisque la sensation est la science, dit Socrate, je m'tonne que Protagoras, au
commencement de son livre, n'ait pas dit que le pourceau, le cynocphale, ou quelque tre
encore plus bizarre, capable de sensation, est la mesure de toutes choses (16). Pourquoi
encore, si chacun est la mesure de la Vrit, Protagoras se croit-il en droit d'enseigner les
autres et de mettre ses leons un si haut prix? Quant la dialectique, cet art d'examiner
et de rfuter les opinions contraires la vrit, qu'est-ce autre chose qu'une insigne
extravagance, puisque toute opinion est vraie pour chacun?
Si la sensation est la science, il suft d'entendre la langue des barbares pour savoir cette
langue; de regarder les lettres d'un livre pour savoir les lire (17). La Nature est un livre
ouvert devant nos regards, et dont les sensations sont les signes. Suft-il donc de sentir
pour comprendre?
Si la science est la sensation et disparat avec elle, il ne peut y. avoir aucune science du
pass. Celui qui voit un objet le connat ; ferme-t-il les yeux, il a beau s'en souvenir, il ne le
connat plus, puisqu'il ne le sent plus. La mmoire est donc impossible ; notre science,
exclue du pass et par l mme de l'avenir, est renferme dans l'espace infniment petit du
prsent (18).
S'il y a connaissance partout o il y a sensation, celui qui regarde un objet avec un seul il
et tient l'autre ferm, voit et ne voit pas, sent et ne sent pas, connat et ne connat pas. La
contradiction qui existe entre les sensations passe dans la science elle-mme ; tout est vrai,
et en mme temps tout est faux.
Il y a plus : Protagoras, en reconnaissant que ce qui parat tel chacun est, accorde que
l'opinion de ceux qui contredisent l sienne est vraie. Et puisque sa prtendue vrit est
conteste par tout le monde, elle n'est vraie ni pour personne ni pour lui-mme.
Examinons maintenant, non plus les consquences logiques de la doctrine ionienne, mais
ses consquences morales et sociales.
- Le juste, c'est ce qui parat tel chacun ; il n'y a donc plus de justice absolue; le bien et le
mal sont choses toutes relatives. Une loi est juste tant qu'elle. est tablie, mais non au del;
elle est juste pour ceux qui la croient telle, mais elle n'a pour les autres aucun caractre qui
commande le respect.
Qu'importe le juste, dira Protagoras, pourvu que l'utile subsiste (19)? Le sage ne connat ni
le vrai ni le juste, choses chimriques; mais il sait ce qui est agrable et avantageux : c'est
par l qu'il l'emporte sur les autres hommes, et qu'il est le meilleur des politiques. - Mais
comment comprendre, rpond Socrate, que tout le monde ne soit pas apte juger de ce qui
est utile, si tout le monde est galement apte juger de ce qui est vrai? L'utilit regarde
l'avenir, et c'est pour l'avenir qu'une lgislation est faite. Dirons-nous donc que l'homme a
en lui la rgle propre juger les choses venir, et qu'elles deviennent pour chacun tel qu'il
se fgure qu'elles seront? Est-ce le malade ou le mdecin qui aura l'opinion la plus juste
sur la nature et le traitement d'une maladie? Toute cit qui se donn des lois est-elle
incapable d'erreur sur l'utilit future de ses lois? Protagoras avoue lui-mme que l'avenir ,
dpassant les limites de la sensation prsente, chappe la science; il doit donc avouer que
l'utile, ayant pour objet l'avenir, lui chappe galement; et la science politique n'est pas
moins impossible que la science morale dans le systme de la sensation (20).
Serrons encore de plus prs ce systme, et au lieu d'emprunter la logique et la morale
des objections qui pourront toujours paratre extrieures, pntrons jusqu'au fond des
choses ; soumettons l'preuve le principe mme de la doctrine, la sensation prtendue
infaillible. Examinons cette essence toujours en mouvement, et en la frappant comme un
vase, voyons si elle rend un son bon ou mauvais (21). .
Il y a deux espces de mouvement. L'un est un changement de qualit, l'altration; l'autre
un changement de lieu, la translation. Dirons-nous que tout se meut, mais d'un seul de ces
mouvements? Alors, par rapport au mouvement contraire, tout serait en repos. Pour tre
consquent avec lui-mme, Hraclite doit admettre la fois les deux mouvements tout
s'altre et en mme temps change de lieu. S'il en est ainsi, aucune qualit n'est fxe :
couleur, saveur, odeur, tout s'coule et s'chappe dans un perptuel mouvement
d'altration, et aucune qualit ne peut tre dtermine par le langage. On ne saurait donc
dire d'un homme qu'il voit plutt qu'il ne voit pas, qu'il a telle sensation plutt qu'il ne l'a
pas. La sensation n'est pas plus sensation qu'autre chose ; elle n'est pas plus la science que
le contraire de la science. Les qualits, mme relatives, s'vanouissent dans une
indtermination invincible ; non seulement il n'y a plus d'tre, mais il n'y a pas mme de
devenir. Tous ces termes, par lesquels on essaie de dterminer un objet, portent en eux-
mmes leur contradiction. La seule expression qui reste, c'est : en aucune manire; ou plutt,
le silence seul convient devant ce fux ternel des choses ; il ne faut pas nommer les objets,
ni ne faut pas mme les montrer du doigt : il faut s'abandonner passivement au torrent qui
emporte la fois la nature et l'humanit.
Telle est la lgitime conclusion du systme d'Hraclite. Protagoras invoqu ce systme
l'appui du sien; et il ne s'aperoit pas que sa propre doctrine est dtruite par la preuve
mme qu'il en donne, que sa vrit disparat, avec toute vrit, au milieu de la
contradiction et de l'indtermination universelles.
Concluons que la sensation ne peut se sufre elle-mme; elle contient en elle sa propre
ngation : si elle est seule, elle n'est rien. Pour exister, au moins faut-il qu'elle soit sentie.
Au lieu de considrer seulement la surface de l'me, pntrons plus avant. Sous la
multiplicit des sensations, pures manires d'tre, la conscience n'aperoit-elle pas l'unit
de l'tre? Toutes les impressions du dehors ne viennent-elles pas aboutir un centre
commun? Ce n'est point l'il qui voit, ni l'oreille qui entend ; c'est l'me qui voit et entend
par le moyen des organes. Il serait trange, en efet, qu'il y et en nous plusieurs organes
des sens, comme dans des chevaux de bois, et que nos sens ne se rapportassent pas tous
une seule essence, qu'on l'appelle me ou autrement, avec laquelle, nous servant des sens
comme d'instruments, nous sentons tout ce qui est sensible (22). Ainsi, la ralit que
l'cole ionienne accordait faussement aux sensations, il faut la leur retirer si on veut que les
sensations elles-mmes subsistent, car elles empruntent leur existence mobile et fugitive au
principe permanent qui est leur centre commun.
Il y a plus. Supposons que la sensation, rduite elle-mme, puisse encore subsister. Du
moins elle ne pourra sortir de ses propres limites pour apercevoir les autres sensations,
soit passes, soit prsentes, et toute notion de rapport lui chappera. Ce que tu sens par
un organe, il t'est impossible de le sentir par un autre ; comme de sentir par la vue ce que
tu sens par l'oue, ou par l'oue ce que tu sens par la vue. Si donc tu as quelque notion
commune sur les objets de ces deux sens pris ensemble, ce ne peut tre ni par l'un ni par
l'autre organe que te vient cette ide collective. Or, la premire ide que tu as l'gard du
son et de la couleur pris ensemble, c'est que tous les deux existent. Et aussi que l'un est
difrent de l'autre, et identique lui-mme. Que, pris conjointement ils sont deux, et que
chacun pris part est un. Toutes ces ides, par quel organe les acquiers-tu ? Car ce n'est ni
par l'oue ni par la vue qu'on peut saisir ce que la couleur et le son ont de commun (23). -
Il me parat que nous n'avons point d'organe particulier pour ces sortes de choses; mais
que notre me examine immdiatement par elle-mme ce que tous les objets ont de
commun. - Tu juges donc qu'il y a des objets que l'me connat par elle-mme, et d'autres
qu'elle connat par les organes du corps... Dans laquelle de ces deux classes ranges-tu
l'tre? Car c'est ce qui est le plus gnralement commun toutes choses? - Dans la classe
des objets avec lesquels l'me se met en rapport immdiatement et par elle-mme. - En est-
il de mme de la ressemblance et de la dissemblance, de l'identit et de la difrence? - Oui.
- Et du beau et du laid, et du bien et du mal ? - Ces objets surtout sont du nombre de ceux
dont l'me examine l'essence en les comparant et en combinant en elle-mme le pass et le
prsent avec le futur... - Ainsi donc, il est des choses qu'il est donn aux hommes et aux
animaux de sentir, ds qu'ils sont ns : celles qui passent jusqu' l'me par l'organe du
corps; au contraire, les rfexions sur les sensations, par rapport leur essence et leur
utilit, on n'y arrive qu' la longue, quand on y arrive, avec beaucoup de peine, de soins et
d'tudes. - Assurment. - Mais est-il possible que ce qui ne saurait atteindre l'essence,
atteigne la vrit? Aura-t-on jamais la science quand on ignore la vrit? - Le moyen,
Socrate? - La science ne rside donc pas dans les sensations, mais dans la rfexion sur les
sensations, puisqu'il parat que c'est par la rfexion qu'on peut saisir l'essence et la vrit, et
que cela est impossible par l'autre voie?... C'est prsent surtout que nous voyons avec la
dernire vidence que la science est autre chose que la sensation (24). La sensation, en
efet, concentre dans le moment prsent et isole en elle-mme, ne peut nous fournir ces
ides universelles et infnies d'existence, d'unit, d'identit, de bien et de beau, qui
embrassent tous les objets, tous les lieux et tous les temps; ides ncessaires et absolues,
qui se rapportent l'essence des choses, par consquent la vrit mme, et sans le secours
desquelles il n'y a point de science possible.
O donc est l'origine de ces ides, tellement suprieures la sensation que la sensation
elle-mme en a besoin pour tre perue, connue et conserve dans la mmoire? Si nous
parvenions dcouvrir cette origine, ne serions-nous pas remonts jusqu' la source la
plus haute de la science? - Maintenant du moins nous sommes assez avancs pour ne
plus chercher la science dans la sensation, mais dans une opration de l'me, quel que soit
le nom qu'on lui donne, par laquelle elle considre elle-mme les objets (25).
II. L'opinion.
La premire solution qui se prsente, c'est d'attribuer les ides d'tre, d'unit, d'identit, et
les autres principes de la science au travail logique de l'esprit sur les sensations.
Dans l'opinion, l'me ne fait autre chose que s'entretenir avec elle-mme, interrogeant et
rpondant, afrmant et niant. Or, quand elle se dcide, que cette dcision se fasse plus ou
moins promptement, quand elle sort du doute et qu'elle prononce, c'est cela qu'il faut
appeler avoir une opinion (26).
Le point de dpart de l'opinion, la matire sur laquelle elle s'exerce, c'est la sensation, soit
actuelle, soit conserve dans la mmoire (27). L'esprit s'adresse une question (28); il se
demande quel rapport existe entre plusieurs sensations ou entre une sensation et une
pense, ou entre plusieurs penses (29). Pour dcouvrir ce rapport, il revient sur ses
souvenirs : c'est la rfexion; puis il les compare, et enfn il exprime le rsultat de sa
comparaison dans un jugement, sorte de parole intrieure qui met fn au doute, et
prononce (30).
Sensation, souvenir, rfexion, comparaison, jugement, tels sont les procds de l'opinion
proprement dite. Sufsent-ils la science?
Le souvenir ne cre pas la science, il la prsuppose. De mme, la rfexion n'est qu'une
opration ultrieure et un retour de la pense sur ce qu'elle possdait dj.
Peut-tre la science est-elle dans le jugement comparatif? - D'abord, ce n'est pas la
comparaison qui cre les deux termes du jugement; au contraire, pour que la comparaison
soit possible, il faut que les deux objets comparer soient donns antrieurement et dj
connus en eux-mmes.
Supposons que ces lments soient donns; comment savoir si le rapport tabli entre eux
par le jugement est conforme aux trois rapports des choses? Pour le savoir, il faudrait une
comparaison nouvelle entre la ralit et notre pense, entre l'objet reprsent et l'ide qui le
reprsente. Cette comparaison, son tour, n'a de valeur qu'autant que les deux termes sont
parfaitement connus en eux-mmes. Donc, pour comparer notre pense l'objet rel, il
faut dj connatre cet objet et le bien connatre; on aboutit ainsi un cercle vicieux.
Si la vrit et la science consistaient dans un rapport de convenance entre un sujet et un
attribut, l'erreur se rduirait une mprise. Ce faux jugement consisterait prendre une
chose pour une autre et afrmer ainsi un rapport inexact entre les deux termes de la
comparaison. Or, supposez ces deux termes galement inconnus, il est clair que la mprise
sera impossible; supposez que l'un soit connu et que l'autre ne le soit pas, l'impossibilit
sera la mme, car on ne peut comparer une chose que l'on connat une autre chose dont
on n'a pas mme l'ide. Il faut donc que les deux termes de la comparaison soient
pralablement connus; mais alors comment les confondre l'un avec l'autre? Il faut
admettre, pour expliquer une telle confusion, que l'on connat et que l'on ne connat pas
tout ensemble le mme objet. L'erreur est donc aussi inexplicable que la science, et on ne
peut les distinguer l'une de l'autre si on est rduit juger toutes choses par comparaison
(31).
L'impuissance de cette espce de jugement apparatrait avec bien plus d'vidence encore, si
on lui demandait d'expliquer les notions universelles d'tre, d'identit, de difrence et les
autres ides pures. Dans la comparaison, la pense cherche la ressemblance ou la
difrence; et si elle les cherche, elle en a donc dj la notion. L'tre, l'galit, l'ingalit, la
ressemblance, la difrence, sont comme des types sur lesquels se rgle le jugement pour
prononcer que tel objet existe, qu'il est gal tel autre objet ou qu'il lui est ingal. De l
encore la ncessit d'un savoir antrieur toute comparaison.
Au-dessus du jugement comparatif, au-dessus de l'opinion vraie, se trouve l'opinion
accompagne d'explication et de notion, , qui a plus de porte que la
premire; peut-tre est-ce l que nous dcouvrirons enfn l'origine de la science.
La notion est due la dfnition, qui est de trois sortes:
1 La dfnition de mots consiste exprimer en termes prcis l'objet que l'on conoit, en
sorte qu'il se peigne dans la parole comme dans un miroir.
Demande-t-on, par exemple, qu'est-ce qu'un char? On pourra rpondre : ce sont des roues,
un essieu, des ailes, des jantes, un timon. Mais, outre que cette espce de dfnition
prsuppose encore la connaissance de l'objet, on peut exprimer en termes prcis l'erreur
comme la vrit (32).
2 La dfnition d'un tout par ses lments. Elle consisterait, par exemple, numrer par
ordre toutes les pices du char. C'est une division, une analyse qui aboutit des lments
simples et indivisibles.
Or, de deux choses l'une: ou bien ces lments chappent la connaissance, et alors, en
dfnissant an objet, vous le dfnissez par l'inconnu. En ce cas. la science se rsout dans
l'ignorance. Ou bien les lments, quoique simples et indcomposables, tombent
cependant sous la connaissance, et alors ce n'est pas la dfnition qui les fait connatre.
3 La troisime espce de dfnition se fait par la difrence; exemple: Le soleil est le plus
brillant de tous les corps clestes qui tournent autour de la terre.
Cette dfnition est suprieure la prcdente. Se borner l'numration de tous les
lments, de toutes les qualits d'un objet, ce n'est pas distinguer les qualits propres des
qualits communes; l'objet demeure donc comme absorb dans le genre dont il fait partie.
Aussi la dfnition, pour tre complte, doit-elle ajouter au genre les difrences. Est-ce l
enfn la science vritable? Non encore; car pour assigner la difrence d'un objet, il faut dj
connatre cet objet, et le connatre dans ce qu'il a de propre; autrement il demeurerait
confondu avec tous les autres et ne serait pas plus qu'un autre l'objet de la pense. Donc,
pour distinguer un objet des autres par la dfnition, il faut dj l'avoir distingu de tous
les autres par une vue pralable et immdiate. Nous retombons dans le mme cercle
vicieux.
Ainsi le jugement par dfnition ne dorme pas plus la science que le jugement comparatif;
et en gnral, tout jugement qui est le produit de la rfexion suppose des notions
spontanes auxquelles il s'applique.
Qu'il s'agisse de comparaison, de division, de dfnition, peu importe. Juger, c'est toujours
tablir des rapports entre plusieurs termes. Il y a donc deux choses considrer dans le
jugement : les deux termes et le rapport. Les deux termes ont besoin d'tre pralablement
connus; les rapports sont des relations d'identit, de difrence, d'galit, d'ingalit, ou
encore des relations de substance et de mode, de cause et d'efet, etc. Ces rapports sont
universels, absolus, ncessaires, quels que soient les termes qui les unissent; et tout
jugement n'est que l'application de ces rapports gnraux deux termes particuliers.
Diriez-vous que telle chose est, si vous ne possdiez pas dj en vous-mme, sous une
forme plus ou moins obscure, cette ide de l'existence qui dpasse de l'infni les tres
borns auxquels nous l'appliquons, et qui semble un modle idal dont nous retrouvons
l'imparfaite image dans les objets particuliers? Tout jugement implique cette ide, et aucun
jugement ne la donne (33).
De mme, pourrions-nous juger, si nous ne possdions pas les notions d'identit et de
difrence? L'afrmation ne suppose-t-elle pas que ce qui est est, et qu'une mme chose ne
peut tout la fois tre et n'tre pas sous le mme rapport. Ce qui est, dit Platon dans le
Sophiste, est identique soi-mme et autre que les autres choses. Ainsi l'intelligence
afrme, antrieurement tout jugement, l'identit intime et essentielle de l'tre, et
l'impossibilit o il est de recevoir son contraire (34).
A quelque point de vue qu'on se place, qu'il s'agisse des termes ou des rapports, l'opration
logique du jugement ne donne qu'une science drive et emprunte. L'opinion est la
science ce que l'image est l'objet (35). O donc trouver la science primitive, la science
immdiate qui se suft elle-mme, qui contient en elle sa propre raison et donne la raison
de toutes les autres connaissances ? De la sensation l'opinion vraie, de l'opinion vraie
l'opinion raisonne, nous avons cherch vainement la science. Elevons-nous plus haut
encore, et de l'opinion raisonne passons au raisonnement pur (36).
III. La pense discursive.
La ou pense discursive, c'est la dduction, principalement celle des gomtres,
avec tous ses procds accessoires : dfnitions o l'on pose des principes (),
fgures dont on s'aide en raisonnant (), etc.
Dans les mathmatiques, l'me se sert des donnes du monde sensible comme d'autant
d'images, en partant de certaines hypothses, non pour remonter au principe, mais pour
descendre la conclusion... Les gomtres et les arithmticiens supposent deux sortes de
nombres, l'un pair, l'autre impair, les fgures, trois espces d'angles; et ainsi du reste, selon
la dmonstration qu'ils cherchent. Ces hypothses une fois tablies, ils les regardent
comme autant de vrits que tout le monde peut reconnatre, et n'en rendent compte ni
eux-mmes ni aux autres; enfn, partant de ces hypothses, ils descendent par une chane
non interrompue de propositions, en demeurant toujours d'accord avec eux-mmes,
jusqu' la conclusion qu'ils avaient dessein de dmontrer... Ils se servent sans doute de
fgures visibles et raisonnent sur ces fgures; mais ce n'est point elles qu'ils pensent, c'est
d'autres fgures reprsentes par celles-l. Par exemple, leurs raisonnements ne portent pas
sur le carr, ni sur la diagonale, tels qu'ils les tracent, mais sur le carr tel qu'il est en lui-
mme avec sa diagonale. J'en dis autant de toutes sortes de formes qu'ils reprsentent, soit
en relief, soit par le dessin. Les gomtres les emploient comme autant d'images, et sans
considrer autre chose que ces autres fgures dont j'ai parl, qu'on ne peut saisir que par la
pense, . Ces fgures, j'ai d les ranger parmi les choses intelligibles; pour les
obtenir, l'me est contrainte de se servir d'hypothses, non pour aller jusqu'au premier
principe; car elle ne peut remonter au del de ses hypothses (
); mais elle emploie les images qui lui sont fournies par
les objets terrestres et sensibles, en choisissant toutefois parmi ces images celles qui,
relativement d'autres, sont regardes et estimes comme ayant plus de nettet. - Je
conois que tu parles de ce qui se fait dans la gomtrie et les autres sciences de cette
nature... Ces arts ont pour principes des hypothses, et ils sont bien obligs de se servir du
raisonnement () et non des sens () ; mais ne remontant pas au principe
( ' ) et partant au contraire d'hypothses ( ), ils ne te
semblent pas appartenir l'intelligence ( ), bien qu'ils devinssent intelligibles
avec un principe ( ); et tu appelles connaissance
raisonne celle qu'on acquiert au moyen de la gomtrie et des autres arts semblables, et
non pas intelligence, cette connaissance tant comme intermdiaire entre l'opinion et la
pure intelligence. - Tu as fort bien compris ma pense (37).
La est donc, sans aucun doute, le raisonnement gomtrique, la dduction ; et
Platon croit que la vritable science n'est pas encore l. Rsumons les raisons qu'il en
donne.
La mthode gomtrique comprend quatre procds : 1 les images sensibles ou fgures
(); 2 le raisonnement dductif () ; 3 les principes du raisonnement
(, ); 4 la loi du raisonnement : savoir l'absence de toute contradiction
( ), en d'autres termes l'axiome d'identit.
La dduction descend du principe la consquence, et ne peut remonter plus haut
( ). Simple analyse, elle ne sort pas des limites o elle s'est comme
enferme ; elle explore et creuse un domaine dont elle ne saurait reculer les bornes. En
d'autres termes, elle suppose des principes.
C'est aux principes que le raisonnement emprunte sa valeur absolue. Une dduction exacte
peut aboutir une conclusion fausse. Le raisonnement ne contient par lui-mme ni vrit
ni fausset, ou du moins il n'a qu'une valeur intrinsque, relative, qui vient de ce qu'il est
ou n'est pas conforme sa loi propre.
Cette loi, nous l'avons vu, c'est l'accord de la pense avec elle-mme, . De
mme que le jugement tablissait un rapport entre plusieurs notions, le raisonnement
tablit un rapport entre plusieurs jugements. C'est le rapport du mme au mme; c'est la
loi de l'identit qui veut que l'tre vritable ne puisse recevoir son contraire. Les contraires
sont mls dans la sensation, o se confondent le grand et le petit, la ressemblance et la
difrence, le beau et le laid. Par le jugement, par le raisonnement, par toutes les oprations
logiques, la pense spare ce que la sensation runit. Au lieu de cette opposition, elle veut
l'harmonie; sous cette contrarit, elle cherche l'unit. Elle sait donc dj que l'unit existe;
elle le sait puisqu'elle la cherche; et ce n'est pas aux sens, ce n'est pas au jugement, ce n'est
pas au raisonnement qu'elle doit cette science. Ces grandes, notions de l'existence, de la
vrit, de l'identit, qui sont les lois de toute opration logique, ne peuvent elles-mmes
rsulter de ces oprations, puisque l'esprit humain tournerait ainsi dans un cercle vicieux.
On le voit, la dduction n'emprunte pas seulement des principes suprieurs sa vrit
absolue ; elle leur emprunte jusqu' cette vrit imparfaite et relative qui rsulte de sa
conformit avec sa loi; car cette loi elle-mme, cette loi de l'identit et de l'unit, qu'est-ce
autre chose qu'un principe?
Laissons donc de ct le raisonnement lui-mme et considrons les principes dont le
raisonnement drive. Certes, c'est dans la rgion des principes, c'est dans le domaine de la
, que nous trouverons la science, si la science existe.
IV. La pense intuitive.
Les mathmatiques ont pour principes les dfnitions du nombre, de la fgure, du triangle,
du cercle et autres objets semblables. Le gomtre les reprsente par des images sensibles;
mais tandis que ses yeux se fxent sur les fgures matrielles, sa pense est ailleurs. Il pense
au triangle idal, au cercle idal, aux nombres idaux, et il dveloppe par le raisonnement
tout ce que contiennent ces principes intelligibles. Seulement, il ne se rend pas compte
lui-mme et il ne rend pas compte aux autres des principes qu'il a poss : il les admet, mais
il ne les vrife pas. Ils ne sont pour lui que des hypothses; car, tout ce qui n'est pas par
soi-mme intelligible, tout ce qui n'a pas en soi-nime sa raison, ne satisfait pas
entirement l'esprit et conserve un caractre d'incertitude; la pense demande encore
quelque chose au del, elle veut s'lever plus haut, et tant qu'elle n'est pas remonte un
principe inconditionnel et absolu , elle comprend qu'elle n'est pas encore en possession de
la vritable science.
Ce que ne fait pas le mathmaticien, - rendre compte des principes sur lesquels il s'appuie,
- le philosophe doit le faire. Quelle est donc la vraie nature des conceptions gomtriques :
cercle, triangle,. fgures et nombres ? Comment ces conceptions naissent-elles dans l'esprit?
Nous savons que la dduction les suppose, et par consquent ne les explique pas. Il faut
chercher ailleurs leur origine.
I. Les conceptions gomtriques ont pour premier caractre la gnralit, .
L'opration intellectuelle dont elles sont le produit aura donc elle-mme pour premier
caractre de s'lever du particulier au gnral: elle impliquera la gnralisation, qui
runit les objets multiples sous l'unit de la notion universelle pour aboutir ainsi une
dfnition (38).
On reconnat le procd familier Socrate, l'induction ( ), qui conduit par la
gnralisation une dfnition universelle (
) (39). C'est l'induction qui fournit la dduction ses principes, car pour
descendre du gnral au particulier, il faut bien concevoir pralablement le gnral. La
dduction la plus simple, la plus lmentaire, suppose une induction antrieure : pour
raisonner sur l'homme, sur l'animal, sur le bien, sur la justice, sur les fgures, sur les
nombres, il faut concevoir tons ces objets sous la forme de l'universel : il faut gnraliser.
Tant l'induction est suprieure la dduction ! Socrate le comprenait, et il voyait dans
l'induction la science mme (40). Platon approfondit son tour la nature du procd
socratique : et ses yeux, l'induction est trs voisine de la science, si voisine qu'elle se
confond presque avec elle ; cependant, elle n'est pas encore la science. C'est ici que le
disciple va se sparer du matre; c'est ici que la thorie des Ides va commencer.
L'induction a pour point de dpart les donnes des sens. C'est par la vue, c'est par le
toucher, c'est par l'oue, dit Platon, qu'il faut dbuter; toute autre voie est impraticable (41).
Point de gnralisation possible sans la perception des objets particuliers ; pour concevoir
l'unit, , il faut avoir peru le multiple. Est-ce dire que l'ide gnrale
soit un simple. rsum des sensations individuelles, et dans cette recherche des principes
de la science, serions-nous ramen aprs un long dtour notre point de dpart, la
sensation ?
Il faudrait pour cela qu'il n'y et rien de plus dans l'ide gnrale que dans les diverses
perceptions qui l'ont fait natre. Or, il y a dans l'ide gnrale un lment tout fait
nouveau ; je veux dire la gnralit mme.
La gnralit n'est dans aucune sensation particulire : rien de plus vident. Elle n'est pas
non plus dans une certaine somme de sensations. Toute somme, en efet, est fnie et
multiple. La gnralit, au contraire, implique la fois l'infnit et l'unit. Une notion
gnrale n'a-t-elle pas une extension sans limites? La notion du cercle, par exemple, ne
convient-elle pas, non seulement un certain nombre de cercles, mais tous les cercles
rels ou possibles? Vous n'avez cependant aperu par les sens qu'un nombre limit d'objets
ayant la forme circulaire; ajoutez-les l'un l'autre, vous n'obtiendrez rien d'infni et
d'universel. De plus, toute somme est multiple, tandis que l'ide gnrale est une.
Runissez et confondez dans votre mmoire un nombre quelconque de. sensations, et vous
obtiendrez une image vague dont la multiplicit se refusera toute dtermination, par
consquent toute dfnition. L'image ne se dfnit pas plus que la sensation elle-mme
dont elle n'est que le souvenir indcis et demi efac : c'est une ombre infrieure en
nettet l'objet qu'elle reprsente; c'est un refet afaibli dont les contours sont
insaisissables. L'ide, au contraire, est nette et prcise : elle peut se dfnir, elle est le
principe mme de la dfnition. Ainsi, par sa gnralit infnie, elle est au-dessus de tout
nombre ; elle embrasse le prsent, le pass et l'avenir ; elle satisfait la pense qui ne se
repose que dans l'universel. Mais en mme temps, par son unit et sa dtermination, elle
ofre une prise la dfnition et la science. Infnie et fnie, multiple et une tout ensemble,
la notion gnrale runit en elle-mme le principe de l'identit et le principe de la
distinction. Ce n'est pas l'identit pure, chose suprieure ; ce n'est pas non plus la diversit
pure; c'est un terme intermdiaire, qui dpasse la sensation par son infnit et sa simplicit,
mais qu'il faut dpasser lui-mme pour remonter un principe plus lev encore. Au-
dessus de la notion gnrale, il y a les principes mmes de la gnralit, je veux dire l'infni
et l'universel, l'unit et l'identit, la distinction et la difrence, tous ces principes enfn que
nous avons dj vus apparatre comme conditions du jugement et du raisonnement, et qui
nous apparaissent de nouveau comme conditions essentielles de la gnralisation et de
l'induction.
Socrate avait donc tort de s'arrter la notion gnrale, ou du moins de la laisser
confondue avec les objets qui la font natre, comme si elle ne contenait pas un lment
nouveau et parfaitement spar de toutes les donnes sensibles; comme si elle tait le
produit d'un simple travail logique appliqu aux sensations. Sans doute, elle est due au
travail de l'esprit; mais pour accomplir ce travail, l'esprit a besoin de donnes suprieures,
qu'il faut poser part (). La gnralisation la plus simple et la plus lmentaire,
par cela mme qu'elle communique son produit un caractre de gnralit, implique la
conception de l'universel dans son unit et son infnit.
II. Que sera-ce, si les notions des genres ofrent l'esprit, outre leur caractre
d'universalit, un caractre de perfection? Dans les ides de cercle, de triangle, de nombres
et de fgures idales, nous avons considr seulement ce qu'on appellera plus tard
l'extension et la quantit de l'ide. Considrons maintenant avec Platon la qualit.
A ce nouveau point de vue, le contraste de la notion avec la sensation ou avec l'image
sensible est encore plus incontestable. La notion a pour caractre essentiel ce que Platon
appelle la: puret sans mlange, , , , c'est--dire cette
perfection d'une qualit qui exclut radicalement son contraire, et laquelle ne vient se
mler aucun dfaut. De mme que la blancheur par excellence, la blancheur parfaite, c'est
celle qui est pure et sans mlange, de mme le cercle parfait, le triangle vritable, la vraie
beaut, la vraie justice, excluent toute qualit contraire et tirent toute leur excellence de
leur puret absolue (42).
En est-il ainsi de la sensation? ou plutt, les objets qui frappent nos sens ne sont-ils pas le
plus souvent un mlange imparfait ides contraires? N'est-ce pas leur imperfection mme
qui nous force concevoir la perfection? N'est-ce pas leur mlange de beaut et de laideur,
de grandeur et de petitesse, de multiplicit et d'unit, qui nous fait penser, par contraste,
la beaut pure; la grandeur absolue, l'unit vritable? Ce sont les contradictions des sens
qui tonnent et veillent la pense; et cet tonnement fcond engendre la science : Iris est
flle de Thaumas.
Les perceptions des sens sont de deux sortes : Les unes n'invitent point l'entendement
la rfexion, parce que les sens en sont juges comptents; les autres sont trs propres l'y
inviter, parce que les sens n'en sauraient porter un jugement sain... J'entends comme
n'invitant point l'entendement la rfexion tout ce qui n'excite point en mme temps
cieux sensations contraires; et je tiens comme invitant la rfexion tout ce qui fait natre
cieux sensations opposes... voil trois doigts ; le petit, le suivant et celui du milieu.
Chacun nous parait galement un doigt; peu importe cet gard qu'on le voie au milieu ou
l'extrmit, blanc ou noir, gros ou menu, et ainsi du reste. Rien de tout cela n'oblige l'me
demander l'entendement ce que c'est. prcisment qu'un doigt; car jamais la vue n'a
tmoign en mme temps qu'un doigt ft autre chose qu'un doigt. Mais quoi? la vue
juge-t-elle. bien de la grandeur ou de la petitesse, de ces doigts..: ou de la grosseur et de la
fnesse, de la mollesse et de la duret au toucher? En gnral, le rapport des sens sur tous
ces points n'est-il pas bien dfectueux? Le sens destin juger ce qui est dur ne peut le
faire qu'aprs s'tre pralablement appliqu ce qui est mou, et il rapporte l'me que la
sensation qu'elle prouve est en mme temps une sensation de duret et de mollesse.
N'est-il pas invitable alors que l'me soit embarrasse de ce que peut signifer une
sensation qui lui dit dur, quand la mme sensation dit aussi mou? De mme pour la
pesanteur et la lgret... Ce n'est donc pas tort que l'me, appelant son secours
l'entendement et la rfexion, tche alors d'examiner si chacun de ces tmoignages porte
sur une seule chose ou sur deux? Et si elle juge que ce sont deux choses, chacune d'elles ne
lui paratra-t-elle pas une et distincte de l'autre? (Par exemple la grandeur lui semblera
une, et distincte de la petitesse ; ce sera la grandeur sans mlange de petitesse, dans son
unit, sa simplicit, sa puret). Si donc chacune de ces choses lui parat une, et l'une et
l'autre deux, elle les concevra toutes deux part (elle concevra la grandeur part de la
petitesse), car si elle les concevait comme n'tant pas spares, ce ne serait plus la
conception de deux choses, mais d'une seule (et il faudrait dire que la grandeur et la
petitesse ne font qu'un).
La vue, disions-nous, aperoit la grandeur et la petitesse comme des choses non
spares, mais confondues ensemble. Et pour claircir cette confusion, l'entendement, au
contraire de la vue, est forc de considrer la grandeur et la petitesse, non plus
confondues, mais spares l'une de l'autre. Voil ce qui nous fait natre la pense de nous
demander nous-mmes ce que c'est que grandeur et petitesse... C'est ce que je voulais te
faire entendre, lorsque je disais que, parmi les sensations, les unes appellent la rfexion,
savoir celles qui sont enveloppes avec des sensations contraires, et les autres ne l'appellent
point, parce qu'elles ne renferment pas cette contradiction. A laquelle de ces deux classes
rapportes-tu le nombre et l'unit? - Je n'en sais rien. - Juges-en par ce que nous avons dit. Si
nous obtenons une connaissance satisfaisante de l'unit par la vue ou par quelque autre
sens, cette connaissance ne saurait porter la pense vers l'tre, comme nous le disions tout
l'heure du doigt (l'tre, en efet, ou l'essence, objet de la science, exclut cette multiplicit
et cette indtermination qui rsulte du mlange des contraires). Mais si l'unit ofre
toujours quelque contradiction, de sorte que l'unit ne paraisse pas plus unit que
multiplicit, il est alors besoin d'un juge qui dcide ; l'me se trouve ncessairement
embarrasse, et rveillant en elle l'entendement, elle est contrainte de faire des recherches
et de se demander ce que c'est que l'unit; c'est cette condition que la connaissance de
l'unit est une de celles qui lvent l'me et la tournent vers la contemplation de l'tre.
C'est l prcisment ce qui arrive dans la perception de l'unit par la vue; nous voyons la
mme chose la fois une et multiple jusqu' l'infni. Ce qui arrive l'unit n'arrive-t-il pas
aussi tout nombre quel qu'il soit? - Oui. - Or la science du calcul et l'arithmtique ont
pour objet le nombre? - Sans contredit. - Elles conduisent par consquent la connaissance
de la vrit (43).
Elles y conduisent; mais elles ne sont pas cette connaissance mme. Elles occupent une
rgion intermdiaire entre la rgion des sens et le domaine de la science pure. Il en est de
mme de la gomtrie, de l'astronomie, et de toutes les tudes qui ont pour objet des
notions revtues du double caractre de l'universalit et de la puret absolues des (genres
ou des types) et qui ont par cela mme pour instrument la gnralisation ou induction.
Le point de dpart de ces tudes, ce sont les donnes sensibles, dans lesquelles il n'y a rien
de pur, de parfait, d'un et d'identique. La mme chose est grande et petite suivant le point
de vue ; elle est belle et laide, bonne et mauvaise. Il n'y a rien l que de relatif, et la pense
n'en peut rien afrmer que par comparaison. Mais ce relatif suppose l'absolu ; ces
afrmations par comparaison supposent une afrmation pure et simple, portant sur des
objets fxes, ayant leur essence propre, dtermins en eux-mmes, au lieu d'tre
dterminables seulement par rapport d'autres objets. Pas de science possible, si
l'induction ne vient gnraliser et purifer les donnes sensibles, en les ramenant, sous le
rapport de l'extension, l'unit de l'universel, et sous le rapport de la qualit, l'unit, du
parfait, exclusive de tout mlange. Mais l'induction, son tour, n'est possible que par
l'application aux choses sensibles de certains principes de gnralit et de perfection, en un
mot d'Unit. Ces principes, l'induction ne les fait pas ; elle les reoit d'ailleurs et les
applique. La science n'est pas dans' l'induction, mais dans les principes qui rendent
l'induction possible ; elle n'est pas clans les oprations logiques, mais dans les principes
mtaphysiques qui sont les conditions ncessaires de ces oprations.
Approfondissons la nature de ces principes de la science, si nous voulons savoir enfn en
quoi consiste la science.
III. Il y a plusieurs choses que nous appelons belles, et plusieurs choses, bonnes; c'est
ainsi que nous dsignons chacune d'elles. - Oui. - Et le principe de chacune, nous
l'appelons le beau, le bien; et nous faisons de mme de toutes les choses que nous avons
considres tout l'heure dans leur varit, en les considrant sous un autre point de vue,
dans l'unit de l'ide gnrale laquelle chacune d'elles se rapporte (44).
La pense ne peut tre satisfaite par la considration de tel objet beau, de tel objet bon; car
la beaut, la bont des choses particulires, est mle de laideur et de mchancet. La
pense conoit donc ncessairement un principe du beau et un principe du bien. Ce
principe devra exister partout o il y a quelque degr de beaut et de bont : car la cause
est partout o est l'efet; elle contient mme la raison, .non-seulement des efets actuels,
mais encore des efets passs ou venir, et mme des efets purement possibles. Le bien et
le beau, qui se trouvent clans les objets particuliers, supposent donc un principe qui
contienne dans son sein l'origine du rel et du possible, du prsent, du pass et de l'avenir.
Ce principe, en d'autres termes, est d'une gnralit absolue et infnie, et par l, il est un.
C'est quelque chose d'identique soi-mme, malgr la diversit des objets qui en drivent,
ou plutt cause de cette diversit mme. Tel est le premier caractre que l'esprit attribue
ncessairement au principe du beau et au principe du bien : l'unit de l'universel.
Ce n'est pas tout. Comment pourrions-nous juger que tel objet est beau ou bon, et surtout
que celui-ci est suprieur celui-l sous le rapport de la beaut et de la bont, si nous ne
concevions pas, derrire cette multiplicit. de degrs dans le bien et dans le beau, l'unit
d'un principe toujours gal lui-mme. Ce qui fait les degrs divers du bien et du beau
dans les objets particuliers, c'est que ces qualits y sont confondues avec des qualits
contraires; elles n'ont, dans les objets sensibles, ni puret ni simplicit. Or, il n'en peut tre
ainsi du principe mme qui produit le bien et le beau. Le principe du bien produit le bien
seul, et non le mal; autrement il serait faux de dire qu'il est le principe du bien; ce ne serait
mme pas un principe, mais je ne sais quoi d'indtermin et d'indifrent tous les
contraires. Donc nous ne concevons le bien imparfait, multiple, relatif et comme impur,
qu' la condition de concevoir un principe o le bien soit parfait, simple, pur et sans
degrs, parce qu'il est sans mlange. Il en est de mme du beau, et les divers degrs de la
beaut imparfaite ne sont intelligibles que, par la beaut parfaite et sans degrs. Nous
rapportons nos sensations ces notions primitives que nous trouvons en nous et qui nous
servent d'exemplaires (45). Les principes chu bien et du beau, outre leur universalit, ont
donc pour second caractre l'absolue perfection. Cette perfection rsulte de leur unit
mme ; la beaut une et simple, c'est la beaut sans mlange de laideur. Formons-nous
l'ide suivante de toutes ls choses que nous appelons pures... Comment et en quoi
consiste la puret de la blancheur? Est-ce dans la grandeur et la quantit? ou bien en ce qui
est tout fait sans mlange, et o il ne se trouve aucune trace d'aucune autre couleur? - Il
est vident que c'est en ce qui est parfaitement dgag de tout mlange. - Fort bien. Ne
dirons-nous pas que ce blanc est le plus vrai et en mme temps le plus beau de tous les
blancs, et non pas celui qui serait en plus grande quantit ou plus grand? - Oui, et avec
beaucoup de raison (46). - Aussitt donc que vous concevez une qualit sous le point de
vue de l'unit absolue, vous lui communiquez deux caractres qu'elle n'avait pas d'abord :
elle devient d'une gnralit sans limites, et par l mme d'une puret et d'une perfection
absolues.
Demande-t-on maintenant quel nom il faut donner au principe d la beaut et de la bont
rpandues dans les choses possibles ? Comment l'appellerait-on, si ce n'est le beau, si ce
n'est le bien? Ce n'est plus telle beaut, telle bont particulire; tout ce qui exprime la
varit, la multiplicit de degrs et de manires d'tre, ne convient point un principe
immuable et identique; il est le beau, il est le bien? dans leur simplicit sublime, et tout ce
qu'on ajouterait ces expressions ne pourrait que dtruire l'unit absolue des premiers
principes. Disons-le donc encore une fois : Il y a plusieurs choses que nous appelons
belles et plusieurs choses bonnes. Et le principe de chacune, nous l'appelons le beau, le bien;
et nous, faisons de mme de toutes les choses que nous avons considres tout l'heure
dans leur varit, en les considrant sous un autre point de vue, dans l'unit de l'ide
laquelle chacune d'elles se rapporte.
Veut-on d'autres exemples? Nous ne concevons l'galit qui se trouve entre un arbre et un
arbre, entre une pierre et une pierre, que par la conception de l'galit en soi, qui est en dehors
de tous ces objets et ne varie pas comme eux. Les pierres, les arbres, ne nous paraissent-ils
pas tantt gaux, tantt ingaux, bien que souvent ils ne subissent par eux-mmes aucune
modifcation? - Assurment. - Mais quoi, ce qui est gal en soi t'a-t-il quelquefois paru
ingal, ou l'galit te parat-elle ingalit? - Jamais. - L'galit et ce qui est gal ne sont donc
pas la mme chose. L'galit en soi, c'est celle qui a pour caractre l'unit absolue. Elle est
donc galit et rien autre chose : par l elle est pure et parfaite. De plus, elle est prsente
dans son unit partout o il y a quelque degr d'galit, et sous ce rapport elle est
universelle.
Ce que nous disons ici ne concerne pas plus l'galit que le beau en soi, le bien, la justice,
la saintet. Joignons-y les notions de l'tre, de l'identit, de la difrence, que supposent
le jugement et le raisonnement. Toutes ces notions expriment un principe d'unit dans la
multitude des choses particulires : .
Mais elles-mmes sont multiples encore : elles contiennent des lments divers. L o la
simplicit n'est pas absolue, l'esprit sent le besoin d'un principe suprieur. Les genres et les
types ne sont .donc pas parfaitement intelligibles en eux-mmes; ils conservent un
caractre hypothtique qui force l'esprit les dpasser pour s'lever toujours plus haut; ils
ne seront compltement intelligibles qu'une fois ramens leur principe :
' . Toutes les notions o l'unit n'est pas absolue sont pour le philosophe des
hypothses qu'il regarde comme telles, et non comme des principes, et qui lui servent de
degrs et de points d'appui pour s'lever jusqu' un premier principe qui n'admet plus
d'hypothse. Or, ce qu'il y a de commun dans tous les genres, c'est la gnralit infnie;
dans tous les types, c'est la perfection infnie. Et qu'est-ce que la gnralit infnie? Nous
l'avons vu, c'est l'unit absolue sous le rapport de la quantit et de l'extension. Qu'est-ce
que la perfection infnie? - C'est l'unit absolue sous le rapport de la qualit; - c'est la
simplicit excluant tout mlange. Le premier principe est donc conu comme unit; et d'un
autre nom, c'est le parfait, le bien par excellence : . L se repose la pense aprs
sa marche dialectique; l est le principe suprme de la science.
Il faut donc bien l'avouer : au-dessus de toutes les oprations logiques, ascendantes ou
descendantes, inductives ou dductives, il y a des principes d'unit auxquels l'induction et
la dduction sont galement suspendues, et que l'esprit impose aux objets sensibles, loin
de les recevoir de la sensation.
Ces principes eux-mmes peuvent se ramener un principe unique, dernier terme de la
science. Le dernier, - et en mme temps le premier! C'est l qu'elle arrive ; mais c'est de l
qu'elle tait partie. Jugement, dfnition, division, raisonnement, toute opration logique
aboutit l'unit; mais en mme temps elle la suppose. Elle implique l'obscure et confuse
notion de l'universel et du parfait, qu'elle ne fait qu'claircir. Comment donc l'esprit est-il
entr en possession de ce principe qui rend tout le reste intelligible et d'o drive la
connaissance tout entire?
IV. C'est la vue des choses belles que nous concevons le beau, qui pourtant en difre;
c'est la vue des choses bonnes que nous concevons le bien, qui ne peut tre confondu
avec les objets o il se trouve. La sensation est donc l'occasion qui nous fait concevoir les
principes, l'occasion et non la cause. Mais, quand la vue d'une chose nous fait penser
une autre, il y a ncessairement rminiscence. Ainsi l'ami pense son ami en voyant la
lyre dont il a coutume de faire usage. Le portrait fait penser l'original, et les objets
sensibles font penser aux types intelligibles dont ils ofrent l'imparfaite image. Concevoir la
beaut, la bont, la justice, ne semble donc tre autre chose qu'un souvenir. De mme que
la mmoire conserve chaque ide, mais sous une forme obscure et implicite, jusqu'au
moment o la vile de quelque objet, par son rapport avec cette ide, la rveille et la force
se manifester; de mme, il y a dans l'me une facult qui conserve les principes sous une
forme obscure, jusqu'au moment o la vue du monde extrieur les veille, les excite, les
produit au grand jour.
Le souvenir sera-t-il donc le fait primitif de la vie intellectuelle? Sera-t-il la science, la seule
vritable science? - Non, cela est impossible et contradictoire. On se souvient seulement de
ce que l'on connat dj; le souvenir, pomme toute rfexion, comme toute opration de
l'esprit, suppose un acte primitif de pense, et comme une prise de possession immdiate
par laquelle l'intelligence s'est empare de l'intelligible.
Cette vision sans intermdiaire, cette vision face face de la beaut, de la justice, de l'unit
et du bien, dans laquelle la pense et son objet sont unis et se pntrent l'un l'autre comme
se pntrent l'il et la lumire, c'est l'intuition, c'est la raison pure, c'est la . Que
cette connaissance immdiate de la vrit par la pense ait eu lieu dans la vie prsente ou
dans une vie antrieure, c'est un point secondaire; ce qui est certain, c'est qu'elle a eu lieu.
Au-dessus des procds multiples de la logique, comme au-dessus des contradictions de
nos sens, se trouve ncessairement .l'unit de l'intelligence et de l'intelligible dans
l'intuition. Voil cette science primitive que nous chef chions vainement et dans le domaine
des sens et dans le domaine des oprations logiques. Qu'est-ce que la science?
demandions-nous ; est-ce la sensation? est-ce l'opinion? est-ce la pense discursive? - Et
aucune de ces rponses ne pouvait satisfaire notre pense, car la pense ne se reconnat pas
dans les oprations des sens ni dans les oprations de la logique : images imparfaites
d'elle-mme, miroirs incomplets et infdles o elle ne peut se rfchir tout entire dans
son unit. La pense ne se reconnat que dans l'immdiate intuition de la vrit infnie.
Qu'est-ce que la science? - Nous pouvons maintenant rpondre: La science, c'est
l'intuition ; c'est l'intelligence saisissant l'intelligible sans aucun intermdiaire et ne faisant
qu'un avec son objet. - Et ce n'est pas l, sans doute, une dfnition logique de la science;
car on ne dfnit pas ce qui est primitif; on ne dcompose pas ce qui est simple. Dans toute
prtendue dfnition de la science, on introduira les mots mmes de savoir, de
connaissance, de pense. La raison ne se dfnit pas elle-mme ; elle a seulement
conscience d'elle-mme; et toute explication logique de la science n'en donnerait pas l'ide
celui qui ne possderait pas dj cette ide primitive et irrductible, cette ide de la
science, qui n'est pas distincte de la science mme (46).
Mais, si de simples synonymes, si de simples claircissements mtaphysiques peuvent
remplacer la dfnition logique, disons alors que la science est la connaissance de l'unit
par le multiple; que l'unit a cieux noms divers qui expriment son rapport avec les diverses
espces de multiplicit : l'un est l'universel; l'un est aussi le parfait. La science a donc pour
objet l'universalit et la perfection, l'unit identique au bien, et en un seul mot le bien.
Le bien, un et simple en lui-mme, prend des aspects et des noms divers suivant-ses
diverses relations avec le multiple : il s'appelle alors le beau, le vrai, l'ordre, le juste,
l'galit, l'identit; il donne naissance ces principes que nous avons trouvs au-dessus de
la sensation et de la rfexion qu'ils rendent possibles. Toute qualit leve au degr de
l'universel et du parfait est une forme du bien ; ces formes sont l'objet des diverses
sciences, et sans elles rien n'est intelligible ; par elles, tout s'claircit et s'explique, de mme
que tout devient visible la lumire du jour. Ces principes d'universalit et de perfection,
d'unit et de bien, suprieurs tout ensemble la sensation et aux abstractions logiques,
objets de la raison intuitive, origine et fn de la science, aussi rels. que la science mme,
puisqu'ils la produisent, aussi rels que notre pense, puisqu'ils l'clairent et la
dveloppent; ces principes intelligibles par lesquels l'intelligence existe, et qui existent
aussi certainement que l'intelligence mme, quelle que soit d'ailleurs la manire dont on se
reprsente leur existence, - ce sont les Ides (47).
(01) , '
,
. (Phdon, 77, b. )
(02) , ; - .
; - ; - ib.
(03) ' ; ...
; ( 1er Hipp. 177, b.) .
(04) Il ne faut cependant pas l'oublier, Platon ne considrait pas les dialogues comme
l'expression rigoureuse de sa propre doctrine; il exposait-celle-ci, non en crivant ou en
conversant, mais dans de vritables leons orales. (voir p.. 14, note 2).
(05) V. le Tht. et le 6e liv. de la Rp., plus loin, ch. II.
(06) Time, p. 51, b. c., tr. H. Martin.
(07) Rp., v. 477.
(08) Phaed., 100, a.
(09) Plato and the other companions of Sokrates, 3 vol. in-8, 2e d., 1867 (Londres, Murray).
(10) Terme de jurisprudence, dsignant la mise aux prises de l'accusateur, du dfenseur et
des tmoins.
(11) Notre exposition fera voir sufsamment, nous l'esprons, combien M. Grote s'loigne
de la vrit en soutenant qu'aucune intention commune ne traverse les Dialogues (no
commit purpose peroading the Dialogues, t. II, Kratylus). Voir en particulier notre analyse du
Cratyle, que M. Grote prtend sans aucun lien avec les autres dialogues. (Voir notre
chapitre sur le rapport des Ides aux mots.) C'est surtout par les contradictions vraies ou
prtendues de Platon avec lui-mme qu'on veut prouver l'absence de dogmatisme chez ce
philosophe. D'abord, ces contradictions sont beaucoup moins nombreuses qu'on ne le croit
et portent sur des dtails secondaires; ensuite, ces contradictions fussent-elles plus relles
et plus frquentes, il ne suft pas que la pense d'un philosophe ait err ou vari pour
qu'on ait le droit de lui refuser un esprit systmatique et une doctrine propre.
(12) On rpte sans cesse : il n'y a pas eu d' , puisque l'antiquit ne les a
jamais vus ; mais il est clair que l'antiquit n'a pas pu soir des leons non crites. Il n'en est
pas moins vrai que Platon avait son enseignement oral auquel Aristote se reporte trs
souvent. Aristote avait mme rdig en partie les leons de son maitre dans le trait du
Bien. (Voir M. Ravaisson, Essai sur la mtaphysique d'Aristote, t. I; et plus loin, dans notre
chapitre sur les attributs de Dieu, un fragment platonicien o est dmontre l'immutabilit
divine.) - On trouve dans Aristoxne un curieux passage o il raconte, d'aprs le
tmoignage d'Aristote, l'efet produit sur les auditeurs par les leons svres et abstraites
d Platon (Harm.. II, p. 30). Ceux qui venaient aux leons sur le souverain bien, croyaient
entendre parler de la gloire, de la beaut, de la sant, et de tout ce qui passe pour des biens
aux yeux des hommes ; mais ils entendaient parler de la monade et de la dyade indfnie,
et s'en retournaient dsagrablement surpris. Dans les Lettres, que M. Grote regarde
comme authentiques (Plato, I, 220), Platon rpte qu'il ne faut pas livrer au vulgaire les
parties les plus belles et les plus difciles de la philosophie. Tout le mond tonnait le mot :
Que nul n'entre ici, s'il n'est gomtre.
(13) Sur l'sotrisme de Platon, voir dans ce volume la note qui suit l'exposition de la
philosophie platonicienne.-
(14) Tht., 152 A, et ss.
(15) Sur picharme, voir Diog. Laer., III, 12.
(16) Tht., 161 C. Nous nous servons en gnral de la traduction Cousin, mais en
corrigeant les inexactitudes et les erreurs.
(17) Ibid., 163B
(18) Ibid., 163
(19) Tht., 167, A sqq.
(20) M. Grote prend en main, contre Platon et Aristote, la cause de Protagoras, pour lequel
il a une sympathie toute particulire ; et il dploie dans la dfense de l'illustre sophiste une
fnesse et une subtilit de dialectique vraiment admirables. Platon lui-mme et
certainement applaudi son chapitre sur le Thtte (Plato, t. II). M. Grote emprunte ses
principaux arguments Hamilton et Stuart Mill, qui ont eu eux-mmes Kant pour
devancier. L'homme est la mesure de toutes choses signiferait simplement, d'aprs M.
Grote, que toute connaissance suppose, en mme temps qu'un objet connu, un sujet auquel
la connaissance est ncessairement relative. Objet et sujet, dit M. Grote, s'appellent
rciproquement et sont insparables; l'objet n'est pour nous qu'en tant que connu, et nous
ne connaissons qu'en tant que l'objet nous apparait. La connaissance, ajoute
ingnieusement M. Grote, est un phnomne bipolaire ou bilatral (a bi-polar, bi-lateral
phaenomenon); elle prit dans l'abstraction de l'un ou de l'autre des deux termes. Quand
Platon reproche Protagoras de constituer l'homme mesure de la vrit, il se fait lui-mme
mesure de cette vrit; toutes les propositions qu'il prononce sur la mesure absolue des
choses et qu'il veut rendre indpendantes de la pense humaine, ont pour sujet exprim ou
sous-entendu je ou moi. Je ne suis pas la mesure de la vrit , revient dire : Je mesure
par ma pense que je ne suis pas la mesure de la vrit. Quand nous afrmons qu'une
chose est indpendante de nous; nous sous-entendons encore ces mots : pour nous; - elle
est donc pour nous indpendante de nous. En un mot, quoi que l'homme fasse et pense,
qu'il s'lve au plus haut des cieux ou descende au plus profond de la terre , il ne peut
jamais sortir de sa propre pense. C'est donc bien le sujet qui est la mesure de l'objet. -
Nous craignons qu'il n'y ait l un malentendu, et que ni Protagoras ni Platon n'aient t
compris dans leur vritable sens. Nous avons pour nous le tmoignage d'Aristote, dont M.
Grote semble contester tort la valeur. Protagoras ne se bornait pas soutenir que toute
pense suppose un sujet pensant en mme temps qu'un objet, ce que personne ne lui et
contest. Son but tait, d'une part, de supprimer l'objet, la vrit, et d'autre part, de rduire
le sujet la sensation. M. Grote prtend que Platon rapproche tort la doctrine du
sensualisme ionien de celle de Protagoras. Rien ne prouve d'aprs lui que Protagoras ait
t sensualiste, sinon les critiques de Platon et d'Aristote ; mais en vrit, pourquoi
rejetterions-nous cos deux autorits pour le seul plaisir de rhabiliter Protagoras et d'en
faire un Kant ou un Hamilton? Pourquoi cette dfance non motive l'gard de Platon et
d'Aristote lui-mme, joint cette confance galement peu motive dans le sophiste
Protagoras? Que M. Grote oppose des preuves et des textes Platon et Aristote, nous le
croirons. Jusque-l, nous continuerons de voir un lien trs logique entre ces trois choses :
phnomnisme, sensualisme et scepticisme. - Quant Platon, qui a voulu rfuter cette
triple consquence de la doctrine ionienne, M. Grote fait son gard ce qu'il l'accuse
d'avoir fait l'gard de Protagoras : il lui prte une doctrine qui n'est pas la sienne. Platon
ne nie pas que chacun porte en soi la mesure de la vrit, que chacun ne soit, en un certain
sens, mesure des choses. Mais il s'agit de savoir quelle est cette mesure que chacun porte
en soi. Est-ce le ct individuel, subjectif, variable et sensible de la connaissance, comme
Protagoras le prtendait? ou n'est-ce pas le ct universel, immuable, intelligible, c'est--
dire l'Ide? Loin de vouloir refuser l'homme la mesure de la vrit, Platon n'a d'autre but
dans toute sa philosophie que de nous faire dcouvrir en nous cette mesure et de nous
apprendre nous en servir. C'est de notre propre fonds que nous tirons la science. Peut-on
nier, oui ou non, que tantt l'homme se trompe, et tantt il ne se trompe pas? Pourtant,
dans les deux cas; il sent ou croit; donc ce n'est pas la sensation ou la croyance qui par
elles-mmes font la vrit. Quand il ne se trompe pas, quand il sait, l'homme raisonne
d'aprs des ides universelles; donc ces ides sont la vraie mesure, et non la sensation ou
l'opinion.
(21) Ib., 179, B.
(22) Tht., 184, D.
(23) Tht., 185 D.
(24) lb., 186 D.
(25) Tht., ib. et sqq. Schleiermacher (Einleit. zum Theet.) croit cette premire partie du
dialogue dirige contre Aristippe et la suivante contre Antisthne. Nous verrons plus tard
que ce dernier est rfut dans le Sophiste et non dans le Thtte.
(26) C'est avec elle-mme, et non avec les choses, que l'me s'entretient dans l'opinion, qui
demeure alors subjective. Qu'est-ce que j'aperois l-bas prs du rocher, et qui parat
debout sous un arbre?... Ensuite cet homme, rpondant sa pense, pourra se dire: c'est un
homme, - jugeant ainsi l'aventure. Puis, venant passer auprs, il pourra se dire alors
que l'objet qu'il a vu est une statue. (Philb. 38; b. e.; 39, a.). Schleiermacher (Einleit. zum
Th.) et Ueberweg (Ueber die Aechtheit und Zeitfolge Plat. Schr, 279) soutiennent avec raison
que la science et l'opinion sont absolument spares dans Platon. La science est infaillible,
capable de rendre raison d'elle-mme, et rpond aux Ides. Steinhart (Einleit. z. Th., 94)
conteste tort ce point. Voir surtout Phd., 76, b., Mn., 96, a, Tim., 51, e.
(27) Philbe, 38, b. e.
(28) Id.
(29) Id., 39, a.
(30) Tht., 189, e., 190, a.
(31) Th. 199, 200 et ss.
(32) Th. 207 et ss.
(33) Leibnitz : Il y a de l'tre dans toute proposition.
(34) Cf. Phdon. 102, e.
(35) , . Rp.,
510, a.
(36) Le Thtte n'a d'autre but que de montrer l'insufsance de Ia sensation et de l'opinion.
C'est un dialogue ngatif, comme le soutiennent Ast, Socher, Stallbaum, Ueberweg, Zeller
et Grote. Mais ce dernier prtend que, au del de ce rsultat ngatif, Platon ne tend
aucune doctrine positive, qu'il n'y a dans le Thtte aucune allusion aux Ides, et que les
difcults souleves dans ce dialague ne reoivent aucune solution dans les autres
ouvrages de Platon. Ces trois points sont galement errons. Prtendre que Platon n'avait
aucune doctrine positive sur la nature de la science, est-ce comprendre les thories
platoniciennes? Nous verrons dans la Rpublique et dans tous les autres dialogues la
fausset de cette assertion. En second lieu, Platon laisse clairement entrevoir les Ides dans
le Thtte, 1 quand il reprsente le philosophe comme se demandant : qu'est-ce que
l'homme? et non qu'est-ce que tel ou tel homme? - Qu'est-ce que le juste? et non ceci est-il juste? 2
Quand il parle de l'tre, de l'unit, de la difrence, impliqus dans le jugement, de
l'essence et de la vrit, objets de la science, etc.
Quant l'absence de solution dont parle M. Grote, nous verrons plus tard ce qu'il en faut
penser. - V. Grote Plato, t. lI, Theaetetus.
(37) Rp., VI, 510 c. d. et ss., 511, a. b. - Cf. Lettre VII Ce cercle est un dessin qu'on eface,
une fgure matrielle qui se brise ; tandis que le cercle lui-mme () auquel
tout cela se rapporte ne soufre pourtant rien de tout cela. Cousin, 97.
(38) , ! " # $
" (Phdre, 265, d.)
(39) Arist., Mt. XIII.
(40)Voir notre travail spcial sur Socrate.
(41) Phdo, loc. cit.
(42) Philb., p.58. - Le cercle vritable ne peut avoir en lui-mme, ni en petite ni en grande
quantit, rien de contraire sa nature. Lettre VII. Cousin, 98.
(43) Rp. VII, 525.
(44) Rp. VI, 507 c.
(45) Phdo, 75.
(46) Philbe, 58.
(47) Thet. 196 e. Dans ses symboles mathmatiques, Platon appelle la science l'unit ou le
point; le raisonnement, la dualit ou la longueur; l'opinion, la triplicit ou surface ; et la
sensation, le nombre quatre ou le solide. V. plus loin un important passage d'Arist. Liv. Il,
les Nombres. Sur l'Ide de la science v. l'analyse du Parmnide.
(48) Dans la Lettre VII, la plus authentique de toutes (M. Grote admet mme que toutes le
sont) nous trouvons une confrmation remarquable de l'exposition qui prcde. Il y a
dans tout tre trois choses qui sont la condition de la connaissance : en quatrime lieu
vient la connaissance elle-mme, et en cinquime lieu ce qu'il s'agit de connaitre, la vrit
(l'Ide). La premire chose est le nom, la seconde .la dfnition, la troisime l'image; la
science est la quatrime... Le cercle a d'abord un nom... puis une dfnition compose de
noms et de verbes... Le cercle matriel est un dessin qu'on eface... tandis que le cercle en
soi est essentiellement difrent. Vient ensuite la science, la pense, l'opinion vraie sur cet
objet (Ce sont les trois degrs de la connaissance, raison, raisonnement et opinion).
Prises ensemble ces trois choses sont un nouvel lment qui n'est ni dans les noms, ni dans
les fgures des corps, mais dans les mes ; d'o il est clair que sa nature difre et du cercle
en soi et des autres choses dont nous avons parl. C'est--dire que les tats subjectifs et les
notions de notre me, intuitives, discursives, ou purement conjecturales, difrent la fois
des objets sensibles, des noms et des objets intelligibles ou Ides. Eclatante rfutation de
ceux qui prennent les Ides de Platon pour des notions gnrales et subjectives. De ces
quatre lments, le est celui qui, par ses ressemblances et son afnit naturelle, se
rapproche le plus du cinquime (l'Ide), les autres (raisonnement, opinion, mots, fgures)
en difrent beaucoup plus. (342 c.) - Donc les Ides sont les objets de la science et des
notions scientifques; le subjectif est seulement analogue l'objectif, en vertu du principe
platonicien que la connaissance doit tre analogue l'objet connu (Arist., De an., 404b.)
PREMIRE PARTIE
EXPOSITION DE LA PHILOSOPHIE PLATONICIENNE
LIVRE PREMIER.
EXISTENCE DES IDES.
CHAPITRE III.
PREUVE DES IDES PAR LES CONDITIONS DE L'EXISTENCE.
I. L'Ide, principe d'essence. La dtermination, l'indtermination et l'essence mixte. - II
L'Ide, type de perfection. - III. L'Ide, principe des genres. - IV. L'Ide, cause fnale.
L'analyse de la connaissance suft pour prouver les Ides ; car elle aboutit cette
conclusion : sans les Ides, point d'intelligence. Cherchons cependant des preuves d'un
autre ordre, et aprs avoir tudi les principes de la connaissance, tudions les principes de
l'existence.
Comment cette preuve ne serait-elle pas la confrmation de la premire? comment
pourrait-il y avoir opposition entre la pense et son objet, entre la raison et la ralit?
D'ailleurs, la ralit ne nous est connue que par la pense, comme d'autre part la pense
n'entre en acte que par la ralit qu'elle conoit. Pas de pense sans l'tre, pas d'tre pour
nous sans la pense. L o nous voyons deux preuves, il n'y en a qu'une seule pour celui
qui descend au fond des choses. Telle est la connaissance, et telle est pour nous l'existence.
La connaissance a son origine dans les Ides : comment n'en serait-il pas de mme de la
Nature ?
Il n'est pas inutile, cependant, de reprendre un autre point de vue la recherche des Ides.
L'analyse de l'tre sera la contrepartie et la confrmation de l'analyse du connatre. Si nous
trouvions entre les deux points de vue des oppositions vritables et invincibles, il faudrait
y reconnatre le signe de quelque illusion naturelle et de quelque erreur invitable ; l'esprit
humain entrerait alors en suspicion, et nous n'aurions d'autre refuge que le doute. Si au
contraire l'harmonie se maintient jusqu'au bout entre la raison et la ralit, ne sera-ce pas
la preuve que les principes de la raison sont identiques aux principes de la ralit, les lois
de la pense aux lois des choses?
I. L'Ide, principe d'essence.
Considrons les objets sensibles, d'abord en eux-mmes, puis dans leurs relations entre
eux, et recherchons quelles sont toutes leurs conditions d'existence.
De mme qu'au plus bas degr de la connaissance nous avons trouv la sensation, de
mme, au plus humble degr de l'existence, nous trouvons le phnomne sensible, ou
gnration (), toujours en mouvement, naissant dans un lieu, d'o il disparat
bientt en prissant, comprhensible par l'opinion accompagne de la sensation (01).
Dans ce monde sensible, la varit est infnie ; mais cette varit a elle-mme son origine
dans un phnomne commun, auquel se rduisent tous les autres, auquel aboutit toute
explication du monde physique : Le mouvement est le principe de l'existence apparente
et de la gnration, et le repos, celui du non-tre et de la corruption. En efet, la chaleur, le
feu qui engendre et entretient tout, est lui-mme produit par la translation et le frottement,
qui ne sont que du mouvement. N'est-ce pas l ce qui donne naissance au feu? - Sans
contredit. - L'espce des animaux doit aussi sa production aux mmes principes. -
Assurment. - Mais quoi? notre corps ne se corrompt-il point par le repos et l'inaction, et
ne se conserve-t-il point principalement par l'exercice et le mouvement? - Oui. - L'me elle-
mme n'acquiert-elle pas et ne conserve-t-elle pas l'instruction, et ne devient-elle pas
meilleure par l'tude et la mditation, qui sont des mouvements ; au lieu que le repos,
c'est--dire le dfaut de rfexion et d'tude, l'empchent de rien apprendre, ou lui font
oublier ce qu'elle a appris? - Oui. - Le mouvement est donc un bien pour l'me comme
pour le corps, et le repos un mal... Admets donc cette faon de raisonner pour tout ce qui
frappe tes yeux; conois que ce que tu appelles couleur blanche, n'est point quelque chose
qui existe hors de tes yeux, ni dans tes yeux : ne lui assigne mme aucun lieu dtermin,
parce qu'ainsi elle aurait un rang marqu, une existence fxe, et ne serait plus en voie de
gnration... Il faut se former la mme ide de toutes les autres qualits, telles que le dur, le
chaud, et ainsi du reste; et concevoir que rien de tout cela n'est tel en soi, mais que toutes
choses sont produites avec une diversit prodigieuse dans le mlange universel qui est une
suite du mouvement (02). Hraclite, en ramenant tous les phnomnes au mouvement, et
tous les mouvements l'action d'un feu intrieur qui anime, produit et dtruit toutes
choses, avait parfaitement compris le caractre principal du monde sensible.
De l'universelle mobilit rsulte l'universelle indtermination. Examine si tu dcouvriras
quelque chose de dtermin dans ce qui est plus chaud ou plus froid ; ou si le plus et le
moins qui rside dans cette espce d'tres, tant qu'il y rside, ne les empche point d'avoir
des bornes prcises; car aussitt qu'ils sont dtermins et fnis, leur fn est venue... Tout ce
qui nous paratra devenir plus et moins, recevoir le fort et le doucement, et encore le trop
et les autres qualits semblables, il nous faut le rassembler en quelque sorte en un, et le
ranger dans l'espce de l'indtermin ( ! ), suivant ce qui a t dit plus haut, qu'il
fallait, autant qu'il se peut, runir les choses spares et partages en plusieurs sortes, et les
marquer du sceau de l'unit (03).
Cependant l'indtermination n'est pas absolue dans le monde matriel, comme le
prtendait faussement Hraclite. Nous dterminons les objets sensibles en les qualifant et
en les nommant. Nous disons mme qu'ils sont, sinon absolument, du moins d'une
certaine manire. Il faut donc admettre qu'ils sont un mlange d'indtermin et de
dtermination. Examinons-les attentivement sous chacun de ces points de vue, et
recherchons d'abord le principe de l'indtermination des objets sensibles. Considrs en
eux-mmes, il est vrai de dire avec Hraclite,- qu'ils n'ont aucune forme propre, aucune
unit, et par consquent aucune existence vritable. L'eau, en se congelant, devient, ce
qu'il semble, des pierres et de la terre; la terre dissoute et dcompose s'vapore en air; l'air
enfamm devient du feu; le feu comprim et teint redevient de l'air; son tour l'air
condens et paissi se transforme en nuage et en brouillard; les nuages, en se condensant
encore plus, s'coulent en eau ; l'eau se change de nouveau en terres et en pierres; tout cela
forme un cercle, dont toutes les parties ont l'air de s'engendrer les unes les autres. Ainsi,
ces choses ne paraissant jamais conserver une nature propre, qui oserait afrmer que l'une
d'elles est telle chose et non pas telle autre?... Il ne faut pas parler de ces choses comme
d'individus distincts, mais. il faut les appeler toutes et chacune des apparences soumises
de perptuels changements. Nous appellerons donc des apparences le feu et tout ce qui a
eu un commencement. (En efet, ce qui commence ne peut sortir du pur nant; il est donc
ncessairement un simple changement d'apparence dans ce qui existait dj.) Mais l'tre
dans lequel. ces choses apparaissent pour s'vanouir ensuite, celui-l seul peut tre
dsign par ces mots : ceci ou cela, tandis qu'on ne peut les appliquer aux qualits...
Supposons qu'on fasse prendre successivement toutes les formes possibles un lingot d'or,
et qu'on ne cesse de remplacer chaque forme par une autre ; si quelqu'un, en montrant une
de ces formes, demandait ce que c'est, on serait certain de dire la vrit en rpondant que
c'est de l'or; mais on ne pourrait pas dire, comme si cette forme, avait une existence relle,
que c'est un triangle ou toute autre fgure, puisque cette fgure disparat au moment mme
o l'on en parle. Si donc on rpondait, pour viter toute erreur : elle est l'apparence que
vous voyez, il faudrait se contenter de cette rponse. L'tre qui contient tous les corps en
lui-mme est comme ce lingot d'or : il faut toujours le dsigner par le mme nom, car il ne
change jamais de nature; il reoit perptuellement toutes choses dans son sein, sans revtir
jamais une forme particulire semblable quelqu'une de celles qu'il renferme; il est le fond
commun o vient s'empreindre tout ce qui existe, et il n'a d'autre mouvement ni d'autres
formes que les mouvements et les formes des tres qu'il contient. Ce sont eux qui le font
paratre divers... Il est donc ncessaire que ce qui doit recevoir dans son sein toutes les
formes, soit dpourvu lui-mme de toute forme... En consquence, - cette mre du monde,
ce rceptacle de tout ce qui est visible et perceptible par les sens, nous ne l'appellerons ni
terre, ni air, ni feu, ni eau, ni rien de ce que ces corps ont form, ni aucun des lments
dont ils sont sortis ; mais nous ne nous tromperons pas en disant que c'est un certain tre
invisible, informe, contenant toutes choses en son sein (04). S'il faut donner un nom ce
principe innommable, appelons-le l'indfni ou l'indtermin, . Ce n'est pas la !
matire, dans le sens ordinaire de ce mot, puisque nous appelons matire quelque chose
de dtermin, ayant des formes et des qualits relles. Mais c'est une matire premire, qui
contient en elle-mme la possibilit de toutes choses, sans tre par elle-mme aucune chose
en particulier.
Tel est le fond commun de tous les phnomnes sensibles; telle est la premire condition
de leur existence; par l ils sont possibles, mais ils ne sont pas encore rels. De la matire
indfnie vient ce caractre d'indtermination qui apparat tout d'abord dans le monde
extrieur.
Mais il y a autre chose dans ce monde; ce monde n'est pas la matire pure,
l'indtermination absolue, ; il a des qualits dtermines, des formes relles, !
quoique fugitives, quoique emportes par un mouvement sans fn. L'indfni n'est pas,
proprement parler. Peut-on dire d'une chose qu'elle est, si elle n'est point telle ou telle
chose? O donc est l'tre? il n'est pas dans l'indtermination absolue de la matire pure : il
est dans la forme que prend cette matire, qui la dfnit et la dtermine ( ).
Or, nous disons que le monde sensible existe, non d'une manire absolue, mais dans un
sens relatif, qui convient son incessante mobilit; il nat, il apparat, il est donc d'une
certaine manire, et s'il n'est pas l'tre vritable, au moins il est une imitation de l'tre :
l'apparence n'est autre chose que cette imitation de l'existence. D'o vient donc ce
commencement de dtermination que la pense aperoit dans les objets sensibles? Encore
une fois, la dtermination ne vient pas de ces objets eux-mmes; elle vient d'ailleurs, elle
vient de plus haut. Au-dessus d'eux, il faut bien admettre un principe de dtermination.
Ce principe, appelons-le l'essence, c'est--dire ce qui fait que ce qui est est tel, ou plus
simplement que ce qui est est; puisque l'tre est dans la forme dtermine et non dans la
matire indtermine.
C'est ce principe de dtermination, de qualifcation, d'existence, dont il faut approfondir la
nature.
Nous ne saurions trop le redire: Les objets sensibles n'ont par eux-mmes aucune essence,
et cependant ils en ont une dans la ralit actuelle. Quel est donc le principe qui explique
la prsence de telle ou telle qualit dans les choses? Pourquoi, par exemple, une chose est-
elle belle ou bonne? Il y a une rponse bien simple : mais c'est souvent dans la simplicit
que l'on trouve la profondeur. Voici cette rponse : une chose est belle par la prsence de la
beaut, bonne par la prsence de la bont. Je ne saurais comprendre toutes ces autres
causes si savantes que l'on nous donne. Si quelqu'un me dit qu'une chose est belle cause
de ses couleurs vives, ou de sa forme, ou d'autres proprits semblables, je laisse l toutes
ces raisons qui ne font que me troubler (05). Et en efet, elles reculent la difcult sans la
rsoudre.; elles numrent les conditions d'une chose sans en faire comprendre le principe
et l'essence. Autre chose est la cause, et autre chose est la condition sans laquelle la cause
ne serait jamais cause. Les couleurs vives, par exemple, ne communiqueront la beaut
un objet que si elles la possdent dj en elles-mmes; et alors d'o vient. qu'elles la
possdent? qu'est-ce que cette beaut qu'elles contiennent? - La mme question se
prsentera toujours tant qu'on restera dans le domaine des causes secondaires et
particulires. Je me dis donc moi-mme, sans faon et sans art, peut-tre mme trop
simplement, que ce qui rend belle une chose quelconque, c'est la prsence ou la
communication de la beaut, de quelque manire que cette communication se fasse : car,
sur ce dernier point, je n'afrme rien ; ce que j'afrme, c'est que toutes les belles choses
sont belles par la prsence du beau. C'est, mes yeux, la rponse la plus sre pour moi et
pour tout autre, et tant que je m'en tiendrai l j'espre bien ne jamais me tromper et
rpondre en toute sret, moi et tout autre, que c'est la beaut que les choses belles
doivent d'tre belles... De mme, c'est par la grandeur que les choses grandes sont grandes,
et par la petitesse que les choses petites sont petites ( ,
) ( ! 06).
Maintenant, quels sont les caractres de cette bont, de cette beaut, de cette grandeur,
dont la prsence rend un objet bon, beau ou grand? Est-ce, par exemple, une beaut
particulire, qui appartienne seulement l'objet o elle se trouve et qui y soit comme
puise tout entire? Il faudrait dire alors que ce qui rend un objet beau, c'est sa beaut.
Mais une telle rponse serait un cercle vicieux ridicule : elle n'aurait aucun caractre
scientifque; elle serait mme la ngation de la science. Dire que Phdon est beau cause
de sa beaut, ce n'est pas seulement une navet, c'est une erreur car la beaut n'est point
une chose propre Phdon, une chose qui lui appartienne tout entire : la beaut
particulire qui rside dans Phdon n'a point en elle-mme sa raison et son principe : elle
n'est ni ncessaire ni absolue. En d'autres termes, elle n'est pas son essence elle-mme;
car alors il serait contradictoire de supposer Phdon sans beaut; et pourtant il n'a peut-
tre pas toujours eu, il n'aura peut-tre pas toujours cette beaut qu'il possde aujourd'hui.
Qu'est-ce donc, sinon une beaut d'emprunt? Ainsi Phdon n'est point le principe de la
beaut qui est en lui, et il est encore moins le principe de la beaut qui est dans les autres.
Le particulier ne peut tre principe ni essence. La beaut de tel ou tel objet se rattache donc
un principe suprieur, qui est la beaut mme, la beaut, dis-je, et non telle ou telle
beaut particulire. Il en est de mme pour la bont, pour la grandeur. - Cette proposition :
- Simmias est plus grand que Socrate, - n'est pas vraie dans son acception littrale; Simmias
n'est pas plus grand naturellement et parce qu'il est Simmias, mais cause de la grandeur
qu'il se trouve avoir; et de mme, s'il est plus grand que Socrate, ce n'est pas parce que
Socrate est Socrate, mais parce que Socrate se trouve avoir la petitesse en comparaison de
fa grandeur de Simmias (07). La preuve en est que Socrate lui-mme, qui est petit par
rapport Simmias, est grand par rapport Phdon. Loin d'avoir pour essence la grandeur,
il admet en lui-mme la petitesse. En un mot, les termes particuliers d'une comparaison,
comme Simmias et Socrate, ne sont point ce qui constitue le rapport de grandeur; et ce
rapport n'est lui-mme que la manire dont se manifeste dans deux objets particuliers le
principe universel de la grandeur ou de la quantit. ,
L'universalit, tel est donc le premier caractre qu'ofre le principe de l'essence ou de la
forme.
Le second caractre de ce principe, c'est la puret, c'est--dire cette simplicit absolue qui
exclut les contraires et qui est identique la perfection. Socrate, nous l'avons vu, est la
fois grand et petit; la grandeur en soi ne peut jamais tre en mme temps grande et
petite; il y a plus, la grandeur mme qui est en nous n'admet point la petitesse (en tant
qu'elle est grandeur) et ne peut tre surpasse (car alors elle deviendrait petite). Socrate
peut tre surpass par Simmias, et admettre en lui-mme grandeur et petitesse; mais la
grandeur laquelle il participe en tant qu'il est grand, exclut absolument la petitesse. De
deux choses l'une, ou la grandeur s'enfuit et se retire quand elle voit venir son contraire, ou
elle prit son approche ; mais lorsqu'elle demeure et reoit la petitesse, elle ne peut
devenir autre chose qu'elle n'tait. Ainsi, moi, aprs avoir admis la petitesse, restant le
mme Socrate que je suis, je suis ce mme Socrate petit. Il n'y a pas contradiction entre
Socrate et la petitesse, parce que Socrate n'est pas la grandeur, quoiqu'il en participe. Il
peut donc, sans cesser d'tre Socrate, admettre la petitesse; mais la grandeur qui est en lui
sans tre lui ne l'admet pas : elle peut coexister dans un mme sujet, qui est Socrate, avec la
petitesse; mais elle ne se confond pas avec la petitesse mme. En un mot, il n'est pas un
seul contraire qui puisse, pendant qu'il est ce qu'il est, devenir ou tre son contraire: Mais il
se retire ou il prit quand l'autre arrive. - Pourtant, objecte Cbs, nous avons dit tout
l'heure que les contraires naissent toujours de leurs contraires, et maintenant nous disons
qu'un contraire ne peut jamais tre contraire lui-mme, soit en nous, soit dans la nature
des choses. - Alors, mon ami, nous parlions des choses qui ont en elles les contraires et
leur empruntent leur nom. (Voici, par exemple, deux contraires : la vie et la mort; quanti
un tre possde la vie (), il a en lui l'un des contraires et on l'appelle vivant; s'il meurt,
il sera pass d'un contraire. l'autre, et en lui la mort sera ne de la vie, qui est son
contraire.) Mais prsent nous parlons des essences mmes qui, par leur prsence,
donnent leur nom aux choses o elles se trouvent, et ce sont ces essences qui, selon nous,
ne peuvent natre l'une de l'autre (08). Les essences gnrales qui prtent leur forme aux
objets particuliers, excluent donc ncessairement tout mlange ; car en elles le mlange
serait une contradiction. La grandeur en soi, la grandeur parfaite, exclut ncessairement la
petitesse ; car, si elle l'admettait, elle cesserait d'tre absolue et parfaite. Le mlange des
contraires est la marque infaillible de la multiplicit, de l'impuret, de l'imperfection. Mais
toute chose qui est son essence elle-mme est simple, sans degr, sans dfaut, sans
contradiction intrieure. Ce qu'elle est, elle l'est sans restriction, elle l'est absolument, elle
l'est uniquement. A cette unit, qui rsulte de son universalit, elle joint l'unit de la
perfection.
De l drive une consquence importante. Les principes d'essence, comme la grandeur en
soi, la beaut en soi, excluant tout mlange qui altrerait la perfection de leur essence, sont
parfaitement distincts entre eux sous le rapport mme de l'essence ou de la forme. Il peut
exister des essences qui s'allient et d'autres qui s'excluent, mais lors mme. qu'il y a union,
l'unit intrinsque de chaque essence persiste, et cette unit intrieure est prcisment ce
qui fait leur distinction les unes par rapport aux autres.
Unit intrinsque et distinction rciproque des essences, - tels sont, d'aprs Platon, les
fondements mtaphysiques de cette loi logique que l'on appellera plus tard axiome
d'identit et de contradiction. Ce qui est grand est grand et ne peut tre en mme temps
petit sous le mme rapport. Cet axiome logique suppose que chaque essence, est
identique elle-mme, et qu'elle doit sa perfection une simplicit, une unit intrieure
exclusive de tout mlange, par laquelle telle se distingue nettement de toute essence
oppose ou mme simplement difrente. La raison conoit cette ncessit mtaphysique,
et elle la transforme en rgle logique : l'absence de contradiction, qui est la loi de toute
essence, devient la loi de toute pense. Dans une chose n'entrera jamais d'ide contraire
la forme qui la constitue (). Par exemple, ce qui constitue trois, c'est l'impair
(l'impair n'est pas un accident, mais l'essence mme de trois, essence sans laquelle trois
ne pourrait exister). L'ide du pair ne se trouvera donc jamais dans le trois ; car il y
aurait alors contradiction, et l'essence de trois serait dtruite.
En rsum, toute chose multiple, mobile, relative et particulire, n'a point et ne peut avoir
en elle-mme la raison de son essence. Il n'y a d'essence vritable que dans l'unit, non pas
l'unit vide et morte produite par l'limination de toute qualit, mais l'unit infniment
riche produite par l'lvation d'une qualit sa plus haute puissance. Alors disparat toute
contradiction, toute ngation, toute limitation. Les principes des formes, les causes
essentielles, renferment l'identit absolue qui s'exprime dans la logique par l'absolue
afrmation ; c'est donc par eux que les tres particuliers sont identiques eux-mmes et
distincts des autres tres. Ces principes d'identit et de distinction, d'essence et de forme, ce
sont les Ides.
II. L'Ide, type de perfection.- Du matrialisme.
L'Ide, par cela mme qu'elle est un principe d'essence, nous est apparue aussi comme un
principe de perfection. Un objet ne peut tre qu' la condition de possder certaines
qualits positives qui le dterminent en lui-mme et dans notre pense. Autant il aura de
qualits positives, et par consquent de perfections, autant de fois nous aurons le droit
d'afrmer son existence.
Nous l'avons vu, dans les tres variables et multiples aucune qualit n'est pure et parfaite :
on ne peut dire que Phdon est beau, que Socrate est grand, sans restriction et dans le sens
absolu de ces termes. Il n'y a point en eux cette simplicit infniment riche de la beaut
vritable et de la vritable grandeur. Seule la beaut en soi est belle simplement, et sans
qu'aucune ngation vienne s'ajouter cette afrmation absolue, sans qu'aucun mlange de
contraires vienne altrer cette parfaite identit du beau avec lui-mme. Le beau seul est
beau, la grandeur seule est grande, et sous l'apparente navet de ces termes se cache une
relle profondeur.
De mme la vritable science est celle qui sait, dans toute la simplicit et dans toute
l'universalit de ce terme; ce n'est pas cette science incomplte et inacheve qui sait telle
chose et ignore telle autre, qui par l mme a est sujette au changement et variable suivant
les difrents objets que nous appelons des tres (09). Non, la vraie connaissance n'est pas
celle qui connat telle et telle chose, mais celle qui connat tout, ou, plus simplement
encore, celle qui connat, sans qu'il soit ncessaire de rien ajouter. Telle n'est pas la science
humaine avec toutes ses ignorances : elle a beau s''tendre; s'accrotre et faire efort pour se
complter, passant de la science d'un objet la science d'un autre; jamais il ne lui sera
donn de se reposer dans l'universel et de se rsumer elle-mme dans l'infnit de ce seul
mot : Je sais !
Je sais ! - Expression trange qui semble l'indtermination mme pour un esprit born
comme l'esprit de l'homme, et qui exprime cependant la dtermination la plus absolue et
la perfection mme de la science. Je sais ! Derrire ce mot, il n'y a rien ou il y a toutes
choses ; il y a la simple possibilit ou la complte ralit de la science, l'absolu non-tre, ou
l'tre absolu. Mais dans aucun de ces deux sens ce mot ne s'applique vritablement
l'homme; car la science humaine n'est ni la pure indtermination et la pure possibilit de la
science, ni la science parfaitement dtermine et relle; c'est quelque chose d'intermdiaire,
comme le mouvement entre le repos du non-tre et le repos de l'tre, comme le nombre
entre l'unit du nant et l'unit de l'universel; c'est un trait, d'union entre la pure ignorance
et la pure science, c'est un milieu entre rien et tout.
Ce qui est vrai de la science humaine est vrai de toutes les qualits ou vertus humaines ; et
il en faut dire autant de la nature entire, mlange de perfection et d'imperfection.
Ce mlange, comme le montre fort bien le Philbe, doit avoir une cause. Cette cause ne peut
tre elle-mme un mlange, un degr particulier de perfection ou d'imperfection : car alors
on ne sortirait pas du relatif et du multiple, et comme il n'y aurait aucune raison pour
s'arrter tel degr plutt qu' tel autre, la pense avancerait ou reculerait toujours sans
pouvoir se fxer nulle part, sans se reposer dans l'absolu et dans l'unit. La cause du
mlange doit - donc tre pure, simple, sans mlange, et par consquent elle ne peut tre
que l'absolue imperfection de la matire pure ou l'absolue perfection de l'Ide. Le
matrialisme, qui choisit la premire hypothse, prtend faire sortir le plus du moins ;
mais d'o peut venir ce surplus qui se trouve dans l'efet, s'il n'est pas emprunt la cause?
Ne venant ni de la cause qui ne peut donner ce qu'elle n'a pas, ni de l'efet qui n'existe pas
encore et reoit tout de sa cause, ce surplus est videmment sans cause. Donc, le
matrialisme, aprs nous avoir annonc qu'il nous dcouvrirait la cause du mlang, fnit
par la supprimer. Sans doute le plus est communiqu au moins, mais non par le moins. Si
le monde est le dveloppement d'un germe que la Pauvret ou la Matire reoit dans son
sein, encore faut-il que ce germe fcondant y ait t dpos par la Richesse ou la Perfection.
L'Amour, c'est--dire ce monde mobile qui aspire sans cesse au bien, et qu'un dsir
insatiable pousse au dveloppement et au progrs, ne doit donc sa mre, l'Imperfection
radicale, que sa: possibilit et la condition passive de son existence ; mais il doit son pre,
le Parfait, son existence relle et son activit (10). Le matrialisme confond, par une erreur
grossire, le rceptacle () ( 11) avec la vraie cause.
Si vous voulez trouver la vraie cause d'un tre, ne regardez pas au-dessous de lui, mais au-
dessus ; ne cherchez pas seulement d'o il vient, mais encore, mais surtout o il va ; ne
vous contentez pas de regarder le sein qui l'a reu, dcouvrez le germe fcondant qui lui a
donn la forme et la vie. La vraie raison des choses, c'est le parfait ou l'Ide, qui est la fois
cause et modle, ou cause exemplaire : ( 12). Les degrs relatifs
du bien ne s'expliquent que par l'absolu du bien.
Aristote, dans son trait sur la Philosophie, o il rsumait les leons de son matre, exprime
avec une admirable prcision cette formule platonicienne qui rattache la perfection relative
la perfection absolue. En gnral, l o se trouve du plus parfait (et du moins, c'est--
dire des degrs), l existe aussi le parfait. Si donc il y a dans les tres tel tre meilleur que
tel autre, il faut qu'il existe aussi quelque chose de parfait, qui ne peut tre que le divin
(13). Impossible de mieux dgager le procd fondamental du platonisme, qui consiste
expliquer les degrs des choses, ou le mixte, par l'absolu et le pur, c'est--dire par le
parfait. Nous l'avons vu, pourquoi disons-nous que Phdon est plus beau que Socrate? Est-
ce seulement parce que nous le comparons Socrate? - Rponse incomplte et qui ne
pntre pas au fond de la difcult! Cette comparaison de Phdon avec Socrate n'est elle-
mme possible que si une lumire suprieure vient clairer les deux termes; je veux dire
cette lumire de la beaut absolue au milieu de laquelle nous apercevons tout ensemble
Phdon et Socrate, comme deux ombres dans lesquelles l'obscurit n'est pas complte, et
qui empruntent ingalement au soleil de la beaut une partie de sa lumire. Alors nous
disons que Phdon est plus beau que Socrate, c'est--dire qu'il participe davantage la
beaut, mais sans la possder tout entire. Ainsi donc la connaissance de la beaut relative
a pour condition celle de la beaut absolue; et de mme, dans la ralit, la premire
n'existe que par la seconde dont elle est l'imitation. L o se trouve le meilleur, existe
aussi le parfait.
En rsum, la varit des choses sensibles est produite par le concours de deux termes : la
matire premire et indtermine, semblable l'obscurit complte ; la forme
dterminante, ou type de perfection, analogue la pure lumire. Le monde sensible est la
rgion des ombres o la lumire se mle l'obscurit dans les proportions les plus
diverses, o le parfait se refte dans l'imparfait avec plus ou moins de nettet. La cause du
mlange est le bien absolu, l'unit concrte qui enveloppe toutes les qualits positives, et
non l'unit abstraite qui les exclut. Tel est le grand principe du platonisme : Identit de la
perfection avec la dtermination et par consquent avec l'existence. C'est le parfait qui
constitue le rel.; c'est le Bien, , qui est la source de toute existence ; et les,
difrents aspects du bien par rapport au monde o il se refte, les apparences diverses de
l'unit par rapport la multiplicit, ce sont les types ternels, principes de perfection,
causes exemplaires de toutes choses ; ce sont les Ides.
III. L'Ide, principe des genres.
Jusqu' prsent, nous avons considr les objets en eux-mmes, dans leur essence et leurs
qualits. Si nous les considrons maintenant dans leurs relations mutuelles, ils nous
apparatront sous de nouveaux aspects,- genres, lois et fns, - dont l'ensemble constitue
l'ordre du monde.
La connaissance n'a point pour objet l'individu, sujet au changement, la naissance et la
mort ; car elle serait variable elle-mme et s'vanouirait dans l'indtermination. Ni la
multiplicit pure ni la pure unit ne sont l'objet ordinaire de la science humaine, du moins
de la science discursive : l'unit pure n'est saisissable que dans l'unit de l'intuition, et la
multiplicit indfnie se conoit indirectement par un raisonnement btard, peine
comprhensible. Les objets ordinaires de la science, ce sont les rapports, chose
intermdiaire entre le multiple et l'un : tout rapport, en efet, suppose l'unit dans la
multiplicit.
Entre les divers individus l'esprit saisit des rapports de ressemblance ou d'opposition. S'il
considre les ressemblances isolment, en faisant abstraction des difrences, l'ide ainsi
obtenue est gnrale.
ette ide n'existe-t-elle que dans notre esprit, et ne suppose-t-elle rien' en dehors de
l'esprit lui-mme ou des objets particuliers qui ont servi de termes la comparaison? -
Les genres ne dsignent pas des individus, mais s'ensuit-il qu'ils ne dsignent rien de rel?
Parmi les notions gnrales, il en est sans doute que l'esprit forme son gr et qui
semblent de pures fctions. Et cependant, mme dans ces ides factices, l'esprit est peut-
tre moins crateur qu'il ne le semble; peut-tre une analyse plus profonde dcouvrirait-
elle, mme dans nos chimres, des lments nombreux de ralit. La possibilit de
concevoir une chimre suppose quelque principe rel d'o cette possibilit drive (14).
N'importe ; accordons qu'il y a des notions tout artifcielles, et considrons exclusivement
celles que la nature mme nous enseigne produire, celles qu'on retrouve dans toutes les
langues parce qu'elles existent dans tous les esprits. Cette universalit de certaines notions
prouve qu'elles sont tout au moins des lois de la pense et le rsultat ncessaire du
dveloppement intellectuel. Ne sont-elles rien de plus, et n'y a-t-il absolument rien qui leur
corresponde en dehors de nous? Cela est impossible; car comment la nature viendrait-elle
se conformer d'elle-mme aux conceptions de notre pense? comment se soumettrait-elle
aux lois de notre intelligence? Confez la terre le germe d'une feur, et vous savez
l'avance que ce germe produira une feur semblable celle d'o il est sorti: jamais la feur
n'engendrera autre chose qu'une feur de son espce. Cette espce n'est donc pas
seulement dans votre esprit ; elle est dans les choses mmes, et les lois de la pense sont les
lois de la nature.
Cependant, si les genres et les espces sont dans les objets particuliers, il faut reconnatre
qu'en
L'IDE, PRINCIPE DE$ GENRES. 73
mme temps ils dpassent de l'infni ces mmes objets. Le type gnral dborde, pour
ainsi dire, les choses prsentes : il s'tend dans le pass et dans l'avenir; bien plus, il
dborde la ralit tout entire, prsente, passe ou future, et embrasse le possible, qui
n'existera peut-tre jamais, mais qui pourrait exister. Ne dites donc pas que les genres sont
seule-ment dans les choses et existent par elles ; ne voyez-vous pas plutt que ce sont les
choses particulires qui existent par les genres, que ce sont les phnomnes qui existent
par la loi? La loi qui prside la gnration de la feur et qui la fait sortir du germe, n'est
pas l'efet de cette feur qui n'existe pas encore; elle en est plutt la cause. C'est le
semblable, objectera-t-on, qui produit par lui-mme le semblable (1). v Etrange
explication qui n'est qu'une ptition de principe : ces deux semblables, l'un engendrant,
l'autre engendr, d'o vient qu'ils sont semblables? C'est prcisment cette ressemblance
qui tonne et qu'il s'agit d'expliquer. Suft-il pour cela de rpondre par la question mme,
et de dire qu'un tre particulier a la vertu de produir un tre semblable lui? Encore une
fois, c'est cette vertu mme, qu'il s'agit d'expliquer; c'est cette possibilit indfnie des
semblables dont il faut donner la raison ; et tant que vous resterez dans le domaine des
tres particuliers, vous n'obtiendrez aucune raison gnrale et absolue : la difcult
reculera l'infni dans la srie rtrograde des causes secondes, mais elle subsistera tant que
l'esprit . ne se reposera pas dans une cause premire (2).
(t) V. plus loin les chapitres sur Aristote.
(2) Cf.. Jacobi, Des chose' divines, Appendice C. Les genres, les Ides de Platon, existent
en ralit et en vrit avant les espces et les choses particulires, et dans le sens le plus
propre et le plus strict, elles
74 EXISTENCE DES IDES.
Concluons que les genres et les lois existent dans les choses sensibles, mais mutils et
incomplets. Le particulier aura beau s'ajouter au particulier, il ne sera jamais identique au
gnral. Les genres et les lois sont la condition des objets individuels, loin d'en tre l'efet.
S'ils ne sont pas eux-mmes des causes, ils expriment du moins le rapport des efets leur
cause premire. L est la grande conception platonicienne : les notions gnrales sont des
rapports, mais non pas seulement des rapports entre les objets particuliers, comme
l'enseigne une logique vulgaire; car ces rapports supposent eux-mmes un rapport
suprieur celui des objets particuliers et imparfaits avec l'tre universel ;et parfait, qui est
l'unit absolue. Ainsi, au-dessus de la-matire, comme au-dessus de
rendent d'abord celles-ci possibles, .de la mme manire que la pense du premier
inventeur et le modle qu'il a construit sur cette pense, existent avant le nombre infni des
copies, qui se font d'aprs la vue et la rgle du modle, en sorte que cette multiplicit
postrieure n'est devenue possible qu'au moyen de l'unit antrieure et lui doit sa
naissance ; mais il ne se peut, en aucune faon, que l'unit, qui a donn naissance la
pluralit, devienne elle-mme multiple ; elle demeure jamais l'unit, et ne peut
absolument pas tre multiple. Il ne saurait rien sortir de la pluralit, en tant que pluralit ;
de l'unit, il ne sort jamais que l'unit. On n'invente point' des montres, des vaisseaux, des
mtiers, des langues ; mais on invente une ou la montre, un ou le vaisseau, une ou celte
langue. On ne peut et l'on ne doit dire d'aucune chose particulire et individuelle de ces
difrentes espces, d'aucune montre,- d'aucun vaisseau, d'aucune langue, qu'elle est la
montre, le vaisseau, la langue. Cette manire de s'exprimer ne convient qu' une cause,
qu'on l'appelle comme on voudra, espce, loi, pense ou me, d'o est provenu le
multiple, et d'o il continue provenir. Malebranche dit aussi : Il semble mme que
l'esprit ne:serait pas capable de se reprsenter les Ides. universelles de genre, d'espce,
etc., s'il ne voyait tous les tres renferms en un (c'est--dire dans leur Ide). Car, toute
crature tant un tre particulier, on ne peut pas dire qu'on voye quelque chose de cr,
lors-qu'on voit un triangle en gnral. Enfn, je ne crois pas qu'on puisse rendre raison de
plusieurs vrits abstraites et gnrales, que par la prsence de celui qui peut clairer
l'esprit en une infnit de faons difrentes. (Recherche de la vrit, v. m, ch. 6.)
l'esprit, il faut admettre un principe qui explique la ralisation des genres dans la matire
et la conception des genres dans l'esprit. Cette cause exemplaire de ce qu'il y a de
constant dans la nature n et clans la pense humaine, c'est l'Ide (1).
IV. L'Ide, cause fnale.
N'y a-t-il point deux sortes de choses, l'une qui est pour elle-mme, l'autre qui en dsire
sans cesse une autre? - Comment, et de quelle chose parles-tu?
L'une est trs-noble de sa nature, l'autre lui est infrieure en dignit... Celle-ci est toujours
faite en vue de quelque autre chose ; l'autre est celle en vue de laquelle se fait
ordinairement tout le reste... Conois prsent le phnomne et l'tre. Lequel des deux
dirons-nous qui est fait cause de. l'autre?... Mais la chose en vue de laquelle les autres se
font doit tre mise dans la-classe du bien ; et il faut mettre dans une clisse toute difrente
ce qui se fait en vue d'une autre chose (2).
Ainsi, le caractre essentiel du monde sensible, c'est la mobilit, la gnration, le devenir (i
-' veai). Mais conoit-on le mouvement sans un but auquel il aspire? Si un objet se sufsait
lui-mme, admettrait-il le changement et le dveloppement? Non sans
1) Aristot., Dlt., XII, 242. Procl. in Partnen. d. Cousin, V, 133
Keidi yraty i BEVCxpzcn, Eivxt "d l%) 6p.EVO airiav rxpaSEtYu.artxnv Twv xxr (AMY
&Et aUVEaTc,rG1V... 'O p.v cV GEVOlgATY Tcrcv ir apiaxcvra Till xaer,7ap.dvt TGV
4GV t C; dvi-pa4 E, Xtilptarfv awT7V xat eEtav alTtav TteillEVG:. L'opinion
d'Alcinos est parfaitement d'accord avec le tmoignage de Xnocrate. Introd. in Platon.,
viii : 'Op:;cvrcc e Tnv iSiav aapciSEt7ua Twv xxr yan' aiuivtcv (1eg. amvimv?). Diogne
de Laerte;semble aussi faire allusion la dfnition rapporte par Xnocrate ; III; Ltivn :
T e Sia alara.Tat
&Lrla Ttv X7.1 d.pX TGb T06xIT.x Evac T& aact a'VEaTWTa et 7riG ta tY airG.
2) Philbe, 27. a. b. c.
76 EXISTENCE DES IDES.
doute, et il faut dire que le mouvement existe cause du but, le moyen cause de la fn,
l'imparfait cause du bien qui est la perfection, l'amour cause de l'objet aim.
Le bien, fn dernire des choses , existe donc par lui-mme et pour lui-mme, Set, de plus,
c'est 'pour lui seul qu'existe le reste : le vrai principe de toute chose imparfaite, c'est l'Ide
du meilleur, c'est la perfection.
Sans doute le mouvement suppose, non-seulement une fn, mais un moteur. Cependant la
cause motrice n'est point la raison dernire et vritable du mouvement. L mouvement ne
pourrait se produire sans un but; la cause du mouvement serait donc impuissante et
inactive si ce but n'existait pas. Aussi les causes motrices sont-elles pour Platon au
nombre de ces
causes secondaires et comme auxiliaires (GUVXLT:6)v),
dont Dieu se sert pour reprsenter l'Ide du bien aussi parfaitement qu'il est possible. a
La plupart des hommes les regardent, non comme des causes secondaires, comme des
moyens auxiliaires, mais comme les vraies causes de toutes choses, parce qu'elles
refroidissent, chaufent, condensent, liqufent et produisent d'autres efets semblables.
Mais il ne peut y avoir en elles ni raison ni intelligence. Car, de tous les tres, le seul qui
puisse possder l'intelligence, c'est l'me;, or l'me est invisible, tandis que le feu, l'eau, la
terre et l'air sont tous des corps visibles. Mais celui qui aime l'intelligence et la science doit
rechercher, comme les vraies causes premires, les causes intelli
gentes (Tx; T ; iU.ppoVO ?LM ; airix IreG)T c; tJ.er2k;)Zetv), et
mettre au, rang des causes secondaires toutes celles qui sont mues et meuvent
ncessairement. Il faut suivre et exposer ces deux genres de causes, en trai-
L'IDE, CAUSE FINALE. 77
tant sparment de celles qui produisent avec intelligence ce qui est beau et bon, et de
celles qui, dpourvues de raison, agissent au hasard et sans ordre (1).
Socrate, pendant sa jeunesse, tait possd du d-sir d'apprendre. cette science qu'on
appelle la physique ; mais il reconnut bientt l'insufsance d'une science qui se rduit
tout entire la considration des causes motrices, et qui nglige la fn en faveur des
moyens,'les raisons vritables en faveur de rai-sons secondaires. a Enfn, ayant un jour
entendu quelqu'un lire, dans un. livre qu'il. disait tre d'Anaxagore, que l'intelligence est
l'ordonnatrice et le prin-, cipe de toutes choses, je fus ravi; il me parut convenable que
l'intelligence et tout ordonn et tout dispos dans le meilleur ordre possible. Si donc,
pensai-je, quelqu'un veut trouver la cause de chaque chose, comment elle nat, prit ou
existe, il faut qu'il cherche comment l'tre, l'action ou une modifcation quelconque, sont
pour elle ce qu'il y a de meilleur ; et d'aprs ce principe, il s'ensuit que l'homme ne doit
chercher connatre, dans ce qui le concerne comme dans ce qui se rapporte quoi que ce
soit,'que ce qui est le meilleur et le plus parfait. Que l'on dise, par exemple, que, si je
n'avais ni os ni muscles, je ne pourrais faire ce que je jugerais propos, on dira la vrit;
mais dire que ces os. et ces muscles sont la cause de ce que je fais, et non pas la prfrence
pour ce qui est le meilleur, en quoi je me sers de l'intelligence, voil une explication de la
dernire faiblesse : c'est ne pouvoir pas-faire cette distinction qu'autre chose est la cause, et
autre chose ce sans quoi la cause ne serait jamais cause ; c'est pourtant ce qui
(1) Time, 46, c. Cf. Phil., 27, a, et Polit., 128.
-78 EXISTENCE DES IDES.
sert de moyen que la plupart des hommes, marchant ttons comme dans_les tnbres,
donnent improprement le nom de cause... Ils n'admettent pas le principe du bien,
ncessaire pour tout lier et tout sou-tenir. Quant moi, pour apprendre quelle est cette
cause, je me serais fait volontiers le disciple de qui que ce ft ; mais n'ayant pu parvenir
la connatre, ni par moi ni par les autres, j'allai sa recherche par une voie nouvelle (1). D
Cette voie consiste regarder comme cause vritable d'un objet la perfection idale de ce
mme objet, c'est--dire son Ide. Pour Platon , la mthode des causes fnales et la mthode
des Ides sont absolu-ment identiques, et il expose la seconde dans le Phdon, comme
application de la premire (2). Entre la cause exemplaire et la cause fnale, il n'y a pour lui
aucune difrence. L'artiste qui a les yeux fxs sur l'idal et qui s'eforce d'en reproduire
la vertu, D n'a d'autre fn que l'idal lui-mme. Ainsi l'intelligence divine a. pour modle la
perfection, le bien, soit qu'elle porte en elle-mme ce modle, soit qu'elle s'en distingue ;
et'sa fn est galement le bien. Elle n'agirait point si le bien n'existait pas; elle aurait beau
contenir en elle-mme la puissance efciente, elle ne pour-rait la manifester et la
dvelopper; car cette manifestation, tant sans motif et sans but, serait sans raison, Si
donc la cause efciente explique la ralit de l'efet, la cause fnale, son tour, explique
l'action de la cause efciente, et ainsi, au premier rang des causes, il faut placer, non pas
l'activit, non pas la pense, non pas mme l'tre, mais le bien.
1) Phoedo, 100, sqq.
2) La premire appartient Socrate, la seconde Platon, qui a chang la cause fnale en
Ide. Phcedo 100, 101 et ss.
L'IDE, CAUSE FINALE. 79
A cette hauteur, la mtaphysique et la morale s'unissent dans la communaut d'un mme
principe, et c'est pour ainsi dire la moralit et la bont des choses qui en explique
l'existence. Toute qualit, toute'essence, drive du bien et n'est compltement intelligible
que si on l'lve au degr de la perfection. Tout genre, toute loi, drive du bien et n'est
intelligible que par un modle idal qui est la perfection mme. Tout mouvement, enfn,
tout changement s'explique par un but idal qui est encore la perfection. Il y a un principe
qui se repose jamais clans son unit et sa puret, tandis que la nature inquite le
poursuit et le d-sire : ce principe esi l'Ide.
L'Ide est donc la raison suprme de l'existence, comme elle est la raison suprme de la
connaissance. C'est tout la fois une forme de'l'tre et une forme de la pense, par laquelle
l'tre devient intelligible et la pense intelligente. L'tre et la pense manent d'un mme
foyer; ce sont les rayons d'un mme soleil intelligible ; et s'il y a partout harmonie entre
l'intelligence et l'existence, c'est que la pense et l'tre ne font qu'un leur origine dans ce
centre commun des Ides, qui est le Bien (1).
(l) Nous reviendrons sur la cause fnale et sur la cause efciente dans la Thodice.
(01) Time, 52, a. , , , % &
, , &
'
(02) Tht., 153, 154.
(03) Philbe, 23 c. et ss.
(04) Time, 50; a. b. c.
(05) Phd., 100, 101.
(06) Phd., 101, a.
(07) Phd., 102, b.
(08) Phd., ib. Nous corrigeons la traduction Cousin, qui contient un norme non-sens.
(09) Phdre, 248 et ss.
(10) Banquet, 208.
(11) Time, 50.
(12) Procl., in Parm. V, 133.
(13) .
, , !
! ! , ! ! , % ( . -
Simplicius, de Coelo. (Aldd.; 67;b.)
(14) Nous ne laissons pas d'afrmer d'une manire absolue les vrits que nous avons une
fois dcouvertes, que les objets existent ou n'existent pas ; ce qui ne pourrait avoir lieu, si
ces vrits dpendaient uniquement de l'existence des objets, et si elles ne subsistaient pas
toujours comme des possibilits, dont la ralit est fonde dans quelque chose d'actuel ou
dans les Ides.
Les scolastiques, dit Leibnitz, ont fort disput de constantia subjecti, c'est--dire comment la
proposition faite sur un sujet peut avoir une vrit relle, si ce sujet n'existe pas.
C'est que la vrit n'est que conditionnelle, et dit qu'en cas que le sujet existe jamais, on le
trouvera tel.
Mais on demandera en quoi est fonde cette connexion, puisqu'il y'a de la ralit l
dedans qui ne trompe pas.
La rponse sera qu'elle est dans la liaison des ides.
Mais on demandera en rpliquant o seraient ces ides, si aucun esprit n'existait, et que
deviendrait alors le fondement rel de cette certitude des vrits ternelles?
Cela nous conduit au dernier fondement des vrits, savoir cet esprit suprme et
universel, qui ne peut manquer d'exister, dont l'entendement est la rgion des vrits
ternelles. Et afn qu'on ne pense pas qu'il n'est point ncessaire d'y recourir, il faut
considrer que les vrits ncessaires contiennent la raison dterminante des existences
mmes, en un mot, les lofs de l'univers. Ainsi, ces vrits tant antrieures aux existences
des tres contingents, il faut bien qu'elles soient fondes dans l'existence d'une substance
ncessaire. (Nouveaux Essais sur l'entendement humain, liv. IV, ch. 2.)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28) Id.
(29) Id., 39, a.
(30) Tht., 189, e., 190, a.
(31) Th. 199, 200 et ss.
(32) Th. 207 et ss.
(33) Leibnitz : Il y a de l'tre dans toute proposition.
(34) Cf. Phdon. 102, e.
(35) , . Rp.,
510, a.
(36) Le Thtte n'a d'autre but que de montrer l'insufsance de Ia sensation et de l'opinion.
C'est un dialogue ngatif, comme le soutiennent Ast, Socher, Stallbaum, Ueberweg, Zeller
et Grote. Mais ce dernier prtend que, au del de ce rsultat ngatif, Platon ne tend
aucune doctrine positive, qu'il n'y a dans le Thtte aucune allusion aux Ides, et que les
difcults souleves dans ce dialague ne reoivent aucune solution dans les autres
ouvrages de Platon. Ces trois points sont galement errons. Prtendre que Platon n'avait
aucune doctrine positive sur la nature de la science, est-ce comprendre les thories
platoniciennes? Nous verrons dans la Rpublique et dans tous les autres dialogues la
fausset de cette assertion. En second lieu, Platon laisse clairement entrevoir les Ides dans
le Thtte, 1 quand il reprsente le philosophe comme se demandant : qu'est-ce que
l'homme? et non qu'est-ce que tel ou tel homme? - Qu'est-ce que le juste? et non ceci est-il juste? 2
Quand il parle de l'tre, de l'unit, de la difrence, impliqus dans le jugement, de
l'essence et de la vrit, objets de la science, etc.
Quant l'absence de solution dont parle M. Grote, nous verrons plus tard ce qu'il en faut
penser. - V. Grote Plato, t. lI, Theaetetus.
(37) Rp., VI, 510 c. d. et ss., 511, a. b. - Cf. Lettre VII Ce cercle est un dessin qu'on eface,
une fgure matrielle qui se brise ; tandis que le cercle lui-mme () auquel
tout cela se rapporte ne soufre pourtant rien de tout cela. Cousin, 97.
(38) , ! " # $
" (Phdre, 265, d.)
(39) Arist., Mt. XIII.
(40)Voir notre travail spcial sur Socrate.
(41) Phdo, loc. cit.
(42) Philb., p.58. - Le cercle vritable ne peut avoir en lui-mme, ni en petite ni en grande
quantit, rien de contraire sa nature. Lettre VII. Cousin, 98.
(43) Rp. VII, 525.
(44) Rp. VI, 507 c.
(45) Phdo, 75.
(46) Philbe, 58.
(47) Thet. 196 e. Dans ses symboles mathmatiques, Platon appelle la science l'unit ou le
point; le raisonnement, la dualit ou la longueur; l'opinion, la triplicit ou surface ; et la
sensation, le nombre quatre ou le solide. V. plus loin un important passage d'Arist. Liv. Il,
les Nombres. Sur l'Ide de la science v. l'analyse du Parmnide.
(48) Dans la Lettre VII, la plus authentique de toutes (M. Grote admet mme que toutes le
sont) nous trouvons une confrmation remarquable de l'exposition qui prcde. Il y a
dans tout tre trois choses qui sont la condition de la connaissance : en quatrime lieu
vient la connaissance elle-mme, et en cinquime lieu ce qu'il s'agit de connaitre, la vrit
(l'Ide). La premire chose est le nom, la seconde .la dfnition, la troisime l'image; la
science est la quatrime... Le cercle a d'abord un nom... puis une dfnition compose de
noms et de verbes... Le cercle matriel est un dessin qu'on eface... tandis que le cercle en
soi est essentiellement difrent. Vient ensuite la science, la pense, l'opinion vraie sur cet
objet (Ce sont les trois degrs de la connaissance, raison, raisonnement et opinion).
Prises ensemble ces trois choses sont un nouvel lment qui n'est ni dans les noms, ni dans
les fgures des corps, mais dans les mes ; d'o il est clair que sa nature difre et du cercle
en soi et des autres choses dont nous avons parl. C'est--dire que les tats subjectifs et les
notions de notre me, intuitives, discursives, ou purement conjecturales, difrent la fois
des objets sensibles, des noms et des objets intelligibles ou Ides. Eclatante rfutation de
ceux qui prennent les Ides de Platon pour des notions gnrales et subjectives. De ces
quatre lments, le est celui qui, par ses ressemblances et son afnit naturelle, se
rapproche le plus du cinquime (l'Ide), les autres (raisonnement, opinion, mots, fgures)
en difrent beaucoup plus. (342 c.) - Donc les Ides sont les objets de la science et des
notions scientifques; le subjectif est seulement analogue l'objectif, en vertu du principe
platonicien que la connaissance doit tre analogue l'objet connu (Arist., De an., 404b.)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59) Sur un lit de parade. - Cet usage a dur longtemps. V. Svign, Lettr., 8 dc. 1679, et
comp. Labruyre, ch. VII, De la Ville, av.-dern, alina.
(60) Six livres : Histoire des empereurs romains depuis Auguste jusqu' l'an 410; simple rsum
jusqu' Diocltien, le rcit est plus dvelopp partir du rgne de ce prince. Il manque la
fn du 1er livre, le commencement du second, c'est--dire la fn du rgne de Probus, les
rgnes de Carus, de Numrien et de Carin (liv. 1), puis les rgnes de Diocltien, de
Maximien, de Constance et de Galerius jusqu' l'an 305 de J.-C.; il manque aussi la fn du
6e.
(61) Svre.
(62) Comp. plus.haut, p. 144-145, Eusbe, Chronic., II, sub ann. Ol. 254, 1, apr. J.-C. 235.
(63) Apr. J-C. 237.
(64) Apr. J.-C. 253.
(65) Apr. J.-C. 254.
(66) Agrippina (Colonia), Cologne (an de J.-C. 260).
(67) C'est--dire cantonnes chez les Celtes.
(68) An de J.-C. 276.
(69) An de J.-C. 277.
(70) An de J.-C. 277. - Eumne (Paneg. de Constance Chl., 18) rappelle ce fait d'incroyable
audace de prisonniers francs qui a Ponto usque correptis navibus, Graeciam Asiamgiie
populati, nec impune plerisque Libye littoribus appulsi, ipsas postremo navalibus
quondam victoriis ceperant Syracusas, etc.
(71) An de J.-C. 307.
(72) An de J.-C. 308.
(73) An de. J.-C. 312.
(74) An de J-C. 313.
(75) An de J.-C. 317.
(76) An de J.-C. 332.
(77) An de J.C. 337. Les deux princes ici mentionns taient fls de Constantin 1er, dit le
Grand.
(78) An de J.-C. 350 : Le repas se prolongea fort avanc dans la nuit... To d sumposou
mxri msvn ktayntow nuktr, Magnntiow di ti dyen tn nagkavn dianstw k
to depnou ka prw brax tn daitumnvn autn postsaw, faneto tow
sumptaiw sper n skhn tn basilikn mfesmnow stoln. Tn de ktl.
(79) Ce passage est traduit d'Aurelius Victor (De Vita et Moribus impp. rom., XLI) ou puis
la mme source Constans fugere conatus apud Helenam oppidum Pyrenaeo proximum a
Gaisone cum lectissimis misso interfcitur anno III dominationis. - Helena, Elne (Pyrn.-
Orientales), nomme primitivement Illiberis.
(80) An de J.-C. 350.
(81) An de J.-C. 351. Saint Jrme dit son frre.
(82) An de J.-C. 352. - V. la note 2 de la page ci-contre.
(83) La perte de la bataille de Mursa, en Pannonie (351), lui avait port un coup dont il
n'avait pu se relever. Il avait dans son arme des cohortes gauloises ou celtes; il en engagea
quatre qui prirent jusqu'au dernier homme dans un stade prs de la ville o il les avait
postes. Zosime, II, 50. Tot (stad) Keltn flaggaw tssaraw napkrucen... xriw te
difyeiran "pantaw .- Sur Magnence et sa tyrannie, v. ci-aprs Socrate, II, 25, 32. Selon cet
historien, Mursa est une place forte des Gaules (frorion d toto tn Gallin), trois
journes de marche de Lyon, et Adrien de Valois n'hsite pas y voir la petite ville de La
Mure en Dauphin. Eam esse existimat Hadr. Valesius, qu, sublata una littera, nunc
appellatur Mura, La Mure, et in Delphinatu posita est, abestque ab urbe Lugduno leugas
circiter XXV aut etiam XXX, quod trium dierum iter facile confcitur. Note de D. Bouq. -
Sozornne, Hist. eccl., IV, 7 (v. ci-apr.), copie Socrate.
(84) Sur le rle de l'impratrice Eusbie en cette afaire, v. ci-apr. Socrate, Hist. eccl., III, 1.
Comp. Amm. Marcell., XV, VIII, 1 : Queis (Constantii proximis) adnitentibus obstinate,
opponebat se solaregina, incertum...... an pro nativa prudentia consulens in commune,
omnibusque memorans anteponi debere propinquum....
(85) Comp. plus bas Socrate, Hist. eccl., liv. II, 1, et Sozomne, Hist., eccl., V, 1-3. Ces
crivains chrtiens apprcient avec assez d'impartialit dans le nouveau csar et dans le
successeur de Constance l'homme de guerre, l'administrateur, le philosophe et le
restaurateur impuissant d'une religion jamais dchue.
(86) 350 ap. J.-C. - Socrate, ibid., indique l'espce de dsordres auxquels le jeune csar dut
avant tout remdier.
87) Pour les dtails de la bataille d'Argentoratum (apr. J.-C. 357), v. les dveloppements un
peu emphatiques d'Amm. Marcellin (XVI,,12). Selon lui, les pertes des Romains furent
insignifantes : Ceciderunt autem in hac pugna Romani quidem CCXL et in rectores vero
IV... ex Alamannis vero sex millia corporum inventa sunt in campo constrata, et
inaestimabiles mortuorum acervi per undas fuminis ferebantur...
(88) Ici, comme plus haut, dans le XIIIe fragm. d'Eunape, p. 128-9, il faudrait sans doute
crire Vadomarios ou Vadomarius. Cf. Amm. Marcel:, XIV, X, 1 et ailleurs.
(89) Les quatre lignes qui prcdent se trouvent dans les extraits de D. Bouquet. - 900
stades = 180 m. X 900 st. = 162 kil. - C'est de la Bretagne qu'il tirait d'habitude ses
approvisionnements, annona a Britannis sueta transferri. Amm. Marcell., XVIII, II, 3.
(90) Ce morceau, partir d'ici, se trouve dans D. B.
(91) Comp. plus haut, p. 122-129, le dramatique rcit d'Eunape.
(92) An de J.-C. 359.
(93) Amm. Marcell.,. XX, IV, 1 : .... Urebant Juliani virtutes, quas per ora gentium
diversarum fama celebrior efundebat...
(94) An de J.-C. 360. - Cf. Amm. Marcel l., ibid., 11 : cum ambigeretur diutius qua pergerent
via, placuit...... per Parisios homines transire, ubi morabatur adhuc caesar nusquam
motus...
(95) Comp. Ammien, ibid., 14, 17 : ... lmpositusque scuto pedestri et sublatius eminens,
nullo silente, Augustus renuntiatus ...
(96) Il tait le beau-pre du nouvel empereur Jovien, et avait t charg, avec Procope et
Valentinien (le successeur de Jovien), de porter aux armes la nouvelle de la mort de
Julien. - Apr. J.-C. 363.
(97) Apr. J.-C. 366.
(98) Charietton prit dans cette bataille: V., Amm. Marcell., XXVII, 1.
(99) An de J.-C. 366.
(100) Valentinien demeura toute cette anne dans le N.-E. de la Gaule, Reims, Metz,
Chalons, pour surveiller les desseins des Alamans.
(101) An de J.-C. 375.
(102) An de J.-C. 379.
(103) Ces mauvaises nouvelles taient le dplorable tat de la Thessalie et de la Macdoine,
et la ngligence de Thodose, son associ l'empire, qui, sans tre touch des misres
publiques, ne songeait qu'a donner Constantinople un luxe et des plaisirs en rapport avec
la grandeur de la ville.
(104) An de J.-C. 383.
(105) An de J.-C. 388. Magister ofciorum. C'tait une espce de ministre universel, dont les
fonctions taient fort tendues ; il rendait la justice presque tous les employs du palais
(palatini), etc., etc. Guizot, Hist. de la civil. en France, t. III, p. 9, in-8.
(106) Comp. ci-aprs Philostorge, XI, 1, p. 283. - Grg. de Tours, 11;9, donne, d'aprs
Sulpice Alexandre, d'autres dtails intressants ... Valentiniano, pene infra privati modum
redacto, militaris rei cura Francis satellitibus tradita...
(107) An de J.-C. 392. - Cf. Philostorg., ibid., p. 85.
(108) An de J.-C. 395.
(109) Proprement ador, selon l'usage.
(110) Littralement des paeans. - Cf. ci-apr. Philost., p. 288-289.
(111) An de J.-C. 405.
(112) A Honorius qui voulait passer en Orient pour venir en aide son jeune neveu,
Thodose II, que la mort d'Arcadius venait de mettre en possession du trne.
(113) An de J.-C. 407.
(114) Ici commence l'extrait de D. Bouquet.
(115) An de J.-C. 408.
(116) An de J.-C. 406.
(117) De l'empereur Julien.
S-ar putea să vă placă și
- Joseph Moreau - L'Idée Platonicienne Et Le RéceptacleDocument14 paginiJoseph Moreau - L'Idée Platonicienne Et Le RéceptacleduckbannyÎncă nu există evaluări
- La Raison - Assistance Scolaire Personnalisée Et Gratuite - ASPDocument3 paginiLa Raison - Assistance Scolaire Personnalisée Et Gratuite - ASPAlix FaucretÎncă nu există evaluări
- Chapitre VéritéDocument11 paginiChapitre Véritélaurine.chayrouseÎncă nu există evaluări
- V2PS - La Réalité...Document9 paginiV2PS - La Réalité...ludovicvandercamÎncă nu există evaluări
- Pr. La VéritéDocument3 paginiPr. La Véritéflore moussavoumÎncă nu există evaluări
- TG3 VéritéDocument7 paginiTG3 VéritéYOUSSEF LANDOULSIÎncă nu există evaluări
- La Vérité TA Trace ÉcriteDocument8 paginiLa Vérité TA Trace ÉcriteThildemaÎncă nu există evaluări
- Philo Tout (Merci Jess')Document44 paginiPhilo Tout (Merci Jess')shouaipsÎncă nu există evaluări
- 1931 André Marc - La Méthode D'opposition en Ontologie ThomisteDocument22 pagini1931 André Marc - La Méthode D'opposition en Ontologie ThomisteEduardo FigueiredoÎncă nu există evaluări
- Philo AntiqueDocument4 paginiPhilo AntiqueAlain TerrieureÎncă nu există evaluări
- Les SocratiquesDocument3 paginiLes SocratiquesStephane KouakouÎncă nu există evaluări
- Textes Quest Ce Quun ProblèmeDocument2 paginiTextes Quest Ce Quun ProblèmeMatthieu BazenÎncă nu există evaluări
- Brunschvicg: de Quelques Préjugés Contre La PhilosophieDocument21 paginiBrunschvicg: de Quelques Préjugés Contre La PhilosophiemathesisuniversalisÎncă nu există evaluări
- Philosophie Quete VéritéDocument4 paginiPhilosophie Quete VéritéAstroRakotoÎncă nu există evaluări
- Ob 17bd33 La Querelle Des Universaux2Document8 paginiOb 17bd33 La Querelle Des Universaux2Alae Omar NejjarÎncă nu există evaluări
- KOUASSI Bernard YaoDocument11 paginiKOUASSI Bernard Yaokoffikonaneric299Încă nu există evaluări
- Frithjof Schuon Ou La Saintete de LDocument3 paginiFrithjof Schuon Ou La Saintete de LJoranxxx100% (1)
- Questions Sur PlatonDocument3 paginiQuestions Sur PlatonRodney ElmireÎncă nu există evaluări
- Philosophie Du DroitDocument57 paginiPhilosophie Du DroitFelix Lorenzo SoromouÎncă nu există evaluări
- 6 Philosophie Et Esprit Critique-1-1Document2 pagini6 Philosophie Et Esprit Critique-1-1Mouhamed BarroÎncă nu există evaluări
- Verite, Certitude, EvidenceDocument9 paginiVerite, Certitude, EvidenceJunior SimeusÎncă nu există evaluări
- PhiloDocument3 paginiPhilokergourlaycarlaÎncă nu există evaluări
- Je Pense Donc Je SuisDocument2 paginiJe Pense Donc Je SuisPierre Frantz PetitÎncă nu există evaluări
- Synthèse de "La Soif de La Sagesse" de M. ClémentDocument4 paginiSynthèse de "La Soif de La Sagesse" de M. ClémentClaire COUVREURÎncă nu există evaluări
- L'idée Du Néant Brehier Et Le Probleme de L'origine Radicale Dans Le Néoplatonisme GrecDocument34 paginiL'idée Du Néant Brehier Et Le Probleme de L'origine Radicale Dans Le Néoplatonisme GrecJuan José Fuentes UbillaÎncă nu există evaluări
- Cours 4 NietzscheDocument8 paginiCours 4 NietzscheHam arteliÎncă nu există evaluări
- Russell Philosophie ExplicationDocument3 paginiRussell Philosophie ExplicationLadji Mamoudou KabaÎncă nu există evaluări
- Méthodecommentaire Exemple Bernard VéritéDocument4 paginiMéthodecommentaire Exemple Bernard VéritéMamadou Moustapha SarrÎncă nu există evaluări
- Aristo Te CritiqueDocument210 paginiAristo Te CritiquebenrabahÎncă nu există evaluări
- TendryDocument5 paginiTendryraex_innoÎncă nu există evaluări
- Cours Philo La VéritéDocument17 paginiCours Philo La VéritéMamadou Moustapha Sarr100% (1)
- L'Idéalisme en PhilosophieDocument2 paginiL'Idéalisme en PhilosophiePierre Frantz PetitÎncă nu există evaluări
- BORELLA Jean - Firthjof Schuon Ou La Sainteté de L'intelligenceDocument10 paginiBORELLA Jean - Firthjof Schuon Ou La Sainteté de L'intelligenceTouveron Jean-YvesÎncă nu există evaluări
- CRP Et CPPRDocument10 paginiCRP Et CPPRFraise MandarineÎncă nu există evaluări
- La Connaissance Selon PlatonDocument56 paginiLa Connaissance Selon PlatonMondet0% (1)
- Dieu Garant de La Regle General DescarteDocument6 paginiDieu Garant de La Regle General Descarteapi-10223024100% (2)
- Philosophie 12SSDocument20 paginiPhilosophie 12SSfujiÎncă nu există evaluări
- La Philosophie Critique de KantDocument56 paginiLa Philosophie Critique de Kantzbsyahoo100% (1)
- La RaisonDocument3 paginiLa Raisonerray yousraÎncă nu există evaluări
- La Vérité en Science Expérimentale Cours CompletDocument7 paginiLa Vérité en Science Expérimentale Cours Completmsm le plus beau des reubeusÎncă nu există evaluări
- Spécificité de La PhilosophieDocument6 paginiSpécificité de La PhilosophieMamadou Moustapha Sarr0% (1)
- Les Formes IntelligiblesDocument5 paginiLes Formes Intelligiblesgregorykudish100% (1)
- Exposé MétaphysiqueDocument13 paginiExposé MétaphysiqueKomlan Jérémi AtamekloÎncă nu există evaluări
- Resume Philo CompletDocument105 paginiResume Philo CompletKarim524Încă nu există evaluări
- Support écrit 1e PartieDocument68 paginiSupport écrit 1e Partienourkada040905Încă nu există evaluări
- HéloiseDocument3 paginiHéloiseCDES Ibn KhaldounÎncă nu există evaluări
- Dissertation L'idealismeDocument2 paginiDissertation L'idealismekoupannagaardjoumasÎncă nu există evaluări
- L2 Descriptifs 2018 2019Document50 paginiL2 Descriptifs 2018 2019Link ZeldaÎncă nu există evaluări
- Philo PlatonDocument12 paginiPhilo Platonclement17100% (2)
- Fascicule de Philosophie (Gwye)Document98 paginiFascicule de Philosophie (Gwye)coumbacamara2705Încă nu există evaluări
- 00 - Intro - La Philosophie Cheminement - RaisonDocument10 pagini00 - Intro - La Philosophie Cheminement - Raisond9vpfhm5t8Încă nu există evaluări
- PHILO KholleDocument2 paginiPHILO KholleMoesha D'almeidaÎncă nu există evaluări
- Philo Terminal D, Sujet - CorrigéDocument3 paginiPhilo Terminal D, Sujet - CorrigéEkspench Orelien67% (3)
- DOMAINE III 11 Textes D'appuiDocument4 paginiDOMAINE III 11 Textes D'appuiMamadou Moustapha SarrÎncă nu există evaluări
- Le Temps N'est Pas Un Produit de L'âme: Proclus Contre PlotinDocument11 paginiLe Temps N'est Pas Un Produit de L'âme: Proclus Contre PlotindoppiapresaÎncă nu există evaluări
- Théorie et expérience (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieDe la EverandThéorie et expérience (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Leçons de philosophie: ou Essai sur les facultés de l'âme - Tome IIDe la EverandLeçons de philosophie: ou Essai sur les facultés de l'âme - Tome IIÎncă nu există evaluări
- Connaissance: Les Grands Articles d'UniversalisDe la EverandConnaissance: Les Grands Articles d'UniversalisÎncă nu există evaluări
- Polybe Histoire Générale Livre 11Document21 paginiPolybe Histoire Générale Livre 11gustavog1956Încă nu există evaluări
- Polybe Histoire Générale Livre 10Document68 paginiPolybe Histoire Générale Livre 10gustavog1956Încă nu există evaluări
- Polybe Histoire Générale09Document57 paginiPolybe Histoire Générale09gustavog1956Încă nu există evaluări
- Polybe Histoire Générale Livre IIDocument45 paginiPolybe Histoire Générale Livre IIgustavog1956Încă nu există evaluări
- Tacite Annales01Document42 paginiTacite Annales01gustavog1956Încă nu există evaluări
- Polybe Histoire Générale Livre VIIIDocument24 paginiPolybe Histoire Générale Livre VIIIgustavog1956Încă nu există evaluări
- Polybe Histoire Générale Livre VIIDocument12 paginiPolybe Histoire Générale Livre VIIgustavog1956Încă nu există evaluări
- Polybe Histoire Générale Livre IIIDocument76 paginiPolybe Histoire Générale Livre IIIgustavog1956Încă nu există evaluări
- Polybe Histoire GénéraleLivre VIDocument36 paginiPolybe Histoire GénéraleLivre VIgustavog1956Încă nu există evaluări
- Polybe Histoire Générale05Document64 paginiPolybe Histoire Générale05gustavog1956Încă nu există evaluări
- Polybe Histoire Générale Livre IVDocument54 paginiPolybe Histoire Générale Livre IVgustavog1956Încă nu există evaluări
- Polybe Histoire Générale Livre 1Document55 paginiPolybe Histoire Générale Livre 1gustavog1956Încă nu există evaluări
- MACROBE Saturnales02Document51 paginiMACROBE Saturnales02gustavog1956Încă nu există evaluări
- Contre Les GaliléensDocument30 paginiContre Les Galiléensgustavog1956Încă nu există evaluări
- TACITE ANNALES Livre 02Document39 paginiTACITE ANNALES Livre 02gustavog1956Încă nu există evaluări
- Athénée de Naucratis Livre IXDocument110 paginiAthénée de Naucratis Livre IXgustavog1956Încă nu există evaluări
- Aulu-Gelle Nuits Attiques Livre 2Document58 paginiAulu-Gelle Nuits Attiques Livre 2gustavog1956Încă nu există evaluări
- Julien Épître Au Sénat Et Au Peuple DDocument15 paginiJulien Épître Au Sénat Et Au Peuple Dgustavog1956Încă nu există evaluări
- Julien Le Banquet Ou Les CésarsDocument20 paginiJulien Le Banquet Ou Les Césarsgustavog1956Încă nu există evaluări
- MACROBE Saturnales03Document32 paginiMACROBE Saturnales03gustavog1956Încă nu există evaluări
- MACROBE Saturnales01Document90 paginiMACROBE Saturnales01gustavog1956Încă nu există evaluări
- MACROBE Saturnales04Document28 paginiMACROBE Saturnales04gustavog1956Încă nu există evaluări
- Athénée de Naucratis Livre 15Document56 paginiAthénée de Naucratis Livre 15gustavog1956Încă nu există evaluări
- Athénée de Naucratis Livre XDocument72 paginiAthénée de Naucratis Livre Xgustavog1956Încă nu există evaluări
- Athénée de Naucratis Livre 14Document88 paginiAthénée de Naucratis Livre 14gustavog1956Încă nu există evaluări
- Athénée de Naucratis Livre VIIDocument135 paginiAthénée de Naucratis Livre VIIgustavog1956Încă nu există evaluări
- Athénée de Naucratis Livre XiiDocument18 paginiAthénée de Naucratis Livre Xiigustavog1956Încă nu există evaluări
- Athénée de Naucratis Livre ViDocument91 paginiAthénée de Naucratis Livre Vigustavog1956Încă nu există evaluări
- Athénée de Naucratis Livre VIIIDocument86 paginiAthénée de Naucratis Livre VIIIgustavog1956Încă nu există evaluări
- Athénée de Naucratis Livre VDocument88 paginiAthénée de Naucratis Livre Vgustavog1956Încă nu există evaluări
- Platon, ExposéDocument3 paginiPlaton, ExposéLucieAlheincÎncă nu există evaluări
- Macherey Georges Canguilhem Un Style de PenséeDocument6 paginiMacherey Georges Canguilhem Un Style de PenséeNicolas CaballeroÎncă nu există evaluări
- RENE GUENON - Le DémiurgeDocument10 paginiRENE GUENON - Le DémiurgeDoghouse ReillyÎncă nu există evaluări
- La Philosophie Du DroitDocument91 paginiLa Philosophie Du DroitMehdi Lhmr100% (3)
- Fiche Ecrire Un Texte ArgumentatifDocument1 paginăFiche Ecrire Un Texte ArgumentatifFouzia BadiÎncă nu există evaluări
- Badiou NietzscheDocument141 paginiBadiou Nietzscheparvizm100% (1)
- L'imagination Productrice Dans La Logique Transcendantale de Fichte PDFDocument22 paginiL'imagination Productrice Dans La Logique Transcendantale de Fichte PDFdfsdfsdfteÎncă nu există evaluări
- Paul Ricoeur - Autrement Lecture PDFDocument46 paginiPaul Ricoeur - Autrement Lecture PDFAnonymous PSO0vRf100% (1)
- Mé Thodologie de RechercheDocument16 paginiMé Thodologie de Rechercheadil BENCHAHBÎncă nu există evaluări
- MD Philippe Philosophie de L'etreDocument79 paginiMD Philippe Philosophie de L'etreΦΧΦΠ100% (2)
- Somme de La Foi Catholique Contre Les Gentils (Tome 1)Document487 paginiSomme de La Foi Catholique Contre Les Gentils (Tome 1)IHS_MAÎncă nu există evaluări
- DescartesDocument58 paginiDescartesBbaggi BkÎncă nu există evaluări
- Logique Mathématique Etudiants Prédicat ch3Document18 paginiLogique Mathématique Etudiants Prédicat ch3zidane3x3100% (1)
- Fondements Principes Demarches BonDocument36 paginiFondements Principes Demarches Bonablo NebieÎncă nu există evaluări