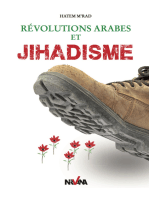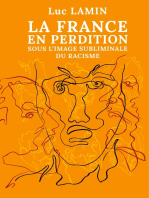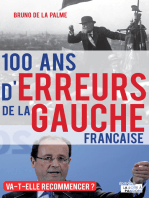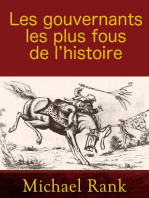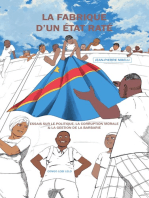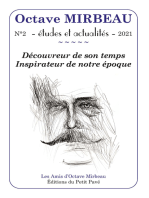Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Boukrouh 13
Încărcat de
Anonymous heudrulA70 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
53 vizualizări3 paginiarticle
Titlu original
BOUKROUH 13
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentarticle
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
53 vizualizări3 paginiBoukrouh 13
Încărcat de
Anonymous heudrulA7article
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 3
Contribution : QUATRIÈME MANDAT
Un homme a gagné, une nation a perdu
Par Nour-Eddine Boukrouh
noureddineboukrouh@yahoo.fr
«Toutes les nations ont traversé des époques pendant lesquelles quelqu’un qui ne devait pas les commander
aspirait pourtant à le faire. Mais un fort instinct leur fit concentrer sur-le-champ leurs énergies et expulser cette
illégitime prétention. Elles repoussèrent l’irrégularité et reconstruisirent ainsi leur morale publique. Mais il en est
qui font tout le contraire ; au lieu de s’opposer à être commandées par quelqu’un qui leur répugne dans leur for
intérieur, elles préfèrent falsifier tout le reste de leur être pour s’accommoder de cette fraude initiale »
(José Ortega Y Gasset, La révolte des masses).
Un soir que nous dînions à Valence, le Président Bouteflika et la délégation qui l’accompagnait, dont moi, à la
table du Premier ministre espagnol José Maria Aznar, je lui ai posé une question sur le philosophe espagnol
auteur de la pensée qu’on vient de lire. Arquant les sourcils d’étonnement, il me fit cette réponse : «C’est notre
maître à penser !» C’était je crois en avril 2002. Les membres de notre délégation n’étaient pas moins étonnés
par ce bref échange entre Aznar et moi. C’est que nous, nous n’avons jamais eu de «maître à penser». Nous
nous hérissons à l’idée qu’il puisse en être question et quand il s’en présente inexplicablement un, comme Malek
Bennabi, on fait tout, les soi-disant élites en tête, pour l’enterrer sous des montagnes d’accusations et de
préjugés. Notre mentalité vénère depuis la nuit des temps les cheikhs aveugles au sens propre et figuré du
terme, les zaïms ignares, les «hommes historiques» de la Révolution, les despotes semi-analphabètes et la
casquette militaire. En avril 1993, j’avais publié dans le quotidien Liberté un article intitulé «L’encanaillement du
peuple algérien» où je reprenais à mon compte pour décrire notre situation une expression de l’auteur espagnol.
Contemporain, ce philosophe a été pour l’Espagne ce que Malek Bennabi a été pour le monde musulman, et ce
que l’un entendait par «encanaillement », l’autre l’appelait « colonisabilité». Dans les années soixante-dix, je
faisais déjà dans mes écrits un parallèle entre les deux penseurs. En 1993 donc, Bouteflika n’était pas au pouvoir
mais un homme perdu dans la masse qui, s’il «y pensait toujours, n’en parlait jamais» selon la formule de
Gambetta à propos de l’Alsace et de la Lorraine occupées par l’Allemagne en 1870. Voici la définition que donne
Ortega de cette expression dans son livre: «L’encanaillement n’est rien d’autre que l’acceptation, en tant qu’état
naturel et normal, d’une irrégularité, d’une chose qui continue de paraître anormale, mais que l’on continue
d’accepter. Or comme il n’est pas possible de convertir en une saine normalité ce qui, dans son essence même
est criminel et anormal, l’individu décide de s’adapter de lui-même à la faute essentielle et de devenir ainsi partie
intégrante du crime et de l’irrégularité qu’il entraîne». Elle nous va comme un gant et montre que ceux qui croient
pouvoir déchiffrer les faits sociologiques et politiques sans les rapporter à la courbe de vie historique d’une
nation, à son fonds mental et à son psychisme culturel (le fameux «inconscient collectif» de Jung), ne peuvent
que voir et conclure faux. Un homme concentrant entre ses mains 100% des pouvoirs que confère la Constitution
au président de la République alors qu’il ne dispose que de quelque % de ses capacités physiques et
intellectuelles pour les assumer était déjà un casse-tête juridique, un péril pour la continuité de l’Etat, un non-sens
mental, une impossibilité logique et un cas de «chèvre qui vole» qu’on ne voit qu’en Algérie. Un tel homme a été
montré jeudi dernier au monde entier, après l’annonce d’une «grande amélioration dans son état de santé»,
effectuant son devoir d’électeur : il était incapable d’introduire un bulletin de vote d’un gramme dans une
enveloppe. Qu’il ait gagné l’élection par la fraude ou le vote sincère revient au même : ce n’est pas la démocratie
qui vient de gagner, c’est l’«encanaillement» d’une partie de notre peuple et de ses «élites» civiles et militaires
qu’il n’est pas possible de quantifier. L’homme ne pouvait gagner et la nation perdre qu’en convenant ensemble,
par une sorte de télépathie, de quitter le monde du «common sense» (sens commun) pour aller traficoter dans
celui de l’absurde et de la «beznassa ». On connaît la trajectoire de l’homme : il a été de ceux qui ont dominé
notre vie nationale de 1962 à 1979 par le rôle qu’il a joué dans le renversement du GPRA et de Ben Bella ainsi
que tout au long du gouvernement de Boumediene. C’est ce dernier qui l’a ramené puis nous l’a légué, et c’est
l’une des grandes énigmes de son règne. C’est par pure chance que nous avons échappé en 1979 à son
inextinguible soif du pouvoir grâce à la lucidité (ou aux calculs) de feu Kasdi Merbah qui lui avait barré la route de
la présidence. D’autres l’ont remis en 1999 au pouvoir qu’il n’imagine quitter désormais que mort. Voilà donc un
demi-siècle de notre vie nationale, seule période que l’Algérie a vécue en tant qu’Etat-nation dans son histoire
trimillénaire, passé presqu’en entier sous la direction d’un seul homme par la magie de l’esprit du douar qui était
jadis le socle sur lequel s’élevait le colonialisme, au temps du parti unique celui sur lequel s’élevait le despotisme,
entre 1989 et 1992 celui sur lequel a failli s’élever «l’Etat islamique», et aujourd’hui celui sur lequel s’élève haut la
tête le 4e mandat d’un homme pris en otage par son entourage familial et les mameluks à son service qui vont
avoir tout loisir d’intriguer pour lui succéder. Les Mameluks sont ces anciens serviteurs du calife qui ont accédé
au pouvoir en Égypte au XIIIe siècle et ne l’ont quitté par la force qu’au XVIe. La nation qui a perdu, ce ne sont
pas ceux qui ont voté et dont on a falsifié le choix, ce ne sont pas ceux qui se sont abstenus ou ont boycotté mais
qu’on a quand même fait «voter , ce ne sont pas les Algériens en vie seulement, c’est l’idée de nation elle-même,
c’est la nation algérienne du temps de la Révolution, d’aujourd’hui et de demain. C’était déjà une anomalie qu’il
se présente à une élection présidentielle dans son état, à son âge et après trois mandats alors que la Constitution
qu’il a trouvée en venant n’en permettait que deux. Une nation saine d’esprit et de corps ne peut pas entériner
une conjonction aussi importante d’anomalies. La nôtre vient de le faire dans la liesse et l’allégresse. Sur les
1825 jours que compte un mandat, Bouteflika n’a besoin du peuple que durant 1 seul, celui de l’élection
présidentielle, juste pour faire de la figuration car il sait comment les choses se passent réellement. Pendant les
1824 autres il n’a pas besoin du peuple et va donc lui tourner le dos pour s’occuper de lui-même. Notre nation va-
t-elle être choquée par les résultats de l’élection, par les conséquences pouvant découler tôt ou tard de sa
complaisance et de sa passivité ? Quelque chose va-t-il changer radicalement dans le mode de pensée de ses
«élites» et le discours de ses partis ? Jusqu’ici ils n’ont été qu’une facette, qu’un volet de la déliquescence
générale. Sous leurs habits modernes se cache une psychologie archaïque dominée par les jugements
approximatifs, intéressée seulement par ce qui va dans le sens de ses intérêts personnels ou partisans. Ils
s’amusent avec des concepts sans prise sur les mentalités, sans rapport avec notre stade d’évolution sociale. Un
quart de siècle après l’apparition du multipartisme, aucune alternative au «système» ne s’est formée si l’on
excepte la tentative populiste du FIS entre 1989 et 1991 qu’il ne faut pas prendre pour un phénomène politique,
mais pour un phénomène culturel à l’instar de ce qui s’est produit dans le monde arabo-musulman où il y a eu
des élections. L’opposition au sens politique, moderne et rationnel n’existe pas encore, elle est à créer. Et ce
n’est pas parce que le pouvoir à tort que ce qui tient lieu d’opposition a raison. Si elle dit vrai dans le procès du
«système», elle n’a rien fait de tangible pour se préparer à le remplacer. L’avenir du pays passe par le
changement du système mais celui-ci n’aura pas lieu sans l’assainissement des idées concernant les
fondements, l’organisation et les objectifs de l’opposition. Nous avons essayé les émeutes d’octobre 1988, les
marches menaçantes du FIS, le terrorisme de l’AIS, des GIA et d’AQMI, les longues marches des «Arouch», les
émeutes de janvier 2011, les boycotts d’élection, le retrait des élections et les tentatives de changement « de
l’intérieur » auxquelles ont cru, en intégrant le gouvernement, dans l’ordre le FFS, d’ex-membres du FIS, HAMAS,
le RCD, NAHDA, l’ANR et moi-même (en tant que personne et non au nom du PRA que j’avais quitté). Ce qu’il
reste à essayer, c’est une vie politique repensée et remaniée de fond en comble, rompant avec ce qui a été
vainement testé et nouant avec ce qui ne l’a pas encore été. Une vie politique qui ne soit pas égocentrique,
c’està- dire centrée sur les leaders, ni allocentrique, c’est-à-dire obsessionnellement tournée vers le pouvoir, mais
orientée vers l’esprit du douar pour le réformer, le peuple pour l’impliquer dans le militantisme et la société pour
l’engager dans la production d’idées civiques et de comportements citoyens. Alors la nation pourra rêver de
pouvoir gagner un jour contre un mameluk qui voudrait placer ses déficiences personnelles, sa dynastie ou ses
domestiques au-dessus de nos têtes. Nous ne connaîtrons pas de printemps démocratique parce qu’il n’est pas
encore à notre portée, parce que nous ne le méritons pas encore. Par contre, c’est un hiver glacial qui nous
gèlera et tuera beaucoup des nôtres qui s’abattra sur nous un jour difficile à déterminer dans les conditions
économiques et sociales actuelles, mais qui s’abattra à n’en pas douter. Ce jour ne sera pas celui où nous
voudrions changer de régime politique pour aller vers un meilleur, mais celui où les recettes des hydrocarbures
ne suffiront plus pour assurer le fonctionnement des services de l’Etat, couvrir nos importations et acheter la paix
sociale. Il ne peut pas ne pas arriver sachant que 98% de notre consommation en biens et services extérieurs
sont financés par les recettes des hydrocarbures. Bouteflika le sait mieux que personne, mais il n’en a cure ; ne
lui importe que la «stabilité» tant qu’il est au gouvernail. Après lui le déluge. Ces derniers mois, beaucoup de
figures politiques ont lancé des initiatives sans qu’aucune ne comporte de modalités pratiques, s’illusionnant
qu’avec la simple parution de leurs appels dans la presse les Algériens accourraient en masse pour se placer
sous l’étendard de l’une ou de l’autre. Benflis, qui vient à son tour de lancer un appel à se regrouper autour de
son projet de «rénovation nationale », risque de tomber dans le même travers et d’essuyer par conséquent le
même échec. S’il l’a adressé à ses électeurs, il a bien fait. Mais s’il le destinait à la scène politique, il se trompe
mais peut encore se rattraper. Ceux qui ne l’ont pas rejoint au plus fort de sa campagne ne le rejoindront pas
maintenant qu’il a été défait, même si c’est par la fraude. Les «démocrates» et les «islamistes» qui ont appelé au
boycott croyaient, de bonne ou de mauvaise foi, c’est selon, faire échec au 4e mandat. Ils n’ont fait que s’en laver
les mains. Ils savaient que s’ils avaient présenté des candidats, aucun d’entre eux n’aurait dépassé le score
concédé à Belaïd. Pris dans leurs «açabiyate » pour les uns et le jeu médiatique grisant pour l’ego mais stérile en
termes de rendement électoral pour les autres, ils ont favorisé un 4e mandat de Bouteflika sur la victoire d’un
autre sur lequel ils savaient ne pas pouvoir s’entendre parce que chacun se voyait à sa place. C’est sur le mur de
l’égocentrisme que se sont fracassées toutes les tentatives de travail en commun de l’«opposition» depuis 1989.
J’étais dans la vie politique partisane, et on peut me demander ce que j’ai fait pour qu’il en aille autrement. Voici
quelques éléments de réponse : 1) En mai 1990, au Congrès constitutif du PRA qui s’était tenu à la coupole du 5-
Juillet et auquel avait été invité l’ensemble des partis politiques de l’époque, j’avais exprimé dans mon discours
d’ouverture, deux ans avant l’apparition du terrorisme, ces appréhensions (début de citation) : «Notre patrie est
en danger. Elle est au premier chef menacée par la disqualification définitive d’un régime irrédentiste qui s’obstine
à exciter les causes de mécontentement populaire par le seul fait de s’accrocher à un pouvoir que le peuple lui
conteste tous les jours de multiples façons… Mais elle est aussi menacée, et là je m’adresse à vous honorables
invités en qui nous voyons des frères avant de voir des rivaux, par nos antagonismes, nos efforts divergents, nos
peurs réciproques, nos irrationalités respectives… Voici qu’à notre tour nous confirmons le séculaire manque de
sens collectif reproché à notre peuple.
Voilà que nous administrons au monde qui nous observe la preuve de notre incompétence à nous élever à une
appréciation commune de nos intérêts supérieurs en une étape pourtant cruciale pour l’avenir de notre nation.
Nous savons tous que c’est cela qui a perdu les générations qui nous ont précédés sur cette terre et les a
conduites à la colonisation et au sous-développement. Nous pressentons tous obscurément que c’est ce qui nous
mènera fatalement à la GUERRE CIVILE… «Faute de pouvoir présenter à notre peuple un projet de société
commun, nous y parviendrons peut-être un jour, nous pourrions lui offrir dans l’immédiat l’espoir de solutions
consensuelles émanant d’une sorte de «Conseil de l’entente nationale» que nous pourrions former pour être
consultés sur les affaires de la nation en attendant la dissolution de l’Assemblée nationale. Que le système en
place doive être évacué est notre premier point d’accord. Qu’il le soit dans la paix sociale et la stabilité des
institutions peut être le deuxième point d’accord. Mais que nous réussissions à convenir d’un discours de salut
public assorti d’un programme économique adapté aux problèmes urgents, serait la preuve sublime que
l’opposition algérienne est en mesure d’assurer la transition pacifique vers l’alternative que dessineront
démocratiquement les prochaines élections législatives… «Les solutions que nous pourrions avancer ne
devraient en aucune façon découler de la mise en exergue de nos dissemblances, mais plutôt de notre aptitude à
mettre en avant nos ressemblances d’Algériens venus d’horizons politiques divers, formés à des écoles de
pensée différentes, mais nourrissant néanmoins le même attachement à voir notre nation sortir sans dommage
de la crise actuelle… Parce qu’elles ont été inaptes à promouvoir une société algérienne qui se pense avec ses
idées, se réalise avec ses moyens et se projette dans l’Histoire à partir de ses propres déterminismes, les
générations qui nous ont précédés ont perdu la maîtrise de leur destin et de ce fait leur souveraineté
intellectuelle, économique et politique. Les conséquences de cette incompétence ont été la récente colonisation
que vous savez, le sous-développement économique que vous voyez et la déstructuration mentale que vous
connaissez. Nous sommes déjà les produits et les victimes de cette incompétence. Devons-nous en être les
continuateurs entêtés ?» (Fin de citation). C’est dans ce même discours que j’ai utilisé pour la première fois
l’expression «construire la NOUVELLE ALGÉRIE» qui sera reprise plus tard par à peu près tout le monde. 2)
L’unique tentative de fédération des forces de l’opposition a été l’expérience des «7+1» à mon initiative, en avril
1991, pour contrer le projet de loi électorale concocté par Hamrouche au profit du FLN. C’est dans mon bureau
que se sont réunis de multiples fois, outre le PRA que je présidais, le MDA de feu Ben Bella, HAMAS de feu
Nahnah, MAJD de feu Kasdi Merbah, NAHDA de Djaballah, le RCD de Saïd Sadi, le PNSD de Rabah Benchérif
et le PSD de Hamidi Khodja. Le MDRA de feu Slimane Amirat devait aussi se joindre au groupe. Par contre, le
parti de Louisa Hanoune qui était arrivée jusqu’à la porte de mon bureau n’en a pas fait partie pour une question
de protocole : alors que les réunions étaient ouvertes aux premiers responsables des partis, elle a voulu imposer
la présence d’une autre personne à ses côtés, ce qui lui a été refusé à l’unanimité. L’expérience a été tuée par
l’idée lancée par feu Ben Bella, soutenue par Sadi mais refusée par moi, d’organiser une grève nationale, idée
que saisira au vol le FIS et mettra en pratique quelques semaines plus tard entraînant la chute du gouvernement
Hamrouche, l’instauration de l’état de siège, des morts et des blessés et le report des élections législatives
prévues en juin à décembre avec les conséquences que tout le monde connaît. 3) En 1995, j’avais proposé à
Saïd Sadi et à feu Mahfoud Nahnah que nous nous retirions de l’élection présidentielle lorsque Zéroual s’était
porté candidat au dernier moment. Ils ont refusé tous les deux. 4) En 1999, et pour faire pièce à la candidature de
Bouteflika, j’avais proposé à Saïd Sadi et à Rédha Malek (après un marathon de réunions) que nous formions un
«bloc démocratique » qui entrerait dans l’élection avec une plateforme commune et un candidat unique selon les
modalités suivantes : élaborer un programme commun, le soumettre à un Congrès des trois partis formé de 1 000
délégués pour chacun, faire adopter la plateforme consensuelle et, enfin, faire élire par les 3 000 congressistes à
bulletins secrets, en présence d’huissiers et des médias, le candidat commun. L’idée échoua parce qu’un des
deux leaders s’était déjà engagé secrètement aux côtés de Bouteflika. A titre personnel je ne me fais pas
d’illusions et n’ambitionne pas de provoquer une révolution morale; l’esprit du douar ne m’écoutera pas et ne me
comprendra pas. Mais il y a le reste, ces dizaines de milliers d’Algériens qui me lisent dans ce journal et sur les
réseaux sociaux, et les centaines parmi eux qui m’écrivent pour m’encourager ou me critiquer. C’est pour eux que
j’écris et ce sont eux qui me motivent. Je souhaite surtout que les idées que je défends rencontrent un peu
d’intérêt auprès des nouvelles générations : elles ne sont pas miennes, elles sont universelles, elles sont le «sens
commun». Je veux aussi témoigner de ce que j’ai vécu et que les étrangers, ne serait-ce qu’à travers leurs
chancelleries, notent qu’en dépit des apparences nous ne sommes pas une nation civiquement et politiquement
morte, une nation capable d’émeutes de la faim, de transes maraboutiques et de violence, mais rien que cela.
N. B.
S-ar putea să vă placă și
- Boukrouh 12Document3 paginiBoukrouh 12Anonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- L'Algérie Entre Le Mauvais Et Le Pire Essai Sur La Crise Algérienne Par Noureddine Boukrouh PDFDocument18 paginiL'Algérie Entre Le Mauvais Et Le Pire Essai Sur La Crise Algérienne Par Noureddine Boukrouh PDFnecim100% (1)
- GRANDS HOMMES POLITIQUES NOIRS - 20e S. Thomas Sankara - Part 1Document4 paginiGRANDS HOMMES POLITIQUES NOIRS - 20e S. Thomas Sankara - Part 1MICHOAGAN TandjiékponÎncă nu există evaluări
- H. Boumédiène Un Homme, Un Modèle, Une Révolution TOUT SUR TLEMCENDocument7 paginiH. Boumédiène Un Homme, Un Modèle, Une Révolution TOUT SUR TLEMCENaziner01Încă nu există evaluări
- Négatif 11Document12 paginiNégatif 11Pat HibulaireÎncă nu există evaluări
- Les Dirigeants Dafrique Noire Face Leur Peuple (Seydou Badian) (Z-Library)Document152 paginiLes Dirigeants Dafrique Noire Face Leur Peuple (Seydou Badian) (Z-Library)Ziz Philztry100% (1)
- DOMINIQUE VENNER - Pour Une Critique PositiveDocument24 paginiDOMINIQUE VENNER - Pour Une Critique PositivemsdfliÎncă nu există evaluări
- Georges Sand ExposéDocument3 paginiGeorges Sand Exposémarilou.gallesÎncă nu există evaluări
- Les Gilets jaunes: Naissance du premier Lobby Populaire FrançaisDe la EverandLes Gilets jaunes: Naissance du premier Lobby Populaire FrançaisÎncă nu există evaluări
- Boudiaf Mohamed - Ou Va L'algerieDocument202 paginiBoudiaf Mohamed - Ou Va L'algeriecrazycavan60% (5)
- Ou Va l'ALGERIEDocument202 paginiOu Va l'ALGERIEHOCINIÎncă nu există evaluări
- BOUKROUH3Document3 paginiBOUKROUH3Anonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- A Bas Les ChefsDocument7 paginiA Bas Les ChefsbakwardubÎncă nu există evaluări
- Penser l'islam au 21em siecle: PLAIDOYER POUR UNE REFORME DE L’ISLAMDe la EverandPenser l'islam au 21em siecle: PLAIDOYER POUR UNE REFORME DE L’ISLAMEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Haro vicieuses torpilles: Essais politiquesDe la EverandHaro vicieuses torpilles: Essais politiquesÎncă nu există evaluări
- Houria Bouteldja - Beaufs Et Barbares-La Fabrique Éditions (2023)Document175 paginiHouria Bouteldja - Beaufs Et Barbares-La Fabrique Éditions (2023)Jorge Ramos Tolosa100% (2)
- Boualem SansalDocument8 paginiBoualem SansalfaqirÎncă nu există evaluări
- Montée de L'Insignifiance - Castoriadis-1996Document1 paginăMontée de L'Insignifiance - Castoriadis-1996caroscribdoÎncă nu există evaluări
- Chronique AlgérienneDocument32 paginiChronique AlgérienneKarim MerabetÎncă nu există evaluări
- Le Role de L'intellectuel CongolaisDocument5 paginiLe Role de L'intellectuel CongolaisLorraine M. ThompsonÎncă nu există evaluări
- Legendre Entretien 2015Document19 paginiLegendre Entretien 2015Anonymous 2Aq3DpÎncă nu există evaluări
- Devant Le Desarroi D Un Peuple ExtraitDocument26 paginiDevant Le Desarroi D Un Peuple ExtraitPatrick Kambu KambuÎncă nu există evaluări
- La France en perdition sous l'image subliminale du racismeDe la EverandLa France en perdition sous l'image subliminale du racismeÎncă nu există evaluări
- Boukrouh NDocument3 paginiBoukrouh NAnonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- 100 ans d'erreurs de la gauche française: Va-t-elle recommencer ?De la Everand100 ans d'erreurs de la gauche française: Va-t-elle recommencer ?Încă nu există evaluări
- Héros sans gloire: Échec d'une révolution (1963-1973)De la EverandHéros sans gloire: Échec d'une révolution (1963-1973)Încă nu există evaluări
- Liaisons - Au Nom Du PeupleDocument220 paginiLiaisons - Au Nom Du PeuplePaul DébrayageÎncă nu există evaluări
- La France Dans L'europe Des Nationalités Politique Et SociétéDocument5 paginiLa France Dans L'europe Des Nationalités Politique Et SociétéLuisa MaciasÎncă nu există evaluări
- Cornelius Castoriadis - La Montee de L'insignifianceDocument10 paginiCornelius Castoriadis - La Montee de L'insignifianceclaudinhotavaresÎncă nu există evaluări
- Algérie: Les Grands Articles d'UniversalisDe la EverandAlgérie: Les Grands Articles d'UniversalisÎncă nu există evaluări
- La Colère des peuples: Ou la mondialisation du ras-le-bolDe la EverandLa Colère des peuples: Ou la mondialisation du ras-le-bolÎncă nu există evaluări
- L'ame Perdue D'une Nation - Version Electronique PDFDocument230 paginiL'ame Perdue D'une Nation - Version Electronique PDFluqman100% (1)
- La wilaya II historique: L'ombre de constantineDe la EverandLa wilaya II historique: L'ombre de constantineÎncă nu există evaluări
- Chesnay Philippe - Pinochet, L'autre VéritéDocument252 paginiChesnay Philippe - Pinochet, L'autre VéritéBessarion JGHENTI100% (1)
- L'Ere Compaore PDFDocument286 paginiL'Ere Compaore PDFderek williams100% (2)
- Limogeage de ToufikDocument3 paginiLimogeage de ToufikfaqirÎncă nu există evaluări
- Sans papiers ?: Pour lutter contre les idées reçuesDe la EverandSans papiers ?: Pour lutter contre les idées reçuesEvaluare: 3.5 din 5 stele3.5/5 (1)
- AU CREPUSCULE (Corrigé)Document44 paginiAU CREPUSCULE (Corrigé)PaulÎncă nu există evaluări
- Nouda Le Sociétal ExtraitDocument13 paginiNouda Le Sociétal ExtraithsnhasnaeÎncă nu există evaluări
- Primo de Rivera José Antonio - Anthologie Volume 2Document57 paginiPrimo de Rivera José Antonio - Anthologie Volume 2Der KommissarÎncă nu există evaluări
- Demain, après Kabila: Remettre les cerveaux à l'endroit. Reconquérir notre dignité et nos terres. Réinventer le Congo-KinshasaDe la EverandDemain, après Kabila: Remettre les cerveaux à l'endroit. Reconquérir notre dignité et nos terres. Réinventer le Congo-KinshasaEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Les Generaux Et Le GiaDocument187 paginiLes Generaux Et Le GiaBouhlala Med Amine100% (3)
- SNCF Blues OkpdfDocument20 paginiSNCF Blues OkpdfbobyÎncă nu există evaluări
- Castoriadis-Stopper La Montée de L'insignifianceDocument5 paginiCastoriadis-Stopper La Montée de L'insignifiancecrates11Încă nu există evaluări
- La fabrique d'un Etat raté: Essais sur le politique, la corruption morale et la gestion de la barbarieDe la EverandLa fabrique d'un Etat raté: Essais sur le politique, la corruption morale et la gestion de la barbarieÎncă nu există evaluări
- La piètre vision d’un aveugle: Devoir de conscience - Version 2De la EverandLa piètre vision d’un aveugle: Devoir de conscience - Version 2Încă nu există evaluări
- Le Prince Louis RWAGASORE - Un Nationaliste Qui Inspire La JeunesseDocument7 paginiLe Prince Louis RWAGASORE - Un Nationaliste Qui Inspire La JeunesseAnonymous rSGBAXÎncă nu există evaluări
- Cornelius Castoriadis ( ) Contre Le Conformisme GénéraliséDocument9 paginiCornelius Castoriadis ( ) Contre Le Conformisme GénéralisécasimiroamadoÎncă nu există evaluări
- Le Groupe Bilderberg Et La Gouvernance MondialeDocument5 paginiLe Groupe Bilderberg Et La Gouvernance MondialeBombinette GideonÎncă nu există evaluări
- Octave Mirbeau - Études et Actualités - N° 2 - 2021: Découvreur de son temps, inspirateur de notre époqueDe la EverandOctave Mirbeau - Études et Actualités - N° 2 - 2021: Découvreur de son temps, inspirateur de notre époqueÎncă nu există evaluări
- الاختيار الثوري في المغرب - المهدي بنبركةDocument31 paginiالاختيار الثوري في المغرب - المهدي بنبركةأرشيف جريدة المناضل-ة0% (2)
- Les souterrains de la démocratie: Soral, les complotistes et nousDe la EverandLes souterrains de la démocratie: Soral, les complotistes et nousÎncă nu există evaluări
- Indignez-vous ! de Stéphane Hessel (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreDe la EverandIndignez-vous ! de Stéphane Hessel (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreÎncă nu există evaluări
- Le Mondialisme Un Nouveau Fascisme - Jay FALCONDocument226 paginiLe Mondialisme Un Nouveau Fascisme - Jay FALCONjayroom100% (1)
- AspaDocument8 paginiAspaAnonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- Assassinat de AbaneDocument2 paginiAssassinat de AbaneAnonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- Une Contribution de Said Sadi PDFDocument11 paginiUne Contribution de Said Sadi PDFAnonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- Maitre Bouzida Repond A La Femme de Boumdienne Anissa Agnès El MansaliDocument3 paginiMaitre Bouzida Repond A La Femme de Boumdienne Anissa Agnès El MansaliAnonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- Démystification de LDocument2 paginiDémystification de LAnonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- Calendrier Ramadan 2018 Pour AvignonDocument1 paginăCalendrier Ramadan 2018 Pour AvignonAnonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- La Fin Des Temps ModernesDocument14 paginiLa Fin Des Temps ModernesAnonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- Boukrouh NDocument3 paginiBoukrouh NAnonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- Vegas140 ManualDocument826 paginiVegas140 ManualAnonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- Web Memoria 34Document100 paginiWeb Memoria 34Anonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- BOUKROUH3Document3 paginiBOUKROUH3Anonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- Entre Recette Magique 1Document21 paginiEntre Recette Magique 1Anonymous heudrulA7Încă nu există evaluări
- Larousse - Grammaire - FrançaisDocument194 paginiLarousse - Grammaire - FrançaisCa KZ100% (1)
- CRONOLOGY Revolution-Engleza PDFDocument302 paginiCRONOLOGY Revolution-Engleza PDFAnonymous Tr0Mg8l2Încă nu există evaluări
- Institutions Du Royaume Du MarocDocument3 paginiInstitutions Du Royaume Du MarocHanane AitÎncă nu există evaluări
- Aad 1209Document21 paginiAad 1209Asseli DjakboubeÎncă nu există evaluări
- CENI RDC - Liste Definitive Deputation Nationale - LUALABADocument45 paginiCENI RDC - Liste Definitive Deputation Nationale - LUALABAmuembiafabriceÎncă nu există evaluări
- Mairie Du 13e - Bibliothèque - Dunois - Jeanne D'arcDocument5 paginiMairie Du 13e - Bibliothèque - Dunois - Jeanne D'arcreservistepmgÎncă nu există evaluări
- Constittion GabonDocument39 paginiConstittion GabonistovanÎncă nu există evaluări
- LC-807 16513760Document9 paginiLC-807 16513760cedd100% (1)
- Stauts Du GIC MAVECADocument10 paginiStauts Du GIC MAVECAserges zibiÎncă nu există evaluări
- Carte MentaleDocument1 paginăCarte MentaledragonrougeisbackÎncă nu există evaluări
- Livre AGO - Pourquoi J'y CroisDocument94 paginiLivre AGO - Pourquoi J'y CroisjacquesauxietteÎncă nu există evaluări
- Statuts Association Des Anciens Eleves Du College SabayaDocument6 paginiStatuts Association Des Anciens Eleves Du College SabayaDolin Kenfouo100% (2)
- 1341 PDFDocument24 pagini1341 PDFdknewsÎncă nu există evaluări
- Faits Et Documents 235Document12 paginiFaits Et Documents 235stefstefanoÎncă nu există evaluări
- AmicaleDocument11 paginiAmicalekarlÎncă nu există evaluări
- Afrique Occidentale FrançaiseDocument20 paginiAfrique Occidentale FrançaiseIbrahima Koné100% (1)
- HERAULT DU JOUR Du Lundi 30 MarsDocument40 paginiHERAULT DU JOUR Du Lundi 30 MarsJournal la MarseillaiseÎncă nu există evaluări
- TD 9 Et 10 Conseil ConstitutionnelDocument23 paginiTD 9 Et 10 Conseil ConstitutionnelSolène CabsÎncă nu există evaluări
- 08 12 23 LP ByneonDocument48 pagini08 12 23 LP ByneonbayodvictoriaÎncă nu există evaluări
- Franceza Juridica 51Document51 paginiFranceza Juridica 51Paul Florin BaraboiÎncă nu există evaluări
- FICHE CM6 Droit Constitutionnel Sciences Po Paris (Marcel Morabito)Document2 paginiFICHE CM6 Droit Constitutionnel Sciences Po Paris (Marcel Morabito)Jeanne BRUAÎncă nu există evaluări
- Annexes PV CC 140915 - SP 1Document80 paginiAnnexes PV CC 140915 - SP 1Jeremy CroesÎncă nu există evaluări
- Les Grands Systèmes ConstitutionnelsDocument10 paginiLes Grands Systèmes ConstitutionnelsEL YarmaniÎncă nu există evaluări
- Le Monde Diplomatique 2015 05Document28 paginiLe Monde Diplomatique 2015 05zaboub mohamedÎncă nu există evaluări
- SPC Grande BretagneDocument10 paginiSPC Grande BretagneSaraTouiraÎncă nu există evaluări
- Annex 4 Modèle de Procès Verbal D'assemblée Élective COGESDocument3 paginiAnnex 4 Modèle de Procès Verbal D'assemblée Élective COGESDongo Hyacinthe ADOU50% (2)
- CHAP 1 - 11 - B - Les Formes de La Séparation Des Pouvoirs (Cours Ter SC - Po) (2012-2013)Document7 paginiCHAP 1 - 11 - B - Les Formes de La Séparation Des Pouvoirs (Cours Ter SC - Po) (2012-2013)Meryem AnbÎncă nu există evaluări