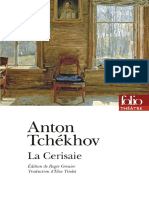Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Apres Dreyer Au Temps de La Resurrection PDF
Încărcat de
Inés Marisela LópezTitlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Apres Dreyer Au Temps de La Resurrection PDF
Încărcat de
Inés Marisela LópezDrepturi de autor:
Formate disponibile
Après Dreyer,
au temps de la
résurrection
par Olivier Cheval
L
a hauteur blanche du ciel au-dessus des visages ne suffit pas à figurer la
solitude des grandes abandonnées de Dieu. Et tout réveil des morts ne fait
pas se lever le jour sur la longue nuit du monde. La grâce ne s’hérite pas.
Et pourtant, qu’hériter de Dreyer, si ce n’est son art du miracle – plus encore, son
idée de l’art comme miracle ? Mais y a-t-il chose qui soit moins transmissible que cette
idée-là ? C’était une pensée du film comme événement – comme solitude aussi. Une
partie du cinéma contemporain semble avancer dans cette impasse : marcher dans les
pas d’un promeneur solitaire indisposé à révéler le fond du mystère qu’il a sondé.
On me dira que de grands cinéastes ont su hériter du maître danois : Robert
Bresson, Ingmar Bergman, Andreï Tarkovski. Mais chacun l’a mené vers lui, comme
à contre-courant. En 1962, Bresson tourne, avec Le Procès de Jeanne d’Arc, le négatif,
sec et juridique, de La Passion 1, juste avant que Dreyer et lui n’atteignent l’épure
ultime, l’un en étirant comme jamais l’espace-temps, l’autre en le fragmentant
toujours davantage (Gertrud sort en 1964, Au hasard Balthazar en 1966). Bergman
a repris à Dreyer des cadres, des transparences, des violences du blanc, mais pour
les transposer dans la profondeur nocturne, archaïque et païenne des rêves et des
mythologies nordiques ou dans la fureur athée du monde moderne. Tarkovski a aimé
ces trois-là, mais à l’intensivité du cadre il a préféré la pression de la durée dans le
plan, inventant comme la ruine flottante de ce cinéma de l’esprit. Hériter de Dreyer
désormais, c’est toujours aussi s’inscrire dans cette lignée.
Tarkovski meurt en 1986. Depuis, seuls Alexandre Sokourov et Béla Tarr semblent
continuer le mouvement d’approfondissement et de ralentissement de ce cinéma spiri
1. Jean Sémolué, « Passion et Procès (de Dreyer à Bresson) », Études cinématographiques, n° 18-19,
« Jeanne d’Arc à l’écran », 1962. 1
Cheval.indd 1 06/03/15 19:24
tualiste, cette exploration du temps de la psyché humaine à partir du mystère et de
la pesanteur de la durée. Ceux qui viennent après semblent avoir trouvé la lignée
trop bien dessinée, comme déjà finie, sans autre solution que de replonger en son
milieu, comme si depuis rien ne s’était passé.
Il y a tout juste trente ans, Serge Daney se plaignait de ce qu’il finirait par appeler
les « chromo-croûtes » : « Le cinéma actuel est tiraillé entre deux maux complices :
l’académisme et le maniérisme. […] L’académique est celui qui part de l’ensemble (une
idée de film fini, déjà compromise dans le script) et qui, souvent besogneusement,
l’illustre jusqu’au moindre détail. Les académiques sont peu stimulants mais ils
rassurent et on les respecte. Le maniériste est plutôt celui qui part des détails, quitte
à se perdre en cours de route, à décourager tout le monde et à rater l’ensemble. Les
maniéristes sont plus stimulants, mais comme ils posent un peu trop (ils font des
“manières”) ils exaspèrent et déçoivent 1. » On serait bien en peine aujourd’hui de les
distinguer. C’est que la nouvelle manière de nombreux cinéastes, c’est l’esprit de
sérieux de l’académisme affiché, l’exhibition de la sobriété, de la retenue et de la
gravité. À la langueur post-antonionienne des années 1980-1990 a succédé une sorte
de dreyérisme à la fois brutal et maniéré – si par dreyérisme on entend l’inscription
dans cette lignée cinématographique dont Dreyer est l’origine, même si son héritage
est parfois de seconde main, via l’influence plus directe et plus massive de Bresson,
de Bergman et de Tarkovski. (C’est l’un des deux pôles chrétiens du grand cinéma
d’auteur européen. À l’opposé de ce rigorisme nordique – ce cinéma de la faute et du
mystère avec son esthétique intensive de la densité des corps –, il existe un francis
canisme méditerranéen – un cinéma de l’évidence des choses et de la foi au monde,
avec son esthétique extensive de la dispersion des êtres et des choses : Rossellini,
Pasolini quand il n’est pas païen, Rohmer quand il n’est pas libertin. On pourrait
s’interroger longtemps sur la victoire du Nord sur le Sud pour l’inspiration des
jeunes cinéastes en quête de grâce. Pour faire court : l’évidence est un effet moins
facile à obtenir que le mystère ; un scénario se nourrit plus facilement de faute
cachée que de preuve donnée ; le rigorisme religieux a son actualité.)
Parole rare, corps empesés et visages taciturnes englués dans la durée intensive
de plans-séquences cadrés au cordeau sont donc les signes d’un nouvel art pompier
qui, pour mettre son mysticisme au goût du jour, corse désormais ses histoires de
foi ébranlée et d’amours frustrées d’une nouvelle torture pour ses chairs trop
humaines : une soif inextinguible de transgression, de crime et de souillure. Le
cinéma sage qu’est l’académisme et le cinéma poseur qu’est le maniérisme ont
enfanté d’une nouvelle droite esthétique, qui s’épanouit à l’Est depuis une dizaine
d’années.
1. Serge Daney, « Le chant du coton », 3 janvier 1985, repris dans La Maison cinéma et le monde. 2. Les
années Libé 1981-1985, P.O.L, coll. « Trafic », p. 255. Serge Daney insérait cet état des lieux dans un article
sur Cotton Club de Coppola, qu’il louait a minima pour être passé de l’académisme au maniérisme, qui
2 avait sa préférence.
Cheval.indd 2 06/03/15 19:24
Cet académisme maniéré, c’est la levée d’une signalétique de l’intensité lourde de son
effet-cinéma plutôt que des plis de la matière du monde. Son désir de dépouillement,
d’austérité ou d’élévation ne dénude pas les films : il les recouvre de tout un appareil
lage de conventions, les habille des oripeaux du grand cinéma spiritualiste. Dans les
fables bibliques du Russe Andreï Zviaguintsev (Le Bannissement, Léviathan), de son
compatriote Pavel Lounguine (L’Île) et du Géorgien George Ovashvili (Terre éphémère),
dans les calvaires christiques en milieu fondamentaliste de l’Allemand Dietrich
Brüggemann (Chemin de croix) et de l’Autrichien Ulrich Seidl (Paradis : foi), dans
les drames de la perte de foi en couvent du Polonais Paweł Pawlikowski (Ida), du
Roumain Cristian Mungiu (Au-delà des collines) et du Grec Spiros Stathoulopoulos
(Meteora) et dans les tragédies dostoïevskiennes sur le nihilisme contemporain de
l’Ukrainien Sergueï Loznitsa (My Joy) et du Turc Nuri Bilge Ceylan (Winter Sleep),
le plan censé imploser sous le poids de Dieu ou de l’absence de Dieu étouffe trop
souvent de lourdeur. Car il n’est pas facile d’enchaîner des séquences quand elles sont
toutes vouées à monter en intensité – l’intensité est précisément ce qui demande à
être modulé pour ne pas s’épuiser. L’art romanesque de Dostoïevski, référence majeure
de ce cinéma, consistait moins à étendre ses grandes scènes jusqu’à la surchauffe
qu’à imaginer chaque fois une solution de « sortie de crise » qui permet à la tension
de retomber d’un coup – les crises d’épilepsie du prince Mychkine, par exemple,
laissent s’échapper l’énergie accumulée et suspendent un temps l’engrenage tragique
comme pour le réamorcer. Le montage est toujours en dernière instance le lieu où se
joue l’échec de ces drames de la chair, incapables de figurer le cheminement d’une
âme entre les stations du chemin de croix.
Le raide et le cruel – des écarts
Des ciels bouchés de lourds nuages et des corps crevant d’humeurs. Trop d’absence
là-haut, trop de présence ici-bas : la grâce s’est retirée au-dessus de l’épaisse boue du
monde. Ce programme binaire, sans autre horizon que ce départ absolu du ciel et de
la terre, du sublime et de l’obscène, deux films l’annonçaient au seuil de leur très beau
titre : Batalla en el cielo (2005) et Hors Satan (2011). Avec eux, Carlos Reygadas et
Bruno Dumont semblaient avoir visé tout particulièrement la grâce inchoative des
grands films de Dreyer. Les chefs-d’œuvre du Danois ont en effet cette évidence des
premières fois : avant Jeanne d’Arc, nous n’avions jamais vu de visage ; avant Ordet,
nous n’avions jamais su la mort ; avant Gertrud, nous n’avions jamais aimé l’amour.
Mais aujourd’hui, comment filmer comme au début de l’art ? S’y risquer, c’était hériter
d’une promesse intenable : la répétition d’un commencement. Ordet s’était fini sur le
miracle agi par un simple, une enfant et une sainte dans un monde d’hommes trop
humains. Un ciel s’était levé sur Terre, in extremis. Reygadas et Dumont ont essayé
quelque chose comme l’abstraction de ce scénario : le durcissement de l’opposition du
profane et du sacré allait paradoxalement avec sa mise en série. L’héritage comme 3
Cheval.indd 3 06/03/15 19:24
radicalisation n’est pas toujours le meilleur choix – c’est au moins une manière
d’échapper à l’académisme moribond de leurs collègues d’Europe de l’Est. Mais leur
Dreyer sériel les a menés tout droit vers un mysticisme obscurantiste et réaction
naire, violemment désespérant. Comme si leur désir d’une origine plus originelle,
d’un archaïsme plus ancien que tout cinéma, les avait mis dans la situation d’un déni
d’héritage, d’une non-reconnaissance de dette, au prix d’une régression, formelle et
politique.
Le film du cinéaste mexicain s’ouvre sur le visage adipeux de Marcos, l’air benêt
et le regard torve derrière ses grosses lunettes de tueur en série des années 1970.
Son souffle court, asthmatique, semble entendu de l’intérieur. Un travelling vertical
descend sur son gros corps humide, comme épinglé sur un mur gris d’entomologiste,
jusqu’à son bas-ventre obstrué par les dreadlocks d’une jeune fille qui le suce. Alors
que la caméra effectue une rotation pour venir cueillir le visage de la femme concen
trée sur sa caresse, jusqu’à un très gros plan sur ses paupières closes qui soudain
s’ouvrent pour échapper une larme, la respiration de Marcos s’est effacée devant le
violoncelle céleste de The Protecting Veil, composé par John Tavener à la gloire de la
Vierge Marie.
Marcos et sa femme, son double catastrophique, tête sans cou et sans âme engoncée
dans un corps à l’obésité morbide, ont kidnappé un bébé qu’ils ont laissé mourir par
accident, par bêtise, par monstruosité, par décision scénaristique surtout de coller au
non-sens de la sauvagerie d’un monde-sans-sens. Il a peur des conséquences judi
ciaires, elle s’inquiète pour l’argent perdu. Dans une scène qui redouble la logique de
l’ouverture fellatoire, Marcos prend sa femme en levrette, corps difforme filmé du
point de vue du mâle comme un tas de graisse qu’agitent des secousses régulières,
avant que la caméra ne remonte vers une reproduction du Christ mort soutenu par un
ange d’Antonello da Messine, d’un style plus flamand qu’italien. Après la jouissance,
alors que les deux corps étendus côte à côte tentent de reprendre leur souffle, la
caméra entre dans le tableau par un travelling vertical, cette fois-ci ascendant, qui
détaille la plaie sanguinolente du Christ et son visage extatique, toute bouche dehors.
Plus tard, après un nouveau rapport sexuel avec Anna, la jeune fille aux dreadlocks
dont on a appris que Marcos était le domestique, la caméra filme leurs deux corps
allongés dans un raccourci violent qui évoque un autre Christ mort, celui de Mantegna.
Sans raison, Marcos a avoué son crime à Anna, et, sans émotion, il la tue d’un coup
de couteau pour l’empêcher de parler. Sans émotion sur son visage, du moins, car
avant le crime, l’homme, immobile, face caméra, se pisse longuement dessus, dans
un plan qui le cadre en pied, frontalement, avec une lumière crue et blanche, pour ne
rien louper de la souillure de son pantalon puis de la petite inondation à ses pieds.
C’est que ça s’agite, au-dedans du bonhomme. Après le meurtre, comme une pietà, il
s’agenouille pour porter le corps qu’il vient de poignarder, avant de le déposer dans
une grosse flaque – de sang, désormais. Accroupi encore, dans un champ où il cueille
des carottes, il est convié par sa femme à expier ses péchés au pèlerinage de Notre-
4 Dame-de-Guadalupe, procession qu’il suivra à la toute fin du film, à genoux et en
Cheval.indd 4 06/03/15 19:24
cagoule, après avoir longuement escaladé une montagne embrumée, dans un vague
souvenir des collines d’Ordet. (La séquence permet d’ailleurs de constater la déperdi
tion qualitative du cinéma de Reygadas, entre son premier film et celui-ci. Japón
(2003), tourné en haute montagne, n’opposait la brume blanche des hauteurs et les
précipices menaçants que pour raconter un destin absolument terrestre, rocailleux et
solitaire, minéral mais déjà s’évaporant, à la manière du panthéisme renfrogné de
La Libertad de Lisandro Alonso, tourné en Argentine un an plus tôt. La scène de sexe
entre le héros, un homme mûr décidé à mourir, et la très vieille dame y était encore
filmée avec pudeur, sans transcendance aucune : c’était à peine une consolation
– l’homme se suicidera peu après –, juste l’étreinte physique de deux corps pierreux
s’amollissant en chair une dernière fois avant la mort.)
Une fellation et une ode à la Vierge. Une levrette entre obèses et la maigreur du
Christ mort. Un gros dans une flaque de pipi et une pietà dans une flaque de sang.
Un meurtre barbare et son expiation liturgique.
Batalla en el cielo ne cesse d’essayer de lier l’obscène d’un drame et le pathétique
d’une iconographie religieuse, pour ouvrir ces destins sordides à une dimension sacrée.
L’écart est pourtant infranchissable, qui sépare l’innocence et l’expressivité extatique
des Saints de l’Évangile de la bêtise de ces baudruches meurtrières gonflées de leur
propre vide. En résulte un redoublement du sordide par le grotesque, à mille lieues
de la grâce de Dreyer, dont Reygadas n’a repris que des formes (l’immobilité des corps
et l’impassibilité des visages du Dreyer dernière manière, la violence des champs-
contrechamps à 180° et la frontalité des cadres juxtaposant deux corps côte à côte, le
coulé du plan-séquence et la violence des faux raccords) et des thèmes (la culpabilité,
la rédemption), sans comprendre que le cheminement d’une âme n’est jamais autre
chose que son assignation à résidence terrestre – et non une suite de petites envolées
vaguement mystiques.
En 2011, Hors Satan est venu radicaliser et renverser le chemin emprunté par
Dumont avec L’humanité (2006), dont il apparaissait presque comme la parodie involon
taire, en achevant le processus de purification et de durcissement de son cinéma,
après l’affreux Twentynine Palms (2003) et l’indéfendable Flandres (2006) – il a
depuis, heureusement, rebroussé chemin et hybridé son cinéma, en se lançant dans
un biopic avec star (Camille Claudel 1915, avec Juliette Binoche, en 2013) puis dans
une série, P’tit Quinquin (2014), excellente comédie policière en forme de parodie
assumée de son œuvre. Dans L’humanité, un crime odieux – le meurtre et le viol
d’une fillette – compromettait la possibilité même de tout être-ensemble : seule la
compassion infinie du lieutenant Pharaon, piètre détective câlinant les suspects,
parvenait à rétablir une communauté éthique ou religieuse, intériorisée, consacrée
par un miracle final, la lévitation du policier. Dans Hors Satan, la communauté a
toujours déjà disparu : ne reste qu’une nature vierge où crimes et miracles s’enchaînent
sans discontinuer. Tout le film durant, un vagabond et une jeune fille marchent,
prient et tuent sur ces collines sableuses et herbeuses qui longent la mer du Nord
– ces dunes sont filmées en contrebas, dans des contre-plongées qui ne cessent de 5
Cheval.indd 5 06/03/15 19:24
rappeler, là encore, la séquence de recherche de Johannes disparu dans Ordet. C’est
que le vagabond faiseur de miracles se présente explicitement comme un nouveau
Johannes. Mais Johannes était une figure du Verbe, comme l’indiquait son prénom,
un prophète déchiré entre sainteté et folie, selon la tradition chrétienne bien connue
du simple d’esprit à qui le Royaume des Cieux sera ouvert. Le vagabond de Hors Satan
n’est que silence, lui, et l’écart infranchissable entre crime et miracle l’isole de toute
tradition, de toute communauté aussi bien.
Le film s’ouvre par un coup de fusil : le garçon venge son amie en assassinant le
beau-père qui la violait. L’acte froidement exécuté, sans difficulté aucune, ni morale
ni pratique, n’est que le premier maillon d’une chaîne du crime qui l’a précédé et qui
se poursuivra après lui. Il aura comme versant symétrique à la fin du film la résurrec
tion de la jeune fille, retrouvée assassinée dans un buisson et miraculeusement
ramenée à la vie par les bras du vagabond. Au fond, le projet figuratif du film consiste
à faire s’équivaloir ce qui d’abord s’oppose : les visages fermés et les paysages ouverts,
la douleur et le plaisir, la bestialité et la grâce, le crime et le miracle. Mais, comme
Reygadas, Dumont exagère tous les écarts. Il cherche la grâce dans des visages qu’il
marque socialement jusqu’à la caricature 1. Il outre la différence sexuelle, la gueule
désespérément fermée de l’homme s’opposant aux bouches pathologiquement grandes
ouvertes des femmes, selon l’iconographie traditionnelle de l’hystérie. Il sépare toutes
choses alors qu’il cherche l’unité d’un état premier du monde.
En témoigne une scène de sexe grotesque et sordide, qui caricature cette confusion.
Une randonneuse demande son chemin au vagabond, qui lui dit de la suivre. Ils
s’arrêtent, boivent une bière, elle lui met le bras autour de l’épaule : « Si tu veux tu
peux me baiser. » Elle se déshabille et s’allonge sur l’herbe ; il se met au-dessus d’elle
et enchaîne une dizaine de coups de reins violents, selon la manière froide et bestiale
dont les personnages des films de Dumont font l’amour – copulent, plutôt. La jeune
femme jouit en faisant le bruit d’un cochon qu’on égorge, et, précisément, le jeune
homme met sa main autour de son cou d’un geste qui relève moins de l’étreinte que
du désir de meurtre. La jeune femme produit alors une bave surabondante, blanche
et épaisse ; sa bouche grande ouverte forme un grand ovale blanc : un œuf. L’homme
embrasse alors dans un cri fracassant la bouche humide dans un baiser, ou plutôt
un embouchement, qui fait s’écouler la semence blanche sur la joue de la femme 2.
L’éjaculation miraculeuse tient aussi de la vomissure : on pense au ptyalisme de
certaines hystériques et des animaux enragés. Tout érotisme semble perdu entre le
geste de salvation – un bouche-à-bouche – et le geste de meurtre – un égorgement –
que façonnent contradictoirement les mains et la bouche de l’homme. Puis le vagabond
1. Jacques Rancière lui en faisait déjà le reproche à propos de L’humanité, pourtant plus subtil, dans
« Le bruit du peuple, l’image de l’art. À propos de Rosetta et de L’humanité », Cahiers du cinéma, n° 540,
novembre 1999.
2. La scène évoque alors davantage Bresson que Dreyer, la crise d’épilepsie qui frappe Monsieur
Arsène dans Mouchette (1967) pendant la nuit d’orage. L’homme tombe d’un coup, crache du sang, puis
6 une salive surabondante ; il violera ensuite la jeune fille.
Cheval.indd 6 06/03/15 19:24
s’en va, laissant la randonneuse étendue, comme morte. Plus encore que l’identité
bataillenne de la jouissance et de la mort, la séquence postule l’équivalence du
miracle et du crime, qui tous deux s’excluent de la gestualité ordinaire des hommes
par leur intensité et leur déraison, sur fond de silence et d’absence – notamment celle
de toute forme de société, qui existait encore dans L’humanité à travers une série
d’institutions représentées, même fugacement (police, hôpital psychiatrique, école,
musée, mairie, église, usine, et même l’armée évoquée par le passage fulgurant d’un
drone dans le ciel). Chez Dreyer et chez Bresson, dans leur film sur Jeanne d’Arc,
par exemple, c’est l’institution qui condamne le miracle comme crime. Ce n’est pas le
film qui entreprenait leur indistinction, mais la Loi qui condamne, le Pouvoir qui
segmente : le geôlier, le juge, le bourreau étaient le contrechamp politique du visage
de la souffrance.
La résurrection finale de la jeune fille devrait fasciner : elle exaspère. Elle aurait
nécessité un relais fictionnel qui aurait cru à ce miracle et l’aurait appelé – d’autant
que celui-ci intervient après une longue série 1. Sans médiation langagière et fiction
nelle, elle n’est qu’un coup de force de plus. Dreyer, Pialat ou Brisseau avaient su que
filmer un miracle, c’était filmer la naissance d’une foi et l’émergence d’une parole. La
multiplication des miracles dans Sous le soleil de Satan (apparition du diable, trans
parence des âmes, résurrection) et dans Céline (guérison, ubiquité, lévitation) n’est
pas la structure narrative qui régit le film en sommant le spectateur de l’accepter :
elle devient peu à peu l’objet du récit, situations et dialogues posant la question de
la possibilité de la sainteté dans un monde vidé de mystère, notamment par l’entre
mise d’un personnage qui ne pose pas la question en termes de croyance – foi ou
incrédulité –, mais en termes moraux et sociaux : orgueil, folie, utilité (le doyen joué
par Pialat lui-même et l’infirmière qui secourt Céline). Chez Dumont, pas un mot.
Comme s’il pouvait exister un miracle en dehors du Verbe – comme si le surnaturel
pouvait avoir un sens dans l’état de nature.
On se souvient souvent d’Ordet (La Parole) comme d’un long drame religieux (le
mariage empêché pour différend théologique), familial (la mort d’une mère) et psy
chique (la folie de Johannes) surmonté d’un grand-moment-de-cinéma : un miracle
de Dieu qui est aussi un miracle de l’Art. Mais ce miracle n’arrive pas de nulle part,
et n’a pas d’intensité en soi, séparé du travail figuratif de l’ensemble du film : il est à
la fois l’événement religieux qui conclut un débat théologique entre les personnages,
l’événement narratif préparé par une série d’ersatz et l’événement figural que
soutient une iconographie de la levée et de la chute des corps. Le mot est prononcé
une vingtaine de fois et fait l’objet de plusieurs conversations : à Mikkel Borgen, le
vieux patriarche qui se plaint de la vanité de ses prières devant la folie de son fils
1. Voir Alain Bergala, « Le miracle comme événement cinématographique », in Agnès Devictor et
Kristian Feigelson (dir.), CinémAction, n° 134, « Croyances et sacré au cinéma », avril 2010, p. 37.
L’auteur explique que les miracles d’Ordet et de Sous le soleil de Satan ont nécessité l’invention d’un
personnage crédule – la petite fille chez Dreyer et la mère chez Pialat. 7
Cheval.indd 7 06/03/15 19:24
Johannes, Inger oppose l’idée d’une multitude de miracles discrets d’un Dieu décidé à
œuvrer dans l’ombre. Après la brève guérison d’Inger le soir de l’accouchement, le
médecin oppose les miracles médicaux aux miracles divins qui sont d’un autre
temps, selon les propres mots du pasteur. Mais la possibilité du miracle est aussi, au
fond, le cœur du conflit religieux qui oppose le protestantisme mesuré et intériorisé
du domaine de Borgensgard, dans les dunes du village, son quartier le plus moderne
et le plus aisé, à la secte puritaine qui regroupe les pauvres du marais. D’ailleurs,
quand le tailleur qui dirige cette secte apprend par téléphone l’état alarmant d’Inger
au moment même où il s’écharpe avec Mikkel à propos de religion jusqu’à en venir
aux mains, il croit immédiatement à l’intervention divine venue ramener les Borgen
dans la foi véritable – on reconnaît là les prémices encore discrètes d’un humour
théologique qui s’épanouira avec Oliveira. Peu avant, dans la cuisine, la femme du
tailleur avait montré à sa fille et son amoureux éconduit l’illustration de la résurrec
tion de Lazare dans la Bible, qu’ils avaient regardée émerveillés. Surtout, le miracle
du réveil d’Inger est préparé par trois événements d’image : la chute violente de
Johannes sur le lit de la morte, comme pris d’une attaque, qui annonce par son
intensité l’acte physique inverse, la levée du corps à venir ; une conversation entre
Johannes et la fille d’Inger sur la résurrection, filmée dans un travelling circulaire à
180° dont Jacques Aumont a remarqué qu’il ne modifiait pas l’angle de prise de vues
des personnages, comme si ceux-ci lévitaient 1 ; enfin, l’arrivée de Johannes après sa
disparition, le visage changé, sa transformation physique étant accueillie par son père
comme le miracle du recouvrement de sa raison. La métamorphose de son regard est
surtout le premier moment et le vecteur principal du mouvement d’inversion des
corps qui anime toute la séquence – le fou est devenu sage, la morte est redevenue
vivante, l’incroyant devient croyant, les deux vieillards qui se battaient jadis s’enlacent
désormais, les deux jeunes gens séparés par une querelle de chapelle sont enfin
promis l’un à l’autre, la communauté divisée se trouve enfin unie.
Dans Hors Satan, le miracle n’est plus ce qui permet la refonte de la communauté,
comme c’était le cas dans tout le cinéma moderne – le vagabond s’en va avant le
réveil de la jeune fille qu’il a ramenée à la vie. L’amitié n’était qu’un pacte scellé par
un crime et délié par un miracle, dans un état de nature où règne une solitude
radicale, préétablie et définitive. Le crime et le miracle cessent d’être l’origine ou
l’horizon de la communauté, l’exception qui la fonde ou la maintient, pour devenir la
norme figurative : l’incommensurable est la règle qui exclut toute commune mesure
– et, avec elle, toute pensée de la communauté, toute critique de l’exclusion aussi.
Dans ce monde primitif déserté par toute forme de socialité ordinaire, le miracle
n’est plus que la contremarque frappée sur la monnaie du crime. Le projet radicale
ment apolitique de Hors Satan (peut-être en réaction à l’échec de Hadewijch (2009), qui
se confrontait au cœur brûlant d’une actualité politique – les liens entre fanatisme
1. Jacques Aumont, « Vanités (Migrations 2) », Cinémathèque, n° 16, automne 1996, repris dans
8 Matière d’images, Éditions Images modernes, 2005.
Cheval.indd 8 06/03/15 19:24
religieux et terrorisme – réduite à un choc brutal entre cultures et confessions) rejoint
le pessimisme métaphysique qui est celui de la tradition française ultramontaine, le
film pouvant sembler être l’illustration de la pensée de Joseph de Maistre (De l’État
de nature) ou de celle d’Antoine Blanc de Saint-Bonnet (La Douleur). C’est la vision
d’un monde d’après la chute où règne la souffrance en juste réponse au péché originel,
avec comme seule échappatoire une grâce individuelle porteuse d’aucune espérance
en une quelconque communauté à venir, ne serait-ce que par la miséricorde.
Il y a bien un film dans l’œuvre de Dreyer, certes, qui pourrait laisser croire à
l’identité du crime et du miracle par le jeu très simple et très sûr du montage : Jour
de colère (Dies Irae, tourné en 1943, sous l’occupation nazie – d’où l’extrême noirceur
du film). Au Danemark, au xviie siècle, Anne, la jeune épouse du pasteur Absalon,
vieil homme raide aussi avenant qu’un médecin d’une leçon de Rembrandt, avec sa
grande collerette blanche et son front dégarni, tombe amoureuse de Martin, le fils
que son mari a eu d’un premier mariage. À la fin du film, un montage parallèle
montre d’un côté une conversation entre les deux amants durant laquelle la jeune
femme laisse penser que tout serait plus simple si son époux mourait, de l’autre côté
Absalon s’effondrant dans un champ où une tempête se lève. Le pasteur se relève et
finit par arriver chez lui, où le couple adultère l’accueille après avoir interrompu in
extremis son étreinte. Il raconte son attaque à son fils et à sa femme en ces termes
clairvoyants : « J’ai senti la mort me frôler. […] Ma mort a été prononcée. » Une fois
son fils parti, le pasteur s’excuse auprès de sa femme de lui avoir volé sa jeunesse et
lui demande si elle a souhaité sa mort ; elle lui répond qu’elle l’a souvent rêvée et lui
avoue sa relation avec Martin ; les champs-contrechamps s’accélèrent ; l’homme se
lève, se dirige vers l’escalier en bas duquel il hurle le nom de son fils ; sur le portrait
ombré de la jeune femme, on entend la chute de l’homme ; le contrechamp montre
pourtant son corps gisant au pied de la table. L’espace absorbé par le montage
– « passé dans la collure 1 » – est le signe d’une force d’attraction surnaturelle émise
par Anne : le faux raccord est le troisième indice de sa sorcellerie, après les deux
actualisations violentes de sa parole. L’indice mais non la preuve. La découverte du
corps suffira pourtant à la mère d’Absalon, vieille marâtre revêche et superstitieuse,
pour avoir la conviction que sa belle-fille est le suppôt de Satan. Elle l’accusera de
sorcellerie au tribunal, la menant au bûcher. Le film invite donc à refuser cette
interprétation fanatique qui concorde pourtant avec le sens expressif de son montage :
il demande au spectateur, au fond, d’accepter la force affective des signes, des
hasards, des présages, des désirs, de tout un monde invisible, mais de ne jamais
en juger l’efficience, la réalité. Il n’y a pas de sorcière, pas de méchanceté ni de
malédiction, rien que le mal d’une société patriarcale et puritaine qui condamne une
femme au malheur par un mariage forcé. Le seul crime d’Anne est d’avoir désiré la
1. L’expression, magnifique, est employée par Jacques Rivette à propos de Gertrud, avant d’être
popularisée par Deleuze. Voir Jacques Rivette, Sylvie Pierre et Jean Narboni, « Montage », Cahiers du
Cinéma, n° 210, mars 1969, p. 33. 9
Cheval.indd 9 06/03/15 19:24
mort de son mari si fort qu’elle a pu elle-même s’en croire l’auteur – c’est cette
tragédie du cœur existant par-delà le drame social que dessine le faisceau de signes
organisé par le montage.
Antichrist (2009) semble avoir tenté consciemment l’inversion de la logique de Jour
de colère – la dédicace à Tarkovski servant à la fois à détourner l’attention de cet
héritage dreyérien et à s’autoproclamer nouveau héraut de ce cinéma de la cruauté.
Lars von Trier n’hérite pas des formes de son glorieux aîné (les préconisations for
melles de Dogme 95 sont à l’opposé du hiératisme de Dreyer) mais seulement d’enjeux
thématique et scénaristique (Breaking the Waves, par exemple, est le récit hagio
graphique de la Passion d’une femme dont un miracle final célèbre la mort : les
cloches qui sonnent dans le ciel – l’incrustation visuelle est assez grotesque, et, en
tout cas, à mille lieues de la sobriété de son compatriote). Dans Jour de colère,
Dreyer concluait son film par une mort et un procès qui disait la force d’aimer
malgré la répression à l’époque de la chasse aux sorcières ; dans Antichrist, Lars
von Trier commence son film par une mort qui apparaît progressivement comme le
meurtre de l’héroïne jouée par Charlotte Gainsbourg, le temps que le film mène son
procès en sorcellerie et l’accuse d’un crime sans autre raison d’être que l’irraison des
femmes. Lors du fameux prologue au ralenti, un jeune enfant aperçoit ses parents
faire l’amour avant de se défenestrer. La chute est montrée en montage alterné avec
le visage grimaçant de la jeune femme en plein orgasme. Comme chez Dreyer, mais
avec plus de roublardise, le montage mène sur la piste d’une responsabilité de la
femme, mais seul encore le spectateur peut formellement l’en accuser. Seulement,
plus tard, un flash-back nous apprendra qu’elle a vu l’enfant tomber, au moment
où l’on commence à comprendre qu’elle torturait son fils en intervertissant ses
chaussures gauche et droite. Bref, l’héroïne, qui écrit une thèse sur la sorcellerie, a
cru aux accusations portées contre ces femmes et a assumé la position misogyne qui
fait du corps de la femme un objet abandonné aux forces sataniques de la nature. Le
bûcher final n’est plus la marque de l’obscurantisme des temps, mais la légitime
défense de son mari, un psychologue naïf qui ignorait l’état de nature dans lequel
vivait sa femme avant qu’il ne se révèle au beau milieu de la forêt, loin de toute
communauté humaine. Jour de colère et Antichrist sont deux tragédies de l’inté
riorisation d’une oppression. Mais là où Dreyer avait pensé la tragédie comme la
pointe extrême du drame politique de la persécution patriarcale, Lars von Trier l’a
voulue pure de tout contrechamp social, politique et juridique, la laissant croître
seule jusqu’au retournement de sens. Car Antichrist ne raconte plus l’assomption par
une femme du mal que le pouvoir lui prête : il fait le portrait anhistorique d’une
femme qui parviendrait à recouvrer par elle-même et en elle-même sa nature. Soit :
son être sorcière. La force démentielle que Lars von Trier prête aux femmes n’a jamais
eu d’autre qu’objet dans son cinéma que de leur donner le moyen d’accomplir un
mythe misogyne.
Batalla en el cielo, Hors Satan, Antichrist sont les trois cauchemars grotesques et
10 effroyables du cinéma contemporain, trois enquêtes sur le mal qui ont ambitionné
Cheval.indd 10 06/03/15 19:24
d’imaginer un lieu par-delà toute raison et toute loi, mais n’ont dépeint que l’utopie
inquisitoriale d’un monde gouverné par le péché et la vengeance divine, en l’absence de
la grâce – cette grâce qui chez Dreyer n’était jamais que l’autre nom de la beauté.
Le mineur et le baroque – des détours
Entre 1952 et 1954, alors que Carl Theodor Dreyer s’apprête à tourner Ordet d’après
la pièce de Kaj Munk qu’il a découverte vingt ans auparavant au Det Kongelige
Teater de Copenhague, Manoel de Oliveira rédige la première version du scénario de
L’Étrange Affaire Angelica, qu’il réalisera près de soixante ans plus tard. À l’époque
de l’écriture, Manoel de Oliveira connaissait et admirait déjà Dreyer. Il avait
notamment découvert La Passion de Jeanne d’Arc à sa sortie en salles – privilège de
l’âge. Si l’auberge spectrale de Vampyr, avec ses durées effilochées et ses trans
parences irréelles, a pu influencer la pension d’Isaac, l’idée d’ouvrir son film par une
veillée funéraire fantastique ne doit donc rien à Ordet – elle lui a en fait été inspirée
par une expérience vécue dans sa jeunesse. L’Étrange Affaire Angelica s’ouvre la
nuit, alors qu’on vient chercher un jeune photographe pour immortaliser l’image
d’une jeune fille de bonne famille, comme cela se faisait encore au début du xxe siècle
– le film a la temporalité flottante des derniers Oliveira. Isaac pénètre dans la grande
demeure bourgeoise, impressionné par la beauté des lieux, franchit des couloirs, croise
un père effondré, et finit par accéder au salon où la veillée a lieu. Le corps d’Angelica
est exposé dans une mise en scène somptueuse, inspirée des photographies du
pictorialiste anglais Henry Peach Robinson (She Never Told Her Love, Fading Away).
Alors que le rituel funéraire qui concluait Ordet était la forme cérémonielle où tous
les conflits comparaissaient, dans une incroyable condensation morale du drame, tout
ici indique une fiction d’image : le photographe commence par réclamer une lumière
plus forte, il se brûle d’ailleurs en voulant changer l’ampoule ; c’est dans le viseur de
son appareil que le visage de la défunte s’animera d’un gracieux sourire. La morte ne
se lève plus devant la communauté des vivants : elle salue l’artiste. La suite du film est
un conte d’amour fou entre le photographe obsédé par la survivance des phénomènes
du monde et le fantôme d’Angelica, transparence en noir et blanc qui apparaît à
plusieurs reprises. Angelica fait écho à Ordet comme une version mineure et fantas
tique, avec son miracle descendu de la sphère religieuse de la foi et de la grâce à la
sphère éthique et esthétique de l’amour de la beauté et de l’apparition des images.
Manoel de Oliveira n’est pas un esprit nordique : il n’a pas la gravité austère du
protestantisme, c’est un catholique méridional, sceptique en son fond et un peu farceur
sur les bords. Présentant dans une salle de cinéma Gertrud – le film de Dreyer qui l’a
le plus profondément marqué –, le cinéaste portugais s’interrogeait sur cet héritage :
« J’admire beaucoup Dreyer. Je ne sais pas s’il a exercé sur moi une influence. Je crois
être plus proche de Buñuel, qui est ibérique, comme moi. Le Nord, c’est autre chose, un
autre esprit, mais j’admire Dreyer pour sa recherche de profondeur, de ce qui est 11
Cheval.indd 11 06/03/15 19:24
inaccessible à l’homme, de ce à quoi il manque des réponses. Pourquoi nous vivons,
pourquoi la mort. Les chrétiens et d’autres ont peut-être des réponses 1. » Croyant
interpréter l’œuvre en exégète, il avouait pourtant la forme qu’il en a héritée : « À
mon avis, s’il a demandé à ses acteurs de regarder face à eux alors que, pourtant, ils
se parlaient, c’était pour dire qu’ils ne se comprenaient pas. » La modernité de Dreyer
selon Oliveira, c’est l’invention du premier cinéma de la parole (« Dreyer a pressenti le
cinéma futur car il a eu la force de filmer la parole ») et de l’« incommunicabilité » – de
l’irréductibilité du discours au partage du sens. « C’est une façon étrange, quand même
jolie, de l’interpréter, et c’est la mienne. » Jolie interprétation, en effet, qui a donné
l’une des figures les plus typiques de son œuvre : cet œil aveugle des personnages,
statiques comme des « momies 2 », discourant sans fin dans des cadres frontaux et
des intérieurs austères où toute la folie du monde semble réduite, précipitée – et
adoucie. C’est cela, le grand art d’Oliveira : l’acclimatation de l’extrême rigueur formelle
de Dreyer dans un cinéma de la dérive de la parole et du glissement du sens. Alors que
la plupart des héritiers de Dreyer sont allés du côté de la fable religieuse toujours
plus raide, Oliveira, lui, a plutôt repris une configuration particulière – le monologue
parallèle d’un homme et d’une femme incapables d’un regard échangé – et en a fait le
levier d’un romanesque baroque et dissonant fondé sur la non-rencontre, où chaque
personnage est une monade qui avance seule dans le monde de ses fantasmes.
Dix ans après Gertrud, Benilde ou la Vierge Mère, en 1975, était encore un drame
métaphysique sur le modèle dreyérien : une jeune fille s’y prétend enceinte d’un ange
de Dieu et meurt de l’absence de sens dans le monde et de l’absence de foi chez
autrui. Mais dès le film suivant, Amour de perdition (1979), Oliveira dilue le drame
dans une temporalité flottante, mélancolique, pour inventer un romanesque immobile,
ironique et mélancolique. Jour de colère bascule en un Jour de désespoir. En 1988, il
rencontre sa Gertrud : l’actrice Leonor Silveira, avec son regard perdu qu’aucun objet
jamais n’arrête. Elle est une Gertrud de roman, dans Val Abraham (1993), où la
claudication de cette Emma Bovary contemporaine est l’invention sublime qui fait
vaciller ce romanesque arrêté, fait d’ellipses tragiques et de quelques stases de
bonheur. Puis elle est une Gertrud de comédie, dans Le Miroir magique (2005), où
l’actrice incarne une grande bourgeoise neurasthénique, cloîtrée dans sa demeure
par la déception de n’avoir jamais vu la Vierge lui apparaître – quand c’est au fond
l’absence d’enfant et, plus ironiquement encore, l’absence de sexe qui semblent
nourrir cette obsession. L’amour impossible est remplacé par une dévotion maladive
qui prend la forme narcissique d’une identification à Marie, qu’Alfreda imagine riche
1. Pour cette citation et les suivantes : Manoel de Oliveira, « Éloge de Gertrud », Cahiers du cinéma,
n° 557, mai 2001, p. 102-103.
2. L’expression est de Véronique Taquin, « Sur Dreyer et le neutre », Cinergon, n° 6-7, 1999, et a été
popularisée par Gilles Deleuze, qui l’a définie ainsi : « la Momie, cette instance démontée, paralysée,
pétrifiée, gelée, qui témoigne pour “l’impossibilité de penser qu’est la pensée” », in L’Image-mouvement,
Minuit, 1980, p. 217. Deleuze a montré que la momie n’était pas une conception narratologique du
12 personnage, mais une question de forme – la création de la figure par la planéité de l’image.
Cheval.indd 12 06/03/15 19:24
et belle, comme elle, et qui l’empêche d’être sensible à la beauté du monde extérieur,
cette Création où Dieu se laisse voir à qui sait l’admirer. Les momies d’Oliveira ne
sont plus ces blocs froids sous les bandelettes desquels brûle une lave prête à nous
terrasser d’un coup : c’est toute une collection de pantins rouillés, de marionnettes
mal articulées, de ventriloques qui parlent infiniment en circonvolutions imagées
sans jamais approcher du problème qui les anime, sauf par lapsus.
Avec une littéralité inouïe, deux scènes de l’œuvre ont mis le jour sur ce pro
gramme cruel, le démembrement des marionnettes. C’est, dans Les Cannibales (1988),
la séquence grand-guignolesque de la nuit de noces où le vicomte d’Aveleda est
contraint de dévoiler son corps amputé des quatre membres à son épouse, avant de
rouler dans le feu de cheminée où son petit tronc rôtira. C’est le plan où, démasquée
et répudiée, l’héroïne cleptomane de Singularités d’une jeune fille blonde (2009), qui
avait aguiché un jeune comptable naïf en s’exhibant à une fenêtre, s’effondre comme
une poupée dégonflée, prostrée sur un fauteuil où ses membres se raidissent et sa tête
tombe, pointant ses cuisses grandes ouvertes, d’où elle échoue à avorter son mal.
Disons-le enfin : s’il y a un pays qui a su acclimater Dreyer à son esprit, qui en a
saisi la pleine beauté tout en l’amenant ailleurs, pour voir ce qu’elle a encore à
donner sous d’autres latitudes, c’est ce petit pays catholique du sud de l’Europe qu’est
le Portugal. João Cesar Monteiro avait dédié son premier film, Sophia de Mello
Breyner Andresen (1969) à Carl Theodor Dreyer. Il a hérité, comme Pedro Costa
après lui, de l’image spectrale de Vampyr, de ses intérieurs hantés et de ses figures
faites d’ombres et de lumière. João Pedro Rodrigues a bien semblé s’inscrire dans
cette lignée avec son premier film, O Fantasma, sorti en 2000. Un jeune éboueur y
devient l’animal auquel le destine sa vie sexuelle, prédatrice et brutale, fétichiste et
olfactive, lorsqu’il erre à quatre pattes en combinaison de latex dans une grande
décharge, cafard géant d’une série Z de film d’apocalypse – on pense aux fiançailles
de Dreyer et de Tourneur dans une backroom SM à ciel ouvert. Mais ses deux longs
métrages suivants montrent que Rodrigues est surtout, comme Oliveira, l’héritier de
cette figure dreyérienne, la momie – cet être paralysé par le désir venu du dehors
auquel le cinéaste offre une vie exceptionnelle : une image, un corps, un destin
inédits. Ses films partent d’une situation de frustration des chairs, filmée avec un
hiératisme qui évoque autant Dreyer que Bresson, son cousin janséniste, dans des
plans-séquences tendus par la pulsion et soudainement morcelés par des gestes, des
visages, des objets en gros plans surgissant comme autant de saillies libidinales.
D’abord réduits à une dialectique ciel vide / chair brûlante tournant en rond, comme
dans les petits théâtres de la cruauté de Reygadas et Dumont, les personnages de
Rodrigues sont peu à peu emportés vers l’ailleurs auquel la puissance vitale de ce
désir du dehors les destinait, dans une mutation qui arrache le film à sa maîtrise, à
son bon goût, et accomplit pleinement un romanesque des pulsions. Il n’y a qu’à
comparer Odete (2005), le second long métrage de Rodrigues, variation baroque
autour d’Ordet, son quasi-homonyme, et Lumière silencieuse de Reygadas (2007), sa
reprise scolaire et appliquée, pour mesurer l’abîme qui les sépare. 13
Cheval.indd 13 06/03/15 19:24
Aux communautés puritaines de La Quatrième Alliance de Dame Marguerite, du
Maître du logis, de Jour de colère ou d’Ordet, le cinéaste mexicain a substitué un
petit village mennonite au nord du Mexique. La blondeur des visages cadrés en très
gros plans frontaux et la froideur germanique du plautdietsch donnent l’impression
d’un film de Dreyer plongé dans les grands espaces malickiens, étrangement perdu
dans le soleil qui inonde de lumière les champs de maïs, à perte de vue. Johan, pris
d’une autre folie que celle de Johannes, trompe sa femme Esther avec Marianne.
Esther l’apprend, pleure sous la pluie, en meurt. La veillée funèbre cite manifeste
ment celle d’Ordet : même focalisation du temps autour de l’horloge arrêtée, même
séparation spatiale des vivants et des morts par le jeu d’une double porte à franchir
entre le salon où les invités patientent et la chambre où le corps repose. Le plan large
avec la morte joue pareillement du raccourci et de la lumière qui perce du dehors,
par la fenêtre, pour bénir le corps. Mais le cercueil étagé, placé sur un petit tapis
rouge, est entouré de deux immenses chandeliers argentés. La blancheur immaculée
du lieu, saisi en très grand angle, donne l’impression d’une sculpture kitsch et
clinquante dans un white cube, à la façon d’une vanité signée Damien Hirst. Manière
d’indiquer que la reprise est pensée comme variation conceptuelle, comme geste d’art
contemporain. Ce n’est plus la foi d’un fou et d’une enfant qui réveille la morte, mais
un geste de sacrifice et de repentance : Marianne est venue dire à Johan qu’elle ne le
reverrait plus, puis est allée embrasser la morte. Au moment du baiser, une larme
coule du visage de Marianne au visage d’Esther. Un baiser a réveillé la femme,
comme dans La Belle au bois dormant, mais, plus profondément, c’est le partage
d’une humeur et d’une tristesse qui a ravivé la chair. Mais étrangement, dans le jeu
de la citation, le moment a une beauté désincarnée, comme désaffectée. C’est aussi
que le sacrifice de Marianne sonne un peu trop comme un juste retour à l’ordre, là où
Ordet ne réparait la communauté que pour l’emmener tout entière dans un autre
lieu, cette chambre de l’enfance du monde où tout peut s’inverser.
Rodrigues, lui, a fait de la veillée funéraire le point de départ d’un récit baroque
de métamorphose pour inventer une résurrection qui n’aurait pas à en passer par
la levée miraculeuse d’un corps. Odete se rend dans la petite salle en sous-sol où
une mère éplorée et un amant déchiré veillent le corps de Pedro, un voisin qu’elle
connaissait à peine, mort d’un accident de voiture. Elle y reste longtemps, jusqu’à
ce que tout le monde s’endorme, pour déposer un baiser sur les lèvres du cadavre
(Reygadas avait-il vu le film avant de tourner Lumière silencieuse ?), puis pour lui
voler avec la bouche la bague de fiançailles qu’il avait échangée avec Rui, l’homme
qu’il aimait. Par ces deux gestes aussi cérémonieux qu’indécents, la jeune fille
s’immisce dans leur pacte amoureux. Elle se dira d’abord enceinte du défunt, après
une nuit d’orage durant laquelle un vent violent est venu ouvrir sa fenêtre, écarter
les rideaux et figurer son immaculée conception. Une fois la grossesse nerveuse
diagnostiquée, le vent qui avait fait enfler son ventre se retire – mais le délire est
toujours là. Odete va alors se travestir pour devenir Pedro – comme si à la levée
14 miraculeuse du corps dans le cercueil Rodrigues avait préféré le détour baroque
Cheval.indd 14 06/03/15 19:24
d’une métamorphose. La réaction de Rui est d’abord très violente. Le film peut
s’entendre comme la vampirisation illégitime du drame classique du deuil et du
manque par un mélodrame queer et illégitime : Odete parvient à aspirer Rui dans
son jeu délirant quand elle lui montre la bague. Dans un dernier plan magnifique,
la jeune femme vêtue des habits de Pedro mime une sodomie sur Rui, tandis que la
caméra recule pour montrer le fantôme du jeune homme, dans la même tenue,
observant son improbable résurrection. Ce finale a la beauté tragique de l’impossible
et l’immédiateté émotionnelle d’une fin de mélo : là où Reygadas et Dumont ont renchéri
sur la raideur de Dreyer par une esthétique du dualisme et de l’écartèlement de toutes
choses, Rodrigues a préféré le jeu baroque du détour, du pli et du retournement.
Comme s’il fallait casser la densité adamantine du plan dreyérien pour en tirer des
perles irrégulières.
Ce baroque trouve son accomplissement dans son avant-dernier long métrage,
Mourir comme un homme (2010). Tonia, la vedette vieillissante d’un show de travestis,
ne deviendra pas une femme, mourant trop tôt d’une greffe clandestine de silicone à
la poitrine. Tout au long du film, la naturalisation de l’iconographie terrestre des
Évangiles dans le hiératisme stylistique du film transforme Tonia en Vierge de
Douleurs, selon une migration d’images typique du grand drame chrétien (cf. les
pietàs de Poudovkine, Rossellini, Pasolini, Paradjanov, Scorsese, Coppola, etc.). Mais
pour son enterrement, Rodrigues accorde à son héroïne amoureuse des images
sulpiciennes et du kitsch de cabaret de trôner en Vierge de pacotille au-dessus de la
cérémonie, dans un final grandiose et camp où L’Assomption du Titien a servi de
modèle à un maniérisme délirant – c’est avec Dreyer tout le grand cinéma chrétien,
et même toute la peinture chrétienne, qui se retrouvent invités dans une boule à
neige – de celles qu’on achète à Fatima, la Lourdes portugaise. Du christianisme,
Rodrigues ne retient que les montages généalogiques délirants, les chairs ouvertes et
sanguinolentes, les gestes d’humilité et de compassion, et du cinéma chrétien il ne
garde qu’un art de la densité des corps, ces corps qu’il va pouvoir ouvrir, altérer et
métamorphoser. Queer Dreyer, camp Christianity.
15
Cheval.indd 15 06/03/15 19:24
S-ar putea să vă placă și
- Anca Gata PDFDocument12 paginiAnca Gata PDFFaustino JuliaoÎncă nu există evaluări
- Bruno Mars Thats What I Like Bass Transcription - CompressDocument3 paginiBruno Mars Thats What I Like Bass Transcription - CompressNeal BowenÎncă nu există evaluări
- Brochure Saison 21-22Document93 paginiBrochure Saison 21-22Kirane MusicÎncă nu există evaluări
- Messe de La Sainte Vierge Marie-5Document12 paginiMesse de La Sainte Vierge Marie-5Joel Kisoni90% (10)
- EXERCICE 1 - Le BundleDocument2 paginiEXERCICE 1 - Le BundleMarjoÎncă nu există evaluări
- PerspectiveDocument18 paginiPerspectiveLaurent DurandÎncă nu există evaluări
- b1 b2 - Chanson - Paris en ChansonsDocument6 paginib1 b2 - Chanson - Paris en ChansonsEnachi Oana-MariaÎncă nu există evaluări
- Fiche de Mémorisation Sur La Poésie CollègeDocument1 paginăFiche de Mémorisation Sur La Poésie CollègeRémy DelporteÎncă nu există evaluări
- Geoffroy de Pennart: L'univers D'un Auteur, Fiche Pédagogique Cycle 1Document10 paginiGeoffroy de Pennart: L'univers D'un Auteur, Fiche Pédagogique Cycle 1Centre de littérature de jeunesse de la CreuseÎncă nu există evaluări
- Organigramme Universite Bordeaux MontaigneDocument11 paginiOrganigramme Universite Bordeaux MontaigneDennys Silva-ReisÎncă nu există evaluări
- Roosevelt LowDocument18 paginiRoosevelt LowggafiinÎncă nu există evaluări
- Cours 19 Le Post-ModernismeDocument41 paginiCours 19 Le Post-ModernismemerioumaÎncă nu există evaluări
- ResonanceDocument6 paginiResonance劉軒廷Încă nu există evaluări
- Commentaire Littéraire: D'abord en EffetDocument2 paginiCommentaire Littéraire: D'abord en EffetREDA SOULEIMANIÎncă nu există evaluări
- Code Couleur RVBDocument7 paginiCode Couleur RVBCédric LevenÎncă nu există evaluări
- Berklee Scale Requirements - 2nd SemesterDocument3 paginiBerklee Scale Requirements - 2nd SemesterGeorge ConstantinouÎncă nu există evaluări
- Les Rudi Llata Clowns de Légende Et de Rêve - Le Bloc-Notes de Cirk75Document12 paginiLes Rudi Llata Clowns de Légende Et de Rêve - Le Bloc-Notes de Cirk75effeÎncă nu există evaluări
- Carnet de Lecteur ÉlèveDocument1 paginăCarnet de Lecteur ÉlèveMERIEM FATEN DHOUIBÎncă nu există evaluări
- Danse - Situations D'apprentissageDocument2 paginiDanse - Situations D'apprentissageLilieÎncă nu există evaluări
- Les Architectes Les Plus Connus Du MondeDocument20 paginiLes Architectes Les Plus Connus Du MondeLamiae KhalilÎncă nu există evaluări
- Analyse de Lhistoire Du Petit Prince deDocument6 paginiAnalyse de Lhistoire Du Petit Prince deAlicia BacoÎncă nu există evaluări
- La Cerisaie by Tchekhov, Anton (Tchekhov, Anton)Document159 paginiLa Cerisaie by Tchekhov, Anton (Tchekhov, Anton)Walter MonadjemiÎncă nu există evaluări
- Viola-Adios NoninoDocument2 paginiViola-Adios NoninoTheMono1369Încă nu există evaluări
- Expose Poesie LyriqueDocument7 paginiExpose Poesie LyriqueBLEGBO HERVÉÎncă nu există evaluări
- ATELIER SLAM - Centre Les Etoiles - Fiche PédagogiqueDocument2 paginiATELIER SLAM - Centre Les Etoiles - Fiche PédagogiqueLe GLAIVE MOUPASSIÎncă nu există evaluări
- Silent Noon D Flat MajorDocument7 paginiSilent Noon D Flat MajorChopsÎncă nu există evaluări
- La Mc3a9canique Du Cc593ur de Mathias MalzieuDocument14 paginiLa Mc3a9canique Du Cc593ur de Mathias MalzieuLuis Enrique Castillo García100% (1)
- (Faux Titre No 319) Cornille, Jean-Louis - Plagiat Et Créativité - (Treize Enquêtes Sur L'auteur Et Son Autre) - Rodopi (2008)Document222 pagini(Faux Titre No 319) Cornille, Jean-Louis - Plagiat Et Créativité - (Treize Enquêtes Sur L'auteur Et Son Autre) - Rodopi (2008)nassredine hadjadjÎncă nu există evaluări
- Liste de MatérielDocument4 paginiListe de MatérieledysoneÎncă nu există evaluări
- Fire and SteelDocument4 paginiFire and Steeldevin solomonÎncă nu există evaluări