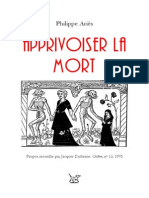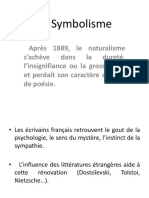Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
En Un Peu Pire
Încărcat de
Franceinfo86%(14)86% au considerat acest document util (14 voturi)
280K vizualizări4 paginiLettre de Michel Houellebecq, lue sur France Inter
Titlu original
en un peu pire
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentLettre de Michel Houellebecq, lue sur France Inter
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
86%(14)86% au considerat acest document util (14 voturi)
280K vizualizări4 paginiEn Un Peu Pire
Încărcat de
FranceinfoLettre de Michel Houellebecq, lue sur France Inter
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 4
Il faut bien l’avouer : la plupart des mails échangés ces dernières
semaines avaient pour premier objectif de vérifier que l’interlocuteur
n’était pas mort, ni en passe de l’être. Mais, cette vérification faite, on
essayait quand même de dire des choses intéressantes, ce qui n’était
pas facile, parce que cette épidémie réussissait la prouesse d’être à la
fois angoissante et ennuyeuse. Un virus banal, apparenté de manière
peu prestigieuse à d’obscurs virus grippaux, aux conditions de survie
mal connues, aux caractéristiques floues, tantôt bénin tantôt mortel,
même pas sexuellement transmissible : en somme, un virus sans
qualités. Cette épidémie avait beau faire quelques milliers de morts
tous les jours dans le monde, elle n’en produisait pas moins la
curieuse impression d’être un non-événement. D’ailleurs, mes
estimables confrères (certains, quand même, sont estimables) n’en
parlaient pas tellement, ils préféraient aborder la question du
confinement ; et j’aimerais ici ajouter ma contribution à certaines de
leurs observations.
Frédéric Beigbeder (de Guéthary, Pyrénées-Atlantiques). Un écrivain
de toute façon ça ne voit pas grand monde, ça vit en ermite avec ses
livres, le confinement ne change pas grand-chose. Tout à fait
d’accord, Frédéric, question vie sociale ça ne change à peu près rien.
Seulement, il y a un point que tu oublies de considérer (sans doute
parce que, vivant à la campagne, tu es moins victime de l’interdit) : un
écrivain, ça a besoin de marcher.
Ce confinement me paraît l’occasion idéale de trancher une vieille
querelle Flaubert-Nietzsche. Quelque part (j’ai oublié où), Flaubert
affirme qu’on ne pense et n’écrit bien qu’assis. Protestations et
moqueries de Nietzsche (j’ai également oublié où), qui va jusqu’à le
traiter de nihiliste (ça se passe donc à l’époque où il avait déjà
commencé à employer le mot à tort et à travers) : lui-même a conçu
tous ses ouvrages en marchant, tout ce qui n’est pas conçu dans la
marche est nul, d’ailleurs il a toujours été un danseur dionysiaque, etc.
Peu suspect de sympathie exagérée pour Nietzsche, je dois
cependant reconnaître qu’en l’occurrence, c’est plutôt lui qui a raison.
Essayer d’écrire si l’on n’a pas la possibilité, dans la journée, de se
livrer à plusieurs heures de marche à un rythme soutenu, est
fortement à déconseiller : la tension nerveuse accumulée ne parvient
pas à se dissoudre, les pensées et les images continuent de tourner
douloureusement dans la pauvre tête de l’auteur, qui devient
rapidement irritable, voire fou.
La seule chose qui compte vraiment est le rythme mécanique,
machinal de la marche, qui n’a pas pour première raison d’être de
faire apparaître des idées neuves (encore que cela puisse, dans un
second temps, se produire), mais de calmer les conflits induits par le
choc des idées nées à la table de travail (et c’est là que Flaubert n’a
pas absolument tort) ; quand il nous parle de ses conceptions
élaborées sur les pentes rocheuses de l’arrière-pays niçois, dans les
prairies de l’Engadine etc., Nietzsche divague un peu : sauf lorsqu’on
écrit un guide touristique, les paysages traversés ont moins
d’importance que le paysage intérieur.
Catherine Millet (normalement plutôt parisienne, mais se trouvant par
chance à Estagel, Pyrénées-Orientales, au moment où l’ordre
d’immobilisation est tombé). La situation présente lui fait
fâcheusement penser à la partie « anticipation » d’un de mes
livres, La possibilité d’une île.
Alors là je me suis dit que c’était bien, quand même, d’avoir des
lecteurs. Parce que je n’avais pas pensé à faire le rapprochement,
alors que c’est tout à fait limpide. D’ailleurs, si j’y repense, c’est
exactement ce que j’avais en tête à l’époque, concernant l’extinction
de l’humanité. Rien d’un film à grand spectacle. Quelque chose
d’assez morne. Des individus vivant isolés dans leurs cellules, sans
contact physique avec leurs semblables, juste quelques échanges par
ordinateur, allant décroissant.
Emmanuel Carrère (Paris-Royan ; il semble avoir trouvé un motif
valable pour se déplacer). Des livres intéressants naîtront-ils, inspirés
par cette période ? Il se le demande.
Je me le demande aussi. Je me suis vraiment posé la question, mais
au fond je ne crois pas. Sur la peste on a eu beaucoup de choses, au
fil des siècles, la peste a beaucoup intéressé les écrivains. Là, j’ai des
doutes. Déjà, je ne crois pas une demi-seconde aux déclarations du
genre « rien ne sera plus jamais comme avant ». Au contraire, tout
restera exactement pareil. Le déroulement de cette épidémie est
même remarquablement normal. L’Occident n’est pas pour l’éternité,
de droit divin, la zone la plus riche et la plus développée du monde ;
c’est fini, tout ça, depuis quelque temps déjà, ça n’a rien d’un scoop.
Si on examine, même, dans le détail, la France s’en sort un peu mieux
que l’Espagne et que l’Italie, mais moins bien que l’Allemagne ; là non
plus, ça n’a rien d’une grosse surprise.
Le coronavirus, au contraire, devrait avoir pour principal résultat
d’accélérer certaines mutations en cours. Depuis pas mal d’années,
l’ensemble des évolutions technologiques, qu’elles soient mineures (la
vidéo à la demande, le paiement sans contact) ou majeures (le
télétravail, les achats par Internet, les réseaux sociaux) ont eu pour
principale conséquence (pour principal objectif ?) de diminuer les
contacts matériels, et surtout humains. L’épidémie de coronavirus
offre une magnifique raison d’être à cette tendance lourde : une
certaine obsolescence qui semble frapper les relations humaines. Ce
qui me fait penser à une comparaison lumineuse que j’ai relevée dans
un texte anti-PMA rédigé par un groupe d’activistes appelés « Les
chimpanzés du futur » (j’ai découvert ces gens sur Internet ; je n’ai
jamais dit qu’Internet n’avait que des inconvénients). Donc, je les
cite : « D’ici peu, faire des enfants soi-même, gratuitement et au
hasard, semblera aussi incongru que de faire de l’auto-stop sans
plateforme web. » Le covoiturage, la colocation, on a les utopies
qu’on mérite, enfin passons.
Il serait tout aussi faux d’affirmer que nous avons redécouvert le
tragique, la mort, la finitude, etc. La tendance depuis plus d’un demi-
siècle maintenant, bien décrite par Philippe Ariès, aura été de
dissimuler la mort, autant que possible ; eh bien, jamais la mort n’aura
été aussi discrète qu’en ces dernières semaines. Les gens meurent
seuls dans leurs chambres d’hôpital ou d’EHPAD, on les enterre
aussitôt (ou on les incinère ? l’incinération est davantage dans l’esprit
du temps), sans convier personne, en secret. Morts sans qu’on en ait
le moindre témoignage, les victimes se résument à une unité dans la
statistique des morts quotidiennes, et l’angoisse qui se répand dans la
population à mesure que le total augmente a quelque chose
d’étrangement abstrait.
Un autre chiffre aura pris beaucoup d’importance en ces semaines,
celui de l’âge des malades. Jusqu’à quand convient-il de les réanimer
et de les soigner ? 70, 75, 80 ans ? Cela dépend, apparemment, de la
région du monde où l’on vit ; mais jamais en tout cas on n’avait
exprimé avec une aussi tranquille impudeur le fait que la vie de tous
n’a pas la même valeur ; qu’à partir d’un certain âge (70, 75, 80
ans ?), c’est un peu comme si l’on était déjà mort.
Toutes ces tendances, je l’ai dit, existaient déjà avant le coronavirus ;
elles n’ont fait que se manifester avec une évidence nouvelle. Nous ne
nous réveillerons pas, après le confinement, dans un nouveau
monde ; ce sera le même, en un peu pire.
Michel HOUELLEBECQ
S-ar putea să vă placă și
- Correspondance Élie FaureDocument176 paginiCorrespondance Élie FaureFrédéric DautremerÎncă nu există evaluări
- Fusiller Céline ?: ou du danger des dialogues électroniquesDe la EverandFusiller Céline ?: ou du danger des dialogues électroniquesÎncă nu există evaluări
- La Vie de Galilée (Bertold Brecht) (Z-Library) PDFDocument135 paginiLa Vie de Galilée (Bertold Brecht) (Z-Library) PDFChercheur de savoirÎncă nu există evaluări
- Jean Pierre Thibaudat Theatre Francais Contemporain PDFDocument55 paginiJean Pierre Thibaudat Theatre Francais Contemporain PDFGheorghe HibovskiÎncă nu există evaluări
- Dispositifs: Anne-Marie DuguetDocument23 paginiDispositifs: Anne-Marie DuguetDe CruzÎncă nu există evaluări
- O Morro Nao Tem Vez 2014Document1 paginăO Morro Nao Tem Vez 2014Filippo FioriniÎncă nu există evaluări
- Tracts - Marc Edouard Nabe PDFDocument66 paginiTracts - Marc Edouard Nabe PDFyouyouÎncă nu există evaluări
- Ne Me Quitte Pas JbrelDocument2 paginiNe Me Quitte Pas JbrelGuido HurtadoÎncă nu există evaluări
- Dèmons Et MerveillesDocument3 paginiDèmons Et MerveillesLaura VinciguerraÎncă nu există evaluări
- Agamben, Giorgio - Le Cinéma de Guy DebordDocument5 paginiAgamben, Giorgio - Le Cinéma de Guy Debordfefe222Încă nu există evaluări
- Bibliographie Jacques Demy MajDocument44 paginiBibliographie Jacques Demy Majeterlou0% (1)
- Pourquoi les gens intelligents prennent-ils aussi des décisions stupides ?: Le paradoxe du QIDe la EverandPourquoi les gens intelligents prennent-ils aussi des décisions stupides ?: Le paradoxe du QIÎncă nu există evaluări
- Dalida - Come PrimaDocument2 paginiDalida - Come PrimagilouxoÎncă nu există evaluări
- Bellour - Kermabon - Machine À Hypnose - CinémActionDocument6 paginiBellour - Kermabon - Machine À Hypnose - CinémActionMireille Berton0% (1)
- Certas Cancoes Milton Nascimento Duo de Contrabaixos Partitura PDFDocument2 paginiCertas Cancoes Milton Nascimento Duo de Contrabaixos Partitura PDFLucas MartinezÎncă nu există evaluări
- Banana JM - GuideDocument2 paginiBanana JM - GuideFlavio MendesÎncă nu există evaluări
- Gilles Deleuze and Felix Guattari - L'Anti-Oedipe & Mille PlateauxDocument402 paginiGilles Deleuze and Felix Guattari - L'Anti-Oedipe & Mille PlateauxGustavoÎncă nu există evaluări
- La Lumière Indirecte-Paul VirilioDocument9 paginiLa Lumière Indirecte-Paul VirilioRodolfo BiquezÎncă nu există evaluări
- CARCASSI - Estudo, Op. 60, NR 2 PDFDocument2 paginiCARCASSI - Estudo, Op. 60, NR 2 PDFGeneroso RufinoÎncă nu există evaluări
- Paçoca (Choro) DUODocument3 paginiPaçoca (Choro) DUOAnonymous yaoHBiMÎncă nu există evaluări
- Ai, Seu Pinguca - BB InstrumentsDocument1 paginăAi, Seu Pinguca - BB InstrumentsDaneilÎncă nu există evaluări
- Dupuy Illich2021Document28 paginiDupuy Illich2021gil peoÎncă nu există evaluări
- Les Écrivains Face Au VirusDocument3 paginiLes Écrivains Face Au Virusaaquariuss12Încă nu există evaluări
- Albert - Camus - La - Peste - Pages 41-44Document5 paginiAlbert - Camus - La - Peste - Pages 41-44Fabianna PellegrinoÎncă nu există evaluări
- 130 1. El Caso Inexistente Prologue Au Livre Du Meme Nom. Texte Francais Traduction Espagnole. 4 Pages. Automne 2006 1Document8 pagini130 1. El Caso Inexistente Prologue Au Livre Du Meme Nom. Texte Francais Traduction Espagnole. 4 Pages. Automne 2006 1Nicolas GomesÎncă nu există evaluări
- Liste Complete Des Disparitions Europe de L Ouest (Reseaux Pedosatanistes Et Traffics D'organes) HOTDocument78 paginiListe Complete Des Disparitions Europe de L Ouest (Reseaux Pedosatanistes Et Traffics D'organes) HOTKilluminatis Kill-uminatis92% (13)
- Jean-Jacques Charbonier - Histoires Incroyables D'un Anesthésiste-RéanimateurDocument228 paginiJean-Jacques Charbonier - Histoires Incroyables D'un Anesthésiste-RéanimateurJames HowlettÎncă nu există evaluări
- A La Recherche de Mon FrereDocument150 paginiA La Recherche de Mon FrereFélicia MartinsÎncă nu există evaluări
- Philippe Ariès Apprivoiser La MortDocument17 paginiPhilippe Ariès Apprivoiser La MortHernando HerreroÎncă nu există evaluări
- De La BetiseDocument5 paginiDe La BetiseAlavi AurélienÎncă nu există evaluări
- Une Civilisation Qui Légalise L'euthanasie Perd ToutDocument3 paginiUne Civilisation Qui Légalise L'euthanasie Perd ToutThiagoos1Încă nu există evaluări
- 1f6564 PDFDocument22 pagini1f6564 PDFyazid cos100% (1)
- Le Moi Des MourantsDocument14 paginiLe Moi Des MourantsMunir BazziÎncă nu există evaluări
- Apprendre À Parler Avec Les Plantes (Marta Orriols)Document242 paginiApprendre À Parler Avec Les Plantes (Marta Orriols)assina MailletÎncă nu există evaluări
- Psihiatrie Sous Communist Dictaure en RoumaniaDocument372 paginiPsihiatrie Sous Communist Dictaure en RoumaniaargatuÎncă nu există evaluări
- La Mélancolie - Gerard PommierDocument378 paginiLa Mélancolie - Gerard PommierDeniz Otay100% (2)
- 9 - Georges Perec Linfra-OrdinaireDocument2 pagini9 - Georges Perec Linfra-Ordinaireapi-355356221Încă nu există evaluări
- Que Faire Jean Luc Nancy 2016 PDFDocument67 paginiQue Faire Jean Luc Nancy 2016 PDFAnonymous SY6vMNzYÎncă nu există evaluări
- Le Dernier Qui S'en Va Éteint La Lumière - Paul JorionDocument267 paginiLe Dernier Qui S'en Va Éteint La Lumière - Paul Jorionmarkorel100% (3)
- Sentinel UFO News - 002Document50 paginiSentinel UFO News - 002wxcvbnnbvcxw100% (1)
- Lettre A La Generation Qui Va T - Raphael GlucksmannDocument107 paginiLettre A La Generation Qui Va T - Raphael Glucksmannsidikouaboubakar33100% (1)
- Émile CohéDocument16 paginiÉmile CohéKhaledBouchoucha100% (1)
- Experiences de Mort Imminente La Preuve ImpossibleDocument13 paginiExperiences de Mort Imminente La Preuve ImpossibleMohamed DoumiÎncă nu există evaluări
- Comprendre Le Processus Du TotalitarismeDocument199 paginiComprendre Le Processus Du TotalitarismePhilÎncă nu există evaluări
- France-La Vie LitteraireDocument393 paginiFrance-La Vie LitteraireAbel MembradoÎncă nu există evaluări
- Dun Robert - Les Catacombes de La Libre Pensée (Ebook French, Race Blanche, Clan9, Skinheads, KKK, 88Document170 paginiDun Robert - Les Catacombes de La Libre Pensée (Ebook French, Race Blanche, Clan9, Skinheads, KKK, 88Ali LapaixÎncă nu există evaluări
- En Quoi Le Mal Nous Rend Plus Humain ?Document360 paginiEn Quoi Le Mal Nous Rend Plus Humain ?Christine MarsanÎncă nu există evaluări
- Au-Delà de L'impossible by Didier Van CauwelaertDocument209 paginiAu-Delà de L'impossible by Didier Van CauwelaertBeni BenitoÎncă nu există evaluări
- Grille D'auto-Évaluation CollègeDocument2 paginiGrille D'auto-Évaluation CollègeFranceinfo100% (4)
- L'interconnexion Électrique France-Espagne Par Le Golfe de GascogneDocument5 paginiL'interconnexion Électrique France-Espagne Par Le Golfe de GascogneFranceinfoÎncă nu există evaluări
- Défi de Janvier - Lettre Au MinistreDocument2 paginiDéfi de Janvier - Lettre Au MinistreFranceinfo100% (2)
- Déontologie Et Utilisation Des Réseaux Sociaux Numériques Dans L'éducation NationaleDocument30 paginiDéontologie Et Utilisation Des Réseaux Sociaux Numériques Dans L'éducation NationaleFranceinfoÎncă nu există evaluări
- CRC Maintenir en Emploi Les Seniors, Une Proposition en RuptureDocument2 paginiCRC Maintenir en Emploi Les Seniors, Une Proposition en RuptureFranceinfoÎncă nu există evaluări
- Note 2 - Comment Maintenir Les Seniors en EmploiDocument31 paginiNote 2 - Comment Maintenir Les Seniors en EmploiFranceinfoÎncă nu există evaluări
- Note 1 - Maintien en Emploi Des SeniorsDocument16 paginiNote 1 - Maintien en Emploi Des SeniorsFranceinfoÎncă nu există evaluări
- Orpea / Note de Mission IGAS IGFDocument2 paginiOrpea / Note de Mission IGAS IGFFranceinfoÎncă nu există evaluări
- Débattre Coûte Que Coûte La Réforme Des Retraites Et Ses Critiques Dans La Presse Et Sur Les Médias SociauxDocument35 paginiDébattre Coûte Que Coûte La Réforme Des Retraites Et Ses Critiques Dans La Presse Et Sur Les Médias SociauxFranceinfoÎncă nu există evaluări
- Appel À Témoins de La Préfecture de Police de ParisDocument3 paginiAppel À Témoins de La Préfecture de Police de ParisFranceinfoÎncă nu există evaluări
- Nombre de GynécologuesDocument9 paginiNombre de GynécologuesFranceinfoÎncă nu există evaluări
- Affaire Adama Traoré: Lettre Envoyée Au Gouvernement Français Du Haut-Commissariat Des Nations Unies Aux Droits de L'hommeDocument8 paginiAffaire Adama Traoré: Lettre Envoyée Au Gouvernement Français Du Haut-Commissariat Des Nations Unies Aux Droits de L'hommeFranceinfoÎncă nu există evaluări
- Délibération C'Kel ProdDocument4 paginiDélibération C'Kel ProdFranceinfoÎncă nu există evaluări
- Lettre Circulaire de l'UEFA N° 51Document4 paginiLettre Circulaire de l'UEFA N° 51FranceinfoÎncă nu există evaluări
- Document HuffPost - Les 318 Héros Issus de La Diversité Que Macron Veut HonorerDocument18 paginiDocument HuffPost - Les 318 Héros Issus de La Diversité Que Macron Veut HonorerLe HuffPost100% (3)
- Crises Sanitaires Et Outils Numériques: Répondre Avec Efficacité Pour Retrouver Nos LibertésDocument145 paginiCrises Sanitaires Et Outils Numériques: Répondre Avec Efficacité Pour Retrouver Nos LibertésFranceinfo100% (3)
- Etude Sur La Survie Des Personnes Atteintes de Cancer en France Métropolitaine 1989-2018Document20 paginiEtude Sur La Survie Des Personnes Atteintes de Cancer en France Métropolitaine 1989-2018FranceinfoÎncă nu există evaluări
- Information Délivrée Aux Parents Concernant La Vaccination Des Adolescents Âgés de Plus de 12 AnsDocument2 paginiInformation Délivrée Aux Parents Concernant La Vaccination Des Adolescents Âgés de Plus de 12 AnsFranceinfoÎncă nu există evaluări
- Carte Des Arrêtés de Limitation Des Usages de L'eau, Du 11 Août 2020.Document1 paginăCarte Des Arrêtés de Limitation Des Usages de L'eau, Du 11 Août 2020.FranceinfoÎncă nu există evaluări
- Lettre Ouverte - "Ce Dont Nous Avons Besoin, C'est de Travailler"Document2 paginiLettre Ouverte - "Ce Dont Nous Avons Besoin, C'est de Travailler"FranceinfoÎncă nu există evaluări
- Etude Covid-19 D'admicalDocument40 paginiEtude Covid-19 D'admicalFranceinfoÎncă nu există evaluări
- Etude Sur Les Mines de Potasse D'alsaceDocument13 paginiEtude Sur Les Mines de Potasse D'alsaceFranceinfoÎncă nu există evaluări
- Le Journal Des Enfants (Déconfinés) Des Livres, Chapitre 16Document4 paginiLe Journal Des Enfants (Déconfinés) Des Livres, Chapitre 16FranceinfoÎncă nu există evaluări
- Didier Franck Et La Dramatique Des PhénomènesDocument9 paginiDidier Franck Et La Dramatique Des PhénomènesGKF1789Încă nu există evaluări
- Dieu Sans L'êtreDocument144 paginiDieu Sans L'êtredavid_colmenares_420% (5)
- Etre Devenir 2mark HalevyDocument296 paginiEtre Devenir 2mark Halevydexterite99Încă nu există evaluări
- A Quoi Sert La Philosophie-François DagognetDocument34 paginiA Quoi Sert La Philosophie-François DagognetTaïeb JlassiÎncă nu există evaluări
- Le Crépuscule Des Idoles Nietzsche 1888 Devoir 4 ELEVESDocument3 paginiLe Crépuscule Des Idoles Nietzsche 1888 Devoir 4 ELEVESMatteo FarahÎncă nu există evaluări
- Cometti, Morizot, Pouivet - Questions D'esthétiqueDocument116 paginiCometti, Morizot, Pouivet - Questions D'esthétiqueJoãoCamilloPenna100% (1)
- Recueil PhilosophieDocument31 paginiRecueil Philosophieraoul yankam100% (4)
- Le Corps Comme Garant Du RéelDocument11 paginiLe Corps Comme Garant Du Réelhassan_hamoÎncă nu există evaluări
- Nietzche PeguyDocument45 paginiNietzche PeguyduckbannyÎncă nu există evaluări
- Georges Palante - La Sensibilité IndividualisteDocument145 paginiGeorges Palante - La Sensibilité IndividualisteParresiades El CínicoÎncă nu există evaluări
- Traductions Et Métamorphoses. À Propos de Sátántangó de Béla Tarr de SDocument6 paginiTraductions Et Métamorphoses. À Propos de Sátántangó de Béla Tarr de SMarguetÎncă nu există evaluări
- DSPC Nietzsche Dieu Est MortDocument2 paginiDSPC Nietzsche Dieu Est MortolivuaÎncă nu există evaluări
- Le Concept de Généalogie de NZDocument18 paginiLe Concept de Généalogie de NZDavid Antonio BastidasÎncă nu există evaluări
- La Quête - Arnaud LANDREAUDocument69 paginiLa Quête - Arnaud LANDREAUromainlangeÎncă nu există evaluări
- Jean Lacoste - La Philosophie Au 20ème SiècleDocument254 paginiJean Lacoste - La Philosophie Au 20ème SièclelamgariÎncă nu există evaluări
- Blondel Les Metaphores Vie Du Corps BlondelDocument6 paginiBlondel Les Metaphores Vie Du Corps BlondelJaime Sologuren LópezÎncă nu există evaluări
- Clément Rosset - Logique Du PireDocument86 paginiClément Rosset - Logique Du Piretokki01Încă nu există evaluări
- Le Symbolisme, Résumé.Document9 paginiLe Symbolisme, Résumé.Duilio BoscoÎncă nu există evaluări
- Femme Diabolisee vs. Femme IdealiseeDocument26 paginiFemme Diabolisee vs. Femme Idealiseeconstantinescu ancaÎncă nu există evaluări
- L'UNEBEVUE Revue de Psychanalyse Nº 12 - Dispositifs, Agencements, MontagesDocument212 paginiL'UNEBEVUE Revue de Psychanalyse Nº 12 - Dispositifs, Agencements, MontagesRui MascarenhasÎncă nu există evaluări
- Granel - Jacques Derrida Et La Rature de L'origineDocument13 paginiGranel - Jacques Derrida Et La Rature de L'origineDaniel CifuentesÎncă nu există evaluări
- Scarlett LE PROBLÈME DU LANGAGE CHEZ NIETZSCHEDocument22 paginiScarlett LE PROBLÈME DU LANGAGE CHEZ NIETZSCHECéliaBenvenhoÎncă nu există evaluări
- Actes Colloque Bernard CHARBONNEAU Habiter La Terre SETDocument180 paginiActes Colloque Bernard CHARBONNEAU Habiter La Terre SETruivalenseÎncă nu există evaluări
- Albert-Camus-soleil-et-ombre-by-Grenier-Roger-Grenier-Roger-z-lib.org_Document312 paginiAlbert-Camus-soleil-et-ombre-by-Grenier-Roger-Grenier-Roger-z-lib.org_Almoustapha Amadou Saïdou DjimbaÎncă nu există evaluări
- Citations de Nietzsche Expliquées by Marc Halévy PDFDocument201 paginiCitations de Nietzsche Expliquées by Marc Halévy PDFLëanahtan Yma Yhadnifazar100% (1)
- Jacques Derrida - L'animal Que Donc Je Suis-Galilée (2006) - CompressedDocument234 paginiJacques Derrida - L'animal Que Donc Je Suis-Galilée (2006) - CompressedImanol Lopez100% (1)
- La Notion de Vérité en PhilosophieDocument10 paginiLa Notion de Vérité en Philosophiebeebac2009Încă nu există evaluări
- 10 - Iuliana Pastin - La Solitude de L Homme Moderne Un Probleme PhilosophiqueDocument10 pagini10 - Iuliana Pastin - La Solitude de L Homme Moderne Un Probleme PhilosophiquegeorgetatufisÎncă nu există evaluări
- Jacques Derrida - Otobiographies - L'Enseignement de Nietzsche Et La Politique Du Nom Propre (2005, Editions Galilée)Document132 paginiJacques Derrida - Otobiographies - L'Enseignement de Nietzsche Et La Politique Du Nom Propre (2005, Editions Galilée)ronaldopelli100% (1)
- De L'âme À La Psyché Lou Andreas-Salomé Et La Question de La Nature Humaine (Isabelle Mons, Dans Mil Neuf Cent. Revue D'histoire Intellectuelle 20041 (N° 22)Document19 paginiDe L'âme À La Psyché Lou Andreas-Salomé Et La Question de La Nature Humaine (Isabelle Mons, Dans Mil Neuf Cent. Revue D'histoire Intellectuelle 20041 (N° 22)aminickÎncă nu există evaluări