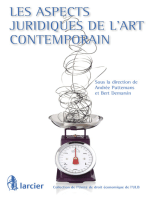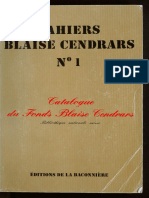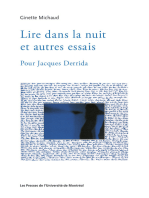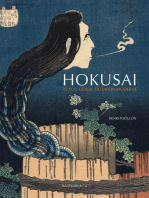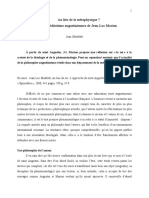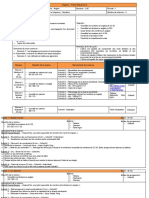Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
LEmotion Puissance de La LittErature
Încărcat de
Asher GutkindDrepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
LEmotion Puissance de La LittErature
Încărcat de
Asher GutkindDrepturi de autor:
Formate disponibile
L’Émotion, puissance de
la littérature ?
Textes réunis et présentés par
Emmanuel Bouju et Alexandre Gefen
p r e s s e s u n i v e r s i ta i r e s d e b o r d e a u x
Modernites34.indd 1 19/09/12 11:19
Modernités
Comité international de lecture
Jacques Dubois, professeur à l’université de Liège, Belgique
Pierre Glaudes, professeur à l’université Paris-Sorbonne, France
Laurent Jenny, professeur à l’université de Genève, Suisse
Sandra Laugier, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
France
Akira Mizubayashi, professeur à l’université de Sophia de Tokyo,
Japon
Jacques Neefs, professeur à la Johns Hopkins University, États-Unis
Michael Sheringham, professeur à All Souls College, University of
Oxford, Royaume-Uni
Ce volume est publié avec le soutien de l’équipe d’accueil « Textes,
littératures : écritures et modèles » EA 4195 (TELEM) de l’université
Bordeaux 3 et du projet « Les Pouvoirs de l’art. Expérience esthétique,
émotions, savoirs, comportements », soutenu par l’Agence nationale de
la recherche. Nous tenons également à remercier Éric Thiébaud, qui
s’est chargé de la préparation du texte.
Modernites34.indd 2 19/09/12 11:19
SOMMAIRE
Emmanuel Bouju et Alexandre Gefen, Introduction.......................................... 5
I – PERSPECTIVES DISCIPLINAIRES :
SENSIBILITÉ, IMAGINATION, ÉTHIQUE
Sandrine Darsel, Imagination narrative, émotions et éthique....................... 13
Maria O’Sullivan, Barthes, art et émotion................................................................35
Anne Vincent-Buffault,
Sensibilité et insensibilité : des larmes à l’indifférence........................................ 51
Jean-Pierre Martin,
Ces émotions à fleur de peau, sans nom pour les désigner................................. 73
Martine Boyer-Weinmann, Thymotique d’une passion ordinaire :
en quoi la colère est-elle littérairement féconde ?....................................................85
Frédérique Leichter-Flack,
Une question de vie ou de mort ? Des usages éthiques
de l’émotion dans la fiction............................................................................................... 101
II – PERSPECTIVES GÉNÉRIQUES :
EMPATHIE, AFFECTIONS, DYNAMIQUE
Jenefer Robinson,
L’empathie, l’expression, et l’expressivité dans la poésie lyrique................. 119
Michel Collot, « Cette émotion appelée poésie » (Pierre Reverdy)............ 131
Élisabeth Rallo Ditche,
Voix et émotions dans Daniel Deronda de George Eliot................................... 147
Maryline Heck,
Les affects entre parenthèses : W ou le souvenir d’enfance,
de Georges Perec.................................................................................................................... 161
Élisabeth Cardonne-Arlyck, Entre humeur et émotion :
la mélancolie mobile de Jacques Roubaud et W. G. Sebald..............................173
Frédérique Toudoire-Surlapierre,
La critique : ou Les stratégies de l’émotion.............................................................. 191
Les directeurs........................................................................................................................ 212
Modernites34.indd 3 19/09/12 11:19
Modernites34.indd 4 19/09/12 11:19
Introduction
« Je ne crois pas aux fantômes, mais j’en ai peur », disait la marquise
du Deffand. Comment se fait-il que nous puissions avoir peur ou nous
enthousiasmer en compagnie d’un personnage de fiction dont nous
savons pertinemment le caractère illusoire ? Pourquoi pleure-t-on au
théâtre, et de quelle nature sont nos larmes ? Cette illusion affective
n’a cessé de troubler la pensée du littéraire ; et qu’il s’agisse de s’en
inquiéter (comme Platon) ou de s’y intéresser (comme Aristote), on
ne saurait contester qu’en littérature particulièrement, « l’usage des
émotions permet une sorte de contrôle temporaire de l’état mental
d’autrui » – comme l’affirme ce grand historien des sentiments qu’est
William M. Reddy. Cette question, un temps éclipsée par le dédain de
la recherche littéraire pour des problématiques apparaissant comme
insuffisamment formalistes et trop « psychologisantes », a retrouvé de
la vigueur ces dernières années, en profitant de cadres descriptifs et
de vocabulaires capables de rendre compte du travail des émotions –
que ceux-ci soient issus de l’ancienne rhétorique des passions et de son
analyse du movere, de la philosophie morale, de la phénoménologie,
de l’anthropologie ou des sciences cognitives.
Nombreuses sont, dans ce cadre, les interrogations difficiles
auxquelles confronter l’analyse. Existe-t-il des émotions propres à
l’expérience littéraire – qui pourraient justifier la formule de Jules
Renard, évoquant un « homme sans cœur, qui n’a eu que des émotions
littéraires » ? Comment penser l’émotion fictionnelle, ses limites et ses
débordements ? Comment évaluer l’incidence sur nos comportements
des savoirs produits ou des exemples instanciés par la littérature
Modernites34.indd 5 19/09/12 11:19
6 Emmanuel Bouju et Alexandre Gefen
sans prendre en compte leur puissance d’affection ? Il est désormais
impossible de penser la réception, les genres, les valeurs et l’idée
même de littérature sans s’intéresser à l’histoire des sensibilités et
de leurs manifestations sociales ; tout comme il est inutile de décrire
les formes de partage ou de discordance du goût sans penser les
mécanismes subjectifs de transfert et de distanciation affectifs. Au
contraire, la puissance affective semble être au centre du programme
de la littérature moderne : faussement étouffée à l’âge de l’autonomie
de la littérature, elle constitue (peut-être par défaut ?) une forme de
réengagement subreptice de la littérature dans le monde, une modalité
d’action dont les écrivains soulignent la paradoxale dimension
éthique, voire politique ; à l’instar d’autres expériences artistiques,
les esthétiques empathiques ne laissent pas de revenir sur les troubles
de notre mémoire, sur les dysfonctionnements de nos communautés,
sur la vulnérabilité psychique et sociale. Usant des armes de la
compassion comme de l’ironie, elles réintroduisent de l’émotion dans
les événements hors de portée ou, au contraire, mettent à distance
l’immédiateté de l’histoire en en déplaçant le point de vue sensible.
Ces interrogations ont présidé à l’organisation d’une journée
d’étude à l’École normale supérieure – Paris, dans le cadre conjoint
des activités du Groupe phi (CELLAM, Rennes 2) et de l’équipe
TELEM (Bordeaux 3), puis ont guidé le séminaire qui a continué de
se tenir au sein de cette dernière équipe. Ce sont certains des textes
communiqués dans ce cadre qui forment le présent volume, organisé
en deux parties.
*
La première série des articles réunis offre une gamme de
perspectives disciplinaires sur les usages de la sensibilité, la puissance
de l’imagination et la valeur éthique de l’émotion littéraire.
Dans une perspective de philosophie morale, Sandrine Darsel
examine tout d’abord les diverses théories qui s’affrontent concernant
la question du rôle éthique ou de la valeur éthique des œuvres d’art
narratif, et évalue la place que prennent les émotions dans ce débat ;
elle plaide pour une thèse performative, dite « optimiste disjonctive » –
laquelle « enchevêtre » conception théorique et conception émotiviste,
au profit d’une mobilisation des tensions émotionnelles et cognitives
dans l’expérience par cas. Il s’agit alors de retrouver dans l’expérience
esthétique ce « moment d’aventure, de performance, d’engagement et
d’improvisation morale » que sollicite la collaboration des sens, de
l’imagination, des émotions et de la raison.
Modernites34.indd 6 19/09/12 11:19
Introduction 7
Relevant d’une perspective d’esthétique générale, le second article
s’attache quant à lui, à partir de Barthes, à l’émotion inscrite dans
le cadre d’une opération de « découpage », dont Maria O’Sullivan
identifie la nature au sein des « arts visuels » que sont le théâtre et le
« tableau » : liée – comme dans le cas de la littérature en général ou
de la photographie – au statut d’« opérateur de gestes1 » de ces arts,
la force émotive (ou « non intellective ») de l’objet d’art ne découle pas
tant du geste de délimitation et d’encadrement qui l’accompagne, que
de ce que ce geste, inattendu et désiré, laisse à ses bords.
Du point de vue cette fois de la sociologie et de l’histoire, il s’agit,
pour Anne Vincent-Buffault (« Sensibilité et insensibilité : des
larmes à l’indifférence »), de considérer l’émotion non comme un état
psychique interne et individuel, mais comme une production sociale,
à laquelle contribuent les régimes d’écriture littéraire et intime : non
seulement en manifestant le caractère approprié ou inapproprié, à un
moment et en un lieu donnés, des expressions de la sensibilité, mais
aussi et surtout en en pratiquant la configuration expérimentale et
en en instituant le sens. L’exemple est donné des formes subjectives de
l’indifférence que la littérature (Balzac, Heine, Musil) et le journal
(Amiel) ont le pouvoir de rendre sensibles en les accordant à certains
moments de développement du régime démocratique.
Quant aux deux articles suivants, ils relèvent résolument d’une
perspective d’anthropologie littéraire et de poétique des affects.
Dans « Ces émotions à fleur de peau, sans nom pour les désigner »,
Jean-Pierre M artin effectue, à la manière remarquable qui est la
sienne, un plaidoyer en faveur d’un pouvoir singulier de la littérature
de récuser les codes du pathétique, la grammaire de l’émotion ou
l’algèbre des sentiments : dans l’« impouvoir » de la littérature de
répertorier la violence des sentiments, dans sa résistance à l’« autorité
du discours tenu », les écrivains comme Proust ou Sarraute trouvent le
moyen de définir une anthropologie littéraire de l’émotion, fondée sur
l’appréhension du « fugace » ou de l’« infinitésimal ».
Martine Boyer-Weinmann, quant à elle, propose de façon non moins
frappante la « thymotique d’une passion ordinaire » : en développant,
à la suite de Sartre, Barthes et Sloterdijk, les lignes directrices
d’une « pensée littéraire de la colère », elle examine l’« efficace
pragmatique » d’une configuration textuelle des passions par laquelle
1 Roland Barthes, « Cy Twombly ou Non multa sed multum » [1979], in L’Obvie et l’Obtus [1982]
et OC IV, p. 706.
Modernites34.indd 7 19/09/12 11:19
8 Emmanuel Bouju et Alexandre Gefen
l’« énergie thymotique » de la littérature (son thymos, son souffle)
trouve à s’exercer pleinement.
Enfin, dans son article sur les usages éthiques de l’émotion dans
la fiction, Frédérique Leichter-Flack revient à la philosophie morale
par le biais de la pragmatique littéraire, et observe, comme dans l’essai
qu’elle vient de publier2, la façon dont l’émotion sert d’« opérateur de
visibilité éthique » – la façon dont elle ouvre un espace de débat « en
obligeant à voir un problème qui était pourtant déjà là, mais qu’on
ne se posait pas ». À partir d’exemples tirés de Quatrevingt-treize et
des Misérables de Hugo, ainsi que des Justes de Camus, l’auteur de
l’article souligne le risque que comporte en elle-même cette fonction de
l’émotion en régime littéraire : « celui d’argumenter trop loin, c’est-à-
dire de brouiller la perception rationnelle des enjeux, en transformant
tout en une question de vie ou de mort ».
*
Dans un second temps, il s’agit plutôt de privilégier la diversité des
perspectives d’ordre générique, en observant, par une série d’entrées
qui n’ont pas la prétention d’être exhaustives ni systématiques, la
façon dont poésie, roman, autobiographie, essai et critique sollicitent
chacun à sa manière, en une stratégie volontaire, un certain régime
de l’émotion.
Les deux premiers articles examinent le rapport de la poésie lyrique
à l’empathie.
Pour Jenefer Robinson, qui se penche sur les pratiques des poètes
romantiques français et anglais, « l’expression n’est pas la même chose
que l’expressivité », et il importe de mesurer le degré d’expressivité de
l’expression lyrique aux phénomènes d’empathie suscités par le poème.
Prônant une sorte d’économie graduée de l’émotion lyrique, l’auteur
privilégie sans hésitation aucune, dans le cadre du moins de la lyrique
romantique, le critère de l’empathie lectoriale.
Pour Michel Collot, cette question demande à être évaluée tout
autrement, dès lors du moins qu’elle s’établit par la médiation de l’art
et de la pensée de Pierre Reverdy – dont l’auteur reprend et examine,
dès le titre de son article (« Cette émotion appelée poésie »), citation
d’essais et de poèmes. Tablant pour sa part sur une identification
pleine et entière entre l’émotion et la poésie, Michel Collot veut démêler
l’apparent écart, chez Reverdy, entre théorie et pratique, et montrer
2 Frédérique L eichter-F lack, Le Laboratoire des cas de conscience, Paris, Alma éditeur, coll.
« Essai / Philosophie », 2012.
Modernites34.indd 8 19/09/12 11:19
Introduction 9
combien l’opposition reverdienne à tout pathétique de l’émotion
n’exclut pas l’« extraversion » lyrique. Prônant, conformément à
l’étymologie, une conception essentiellement dynamique de l’émotion,
la poésie de Reverdy est « un lyrisme de la réalité ».
La question du lyrisme demeure au centre de l’article d’Élisabeth
R allo Ditche, mais elle s’est déplacée de la poésie au roman, et de
Reverdy à George Eliot : selon l’auteur de l’article, l’originalité de la
grande romancière anglaise (l’une des plus importantes, c’est certain,
du xixe siècle en Europe) est d’avoir voulu faire, dans Daniel Deronda,
du « langage musical », et plus précisément de la voix – « chantée et
parlée » – non seulement le vecteur des émotions de l’individualité
moderne, mais aussi « la condition de sa qualité morale ».
C’est là l’expression d’un pathos moral auquel Perec contrevient quant
à lui frontalement, en mettant « les affects entre parenthèses », selon le
titre de l’article de Maryline Heck : partant de l’alliance paradoxale,
dont témoigne W ou le souvenir d’enfance, entre « neutralité du style »
et profondeur de l’émotion, elle propose, entre poétique et psychologie,
de lire ce paradoxe comme « celui de la “voix blanche”, cette voix que
neutralise précisément un trop-plein d’émotions ». Opérant comme
une contrainte typiquement perecquienne, la violente neutralisation
textuelle des émotions servirait, à son tour, d’instrument de mesure
d’une puissance secrète des affects.
Puissance héritée des affects, force thymique et humorale, pouvoir
poïétique des affections : l’émotion se place au centre de certaines
entreprises textuelles, à l’exemple de cette « mélancolie mobile » qui
caractérise aussi bien l’œuvre de Jacques Roubaud que celle de W.
G. Sebald – selon Élisabeth Cardonne-A rlyck. Comme le montre
sa belle réflexion comparatiste, « une fois l’émotion perdue, reste
l’humeur de la perte, la mélancolie » ; et c’est cette mélancolie,
obsessionnelle et vitale à la fois, qui contribue à définir le rythme et
les effets d’œuvres capables de définir au plus juste « la ductilité des
affects qui pénètrent l’imagination ».
« Mouvement, force, masse, sortie hors de soi » : émotion et
puissance allient leur étymologie tout en s’opposant symétriquement,
selon Frédérique Toudoire-Surlapierre, qui propose, dans l’article
final de ce recueil, d’observer la façon dont la critique littéraire
« joue sur les deux tableaux », en profitant du « désir toujours latent
d’institutionnalisation des émotions de lecture » et en tirant d’elles sa
notoriété, ses valeurs et ses codes, par le biais de toute une « politique
de la représentation », selon l’expression célèbre de Louis Marin.
Modernites34.indd 9 19/09/12 11:19
10 Emmanuelle Bouju et Alexandre Gefen
Considérant que « l’affect (l’émotion) est autant affaire de sensibilité
(capacité à être affecté) que capacité d’agir ou de commander, c’est-à-
dire d’affecter de manière contraignante », l’auteur de l’article s’appuie
essentiellement sur les textes de Sartre et de Barthes pour juger à la
fois de l’efficacité stratégique et de la dimension pulsionnelle que revêt
l’alliance entre émotion et raison, génératrice de pensée critique.
*
Aussi pourra-t-on, nous l’espérons, considérer au terme de ce
parcours que la question des émotions autorisées ou provoquées par
l’art semble offrir désormais à l’analyse littéraire un terrain de dialogue
privilégié avec d’autres disciplines : elle oblige à faire le pont entre
les savoirs endogènes sur les affects littéraires– tels que les diverses
rhétoriques et poétiques les ont déployés – et les savoirs exogènes,
constitués aussi bien par la philosophie, la sociologie et l’anthropologie
que par les neurosciences ou la psychologie. Une analyse prenant en
compte l’impact affectif de la littérature n’est donc pas une analyse
émotiviste ou empathique, mais une lecture critique des médiations
émotives par lesquelles la littérature concourt à l’expérimentation
concrète et critique de valeurs et de savoirs abstraits. Elle n’est pas
le signe d’un moment postidéologique ou post-théorique : en revenant
sur le vocabulaire classique des passions et des humeurs, comme en
observant le réemploi moderne des concepts d’empathie, d’attention,
de catharsis, d’identification ou encore d’enaction, il s’agit toujours,
prudemment mais résolument, de penser l’œuvre de réflexion et
d’action spécifique à la littérature.
Emmanuel Bouju et Alexandre Gefen
Université Rennes 2 / CNRS – Université Paris-Sorbonne (CELLF)
Modernites34.indd 10 19/09/12 11:19
I
Perspectives disciplinaires :
sensibilité, imagination, éthique
Modernites34.indd 11 19/09/12 11:19
Modernites34.indd 12 19/09/12 11:19
Imagination narrative, émotions et éthique
J’entends la notion d’« éthique » en un sens aristotélicien de
disposition et d’habitude à bien agir. Un agent est vertueux s’il exerce,
met en œuvre, développe ses vertus pratiques dans la durée et non de
manière ponctuelle. Le caractère vertueux ou vicieux d’un agent se
révèle dans ses choix pratiques, sa capacité à saisir les valeurs et les
normes en question, sa faculté à établir des hiérarchies évaluatives,
l’ajustement de ses émotions, la compréhension éthique d’une situation,
etc. Or les éléments clefs qui confèrent du sens à nos existences et
déterminent notre compréhension du monde et des autres ne sont pas
encadrés de manière nette et rigide par une structure idéologique,
religieuse ou sociale préexistante. La rationalité morale est en partie à
construire ou malléable.
Le problème qui se pose pour l’éducation morale est le suivant :
comment devenir vertueux ? À cette question, aucune partition
morale ne peut être donnée (le terme « partition » est ici entendu
au sens goodmanien de système symbolique répondant aux critères
Modernites34.indd 13 19/09/12 11:19
14 Sandrine Darsel
de la notationalité1). Les théories morales, les traités éthiques ou
même les dictons, les conseils ou impératifs moraux ne permettent
pas de déterminer de manière précise, univoque, et sans ambiguïté ni
contradiction, leur domaine d’interprétation, c’est-à-dire le champ de
l’action morale. Ces descriptions fonctionnent seulement comme guides
théoriques pour l’agent ou encore comme témoins de la vie pratique.
Le problème de l’éducation morale reste donc entier.
Et c’est ici que les œuvres d’art, et en particulier les œuvres d’art
narratives, ont un rôle à jouer : elles nous apprendraient sur nous-
mêmes, les autres et le monde, et nous révèleraient la manière dont les
dilemmes moraux émergent, dont les histoires de vie sont construites
et les conflits de valeur sont résolus, suspendus ou analysés. Ainsi, les
œuvres d’art pourraient être un véritable guide existentiel.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de comprendre et d’analyser l’importance
éthique de l’art et d’en saisir les enjeux, la méfiance quant au rôle
éthique possible des œuvres d’art prédomine. Cette attitude découle
de la distinction franche, voire de l’opposition entre l’esthétique et
l’éthique. Cette séparation repose sur les dichotomies suivantes : fiction
versus réalité, subjectivité versus objectivité, spectateur versus acteur,
fantaisie artistique versus rigueur morale, expérience esthétique
singulière versus jugement moral général… Cette opposition se fait en
faveur de la théorie morale : même si elle ne permet pas de déterminer
de manière univoque la pratique morale, il n’en reste pas moins que
c’est l’un des éléments essentiels de l’éducation morale, combiné avec
l’expérience de l’agent lui-même. La rigueur des réflexions théoriques
est mise en avant. Les œuvres d’art sont au mieux considérées comme
simple illustration de la théorie morale générale, au pire disqualifiées.
1 Je choisis ici d’utiliser les distinctions logiques de fonctionnement symbolique établies par
Nelson Goodman notamment dans Langages de l’art. Il ne s’agit pas de reprendre l’ensemble de
son système et de ses thèses, mais plus simplement de considérer le travail logique goodmanien
autour de la question de la notationalité comme un outil de compréhension pertinent, clair et
opératoire. Je rappelle que Goodman distingue les systèmes notationnels par quelques critères
logiques :
– le réquisit syntaxique de disjointure : toutes les répliques d’une marque déterminée sont
équivalentes du point de vue syntaxique ;
– le réquisit de la différenciation finie : aucune marque ne peut appartenir à plus d’un carac-
tère ;
– le premier réquisit sémantique pour un système notationnel est qu’il soit non ambigu : une
marque est dite ambiguë si elle possède des concordants différents à des moments ou contextes
différents ; une marque n’est pas ambiguë si le rapport de concordance est invariant ;
– le deuxième réquisit sémantique est celui de la disjointure sémantique ;
– enfin, le troisième réquisit sémantique est celui de la différenciation finie. Une marque-de-
note n’a pas une multiplicité de classes-de-concordance.
Modernites34.indd 14 19/09/12 11:19
Imagination narrative, émotions et éthique 15
Pour autant, un simple survol anthropologique montre que les
hommes attachent à l’art un rôle particulier et prédominant dans leur
vie pratique et morale. La réhabilitation éthique de l’art s’articule
autour de deux arguments :
– soit l’on insiste sur les traits génériques des œuvres d’art, leur
contenu moral théorique ;
– soit l’on précise que les œuvres d’art ont une valeur
instrumentale et non une valeur éthique en soi (illustration,
rhétorique, pédagogie).
Il s’agira ici de réfléchir sur le rôle éthique des œuvres d’art dans
l’éducation morale, et sur ce qu’il nous apprend de la philosophie de
l’action et de la réflexion morale. Autrement dit, quelle est la teneur
éthique des œuvres d’art ? Peuvent-elles véritablement être reconnues
dans le processus de l’éducation morale ? N’est-ce pas une forme de
laxisme que de faire appel aux œuvres d’art ? In fine, cela ne constitue-
t-il pas une erreur de catégorie, au sens où art et morale, esthétique et
éthique ne pourraient être que séparés ? Peut-on dire, en allant plus
loin, que la reconnaissance de l’art dans l’éducation morale est source
d’erreurs et qu’elle est nocive du point de vue pratique ? À l’inverse, si
les œuvres d’art jouent un rôle éthique, en quoi consiste leur apport
spécifique ? Leur teneur éthique n’est-elle pas simplement un bénéfice
instrumental pouvant être obtenu par d’autres moyens et de manière
plus fiable ?
En réponse à ces multiples problèmes, plusieurs options s’affrontent :
1. le scepticisme esthétique, qui repose sur l’autonomie des
œuvres d’art et de l’esthétique ;
2. le scepticisme moral, qui insiste sur l’immoralité des œuvres
d’art ;
3. l’optimisme moral, qui défend le caractère moral des œuvres
d’art ;
4. l’optimisme disjonctif, qui analyse la valeur morale possible
des œuvres d’art.
Il s’agira ici d’analyser les implications pratiques des œuvres d’art
par la défense de l’option disjonctive : l’objectif est de montrer que la
relation entre les œuvres d’art et l’éthique se joue moins dans le contenu
de l’œuvre que dans son activation, c’est-à-dire dans la réalisation –
entendue en un sens goodmanien – de l’œuvre par le public, à travers
la mobilisation de l’ensemble de ses facultés cognitives : la perception
multisensorielle de ces œuvres, l’imagination narrative, l’implication
Modernites34.indd 15 19/09/12 11:19
16 Sandrine Darsel
émotionnelle et la compréhension de leur sens complexe et multiple.
Ici, l’œuvre d’art n’est pas conçue comme une source d’exemples,
d’illustrations des raisonnements moraux, ni comme un moyen pour
apporter une solution définie aux conflits pratiques, pour propager
des certitudes éthiques ou pour transmettre un contenu moral
déterminé, comme le soulignent notamment Stanley Cavell2 et Martha
Nussbaum3. L’expérience réussie d’une œuvre d’art est un moment
d’aventure, de performance, d’engagement et d’improvisation morale
de la part du spectateur. Et c’est en cela que réside la valeur morale
possible des œuvres d’art.
Afin de défendre cette thèse, il s’agira dans un premier temps
d’établir la possibilité d’un rapport entre l’art et l’éthique. Dans
un deuxième temps, mon attention se portera sur le problème de
la valeur morale des œuvres d’art, par l’examen de deux options
concurrentes – la conception théorique et la conception émotiviste.
Enfin, je défendrai l’idée selon laquelle c’est l’expérience attentive
à la singularité de l’œuvre (qui sollicite à la fois des capacités
perceptuelles, émotionnelles, imaginatives et cognitives) qui participe
à notre formation morale. L’ensemble de cette analyse se focalisera sur
les arts narratifs, tels que la littérature, le cinéma, le théâtre, etc. Il
ne s’agit pas de réduire le lien entre l’art et l’éthique aux œuvres d’art
narratives, mais simplement de considérer la spécificité de ce lien et
de montrer la pertinence des arts narratifs pour l’éducation morale.
1. Considérations méthodologiques préalables
Avant d’analyser l’ensemble de ces problèmes au sujet du rapport
entre art et éthique, un point de méthode s’avère nécessaire. Alors
que l’exploration philosophique des arts reste souvent assujettie aux
questions proprement esthétiques (à propos, par exemple, du jugement
esthétique, de la valeur esthétique, des critères esthétiques, etc.), mon
objectif est de mettre en évidence la nécessité, l’utilité et la fertilité
d’une investigation philosophique impure des arts. Une philosophie
de l’art impure conteste l’idée selon laquelle l’esthétique constituerait
un domaine de réflexion autonome, indépendant des autres champs
philosophiques. Je propose ici d’ouvrir la philosophie de l’art à
l’éthique. Et loin de mettre à mal la spécificité de l’art, cette méthode
2 Stanley Cavell, À la recherche du bonheur : Hollywood et la comédie du remariage [1981],
trad. de l’anglais par Christian Fournier et Sandra Laugier, Paris, Cahiers du cinéma, 2009.
3 Martha Nussbaum, La Connaissance de l’amour : essais sur la philosophie et la littérature
[1990], trad. de l’anglais (États-Unis) par Solange Chavel, Paris, Éd. du Cerf, 2010.
Modernites34.indd 16 19/09/12 11:19
Imagination narrative, émotions et éthique 17
du décloisonnement permet d’en rendre compte. Autant dire qu’il ne
s’agit pas d’échapper aux questionnements supposés fondamentaux
sur la magie et les mystères qui entourent l’art en général, mais
plutôt de recentrer l’entreprise philosophique appliquée à l’art sur
ce qu’elle peut faire : elle ne peut pas remplacer ses objets (l’art, la
création et l’expérience artistiques), ni menacer leur existence ou
leur prestige, mais plus modestement analyser ce qui fait problème
philosophiquement.
En outre, la méthode utilisée sera doublement impure :
– non seulement elle ne se passe pas d’une réflexion philosophique
transversale ;
– mais d’autre part, ce sont les pratiques et croyances ordinaires
autour de l’art et des œuvres d’art qui constituent le cadre de
cette réflexion.
En effet, je défends une philosophie descriptive de l’art, laquelle se
distingue de deux attitudes :
– soit invoquer le « jugement de la foule » de manière dogmatique ;
– soit élever la philosophie à une superconnaissance, une
connaissance lucide d’un autre ordre que la connaissance
ordinaire, et qui pourrait bouleverser nos intuitions et pratiques
ordinaires.
La structure de nos pratiques, discours et pensées autour de
l’art implique des certitudes préalables non épistémiques (comme
l’indique Wittgenstein dans De la certitude). Celles-ci jouent un
rôle régulateur essentiel : ce sont des normes-en-contexte acceptées
dans des circonstances normales. La normativité de ces intuitions
préthéoriques suppose l’établissement d’un équilibre réfléchi entre
elles et les orientations philosophiques.
Autrement dit, si la philosophie ne consiste pas en un simple
inventaire des hypothèses variées possibles, étayées par des
argumentations complexes, mais en l’examen des raisons que nous
pouvons avoir d’assumer tel ou tel engagement ontologique, ces raisons
sont pourtant de divers ordres :
– logique (le principe de non-contradiction, par exemple) ;
– formel (le principe d’économie, selon lequel il ne faut pas
multiplier les entités plus qu’il n’en faut) ;
– scientifique (l’accord avec les avancées de la science) ;
Modernites34.indd 17 19/09/12 11:19
18 Sandrine Darsel
– esthétique (l’élégance d’une théorie simple ou la beauté d’une
conception originale) ;
– et enfin pratique (nos certitudes préalables et leur poids
relatif).
Toutefois, la contrainte du sens commun est indispensable pour une
investigation philosophique en art : les œuvres d’art sont des entités
relationnelles (quoique réelles) et supposent un ensemble complexe
de croyances et de pratiques. Bien sûr, il ne s’agit pas de coller de
manière aveugle à ce système ni de méconnaître les inconsistances, les
cas difficiles ou problématiques, ou encore la diversité des pratiques
(attachées à l’art et à telle ou telle forme artistique). Cependant,
l’enracinement des œuvres d’art dans cet enchevêtrement de
croyances et de pratiques constitue le point de départ et la contrainte
méthodologique principale pour toute enquête philosophique en art.
Ainsi, plusieurs intuitions, pratiques et croyances se rapportent au
problème envisagé ici : le rapport entre l’art et l’éthique.
• L’art est évalué moralement.
• Cette évaluation donne lieu à des désaccords.
• On attend parfois de l’art qu’il participe de l’éducation morale,
comme dans le cas de la littérature de jeunesse.
• On accuse aussi l’art d’être à la source de comportements
critiquables (on dit ainsi de certains films qu’ils banalisent la
violence, qu’ils font l’apologie de la guerre, du mensonge, etc.).
• Certaines œuvres d’art sont utilisées comme illustration pour
la pensée morale : par exemple, Le Choix de Sophie, de William
Styron, ou encore le mythe de Médée.
• Certaines catégories d’art sont plus utilisées que d’autres,
comme c’est le cas pour l’art narratif (littérature, cinéma,
théâtre).
• Enfin, on valorise les œuvres d’art dont on suppose qu’elles
ont une valeur morale.
• Mais en même temps on dévalorise les œuvres d’art jugées
moralisatrices.
Pour le philosophe descriptif, la tâche sera donc exigeante, puisqu’il
importe de donner sens à l’ensemble de ces croyances et pratiques
ordinaires qui se rapportent au problème particulier envisagé ici : le
rôle éthique des œuvres d’art.
Modernites34.indd 18 19/09/12 11:19
Imagination narrative, émotions et éthique 19
2. Art et éthique : une alliance impossible ?
La méfiance quant à la possibilité d’établir un rapport fécond entre
l’art et l’éthique prend deux voies argumentatives distinctes : la voie
esthétique ou la voie morale.
D’un côté, le scepticisme esthétique conteste la pertinence du fait
de parler des œuvres d’art en termes moraux. Cette contestation
repose sur le postulat de l’autonomie de l’art. Autrement dit,
l’esthétique et la réflexion philosophique sur l’art sont définies comme
un domaine indépendant. En ce sens, l’esthétique philosophique
prend essentiellement pour objet le sujet esthétique producteur et
récepteur. C’est à partir de ce point de vue théorique autour du sujet
esthétique que s’articulent la plupart des notions suivantes : le goût, le
génie, le critique, le beau et le sublime, les beaux-arts… L’esthétique
philosophique s’établit ainsi autour de distinctions duales afin de
cerner la spécificité de l’art : le plaisir/la connaissance, le sensible/
l’intellect, le génie artistique/la production technique, l’art/la science,
la contemplation esthétique/l’explication intellectuelle, et enfin, le
beau/le bien/le vrai.
L’œuvre d’art requiert une expérience pure et appelle une
interprétation exclusivement esthétique. Toute réflexion morale est
inappropriée. Dire du film de Lynch Une histoire vraie, de la pièce
de Shakespeare Hamlet ou du livre de jeunesse À la recherche du
bonheur, écrit par Juliette Saumande et illustré par Éric Puybaret,
des chansons de NTM, de la série télévisée La Petite Maison dans la
prairie, ou encore de l’ensemble de l’œuvre de Céline que ce sont des
œuvres d’art appelant une évaluation morale (positive ou négative),
c’est se méprendre sur ce que sont ces œuvres d’art : un ensemble
de mouvements et d’actions enregistrés (pour le cinéma) ou joués en
direct (pour le théâtre), un texte pour l’œuvre littéraire, une forme
pour l’image, un texte et un ensemble de sons ou de notes pour une
chanson. Autrement dit, l’expérience véritablement esthétique ne peut
et ne doit pas être assujettie à une quelconque réflexion morale.
Cette conception a l’avantage de rendre compte de l’intuition selon
laquelle l’art n’est pas un instrument de moralité et n’est pas envisagé
au vu de ses conséquences morales (effets sur le comportement) : l’art
n’a pas pour fonction d’avoir des effets moraux. Il n’aurait d’autre
finalité que lui-même, d’où le manifeste de « l’art pour l’art ». Puisque
les propriétés de l’œuvre sont ses propriétés formelles, l’appréciation
proprement esthétique repose uniquement sur le plaisir formel. D’où
la neutralisation de la responsabilité auctoriale. Toutefois, cette option
Modernites34.indd 19 19/09/12 11:19
20 Sandrine Darsel
invalide bon nombre des pratiques courantes autour des œuvres d’art
et ne rend pas compte du rôle moral (quoique non instrumental)
souvent accordé aux œuvres d’art. Par ailleurs, elle réduit l’œuvre
d’art et assèche la pratique interprétative4.
D’un autre côté, le scepticisme moral, hérité de Platon, insiste sur
l’immoralité des œuvres d’art. Ce n’est pas que l’art soit indépendant de
la morale, comme le suppose le scepticisme fort, c’est que l’art s’oppose
à la morale. Cette option situe l’art dans la sphère de l’immoral, du
vice, de la faute morale. Ce n’est qu’en termes négatifs que l’on peut
penser l’art moralement. Ce caractère vicieux de l’art s’explique de
deux manières. Soit l’art est immoral du fait d’un contenu immoral :
l’apologie de la violence dans le film Fight Club, la banalisation de
l’infidélité dans les livres de David Lodge, la contestation des valeurs
traditionnelles, telles que l’éducation, la prudence, la bienséance…,
l’esthétisation d’une sexualité débridée et rompant toute règle avec les
livres de Houellebecq ou la chanson de Nirvana Rape Me, l’affirmation
de propos racistes, les films pornographiques, les pièces de théâtre
vulgaires, etc. Soit l’art appelle des réponses et des sentiments
immoraux chez le spectateur : l’attachement et la sympathie pour des
êtres vicieux et/ou inhumains, comme dans le film La Chute, la pitié
pour des criminels, la distance par rapport aux vertus éthiques, la
déstabilisation de la personnalité par l’identification à un personnage
imaginaire, l’indifférence à l’égard de la violence…
Autrement dit, cette seconde conception sceptique, la voie morale,
est une injonction à ne pas prendre les œuvres d’art pour guide moral.
En effet, même si les œuvres d’art sont apparemment inoffensives,
aucune n’échappe à la sphère de l’immoralité : de manière générale,
l’art, règne des émotions, détourne du bien, règne de la raison droite.
Néanmoins, même si l’on s’accorde sur la possibilité d’œuvres d’art
immorales (soit du point de vue du contenu, soit du point de vue des
réponses appelées par l’œuvre), cela n’induit pas l’assimilation des
œuvres d’art au domaine du vice. Bien au contraire, on peut plutôt
penser que si certaines œuvres d’art ont une valeur morale négative,
d’autres possèdent une valeur morale positive. De plus, on peut
remettre en cause les conceptions implicites de l’art et de la morale
qui sous-tendent ce scepticisme moral. En effet, peut-on réduire l’art
à l’excitation émotionnelle et/ou à la déconstruction des valeurs ? Par
4 L’analyse critique de la position formaliste suppose d’explorer la distinction ontologique entre
les propriétés intrinsèques et extrinsèques, souvent confondue avec la distinction entre pro-
priétés réelles et projetées. Cette discussion essentielle dépasse largement le cadre de cet article
et mérite d’être examinée en tant que telle.
Modernites34.indd 20 19/09/12 11:19
Imagination narrative, émotions et éthique 21
ailleurs, comprendre la morale comme le règne de la droite raison,
n’est-ce pas manquer l’importance des émotions au cœur des attitudes
éthiques ? Enfin, l’opposition entre les émotions et la raison est-elle
tenable ?
L’optimisme moral s’oppose de manière radicale à l’option
précédente et considère a contrario que les œuvres d’art ont une
valeur morale positive. Cette conception utopique postule le caractère
émancipatoire de l’art. En ce sens, on peut penser à Schiller qui, dans les
Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, considère l’art comme
libérateur, permettant d’accéder à une vie libre et harmonieuse. Plus
généralement, il s’agit d’articuler la moralité des œuvres d’art avec la
création par l’œuvre d’un autre monde, le monde de l’art. L’art, qui
mobilise l’imagination, nous fait accéder au domaine du concevable,
du possible, de ce qui pourrait être. Or la possibilité est au fondement
du choix pratique, et c’est en ce sens que l’art est profondément et
essentiellement moral, quels que soient son type, son genre, sa forme,
son contenu5.
Néanmoins, cette analyse de l’art est problématique. D’une part,
elle confond le concept d’œuvre d’art et celui d’une bonne œuvre
d’art au sens où elle attache une dimension évaluative au concept
d’art. Par ailleurs, comment concilier, d’une part, l’apport moral
fondamental supposé de toutes les œuvres d’art, et d’autre part, les
contenus ou expériences contraires aux vertus, liés à certaines œuvres
d’art ? Enfin, si l’on considère souvent l’imagination comme un guide
pour l’acquisition d’une connaissance modale (au sens où ce qui est
imaginable serait possible et l’inimaginable, impossible, comme le
suppose Hume dans le Traité de la nature humaine), peut-on s’en
tenir à cette association apparente ?
3. L’optimisme disjonctif
Les œuvres d’art, en tant qu’artefacts culturels spécifiques,
peuvent avoir une valeur morale positive ou négative (quoique plus
ou moins importante suivant les œuvres d’art particulières). L’apport
moral est fonction de l’exemplarité de l’œuvre d’art. Certains cas
artistiques sont paradigmatiques (telles certaines œuvres littéraires,
cinématographiques ou théâtrales considérées comme une forme
d’attention à la vie humaine, avec des personnages moraux confrontés
5 À ce propos, voir l’article de Florence Quinche, « Apport de la littérature à l’éthique : des fonc-
tions de la communication à la théorie des mondes possibles », in id. (dir.), Quelle éthique pour
la littérature ? Pratiques et déontologies, Genève, Labor et Fides, 2007, p. 125-137.
Modernites34.indd 21 19/09/12 11:19
22 Sandrine Darsel
à des choix ou à des dilemmes importants, et questionnant ce qu’est
l’homme, son rapport aux autres et ses choix de vie). D’autres cas
sont problématiques (l’œuvre de Claude Simon, par exemple, où
l’élucidation des valeurs reste aporétique, ou les œuvres moralisatrices
qui sapent par là même leur rôle moral). Enfin, d’autres cas sont
périphériques, au sens où ils ne relèvent du questionnement moral que
de manière subsidiaire ou indirecte, comme la musique instrumentale.
Pour autant, l’esthétique ne peut se passer de l’éthique, et la réflexion
morale de la pensée par cas artistiques. Reste à déterminer ce que
peut nous apprendre l’art d’un point de vue moral.
À ce sujet, deux conceptions distinctes se dessinent :
– la conception théorique, selon laquelle le contenu moral de
l’art est un contenu conceptuel et argumentatif ;
– la conception émotiviste, selon laquelle le contenu moral de
l’art est du côté de l’émotivité.
Dans le premier cas, l’éthique est pensée comme une affaire
de jugement, d’inférences morales, et d’adéquation avec la réalité
morale. Ainsi, ce qui fait la valeur morale d’une œuvre d’art, c’est
qu’elle délivre un contenu propositionnel moral déterminé. Toutefois,
cette analyse cognitiviste est confrontée au problème suivant : le plus
souvent, le contenu propositionnel des œuvres d’art est pauvre et déjà
connu. Si l’on résume, par exemple, le contenu moral du film Une
histoire vraie, de Lynch, celui-ci sera réduit à une peau de chagrin :
s’occuper des gens que l’on aime. Or ce principe moral est loin
d’être une découverte. Dès lors, au mieux, le film de Lynch permet
d’asseoir la vérité de ce principe, au pire il n’en propose qu’une reprise
(comme un vieux dicton asséné). L’art en ce sens n’a de valeur morale
qu’instrumentale, tout à fait remplaçable, voire inutile, au sens où
une réflexion philosophique ou un essai moral suffirait à dévoiler
ce contenu. D’ailleurs, l’attention au contenu propositionnel moral
des œuvres d’art peut parfois conduire à une évaluation négative de
l’œuvre d’art, au sens où celle-ci serait moralisatrice et participerait
de la fixité d’une proposition morale.
La seconde conception, émotiviste, conteste l’assimilation de
l’éthique à une question de jugements et de délibérations autour
de propositions. L’éthique, dans ce cas, a pour objet nos réactions
affectives, nos sentiments moraux et nos émotions dans la vie éthique.
Ainsi, ce qui fait la valeur morale d’une œuvre d’art, ce n’est pas son
contenu moral, mais le fait qu’elle suscite des réactions éthiques, plus
précisément des sentiments moraux comme l’indignation, la honte, le
Modernites34.indd 22 19/09/12 11:19
Imagination narrative, émotions et éthique 23
respect, l’empathie, etc. L’œuvre d’art joue un rôle moral, au sens où
elle a la disposition d’exciter certains types d’émotions ayant elles-
mêmes une valeur morale.
Toutefois, toute émotion appropriée à l’œuvre d’art est-elle morale,
convenable ? De plus, si les émotions sont au cœur des pratiques morales,
cela ne signifie pas qu’elles en épuisent le champ. Ainsi, la réduction
de la morale à une question d’émotions la rend vide de sens. Enfin, il
importe de questionner pour la conception émotiviste comme pour la
conception cognitiviste présentée ci-dessus, le gouffre supposé entre le
conceptuel et le sensible, le cognitif et l’émotif, qui fait pencher d’un
côté ou de l’autre sans rendre compte de l’enchevêtrement des deux
aspects (de leur caractère indissociable). Ainsi, afin de concevoir les
rapports entre l’art et la morale, il s’agit de dépasser cette alternative
en défendant une analyse « enchevêtrée » : l’éducation morale par l’art
est une éducation qui lie de manière indissoluble le conceptuel et le
sensible.
Le rôle moral de l’art est loin d’être simple. Il participe d’une double
éducation. Il s’agit à la fois d’un affinement de nos concepts moraux
par l’expérience des œuvres d’art et d’une éducation des facultés par
l’expérience attentive des œuvres d’art. La spécificité des arts narratifs,
comme la littérature et le cinéma, qui occupent une place primordiale
dans nos vies, est qu’ils conduisent, par l’expérience de la lecture ou
du visionnage, à une aventure complexe et dense de la personnalité
humaine : ils nous rendent sensibles et attentifs à la densité de la vie
ordinaire. Les émotions, les choix et actions, les réflexions, pensées,
certitudes et doutes des personnages deviennent notre propre aventure
pour donner du sens à l’œuvre6. Cette expérience du moral dans sa
complexité consiste non pas en une révélation morale ou une conversion
éthique, mais en l’exercice d’une attention au particulier, c’est-à-
dire aux aspects de l’œuvre d’art. L’expérience réussie d’une œuvre
d’art paradigmatique mobilise une perception aspectuelle affinée,
des émotions ajustées, une imagination exploratrice, des distinctions
cognitives fines. En mobilisant l’ensemble de ces capacités, cette
expérience réussie devient performance morale : l’œuvre d’art appelle
6 Arthur Danto affirme en ce sens que l’œuvre littéraire implique une indexicalité (le « je » qui
lit). Chaque œuvre est à propos de chaque individu qui lit le texte à un moment donné. Le
lecteur s’identifie non pas au lecteur impliqué par l’auteur, mais au sujet actuel du texte. Et
ainsi l’œuvre devient une métaphore pour le lecteur, une espèce de miroir actif, au sens où en
vertu de l’identification avec le(s) personnage(s), le lecteur reconnaît ce qu’il est. La littérature
dépasse ainsi la distinction entre l’expérience et l’imagination. Cf. A. Danto, « Philosophy as/
and/of Literature », Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association,
vol. 58, no 1, septembre 1984, p. 5-20.
Modernites34.indd 23 19/09/12 11:19
24 Sandrine Darsel
et requiert alors des manières et attitudes morales. Le jugement
moral immédiat est anesthésié : la censure, le blâme ou l’approbation
sont mis en suspens ; c’est la performance du spectateur qui donne à
penser de manière éthique. L’œuvre d’art stimule de manière éthique
son récepteur par diverses voies : l’immersion, le décentrement, la
perplexité, le choc, le retour sur soi…
4. L’expérience esthétique comme performance morale
L’idée de performance morale est centrale pour comprendre
l’apport spécifique des œuvres d’art dans la réflexion, ainsi que la
pratique morale. En effet, comme je l’ai indiqué en introduction, on
ne peut donner une notation complète et déterminante de ce que l’on
doit faire (comment être une bonne mère, comment aimer quelqu’un,
comment être un ami, comment être un bon citoyen, etc.). Bien sûr,
une esquisse peut être faite, laquelle va donner et dégager les points
moraux et pratiques importants. Cette esquisse est d’ailleurs à la
charge notamment de la philosophie morale (et des théories morales).
L’action morale, quant à elle, est comparable à une performance
chorégraphique, théâtrale ou musicale : on a beau avoir une notation
ou partition comme guide, la notation sous-détermine la performance.
Autrement dit, quelle que soit la densité des théories morales du point
de vue des détails quant aux questionnements moraux (en insérant,
par exemple, des expériences de pensée ou en se limitant à un point
moral problématique – comme les questions de l’euthanasie, de
l’éthique parentale ou de l’éthique animale), ces esquisses théoriques
ne déterminent pas de manière complète et univoque les choix de
l’individu agissant7.
Or cette densité de la performance, on peut y accéder par l’expérience
de la densité narrative notamment (théâtre, cinéma, littérature),
et plus généralement par l’exemplarité des œuvres d’art. C’est cette
expérience de la densité qui s’avère irremplaçable. Par exemple, la
question morale de ce que c’est que d’être une bonne mère nécessite
évidemment une réflexion théorique (sur le maternage, l’éducation, le
statut de l’enfant, etc.). Néanmoins, cette réflexion s’avère toujours
insuffisante. Le détour par la pensée par cas artistique n’est pas
inutile. La lecture suivie du livre Le Choix de Sophie, de Styron, la
7 Il ne s’agit pas, par contre, de dénier toute valeur à la réflexion théorique, ni d’opposer les
œuvres d’art aux essais théoriques, comme le suggère par exemple Peter L evine dans son
ouvrage Living without Philosophy : On Narrative, Rhetoric, and Morality, New York, State
University of New York Press, 1998.
Modernites34.indd 24 19/09/12 11:19
Imagination narrative, émotions et éthique 25
vision attentive du film Mères et filles, de Julie Lopes-Curval, ou
encore l’expérience du roman Vipère au poing et de ses adaptations
cinématographiques ou théâtrales sont autant de moyens pour donner
accès à cette densité qu’exige la morale. Cette aventure morale
attentive au cas artistique est évidemment exigeante pour celui qui
fait l’expérience de l’œuvre. Cela implique aussi la possibilité d’une
surdité morale qui manque l’exemplarité de l’œuvre. En tout cas, avec
l’art, nous pouvons penser moralement par cas.
5. La pensée par cas
Cette analyse du rôle moral spécifique de l’œuvre d’art invite à
repenser, à la suite de Wittgenstein, le statut de la pensée (au sens
général de compréhension) par cas. L’originalité de la pensée par cas
consiste à penser à partir de singularités8. C’est une pensée déictique
qui vient pointer vers ce qui fait la particularité de ce cas. Autrement
dit, un cas n’est pas un exemple quelconque, une illustration ou
l’application d’une théorie générale. C’est un exemple singulier qui
tire paradoxalement sa valeur de sa particularité, de son caractère
irremplaçable, non substituable, non réitérable. Paradoxalement,
car on s’attend le plus souvent à ce que l’exemple tire sa valeur de sa
potentielle généralité. Ainsi, les œuvres d’art constituent des cas pour
la pensée morale. Des cas paradigmatiques, des cas problématiques,
des cas périphériques.
Généraliser le cas artistique considéré, abstraire du cas une
théorie morale ou des principes éthiques, établir des inférences
à partir de la comparaison des cas artistiques, c’est refuser de
considérer le cas comme un cas. C’est appréhender l’œuvre de manière
univoque, transparente. Aussi, le déficit inférentiel du cas artistique
(l’impossibilité de généraliser à partir de lui) ne compromet pas sa
valeur éthique : sa teneur vient de ce qu’il encourage, de ce qu’il
mobilise comme dispositions par sa densité ; elle n’est pas inférentielle
mais performative. En effet, le cas développe une manière d’être
informative, une teneur épistémologique différente de la construction
théorique : c’est un savoir qui prend forme dans les particularités
du cas inscrit dans un contexte, à travers les détails de la narration
littéraire, cinématographique, etc. La réception esthétique accentue
le tropisme plutôt qu’un élan vers le général. En d’autres termes, la
compréhension de l’œuvre d’art narrative appelle de manière logique
8 Jean-Claude Passeron et Jacques R evel (dir.), Penser par cas : enquête, Paris, Éd. de l’EHESS,
2005.
Modernites34.indd 25 19/09/12 11:19
26 Sandrine Darsel
une pensée sensible avec une portée éthique. La capacité à faire une
expérience réussie de l’œuvre consiste en la maîtrise d’un comportement
élaboré, un exercice vertueux des capacités logiques, imaginatives et
émotionnelles participant elles-mêmes à la performance morale. Le
but n’est pas de dérationaliser l’enquête morale, mais simplement d’en
montrer la complexité : elle engage une personne et non simplement un
esprit logique ou un corps.
L’activation d’une œuvre d’art suppose une performance de la
part du récepteur (lecteur, spectateur, auditeur…). De là vient sa
valeur cognitive et éthique essentielle. Le cas, par son individualité,
sollicite, et ce de manière spécifique : il donne à penser de manière
sensible. C’est une pensée authentique qui dépasse et chevauche la
distinction entre la pensée et la sensibilité. Il ne s’agit pas de penser
que, de concevoir que (attitude propositionnelle), mais de penser en,
c’est-à-dire en mobilisant ses capacités perceptives, imaginatives et
émotionnelles :
– penser en ressentant la douleur de tel x ;
– penser en regardant ce x ;
– penser en imaginant ce que cela ferait d’être ce x ;
– penser en écoutant l’histoire de x.
Toutefois, parler en ces termes du rôle éthique des œuvres d’art,
n’est-ce pas au fond l’inclure parmi les connaissances pratiques
distinctes des connaissances théoriques ? Non, si l’on entend par
« connaissance pratique » l’actualisation de connaissances théoriques ;
oui, si l’on considère que la valeur de la pensée par cas réside dans la
performance cognitive (irréductible aux dispositions intellectuelles)
appelée logiquement par la compréhension de l’œuvre. Elle implique
l’enchevêtrement du sensible et du conceptuel.
Ainsi, les arts peuvent sans nul doute avoir une valeur morale
irréductible. Ils ne conduisent pourtant pas à des connaissances
générales ni à l’établissement de principes universels. Leur valeur tient
à la spécificité de l’objet et à ce qu’il réclame, en termes cognitifs, afin
d’être compris. Car le fonctionnement des œuvres d’art, en particulier
celui des œuvres d’art narratives en tant qu’« épisodes » singuliers,
requiert de la part du récepteur la maîtrise de systèmes complexes et
riches ; il exige d’articuler les traits saillants du cas en comprenant
les liens logiques ; il demande aussi d’affiner nos concepts trop
souvent réducteurs. Le cas artistique sollicite à la fois des capacités
émotionnelles et cognitives, le travail de l’imagination, l’élargissement
Modernites34.indd 26 19/09/12 11:19
Imagination narrative, émotions et éthique 27
de la perception, l’acuité aux détails, l’aventure conceptuelle.
L’activation de telle œuvre d’art suppose l’enchevêtrement des
dispositions sensibles, intellectuelles, émotionnelles et corporelles :
elle requiert ainsi une activité cognitive exemplaire à la fois
sensiblement, intellectuellement et émotionnellement. L’œuvre d’art
attend du récepteur non une attitude contemplative et modulaire,
mais immersive et synesthésique.
6. Les émotions esthétiques et éthiques
Un problème récurrent se pose : le caractère fictif invaliderait
le rôle éthique de l’art. Il y aurait une distinction franche entre
l’expérience quotidienne et la réception esthétique. Or l’émotion
esthétique du spectateur est une émotion réelle et non contradictoire.
C’est un sentiment dirigé vers un objet : l’œuvre d’art considérée.
L’émotion esthétique est aussi un moyen de comprendre l’œuvre d’art :
elle joue un rôle cognitif essentiel. Ainsi, le fait que je sois bouleversée
à la lecture du livre de Philippe Forest L’Enfant éternel est lié
logiquement au fait que cette œuvre raconte une histoire tragique (la
maladie et la mort lente de son enfant, Pauline, âgée de quatre ans),
qu’elle représente le rapport de la société à la mort, qu’elle donne
un échantillon des traitements quotidiens dans les hôpitaux, qu’elle
réfère de manière complexe, à travers le conte de Peter Pan, à la
jeunesse éternelle, qu’elle exprime la douleur, l’attente, la désillusion,
l’absence. L’expérience émotionnelle de cette œuvre littéraire comme
exprimant telle émotion n’est pas identique au fait de penser que cette
œuvre littéraire exprime telle émotion, bien que la connaissance du
caractère expressif de cette œuvre puisse affiner, guider l’expérience
émotionnelle. L’émotion esthétique, de par son intentionnalité (être
triste à la lecture de ce livre), diffère d’une simple humeur (rester
triste ensuite), tout en restant distincte d’un jugement.
D’autre part, l’intelligibilité d’une émotion ne se réduit pas à
la rationalité de celle-ci (une expérience émotionnelle peut être
intelligible tout en reposant sur une croyance fausse, issue d’un
processus non rationnel), ni à son caractère approprié (la fierté que
je ressens à l’égard de mes ancêtres est intelligible, bien qu’elle soit
inappropriée dans le contexte culturel et social actuel). C’est une
structure complexe, dynamique et narrative, qui rend intelligible
l’émotion ressentie par telle personne9. Par exemple, l’expérience
9 Peter G oldie, The Emotions : A Philosophical Exploration, Oxford, Clarendon Press, 2002,
p. 4-5.
Modernites34.indd 27 19/09/12 11:19
28 Sandrine Darsel
émotionnelle de regret mêlé de crainte éprouvée par Adam Appleby
dans La Chute du British Museum, de David Lodge10, est intelligible
en tant qu’elle s’inscrit dans une narration complexe comprenant
plusieurs occurrences émotionnelles, des perceptions, des pensées, des
changements corporels, des dispositions à l’action, des événements, des
humeurs et des traits de caractère, un contexte physique et social…
Cette structure narrative, loin d’être un ensemble méréologique de
composants plus ou moins essentiels, révèle la complexité intrinsèque
des émotions.
Par conséquent, les réponses émotionnelles « attendues » par
l’œuvre d’art sont sujettes à une évaluation critique, fonction de
leur caractère approprié. Il est possible de distinguer deux sens
dans lesquels les émotions sont dites appropriées : la jalousie, par
exemple, est considérée comme appropriée quand on voit un autre
jouir d’un avantage qu’on ne possède pas ou qu’on désirerait posséder
exclusivement. Mais, en même temps, on peut nier que la jalousie soit
appropriée, suivant l’idée (contestable, à dire vrai) selon laquelle elle
est un défaut de caractère.
La différence entre la correction d’une émotion (savoir si elle
s’accorde à son objet) et son caractère propre, sa convenance (savoir si
c’est la bonne manière d’être ému) est importante : du caractère ajusté
d’une émotion, on ne peut pas inférer son caractère propre ; et du
caractère propre d’une émotion, on ne peut pas inférer son caractère
ajusté. Or le rôle éthique des œuvres d’art suppose la prise en compte
de ces deux sens : les œuvres d’art sont l’occasion d’accords, d’écarts,
de tensions, voire de contradictions entre les dispositions émotionnelles
mobilisées. Une émotion est inappropriée du point de vue de la forme
si l’œuvre d’art en question ne possède pas la propriété émotionnelle
supposée. Et même si une émotion est appropriée du point de vue de la
forme, elle peut faire l’objet d’une critique en fonction de sa taille : elle
est soit ajustée de manière précise, soit disproportionnée (trop forte ou
trop faible) par rapport à ce qu’attend le spectateur de l’œuvre. Reste
que parfois la réponse émotionnelle appelée par les traits expressifs
de l’œuvre d’art et la réponse émotionnelle méritée diffèrent : soit le
fonctionnement expressif de l’œuvre échoue (l’échec expressif conduit
à une sanction émotionnelle), soit la réponse émotionnelle appelée n’est
pas désirable d’un point de vue moral. Les œuvres d’art qui proposent
des géographies éthiques divergentes, problématiques, ne sont pas
dénuées de valeur morale, au sens où elles mobilisent justement ces
10 Ibid., p. 21-22.
Modernites34.indd 28 19/09/12 11:19
Imagination narrative, émotions et éthique 29
tensions émotionnelles et cognitives en général. Il importe ainsi de
bien remarquer que la compréhension d’une œuvre d’art suppose
l’anesthésie du jugement moral en faveur de l’activation esthétique de
l’œuvre, qui peut inclure un engagement moral11. Ainsi, l’art investit
l’éthique par-delà les jugements moraux et la réactivité morale sensible.
7. Penser de manière sensible
Ainsi, l’œuvre d’art peut jouer un rôle éthique spécifique par les
capacités qu’elle mobilise. L’ordre axiologique du cas artistique ne
relève pas de la certitude, ni de la connaissance propositionnelle.
Comprendre une œuvre d’art, c’est comprendre les normes en les
suivant, en les ressentant plutôt qu’en les formulant. Ici, les arts
ne sont pas conçus comme une source d’exemples, d’illustrations
de raisonnements éthiques, ni comme un moyen pour apporter une
solution définie aux conflits pratiques. L’expérience réussie d’un
cas artistique est un moment de performance et d’engagement qui
participe de la formation éthique du récepteur. Ainsi, l’expérience des
œuvres d’art est un mode d’enquête morale fécond.
Les œuvres d’art deviennent prescription à penser de manière
sensible. Cela implique un double processus : reconnaître ce qui est
vrai de l’œuvre et comprendre par l’action en adoptant les attitudes
attendues logiquement par l’œuvre. Afin d’appréhender ce double
processus, prenons l’exemple suivant : le film Biutiful, d’Alejandro
González Iñarritu, sorti en 2010. La compréhension de ce cas singulier
artistique implique :
• d’une part, d’identifier les personnages principaux (Uxbal,
Marambra, les deux enfants), de savoir que ce film raconte
l’histoire d’un père barcelonais qui vit de l’organisation de
trafics liés au travail clandestin et qui vient de découvrir qu’il
est atteint d’un cancer ;
• d’autre part, et surtout :
– d’entendre l’indifférence sociale par rapport à la situation
sanitaire et sociale des immigrés illégaux ;
– de voir la gravité déchirante du père confronté à l’abandon
proche de ses enfants ;
11 À propos de la possible corruption de notre sensibilité, voir David Novitz, « L’anesthétique
de l’émotion », in Jean-Pierre Cometti, Jacques Morizot et Roger Pouivet (dir.), Esthétique
contemporaine : art, représentation et fiction, Paris, J. Vrin, coll. « Textes clés », p. 415.
Modernites34.indd 29 19/09/12 11:19
30 Sandrine Darsel
– de ressentir la détresse du père, la difficulté pour lui de
pardonner à la mère de ses enfants, sa peur de perdre son
père ;
– d’imaginer, en se mettant à la place des immigrés, la
difficulté de trouver sa place dans une société ayant une
autre culture ;
– de comprendre les désastres de notre société, le sens
tragique de la vie, pourtant non dénuée d’espérance ;
– de craindre les difficultés d’être mère et femme.
Ceux qui se méfient du rôle éthique des œuvres d’art insistent sur
le fonctionnement esthétique de l’œuvre : le biais, la subjectivité de
l’interprétation du spectateur, le caractère arbitraire et fictif de la
construction artistique, les intentions auctoriales, etc., impliquées par
le statut de l’œuvre d’art, autant d’arguments qui conduisent à rejeter
de nouveau la valeur éthique des œuvres d’art. Or le fonctionnement
esthétique des œuvres d’art assure en réalité leur spécificité éthique.
Le cas artistique développe une teneur éthique différente de la
construction théorique argumentative.
Les œuvres d’art narratives réfèrent à la vie pratique par
description, échantillon (littéral ou métaphorique) et référence
complexe12. Les œuvres d’art instancient tout en référant à la complexité
de la vie morale. Il ne s’agit pas d’instrumentaliser les œuvres d’art et
de les asservir à une fonction morale. Simplement, nombreuses sont
celles qui pour fonctionner esthétiquement, appellent un engagement
moral de la part du spectateur : en tant qu’œuvres d’art ayant un
fonctionnement esthétique particulier, elles supposent logiquement
son activation morale. En ce sens, les œuvres d’art narratives, dont
la fonction est la communication d’une histoire13, ont l’avantage
de combiner ces multiples voies de la référence : représentation,
description, exemplification, expression, références complexes. Elles
donnent une version de la réalité cohérente, inscrite dans un cadre
temporel et causal : le récit détaillé et dense d’une série d’événements
qui fait sens. D’où leur rôle éthique paradigmatique. L’originalité et la
spécificité du rôle moral des œuvres d’art repose sur le type de pensée
appelée (de fonctionnement cognitif, entendu en un sens large et
12 Pour une analyse détaillée de ces fonctionnements esthétiques, voir Nelson G oodman, Langages
de l’art : une approche de la théorie des symboles [Languages of Art, 1968, 2e éd., 1976], pré-
senté et trad. de l’anglais par Jacques Morizot, Nîmes, J. Chambon, 1990.
13 Gregory Currie, Narratives and Narrators
: A Philosophy of Stories, Oxford, Oxford
University Press, 2010.
Modernites34.indd 30 19/09/12 11:19
Imagination narrative, émotions et éthique 31
impliquant à la fois la perception, l’imagination, la mémoire, la pensée
abstraite comme les émotions) : l’expérience éthique du spectateur à
partir de singularités. Telle œuvre d’art engage une pensée déictique
qui vient pointer vers ce qui fait la particularité de ce cas. Les œuvres
d’art ne menacent donc pas l’éducation morale.
7. Récapitulatif
À la question : « Sur quoi repose la valeur des œuvres d’art ? », se
dessinent en réponse deux conceptions distinctes :
– la conception émotiviste, selon laquelle l’apport éthique des
œuvres d’art est du côté de l’émotivité ;
– la conception théorique, selon laquelle l’apport des œuvres
d’art est inférentiel.
Dans le premier cas, le rôle éthique de l’œuvre d’art n’est pas
une question de jugements, d’inférences et de délibérations autour
de propositions morales. L’attention portée aux œuvres d’art a pour
objectif de susciter des réactions affectives, des sentiments et émotions
vertueux chez le spectateur. Le cas joue un rôle au sens où il a la
disposition d’exciter certains types d’émotions éthiques, telles que
l’empathie, l’admiration, l’attachement, la peur…
Dans le second cas, ce qui fait la valeur éthique des œuvres d’art,
c’est qu’elles délivrent un contenu propositionnel déterminé. Toutefois,
cette analyse théorique est confrontée au problème suivant : le plus
souvent, le contenu propositionnel des œuvres d’art est pauvre et déjà
connu. Le cas, en ce sens, n’a de valeur qu’instrumentale, tout à fait
remplaçable, voire inutile, au sens où une réflexion philosophique ou
un essai moral suffirait à dévoiler ce contenu.
L’expérience du cas dans sa complexité consiste en l’exercice d’une
attention à l’identité singulière de l’œuvre d’art considérée, c’est-à-dire
aux aspects de cette œuvre. Cette attention appelle une performance
morale qui mobilise bien plus que des capacités intellectuelles. Elle
suppose la collaboration des sens, de l’imagination, des émotions et de
la raison. C’est donc du point de vue performatif, plutôt que théorique
ou émotif, que les œuvres d’art ont une valeur éthique essentielle
et spécifique. Leur apport est irréductible (ce qui ne veut pas dire
suffisant).
Modernites34.indd 31 19/09/12 11:19
32 Sandrine Darsel
Conclusion
En conclusion, cette communication souligne la contribution
possible, quoique essentielle et irréductible, des œuvres d’art. L’art
entretient des liens privilégiés avec la morale : ce n’est pas une erreur
de catégorie que de penser l’art en termes moraux ; l’éthique émerge
comme indispensable pour la compréhension des œuvres d’art, comme
l’explique Berys Gaut dans Art, Emotion and Ethics14. La force éthique
des œuvres d’art tient à ce qu’elles nécessitent une performance morale,
laquelle suppose l’enchevêtrement du contenu moral avec l’exercice de
réponses morales. La thèse performative que je défends se distingue
de deux conceptions relatives au rôle éthique des œuvres d’art :
1. le scepticisme (le recours éthique aux œuvres d’art est une
méthode incorrecte et défaillante du point de vue du processus,
du résultat, de l’objet), et
2. l’instrumentalisme (le détour par les œuvres d’art n’a pas une
valeur éthique en soi ; il est raisonnable d’en faire usage à des
fins illustratives, rhétoriques ou pédagogiques).
De plus, la reconnaissance du rôle éthique des œuvres d’art montre
les limites d’une éthique entendue comme « rationalité pratique » ou
comme « sensibilité morale ». De manière fondamentale, cette analyse
du rôle moral de l’art permet de recentrer la philosophie de l’action et
la réflexion morale sur les capacités humaines à réagir et à répondre
moralement (une forme morale de compétence et d’intelligence),
dans la lignée aristotélicienne du perfectionnisme moral. Toutefois,
l’impact moral des œuvres d’art ne peut s’expliquer par une simple
explication causale directe : les propriétés signifiantes de l’œuvre ne
sont pas dispositionnelles, même si elles sont relationnelles. Enfin,
la reconnaissance du rôle éthique des œuvres d’art n’est pas sans
conséquence pour l’éducation, comme le montre Martha Nussbaum
dans son ouvrage Les Émotions démocratiques15 : l’éducation artistique
est centrale pour la formation du citoyen démocratique.
Sandrine Darsel
Archives Henri Poincaré, Nancy Université
14 Berys Gaut, Art, Emotion and Ethics, Oxford, Oxford University Press, 2009.
15 M. Nussbaum, Les Émotions démocratiques : comment former le citoyen du xxie siècle ? [2010],
trad. de l’anglais (États-Unis) par Solange Chavel, Paris, Climats, 2011.
Modernites34.indd 32 19/09/12 11:19
Imagination narrative, émotions et éthique 33
Bibliographie
Cavell, Stanley, À la recherche du bonheur : Hollywood et la comédie du
remariage [Pursuits of Happiness, 1981], trad. de l’anglais par Christian
Fournier et Sandra Laugier, Paris, Cahiers du cinéma, 2009.
Currie, Gregory, Narratives and Narrators : A Philosophy of Stories,
Oxford, Oxford University Press, 2010.
Danto, Arthur C., « Philosophy as/and/of Literature », Proceedings
and Addresses of the American Philosophical Association, vol. 58, no 1,
septembre 1984, p. 5-20.
Gaut, Berys, Art, Emotion and Ethics, Oxford, Oxford University Press,
2009.
Goodman, Nelson, Langages de l’art : une approche de la théorie des symboles
[Languages of Art, 1968, 2e éd., 1976], présenté et trad. de l’anglais par
Jacques Morizot, Nîmes, J. Chambon, 1990 ; rééd. A. Fayard-Pluriel, 2011.
Goldie, Peter, The Emotions : A Philosophical Exploration, Oxford,
Clarendon Press, 2002.
Levine, Peter, Living without Philosophy : On Narrative, Rhetoric, and
Morality, New York, State University of New York Press, 1998.
Novitz, David, « L’anesthétique de l’émotion », in Jean-Pierre Cometti,
Jacques Morizot et Roger Pouivet (dir.), Esthétique contemporaine : art,
représentation et fiction, Paris, J. Vrin, coll. « Textes clés », p. 413-444.
Nussbaum, Martha, La Connaissance de l’amour : essais sur la philosophie et
la littérature [Love’s Knowledge, 1990], trad. de l’anglais (États-Unis) par
Solange Chavel, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Passages », 2010.
–, Les Émotions démocratiques : comment former le citoyen du xxie siècle ?
[Not for Profit : Why Democracy Needs the Humanities, 2010], trad. de
l’anglais (États-Unis) par Solange Chavel, Paris, Climats, 2011.
Passeron, Jean-Claude et Revel, Jacques (dir.), Penser par cas : enquête,
Paris, Éd. de l’EHESS, 2005.
Quinche, Florence, « Apport de la littérature à l’éthique : des fonctions de
la communication à la théorie des mondes possibles », in id. (dir.), Quelle
éthique pour la littérature ? Pratiques et déontologies, Genève, Labor et
Fides, 2007, p. 125-137.
Modernites34.indd 33 19/09/12 11:19
Modernites34.indd 34 19/09/12 11:19
Barthes, art et émotion
L’émotion occupe une place centrale dans l’œuvre de Roland
Barthes. Les questions d’affects apparaissent constamment dans son
œuvre et nous font découvrir un auteur en proie à des douleurs et
à des joies extrêmes. Barthes éprouve de l’inconfort qui va jusqu’à
la peur névrotique vis-à-vis de celui qui l’accable de son emprise.
Inversement, l’amitié est pour lui une valeur fondamentale, et ses écrits
sur la relation amoureuse et la perte de l’être aimé mettent en scène ses
émotions d’une manière poignante. Aborder la question de l’émotion
esthétique, cependant, c’est laisser de côté les affects interpersonnels
dans la vie de Barthes et se pencher sur l’un des moteurs principaux de
ses enquêtes dans le domaine des arts plastiques, du spectacle et de la
littérature. Une réaction esthétique, pour simplifier, est une réaction
évaluative suscitée par la rencontre avec un objet. Barthes, il est vrai,
fait souvent montre, dans ses rapports interpersonnels avec des amis,
des collègues, et surtout des amants, de telles réactions évaluatives
face à l’objet qu’est le corps de l’autre. Son propre corps est en retour
objet d’évaluation pour les autres. Ses émotions à l’égard de ceux qui
l’entourent sont donc en lien avec une certaine esthétique évaluative,
esthétique placée sous le signe du corps désirant. Le désir est pour
Barthes un substrat du sujet, qui a été formé en même temps que le
sujet lui-même et qui fond les évaluations formatives de ce dernier,
les évaluations du genre : « J’aime… je n’aime pas. » Les raisons qui
sous-tendent le choix de l’objet du désir restent peu claires pour le
sujet : il réagit à ces objets par la répulsion ou l’attirance, d’abord mu
par son corps. On peut déceler ce mécanisme corporel aveugle et non
Modernites34.indd 35 19/09/12 11:19
36 Maria O’Sullivan
motivé tout au long de l’œuvre de Barthes, non seulement dans ses
propres goûts, mais aussi à travers ce qu’il a écrit sur le corps désirant
de l’autre. Prenons, par exemple, la notion d’« humeur », à laquelle il
apparente le « style » de l’écrivain dans Le Degré zéro de l’écriture1.
Cette idée de l’humeur pour exprimer l’opacité et la nature déterministe
du corps désirant revient dans son livre sur Michelet, où Barthes
déchiffre l’imagination corporelle de l’historien romantique et note
les identités imaginaires que Michelet prête aux corps des personnages
historiques2. Le corps de Michelet réagit à son tour contre ces corps
historiques, et produit de la nausée ou des migraines en même temps
qu’il produit des réactions émotives, « d’effusion ou de dégoût3 ». Ces
émotions participent à l’esthétique, provoquées par les descriptions
physiognomoniques que lisent Michelet – Louis XVI est pâle et
bouffi, et Napoléon, « jaune, cireux et sans sourcils, donne terreur et
nausée4 ». Le corps de Michelet a une place aussi fondamentale dans la
pensée barthésienne que, plus tard, l’inconscient lacanien : tous deux
sont des systèmes flous où circulent des éléments hétérogènes, mais où
la structure de désir se répète avec une rémanence têtue.
Cependant, on tient à distinguer entre un désir qui soit un
travail de transformation de l’objet esthétique pour l’appréhender
selon son propre goût, et une émotion qui soit née d’un moment de
« démunition », de dessaisissement total devant cet objet. Il existe
certes un rapport noué entre l’émotion et le désir ; l’émotion est comme
la peau du système sous-jacent de désir, une peau qui soit sensible
à l’effleurement de l’objet extérieur qui vient à sa rencontre. Il est
même fort probable que les goûts du désir créent les voies de l’accès
d’émotion. Cela étant, l’émotion dans l’œuvre de Barthes reste
quelque chose de particulier. Pour Barthes, l’émotion se structure
le plus souvent comme une perception d’une partie ou d’un fragment
d’un objet, et non pas une réaction plus globale à l’essence imaginée
de l’objet, comme c’est le cas dans les réactions de Michelet. On peut
voir cette dimension fragmentaire dans sa description du punctum,
l’élément qui, dans telle ou telle photo, « fait tilt », qui éveille un
1 On se rappelle que Barthes oppose la langue dans sa dimension sociale (« corps de prescrip-
tions et d’habitudes ») et le « style » comme idiolecte, dont le secret est « un souvenir enfer-
mé dans le corps de l’écrivain ». Voir Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture [1953], in
Œuvres complètes, nouv. éd. revue, corrigée et présentée par Éric Marty, Paris, Éd. du Seuil,
2002, t. I, p. 178 (abrégé ci-après en OC I à V).
2 Id., Michelet [1954], in OC I, p. 355.
3 Ibid., p. 356.
4 Ibid., p. 355.
Modernites34.indd 36 19/09/12 11:19
Barthes, art et émotion 37
« émoi » en Barthes5. L’émotion suscitée par le punctum est un émoi
d’une acuité particulière qui ponctue l’image et se découpe sur le fond
du studium, lequel donne le sens culturel ou idéologique de l’image.
Dans le punctum, l’émotion est elle-même une perception – on perçoit
un détail quelconque précisément parce qu’il suscite une émotion ou
une sensation forte, plus forte que l’émotion qu’on éprouve lorsqu’on
regarde le reste de l’image (monotone, sage, l’émotion que suscite le
studium est celle que nous sommes censés éprouver, d’un point de vue
politique ou culturel). Les émotions barthésiennes sont donc souvent
de l’ordre d’une crise, et elles forment la perception d’une rupture de
ce qui précède cet instant. Pour utiliser le langage du bouddhisme
zen dont Barthes se sert dans ses derniers textes, l’émotion pour lui
correspond au « ge » ou « gatha » : « ce qu’on a perçu ou éprouvé
au moment où l’œil mental s’est ouvert (satori) 6 ». Cette émotion qui
interrompt peut être le précurseur d’une étape de compréhension
future, comme c’est le cas pour l’historien Michelet dont son voyage à
travers le paysage de l’Histoire. Ce dernier suit le chemin linéaire du
Récit chronologique, jusqu’au l’instant où il rencontre soudainement
un détail qui lui permet de tout résoudre dans une vision du Tableau
total :
[T]out d’un coup, sans s’y attendre, il rencontre la figure du paysan Jacques,
dressé sur son sillon : étonnement profond, traumatisme même, puis émotion,
euphorie du voyageur qui, surpris, s’arrête, voit et comprend ; un second
plan d’histoire, celle-ci toute panoramique, faite d’intellection, se dévoile :
l’historien passe, pour un temps, du travail à la Fête7.
Cette intellection seconde qui suit la première étape d’émotion
figure dans l’œuvre même de Barthes, et on la retrouvera par exemple
dans la transformation les émotions douloureuses notées dans le
journal de deuil écrit après la mort de sa mère en livre, dans La
Chambre claire8. Il arrive aussi que l’émotion soit le point final d’un
processus de découverte et non pas le tout début. C’est le cas, souvent,
dans les textes de Barthes écrits dans les années 1970 : l’art de Cy
Twombly, par exemple, est décrit comme un « événement » produisant
un « effet » qui ne peut être décomposé en ses parties constitutives9.
5 R. Barthes, La Chambre claire [1980], in OC V, p. 803.
6 Id., La Préparation du roman I et II : cours et séminaires au Collège de France (1978-1980),
texte établi, annoté et présenté par Nathalie Léger, Paris, Éd. du Seuil – IMEC, 2003, p. 94.
7 Id., Michelet, op. cit., p. 305.
8 Id., Journal de deuil [1977-1979], texte établi, annoté et présenté par Nathalie Léger, Paris,
Éd. du Seuil – IMEC, 2009 ; La Chambre claire, op. cit., p. 785-892.
9 Id., « Sagesse de l’art » [1979], in L’Obvie et l’Obtus [1982] et OC V, p. 694-695.
Modernites34.indd 37 19/09/12 11:19
38 Maria O’Sullivan
Quant au haïku, dans La Préparation du roman, il met en scène un
« Moment de vérité » qui « n’est pas dévoilement, mais au contraire
surgissement de l’ininterprétable, du dernier degré du sens, de l’après
quoi plus rien à dire10 ».
L’art, en tant qu’il met en scène une rencontre avec un objet
étranger au sujet, fait appel à toute une gamme de réactions émotives
esthétiques et perceptives qui diffèrent de celles qui nouent de l’amitié
ou de l’amour entre sujets. Il sera surtout question ici du rôle joué par
les arts visuels, principalement le théâtre et la peinture, dans l’œuvre
de Barthes. Les rapports que désigne Barthes entre l’émotion et l’art
littéraire nécessiteraient, évidemment, un essai complet. D’ailleurs, il
nous semble que l’émotion dont fait preuve le lecteur du texte écrit n’est
pas identique à celle que ressent le spectateur des arts visuels. Barthes
met de temps à l’autre l’accent sur l’émotion suscitée chez le lecteur par
la rencontre, dans la lecture, d’un objet singulier et qui semble être
étranger aux significations du texte. Son œuvre ne s’intéresse à l’objet
réel qu’en tant qu’il entre dans la littérature ; voyons, par exemple, le
chat jaune de l’abbé Séguin dans la Vie de Rancé de Chateaubriand11,
l’effet de réel12 et les tangibilia dont il est question dans son dernier
cours, La Préparation du roman13. Dans ce dernier texte, on voit à quel
point l’objet tangible, la Chose, peut véhiculer la force d’une réaction
émotive qui crée à son tour un « moment de vérité », « la certitude que ce
que nous lisons est la vérité (a été la vérité)14 ». Ce « moment de vérité »
c’est par exemple la sensation vertigineuse qu’évoque par Barthes dans
son texte de 1965, « Chateaubriand : “Vie de Rancé” » ) à propos du
« chat jaune » de l’abbé Séguin, le confesseur de Chateaubriand. Pour
autant que le chat jaune puisse signifier la bonté de l’abbé qui protège
donc un animal méprisé et perdu, il peut tout aussi facilement ne rien
signifier – il est possible que le chat jaune ne soit qu’un chat jaune,
un objet réel qui révèle un « en deçà » de sens et tout le pouvoir de
l’objet immotivé dans la littérature, explique Barthes15. La littérature
peut donc pleinement introduire lecteur à l’objet étranger, situé au
bord de la signification et suscitant par conséquent le trouble chez
10 Id., La Préparation du roman, op. cit., p. 159 ; c’est Barthes qui souligne.
11 Id., « Chateaubriand : “Vie de Rancé” » [1965], in Nouveaux essais critiques [1972] et OC IV,
p. 63-64.
12 Id., « L’effet de réel » [1968], in Le Bruissement de la langue [1984] et OC III, p. 25-32 ; « Le
discours de l’histoire » [1967], in Le Bruissement de la langue et OC II, p. 1261-1262.
13 Id., La Préparation du roman, op. cit., p. 94-96.
14 Ibid., p. 156.
15 R. Barthes, « Chateaubriand : “Vie de Rancé” », texte cité, p. 63-64.
Modernites34.indd 38 19/09/12 11:19
Barthes, art et émotion 39
le lecteur. Cependant, bien que la littérature puisse relayer l’effet
sensuel et incongru de l’objet réel, il manque dans l’acte de lecture
l’expérience frappante, déchirante même qu’est l’instantanéité de la
vision de l’objet artistique, vu de l’extérieur, dans sa présence réelle
et troublante. Dans « Le troisième sens », Barthes décrit le « sens
obtus », réaction émotive à l’image et aux objets qu’elle contient, et
se demande si cette réaction n’est pas nécessairement liée au visuel,
et au filmique, comme un état qui se débarrasserait du langage pour
accéder à la « signifiance », c’est-à-dire un signifiant sans signifié16. Il
évoque aussi, dans un de ses premiers textes sur le théâtre, l’« évidence
viscérale qui naît de la confrontation du regardant et du regardé, et
qui est la fonction constitutive de théâtre17 ». Si la question du regard
et celle la confrontation entre un sujet qui regarde et un objet regardé
s’avère essentiel pour savoir ce que c’est que l’art pour Barthes,
l’émotion est donc l’un des outils principaux pour la comprendre.
Il est également important de noter que l’art, pour Barthes,
est toujours créé par un geste de cadrage, comme celui, qui revient
plusieurs fois dans son œuvre, de l’aruspice découpant du bout de
son bâton un rectangle fictif dans le ciel, afin d’interroger le vol des
oiseaux18. Barthes fait souvent usage du mot « geste » pour parler de
l’art, peut-être parce que le geste est un fragment de mouvement qui
a des bornes claires (il possède un commencement et une fin) et qui
produit de la signification. L’art fonctionne lui aussi selon un processus
de fragmentation en donnant de l’importance à l’objet qu’il représente,
dans l’acte même de l’isoler pour le représenter. La peinture, nous dit
Barthes, est toujours « une scène où advient quelque chose (et si, dans
certaines formes d’art, l’artiste veut délibérément qu’il ne se passe
rien, c’est encore là une aventure)19 ». Pour lui, l’empreinte de l’artiste
est partout dans l’œuvre d’art ; l’art « arrache le monde au hasard,
et c’est en cela qu’il est “humain”, produit par l’homme et l’homme
seul […] une régulation d’assemblages qui montre que l’homme est
là20 ». Ceci, évidemment, est tout à l’encontre de ce que Barthes a écrit
sur le texte littéraire dans ses textes où il débat longtemps la présence
de l’auteur avant le « retour amical » de ce dernier dans ses derniers
16 Id., « Le troisième sens. Notes de recherche sur quelques photogrammes de S. M. Eisenstein »
[1970], in L’Obvie et l’Obtus [1982] et OC III, p. 503.
17 Id., « Théâtre capital » [1954], in OC I, p. 504.
18 Id., S/Z [1970], in OC, p. ; Roland Barthes par Roland Barthes [1975], in OC IV, p. .
19 Id., « Sagesse de l’art » [1979], art. cité, p. 688.
20 Id., « Trois fragments » [1964], in OC II, p. 562.
Modernites34.indd 39 19/09/12 11:19
40 Maria O’Sullivan
écrits. On voit par là un autre parallèle qui existe entre l’art et la
notion du « geste », puisque le geste est toujours produit par un sujet.
Le geste artistique et le geste corporel garantissent tous les deux la
présence de l’autre. Dans les écrits de Barthes sur l’art et sur l’émotion
que l’art peut susciter chez ses spectateurs, le geste artistique et le
geste du corps en tant qu’il figure dans l’œuvre d’art s’entremêlent
constamment. Le geste du corps représenté dans l’œuvre d’art détient
souvent toute la force significative de l’œuvre, force qui se fait sentir
à travers une réaction forte d’émotion. Les corps d’autrui suscitent
un intérêt chez Barthes qui est analogue à celui qu’il porte vers les
tangibilia comme le chat jaune de Chateaubriand, puisque le corps
est, lui aussi, objet complet, vu de l’extérieur, et troublant dans sa
présence. Est-ce que le corps de l’autre signifie ? Cette signification
serait-elle émotionnelle ou intellective ? Ce sont les questions que les
œuvres d’art semblent poser dans l’œuvre de Barthes. Dans le reste
de cette réflexion, c’est aussi cette communication entre le geste du
corps et la nature de l’art dans les textes de Barthes tout au long de
sa carrière, des années 1950 jusqu’aux années 1970 qui appellera
éclaircissement.
1. Le théâtre
Dans ses premiers écrits, et surtout ses textes des années 1950, le
théâtre est sans doute la forme artistique qui attire le plus d’attention
de la part de Barthes. Dans « Pouvoirs de la tragédie antique » (1953),
il réserve un rôle important à l’émotion du spectateur dans cette forme
théâtrale ancienne. Il se méfie toutefois de la réponse émotive du
spectateur moderne, réglée selon lui par la psychologie et l’identification
de l’individu avec le personnage, qui créent « un type d’émotions d’ordre
passionnel et non plus moral21 », et non pas des réactions de pitié ou
d’indignation sur la situation politique de ses personnages, comme c’était
le cas dans la tragédie antique. La seule théâtralité moderne qui facilite
ces réponses émotives non pas individuelles mais partagées en groupe
est celle des grandes arènes sportives, où les spectateurs expriment leur
émotions sur le sort commun de leurs équipes avec tout un série de gestes
corporels. Si les spectateurs de la tragédie antique répondaient à la pièce
avec des gestes corporels comme les larmes, leurs gestes entraient en
rapport avec les gestes également corporels des acteurs. Ces gestes des
acteurs étaient admirablement codifiés, selon Barthes, pour signifier
l’émotion plutôt que de l’exprimer. « Dans tout art civilisé, nous dit
21 Id., « Pouvoirs de la tragédie antique » [1953], in OC I, p. 260.
Modernites34.indd 40 19/09/12 11:19
Barthes, art et émotion 41
Barthes, […] l’intelligence est la condition originelle de l’émotion22. »
L’identité nettement définie du signifié émotif correspond à celle de
son signifiant, le geste : « la plus grande dramaturgie est toujours celle
qui n’utilise les passions que sous un seul signe, un seul nom et un seul
geste23 ».
Pour Barthes, à cette époque, donc, les émotions des personnages
représentés et celles des spectateurs sont tous deux transmises à travers
leurs corps. Cette idée revient dans son article sur la tragédienne
Maria Casarès, où l’actrice force les spectateurs à suivre dans leurs
corps mêmes le prolongement des sentiments et des gestes qu’elle
représente sur scène :
Maria Casarès […] oblige à explorer avec elle toute la durée du geste drama-
tique : si elle pleure, il ne vous suffit pas de comprendre qu’elle souffre, il vous
faut aussi éprouver la matérialité de ses larmes, supporter cette souffrance
bien après que vous l’avez comprise. Si elle attend, il vous faut aussi attendre,
non de la pensée, ce qui vous est facile dans votre fauteuil, mais des yeux, des
muscles, des nerfs, subir l’affreux supplice d’une scène vide où l’on ne parle
pas et où l’on regarde une porte qui va s’ouvrir24.
L’idée de la durée ou du prolongement de l’émotion du spectateur
dans la sensation corporelle prend une forme spatiale dans les quelques
textes que Barthes a consacrés au théâtre en plein air. Ainsi, dans
« “Le Prince de Hombourg” au TNP » (1953), la durée de la sensation
corporelle du spectateur est physiquement présente dans l’espace noir
et ouvert qui entoure le décor de la scène. L’espace délimité et découpé
de la scène entre en communication, pour le spectateur, avec tout
l’espace illimité et vague qui l’entoure. La différence entre le décor
scénique et l’espace ouvert est celle qui existe entre l’intellection et ce
qui déborde les limites de l’intellect :
Par nature, le décor ne participe pas à l’espace ; il est un argument, il fait
partie du matériel d’explication de la pièce, il est un signe intellectuel projeté
par la situation, c’est un accessoire didactique, non magique25.
La magie, par contre, arrive de l’espace vide et expansif :
[L]’espace scénique a une fonction incantatoire ; il n’est pas le lieu où se débat
quelqu’un, mais le lieu par où il entre quelque chose26.
Ce qui entre est la sensation, la fraîcheur du vent, la nuit et la ville,
« comme le souffle engouffré soudain par une porte ouverte révèle la
22 Ibid., p. 265.
23 Ibid., p. 263.
24 R. Barthes, « Une tragédienne sans public » [1954], in OC I, p. 493.
25 Id., « “Le Prince de Hombourg” au TNP » [1953], in OC I, p. 247-248.
26 Ibid., p. 248.
Modernites34.indd 41 19/09/12 11:19
42 Maria O’Sullivan
Nature, la saison, le climat et le temps du jour plus sûrement que toutes
les choses décrites27 ». La sensation corporelle est ici une conscience de
lieu, mais elle est aussi liée au pressentiment de l’événement tragique
chez le spectateur, en un « avènement » qui est, pour Barthes, l’essence
même de la tragédie. L’avènement est ce qu’on voit advenir de loin :
Toute tragédie est une Annonciation, et la scène doit y être physiquement
ouverte pour que l’événement puisse y être mesuré de loin et que tout mes-
sage, avant d’être dit, soit comme solennellement suspendu dans ce délai tra-
gique où il ne manque plus que la sanction des mots pour que le malheur soit
certain28.
Alors que Sur Racine, dix ans plus tard, évoquera l’espace clos où
évoluent le héros ou l’héroïne raciniens, et les coulisses (l’Extérieur)
d’où surgissent leurs messagers, augures de mauvaise fortune, on voit
ici ces « porteurs de nouvelles et de drame » trotter ou accourir de
loin, bien avant qu’ils soient à portée de voix29. L’espace de la sensation
est donc un espace de prévision, d’intuition de ce qui va advenir qui se
communique hors du langage. Il est situé en dehors de l’espace délimité
et encadré de l’intellection-décor – les signes clairs et intellectifs de
la tragédie antique n’auraient pas autant de valeur pour ce Barthes
spectateur en plein air. Si dans la tragédie antique Barthes perçoit
une unité entre le corps de l’acteur et la signification intellective qu’il
juge admirable, dans les modes de théâtre plus modernes il décèle un
écart entre la sensation corporelle du spectateur et une signification
intellective trop didactique.
La question de l’identification « passionnelle » du spectateur de
théâtre avec le personnage et la possibilité de sa réponse émotionnelle
morale et sociale revient dans les écrits barthésiens consacrés au
dramaturge allemand Bertolt Brecht. À la recherche d’un nouveau
théâtre populaire qui différerait du théâtre traditionnel et bourgeois,
Barthes s’est emparé du théâtre brechtien avec enthousiasme et a écrit
neuf articles sur le dramaturge allemand entre 1954 et 1958. Or le
fameux Verfremdungseffekt ou « effet de distanciation » brechtien
visait précisément à briser l’identification émotive du spectateur avec
les personnages représentés, afin de tirer son attention sur la situation
politique qui règle leurs vies. Sous l’influence de Brecht, quelques-uns
des premiers textes de Barthes sur ce dernier semblent répéter cette
opposition entre l’émotion et l’intellection : dans « Le comédien sans
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid.
Modernites34.indd 42 19/09/12 11:19
Barthes, art et émotion 43
paradoxe » (1954), Barthes voit « l’intelligence du public » comme
justification finale du spectacle et il se plaint des acteurs bourgeois
pour mettre au contraire l’accent sur « l’émotion du personnage et
la sentimentalité du spectateur30 ». Pourtant, il est d’autres textes
où Barthes trouve dans l’œuvre de Brecht, sinon de l’émotion, du
moins de la sensation, « cette espèce d’évidence viscérale qui naît de
la confrontation du regardant et du regardé, et qui est la fonction
constitutive du théâtre31 ». La sensation corporelle des spectateurs
est donc toujours, plutôt que de l’émotion, le mode de perception non
intellectuelle le plus acceptable pour Barthes. Bien des textes sur
Brecht visent au demeurant à abolir l’opposition entre l’intellection
et l’émotion. Il affirme ainsi en 1955 que Brecht nous montre qu’« il
ne faut pas avoir peur de penser intellectuellement les problèmes de
la création théâtrale » et ajoute qu’« on nous fait un casse-tête des
incompatibilités prétendues entre l’intelligence et l’art, entre le cœur
et la raison32 ». Bien que Barthes semble vouloir surmonter la vieille
opposition entre l’émotion et l’intellection dans le but principal de
justifier une lecture intellectuelle du théâtre comme signe politique,
il finit en fait par désigner un mode de réponse de la part du
spectateur brechtien qui combinerait l’émotion et l’intellection. Selon
lui, le spectateur brechtien subit une identification partielle avec le
personnage. Comme spectateur nous pouvons identifier avec Mère
Courage, mais nous pouvons aussi voir objectivement à quel point elle
est aveugle sur sa situation politique :
Ainsi le théâtre opère en nous, spectateurs, un dédoublement décisif : nous
sommes à la fois Mère Courage et ceux qui l’expliquent ; nous participons à
l’aveuglement de Mère Courage et nous voyons ce même aveuglement, nous
sommes acteurs passifs empoissés dans la fatalité de la guerre, et spectateurs
libres, amenés à la démystification de cette fatalité33.
Au cœur même d’un système de pensée qui semble rejeter l’émotion
au profit de l’intellection, Barthes réserve donc un rôle important
pour l’émotion comme étape nécessaire dans la création d’une vision
30 R. Barthes, « Le comédien sans paradoxe » [1954], in OC I, p. 514.
31 Id., « Théâtre capital », art. cité, p. 504.
32 Id., « Pourquoi Brecht ? » [1955], in OC I, p. 576. Il dit encore, dans un article de 1963, que
Brecht « a accepté de penser le théâtre intellectuellement, abolissant la distinction (rancie mais
encore vivace) entre la création et la réflexion, la nature et le système, le spontané et le ration-
nel, le “cœur” et la “tête” ; son théâtre n’est ni pathétique ni cérébral ; c’est un théâtre fondé »
(« Littérature et signification », in Essais critiques [1964] et OC II, p. 509).
33 Id., « Mère Courage aveugle » [1954], in Essais critiques [1964] et OC II, p. 312.
Modernites34.indd 43 19/09/12 11:19
44 Maria O’Sullivan
qui joue sur un double niveau34. Il y a ici une conjonction nette entre
la pensée de Barthes et celle de Mikhaïl Bakhtine, qui décrit le même
processus de projection émotive suivie d’un retour en soi intellectif
par rapport à la création artistique. Pour Bakhtine, l’empathie comme
pouvoir d’habiter la souffrance de l’autre est tout à fait essentiel pour
l’artiste. Cependant, elle doit être suivie d’un retour en soi, en position
objective en dehors de l’autre, pour que la création artistique puisse
avoir lieu :
L’activité esthétique au sens propre commence effectivement au moment où
nous retournons en nous-mêmes, où nous regagnons notre propre place hors
de celui qui souffre, et où nous commençons à donner forme et finition au
matériau que nous avons recueilli à la faveur de notre projection sur l’autre
et de notre expérience de l’autre depuis son propre moi35.
Bakhtine décrit le processus créatif de l’auteur plutôt que celui du
lecteur, mais on peut néanmoins dresser un parallèle entre ses idées
relatives à la création artistique et celles de Barthes concernant la
réponse active et participative du spectateur – même dans ces textes
écrits assez tôt dans l’œuvre de Barthes, le spectateur et le lecteur
barthésiens sont doués d’un pouvoir de réponse créateur essentiel.
Dans le théâtre brechtien, l’émotion proprement dite devient essentielle
pour Barthes. Cependant, la validité de la réponse émotionnelle est
conférée par sa récupération par l’intellection en deuxième étape et
elle ne fait que partie initiale d’un processus global d’intellection. Le
spectateur finit donc par voir le personnage brechtien de l’extérieur,
mais c’est du point de vue d’une extériorité qui comprend et non pas
celle qui resterait démunie et perplexe devant un objet incongru tel
que le chat jaune de Chateaubriand.
2. Le tableau
Passer de l’intérêt barthésien pour le théâtre à celui pour l’image,
c’est aborder ses textes des années 1960 et 1970 et suivre une certaine
évolution de sa pensée. C’est aussi tout un changement du point de vue
de la mobilité : la valorisation de la durée et du continu, qui caractérise
l’essentiel de son travail sur le théâtre, fait place à un intérêt pour
l’immobile et le fragmentaire. Barthes était lui-même conscient
34 On sait à quel point la vision ou la compréhension à plusieurs niveaux s’avérera importante
dans les derniers textes de Barthes – voir, par exemple, l’idée des « amphibologies » dans
Roland Barthes par Roland Barthes, op. cit., p. 650-652.
35 Mikhaïl Bakhtine, « Author and Hero in Aesthetic Activity », in Art and Answerability : Early
Philosophical Essays by M. M. Bakhtin, éd. Michael Holquist et Vadim Liapunov, Austin,
University of Texas Press, 1990, p. 26.
Modernites34.indd 44 19/09/12 11:19
Barthes, art et émotion 45
de cette situation dans un texte qu’il a écrit en 1960 qui commente
des photographies d’une représentation de la pièce de Brecht, Mère
Courage et ses enfants : « Un préjugé constant, que j’ai partagé, c’est
de croire à une spécialité du spectacle, et d’opposer par conséquent
peinture et théâtre au nom du mouvement et de la durée36. »
Barthes, cependant, ne délaisse pas complètement le spectacle :
deux de ses textes qui ont le plus fait pour établir une esthétique
du tableau, « Commentaire : Préface à Brecht » (1960) et « Le
troisième sens » (1970) prennent pour sujet des photographies fixant
les moments d’une représentation : théâtrale pour le premier (Mère
Courage et ses enfants, de Brecht), filmique pour le second (le cinéma
d’Eisenstein) 37. C’est dans sa capacité d’arrêter et de fragmenter
une œuvre d’art qu’il faut comprendre l’intérêt nouveau que porte
Barthes à l’image et à l’instant. À l’opposé des photos de La Chambre
claire, ces photographies ou photogrammes interrompent, non pas la
vie quotidienne, mais plutôt un geste artistique qui est déjà un objet
complet, c’est-à-dire la pièce de théâtre ou le film38. L’œuvre artistique,
nous dit Barthes, est au fond d’une nature discontinue parce qu’elle
construite à partir d’une série de tableaux. C’est le fait fondamental
que révèle la photographie d’une pièce de Brecht ou le photogramme
d’un film d’Eisenstein. Photographier une œuvre d’art inscrite dans
le temps comme le théâtre, c’est accomplir un geste d’isolement,
de fragmentation et de création, comme le geste de découpage de
l’aruspice. Mais le fond sur lequel s’opère ce geste est déjà lui-même
un découpage, c’est-à-dire une œuvre artistique. La photographie de
l’objet d’art est donc un geste fait sur un geste.
Il existe pourtant un troisième niveau dans la photo ou le tableau,
où le geste artistique se mêle pleinement avec le geste du corps humain :
c’est le pouvoir du détail imprévisible à nous frapper :
Le détail brechtien a pour fonction de rompre la continuité, l’empâtement du
tableau ; mais le tableau a exactement la même fonction par rapport à l’œuvre
36 R. Barthes, « Commentaire : Préface à Brecht, “Mère Courage et ses enfants” (avec des photo-
graphies de Pic) » [1960], in OC I, p. 1075-1076.
37 Ibid., p. 1064-1082 ; « Le troisième sens », art. cité, p. 485-486.
38 On pourrait dire par conséquent qu’il n’est pas sûr que la photo accède uniformément au stade
de l’objet d’art dans la pensée barthésienne, autant qu’elle a pour but l’enregistrement du réel,
et non pas la création artistique d’une image. Il est indubitable que le punctum qu’évoquent
les photos dans La Chambre claire nous donne une des expressions les plus fortes de la réponse
émotive provoquée par l’objet d’art chez Barthes. Cependant, la plupart des photos dans ce
texte sont des photos de reportage ou de famille qui n’ont pas pour but un geste artistique. Le
photographe est là pour capturer le réel, mais sa présence dans sa photo à travers ses choix de
sujets ne garantit pas l’intention de transformation artistique.
Modernites34.indd 45 19/09/12 11:19
46 Maria O’Sullivan
tout entière : il la brise, veut ouvertement épuiser toutes les significations
du moment. […] le geste (et par extension le tableau) est une citation, il est
construit pour rompre une cohérence, un empoissement, pour étonner, pour
distancer39.
L’art est donc un geste qui découpe et fragmente et qui change de
perception – comme Barthes le remarque à plusieurs reprises, tout l’art
de Nicolas de Staël est dans deux centimètres carrés de Cézanne. Et ce
que l’art découpe souvent, pour Barthes, est le corps humain. Comme
le sculpteur Sarrasine dans la nouvelle de Balzac, qui « dépèce » le
corps de ses modèles (la jambe de l’une, le sein de l’autre, etc.) pour
trouver la beauté idéale, le détail qui suscite de l’étonnement et de
l’émotion chez Barthes vient souvent d’un aspect quelconque du corps
de l’autre dans le fragment figé de l’art :
[Q]uelques substances fraîches, fragiles […], dans le col entrouvert d’une
chemise, la peau d’un visage, un pied nu, le geste enfantin d’une main, une
casaque trop courte ou à moitié attachée 40.
Figé dans le tableau, le geste suspendu, immobilisé, est doté d’un
pouvoir émotif encore supérieur à celui qu’avait au théâtre le geste
dramatique prolongé de Maria Casarès. Il apparaît également dans
« Le monde-objet », article de 1953 où Barthes décrit le numen, ce
geste dont la fonction est de signifier sans l’accomplir le mouvement
infini, « éternisant seulement l’idée du pouvoir41 ». Ainsi de Napoléon
sur le champ de bataille d’Eylau (1808), par Antoine-Jean Gros, dont
la force principale du tableau réside dans la main levée de l’Empereur,
« grosse de toutes les significations simultanées », produisant « la
fantasmagorie d’un pouvoir étranger à l’homme42 ». Dans son texte
sur les photographies des représentations brechtiennes, écrit en
1960, Barthes suggère que les détails corporels ont pour fonction le
chiffrement de la vulnérabilité du corps humain – le signifié, c’est que
« l’homme est aimable43 ». Dans les deux cas, le corps dans l’art serait
clairement significatif, et l’émotion qu’il peut susciter fonctionne
toujours en service d’une l’intelligibilité intellectuelle. En 1970, en
examinant de près des photogrammes des films d’Eisenstein, Barthes
reçoit la même charge affective des détails isolés des corps des acteurs
dans les images fixes. Cette fois, cependant, il n’assigne pas une
39 R. Barthes, « Commentaire : Préface à Brecht… », art. cité, p. 1075.
40 Ibid., p. 1069. Ce qui est frappant, c’est que ces détails sont tous du genre de gestes corporels
qui vont attirer la réponse émotive de Barthes dans les textes comme La Chambre claire.
41 R. Barthes, « Le monde-objet » [1953], in Essais critiques [1964] et OC II, p.1180.
42 Ibid.
43 R. Barthes, « Commentaire : Préface à Brecht… », art. cité, p. 1070.
Modernites34.indd 46 19/09/12 11:19
Barthes, art et émotion 47
signification nette et finale à cette charge. Si elle véhicule un sens,
c’est un « sens obtus », qui est « un signifiant sans signifié44 ». La force
de « signifiance » est sentie parce qu’elle frappe celui qui regarde les
images d’une émotion qui point :
Je crois que le sens obtus porte une certaine émotion ; […] c’est une émotion
qui désigne simplement ce qu’on aime, ce qu’on veut défendre ; c’est une émo-
tion-valeur, une évaluation45.
Tout ce qu’on peut faire avec une telle réponse émotionnelle est non
pas d’essayer de l’expliciter, mais seulement de le dire. Dans ses efforts
pour identifier le locus de cette force émotive, Barthes ne peut que
dire :
[C]’est une certaine compacité du fard des courtisans […] ; c’est le nez « bête »
de l’un, c’est le fin dessin des sourcils de l’autre, sa blondeur fade, son teint
blanc et passé, la platitude apprêtée de sa coiffure […] 46.
On est dans le monde du « C’est ça ! », expression de Barthes qui
désigne le moment où le langage ne peut plus que marquer le détail qui
suscite l’émotion. L’art visuel, tant qu’il se défait du langage, produit
des réactions immédiates qui ont du mal à se traduire en langage. On
est loin ici des émotions codifiées louées dans « Pouvoirs de la tragédie
antique », où les gestes corporels des acteurs étaient dotés d’une
signification claire et explicite. La réponse émotionnelle individuelle
est rachetée, non pas comme moyen de s’identifier avec le personnage
représenté, ou comme première étape en voie d’intellection, mais plutôt
comme la fondation légitime de toute évaluation de l’œuvre d’art. Elle
marque ainsi le fait que l’œuvre d’art est, comme le dit Barthes, une
scène où se passe quelque chose : la rencontre d’un sujet regardant
avec un objet regardé, émouvant dans son étrangeté et son extériorité
même.
Conclusion
Dans « Le monde-objet », Barthes évoque un autre moment du
numen, cette fois dans les tableaux de corporations (Doelen) hollandais.
Il réside en particulier dans les yeux des patriciens, arrogants et sûrs de
leur autorité, qui regardent curieusement celui qui vient les regarder
à son tour. Cette rencontre entre le sujet regardant et l’objet regardé
produit une profondeur qui « ne naît qu’au moment où le spectacle
lui-même tourne lentement son ombre vers l’homme et commence à
44 Id., « Le troisième sens », art. cité, p. 500.
45 Ibid., p. 493 ; c’est Barthes qui souligne.
46 Ibid., p. 487.
Modernites34.indd 47 19/09/12 11:19
48 Maria O’Sullivan
le regarder47 ». Pour Barthes, l’art visuel fonctionne à travers cette
rencontre entre le spectateur et l’objet représenté, où une rencontre
et une communication quelconques sont établies. Au fur et à mesure
que développe l’œuvre de Barthes, cette communication qui existe
entre le spectateur et l’objet devient plus émotive qu’intellective. Les
objets encadrés ou découpés qui semblent susciter la réponse émotive
la plus forte chez Barthes sont les corps d’autrui. À cet égard, Barthes
expose les liens inévitables qui existent entre ses émotions et ses désirs.
Le corps de l’autre offre la possibilité d’un rapprochement érotique
et de la transformation désireuse d’un objet qui resterait autrement
insaisissable et au bord de la signification, comme le chat jaune de
Chateaubriand. Nous avons vu que la question du geste (corporel
ou artistique) renvoie à celle de découpage. L’art est donc créé par
un geste de découpage, mais la force émotive ou non intellective de
l’objet d’art ne découle pas de ce geste de délimitation. Elle existe
plutôt quelque part d’autre, soit dans l’espace ouvert et illimité qui
entoure le cadre du décor du théâtre en plein air, soit dans le plus
petit geste corporel imprévu à l’intérieur même du tableau encadré. Il
faudrait peut-être, en pensant le geste de découpage qu’est la création
artistique, se rappeler la distinction que fait Barthes entre l’acte et le
geste dans un de ses textes sur le peintre Cy Twombly :
L’acte est transitif, il veut seulement susciter un objet, un résultat ; le geste,
c’est la somme indéterminée et inépuisable des raisons, des pulsions, des
paresses qui entourent l’acte d’une atmosphère […]. Distinguons donc le
message, qui veut produire une information, le signe, qui veut produire une
intellection, et le geste, qui produit tout le reste (le « supplément »), sans for-
cément vouloir produire quelque chose. L’artiste […] est par statut un opé-
rateur de gestes : il veut produire un effet, et en même temps ne le veut pas
[…] 48.
L’art est donc toujours un élément de l’acte, en tant qu’il fragmente
et encadre, et qu’il cherche à créer de la signification. Il atteint sa
pleine nature de geste dans l’émotion que l’acte de délimiter crée
autour des bords qu’il impose, un débordement que Barthes lit dans
et avec le corps.
Maria O’Sullivan
Balliol College, University of Oxford
47 R. Barthes, « Le monde-objet » [1953], art. cité, p. 291-292.
48 Id., « Cy Twombly ou Non multa sed multum » [1979], in L’Obvie et l’Obtus [1982] et OC IV,
p. 706 ; c’est Barthes qui souligne.
Modernites34.indd 48 19/09/12 11:19
Barthes, art et émotion 49
Bibliographie
Bakhtine, Mikhaïl, « Author and Hero in Aesthetic Activity », in Art and
Answerability : Early Philosophical Essays by M. M. Bakhtin, éd. Michael
Holquist et Vadim Liapunov, Austin, University of Texas Press, 1990 ; éd.
fr. : « L’auteur et le héros », in Esthétique de la création verbale, trad. du
russe par Alfreda Aucouturier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées »,
1984, p. 25-210.
Barthes, Roland, Le Degré zéro de l’écriture, Paris, Éd. du Seuil, coll.
« Pierres vives », 1953 (Œuvres complètes [abrégé en OC I à V], t. I, p. 169-
225).
—, « “Le Prince de Hombourg” au TNP », Lettres nouvelles, no 1, mars 1953
(OC I, p. 245-252).
—, « Le monde-objet », Lettres nouvelles, no 4, juin 1953, in Essais critiques,
Paris, Éd. du Seuil, coll. « Tel Quel », 1964, p. 19-28 (OC II, p. 283-292).
—, « Pouvoirs de la tragédie antique », Théâtre populaire, no 2, juillet-
août 1953 (OC I, p. 259-267).
—, Michelet, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Écrivains de toujours », 1954 (OC
I, p. 291-449).
—, « Une tragédienne sans public », France-Observateur, 27 mai 1954 (OC
I, p. 493-496).
—, « Théâtre capital », France-Observateur, 8 juillet 1954 (OC I, p. 503-
505).
—, « Le comédien sans paradoxe », France-Observateur, 22 juillet 1954 (OC
I, p. 512-514).
—, « Mère Courage aveugle », Théâtre populaire, no 8, juillet-août 1954, in
Essais critiques, op. cit., p. 48-50 (OC II, p. 311-313).
—, « Pourquoi Brecht ? », Tribune étudiante, no 6, avril 1955 (OC I, p. 575-
577).
—, « Commentaire. Préface à Brecht, “Mère Courage et ses enfants” (avec
des photographies de Pic) », L’Arche, 1960 ((OC I, p. 1064-1082).
—, « Littérature et signification », Tel Quel, no 16, 1963, in dans Essais
critiques, op. cit., p. 258-276 (OC II, p 508-525).
—, « Trois fragments », Gulliver, no 0, non paru, 1964 (OC II, p. 559-562).
—, « La voyageuse de nuit », préface à Chateaubriand, La Vie de Rancé,
Paris, UGE, coll. « 10/18 », 1965 ; repris sous le titre « Chateaubriand :
“Vie de Rancé” » dans Le Degré zéro de l’écriture, suivi de Nouveaux essais
critiques, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Points », 1972, p. 106-120 (OC IV,
p. 55-65).
—, « Le discours de l’histoire », Information sur les sciences sociales, VI,
no 4, août 1967, in Le Bruissement de la langue (Essais critiques IV), Paris,
Éd. du Seuil, coll. « Points-essais », 1984, p. 163-177 (OC II, p. 1250-1262).
Modernites34.indd 49 19/09/12 11:19
50 Maria O’Sullivan
—, « L’effet de réel », Communications, no 11, mars 1968, p. 84-89, in Le
Bruissement de la langue, op. cit., p. 179-187 (OC III, p. 25-32).
—, S/Z, Paris, Éd. du Seuil, coll. « coll. « Tel Quel », 1970 ; rééd. coll.
« Points », 1976.
—, « Le troisième sens. Notes de recherche sur quelques photogrammes de
S. M. Eisenstein », Cahiers du cinéma, no 222, juillet 1970, in L’Obvie et
l’Obtus (Essais critiques III), Paris, Éd. du Seuil, coll. « Points-essais »,
1982, p. 43-61 (OC III, p. 485-506).
—, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Éd. du Seuil, coll.
« Écrivains de toujours », 1975 (OC IV, p. 575-771).
—, « Sagesse de l’art », in Cy Twombly, Paintings and Drawings : 1954-1977,
catalogue d’exposition, New York, Whitney Museum of American Art, 1979,
in L’Obvie et l’Obtus, op. cit., p. 163-178 (OC V, p. 688-702).
—, « Cy Twombly ou Non multa sed multum », in Yvon L ambert, Cy Twombly :
catalogue raisonné des œuvres sur papier, t. VI, Milan, Multhipla edizioni,
1979, in L’Obvie et l’Obtus, op. cit., p. 145-162 (OC V, p. 703-720).
—, La Chambre claire : note sur la photographie, Paris, Cahiers du cinéma
– Gallimard – Seuil, 1980 (OC V, p. 785-892).
—, Œuvres complètes, nouv. éd. revue, corrigée et présentée par Éric Marty,
Paris, Éd. du Seuil, 2002, t. I (1942-1967), II, (1966-1973), III (1968-1971),
IV (1972-1976), V (1977-1980).
—, La Préparation du roman I et II : cours et séminaires au Collège de
France (1978-1980), texte établi, annoté et présenté par Nathalie Léger,
Paris, Éd. du Seuil – IMEC, coll. « Traces écrites », 2003.
—, Journal de deuil [1977-1979], texte établi, annoté et présenté par Nathalie
Léger, Paris, Éd. du Seuil – IMEC, coll. « Traces écrites », 2009.
Modernites34.indd 50 19/09/12 11:19
Sensibilité et insensibilité : des larmes à l’indifférence
Faire l’histoire des larmes ou de l’indifférence, objets liquides ou
évanescents, implique un questionnement méthodologique original
pour les définir en situation à l’aide de concepts opératoires souvent
issus des sciences sociales. C’est en parcourant tour à tour ces deux
terrains d’étude, manifestations des émotions et absence de sentiment
présenté, que seront évoqués également les rapports entre histoire et
littérature. En effet, concernant l’histoire des sensibilités, l’étude des
textes littéraires constitue un passage obligé et un exercice délicat au
regard des deux disciplines : je remercie les participants au séminaire
« Émotions esthétiques » de m’avoir ouvert de nouvelles pistes par la
discussion qui a suivi l’exposé dont est tiré cet article1.
1. Les larmes ont une histoire
Pourquoi les larmes ? De l’œil humide aux flots de pleurs, du regard
brouillé aux sanglots, les larmes ont aussi une histoire, qui permet
de réfléchir aux manières subtiles ou contraintes, selon l’époque et la
société, de les utiliser. Norbert Elias, le grand sociologue allemand, et
Roland Barthes, le sémiologue subtil, avaient chacun appelé de leurs
vœux une histoire des larmes, et répondre à cet appel devenait une
heureuse nécessité en s’appuyant sur leurs travaux.
Les échanges de larmes et leurs places dans les enjeux des Lumières
n’ont pas de vrais précédents et peuvent se résumer ainsi :
1 Université Bordeaux 3, séminaire interdisciplinaire « Émotions esthétiques », 4 avril 2012.
Modernites34.indd 51 19/09/12 11:19
52 Anne Vincent-Buffault
– un plaisir de l’échange des larmes, ce que j’ai appelé un modèle
de circulation sensible, fondé sur un fluide cordial que l’on mêle à
l’œuvre dans les métaphores du discours romanesque, mais aussi dans
les scènes de larmes qui empruntent à la gestuelle pathétique ;
– une perception en partie déchristianisée de la douleur d’autrui
comme un intolérable, et non comme source possible de rédemption.
Le spectacle du malheur prend la figure d’un tableau auquel nul ne
peut rester insensible et qui fait pleurer jusque dans les prétoires2 ;
– cette mise en scène du sentiment d’humanité, à la fois naturel et
social met en mouvement les enjeux des Lumières et s’affiche dans les
romans, les pièces de théâtre, mais aussi dans les tribunaux, voire
dans la réaction des passants dans la rue.
Au xviiie siècle, le public court assister aux comédies larmoyantes
et se donne le spectacle de sa propre sensibilité. Hommes et les femmes
partagent avec délice ces signes de sensibilité qui les rassemblent en
s’opposant au modèle de cour, qui requiert de maitriser ses émotions.
L’homme et la femme sensible deviennent une figure du débat public.
Née de la sphère publique littéraire, la mode des larmes envahit les
assemblées et les foules, les grandes scènes publiques de la Révolution
française (comme en témoigne l’épisode du baiser Lamourette). À
ce titre, l’émotion fait l’histoire et peut provoquer des changements.
L’émotion met en jeu les corps et les mobilise dans l’interaction,
produit des jugements sur les situations qui comportent des enjeux
éthiques et parfois politiques. Autour de la Révolution se noue un
conflit d’interprétation au sujet de la sensibilité et de la pitié.
À partir de sources littéraires, médicales, judiciaires, de journaux
intimes, de traités de savoir-vivre et de manuels d’éducation, se
découvre un xviiie siècle aux larmes facilement versées en public,
qui témoignent de la sensibilité et du sentiment d’humanité, et un
xixe siècle où chacun aime pleurer dans le secret et la pudeur, et qui,
dans sa seconde moitié, va tenter de mettre de l’ordre dans les pleurs.
Devenues inquiétantes, les larmes sont suspectes, et les femmes sont
au centre du discours : victimes ou manipulatrices de leurs larmes,
leur puissance émotive doit être contrôlée… Par exemple, les larmes
féminines sont à la fois liées à leur nature, mais peuvent être un moyen
d’érotiser une scène touchante (Manon Lescaut) ou être interprétées
comme une stratégie, une rhétorique de la faiblesse.
2 Voir, à ce sujet, Sarah M aza, Vies privées, affaires publiques : les causes célèbres de la France
prérévolutionnaire [1993], trad. de l’anglais (États-Unis) par Christophe Beslon et Pierre-
Emmanuel Dauzat, Paris, Fayard, 1997.
Modernites34.indd 52 19/09/12 11:19
Sensibilité et insensibilité : des larmes à l’indifférence 53
La façon dont la subjectivité se manifeste ou non nous éclaire sur ce
qui est considéré comme acceptable, présentable ou intolérable, sincère
ou inauthentique, touchant ou repoussant, normal ou pathologique.
Elle renvoie à une conception de l’expressivité qui est mouvante entre le
xviiie et le xixe siècle : il s’agit de manifester sa sensibilité, ou d’afficher
sa maîtrise sans se livrer aux autres. À ce titre, il importe de repérer
les interprétations portées sur les signes corporels.
Du point de vue théorique, la lecture de Marcel Mauss, qui fait
de l’émotion un signe et parle de sentiment obligatoire et néanmoins
spontané, attendu et intensément vécu, a été essentielle. « On fait
donc plus que manifester ses sentiments, on les manifeste aux autres,
puisqu’il faut les leur manifester3. » Je crois qu’il s’agit là d’un concept
plus opératoire que d’autres. Il ne se limite pas au rituel et peut
expliquer des phénomènes contemporains en insistant sur le caractère
social de la subjectivité des émotions (je pense en particulier à la façon
d’envisager le malheur public ou privé : le sociologue Alain Ehrenberg
insiste sur le paradigme de la santé mentale dans nos jeux de langage
concernant le malheur aujourd’hui4). De cette lecture, je crois que
l’on peut tirer des conséquences.
2. Qu’est ce que cela nous apprend sur l’histoire des
émotions ?
La mode de la sensibilité, la montée du sentimental croisent des
enjeux sociaux et politiques qui peuvent donner lieu à un conflit de
larmes, par exemple sous la Révolution française. L’idée que « ce
n’était pas pareil autrefois » permet un écart salutaire pour qui veut
comprendre et parfois se déprendre du régime d’émotions auquel
nous sommes tenus. Les sentiments apparaissent et se transforment.
Les émotions sont historiques, même si le langage qui dit l’émotion
n’est pas à prendre à la lettre (Alain Corbin parle ainsi de l’inertie
des pratiques langagières5). D’autant que les larmes apparaissent
quand le langage fait défaut (Rousseau exploite cette vicariance des
larmes). Les métaphores véhiculent néanmoins un imaginaire – et au
xviiie siècle, on verse des torrents de larmes –, mais impliquent aussi un
recours à la lecture participative (les lettres des lecteurs de Rousseau
3 Marcel M auss, « L’expression obligatoire des sentiments » [1921], in Œuvres, t. III, Paris, Éd.
de Minuit, 1969, p. 277-278.
4 Alain Ehrenberg, La Société du malaise, Paris, O. Jacob, 2010.
5 Alain Corbin, Le Temps, le désir et l’horreur, Paris, Aubier, 1991, p. 238.
Modernites34.indd 53 19/09/12 11:19
54 Anne Vincent-Buffault
en témoignent : on y pleure beaucoup) et à des scènes de sensibilité du
théâtre au prétoire, et de là à la rue.
Au xixe siècle, la larme rare devient la valeur montante de la
sensibilité masculine, l’œil humide suffit à déceler la sensibilité cachée.
On entre dans l’économie de la rareté. Nous pensons, nous vivons
l’émotion avec les mots et la gestualité de notre temps, mais aussi à
travers les conceptions scientifiques et philosophiques qui tentent de
les appréhender. La théorie des fluides nerveux infléchit la perception
de l’émotivité féminine et la rabat sur les autres humeurs féminines
(les règles et le lait).
À l’issue de l’analyse, l’économie d’un signe corporel s’est modifiée :
humeur noble qui révèle la sensibilité, les larmes se font inconvenantes
quand elles se répandent à l’excès ou à propos de clichés. La
dévalorisation des figures de l’apitoiement, du pathétique ou de la
sentimentalité dessine un clivage à la fois social et sexuel (femmes
et peuple qui pleurent sont tournés en ridicule au xixe siècle, parce
qu’ils sont encore dans cette demande lacrymale). Anne Coudreuse
a travaillé sur le refus du pathos6. On peut faire le même travail
sur la dévalorisation de la sentimentalité. Car c’est manifester des
sentiments convenus, trop s’exposer (ce que Norbert Elias appelle un
processus de déformalisation7). Cette maîtrise de l’émotion n’est pas
totale et rencontre sa limite. Éclater en sanglots révèle une situation de
fragilité, une crise où l’on se trouve hors de soi (les larmes deviennent
symptôme, comme dans la pathologie hystérique ou dans la dépression,
où elles sont inappropriées). L’étrangeté se trouve au cœur de l’intime.
Les larmes masculines ne sont tolérables qu’en de rares occasions,
quand le langage ou l’action ne sont plus possibles, c’est-à-dire face au
désespoir ou à la mort.
La façon dont l’émotion se manifeste nous éclaire sur ce qui est
considéré comme acceptable, présentable ou intolérable, sincère ou
inauthentique, touchant ou repoussant, normal ou pathologique, et sur
la construction sociale de ces normes. Mais il faut à mon avis aller plus
loin que le programme culturaliste ou fonctionnaliste. Une « culture »
n’est pas donnée une fois pour toutes : elle tient principalement aux
pratiques qui la mettent à l’épreuve, en renouvellent la pertinence ou
l’invalident. La dynamique de l’histoire des larmes est de ce point de
vue significative, car elle ne relève pas du temps long, comme on aurait
6 Anne Coudreuse, Le Refus du pathos au xviiie siècle, Paris, Honoré Champion, 2001.
7 Voir N. Elias, La Solitude des mourants [1982], trad. de l’allemand par Sibylle Muller, Paris,
C. Bourgois, 1987.
Modernites34.indd 54 19/09/12 11:19
Sensibilité et insensibilité : des larmes à l’indifférence 55
pu le croire, mais quasiment d’un style de vie où des groupes sociaux
s’affirment dans des conflits d’interprétation. À chaque moment de
l’histoire, les émotions et la manière dont elles se manifestent en sont
transformées. Je prendrais pour exemple l’interprétation des larmes
sous la Révolution française, et en particulier sous la Terreur, telle
qu’elle fut donnée au sortir celle-ci8. Les « âmes sentimentales » ont
fait couler le sang, dit-on alors. Les détracteurs de la Révolution
s’en prennent aux métaphores et à la gestuelle, aux images, aux
clichés de la compassion et du genre pathétique. Les monarchistes
réactivent le modèle chrétien des larmes de repentir et de la douleur
rédemptrice. Le vocabulaire mais aussi la gestualité des émotions en
sont transformés et clivés. Ces effets sociaux se retrouvent dans les
deuils publics au début du xixe siècle. Les cortèges royalistes ravivent
la conception chrétienne des larmes dans le repentir et la contrition.
Par contre, le cortège libéral-républicain aux funérailles du général
Foy, en novembre 1825, connaît encore le modèle des Lumières de la
circulation sensible, dont se moquent les journalistes légitimistes9. Il
s’agit bien d’observer des décalages dans l’usage des émotions selon des
clivages sociaux et politiques. Rien de linéaire ni d’unitaire dans ces
mouvements. Plus étonnant encore, l’interprétation des larmes sous
la Révolution française est encore un marqueur dans l’histoire des
émotions (William Reddy10 et David Denby11, dans la tradition anglo-
saxonne tiennent à distance les larmes révolutionnaires).
Il est devenu maintenant plus évident que l’émotion, qu’elle soit
individuelle ou collective, ne s’oppose pas à la raison comme irruption
de l’irrationnel ou de l’affectif. L’émotion, de ce point de vue, n’est pas
un état psychique interne : elle se vit dans l’interaction et la situation
concrète, en se cherchant et s’essayant (la sociologie de Goffman en
fournit l’illustration pour le contemporain).
8 Voir Anne Vincent-Buffault, Histoire des larmes, xviiie-xixe siècles, Paris, Marseille, Rivages,
1986, chap. v : « Pleurer sous la Révolution française (1789-1794) ».
9 Voir Emmanuel F ureix, La France des larmes : deuils politiques à l’âge romantique, 1814-
1840, Seyssel, Champ Vallon, 2009.
10 William R eddy, The Navigation of Feeling : A Framework for the History of Emotions,
Cambridge, Cambridge University Press, 2001. Il trouve le modèle des Lumières fondé sur des
émotions naturelles plus contraignant pour l’individu que celui du xix e siècle, qui permettrait
une plus grande liberté dans la navigation émotionnelle en cantonnant au privé l’expression des
émotions.
11 David J. Denby, Sentimental Narrative et Social Order in France, 1760-1820, Cambridge,
Cambridge University Press, 1994, où il fait la genèse du sentimentalisme comme style narratif
centré sur le tableau touchant. Il affiche une certaine méfiance à l’égard de l’universalisme des
Lumières et des mobiles cachés de la bourgeoisie sentimentale.
Modernites34.indd 55 19/09/12 11:19
56 Anne Vincent-Buffault
Il s’agit d’une production sociale. Pas seulement, comme le dit
Durkheim, parce qu’il existe des phénomènes d’émotions collectives
indispensables à l’ordre social ou, selon Weber, parce qu’existent
des communautés « émotionnelles » (Gemeinden, dont la traduction
française pose problème12). Les émotions sont des œuvres communes
auxquels plusieurs participent à l’aide d’un répertoire disponible.
Il existe dans l’échange une part d’incertitude qui différencie la
manifestation de l’émotion du langage articulé que l’émotion vient
parfois remplacer. Ce sentiment d’incertitude peut varier selon les
époques et, c’est ce qui est intéressant, il s’accroît au xixe siècle, alors
que le xviiie siècle avait célébré la sensibilité en mettant en place un
code d’apparence crédible13. Une méfiance s’instaure à l’égard des
émotions, preuve de faiblesse et facteur d’incertitude qui se trouve
dans le journal intime de Maine de Biran et l’œuvre philosophique de
Victor Cousin. Les émotions essentiellement mobiles et vagues révèlent
la faiblesse de la nature humaine.
3. Des sources littéraires indispensables, même si elles sont
difficiles à manier
C’est la raison pour laquelle la littérature et l’écriture intime restent
un terrain essentiel, même si les divisions disciplinaires rendent cet
exercice d’interprétation délicat. Nous devons, comme historiens ou
sociologues, nous prévenir d’une lecture trop littérale et les confronter
à d’autres sources.
– C’est en particulier dans les textes littéraires et intimes que se
lisent les contraintes de plus en plus fines qui régissent les attitudes
mais aussi les réactions de rejet qu’elles suscitent (un romantisme qu’on
pourrait dire « structurel », dans la perspective de Norbert Elias14).
Par exemple, si la philosophie du début du xixe siècle, on l’a dit au sujet
de Maine de Biran et de Victor Cousin, se méfie des émotions, preuve
de faiblesse et facteur d’incertitude, les romantiques les exaltent au
même moment. Plusieurs régimes d’émotions cohabitent, s’affrontent,
débattent.
12 Voir, par exemple, Jeanne Favret-Saada, « Weber, les émotions et la religion », Terrain, no 22,
mars 1994, p. 93-108.
13 Richard Sennett, Les Tyrannies de l’intimité [The Fall of Public Man, 1977], trad. de l’anglais
(États-Unis) par Antoine Berman et Rebecca Folkman, Paris, Éd. du Seuil, 1995.
14 Norbert Elias, La Société de cour [1969], trad. de l’allemand par Pierre Kamnitzer et Jeanne
Étoré, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1985, p. 241-242.
Modernites34.indd 56 19/09/12 11:19
Sensibilité et insensibilité : des larmes à l’indifférence 57
– La littérature et la pratique de l’écriture intime constituent un
espace de réflexivité, le lieu d’émergence de nouveaux modèles de
subjectivité pour les lecteurs qui éprouvent des émotions. C’est sans
doute avec la pratique de la lecture romanesque, de la correspondance
et du journal intime que naît, au xixe siècle, une certaine forme
d’intimité faite de confidences, de révélation du secret, d’émotion. Ces
formes de subjectivité ne sont pas intrinsèquement liées aux pratiques
de la vie privée et aux exigences de maîtrise de soi : elles s’y ajoutent,
voire s’y opposent. La littérature et l’écriture intime à cette époque
créent un récit avec du désordre, de l’informe. Un sujet peut se tromper
sur ces propres émotions, et c’est ce que ne cesse de nous apprendre le
roman (de Marivaux à Henry James).
– Loin d’être le pur reflet du réel, la littérature est en souvent
la figure inversée, laboratoire où se formulent, se combinent,
s’expérimentent (par le biais de la fiction qui la rend pensable), « les
pratiques rusées de la relation à autrui15 », selon l’expression de Michel
de Certeau explicitant les formalités des stratégies sociales.
– Je ne suis pas loin de penser, comme Pierre Pachet, que
certains écrivains regardaient déjà eux-mêmes les choses sous l’angle
anthropologique. En décrivant ce qui se présentait à eux (dans les
rues aussi bien que dans le déroulement de leur pensée ou en élaborant
des fictions), ils se rendaient et rendaient leurs lecteurs sensibles aux
variabilités des comportements humains. Ils bâtissaient des institutions
du sens (terme que Vincent Descombes empreinte justement à Pachet,
qui l’avait inventé à propos du dandysme16).
Il va de soi que ces remarques impliquent une sensibilité aux effets
de la littérature sur les lecteurs, qui trouve aujourd’hui des échos avec
les travaux de Martha Nussbaum, de Jacques Bouveresse, de Sandra
Laugier et, bien évidemment, de Stanley Cavell, sur l’activation
complexe des sentiments moraux par les moyens de l’art et sur les
modes de subjectivation qu’ils rendent possibles.
15 Michel de Certeau, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Paris, Gallimard, coll.
« Folio-essais », 1987, p. 128.
16 Vincent Descombes, Les Institutions du sens, Paris, Éd. de Minuit, 1996 ; Pierre Pachet, Le
Premier Venu : essai sur la politique baudelairienne, Paris, Denoël, 1976, p. 97 sqq. Voir aussi
« Entretien avec Pierre Pachet », Rue Descartes, 1/2004, no 43, p. 70-87, publié en ligne : www.
cairn.info/revue-rue-descartes-2004-1-page-70.htm.
Modernites34.indd 57 19/09/12 11:19
58 Anne Vincent-Buffault
4. Affecté désaffecté : l’indifférence
Peut-on faire l’histoire d’un sentiment qui est une absence de
sentiment, qui approche du degré zéro de l’expression ?
Alors que la manifestation de l’émotion fait signe par les larmes,
l’indifférence l’annule. L’attitude indifférente a ceci de paradoxal qu’elle
se définit par ce par quoi (ou par qui) elle refuse d’être affectée. Elle
se veut suffisante sans se suffire. L’indifférence peut être néanmoins
chargée d’émotions paralysantes (inhibition, effroi, désarroi). C’est
parfois une éclipse de la sensibilité, une mise en suspens.
Je limiterai mon propos, dans le cadre des rapports entre histoire
et littérature, à deux axes essentiels. En quoi la littérature a-t-elle
participé à construire la représentation d’une montée de l’indifférence ?
Qu’est-ce que nous apprend le personnage de l’indifférent sur l’histoire
de la subjectivité, et sur le lien établit entre pathologie individuelle et
crise de civilisation ?
D’après cette enquête, l’histoire de la perception de l’indifférence
est indissociable de l’énonciation des causes de son extension. Au
xixe siècle s’affirment ainsi :
– la perception d’une indifférenciation sociale, dans l’anonymat
des grandes villes ;
– la dénonciation des médiocrités de la vie bourgeoise, réputée
indifférente à toute passion ;
– la conséquence de la rationalisation liée au développement de
la science et de l’industrie.
Toutes ces observations convergent pour créer le sentiment d’une
montée de l’indifférence. Ces représentations rendent-elles dicibles un
malaise, et permettent-elles de mettre en mots une atmosphère pesante
d’ignorance mutuelle ?
Partons de l’hypothèse suivante : contrairement à la pensée
systématique des critiques de la démocratie et des changements issus
de la Révolution, l’impureté féconde du roman dont parle Mona Ozouf17
prend acte des contradictions de la démocratie en marche dont elle
est fille18. C’est la raison pour laquelle elle nous permet d’interroger
les représentations de l’indifférence. Mais plus encore, elle met en
forme ce problème de manière plus intéressante et plus subtile que les
17 Mona Ozouf, Les Aveux du roman : le xixe siècle entre Ancien Régime et Révolution, Paris,
Gallimard, coll. « Tel », 2004, p. 347.
18 Nelly Wolf, Le Roman de la démocratie, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes,
2003.
Modernites34.indd 58 19/09/12 11:19
Sensibilité et insensibilité : des larmes à l’indifférence 59
théories, et même celles que pourraient défendre les romanciers – par
exemple, celle de Flaubert sur la démocratie dans sa correspondance.
En effet, c’est le style de Flaubert qui tend à l’indifférence : il développe
un véritable pathos de l’apathie par le style indirect libre, l’usage de
l’imparfait. Avec la difficulté à accommoder l’ensemble et les détails,
Flaubert provoque la ruine d’une conception hiérarchisée de la
description et signe l’apparition de la vision démocratique du réel, où
chaque objet, le moindre caillou ou n’importe quel brin d’herbe valent
autant que les histoires sentimentales d’une femme normande, comme
le dit Jacques Rancière19.
La description et la dénonciation de l’indifférence comme phénomène
social participent d’une histoire à la fois intellectuelle et littéraire.
En effet, les scansions que ces descriptions dégagent nous paraissent
familières : elles commencent avec la société issue de la Révolution
française, que nous découvrirons avec Balzac. Elles se poursuivent
avec la place grandissante de l’argent, de la marchandise, dont nous
ferons l’analyse avec Heine, puis celle de l’industrie et de la science
à la fin du xixe siècle, avec la disparition de la responsabilité dans
un monde régi par la statistique, que nous envisagerons avec Musil.
Enfin, je vous parlerai d’une expérience singulière de l’indifférence
qui fut interprétée comme une pathologie sociale : je veux parler du
journal d’Amiel. La réception de ce journal d’indifférent cultivé fait
figure de symptôme d’une crise de civilisation.
5. La vision démocratique du réel
Dans la littérature, l’indifférence n’est pas seulement un thème,
mais une manière d’écrire et de décrire, un style qui nous la fait sentir,
qui nous la rend palpable. C’est l’analyse d’Auerbach dans Mimésis
qui m’a inspiré20. Lorsque Balzac dans Le Père Goriot, dresse le
tableau des « êtres rassemblés par le hasard21 » à la table de la pension
Vauquer, le lecteur est mis en disposition de sentir cette indifférence
mêlée de défiance, cette distance dans la proximité. Nous verrons
qu’une telle description rend compte de l’inquiétude des lecteurs de
son époque.
19 Jacques R ancière, Politique de la littérature, Paris, Galilée, 2007, p. 48 sqq.
20 Erich Auerbach, Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature occidentale
[1946], trad. de l’allemand par Cornelius Helm, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1977, p. 465
sqq.
21 Honoré de Balzac, Le Père Goriot [1835], in La Comédie humaine, t. III, éd. publ. sous la dir.
de Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 57.
Modernites34.indd 59 19/09/12 11:19
60 Anne Vincent-Buffault
La vie mécanique de l’indifférence rendue palpable
La pension Vauquer fait se côtoyer des personnes dont les situations
sociales passées et présentes sont très différentes. Le hasard de la
grande ville les a regroupés, sans qu’elles se soient choisies, et elles
se côtoient en lieu clos dans la plus complète indifférence et dans une
grande proximité statique, sans bénéficier de l’effet de fluidité de la
foule en marche.
Chacun a des « malheurs » qui ont épuisé sa capacité de compatir.
Personne ne s’intéresse vraiment au malheur d’autrui, sauf à y trouver
des occasions de persiflages et de bavardages à la table qui les réunit
dans l’absence de lien.
Bien sûr, les fortunes diverses des personnages sous la Révolution
expliquent en grande partie ces ignorances volontaires. Personne ne
s’inquiète de vérifier les malheurs des uns et des autres, chacun se sent
impuissant à participer à la douleur des autres. La pension devient
une société complète en réduction où les relations humaines paraissent
détruites dans cette cohabitation de hasard : « il ne restait donc
entre elles que les rapports d’une vie mécanique, le jeu de rouages
sans huile22 ». Le lieu lui-même, triste, sombre et poisseux, provoque
chez le lecteur la sensation palpable de cette « indifférence mêlée de
défiance qui résultait de leurs situations respectives23 », donnant un
effet de réel très prégnant. La littérature balzacienne a pour vocation
de créer un climat, une atmosphère physique et morale dans une
situation historique générale24. La vie mécanique de l’indifférence
nous est rendue palpable dans le roman.
La crainte de l’isolement et la réponse de la littérature
Les romans de Balzac répondent à une forte demande des
lecteurs concernant la compréhension de la vie sociale. La crainte de
l’indifférenciation sourd de ces romans. La multiplication des intérêts,
des ambitions semble créer une situation confuse, une expérience
sociale de la perte des repères, une difficulté de socialisation, une
situation constitutive d’indifférence.
La description littéraire de cette indifférence nous paraît fondatrice
de ce point de vue : elle correspond à l’horizon d’attente des lecteurs
ordinaires de l’époque qui cherchent une meilleure lisibilité du monde
22 Ibid., p. 62.
23 Ibid.
Auerbach, Mimésis, op. cit., p. 465.
24 E.
Modernites34.indd 60 19/09/12 11:19
Sensibilité et insensibilité : des larmes à l’indifférence 61
social, ce que révèlent leurs lettres aux grands écrivains, étudiées par
Judith Lyon-Caen25. Cette hantise de l’indifférenciation se traduit chez
Balzac par la production de nuances infinies qui sollicitent le regard.
Soit l’on s’attache à raviver les distinctions anciennes, soit l’on crée des
vanités nouvelles : l’Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet
multiplient ces mouvements de distinction sur l’échelle sociale. Dans
la grande ville balzacienne, de nouveaux signes de différenciation
apparaissent, tandis que les souvenirs des différences anciennes,
venues de l’existence passée des contemporains, survivent en parallèle
et resurgissent de manière intempestive. La contiguïté de l’aisance et
de la misère, de la futilité et du malheur renforce cette perception.
La multiplication et le nivellement des différences, la concurrence
avec tous semblent engendrer une atmosphère générale d’indifférence
mutuelle. Par ce chatoiement de la différence, le roman balzacien peut
ainsi passer pour un remède à l’indifférence.
Plus encore, la foule devient, comme le dit Walter Benjamin, le
thème pour lequel le public de plus en plus nombreux de lecteurs
passe commande aux écrivains. Balzac, Hugo, Eugène Sue tentent de
répondre à cette foule parisienne, constituée en public, qui exige « de
se retrouver dans le roman de son époque26 ». Hugo, Sue l’ont bien
compris qui furent élus au Parlement.
6. La critique artistique et la dénonciation de l’indifférence
bourgeoise
Se dégage une figure particulière de l’indifférent : le bourgeois. Les
caricaturistes en ont croqué la posture satisfaite dans sa suffisance.
Les physiologistes en dessinent les types et les stéréotypes : l’épicier, le
notaire, le rentier, ce que Max Weber appelle aussi le borné heureux27.
Il vit dans l’acceptation d’une vie tiède, terne, d’un monde sans gloire,
tranquille dans la répétition des jours, de la quiétude bourgeoise.
Cette tiédeur vigilante et assumée résiste et se défend tout à la fois de
l’excès de la dépense aristocratique et du désordre révolutionnaire.
Jamais sans doute autant que sous la monarchie de Juillet le goût de
25 Judith Lyon-Caen, La Lecture et la Vie : les usages du roman au temps de Balzac, Paris,
Tallandier, 2007.
26 Walter Benjamin, « Sur quelques thèmes baudelairiens » [1939/1940], trad. de l’allemand
par Maurice de Gandillac, revue par Rainer Rochlitz, in Œuvres III, Paris, Gallimard, coll.
« Folio-essais », 2000, p. 345.
27 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 3e éd., Tübingen, J. C. B. Mohr, 1947, iv, 10, t. I,
p. 314, cité par Julien F reund, « L’éthique économique et les religions mondiales selon Max
Weber », Archives des sciences sociales des religions, vol. 26, no 26, 1968, p. 21.
Modernites34.indd 61 19/09/12 11:19
62 Anne Vincent-Buffault
l’immobilité et de la routine n’a été érigé en modèle de vie. La critique
de cette attitude contagieuse devient véritable insurrection contre la
tiédeur, dégoût de la fadeur et de l’uniformité, guerre déclaré à l’ennui.
L’ensemble de ce que nous pouvons appeler la critique artistique
de l’indifférence à l’époque romantique repose sur la détestation de ce
culte de l’utile, de l’argent et l’absence des valeurs de l’héroïsme.
Personne mieux que Heinrich Heine dans un article de Lutèce
n’a décrit la source de ce sentiment qui règne sous le gouvernement
Guizot :
Ici règne actuellement le plus grand calme. Une paix de lassitude, de somno-
lence et de bâillements d’ennui. Tout est silencieux comme une nuit d’hiver
enveloppée de neige. Rien qu’un petit bruit mystérieux et monotone, comme
des gouttes qui tombent. Ce sont les rentes des capitaux, tombant sans cesse
dans les coffres-forts des capitalistes, et les faisant presque déborder ; on
entend distinctement la crue continuelle des richesses des riches. De temps en
temps il se mêle à ce sourd clapotement quelque sanglot poussé à voix basse,
le sanglot de l’indigence28.
Heine tend, dans Lutèce, à brosser un « tableau de l’époque jusque
dans les moindres nuances29 » : reportages et réflexions quotidiennes,
commentaires sur la vie politique et économique, visites d’exposition
écrites entre 1840 et 1843 que nous allons justement commenter.
L’ironie, la faculté de saisir le trait significatif caractérisent l’écriture
de Heine. Étranger curieux dans la ville, il dessine, comme il le dit
lui-même, des daguerréotypes.
Le recours au tableau pour donner à sentir l’indifférence est une
manière de mettre le lecteur en tiers. C’est un procédé utilisé par
Michelet, lorsqu’il décrit un tableau hollandais pour faire sentir
les malheurs de la guerre de Trente Ans et l’indifférence cruelle
d’un capitaine face à la misère d’une paysanne qui a perdu toute sa
famille30. Il réactive le pathétique dans une période de glaciation et
d’indifférence, de guerre mécanisée.
Mais le mobile de Heine est différent. Le Salon de 1843 prend sous sa
plume l’aspect d’une visite du climat de l’époque, la marque de l’esprit
du temps. Le regard indifférent d’un chameau assistant à un marché
scabreux, dans un tableau d’inspiration biblique peint par Horace
Vernet, symbolise pour lui l’« indifférentisme » de la bourgeoisie31.
28 Heinrich H eine, Lutèce : lettres sur la vie politique, artistique et sociale de la France, nouv.
éd., Paris, Michel Lévy frères, 1866, LI [4 décembre 1842], p. 289.
29 Ibid., épître dédicatoire [1854], p. 9.
30 Jules M ichelet, Histoire de France, t. XIV, Paris, A. Lacroix, 1877, chapitre premier, p. 5.
31 Ibid., LVII [7 mai 1843], p. 346.
Modernites34.indd 62 19/09/12 11:19
Sensibilité et insensibilité : des larmes à l’indifférence 63
Heine nous livre une description ironique de la peinture bourgeoise,
où règne l’inexpressivité. Tous les sentiments exprimés sur les visages
ne manifestent que des intérêts financiers et les vertus épargnantes,
la tiédeur politique. Une fustigation du Christ ressemble à celle d’un
directeur d’entreprise en faillite se trouvant face à ses actionnaires
courroucés qui lui demandent, sous la forme de bourreaux et de
pharisiens, des comptes après avoir perdu beaucoup d’argent32. Dans
un autre tableau, Guillaume le Conquérant apparaît comme un garde
national qui fait sa faction avec un zèle exemplaire, honore son épouse
et solde régulièrement ses billets à échéance33. L’indifférence souligne
l’anachronisme des sentiments sous les costumes d’époque.
Il semble à Heine, contemplant un tableau, que l’original vivant
ne pensait qu’au montant à payer et que le peintre « regrettait
continuellement le temps qu’il était forcé de prodiguer à cette déplorable
corvée mercenaire34 ». L’ironie romantique ruine le pathétique et
démonte les mécanismes de la relation marchande et de la rente.
7. Les statistiques et le désert des détails : l’indifférence
morale chez Musil
Robert Musil, dans L’Homme sans qualités, tend à opposer son
travail romanesque à la montée de l’indifférence. La science, la loi
des grands nombres, l’homme moyen et objectivé donnent à la vie un
aspect terne et neutre qui s’inscrit au plus près des habitudes sociales,
et pétrifient les sentiments :
[L]’extraordinaire solitude de l’homme dans un désert de détails, son inquié-
tude, sa méchanceté, l’indifférence sans égale de son cœur, sa cupidité, sa
froideur et sa violence, toutes caractéristiques de notre temps, ne peuvent
être autre chose, si l’on en croit ces censeurs, que la conséquence des pertes
que ferait subir à notre âme une pensée aiguisée par la logique35 !
Dans le roman choral de Musil, chaque personnage, devant
l’indifférence du monde moderne, tente de trouver sa voie pour
restaurer des valeurs telles que l’âme, la patrie, la culture ou l’art.
Musil traite leur quête avec ironie dans une série d’histoires parallèles
dont le point d’articulation est Ulrich, qui se donne la liberté
d’indifférence (se mettre en congé de la vie, sans projet).
32 Ibid., p. 341.
33 Ibid., p. 342.
34 Ibid.
35 Robert Musil, L’Homme sans qualités [1930-1932], trad. de l’allemand par Philippe Jaccottet,
et par Jean-Pierre Cometti et Marianne Rocher-Jacquin pour les textes nouveaux, Paris, Éd.
du Seuil, 2004, I, chap. 11 (« L’essai le plus important »), t. I, p. 61.
Modernites34.indd 63 19/09/12 11:19
64 Anne Vincent-Buffault
Ulrich, le héros de L’Homme sans qualités, quitte le monde des
mathématiciens, ces policiers de la logique qui peuplent le monde
de chiffres, malgré son talent prometteur. Il abandonne sa carrière
de mathématicien car il se sent essentiellement substituable. Ainsi,
d’autres aboutiront ce qu’il était en train de tenter dans ses recherches.
« Plus tard, dans une époque mieux informée, le mot destin prendra
probablement un sens statistique36. »
De son expérience scientifique, il retire que la paralysie du
sentiment à la base du comportement objectif a son pendant dans
l’abolition du sentiment dans la vie sociale. Le monde gouverné par la
statistique correspond au principe de raison insuffisante éprouvé par
Ulrich et par la Cacanie tout entière : il correspond à une absence de
cause, une absence de motivation ou de signification, une absence de
nécessité, qu’il s’agisse de la croyance ou de l’action37. Dans un monde
dominé par l’énormité des données statistiques, les probabilités
permettent toutes sortes d’irrégularités que l’on considère comme sans
conséquence sur le cours du monde.
Cette conscience aiguë du nombre, d’être parmi des millions
d’autres, est une expérience historique dont Ulrich tire les conclusions :
« Il s’est constitué un monde de qualités sans homme, d’expériences
vécues sans personne pour les vivre », conclut-il38.
Les individus se déchargent du fardeau de la responsabilité
personnelle, qui se dissout « dans l’algèbre des significations
possibles39 ». Ils se livrent à la négligence ou à l’absence de conscience
sans qu’on puisse tenir qui que ce soit pour responsable. Les victimes
des crimes deviennent abstraites, comme des milliers de personnes
qui sont exposées aux dangers des usines, du chemin de fer et de
l’automobile. Mis à part quelques hommes que leur constitution
psychique rend capables de s’apitoyer de façon systématique sur
le sort de n’importe quelle victime, l’être humain ordinaire est
indifférent à l’égard de ce qui se passe en dehors de son petit cercle.
Cette paralysie du sentiment se transpose dans la vie quotidienne.
« La vie devenait toujours plus uniforme et impersonnelle. Dans les
36 Ibid., III, chap. 8 (« Famille à deux »), t. II, p. 59.
37 Jacques Bouveresse, Robert Musil : l’homme probable, le hasard, la moyenne et l’escargot de
l’histoire, Paris, Éd. de l’éclat, 1993.
38 R. Musil, L’Homme sans qualités, op. cit., II, chap. 39 (« Un homme sans qualités se compose
de qualités sans homme »), t. I, p. 180.
39 Ibid.
Modernites34.indd 64 19/09/12 11:19
Sensibilité et insensibilité : des larmes à l’indifférence 65
plaisirs, les excitations, les délassements, dans les passions même, la
normalisation, la mécanique, la statistique s’insinuaient40. »
Or la grande affaire de Musil est le sentiment, et alors que dans les
deux premières parties du roman, Ulrich prend le parti de l’indifférence,
la fin du livre est consacrée à l’expérimentation sentimentale. Ulrich
décèle dans cette situation un nouveau champ de possibles à explorer
avec sa sœur Agathe. Il décide de résister à l’emprise de la seule logique
et de ne pas se satisfaire du caractère rudimentaire de la connaissance
des émotions. Il fait place au flottement intérieur, à l’indéterminé.
À son plus haut degré d’incandescence, ce qu’il appelle l’autre état
conduit au pouvoir de « modifie[r] le monde avec l’indifférence et
le désintéressement du ciel modifiant ses couleurs41 ». Cette autre
conception de l’indifférence fait penser au neutre de Barthes.
8. Amiel drapé dans son manteau d’indifférence
L’indifférence sociale, au cœur du journal intime d’Amiel et sa
réception après publication, nous livre un angle d’analyse précieux sur
l’interprétation de la crise de la civilisation bourgeoise de la deuxième
moitié du xixe siècle.
L’expérience de l’indifférence est révélée par la pratique du journal
intime, pour ainsi dire de l’intérieur. Amiel se retranche du monde, qui
le tient à distance. Dans la solitude et le retrait, il analyse la perception
du poids d’être un individu, le sentiment d’une impuissance de soi sur
soi. Amiel déplore avec constance son inconsistance et son apathie
dans un journal tenu pendant quarante ans : plus de vingt mille pages.
Lecteur de Tocqueville, Amiel explore les effets de sa singularité
sans personnalité comme une maladie propre à l’âge égalitaire, celui
d’un souverain déchu, menacé par l’impersonnalité. Il présente à cette
époque le sentiment d’une certaine bourgeoisie cultivée du xixe siècle
face aux contraintes de la modernité, et la conscience très aiguë de la
montée de l’individualité aux prises avec la massification, l’anonymat
et de la démocratisation, fruit de l’histoire. En cela, sa lecture du
malaise qui le taraude est politique : « Le spleen deviendra la maladie
du siècle égalitaire42. »
40 Ibid., IV, chap. 46 (« Rayons de lune en plein jour »), t. II, p. 422.
41 Ibid., IV, chap. 58 (« Ulrich et les deux mondes du sentiment »), t. II, p. 525.
42 Henri-Frédéric A miel, journal du 6 septembre 1851 in Journal intime. 1, 1839-1851, texte
établi et annoté par Philippe M. Monnier, avec la collab. de Pierre Dido, Lausanne, L’Âge
d’homme, 1976, p. 1063.
Modernites34.indd 65 19/09/12 11:19
66 Anne Vincent-Buffault
La vie sociale et l’action l’indiffèrent, il se sent étranger aux hommes.
Avec son indécision, son irrésolution et ses scrupules moraux, Amiel
guette sans relâche son propre détachement du monde réel et raconte sa
souffrance d’être indifférent. Une autre humeur le renvoie à sa fierté
de solitaire, à son « autonomie entière et altière », à son « instinct
d’antivasselage43 ». Dans son sentiment inquiet d’une absence, d’un
vide de sentiment, « enveloppé du manteau de l’indifférence, comme
un souverain détrôné et une majesté méconnue44 », Amiel déplore
son destin d’anonyme blessé dans une société qui ne reconnaît pas sa
différence.
Le journal intime devient un monument d’insignifiance, où
l’éloignement de la vie sociale, le manque d’ambition et de volonté
renvoient à une intime indifférence.
Amiel, témoin de l’échec de la toute-puissance de l’individu, tout à
la fois orgueilleux et humilié, se trouve réduit à se conformer à l’ordre
social par aboulie, tout en ne supportant pas la société de masse qui
l’emporte. L’indifférence se loge alors au cœur même de l’intime, le
retrait en son intime devient un phénomène social. Dans « le sentir
que je ne sens pas » que traduit la pathologie de l’indifférence se noue
une réflexivité nouvelle.
Cette tendance a des conséquences politiques et sociales : Amiel
a ceci de paradoxal qu’il respecte avec minutie les règles sociales et
remet en cause des idéaux religieux, moraux, sociaux et scientifiques.
Il ne se révolte pas : c’est un conformiste sans idéal, un indifférent sans
chimère.
« Hamlet protestant », comme le nomme Paul Bourget45, il est le
double indécis du champion de l’action dans le monde de « l’esprit du
capitalisme » de Max Weber. Il s’empêche lui-même d’agir dans un
monde déréalisé : l’idéal ascétique ne le pousse pas à l’action, mais le
réduit à un conformisme qui le taraude.
Par le journal, Amiel tient à distance la société dans laquelle il vit,
avec ses raisons ressassées : « Le statisticien enregistrera un progrès
43 Id., journal du 13 septembre 1866, in Journal intime de l’année 1866, texte intégral publié
avec une introduction et des notes par Léon Bopp, Paris, Gallimard, 1959, p. 422 ; Journal
intime. 6, octobre 1865-mars 1868, texte établi et annoté par Philippe M. Monnier et Anne
Cottier-Duperrex, Lausanne, L’Âge d’homme, 1986, p. 560.
44 Id., journal du 5 avril 1866, éd. Bopp, op. cit., p. 220 ; éd. Monnier, op. cit., p. 312.
45 Paul Bourget, « Henri-Frédéric Amiel », in Essais de psychologie contemporaine, Paris,
Plon-Nourrit, 1920, t. II, p. 258.
Modernites34.indd 66 19/09/12 11:19
Sensibilité et insensibilité : des larmes à l’indifférence 67
croissant et le moraliste un déclin graduel ; progrès des choses, déclin
des âmes46. »
Le journal d’un indifférent
Publié, le journal d’Amiel devient à la fois le prototype d’une
pathologie et la figure-témoin d’une crise de civilisation : il révèle la
banalité de l’échec existentiel.
D’où la lecture qui en a été faite par les moralistes de la fin du
xixe siècle (Renan, Taine, Bourget) comme symptôme d’un malaise
politique dans la culture, de l’impossible adaptation du moi à la vie
moderne. Pour les plus critiques comme Bourget, la maladie du siècle est
liée à l’affaiblissement de la volonté, au nihilisme, au cosmopolitisme.
Ce mal comporte le danger d’une « propagande d’idées et de
sentiments47 » qui provoque la dégénérescence. Le critique français
dénonce l’influence du romantisme et de la philosophie d’outre-Rhin.
Amiel devient une institution, tout comme le journal intime qui,
en cette fin de siècle, se publie, ce qui explique aussi de nombreuses
appropriations.
Les pathologies du rapport au réel
Amiel devient un cas surtout à partir de la lecture qu’en fait le célèbre
médecin Pierre Janet. Celui-ci dégage du journal d’Amiel les traits
du psychasthénique, caractérisé par un sentiment d’abattement sans
remède, provoqué par le scrupule, mais surtout par une inadéquation
à la fonction du réel. « Les fonctions les plus troublées sont les fonctions
qui mettent l’esprit en rapport avec la réalité, l’attention, la volonté,
le sentiment et l’émotion adaptée au présent48. » Le psychasthénique,
souvent cultivé, raisonne avec rigueur, déploie en toute logique les
conséquences de ces symptômes dont il a tout à fait conscience. Amiel,
idéaltype du psychasthénique cultivé, est taraudé par l’impossibilité
de décider, l’aboulie par excès de réflexivité. Dans son univers, plus
rien n’a d’importance ni de saveur. Le sentiment d’absence de relief,
comme celui de faux, de dédoublement, d’éloignement, d’isolement,
d’engourdissement sont rassemblés par Janet sous le terme générique
46 H.-F. A miel, journal du 6 septembre 1851 in Journal intime. 1, 1839-1851, op. cit., p. 1063.
47 P. Bourget, « Avertissement de 1885 », in Essais de psychologie contemporaine, op. cit., t. I,
p. xx.
48 Pierre Janet et Fulgence R aymond, Les Obsessions et la psychasthénie [1908], Paris,
L’Harmattan, 2005, t. II, vol. i, p. 737-738.
Modernites34.indd 67 19/09/12 11:19
68 Anne Vincent-Buffault
d’un sentiment d’absence à la réalité. Avec la perte de la fonction
du réel, l’indifférence devient une tonalité affective où toutes les
possibilités se retirent.
Il semble que la capacité de rationalisation de ces malades menace
le clinicien d’un débat sans fin avec un univers mental tragiquement
cohérent, qui puise dans la philosophie et les inquiétudes métaphysiques
du xixe siècle une capacité de doute illimitée, des interrogations infinies
qui éloignent du réel.
La dépersonnalisation du sujet est corrélative de sa déréalisation
du monde extérieur, d’un manque d’attention à la vie présente, selon
Bergson49. Le philosophe, cherchant à dégager sa propre définition
des troubles psychasthéniques, y voit un amenuisement de l’élan
constitutif de la personnalité : en effet, remarque Bergson : « Lorsqu’on
les examine attentivement, on s’aperçoit que ces désordres sont tous,
sans exception, des formes d’indécision. Et derrière cette indécision
elle-même il y a une cause plus profonde, à savoir le ralentissement de
l’élan normal50 ». Et qu’est-ce que ce ralentissement de l’élan normal,
sinon le déficit de ce que Bergson appelle « la poussée vers l’action51 » ?
Amiel devient un symptôme
Janet et Bergson prennent-ils les effets pour la cause, en dressant
le portrait clinique du psychasthène et en visant la déficience de son
élan vital ? Les moralistes y voient plutôt les effets d’une crise de
civilisation, où les individus, sommés de se particulariser, se révèlent
trop faibles de par leur constitution morbide52.
Cette figure pathologique et sociale est historiquement construite.
Il existe un lien entre diagnostic médical et analyse de la crise de
la culture. Devant cette pathologie nouvellement construite de
49 Comme l’écrit Janet, si la fonction du réel « consiste dans l’appréhension de la réalité sous
toutes ses formes », elle « constitue “cette attention à la vie présente” dont parle M. Bergson
dans un livre de métaphysique qui semble souvent prévoir ces observations psychologiques ».
Ibid., p. 477. Le livre en question est Matière et mémoire, Paris, F. Alcan, 1896, p. 190.
50 Henri Bergson, « Onze conférences sur “La personnalité” aux Gifford Lectures d’Edinburgh,
21 avril-22 mai 1914, trad. Martine Robinet, in Mélanges, textes publiés et annotés par André
Robinet et al., Paris, PUF, 1972, p. 1083.
51 Ibid. Voir Nicolas Cornibert, « Janet et Bergson : psychasthénie et inattention à la vie »,
Documents de travail du département de philosophie de l’université de Poitiers, conférence
prononcée le 8 avril 2005 dans le cadre du séminaire thématique commun du master recherche
Bordeaux-Toulouse-Poitiers, publié en ligne : http ://www.sha.univ-poitiers.fr/philosophie/.
52 Pierre-Henri Castel, « Amiel, ou la métamorphose de l’obsédé », publié en ligne : http://pier-
rehenri.castel.free.fr/Articles/Amiel.htm. Cette analyse m’a particulièrement éclairée, ainsi
que celle de Claude Morali, Qui est moi aujourd’hui ?, Paris, Fayard, 1984.
Modernites34.indd 68 19/09/12 11:19
Sensibilité et insensibilité : des larmes à l’indifférence 69
l’individualisme bourgeois, face à ce mal-être mental, les moralistes
n’hésitent pas à parler de déclin, de déficience ou de dégénérescence
en réveillant les sirènes nationalistes. Car, devant cette maladie de la
volonté, des mesures radicales sont à prendre, en particulier à l’égard
de la jeunesse53.
Conclusion
La vie mécanique dans la société démocratique naissante, que les
écrivains comme Balzac décryptent pour combler une attente, nous
fait sentir l’indifférence : mimésis. Heine invente une nouvelle lecture
du tableau qui dénonce l’indifférentisme bourgeois en neutralisant le
pathétique par l’ironie et fait sentir la platitude. Avec le roman de
pensées de Musil, la question de l’individu, du qualitatif, du variable
s’impose comme centrale. L’élaboration romanesque se mesure à ce
que l’histoire paraît inexorablement privilégier : le règne des valeurs
moyennes, de l’indifférence. À ce titre, la littérature construit
des représentations tout en fournissant une porte de sortie par le
foisonnement des différences et l’éveil de l’émotion, du sentiment. Nous
avons fini sur Amiel et sur la forme subjective de l’indifférence (du
sentir que je ne sens pas), témoignant d’une pathologie de l’individu
démocratique détrôné et empêché dont on peut faire la généalogie :
à partir d’un journal se construit un cas dont s’empare essayiste,
médecin et philosophe, pour en appeler au sens de la volonté et au
pouvoir d’agir à la veille de la Première Guerre mondiale.
Ces traversées me paraissent davantage approcher cet état d’absence
d’émotion, tel que le percevaient les contemporains, que les discours
théoriques sur la montée de l’indifférence : pouvoir de l’art, droit à la
nuance. Dans tout ce qui forme les sensibilités, la touche de gris de
l’indifférence méritait autant d’attention que l’éclat des larmes.
Anne Vincent-Buffault
Historienne. Chercheuse associée au Laboratoire de Changement social
(Université Paris 7)
Bibliographie
A miel, Henri-Frédéric, Journal intime de l’année 1866, texte intégral publié
avec une introduction et des notes par Léon Bopp, Paris, Gallimard, 1959.
—, Journal intime. 1, 1839-1851, texte établi et annoté par Philippe M.
53 Barrès en est le propagandiste le plus influent.
Modernites34.indd 69 19/09/12 11:19
70 Anne Vincent-Buffault
Monnier, avec la collab. de Pierre Dido, Lausanne, L’Âge d’homme, 1976.
—, Journal intime. 6, octobre 1865-mars 1868, texte établi et annoté par
Philippe M. Monnier et Anne Cottier-Duperrex, Lausanne, L’Âge d’homme,
1986.
Auerbach, Erich, Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature
occidentale [1946], trad. de l’allemand par Cornelius Helm, Paris,
Gallimard, coll. « Tel », 1977.
Balzac, Honoré de, Le Père Goriot [1835], in La Comédie humaine,
t. III, éd. publ. sous la dir. de Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 37-90.
Benjamin, Walter, « Sur quelques thèmes baudelairiens » [1939/1940], trad.
de l’allemand par Maurice de Gandillac, revue par Rainer Rochlitz, in
Œuvres III, Paris, Gallimard, coll. « Folio-essais », 2000, p. 328-390.
Bergson, Henri, Matière et mémoire, Paris, F. Alcan, 1896.
—, « Onze conférences sur “La personnalité” aux Gifford Lectures
d’Edinburgh, 21 avril-22 mai 1914, trad. Martine Robinet, in Mélanges,
textes publiés et annotés par André Robinet et al., Paris, PUF, 1972, p. 1051-
1086.
Bourget, Paul, Essais de psychologie contemporaine, Paris, Plon-Nourrit,
1920, 2 vol.
Bouveresse, Jacques, Robert Musil : l’homme probable, le hasard, la
moyenne et l’escargot de l’histoire, Paris, Éd. de l’éclat, 1993.
Castel, Pierre-Henri, « Amiel, ou la métamorphose de l’obsédé », publié en
ligne : http://pierrehenri.castel.free.fr/Articles/Amiel.htm.
Certeau, Michel de, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Paris,
Gallimard, coll. « Folio-essais », 1987.
Corbin, Alain, Le Temps, le désir et l’horreur : essais sur le xixe siècle, Paris,
Aubier, « Collection historique », 1991.
Cornibert, Nicolas, « Janet et Bergson : psychasthénie et inattention à la
vie », Documents de travail du département de philosophie de l’université
de Poitiers, conférence prononcée le 8 avril 2005 dans le cadre du séminaire
thématique commun du master recherche Bordeaux-Toulouse-Poitiers,
publié en ligne : http ://www.sha.univ-poitiers.fr/philosophie/.
Coudreuse, Anne, Le Refus du pathos au xviiie siècle, Paris, Honoré
Champion, coll. « Babeliana », 2001.
Denby, David J., Sentimental Narrative et Social Order in France, 1760-
1820, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
Descombes, Vincent, Les Institutions du sens, Paris, Éd. de Minuit, coll.
« Critique », 1996.
Ehrenberg, Alain, La Société du malaise, Paris, Odile Jacob, 2010.
Elias, Norbert, La Société de cour [Die höfische Gesellschaft, 1969], trad.
Modernites34.indd 70 19/09/12 11:19
Sensibilité et insensibilité : des larmes à l’indifférence 71
de l’allemand par Pierre Kamnitzer et Jeanne Étoré, Paris, Flammarion,
coll. « Champs », 1985.
—, La Solitude des mourants [Über die Einsamkeit der Sterbenden in
unseren Tagen, 1982], trad. de l’allemand par Sibylle Muller, Paris,
Christian Bourgois, coll. « Détroits », 1987.
Favret-Saada, Jeanne, « Weber, les émotions et la religion », Terrain, no 22,
mars 1994, p. 93-108.
Freund, Julien, « L’éthique économique et les religions mondiales selon Max
Weber », Archives des sciences sociales des religions, vol. 26, no 26, 1968,
p. 3-25.
F ureix, Emmanuel, La France des larmes : deuils politiques à l’âge
romantique, 1814-1840, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », 2009.
Heine, Heinrich, Lutèce : lettres sur la vie politique, artistique et sociale de
la France, nouv. éd., Paris, Michel Lévy frères, 1866.
Janet, Pierre et R aymond, Fulgence, Les Obsessions et la psychasthénie
[1908], Paris, L’Harmattan, 2005, 3 vol.
Lyon-Caen, Judith, La Lecture et la Vie : les usages du roman au temps de
Balzac, Paris, Tallandier, 2007.
M auss, Marcel, « L’expression obligatoire des sentiments » [1921], in Œuvres,
t. III, Paris, Éd. de Minuit, 1969, p. 269-278.
M aza, Sarah, Vies privées, affaires publiques : les causes célèbres de la
France prérévolutionnaire [Private Lives and Public Affairs, 1993], trad.
de l’anglais (États-Unis) par Christophe Beslon et Pierre-Emmanuel Dauzat,
Paris, Fayard, 1997.
M ichelet, Jules, Histoire de France, t. XIV, Paris, A. Lacroix, 1877.
Morali, Claude, Qui est moi aujourd’hui ?, Paris, Fayard, 1984.
Musil, Robert, L’Homme sans qualités [1930-1932], trad. de l’allemand par
Philippe Jaccottet, et par Jean-Pierre Cometti et Marianne Rocher-Jacquin
pour les textes nouveaux, Paris, Éd. du Seuil, 2004, 2 vol.
Ozouf, Mona, Les Aveux du roman : le xixe siècle entre Ancien Régime et
Révolution, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2004.
Pachet, Pierre, Le Premier Venu : essai sur la politique baudelairienne,
Paris, Denoël, coll. « Les Lettres nouvelles », 1976.
—, « Entretien avec Pierre Pachet », Rue Descartes, 1/2004, no 43, p. 70-87,
publié en ligne : www.cairn.info/revue-rue-descartes-2004-1-page-70.htm.
DOI : 10.3917/rdes.043.0070.
R ancière, Jacques, Politique de la littérature, Paris, Galilée, coll. « La
Philosophie en effet », 2007.
Reddy, William, The Navigation of Feeling : A Framework for the History of
Emotions, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
Modernites34.indd 71 19/09/12 11:19
72 Anne Vincent-Buffault
Sennett, Richard, Les Tyrannies de l’intimité [The Fall of Public Man,
1977], trad. de l’anglais (États-Unis) par Antoine Berman et Rebecca
Folkman, Paris, Éd. du Seuil, coll. « La Couleur des idées », 1995.
Vincent-Buffault, Anne, Histoire des larmes, xviiie-xixe siècles, Paris,
Marseille, Rivages, coll. « Rivages/histoire », 1986.
Wolf, Nelly, Le Roman de la démocratie, Saint-Denis, Presses universitaires
de Vincennes, coll. « Culture et société », 2003.
Modernites34.indd 72 19/09/12 11:19
Ces émotions à fleur de peau, sans nom pour les désigner
Lorsque j’ai commencé à réfléchir sur la honte – avec l’intuition
qu’elle était, plus que d’autres émotions, un alcool fort de l’écriture –,
j’étais animé par l’ambition d’entreprendre une sorte d’anthropologie
littéraire des émotions. La colère m’apparaissait d’emblée, presque au
même titre que la honte, comme un affect majeur – d’ailleurs, dans
la tradition indienne, honte et colère sont intimement liées –, et je ne
voulais pas me limiter aux passions tristes : je pensais en particulier
à l’éblouissement, au ravissement, à la joie. Je pensais aussi à la
trahison, qui semble sortir du cadre de ce qu’on appelle communément
les émotions. C’est dire si ma définition du mot « émotion » était peu
conceptuelle, si elle mêlait passion, sentiment, ou sensation.
Or il m’est apparu assez vite que les mots ne rendaient pas compte de
la complexité et surtout du caractère composite des émotions ; que si un
psychologue, un anthropologue ou un sociologue ne pouvait se pencher
avec trop d’attention sur l’insuffisance du langage, à moins d’entraver
sa recherche par des considérations lexicales, un littéraire, lui, était
en droit, ou même devait s’interroger sur le cloisonnement des termes
qui, imposant à notre inconscient un répertoire ou une taxinomie,
nous interdit de penser le vague des émotions. C’est pourquoi j’intitulai
mon livre « le livre des hontes1 » et non « de la honte » : il me fallait
signifier une pluralité (honte de l’origine chez Memmi ou Cohen, honte
sociale chez Ernaux ou ontologique chez T. E. Lawrence, honte proche
du sentiment de culpabilité chez Conrad, etc.), voire un nuancier
1 Jean-Pierre M artin, Le Livre des hontes, Paris, Éd. du Seuil, 2006.
Modernites34.indd 73 19/09/12 11:19
74 Jean-Pierre Martin
(les petits hontes, l’embarras, la gêne, la timidité…). Et lorsqu’on me
demandait pourquoi j’avais exploré la honte plutôt que la culpabilité
ou l’humiliation, je répondais que la littérature, comme les situations
affectives qu’elle tente de suggérer, fait assez peu cas de ces distinctions,
et citais volontiers une phrase de Julien Gracq : « tous les mots qui
commandent à des catégories sont des pièges2 ».
Les littéraires savent en effet non seulement que « le langage est par
lui-même l’investigation3 » (Quignard), mais aussi que nommer, c’est
faire exister, et que dire, c’est classer. Après la disparition de Charcot,
on a noté une diminution brutale des malades atteints de la « grande
hystérie » à la Salpêtrière. Lorsque Darwin compare l’expression
des émotions chez les hommes et les animaux, ce rapprochement
est passionnant, mais le naturaliste ne se pose pas la question de la
médiation langagière. On ne saurait le lui reprocher. En revanche,
telle est, je crois, la question propre au littéraire.
De ce fait, il me paraît souhaitable, plutôt que d’aligner la littérature
sur un discours et un savoir préexistant (psychologique ou sociologique),
de l’envisager comme une tentative de penser dans une forme telle qu’elle
exprimerait ce qu’on ne peut dire dans le langage des sciences humaines,
comme une manière d’exprimer le reste, le laissé pour compte, comme un
désir de ne pas se laisser enfermer et dans le code des expressions qui en
prédéterminent la cartographie. Chaque émotion répertoriée est un mot
gigogne, mais aussi un mot couperet, globalisant, autoritaire, qui cache
d’autres mots – ainsi la colère, qui renvoie à des affects assez distincts
tels que la rage, la fureur, l’indignation, l’emportement, le hors de soi,
etc. Il me semblait donc que la taxinomie des émotions simplifiait la vie
émotive un peu à la façon dont la nomenclature des maladies mentales
(nomenclature que nous étions censés retenir au cours de la licence de
philosophie, dans le cadre d’un certificat de psychologie) réduisait la
diversité des pathologies.
Pour décrire les émotions, nous disposons d’un stock de mots grâce
auquel nous croyons les reconnaître. Elles circuleraient d’un corps à
un autre, se mimeraient et se répèteraient telles des copies conformes.
Mais qu’en est-il d’une émotion à laquelle aucun de ces mots ne semble
correspondre ? d’une émotion inattendue, surprenante, indéfinissable,
précaire, qui ne correspond à rien de connu ? Il y a peut-être des
universaux émotionnels, mais c’est l’individuation des émotions,
leur singularité, qui aimante cette « maîtresse des nuances » qu’est
2 Julien Gracq, En lisant, en écrivant, Paris, J. Corti, 1980, p. 174.
3 Pascal Quignard, Rhétorique spéculative, Paris, Calmann-Lévy, 1995, p. 21.
Modernites34.indd 74 19/09/12 11:19
Ces émotions à fleur de peau, sans nom pour les désigner 75
la littérature. C’est aussi leur mixité, leur mélange, leur caractère
hybride : lorsque Tolstoï décrit l’émotion amoureuse d’Anna Karénine,
il ne manque pas de l’associer à la joie, à la frayeur et à la honte, ou
encore à d’autres tonalités affectives encore plus contrastées. C’est
enfin leur physique : l’affect, étymologiquement, est à la fois une
disposition de l’âme et une physique.
Un tel souci n’est pas nouveau. Voyez Mlle de Scudéry. Elle voulut
cartographier le nuancier du cœur amoureux, dessiner son anatomie,
décrire « toutes les jalousies, toutes les inquiétudes, toutes les
impatiences, toutes les joies, tous les dégoûts, tous les murmures, tous
les désespoirs, toutes les espérances, toutes les révoltes et tous ces
sentiments tumultueux qui ne sont jamais si bien connus que de ceux qui
les sentent ou qui les ont sentis4. » Tenter de représenter le spectre des
tonalités émotionnelles dans leur diversité, soit, l’entreprise est louable.
Mais la force de la littérature à l’âge de l’individuation, c’est d’aller
plus loin encore, c’est de viser des qualités d’émotion innommables,
des motilités volatiles, multiformes, mélangées, qui échapperaient au
discours, où la joie, la crainte, la surprise, l’émerveillement, la peur,
l’enthousiasme, la honte, la colère seraient quasiment indécidables ;
c’est encore de faire droit à la singularité, à l’étrangeté de l’affect, à
son ambivalence, à sa réversibilité, à sa fugacité, à son sfumato ; c’est
enfin de privilégier une physique des émotions, un langage du corps, un
sujet tout à la fois émotionnel, passionnel et corporel, tels que Diderot
et Rousseau, à l’opposé du corps-machine de Descartes, l’ont réhabilité,
à la fois dans le récit (par exemple, les scènes d’évanouissement, les
« petits mouvements convulsifs », le cri, la douleur dans La Religieuse
de Diderot, ou encore les répercussions physiques des émotions passées,
ressenties au présent par le sujet qui les revit dans Les Confessions) et
dans la théorie : « Chaque passion a son action propre. Cette action
s’exécute par des mouvements du corps. […] De la liaison des passions
avec les organes naissent la voix ou les cris5. »
Au traitement ostentatoire de l’émotion (traitement tantôt
essentialiste, qui en désigne l’espèce et l’épingle comme un papillon,
tantôt romantique, qui l’absolutise et la sublime) s’oppose un vécu
intraitable de l’émotion qui cherche ses mots. Une telle antinomie entre
langage et émotion, des programmes esthétiques visent à la dénier,
4 Madeleine et Georges de Scudéry, Artamène ou Le grand Cyrus : extraits [1653], éd. par
Claude Bourqui et Alexandre Gefen, Paris, GF-Flammarion, 2005, X, 10, p. 449-450.
5 Denis Diderot, Éléments de physiologie [1778], in Le Rêve de d’Alembert : Idées IV (Œuvres
complètes, t. XVII), éd. par Jean Varloot et al., Paris, Hermann, 1987, p. 487.
Modernites34.indd 75 19/09/12 11:19
76 Jean-Pierre Martin
en confortant la croyance littéraire dans une langue de l’émotion.
Lorsque Céline déclare : « Au commencement était l’émotion6 », on
peut se demander quel commencement est en jeu. Il s’agit bien sûr
ici de produire de l’émotion, de la communiquer au système nerveux
du lecteur (le parlé, dit-il, est « le seul mode d’expression possible
pour l’émotion7 »), mais cette émotion sans prédicat tend à confondre
sous un même mot l’émotion ressentie et le « rendu émotif ». Les effets
émotifs de la langue littéraire, même lorsqu’elle prétend mimer la
spontanéité et le jaillissement du parlé par des phrases de rappel ou
des tournures familières, c’est encore de la rhétorique, jusque dans le
refus manifeste dont elle est l’objet, et jusque dans la façon propre à
Duras de laisser la phrase « dans un état pantelant8 » ; ou encore de ne
pas exprimer les sentiments ou les émotions, mais leur déplacement,
leur symptôme (cri, fatigue, désarroi, gaucherie soudaine, absence au
monde) : « Michael Richardson se dirigea vers elle dans une émotion si
intense qu’on prenait peur à l’idée qu’il aurait pu être éconduit » ; « la
femme entrouvrit les lèvres pour ne rien prononcer9 ».
Au risque de confondre le pathétique et l’émotionnel, ou encore une
émotion fulgurante et un état émotif qui perdure, n’oublions pas le
rapport antithétique entre l’émotion et le langage pour la traduire,
en même temps qu’un écart essentiel entre l’émotion telle qu’elle se
dit et l’émotion telle quelle se ressent. On pense à John Cage cité par
Barthes : « J’ai découvert que ceux qui n’insistent que très peu de
temps sur leurs émotions savent bien mieux que les autres ce qu’est une
émotion10. » Ou bien à cette phrase de Molé visant Chateaubriand, à
propos des effusions de surface : « Il m’a paru qu’il séduisait les femmes
au même titre que ses lecteurs, par cette même faculté de s’émouvoir
sans rien ressentir, de revêtir tous les types, d’emprunter tous les
langages11… » Ou encore, pour ce qui est de l’impuissance des mots, à
Michaux : « En rêve, on n’écrit pas. Le mystique en transe n’écrit pas.
6 Louis-Ferdinand Céline, « Ma grande attaque contre le verbe » [1957], in Le Style contre les
idées : Rabelais, Zola, Sartre et les autres, Bruxelles, Complexe, 1987, p. 67.
7 Id., « Maintenant aux querelles ! », lettre à André Rousseaux, 24 mai 1936, ibid., p. 54.
8 Marguerite Duras à Montréal, textes réunis et présentés par Suzanne Lamy et André Roy,
Montréal, Spirale, 1981, p. 64.
9 Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, Paris, Gallimard, 1964, p. 17, 18.
10 Roland Barthes, La Préparation du roman I et II : cours et séminaires au Collège de France,
1978-1979 et 1979-1980, texte établi, annoté et présenté par Nathalie Léger, Paris, Éd. du Seuil
– IMEC, 2003, p. 127.
11 Mathieu Molé, Souvenirs de jeunesse (1793-1803), éd. présentée et annotée par Jean-Claude
Berchet, Paris, Mercure de France, 1991, p. 263.
Modernites34.indd 76 19/09/12 11:19
Ces émotions à fleur de peau, sans nom pour les désigner 77
Ravi, on n’écrit pas12 » ; « Mais écrire, écrire : tuer quoi13. » Le défi de
la littérature tient en particulier à ce pouvoir ou plutôt à cet impouvoir
qu’elle révèle face à une violence émotionnelle, un phénomène abrupt
– grâce, effroi, sidération, illumination sous le feu d’une musique,
d’une lecture, d’une voix ou d’un corps.
1. Proust, l’émoi et le zut
Bien des lois perturbatrices entravent chez Proust le pouvoir du sujet
émotif à se livrer en toute liberté au rapport de soi à soi : l’asynchronie
des émotions comme le télescopage d’émotions différentes. Ce qui ne
ruine pas d’avance le projet solitaire de relater un « moment de vérité »,
un passage émotif – même si ce projet est dans la vie constamment
entravé par la prose du monde. Proust s’évertue à exprimer une vérité
inatteignable de l’affect. Ce qui lui importe au fond, c’est la possibilité
de « réduire à son essence le plaisir infini d’être ému » (l’expression
est de Valéry14) :
Et voyant sur l’eau et à la face du mur un pâle sourire répondre au sourire
du ciel, je m’écriai dans mon enthousiasme en brandissant mon parapluie
refermé : « Zut, zut, zut, zut. » Mais en même temps je sentis que mon devoir
eût été de ne pas m’en tenir à ces mots opaques et de tâcher de voir plus clair
dans mon ravissement.
Et c’est en ce moment-là encore – grâce à un paysan qui passait, l’air déjà
d’être d’assez mauvaise humeur, qui le fut davantage quand il faillit rece-
voir mon parapluie dans la figure, et qui répondit sans chaleur à mes « beau
temps, n’est-ce pas, il fait bon marcher » – que j’appris que les mêmes émo-
tions ne se produisent pas simultanément, dans un ordre préétabli, chez tous
les hommes15. »
Le « zut », interjection policée, voire distinguée, renvoie à
l’indicible joie éprouvée dans la contemplation de la nature (« ce jour
où passant sur le pont de la Vivonne, le calme de l’ombre d’un nuage
sur l’eau m’avait fait crier : “Zut alors”, en sautant de joie16 »), la
« merveille inconnue17 » d’une matinée de printemps, l’inexprimable
12 Henri M ichaux, « Absence » [1934], in Œuvres complètes, t. I, éd. établie par Raymond
Bellour, avec Ysé Tran, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1998, p. 960.
13 Id., Ecuador [1928], ibid., p. 144.
14 Paul Valéry, Préface à Kikou Yamata, Sur des lèvres japonaises, Paris, Le Divan, 1924.
15 Marcel P roust, Du côté de chez Swann [1913], II, i, in À la recherche du temps perdu, éd.
publiée sous la dir. de Jean-Yves Tadié, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1987-
1989, t. I, p. 153-154.
16 Id., Le Temps retrouvé [1927], Esquisse XXIV, éd. citée, t. IV, p. 819.
17 Id., Du côté de chez Swann, III, éd. citée, t. I, p. 383.
Modernites34.indd 77 19/09/12 11:19
78 Jean-Pierre Martin
ravissement des « joies artistiques18 », ou encore la joie de l’impression
par l’imagination :
Quand déjà une fois le matin du mariage de Montargis, dans la lumière du
soleil dorant la girouette de la maison d’en face, j’avais revu Venise, aussitôt
j’avais voulu y retourner. Maintenant la manière dont venait toujours à moi le
sentiment enivrant de la vie, hors du temps, de l’action présente, m’enseignait
mieux que ce n’était pas à une jouissance dans le temps, à une action qu’il
devait aboutir, car je ne l’y retrouverais pas. Sans doute y avait-il au fond de
nous un être, – celui qui en moi venait de ressentir une telle joie, – qui ne se
nourrissait que de l’essence des choses19.
Quant à l’indicible mélancolie, l’indicible tristesse, la « désolation
du soir20 », cet autre moment de vérité, ce n’est plus le « zut » qui
convient, mais une impression qui étreint le corps, et que le style tentera
de rendre dans ses nuances infinies. L’intermittence des émotions et
surtout des moi émotifs et perceptifs doit constamment s’adapter aux
états changeants de soi et de l’autre – ainsi à l’émotion mouvante suscitée
par une Albertine plurielle, multiple, aux mille visages, qui modifie
la perception, qui fait se succéder les moi émotionnels : « je devrais
donner un nom différent à chacun des moi qui dans la suite pensa à
Albertine ; je devrais plus encore donner un nom différent à chacune
de ces Albertine qui apparaissaient par moi, jamais la même21 ». Dans
ce récit de pensée qu’est la littérature, quelle différence entre une
sensation et une émotion, ou même entre un sentiment et une émotion ?
« L’amour n’est peut-être que la propagation de ces remous qui, à la
suite d’une émotion, émeuvent l’âme22. »
Cherchant une essence de l’émotion qui ne peut se résumer à un
phénomène, à des manifestations, le phrasé de Proust médite sur un
état affectif, une atmosphère émotionnelle dans laquelle baigne de
façon transitoire un sujet mouvant ; ou bien il tente de saisir un émoi,
une émotion subite et indéfinissable – une émotion paysage ou une
émotion japonaise, dirait Barthes. L’anthropologie émotive est ici une
esthétique du fugace. Oscillant entre les anneaux et les volutes de la
phrase et l’interjection, elle rappelle l’impressionnisme d’Elstir, mais
surtout, elle s’affronte au langage, à ses pouvoirs et à ses insuffisances.
18 Id., Le Temps retrouvé [1927], Esquisse XXIV, éd. citée, t. IV, p. 819.
19 Ibid., p. 808-809.
20 M. P roust, La Prisonnière [1925], éd. citée, t. III, p. 540.
21 Id., À l’ombre des jeunes filles en fleurs [1919], II, éd. citée, t. II, p. 299.
22 Id., La Prisonnière, éd. citée, t. III, p. 530.
Modernites34.indd 78 19/09/12 11:19
Ces émotions à fleur de peau, sans nom pour les désigner 79
2. Sarraute et les émotions à fleur de peau
Sarraute, comme Proust, a tenté d’approcher cette zone indicible
où l’émotion défie le langage. Elle a montré la coalescence de l’émotion
et de la sensation. L’émotion, comme la sensation, le sentiment ou
l’impression, échappe fondamentalement à sa transcription – tel est le
postulat qui anime les récits d’expérience émotionnelle chez Sarraute
comme chez Proust : ils cherchent à saisir un monde affectif et sensible,
un en deçà des savoirs et des discours, un en deçà même du langage.
L’hypothèse peut sembler naïve. Elle va en tout cas à l’encontre
d’une théorie de l’affect qui affirme la prédominance du langage (si
on la retrouve dans le lacanisme, elle est cependant tempérée par la
distinction entre l’affect et l’affectif : « L’affect n’est pas l’affectif ni
l’émotionnel mais témoigne du discord du fait que l’homme habite le
langage : c’est du langage que nous sommes affectés23 »).
Une telle naïveté est une force. Sa leçon : ne pas se payer de mots.
Les mots s’inscrivent en nous, ils sont comme des tatouages. « Il y en a
tout un stock commun24 » : amour, amitié, jalousie, crainte, modestie,
snobisme, timidité, etc. Les mots sont comme des institutions, voire des
monuments, c’est à partir de ce constat que Sarraute écrit ses tropismes :
« Dès qu’on prononce ce mot : “timidité”, tout se fige. Une notion
épaisse, patinée par l’usage, recouvre cette palpitation de quelque
chose d’indéfinissable, comme une couverture qu’on jette sur le feu :
c’est de la timidité25. » Il faudrait pouvoir échapper au glacis de « ces
mots brutaux qui assomment comme des coups de matraque26 ». « Il me
semble, quant à moi, dit-elle, qu’au départ de tout il y a ce qu’on sent,
le “ressenti”, cette vibration, ce tremblement, cette chose qui ne porte
aucun nom, qu’il s’agit de transformer en langage. Elle se manifeste de
bien des façons… Parfois d’emblée, par des mots, parfois par des paroles
prononcées, des intonations, très souvent par des images, des rythmes,
des sortes de signes, comme des lueurs brèves qui laissent entrevoir
23 Nicole Bernard, « Un tableau dans “L’angoisse” de J. Lacan », publié en ligne : http://www.
apjl.org/spip.php?article203. Cf. Lacan : « c’est au langage et […] c’est du langage que nous
sommes, manifestement et d’une façon tout à fait prévalente, affectés » (Le séminaire, XXII,
17 décembre 1974, p. 31 publié en ligne : http://gaogoa.free.fr/Seminaires_HTML/22-RSI/
RSI17121974.htm).
24 Nathalie Sarraute, L’Usage de la parole, Paris, Gallimard, 1980, p. 92 ; repris dans Œuvres
complètes, éd. publiée sous la dir. de Jean-Yves Tadié, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade », 1996, p. 957.
25 Id., « Le langage dans l’art du roman » [1969/1970], in Œuvres complètes, op. cit., p. 1679-
1694, cit. p. 1689.
26 Id., Portrait d’un inconnu [1948], Paris, Gallimard, 1956, p 46 ; repris dans Œuvres
complètes, op. cit., p. 74.
Modernites34.indd 79 19/09/12 11:19
80 Jean-Pierre Martin
de vastes domaines… Là est la source vive27. » Y a-t-il une émotion
qui ne se nommerait pas ? Sarraute y croit. Ce pourquoi elle vise tout
particulièrement des infra-émotions, des émotions qui ne font pas signe,
des émotions d’avant le langage. Les tropismes, ce sont des émotions-
sensations infinitésimales, observables uniquement au microscope de la
littérature, ce sont des « états inexplorés », des « états baladeurs28 », à
la fois instables et universels, communs à tous les êtres humains. En ce
sens, dans l’idiolecte de Sarraute, la sensation et l’émotion s’équivalent :
toutes deux participent de « ce bouillonnement confus où nos actes
et nos paroles s’élaborent29 ». Il faut les saisir dans leur informulable
surgissement, prendre acte d’une « lutte continuelle entre la force du
langage qui entraîne et détruit la sensation, et la sensation qui, elle
aussi, détruit le langage30 », faire de l’œuvre « un équivalent littéraire
d’un ordre de sensations encore inconnu31 ». D’où la recherche d’un
autre langage : « On n’a pas encore découvert ce langage qui pourrait
exprimer d’un seul coup ce qu’on perçoit en un clin d’œil : tout un être et
ses myriades de petits mouvements surgis dans quelques mots, un rire,
un geste32. » D’où aussi l’usage de la métaphore, de l’analogie, le recours
à l’image comparative, le « comme », ou l’allégorie. C’est qu’il faudrait
pouvoir saisir le punctum de la sensation, son « impulsivité ».
S’il y a pour Sarraute un maître ès émotion-sensation, c’est bien
Dostoïevski. Les personnages dans Les Frères Karamazov sont les
« porteurs d’états parfois encore inexplorés que nous retrouvons en
nous-mêmes33 ». Les « bonds désordonnés » et les « grimaces » des héros
de Dostoïevski ne traduisent rien d’autre que « ces mouvements subtils,
à peine perceptibles, fugitifs, contradictoires, évanescents, de faibles
tremblements, des ébauches d’appels timides et de reculs, des ombres
légères qui glissent, et dont le jeu incessant constitue la trame invisible
de tous les rapports humains et la substance même de notre vie34 ».
27 Id., « Nathalie Sarraute et les secrets de la création », entretien avec Geneviève Serreau, La
Quinzaine littéraire, 1er-15 mai 1968.
28 Id., L’Ère du soupçon, Paris, Gallimard, 1956, p. 40, 41 ; repris dans Œuvres complètes, op.
cit., p. 1571, 1572.
29 Ibid., p. 133 ; repris dans Œuvres complètes, op. cit., p. 1610.
30 N. Sarraute, Nathalie Sarraute. Qui êtes-vous ? Conversations avec Simone Benmussa, Lyon,
La Manufacture, 1987, p. 129.
31 Id., « Le langage dans l’art du roman », texte cité, p. 1692.
32 Id., Le Planétarium, Paris, Gallimard, 1959, p. 33 ; repris dans Œuvres complètes, op. cit., p. 360.
33 Id., L’Ère du soupçon, op. cit., p. 40 ; repris dans Œuvres complètes, op. cit., p. 1571.
34 Ibid., p. 28, 29 ; repris dans Œuvres complètes, op. cit., p. 1566.
Modernites34.indd 80 19/09/12 11:19
Ces émotions à fleur de peau, sans nom pour les désigner 81
Mais il faut ajouter trois remarques à propos de l’anthropologie
émotive chez Sarraute. D’abord, elle a montré la composante hystérique
de toute émotion. Ensuite, s’il y a selon elle un préverbal, un en deçà
du langage, c’est que le corps est le premier émetteur de sens, tandis
que le signe est un masque, une imposture, un mensonge. Regardez
les corps : eux, ils ne mentent pas. « Un seul geste et tout l’homme est
là35. » Enfin, on comprend à la lire comment la violence des émotions et
des images mentales (souvent faites de rage, de hargne, de colère) peut
être inversement proportionnelle à leurs manifestations visibles. La
relation à l’autre est terrifiante de l’intérieur. Les émotions à fleur de
peau n’affleurent pas nécessairement, et il n’est pas rare que l’émotion
se cantonne dans l’espace du dedans, comme s’il lui fallait ce rempart
pour se protéger de la relation violente à l’autre et de la déstabilisation
qu’elle entraîne.
*
Il en est au fond des émotions comme des idées : elles peuvent êtres
soumises à l’intimidation du langage, à l’autorité d’un discours tenu.
Dès lors, l’émotion devient catégorie – soit, piège verbal. Dans cette
opération de sujétion par la parole, le sujet se perd. Proust, Sarraute,
Duras, Beckett, Gombrowicz, Michaux, bien d’autres encore : voilà
des écrivains qui ne se conforment pas au programme émotionnel, au
code pathétique, à l’algèbre des sentiments ; voilà des écrivains qui
cherchent des intensités, des rythmes d’émotion ; voilà des écrivains
qui cherchent des mots autour d’une tonalité affective (ce que désigne
assez bien le mot allemand Stimmung) : émotion intime ou relationnelle,
microscopique ou macroscopique, émotion paysage, effusion refoulée
ou épiphanie, extase ou évanouissement, effroi ou joie secrète…
N’excluant pas une sincérité viscérale de l’émotion, l’écrivain est
fasciné par l’émotion inexprimable, marginale, précaire, sans domicile
fixe. Retournant l’argument des psychologies ou des philosophies selon
lequel l’émotion hors langage serait un pur fantasme, parce qu’il n’y a
pas un intérieur et un extérieur, la littérature inquiète notre savoir et
se demande, nous demande : y a-t-il des mots pour dire nos émotions,
toutes nos émotions ? Entre l’interjection littéraire qui déraidit la
syntaxe, le haïku « imbibé d’un émoi ténu36 » (Barthes), la motilité de
l’expression ou les volutes d’un phrasé, il y a mille façons langagières
d’échapper à l’émotion répertoriée, de dire l’entrelacs des affects, leur
35 N. Sarraute, « disent les imbéciles », Paris, Gallimard, 1976, p. 148 ; repris dans Œuvres
complètes, op. cit., p. 899.
36 R. Barthes, La Préparation du roman I et II, op. cit., p. 104.
Modernites34.indd 81 19/09/12 11:19
82 Jean-Pierre Martin
ambivalence, leur immédiateté, leur indocilité, leur indétermination
ou leur réversibilité. Dans tous les cas, face aux savoirs sûrs de leur
coup, c’est aussi une hésitation, un impouvoir qui se dit, un principe
d’incertitude, un « je voudrais rendre » : « Je voudrais rendre la joie
de cette heure. Ce n’est pas une exaltation, une excitation de l’esprit.
La joie ne venait pas du jour qui se levait sur ces choses, mais plutôt
de ces choses qui se levaient dans le petit jour – tout comme s’il existait
un matin apparent des choses37. »
Jean-Pierre Martin
Université Lumière Lyon 2
Bibliographie
Barthes, Roland, La Préparation du roman I et II : cours et séminaires au
Collège de France, 1978-1979 et 1979-1980, texte établi, annoté et présenté
par Nathalie Léger, Paris, Éd. du Seuil – IMEC, coll. « Traces écrites »,
2003.
Bernard, Nicole, « Un tableau dans “L’angoisse” de J. Lacan », publié en
ligne : http://www.apjl.org/spip.php?article203.
Céline, Louis-Ferdinand, « Maintenant aux querelles ! », lettre à André
Rousseaux, 24 mai 1936, in Le Style contre les idées : Rabelais, Zola, Sartre
et les autres, Bruxelles, Complexe, coll. « Le Regard littéraire », 1987, p. 53-
55.
—, « Ma grande attaque contre le verbe » [1957], ibid., p. 61-73.
Diderot, Denis, Éléments de physiologie [1778], in Le Rêve de d’Alembert :
Idées IV (Œuvres complètes, t. XVII), éd. par Jean Varloot et al., Paris,
Hermann, 1987.
Duras, Marguerite, Le Ravissement de Lol V. Stein, Paris, Gallimard, 1964.
—, Marguerite Duras à Montréal, textes réunis et présentés par Suzanne
Lamy et André Roy, Montréal, Spirale, 1981.
—, Cahiers de la guerre et autres textes, éd. établie par Sophie Bogaert
et Olivier Corpet, Paris, POL – Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, IMEC,
2006.
Gracq, Julien, En lisant, en écrivant, Paris, José Corti, 1980.
L acan, Jacques, « Le séminaire, XXII, 17 décembre 1974 », publié en ligne :
http://gaogoa.free.fr/Seminaires_HTML/22-RSI/RSI17121974.htm.
M artin, Jean-Pierre, Le Livre des hontes, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Fiction
& Cie », 2006.
37 M. Duras, Cahiers de la guerre et autres textes, éd. établie par Sophie Bogaert et Olivier
Corpet, Paris, POL – Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, IMEC, 2006, p. 319.
Modernites34.indd 82 19/09/12 11:19
Ces émotions à fleur de peau, sans nom pour les désigner 83
M ichaux, Henri, Œuvres complètes, t. I, éd. établie par Raymond Bellour,
avec Ysé Tran, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1998.
Molé, Mathieu, Souvenirs de jeunesse (1793-1803), éd. présentée et annotée
par Jean-Claude Berchet, Paris, Mercure de France, coll. « Le Temps
retrouvé », 1991.
Proust, Marcel, À la recherche du temps perdu, éd. publiée sous la dir. de
Jean-Yves Tadié, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1987-
1989, 4 vol.
Quignard, Pascal, Rhétorique spéculative, Paris, Calmann-Lévy, 1995.
Sarraute, Nathalie, Portrait d’un inconnu, Paris, R. Marin, 1948 ; rééd.
Gallimard, 1956.
—, L’Ère du soupçon, Paris, Gallimard, 1956.
—, Le Planétarium, Paris, Gallimard, 1959.
—, « Nathalie Sarraute et les secrets de la création », entretien avec Geneviève
Serreau, La Quinzaine littéraire, 1er-15 mai 1968.
—, « Le langage dans l’art du roman » [1969/1970], in Œuvres complètes,
p. 1679-1694.
—, « disent les imbéciles », Paris, Gallimard, 1976.
—, L’Usage de la parole, Paris, Gallimard, 1980.
—, Nathalie Sarraute. Qui êtes-vous ? Conversations avec Simone
Benmussa, Lyon, La Manufacture, 1987.
—, Œuvres complètes, éd. publiée sous la dir. de Jean-Yves Tadié, Paris,
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1996.
Scudéry, Madeleine et Georges de, Artamène ou Le grand Cyrus : extraits
[1653], éd. par Claude Bourqui et Alexandre Gefen, Paris, GF-Flammarion,
2005.
Valéry, Paul, Préface à Kikou Yamata, Sur des lèvres japonaises, Paris, Le
Divan, 1924.
Modernites34.indd 83 19/09/12 11:19
Modernites34.indd 84 19/09/12 11:19
Thymotique d’une passion ordinaire :
en quoi la colère est-elle littérairement féconde ?
Dans le spectre des affects fondamentaux qui travaillent sourdement
l’écriture, élisons la colère, cette « passion ordinaire » sécularisée
(pour reprendre le vocabulaire de l’anthropologue David Le Breton1),
jadis comptée parmi les sept péchés capitaux, que Descartes, dans son
traité des Passions de l’âme, considérait comme une passion composite,
à situer quelque part entre haine et indignation, mais nouant des liens
plus troubles avec la tristesse. J’ai choisi cet « affect chaud » (selon les
classements de la galénique antique) pour l’évidente raison que notre
proche xxe siècle en fut tout embrasé, voire calciné, et tout retentissant
de sa clameur, même si – et elles n’en sont pas moins terribles – il
compta aussi des colères froides et silencieuses, souterrainement
vouées à se réchauffer et prendre du volume dans le temps. Michelet
pressentait déjà le « génie colérique » de l’époque postrévolutionnaire
et ce ne sont pas les catastrophes liées à « l’âge des extrêmes » (Eric
Hobsbawm) qui l’auront démenti. Pire encore, comme le notait Pierre
Pachet2, ce fut la « passion errante » d’un siècle furieux qui fixa dans
sa toile un certain nombre de littérateurs et d’artistes, pour le meilleur
et pour le pire, au moins autant qu’ils surent la fixer et la canaliser.
L’affect colérique contient le sujet en colère (au double sens du terme),
1 David L e Breton, Les Passions ordinaires : anthropologie des émotions [1998], Paris, Payot,
« Petite bibliothèque Payot », 2004.
2 Pierre Pachet (dir.), La Colère, instrument des puissants, arme des faibles, Paris, Autrement,
1997.
Modernites34.indd 85 19/09/12 11:19
86 Martine Boyer-Weinmann
et il arrive que le moteur à explosion explose accidentellement à la
plume du littérateur.
Qu’il y ait une pensée poétique de la colère, il suffit de lire Michaux
ou Artaud pour s’en convaincre, le premier affirmant : « En vérité, celui
qui ne connaît pas la colère ne sait rien. Il ne connaît pas l’immédiat »
(Lointain intérieur3) et proposant une esthétique de cet affect, mettant
en avant une sorte de plasticité visible de la colère : « Je me demande
si la haine ne sera pas plus solidement architecturale que l’amour et,
pour le purement spectaculaire, je parie naturellement sur la colère »
(Passages4). Et le second, dans L’Ombilic des limbes et Le Pèse-nerfs,
recueils d’une colère froide et tendue, allant, dans le langage même,
à même le tuf fragilisé de l’effondrement verbal, jusqu’à opposer la
nécessité de « montrer [s]on esprit » à l’idée, prostituée à ses yeux,
de faire de la littérature5 : « Toute l’écriture est de la cochonnerie6. »
Comment alors dire sa colère, sa souffrance, dans des mots qui ne
seraient pas de la littérature ? On atteint là une limite de l’esprit. La
colère fait-elle écrire ou bloque-t-elle la transmutation en œuvre ?
Peut-on écrire en état de colère ? Qu’est-ce qu’un « cri-écrit » ? Faut-il
décolérer pour entrer dans la condition écrivaine ? Comment négocier
littérairement ses petites et grandes colères et les mettre au travail ?
Peut-on être un missionnaire artiste de la colère collective ? Autant
de questions soulevées par la mise en relation de la colère et de la
littérature.
Qu’il y ait également une pensée romanesque de la colère, ou une
prose de la colère chevillée au siècle, à ses grands récits thymotiques, il
suffit de lire Musil ou Nizan pour en éprouver l’incandescence. Musil
d’abord, dans L’Homme sans qualités, qui peint Ulrich à sa fenêtre,
observant une manifestation de rue : il voit (et nous par ses yeux) toute
la colère théâtralisée des manifestants qui prennent un regard furieux
et lèvent leurs cannes en direction du palais ministériel où il se trouve7.
Comédie politique, tragédie de « l’âge de l’utopie de la vie motivée8 »,
3 Henri M ichaux, « Mouvements de l’être intérieur », Difficultés [1930], in Plume, précédé de
Lointain intérieur, nouv. éd. rev. et corr., Paris, Gallimard, 1963, p. 131.
4 Id., « En pensant au phénomène de la peinture » [1946], in Passages (1937-1963), nouv. éd.
rev. et augm., Paris, Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 1998, p. 64.
5 Antonin A rtaud, L’Ombilic des limbes [1925], in Œuvres complètes, t. I, nouv. éd. rev. et
augm., Paris, Gallimard, 1976, p. 47-76, citation p. 49 (incipit).
6 Id., Le Pèse-nerfs [1925], ibid., p. 100.
7 Robert Musil, L’Homme sans qualités [1930-1932], trad. de l’allemand par Philippe Jaccottet,
nouv. éd., II, chap. 120 (« L’Action parallèle provoque des troubles »), t. I, p. 700-701.
8 Ibid., « Ébauches I et III pour l’utopie de la vie motivée », p. 1029-1036.
Modernites34.indd 86 19/09/12 11:19
Thymotique d’une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? 87
grande couveuse sanguinaire du siècle du ressentiment. Cette scène
de L’Homme sans qualités, on ne s’en étonnera pas, est glosée par un
autre observateur et contempteur de la manifestation thymotique à
l’ère des masses, Kundera dans Le Rideau9.
Quant au Nizan d’Aden Arabie (1931), il est presque l’emblème
générationnel de l’association colère-jeunesse-militantisme, dans un
lyrisme torrentiel qui l’emportera le premier comme victime expiatoire
du drame de l’adhésion : « Que pas une de nos actions ne soit pure de la
colère. […] Il ne faut plus craindre de haïr. Il ne faut plus rougir d’être
fanatique. […] j’ignorerai au moins le repentir, je ferai bon ménage
avec la haine10. ». Pureté de la colère : que de crimes commis en ton
nom !
Bref, il y a bien une pensée littéraire de la colère, et je me propose,
en prenant ici à témoin quelques grands penseurs de cette émotion
singulière (Sartre, Barthes, Sloterdijk), d’envisager la littérature
comme une anthropologie émotive des conduites humaines et de leur
ambivalence, et aussi comme une lexicologie ou un traité du style des
affects : un déplacement des termes convenus, doxiques, pour désigner
des sensations ou tropismes plus complexes, une syntaxe et une
rhétorique des émotions mimétiques des nuances en jeu (immédiateté,
acuité, percussion, affleurement nerveux, écorchure, électrocution…)
1. Variations sartriennes sur une phénoménologie de la
colère
Jean-Paul Sartre fut sans doute le premier parmi les philosophes
du xxe siècle à redonner droit de cité à une méditation philosophique
sur le statut de l’émotion, à travers son Esquisse d’une théorie des
émotions, publiée juste avant le déclenchement du second conflit
mondial. Émotion, et non plus « passion » au sens moral où Descartes
parlait des « passions primitives » de l’homme, de même que Hume,
plus tributaires du vocabulaire antique de la philosophie. D’entrée,
Sartre tenait à distinguer l’« émotion » de l’« accident », pour rapporter
la première au « tout de la conscience » (et non à un épiphénomène),
pour affirmer que celle-ci, selon lui, traduisait sous un aspect défini
« la totalité synthétique humaine dans son intégrité […] une forme
organisée de l’existence humaine11 ». Dans ce court ouvrage, où il
9 M. Kundera, Le Rideau : essai en sept parties, Paris, Gallimard, 2005, p. 88-89 (Œuvre, édi-
tion définitive, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2011, t. II, p. 992).
10 Paul Nizan, Aden Arabie [1931], Paris, La Découverte, 1987, p. 155.
11 Jean-Paul Sartre, Esquisse d’une théorie des émotions [1938], Paris, Hermann, 1965, p. 15.
Modernites34.indd 87 19/09/12 11:19
88 Martine Boyer-Weinmann
présente et critique les théories classiques et plus récentes des émotions,
notamment celles des biologistes William James et Charles Sherrington,
(sur la « sensibilité cortico-thalamique »), il s’attarde longuement sur
une émotion peu cotée généralement par la philosophie (la colère), en
donnant son bonus à l’approche du psychiatre Janet et à Dembo (la
colère comme solution dynamique d’un conflit, évasion réussie contre
l’enkystement, transformation agissante du monde), contre la lecture
à ses yeux réductrice de la vulgate psychanalytique, colère vue comme
pure « décharge » libidinale (« assouvissement symbolique de tendances
sexuelles12 »). Sartre est sans doute l’un des premiers à ébaucher une
phénoménologie des émotions plus complexe, et particulièrement
de cette « passion ordinaire » et mixte qu’est la colère, un champ de
recherche impliquant un holisme corps-esprit dont Spinoza (avec sa
notion de conatus comme augmentation de puissance d’agir, effort
modulé de persévérance dans l’être) pourrait être le précurseur, si l’on
en croit aujourd’hui les travaux d’Antonio Damasio repris par Catherine
Malabou13 dans son Ontologie de l’accident :
Et comment parler de la colère, où l’on frappe, injurie, menace sans men-
tionner la personne qui représente l’unité objective de ces insultes, de ces
menaces et de ces coups ? En un mot le sujet ému et l’objet émouvant sont unis
dans une synthèse indissoluble. L’émotion est une certaine manière d’appré-
hender le monde. […] Le sujet qui cherche la solution d’un problème pratique
est dehors dans le monde, il saisit le monde à chaque instant, à travers tous
ses actes. S’il échoue dans ses essais, s’il irrite, son irritation même est encore
une façon dont le monde lui apparaît. Et il n’est pas nécessaire que le sujet,
entre l’action qui échoue et la colère, fasse un retour sur soi, intercale une
conscience réflexive. Il peut y avoir passage continu de la conscience irré-
fléchie « monde-agi » (action) à la conscience irréfléchie « monde-odieux »
(colère). La seconde est une transformation de l’autre14.
12 Ibid., p. 32.
13 Catherine Malabou évoque cette généalogie Spinoza-Deleuze-Damasio, qui réconcilierait la
philosophie continentale avec les neurosciences contemporaines, dans les termes suivants, in
Ontologie de l’accident : essai sur la plasticité destructrice (Paris, Léo Scheer, 2009, p. 25-26) :
« Curieusement, certains scientifiques américains se tournent vers la philosophie continentale
pour élaborer ce nouveau rapport de la biologie et de la thanatologie. Damasio, par exemple,
perçoit une proximité certaine entre son travail et celui de Spinoza. Ce dernier serait un “pro-
to-neurobiologiste”, le premier philosophe à reconnaître l’existence ontologique, c’est-à-dire
essentielle, du système nerveux. Spinoza serait aussi le premier, dans la tradition métaphy-
sique, à donner au concept de forme un sens nouveau : l’identité indissoluble de l’esprit et du
corps. Spinoza affirme en effet, au livre III de L’Éthique, que “ce qui constitue l’essence de
l’esprit n’est rien d’autre que l’idée du corps existant en acte”. La forme est donc le nom donné
à l’unité actuelle de l’esprit et du corps, mais aussi, et plus profondément encore, à l’unité de la
constitution ontologique et de la structure biologique du sujet. » Cf. Antonio Damasio, Spinoza
avait raison : joie et tristesse, le cerveau des émotions, trad. de l’anglais (États-Unis) par Jean-
Luc Fidel, Paris, O. Jacob, 2003, p. 177.
14 J.-P. Sartre, Esquisse d’une théorie des émotions, op. cit., p. 37.
Modernites34.indd 88 19/09/12 11:19
Thymotique d’une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? 89
Sartre définit aussi positivement la colère comme une émotion
mutante, en lien avec la peur notamment (« peur dépassée15 ») et,
élément plus original qui nous conduit directement sur le terrain de
l’empathie, comme « phénomène de croyance » : « La conscience ne
se borne pas à projeter des significations affectives sur le monde qui
l’entoure : elle vit le monde nouveau qu’elle vient de constituer. Elle
le vit directement, elle s’y intéresse, elle souffre les qualités que les
conduites ont ébauchées16. » C’est en tant qu’il dote la colère d’une
efficace pragmatique et même créatrice, et ne la considère plus comme
une conduite purement neuro-psycho-biologiquement déterminée
(réactionnelle-évasive ; offensive-défensive), que Sartre nous intéresse
et pose d’emblée la question du lien structurel (inhibant, désinhibant)
entre le projet artistique et l’émotion singulière qui traverse un
créateur. Ses trois biographies existentielles en seront la démonstration :
Baudelaire et Flaubert pour la conversion de la honte en colère
écrite-désécrite-réécrite, Genet pour le rôle pivot de la triade honte-
orgueil-colère dans la construction d’une identité sexuelle, littéraire
et politique. On se souvient des extraordinaires interprétations des
troubles de la volonté et de la colère désamorcée chez Baudelaire, à
partir de l’examen graphologique et de la scarification du support-
papier dans la correspondance17.
Pour Sartre (et c’est une idée que j’emprunte ici volontiers à Jean-
François Louette18), la colère servirait de méthode d’investigation
philosophique contre la philosophie universitaire idéaliste, celle par
exemple de Léon Brunschvicg. Dans ses Carnets de la drôle de guerre,
il cerne son propre mode de cognition, son tâtonnement heuristique,
et se réclame d’une pensée « à explosions19 », par saccades violentes et
zébrures discontinues, loin de l’irénisme du raisonnement hypothético-
déductif. La violence intellectuelle de Sartre (réelle ou feinte), qui se
rêve lui-même en philosophe dur, trouve en Genet, en 1952, un double
fantasmé en littérature, celui qu’il sait ne pouvoir jamais être, et qu’il
invente dans sa biographie à partir de ses colères, des « rages blanches
et muettes20 » qui le ravagent et le consument.
15 Ibid., p. 48 ; c’est l’auteur qui souligne.
16 Ibid., p. 51 ; c’est l’auteur qui souligne.
17 J.-P. Sartre, Baudelaire [1947], Paris, Gallimard, coll. « Folio-essais », 1988, p. 33 sqq.
18 Jean-François L ouette, « Foin de la littérature ! », in Martine Boyer-Weinmann et Jean-Pierre
M artin (dir.), Colères d’écrivains, Nantes, C. Defaut, 2009, p. 47.
19 J.-P. Sartre, Les Carnets de la drôle de guerre, septembre 1939-mars 1940, texte établi et
annoté par Arlette Elkaïm-Sartre, nouv. éd., Paris, Gallimard, 1995, p. 284-285.
20 Jean-Paul Sartre, Saint Genet comédien et martyr, Paris, Gallimard, 1952, p. 543.
Modernites34.indd 89 19/09/12 11:19
90 Martine Boyer-Weinmann
Privé des connaissances scientifiques modernes sur le
fonctionnement cérébral, mais armé d’un savoir anthropologique et
d’une intuition phénoménologique, Sartre ne dit pas autre chose dans
ses psychobiographies d’écrivains que ce que je lis aujourd’hui sous la
plume d’une Catherine Malabou :
Raisonner sans désirer n’est pas raisonner. Pour penser, pour vouloir, pour
connaître, il faut que les choses aient une consistance, un poids, une valeur ;
or l’indifférence émotionnelle annule le relief, efface la différence des pers-
pectives, nivelle tout. Privé de son pouvoir critique, de sa capacité à discri-
miner, à faire la différence, qui procède de l’émotion et de l’affect, le rai-
sonnement, comme le dit Damasio, devient raisonnement de sang-froid, ne
raisonne plus. « La réduction sélective de l’émotion est au moins aussi préju-
diciable à la rationalité que l’émotion excessive21. »
2. De l’anti-Neutre (Barthes) à la thymotique de la colère
(Sloterdijk)
Revenons désormais à l’émotion spécifique (la colère) que j’ai choisi
d’examiner sous le rapport de sa pragmatique, de sa plus ou moins
féconde dynamique créatrice, et plus particulièrement littéraire. Avec
la colère et son thymos (nous verrons, avec Peter Sloterdijk prendre
corps cette notion de thymotique), nous sommes sans équivoque dans
l’affect chaud, le relief, l’impetus, le bouillant, aux antipodes en
tout cas de « l’indifférence émotionnelle », du « sang-froid » défini
précédemment en creux comme manque, privation critique. Mais ne
risquons-nous pas a contrario de basculer vers « l’émotion excessive »,
qui offusque ou aveugle l’intellection ? Sans doute, si l’on en croit
Roland Barthes, le moins colérique en apparence de nos penseurs
contemporains, parce que l’un des plus mélancoliques, avec Clément
Rosset. Dans son séminaire consacré à la notion de Neutre, il consacre
toute une séquence de cours (la dixième sur vingt-trois) à « La colère »,
intercalée entre les séquences « Images du neutre » et « L’actif du
neutre ». Précisons d’entrée la première définition barthésienne du
Neutre : « Je définis le Neutre comme ce qui déjoue le paradigme,
ou plutôt j’appelle Neutre tout ce qui déjoue le paradigme. Car je ne
définis pas un mot ; je nomme une chose : je rassemble sous un nom,
qui est ici le Neutre./ Le paradigme, c’est quoi ? C’est l’opposition de
deux termes virtuels dont j’actualise l’un, pour parler, pour produire
21 C. M alabou, Ontologie de l’accident, op. cit., p. 27-28, pour la citation encadrante (c’est l’au-
teur qui souligne). La citation encadrée, d’Antonio Damasio, est tirée de Le Sentiment même
de soi : corps, émotions, conscience, trad. de l’anglais (États-Unis) par Claire Larsonneur et
Claudine Tiercelin, Paris, O. Jacob, 1999, p. 49.
Modernites34.indd 90 19/09/12 11:19
Thymotique d’une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? 91
du sens22 » (annulation, contrariété du binarisme implacable par
recherche d’un tertium, également en éthique : rejet de la commination
à choisir son camp, à produire du sens, à entrer dans le conflit, la prise
de responsabilité). Attention, « déjouer le paradigme » (le binarisme)
pour Barthes n’est pas une attitude grise et passe-muraille, c’est une
passion intense, « une activité ardente, brûlante23 », écrit-il. Compte
tenu de ce tableau préalable, comment Barthes va-t-il situer la colère
(affect chaud) dans sa contre-proposition du Neutre brûlant ?
Mythologiquement, le Neutre est associé à un « état » (pathos) faible, non
marqué. Il se détache, se distance par rapport à tout état fort, marqué, em-
phatique (qui est, par là, du côté de la « virilité ») → on peut donner comme
exemple d’état fort de pathos marqué la colère : fonctionne bien comme un
anti-Neutre. Je connais trois « versions » de la colère :
1) La colère comme fuite. Je renvoie ici à la Théorie des émotions de Sartre.
Cf. l’évanouissement. La colère est en effet une espèce d’évanouissement, une
perte de conscience, donc de responsabilité, dans l’excès. Il serait d’ailleurs
curieux de dresser la carte de nos colères : la colère comme pathème (to pa-
thèma : l’événement qui affecte) : quels sont nos « pathèmes » ? (Pour moi, qui
ai peu de colères, sans doute par peur des effets de retour, de la culpabilité
qui s’ensuit immanquablement, un pathème probable : l’attente → colères de
café, de restaurant. Pourquoi ? Sans doute : humiliation, fantasme « royal » :
« me faire attendre, moi ! » : refus de la situation transférentielle : attendre
= s’en remettre passivement à un pouvoir, à une maîtrise : « à discrétion » :
médecins, dentistes, banques, aéroports, professeurs ?)
2) La colère comme hygiène. Idée tout à fait courante, endoxale : l’accès de
colère comme une saignée qui fait du bien → sortie inéluctable, naturelle d’hu-
meur (mot physique) […] → d’où une morale de la mesure : contrôler la colère,
et surtout sa durée, sa fin. […] → idée de la colère utile : contrôler l’apparence
du non-contrôle, théâtraliser sa colère, la manipuler comme élément d’une
épreuve de force. Et surtout, savoir y mettre fin : sagesse, édictée par l’Écri-
ture (citée par Bacon) : « Mettez-vous en colère, mais gardez-vous de pécher ;
que le soleil ne se couche pas sur votre colère. »
3) La colère comme feu. Je pense ici à la très belle conception, mystique et
cosmogonique, de Boehme. Boehme, à propos du monde et même de Dieu
(en tant que père jaloux), emploie souvent les mots : böse, grimmig ; or ce
n’est pas dans son esprit, à proprement parler, mal, méchant, mauvais → cela
renvoie à une énergie (à un désir) = une ardeur irritée et inquiète ; quelque
chose proche de colère, fureur, courroux = ira, orgê = feu dévorant (d’où le
courroux de Dieu, comme feu qui tombe sur les hommes) : c’est le paradoxe de
l’eau ignée, de l’eau-feu : le feu dans les veines […] 24.
22 Roland Barthes, Le Neutre : notes de cours au Collège de France (1977-1978), texte établi,
annoté et présenté par Thomas Clerc, sous la direction d’Éric Marty, Paris, Éd. du Seuil –
IMEC, coll. « Traces écrites », 2002, p. 31.
23 Ibid., p. 32.
24 Ibid., p. 107-108 ; c’est l’auteur qui souligne.
Modernites34.indd 91 19/09/12 11:19
92 Martine Boyer-Weinmann
Il est intéressant de se pencher un instant sur les aveux de Barthes,
logés dans une parenthèse, concernant sa défiance personnelle à l’égard
de l’affect marqué, viril, de la colère. On y verra la trace d’un subtil
déni : avoir peu de colères, c’est néanmoins en avoir quelques-unes,
et c’est même en avoir colorées d’un affect causal particulièrement
sensible : le sentiment d’humiliation converti en crise d’orgueil, avec
sa manifestation douloureuse, la situation d’attente, dont le professeur
Barthes élimine (médecins, dentistes, banques…) et suggère à la fois
dans son énumération (attentes de café, de restaurant) ce qu’elle a
de commun avec l’attente de l’amoureux et la souffrance du jaloux
(cf. le leitmotiv lancinant des Fragments d’un discours amoureux).
Un mobile ambigu est avancé à la défiance vis-à-vis de la colère, qui
plaiderait plutôt en faveur de la thèse d’un Barthes affecté d’une colère
aussitôt désamorcée par calcul coûts-avantages : l’anticipation des
représailles, l’effet-boomerang, la culpabilité, autrement dit une sorte
d’économie émotionnelle, de compte-épargne des coups, contrecoups
et après-coups. Ce qui se lit derrière tout ce discours, et qu’il faut
retenir dans la perspective de la lecture psycho-politico-économique
de la colère par Sloterdijk, c’est le rapport à la temporalité que met
en jeu la scène de la colère (au sens également théâtral, rhétorique,
évoqué par Barthes), mais aussi la force paradoxale d’une faiblesse
apparente (l’esquive, inspirée chez Barthes par la pensée zen) contre
la force de premier degré (taxée d’arrogance). La force du Neutre,
contre l’arrogance brute de l’immédiateté encolérée, est celle d’une
« pensée tactique du gain, de la victoire, […] le sujet neutre pourrait
assister aux effets de sa force25 »). Le sujet en colère, en revanche, va
à sa perte ; c’est un sujet en apparence inscrit dans le présent de son
emportement, collé à la présence, dans l’immédiateté foudroyante
de l’autodestruction (le feu brûlant de Dieu en lui, l’enthousiasme
ravageur au sens étymologique). Le sujet en colère ne fait qu’un avec
sa colère, avec l’objet (si tant que sa colère soit transitive, et non pas
seulement existentielle, auto-immune en quelque sorte), exactement
comme dans la haine, cet amour fusionnel inversé qui vous unit/
identifie à l’objet haï ; il n’« est » pas au monde, la colère le possède.
Il est « hors de lui » (et du monde). En colère, il ne diffère pas son
projet de riposte ou de vengeance (il annule le délai entre projet et
exécution : c’est l’homme du tout ou rien, de la radicalité, de l’absence
de compromis avec le réel) ou, s’il le diffère, il le thésaurise, il gèle
son avoir colérique, il le place à la bourse du ressentiment. Dans les
25 Ibid., p. 119-120.
Modernites34.indd 92 19/09/12 11:19
Thymotique d’une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? 93
deux cas, le sujet en colère a un rapport désajusté au présent vécu,
et c’est exactement cela qui fait reculer Barthes devant l’explosion,
l’éruption, sans qu’on puisse affirmer aussi nettement qu’il l’affirme
qu’il en méconnaisse la tentation (en littérature, le cas paroxystique
est sans doute celui du Nizan d’Aden Arabie). Ce qui fascine Barthes
(le Barthes méditant parallèlement à l’époque du cours sur l’« empire
des signes » japonais et la pensée chinoise), c’est cela même qu’interdit
toute coagulation colérique à l’objet (sorte de toge de Nessus du sujet
occidental), la présence au monde :
Neutre : chercherait un rapport juste au présent, attentif et non arrogant.
Rappeler que le Taoïsme = l’art d’être au monde : il a trait au présent. Peut-
être s’installerait-il dans la nuance (la moire), qui sépare le « présent » du
« moderne » (au sens revendicatif du mot : « soyons modernes ») ; en se rappe-
lant cette remarque de Vico que le présent, « le point indivisible du présent »,
est difficile à comprendre même pour un philosophe26.
Nous y voilà : nous sommes arrivés au noyau d’un Roland Barthes de
1977 « antimoderne », devenu indifférent à l’injonction violente d’être
ce sujet « moderne » des avant-gardes esthétiques du xxe siècle, « l’âge
des extrêmes ». Le présent, c’est le contraire du moderne, c’est ce qui
se soustrait à la réquisition de l’engagement. La « moire », ce terme si
barthésien, c’est l’école de la nuance, ce qui est aussi une définition de
la littérature pour Barthes. Il découle de cette lecture de Barthes sur
la colère que cet affect lui est moins inconnu qu’antipathique, dans
la mesure où il fige le sujet dans un présent non contemplatif, non
vécu, et surtout qu’il bloque tout accès à la médiation créatrice, à la
littérature, à la nuance, qui est du domaine du Neutre.
Après Barthes, pratiquons le grand écart de Weltanschauung,
mais restons-en, sous un autre angle, au nouage problématique entre
littérature et affect colérique. Venons-en à Sloterdijk maintenant, qui
nous rappelle, dans son essai résolument polémique, Colère et temps,
le changement de paradigme anthropologique majeur qui, selon lui,
dès l’Antiquité latine, à l’âge classique, et plus radicalement à l’âge
des Lumières, a rompu le lien intime entre littérature et colère. Un
Sloterdijk qui, dans son deuil de l’âge thymotique, dresse un tombeau
à la vision épique du monde européen.
26 Ibid., p. 118-119.
Modernites34.indd 93 19/09/12 11:19
94 Martine Boyer-Weinmann
3. Chanter la colère : au commencement de la littérature
était la colère
L’essai de Peter Sloterdijk s’ouvre par un rappel en forme d’adieu à
l’âge épique : le premier mot de la tradition européenne, au fondement
de l’anthropologie et de la poétique occidentale, c’est le mot « colère »
(mènis en grec, mènin à l’accusatif plus précisément) propulsé en tête du
vers initial de l’Iliade : « La colère d’Achille, de ce fils de Pelée, chante-
la-nous, Déesse… » Au commencement de la littérature était donc la
colère, cette mènis, qui, par voie de rime et de paronomase, s’oppose
à l’autre pôle du couple anthropologique fondateur, la mètis (la ruse)
portée par l’autre héros, Ulysse. L’immédiateté contre le détour, l’epos
contre l’élégie, la mort volontaire au combat contre le vieillir au foyer
retrouvé de Pénélope (nostalgie). « Chanter la colère, rappelle Sloterdijk
, c’est la rendre mémorable ; or ce qui est mémorable est proche de ce
qui impressionne et de ce à quoi l’on doit vouer durablement une haute
estime ; c’est même proche du bon. Ces évaluations sont si fortement
opposées aux modes de pensée et de sensibilité des modernes qu’on doit
sans doute l’admettre : il ne nous sera pas donné, en dernière instance,
d’avoir un accès non falsifié au sens particulier de la conception
homérique de la colère27 », c’est-à-dire, pour Sloterdijk, à distinguer de
la sainte colère de Yahvé et de Moïse, ce monde du « bellicisme heureux
et sans frontières28 », un monde où la colère est de nature supérieure,
d’espèce quasi divine, d’où l’invocation à la déesse. C’est uniquement
parce qu’il existe une colère conférée d’en haut qu’il est légitime
d’impliquer les dieux dans les virulentes disputes des hommes. Quand
on chante la colère sous de tels auspices, on célèbre une énergie qui
libère les hommes de la torpeur végétative, et les place « sous un haut ciel
voyeur29 » ; pour Sloterdijk, la colère homérique marque historiquement
une anthropologie des affects antérieure à leur sécularisation, entendue
ici comme une subjectivation et une intériorisation des conduites
humaines, ce que rendrait visible la syntaxe : les sujets produisent un
effet sur les objets et leur imposent un pouvoir. Dans le monde d’Homère,
ce ne sont pas les hommes qui ont leurs passions, mais plutôt les passions
qui ont leurs hommes. « L’accusatif [mènin] est encore ingouvernable.
Dans cette situation, le Dieu un et unique se fait naturellement attendre.
Le monothéisme théorique ne peut arriver au pouvoir que lorsque les
27 Peter Sloterdijk, Colère et temps : essai politico-psychologique [2006], trad. de l’allemand par
Olivier Mannoni, Paris, Libella-Maren Sell, 2007, p. 11.
28 Ibid., p. 12.
29 Ibid.
Modernites34.indd 94 19/09/12 11:19
Thymotique d’une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? 95
philosophes postulent sérieusement le sujet de la phrase comme principe
du monde. Alors, les sujets doivent eux aussi avoir leurs passions et les
contrôler en maîtres et en possesseurs30. » Le psychisme héroïque n’y
survivra pas, déplore Sloterdijk sur un ton prophético-crépusculaire…
à moins qu’il ne mute à travers le temps.
Ce qui lui succède, c’est, dès l’époque romaine, et notamment avec le
De ira de Sénèque, « la domestication de la colère » par le discours moral
de la tempérance stoïcienne. Mais Sloterdijk dirige le gros de sa charge
contre une cible historiquement plus récente (ce qui confère à son essai
une virulence polémique, voire une colère teintée d’ironie cinglante en
parfaite symbiose avec son objet), la psychanalyse freudienne, accusée
d’avoir réduit la psyché humaine à l’érotique en évacuant le second
pôle de son fonctionnement, le pôle thymotique. L’érotodynamique
freudienne nous aurait rendus incapables de comprendre et d’anticiper
le mécanisme de la haine (comme sombre revers de l’amour), avec les
funestes conséquences que l’on sait, au plan intersubjectif mais aussi,
par extension, au plan géopolitique. Autrement dit, la psychanalyse
comme système d’interprétation et peut-être système d’alerte aurait
laissé filer ce que l’âge postrévolutionnaire et la philosophie romantique
pointaient comme revendications des êtres et des peuples : le désir de
reconnaissance, les fiertés mondialisées, l’appétit de dignité, sur fond
d’individualisme ressentimental collectivé. D’où le retour en force de
la thymotique à l’âge moderne, que Sloterdijk synthétise sous le nom de
« Théorie des ensembles de fierté » sous les énoncés suivants :
Nous donnerons ici les six principes majeurs qui peuvent servir de points de
départ à une théorie des unités thymotiques :
– Les groupes politiques sont des ensembles placés, de manière endogène,
sous tension thymotique.
– Les actions politiques sont déclenchées par des différentiels de tension entre
centres d’ambition.
– Les champs politiques sont formés par le pluralisme spontané de forces
autoaffirmatives dont les rapports mutuels se transforment sous le coup des
frictions interthymotiques.
– Les opinions politiques sont conditionnées par des opérations symboliques
qui présentent un rapport constant avec les impulsions thymotiques des col-
lectifs.
– La rhétorique – en tant que doctrine de la direction des affects dans les
ensembles politiques – est une thymotique appliquée.
– Les combats pour le pouvoir au sein des corps politiques sont toujours aussi
des luttes pour la primauté, entre individus chargés de thymós – en langage
courant : des individus ambitieux – avec leurs partisans ; raison pour laquelle
30 Ibid., p. 19.
Modernites34.indd 95 19/09/12 11:19
96 Martine Boyer-Weinmann
l’art du politique inclut l’idée de réconcilier les perdants31.
Ces six principes, qui intéressent aussi bien la science politique
que l’école de la rhétorique, on pourrait les appliquer à l’étude de
textes littéraires comme La Conspiration de Nizan (sur le mode
tragique) ou, plus près de nous, L’Organisation de Jean Rolin (sur le
mode distancié de la démystification ironisée). Ce que pointe la thèse
de Sloterdijk, c’est, outre le manqué de la psychanalyse à s’ériger
sur les dépouilles d’un « management traditionnel de la colère par la
religion et la civilisation32 », le triomphe de « l’instant de Nietzsche »,
à anticiper le déclenchement des catastrophes thymotiques par défaut
de prise en charge intellectuelle d’une économie de la fierté (avec ses
banques, ses points de collecte de la colère de groupe…) : « [T]ant que
la colère reste sur le palier de l’explosion, elle se déploie sur le mode
de “l’éclat”. […] La décharge thymotique directe constitue un présent
accompli. […] Le fait de se déchaîner dans l’ici et maintenant neutralise
les extases rétrospectives et prospectives du temps, de telle sorte que
les deux disparaissent dans le flux actuel de l’énergie. […] La vie du
sujet de la fureur est le pétillement dans le calice de la situation. Pour
les romantiques de l’énergie, l’action en état de rage représente une
version du flow33. » Les révolutions seraient les formes bancaires de
la colère, avec leurs petits et gros porteurs de titres, les archives de la
colère, les capitaux accumulés, les avoirs gelés, les entrepreneurs de la
colère mettant en œuvre la « force monstrueuse du négatif » (Hegel).
Et la littérature post-thymotique dans tout cela, la littérature d’idées
certes, mais aussi la fiction, le poème ? On n’est pas aussi loin de la
littérature et du langage que ce lexique économico-psycho-politique
pourrait le laisser penser. Le langage, investi, contaminé, infesté même
par l’énergie thymotique a pu se faire à certains moments de l’histoire,
individuelle ou collective, l’instrument privilégié de cette négativité.
L’univers romanesque d’un Kundera et sa réflexion sur la littérature
l’illustrent parfaitement, mais il suffit, sans citer les éructations
céliniennes, de prendre deux exemples (l’un d’une victime de la praxis
et du langage révolutionnaire, cité par Sloterdijk lui-même, l’autre par
un petit porteur de la colère plus inattendu sur ce registre).
Commençons par citer un extrait du poème 150 000 000 de Vladimir
Maïakovski, tiré de son troisième chapitre consacré à la « banque
mondiale communiste de la colère » :
31 Ibid., p. 33-34.
32 Ibid., p. 41.
33 Ibid., p. 87-88.
Modernites34.indd 96 19/09/12 11:19
Thymotique d’une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? 97
Faire danser la hache sur leur crâne chauve !
Tuer !Tuer !
Bravo : et les calottes crâniennes font de bons cendriers.
La vengeance est le maître de cérémonie,
La faim, l’ordonnateur.
Baïonnette, browning, bombe…
En avant ! Du rythme34 !
Chacun sait en effet que les révolutionnaires aiment généralement
une certaine musique au pas cadencé.
Mais voici la parole d’un rescapé des camps, qui juge la nécessité de
la littérature à l’aune de sa propre colère, de son propre ressentiment,
dans un texte posthume, Lettre anonyme, publié en 1986 :
« Pourquoi écrire ? Pour se venger. La littérature est revanche. Contre sa
laideur, sa pauvreté – Balzac. Contre l’humiliation : La Bruyère ; La Fon-
taine peut-être. Toute littérature est de ressentiment. Contre le Dieu qui nous
inflige les couchers de soleils, les clairs de lune, les furoncles ou la jalousie.
Revanche sur la vie, qu’on passe au noir. Ou au rose, ce qui est le comble de
la dérision35.
On n’est pas très sûr de vouloir suivre Georges Hyvernaud (car c’est
de lui qu’il s’agit) sur ce terrain ressentimental miné, non transformé,
comme si la chance de la littérature, son unique possibilité à l’ère post-
apocalyptique, était l’irritation du derme, le grattage de la plaie vive.
On n’est pas très sûr que cela donne toujours de la (bonne) littérature,
même si l’on retrouve quelque chose du lyrisme scatologique de Flaubert
emporté contre son siècle de bêtise, et décrivant à son ami Louis Bouilhet
son nouveau projet littéraire : « Je sens contre la bêtise de mon époque
des flots de haine qui m’étouffent. Il me monte de la merde à la bouche,
comme dans les hernies étranglées. Mais je veux la garder, la figer, la
durcir. J’en veux faire une pâte dont je barbouillerais le xixe siècle,
comme on dore de bougée de vache les pagodes indiennes […] 36. » Il n’y
a pas que la colère que l’on met en banque, il y a aussi la pâte légèrement
coprophilique de la littérature selon Flaubert.
Martine Boyer-Weinmann
Université Lumière Lyon 2
34 Ibid., p. 153.
35 Georges Hyvernaud, Lettre anonyme, nouvelles et autres inédits (Œuvres complètes, 3), Paris,
Ramsay, 1986, p. 93-94.
36 Gustave F laubert, lettre à Louis Bouilhet, 30 septembre 1855, in Correspondance, t. II
(juillet 1851-décembre 1858), éd. établie, présentée et annotée par Jean Bruneau, Paris,
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980, p. 600.
Modernites34.indd 97 19/09/12 11:19
98 Martine Boyer-Weinmann
Bibliographie
A rtaud, Antonin, L’Ombilic des limbes, Paris, Éditions de la Nouvelle Revue
française, 1925 ; repris dans Œuvres complètes, t. I, nouv. éd. revue et
augmentée, Paris, Gallimard, 1976, p. 47-76.
—, Le Pèse-nerfs, Paris, Impr. de Leibovitz, 1925 ; repris ibid., p. 77-109.
Barthes, Roland, Le Neutre : notes de cours au Collège de France (1977-
1978), texte établi, annoté et présenté par Thomas Clerc, sous la direction
d’Éric Marty, Paris, Éd. du Seuil – IMEC, coll. « Traces écrites », 2002.
Boyer-Weinmann, Martine et M artin, Jean-Pierre (dir.), Colères d’écrivains,
Nantes, Cécile Defaut, 2009.
Damasio, Antonio, Le Sentiment même de soi : corps, émotions, conscience
[The Feeling of What Happens, 1999], trad. de l’anglais (États-Unis) par
Claire Larsonneur et Claudine Tiercelin, Paris, Odile Jacob, 1999.
—, Spinoza avait raison : joie et tristesse, le cerveau des émotions [Looking
for Spinoza, 2003], trad. de l’anglais (États-Unis) par Jean-Luc Fidel, Paris,
Odile Jacob, 2003.
Flaubert, Gustave, Correspondance, t. II (juillet 1851-décembre 1858),
éd. établie, présentée et annotée par Jean Bruneau, Paris, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 1980.
Hobsbawm, Eric J., L’Âge des extrêmes : le court vingtième siècle, 1914-1991
[The Age of Extremes, 1994], trad. de l’anglais, Bruxelles, Éd. Complexe,
Paris, Le Monde diplomatique, 1999.
Hyvernaud, Georges, Lettre anonyme, nouvelles et autres inédits (Œuvres
complètes, 3), préface de Roland Desné, Paris, Ramsay, 1986.
Kundera, Milan, Le Rideau : essai en sept parties, Paris, Gallimard, 2005 ;
repris dans Œuvre, édition définitive, préface et biographie de l’œuvre par
François Ricard, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2011,
t. II, p. 939-1057.
Le Breton, David, Les Passions ordinaires : anthropologie des émotions,
Paris, Payot, 1998 ; rééd. « Petite bibliothèque Payot », 2004.
Louette, Jean-François, « Foin de la littérature ! », in M. Boyer-Weinmann
et J.-P. M artin (dir.), Colères d’écrivains, op. cit., p. 27-54.
M alabou, Catherine, Ontologie de l’accident : essai sur la plasticité
destructrice, Paris, Léo Scheer, coll. « Variations », 2009.
M ichaux, Henri, Plume, précédé de Lointain intérieur, nouv. éd. revue et
corrigée, Paris, Gallimard, 1963.
—, Passages (1937-1963), nouv. éd. revue et augmentée, Paris, Gallimard,
coll. « L’Imaginaire », 1998.
Musil, Robert, L’Homme sans qualités [1930-1932], trad. de l’allemand par
Philippe Jaccottet, et par Jean-Pierre Cometti et Marianne Rocher-Jacquin
pour les textes nouveaux, Paris, Éd. du Seuil, 2004, 2 vol.
Modernites34.indd 98 19/09/12 11:19
Thymotique d’une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? 99
Nizan, Paul, Aden Arabie, Paris, Rieder, 1931 ; rééd. avec l’avant-propos de
Jean-Paul Sartre, Paris, La Découverte, 1987.
Pachet, Pierre (dir.), La Colère, instrument des puissants, arme des faibles,
Paris, Autrement, coll. « Morales », 1997.
Sartre, Jean-Paul, Esquisse d’une théorie des émotions [1938], Paris,
Hermann, coll. « L’Esprit et la main », 1965.
—, Baudelaire, précédé d’une note de Michel Leiris, Paris, Gallimard, coll.
« Les Essais », 1947 ; rééd. coll. « Folio-essais », 1988.
—, Saint Genet comédien et martyr, Paris, Gallimard, 1952.
—, Les Carnets de la drôle de guerre, septembre 1939-mars 1940, texte établi
et annoté par Arlette Elkaïm-Sartre, nouv. éd., Paris, Gallimard, 1995.
Sloterdijk, Peter, Colère et temps : essai politico-psychologique [Zorn und
Zeit. Politisch-psychologischer Versuch, 2006], trad. de l’allemand par
Olivier Mannoni, Paris, Libella-Maren Sell, 2007.
Modernites34.indd 99 19/09/12 11:19
Modernites34.indd 100 19/09/12 11:19
Une question de vie ou de mort ?
Des usages éthiques de l’émotion dans la fiction
Une bombe a été posée dans un lieu public, elle va exploser d’un
moment à l’autre et faire des centaines, voire des milliers de victimes
innocentes ; un homme a été arrêté qui sait où elle se trouve. N’a-t-on
pas le droit, dans ce cas, d’user de tous les moyens possibles pour faire
parler le terroriste et intercepter la bombe à temps ? C’est largement
sur la base de ce scénario fictif, dit de « la bombe à retardement »,
que la question de la torture s’est réimposée dans le débat public sous
la forme d’un enjeu moral. Pourtant, ce qui emporte alors souvent
la tentation d’autoriser exceptionnellement, en conscience, la torture
dans certaines circonstances liées au contre-terrorisme, ce n’est pas
tant la puissance de conviction du raisonnement utilitariste lui-même
(sauver cent, mille ou dix mille vies au prix d’un corps torturé – et qui
méritait bien de souffrir un peu, pourrait-on ajouter) que l’émotion
qui submerge alors la réflexion et balaie toute prudence dans la prise
en compte de ce scénario fantasmatique. Mais l’adossement à cette
fiction extrême n’égare-t-elle pas la réflexion collective sur la torture
plus qu’elle ne la clarifie1 ? Car peut-on prendre une décision juridique
à portée générale sur la base d’une fiction d’exception inventée pour
les besoins de la démonstration ? La « question de vie ou de mort » que
véhicule ce scénario fictionnel n’engage-t-elle pas la réflexion morale
au-delà du point où la raison lui accorderait d’aller ?
1 Voir l’essai de Michel T erestchenko, Du bon usage de la torture ou Comment les démocraties
justifient l’injustifiable, Paris, La Découverte, 2008.
Modernites34.indd 101 19/09/12 11:19
102 Frédérique Leichter-Flack
Dans sa capacité à bâtir des récits de situations extrêmes auxquelles
la puissance de l’émotion produite donne l’allure d’une question de
vie ou de mort, la fiction est, en fait, extrêmement malléable sur le
plan argumentatif. Si la fable de la bombe à retardement oriente la
conviction en direction d’une légitimation de la torture, le récit de
fiction peut très bien argumenter en sens inverse, et la littérature
moderne, dans son formulation du problème du Mal, s’est même bâtie,
pourrait-on soutenir, sur une fable qui argumente à l’inverse. C’est la
fameuse question d’Ivan à Aliocha, à la fin du chapitre « Rébellion »
des Frères Karamazov : « Dis-le moi franchement, je t’y appelle –
réponds : imagine que c’est toi-même qui mènes toute cette entreprise
d’édification du destin de l’humanité dans le but, au final, de faire le
bonheur des hommes, de leur donner au bout du compte le bonheur
et le repos, mais que, pour cela, il serait indispensable, inévitable
de martyriser rien qu’une seule toute petite créature, tiens, ce tout
petit enfant, là, qui se frappait la poitrine avec son petit poing, et de
baser cette entreprise sur ses larmes non vengées, toi, est-ce que tu
accepterais d’être l’architecte dans ses conditions, dis-le, et ne mens
pas2 ! » À cette question, Aliocha, ébranlé par la vingtaine de pages de
récits d’enfants martyrisés auxquels l’a soumis son frère, répond bien
évidemment non. Mais si la conclusion argumentative est différente, le
mécanisme est le même que dans la fable de la bombe à retardement :
Ivan raconte des petites histoires, dont le statut avéré revendiqué
(ce sont des faits divers repérés dans les journaux) n’enlève rien au
caractère « fictif », puisque dans la bouche d’Ivan qui les raconte,
elles fonctionnent avant tout comme des vignettes narratives visant à
produire un certain effet sur l’auditoire auquel elles sont destinées ;
ces récits engrangent un paquet explosif d’émotions, dont il suffit à la
fin à Ivan d’allumer la mèche pour emmener son interlocuteur Aliocha
(et le lecteur avec lui) là où il voulait le conduire dès le début. Dans les
deux cas, le recours aux ressources de la fiction (comme art d’inventer
et de raconter des histoires) provoque une décision morale qui engage
l’universel, via le détour par la considération de l’exception.
Quelle part faut-il donc accorder à la fiction dans cet usage de
l’émotion au service de la réflexion éthique ? En imaginant et en
formulant des situations possibles, la fiction narrative forme et affine
notre capacité de réflexion éthique en l’obligeant à s’affronter aux
mille nuances dont la littérature est le médium privilégié, au sens
2 Fédor Dostoïevski, Les Frères Karamazov [1879-1880], trad. du russe par André Markowicz,
Arles, Actes Sud, 2002, t. I, p. 443-444.
Modernites34.indd 102 19/09/12 11:19
Une question de vie ou de mort? Des usages éthiques de l’émotion dans la fiction 103
où elle formule sans doute des problèmes éthiques inaperçus qu’elle
oblige ses lecteurs à prendre en compte. Mais ne fausse-t-elle pas,
du même mouvement, le raisonnement moral sur ce qu’il est juste de
faire ? Quelle valeur éthique pour l’émotion sur laquelle la fiction bâtit
sa puissance ? Le survol de trois textes littéraires bien connus fournira
quelques balises en direction de ce questionnement.
*
On se souvient comment, à la fin de Quatrevingt-treize, le roman
que Hugo consacre à la guerre civile postrévolutionnaire, le contexte
particulièrement dramatique précipite le dénouement de l’intrigue.
Le royaliste vendéen Lantenac et ses hommes sont retranchés dans la
Tourgue, encerclée et assiégée par l’armée républicaine de Gauvain et
Cimourdin. Les royalistes ont trois otages avec eux, trois jeunes enfants
âgés de deux, quatre et cinq ans, enfermés dans une pièce à laquelle ils
menacent de mettre le feu si les républicains ne les laissent pas s’enfuir.
L’assaut commence. Les Vendéens réussissent à s’enfuir par un passage
secret, laissant sur place le plus sauvage d’entre eux, l’Imânus, pour
couvrir leur fuite et retarder leurs poursuivants. Celui-ci, blessé, décide
d’allumer la mèche fatale. Le feu prend. Les enfants vont mourir dans
l’incendie : la porte de métal, fermée à clé, ne peut être enfoncée ; on
n’a pas d’échelle pour les atteindre par la fenêtre. Les républicains ne
peuvent que regarder d’en bas le spectacle tragique qui s’annonce. Leur
impuissance est totale. Le seul qui pourrait encore quelque chose, c’est
Lantenac, qui a la clé dans sa poche. Mais il a déjà quitté la Tourgue
par le passage secret. Déjà loin, il se retourne pourtant sur l’incendie
en entendant le cri d’horreur de la mère des petits, arrivée sur place
après plusieurs semaines d’errance en quête de ses enfants enlevés. Le
narrateur nous décrit alors comment, sans un mot, Lantenac revient
sur ses pas, ouvre la porte de fer avec sa clé, traverse les flammes et,
un à un, descend les trois enfants qu’il remet à leur mère, avant de se
laisser arrêter par les révolutionnaires.
Le geste de Lantenac se découpe sur fond de dramatisation extrême.
Tout concourt à la création d’une émotion maximale, partagée par tous
les témoins du drame imminent, et par le lecteur : la présence de la
mère, qui ne retrouve ses enfants que pour les regarder mourir, quatre
mille cinq cents hommes armés impuissants à sauver trois enfants d’une
mort horrible, pas d’échelle pour atteindre la fenêtre, pas d’eau pour
éteindre l’incendie, une porte en métal indestructible, aucun espoir
de salut, et une disposition des lieux qui offre au regard des témoins
assemblés en contrebas non seulement l’agonie imminente des enfants,
Modernites34.indd 103 19/09/12 11:19
104 Frédérique Leichter-Flack
mais même, avant elle, l’inconscience bouleversante des trois petits
endormis, ignorants de ce qui les attend. Quant au geste de Lantenac,
il ne sera ni théorisé ni expliqué ; sa décision de revenir sur ses pas
n’avait pas été précédée d’une délibération : le dispositif narratif s’est
arrangé pour qu’elle apparaisse directement déclenchée par la pression
du contexte – l’urgence, l’émotion, le cri d’horreur de la mère (« on me
brûle mes enfants ! »).
Le dispositif narratif est donc clair : c’est l’émotion qui sauve les
enfants. Si c’est là une vertu éthique de l’émotion, elle n’est nullement
théorisée comme telle, et ne saurait l’être : quand une situation se
présente, dans l’urgence, comme une question de vie ou de mort, on ne
réfléchit pas, l’émotion précipite l’action, brouille le jugement. Dans le cas
présent, l’émotion semble avoir obligé Lantenac à reconnaître à la vie des
trois enfants une priorité morale sur la poursuite de son combat, la cause
qu’il défend, et, accessoirement, sa propre vie, mais cette émotion n’est
considérée comme bonne conseillère par le lecteur, dans ce cas précis,
que parce que le roman s’est arrangé, jusque-là, pour que le combat de
Lantenac ne suscite aucune sympathie. La question des priorités morales
(l’arbitrage entre la vie de ces trois innocents et la cause qu’on défend, et
au-delà de cette cause, toutes les autres vies qu’on défend au travers d’un
engagement politique) n’est nullement tranchée par le choix de Lantenac :
la longue délibération torturée de Gauvain, dans les pages suivantes, est là
pour le prouver, puisqu’elle tourne précisément autour de cette question
des priorités morales (dette de vie et d’honneur contre devoir envers la
France et ses opprimés ?) et qu’elle ne la résout pas.
Si l’émotion n’est pas directement porteuse d’un enseignement moral,
elle a pourtant une fonction éthique assez claire : faire apercevoir
le problème jusqu’alors inaperçu. Il fallait que cela sente le brûlé
pour que le sort des enfants soit pris en compte comme l’incarnation
symbolique d’un problème moral et politique crucial. Or, c’est peut-
être dans cette fonction-là – pédagogique – que l’émotion à la Hugo
est devenue le plus superflue, voire peut-être même gênante. Car
pour les lecteurs contemporains que nous sommes, l’enjeu moral de
la question de vie ou de mort n’avait pas attendu l’urgence de l’agonie
imminente dans les flammes : le chantage à la vie des enfants n’avait-il
pas servi de signal suffisant ? Quelques dizaines de pages plus haut, en
effet, les assiégés de la Tourgue avaient adressé aux républicains une
proposition en forme d’ultimatum :
Nous avons en nos mains trois prisonniers, qui sont trois enfants. Ces enfants
ont été adoptés par un de vos bataillons, et ils sont à vous. Nous vous offrons
de vous rendre ces trois enfants.
Modernites34.indd 104 19/09/12 11:19
Une question de vie ou de mort? Des usages éthiques de l’émotion dans la fiction 105
À une condition.
C’est que nous aurons la sortie libre.
Si vous refusez, écoutez bien […]. Si vous refusez de nous laisser sortir, les
trois enfants seront placés dans le deuxième étage du pont, entre l’étage où
aboutit la mèche soufrée et où est le goudron et l’étage où est la paille, et la
porte de fer sera refermée sur eux. Si vous attaquez par le pont, ce sera vous
qui incendierez le bâtiment ; si vous attaquez par la brèche, ce sera nous ; si
vous attaquez à la fois par la brèche et par le pont, le feu sera mis à la fois
par vous et par nous ; et, dans tous les cas, les trois enfants périront. À pré-
sent, acceptez ou refusez. Si vous acceptez, nous sortons. Si vous refusez, les
enfants meurent. J’ai dit3.
« Nous refusons », avaient immédiatement répondu les
républicains. La réponse avait fusé, sans l’ombre d’une hésitation ; la
seule marque de trouble avait été, dans la voix de Gauvain, recouverte
par la perspective d’obtenir un délai suffisant pour organiser
clandestinement un projet de sauvetage des enfants. Mais le problème
ne s’était pas posé au moment du chantage : ni aux assiégés preneurs
d’otages, ni aux assiégeants. Il ne se pose que dans l’urgence de
l’agonie imminente, après la fabrication, par la fiction, d’une émotion
artificielle, suffisamment puissante pour déclencher le réflexe de
Lantenac, i.e. trancher le nœud gordien sans le démêler.
Pourquoi toute cette émotion, intercalée entre la formulation
du chantage à la vie des enfants otages, et le geste de Lantenac, à
vertu pédagogique éthique évidente, nous paraît-elle aujourd’hui
excessive, voire déplacée ? Tout semble se passer comme si nous n’en
avions pas besoin, et que, du coup, elle nous irritait en nous donnant
l’impression de s’adresser à des consciences éthiques moins évoluées
que la nôtre. Est-ce à dire qu’il y aurait, entre les hommes de Hugo
et nous, quoi que ce soit comme un progrès moral ? Ou est-ce parce
que la violence politique s’est montrée, au cours du xxe siècle, plus
cruelle et plus tragique que tout ce que Hugo pouvait imaginer à son
époque ? Est-ce parce que nous sommes familiers de cas similaires,
à la fois plus graves et plus sobres, en un mot parce que nous lisons
Hugo après la prise d’otages de Beslan, ou après tout ce que l’on sait
de la Gestapo ? L’histoire de la littérature a aussi joué en la matière un
rôle crucial : toute une filiation littéraire en effet, à commencer par
le sillage ouvert par le grand discours d’Ivan Karamazov à son frère
Aliocha, a contribué à instaurer un réflexe éthique dès lors que la vie
3 Victor Hugo, Quatrevingt-treize [1874], notices et notes de Jean Gaudon, in Romans III
(Œuvres complètes, publiées sous la dir. de Jacques Seebacher et Guy Rosa), Paris, Robert
Laffont, coll. « Bouquins », 1985, III, ii, 10 (« Les otages »), p. 964.
Modernites34.indd 105 19/09/12 11:19
106 Frédérique Leichter-Flack
d’enfants est en jeu4. C’est aussi parce que nous avons assimilé toute
cette littérature dans laquelle l’enfant est un marqueur moral, et que
nous nous sommes laissé modifier par elle, que le chantage à la vie
des enfants est assez parlant pour rendre superflue toute pédagogie
supplémentaire par le pathos.
Mais Hugo, en écrivant Quatrevingt-treize, n’avait ni lu Les Frères
Karamazov, ni vu les images du carnage de Beslan à la télévision,
et il fallait donc, pédagogiquement parlant, que ça sente le brûlé.
L’émotion aura donc servi à sauver la vie des enfants. Mais enseigne-
t-elle aussi que la vie de quelques enfants vaut plus que toutes les
causes politiques, toutes les luttes, toutes les résistances ? Assurément
non. D’abord, la cause de Lantenac n’étant pas perçue par le lecteur
comme une guerre juste, son sacrifice n’est pas spontanément reçu au
niveau éthique et politique où il mérite de l’être : il faudra toute la
méditation postérieure de Gauvain sur l’acte de Lantenac pour le faire
apercevoir pour ce qu’il est, à savoir un sacrifice non tant de sa propre
vie, mais de son combat, du sens de son engagement, de la vision de
l’avenir qu’il espère pour la France. Ensuite, la question des priorités
morales et des dilemmes du devoir, longuement étudiée par Gauvain,
ne sera pas tranchée par lui. Comme souvent chez Hugo, en effet, les
dilemmes, loin d’être aussi simples que solennels, se composent de
plusieurs questionnements enchevêtrés. En considérant ce qu’il doit
faire de Lantenac emprisonné et condamné à mort, Gauvain se pose
plusieurs problèmes successifs et parallèles. D’abord, une première
question pourrait être : la justice doit-elle être clémente envers un
meurtrier qui a sauvé des vies ? Si la bonne action et la mauvaise sont
décorrélées, la réponse n’est pas si difficile à apporter ; mais si les deux
actions (la culpabilité meurtrière et le sauvetage) portent sur le même
terrain, tout en étant numériquement dissymétriques, la réponse
est évidemment moins simple. L’émotion joue ici un rôle certain. La
justice internationale chargée d’instruire les chefs de génocide, ou les
instances mémorielles soucieuses d’honorer des justes, dans le contexte
des génocides juif et tutsi, ont eu à se pencher sur des cas de ce type. Le
principe « Qui sauve une vie sauve l’humanité tout entière » ne saurait
suffire à motiver une décision clémente de justice, surtout si l’on défend
de la même manière l’idée que « qui tue un homme tue l’humanité tout
entière »… Pas question de se résoudre, avec le personnage du fol-en-
Dieu Ikonnikov dans Vie et destin, à considérer la bonté individuelle
4 Voir Frédérique L eichter-F lack, « Une indignation insatiable ? La souffrance de l’enfant
entre droit et littérature », Les Cahiers de la justice, 2011/1, avril 2011, p. 111-120.
Modernites34.indd 106 19/09/12 11:19
Une question de vie ou de mort? Des usages éthiques de l’émotion dans la fiction 107
comme le seul Bien, ou comme la seule réponse à la question posée par
la nécessité de la violence politique. Gauvain d’ailleurs dépasse vite le
problème de la rétribution de la générosité du criminel :
Trois enfants étaient perdus ; Lantenac les avait sauvés.
Mais qui donc les avait perdus ?
N’était-ce pas Lantenac ?
[…]
Qu’avait-il donc fait de si admirable ?
Il n’avait point persisté, rien de plus.
[…] Et pour si peu, lui rendre tout5 !
La deuxième question prise en charge par le dilemme de Gauvain
concerne le difficile arbitrage entre devoirs incompatibles : dette de
vie envers un homme, ou devoir envers la France ? Là encore, Gauvain
n’a pas de réelle hésitation. Mais la question se déplace légèrement,
sur le terrain de la légitimité, qui surgit de l’articulation entre le
risque d’image et le sens politique profond de la cause qu’il défend.
Car Gauvain s’inquiète de l’image que va s’attirer la Révolution si
elle guillotine Lantenac après le sacrifice héroïque qui a permis sa
capture.
Répondre à un acte généreux par un acte sauvage !
Donner ce dessous à la révolution !
Quel rapetissement pour la république !
[…]
Quoi ! Ne pas lutter de magnanimité ! […] faire dire qu’il y a, du côté de la
monarchie, ceux qui sauvent les enfants, et du côté de la république, ceux qui
tuent les vieillards6 !
La séduction de son geste sert sa cause, car elle est conforme au
sentiment moral populaire. Mais du coup, ce n’est pas qu’un risque
d’image. La Révolution, comprend Gauvain, doit être à la hauteur
morale à laquelle Lantenac a hissé sa cause. Il faut montrer au
peuple, et affirmer solennellement pour nous-mêmes, pense Gauvain,
que nous sommes « pour la vie » : « attester l’humanité », « prouver
qu’au-dessus des royautés, au-dessus des révolutions, il y a l’immense
attendrissement de l’âme humaine7 ». La question de l’exemplarité
morale débouche donc sur celle de la légitimité du combat politique.
Le problème se pose dans les mêmes termes aujourd’hui à propos de
la lutte contre-terroriste et de ses dilemmes en démocratie. Camus
résumait déjà, dans les Lettres à un ami allemand, tout le dilemme
de la guerre juste dans le contexte pourtant difficilement contestable
5 V. Hugo, Quatrevingt-treize, op. cit., III, vi, 2, p. 1038.
6 Ibid., p. 1035-1036.
7 Ibid., p. 1039.
Modernites34.indd 107 19/09/12 11:19
108 Frédérique Leichter-Flack
de la guerre contre le nazisme, avec « la perpétuelle tentation où nous
sommes de vous ressembler8 ». C’est toute la question des moyens au
service de la fin politique : le risque d’image est fondamentalement
un risque de légitimité. Les perceptions comptent, profondément. Car
elles sont un révélateur éthique.
In fine, le choix de Gauvain, qui va libérer Lantenac au prix
de sa propre vie, correspondra au mouvement premier, spontané,
intuitif, vers quoi le portait son trouble devant la transfiguration de
Lantenac, mais ce n’est pas son émotion qui provoque ce choix. Entre
le trouble de Gauvain et la libération de Lantenac, plusieurs pages
de délibération rationnelle se sont interposées. L’émotion n’aura été
qu’un déclencheur de délibération éthique et politique. L’émotion a-t-
elle alors une valeur morale ? Ou n’est-elle qu’un outil, un médium qui
rend capable de percevoir le problème moral, qui prépare au dilemme
resté sans elle inaperçu ?
*
Un autre exemple, très proche, et non moins connu que la fin de
Quatrevingt-treize, permettra de prolonger la réflexion. Dans la
pièce de Camus intitulée Les Justes, l’émotion remplit le même rôle
que dans le roman de Hugo : elle sert d’opérateur de visibilité éthique,
elle ouvre un espace de débat en obligeant à voir un problème qui
était pourtant déjà là, mais qu’on ne se posait pas. C’est Yanek (Ivan
Kaliayev) qui raconte : « Alors, je ne sais pas ce qui s’est passé. Mon
bras est devenu faible. Mes jambes tremblaient. Une seconde après, il
était trop tard9. » Dans le carrosse sur lequel il s’apprêtait à lancer sa
bombe, le révolutionnaire venait d’apercevoir deux enfants, les neveux
du grand-duc. Est-ce à dire que Yanek renonce à jeter sa bombe sur le
carrosse du grand-duc par pitié pour les deux enfants qui s’y trouvent ?
Pas tout à fait. L’émotion, ce réflexe du corps, arrête son geste, mais
pas définitivement. Elle ouvre un espace de débat, mais ne tranche
pas la question de savoir si oui ou non la bombe devait être lancée, et
surtout, si elle doit l’être à nouveau, dès que possible, enfants ou pas.
Au contraire, l’émotion déclenche un débat âpre et impitoyable, dans
lequel la pitié est vite reléguée à sa juste place, en marge du problème.
8 Albert Camus, Lettres à un ami allemand [1943-1944], in Œuvres complètes, t. II, sous la dir.
de Jacqueline Lévi-Valensi, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2006, 1re lettre,
p. 10.
9 Id., Les Justes [1949], in Œuvres complètes, t. III, éd. publiée sous la dir. de Raymond Gay-
Crosier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2008, p. 19.
Modernites34.indd 108 19/09/12 11:19
Une question de vie ou de mort? Des usages éthiques de l’émotion dans la fiction 109
Car le groupe de terroristes a un problème urgent à trancher :
Yanek doit-il retourner attendre le grand-duc à la sortie du théâtre
pour jeter sa bombe sur le carrosse transportant aussi les enfants ? Le
fait d’avoir cédé à l’émotion sur le moment ne préjuge pas de la valeur
et de la pertinence de ce choix émotionnel. Yanek est, au contraire,
tout prêt à le remettre en cause, si le groupe lui donne l’ordre d’aller
lancer sa bombe sur les enfants. L’émotion – la pitié ici – n’est pas un
facteur légitime de prise de décision. Elle n’est, là encore, au départ
qu’instrumentale. La pitié n’est donc pas une objection pertinente au
terrorisme. Si elle brise la disjonction entre la cible et le visage de la
victime, elle n’a qu’une capacité limitée à interrompre le geste, mais pas
d’aptitude à le disqualifier. La vraie question n’est pas : « Pourrais-tu
le faire, toi, tuer des enfants ? » comme il est demandé à Stepan qui
conteste l’attitude de Yanek, car il y a toujours quelqu’un qui pourra
le faire si on lui en donne l’ordre. La vraie question, déclenchée par
l’émotion et prise en charge par le débat, est plutôt : faut-il le faire
quand même ?
Et, comme dans le dilemme de Gauvain, la question de la légitimité
se donne à percevoir par l’intermédiaire d’un risque d’image,
propédeutique à l’enjeu éthique. Car à la question : « A-t-on le droit de
tuer des enfants pour renverser la tyrannie ? » Stepan répondait oui
sans hésiter. Sa réponse pourrait être considérée comme exemplaire
des raisonnements modernes sur la guerre juste, puisqu’il prend appui
sur une évaluation coût-bénéfice : « Des enfants ! Vous n’avez que ce
mot à la bouche. Ne comprenez-vous donc rien ? Parce que Yanek n’a
pas tué ces deux-là, des milliers d’enfants russes mourront de faim
pendant des années encore10. » Le discours de la guerre juste aura
toujours l’argument de la proportionnalité de son côté (puisque son
appréciation dépend de la valeur accordée au but) – du moins tant
que l’émotion n’entre pas en jeu. Car les perceptions émotionnelles
compliquent le raisonnement, brouillent l’évaluation coût-bénéfice,
retournant l’argumentaire de la proportionnalité contre le thème de la
guerre juste. Si, en théorie, l’objection de la guerre sale n’atteint pas
le discours de la guerre juste, en pratique, les exemples ne manquent
pas qui montrent combien la première défait le second. Car, quand
l’émotion s’en mêle, il est plus difficile de justifier une mort singulière
que mille morts anonymes. « Ouvre les yeux [dit Dora] et comprends
que l’Organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait,
10 Ibid., p. 21.
Modernites34.indd 109 19/09/12 11:19
110 Frédérique Leichter-Flack
un seul moment, que des enfants fussent broyés par nos bombes11. »
L’invocation du risque d’image n’est pas une régression morale dans
la bouche de Dora, c’est une preuve par le consensuel humain ; c’est
le maillon opératoire qui permet de conclure contre Stepan, avec
Yanek, « ceci, que pourrait dire le plus simple de nos paysans : tuer
des enfants est contraire à l’honneur12 ».
Quel rôle joue ici l’émotion, pour les personnages et pour le lecteur
balloté entre eux ? Elle est l’instrument, le médium de l’argumentation,
l’opérateur de conviction qui rend les arguments rationnels efficaces.
Mais elle est encore davantage. Car s’il y a une limite, comme dit
Dora, dans l’usage de la violence politique, cette limite n’est pas aisée
à définir : elle n’a rien d’objectif, et se déplace au gré d’un curseur
circonstanciel : ici, on épargnera les enfants, mais pas la femme.
Et surtout, cette limite n’est pas celle de l’innocence objective des
victimes à épargner : peu importe ainsi à Yanek d’apprendre, de la
bouche de la grande-duchesse, à la fin de la pièce, que les deux enfants
qu’il a épargnés ont le cœur mauvais et ne méritaient pas la grâce qui
leur a été accordée. La limite n’est pas celle de l’innocence objective
des victimes, mais celle de l’innocence préservée comme un possible,
comme une catégorie mentale qu’on est encore capable de prêter
à l’ennemi, dont on est encore capable de reconnaître la nécessité,
comme un sanctuaire que la violence politique n’aurait pas le droit
d’atteindre : l’émotion élémentaire pour l’humain commun, ou le droit
de la vie à la vie. Ce qu’ailleurs, dans les Lettres à un ami allemand,
Camus évoquait comme « le souvenir d’une mer heureuse, d’une
colline jamais oubliée, le sourire d’un cher visage13 ».
C’est donc moins un pari sur la vertu de l’émotion qu’un pari sur
sa valeur : maintenir en soi la possibilité d’être touché par l’émotion,
le droit de l’émotion à arrêter le geste et à intervenir sur le terrain de
la rationalité politique (où elle est pourtant le moins légitime) pour
donner son avis, perturber les évaluations coût-bénéfice, s’inviter
dans le jeu au risque de le faire tourner en notre défaveur. Au risque
de creuser, davantage encore, notre propre vulnérabilité.
*
Car cette position morale fragilise, cela va de soi, la capacité à faire
la guerre, quelle qu’elle soit, y compris là où elle est le plus nécessaire.
11 Ibid., p. 20.
12 Ibid., p. 23.
13 A. Camus, Lettres à un ami allemand, op. cit., 4 e lettre, p. 27.
Modernites34.indd 110 19/09/12 11:19
Une question de vie ou de mort? Des usages éthiques de l’émotion dans la fiction 111
Et c’est cette fragilité qui doit être à présent explorée, à partir d’un
troisième exemple, tout aussi connu : la scène de la barricade dans
Les Misérables de Hugo14. Il ne s’agit plus ici de tuer pour des idées,
mais de mourir pour des idées, mais pour la manière dont le roman
fait usage de l’émotion, cela revient à peu près au même. La scène se
passe sur l’une des barricades des journées de juin 1832 : Enjolras,
assisté de Combeferre et de Marius, dirige le petit groupe d’insurgés.
Ceux-ci viennent d’apprendre que l’armée s’apprête à donner l’assaut
et que le peuple ne se soulèvera pas : ils sont perdus, la barricade vit
ses dernières heures. Loin de céder au désespoir alors, ils trouvent
refuge dans l’exemplarité héroïque de leur engagement jusqu’à la mort :
« Citoyens, faisons la protestation des cadavres. Montrons que, si le
peuple abandonne les républicains, les républicains n’abandonnent pas
le peuple. » Et tous de reprendre : « Vive la mort ! Restons ici tous. »
Face à cet enthousiasme funèbre, à cet élan fanatique vers une mort non
seulement acceptée, mais désirée comme la preuve ultime de la justesse
de leur cause et de la totalité de leur engagement, Enjolras proteste avec
irritation : « Pourquoi tous ? […] La position est bonne, la barricade
est belle. Trente hommes suffisent. Pourquoi en sacrifier quarante ?
[…] la république n’est pas assez riche en hommes pour faire des
dépenses inutiles. La gloriole est un gaspillage. Si, pour quelques-uns,
le devoir est de s’en aller, ce devoir-là doit être fait comme un autre15. »
Les insurgés possèdent quatre uniformes de gardes nationaux : quatre
hommes pourront s’enfuir, déguisés, sans risquer d’être arrêtés. Mais
personne ne veut céder sa place dans cette gloire funèbre. C’est alors
qu’intervient Combeferre : son discours, voué à l’émotion, va obtenir
ce que les propos d’Enjolras n’avaient pas réussi à emporter : cinq
hommes sont désignés et exfiltrés. Mais au prix d’une inversion de sens
qui atteint frontalement l’héroïsme sacrificiel, et dont l’engagement lui-
même ne sort pas indemne.
Enjolras, en effet, avait contre le fanatisme suicidaire des objections
rationnelles et pragmatiques : celle d’un militant qui s’efforce d’utiliser
au mieux ses ressources humaines. Dans cette logique économique,
certaines vies sont plus précieuses que d’autres, car plus utiles pour
la continuation du combat : les meilleurs doivent être exfiltrés. Mais
l’héroïsme sacrificiel (vive la mort !) ne peut pas entendre les arguments
comptables de la raison militante. C’est le langage de l’émotion que
14 V. Hugo, Les Misérables [1862], notice et notes de Guy et Annette Rosa, in Romans II (Œuvres
complètes, op. cit.), V, i, 3 (« Éclaircissement et assombrissement ») et 4 (« Cinq de moins, un
de plus »), p. 933-939.
15 Ibid., V, i, 4, p. 934-935.
Modernites34.indd 111 19/09/12 11:19
112 Frédérique Leichter-Flack
Combeferre va leur parler. Et il annonce d’emblée la couleur, aux
insurgés comme au lecteur : une rhétorique massive, tout entière vouée
à la création de pathos. « Allons, dit-il, il faut avoir un peu de pitié.
Savez-vous de quoi il est question ici ? Il est question des femmes. Y a-t-il
des femmes, oui ou non ? y a-t-il des enfants, oui ou non ? […] Mourez,
soit, mais ne faites pas mourir16. » Et de les rudoyer, en les prenant par
les sentiments : tableau de la vieille mère, attendant à la fenêtre (« Vous
vous faites tuer, vous voilà morts, c’est bon, et demain17 ? ») ; tableau
des sœurs et des filles, qui se vendront sur le pavé (« Ah ! vous vous êtes
fait tuer ! ah ! vous n’êtes plus là ! C’est bien ; vous avez voulu soustraire
le peuple à la royauté, vous donnez vos filles à la police18 ») ; ou encore
tableau de l’enfant affamé, « tout petit, haut comme cela », devenu
orphelin, et dont Combeferre décrit l’agonie à l’hospice Necker19. Et de
conclure : « Il ne faut pas être égoïstes20. » Cette rhétorique émotionnelle
est efficace sur les hommes de la barricade, qui vont se « dénoncer »
les uns les autres, se forcer mutuellement au salut. Mais – et c’est là le
problème – elle l’est aussi sur le lecteur.
Sous la surface de l’émotion, l’argumentaire logique, porté par elle,
est doublement dangereux pour l’engagement. D’abord en ce qu’il ne
saurait être circonscrit à des critères de sélection objectifs : tout le
monde est concerné, chacun a des proches que sa mort va bouleverser
et abandonner. L’accroche de Combeferre (« Il est question des
femmes. Y a-t-il des femmes, oui ou non ? y a-t-il des enfants, oui ou
non ? ») est trompeuse, de même que l’appel de Marius qui la relaie
(« Les hommes mariés et les soutiens de famille hors des rangs21 ! ») ;
elle mime la formule convenue « les femmes et les enfants d’abord ! »
dans une situation où ces priorités-là ne sont plus pertinentes, si tant
est qu’elles l’aient jamais été. Preuve par la fiction : cinq hommes sont
désignés au lieu de quatre ; et tous ont le même droit (ou plutôt, le
même devoir) de vivre : « – Toi, tu as une femme qui t’aime. – Toi, tu
as ta vieille mère. – Toi, tu n’as plus ni père ni mère, qu’est-ce que tes
trois petits frères vont devenir ? – Toi, tu es père de cinq enfants. – Toi,
tu as le droit de vivre, tu as dix-sept-ans, c’est trop tôt 22. » Au jeu de
16 Ibid. p. 935.
17 Ibid. p. 936.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid. p. 937.
21 Ibid.
22 Ibid., p. 938.
Modernites34.indd 112 19/09/12 11:19
Une question de vie ou de mort? Des usages éthiques de l’émotion dans la fiction 113
l’émotion, l’argumentation portera toujours trop loin. Car – et c’est le
deuxième danger – elle transforme tout engagement en un dilemme « la
révolution ou ma mère », au risque de rendre illégitime ou impossible
tout engagement, de paralyser l’action en la rendant responsable de
ses effets collatéraux, du mal indirectement causé aux proches, des
dangers, des souffrances ou de la mort à laquelle chacun expose les
siens par son engagement.
Le roman ne néglige pas ce risque. Non seulement il l’aperçoit,
mais il prend la peine de le souligner pour nous : « Combeferre, qui
parlait ainsi, n’était pas orphelin. Il se souvenait des mères des autres,
et il oubliait la sienne. Il allait se faire tuer. Il était “égoïste23”. » Le
mot égoïste est entre guillemets. Ces guillemets, l’excès d’émotion du
discours de Combeferre, ou le surplus comptable du résultat obtenu
(cinq hommes au lieu de quatre), sont autant d’indices qui vont dans
le même sens : ils visent à désigner au regard du lecteur la boîte de
Pandore ouverte par Combeferre, cette zone de risque dans laquelle
le pari sur l’émotion nous entraîne, risque d’argumenter au-delà de sa
cible, et de dissoudre toute possibilité même d’engagement, toute idée
de générosité, de dévouement, de sacrifice héroïque. L’hyper-pathos
est aussi là pour avertir le lecteur du risque moral et politique que
comporte tout recours à l’émotion. Mais le même roman en fournit
aussi l’antidote, en mettant, un peu plus loin, dans la bouche du vieux
Gillenormand récupérant le corps qu’il croît inanimé de Marius
blessé, les mêmes arguments gauchis par un excès nécessairement
perçu comme ironique par le lecteur :
Un gredin qui, au lieu de s’amuser et de jouir de la vie, est allé se battre et
s’et fait mitrailler comme une brute ! Et pour qui ? Pourquoi ? Pour la répu-
blique ! […] C’est bien la peine d’avoir vingt ans. La république, belle fichue
sottise ! Pauvres mères, faites donc de jolis garçons ! […] À vingt ans ! Et
sans retourner la tête pour regarder s’il ne laissait rien derrière lui ! Voilà
maintenant les pauvres vieux bonshommes qui sont obligés de mourir tout
seuls. Crève dans ton coin, hibou ! Eh bien, au fait, tant mieux, c’est ce que
j’espérais, ça va me tuer net. […] Oui, ce temps-ci est infâme, infâme, infâme,
et voilà ce que je pense de vous, de vos idées, de vos systèmes, de vos maîtres,
de vos oracles, de vos docteurs, de vos garnements d’écrivains, de vos gueux
de philosophes, et de toutes les révolutions qui effarouchent depuis soixante
ans les nuées de corbeaux des Tuileries ! Et puisque tu as été sans pitié en te
faisant tuer comme cela, je n’aurai même pas de chagrin de ta mort, entends-
tu, assassin 24 !
23 Ibid. p. 937.
24 Ibid., V, iii, 12 (« La boue, mais l’âme »), p. 1038.
Modernites34.indd 113 19/09/12 11:19
114 Frédérique Leichter-Flack
En attendant, l’argumentaire de Combeferre a marché, au-delà
de toute espérance : car avant même que les cinq hommes n’aient été
désignés, puis exfiltrés, quelque chose a été sauvé, quelque chose de
plus précieux encore que la vie-pour-autrui de ces cinq-là : la vie, la
vie tout court, le « souvenir d’une mer heureuse, d’une colline jamais
oubliée, le sourire d’un cher visage » dont parle Camus, l’émotion de
respect pour la vie elle-même, qui s’est réinvitée dans le jeu politique,
en une sorte de dé-fascination pour la mort, de neutralisation du
fanatisme suicidaire. Ce que les insurgés de la barricade avaient perdu
de vue, ce qu’ils avaient oublié mais qui garantit pourtant le sens de
leur combat, se rappelle à eux dans cette émotion artificiellement
suscitée, dans cet hyper-pathos où la fiction prend aussi le risque de
se discréditer.
*
L’usage de l’émotion proposé dans cet épisode romanesque est
exemplaire : l’émotion a une fonction éthique, comme déclencheur de
prise de conscience de problèmes inaperçus ; elle porte aussi un risque,
celui d’argumenter trop loin, c’est-à-dire de brouiller la perception
rationnelle des enjeux, en transformant tout en une question de vie
ou de mort. Mais l’usage qu’en fait le roman sait en tirer le meilleur
tout en désignant le risque du pire au regard du lecteur, afin de l’en
rendre conscient avant que l’urgence de la vie ne l’y piège. Car avec
l’émotion, tout est toujours une question de vie ou de mort. Et si –
sur le point d’agir dans le réel – il faut se méfier de cette mauvaise
conseillère, dans la littérature, on peut se permettre d’écouter ce
qu’elle a à nous dire. Cela ne remplace pas une politique, et ne doit pas
y prétendre, sous peine de substituer un fanatisme moral à un autre ;
mais contre tous les dégâts collatéraux des politiques consenties par
adhésion rationnelle et morale à l’universel, l’objection émotionnelle
est cependant, même quand elle fragilise, un progrès moral précieux.
En rendant inconfortable l’action qu’on vient de décider, sans pour
autant la paralyser, le scrupule rend conscient de son inéluctable
imperfection, c’est-à-dire aussi de sa constante perfectibilité.
Frédérique Leichter-Flack
Université Paris Ouest Nanterre
Modernites34.indd 114 19/09/12 11:19
Une question de vie ou de mort? Des usages éthiques de l’émotion dans la fiction 115
Bibliographie
Camus, Albert, Lettres à un ami allemand [1943-1944], Paris, Gallimard,
1948 ; repris dans Œuvres complètes, t. II, sous la dir. de Jacqueline Lévi-
Valensi, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2006, p. 1-29.
—, Les Justes [1949], Paris, Gallimard, 1950 ; repris dans Œuvres complètes,
t. III, éd. publiée sous la dir. de Raymond Gay-Crosier, Paris, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 2008, p. 1-52.
Dostoïevski, Fédor, Les Frères Karamazov [1879-1880], trad. du russe par
André Markowicz, Arles, Actes Sud, coll. « Babel », 2002, 2 vol.
Hugo, Victor, Les Misérables [1862], notice et notes de Guy et Annette Rosa,
in Romans II (Œuvres complètes, publiées sous la dir. de Jacques Seebacher
et Guy Rosa), Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1985.
—, Quatrevingt-treize [1874], notices et notes de Jean Gaudon, in Romans
III (Œuvres complètes, op. cit.), Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins »,
1985.
Leichter-Flack, Frédérique, « Une indignation insatiable ? La souffrance
de l’enfant entre droit et littérature », Les Cahiers de la justice, 2011/1,
avril 2011, p. 111-120.
Terestchenko, Michel, Du bon usage de la torture ou Comment les
démocraties justifient l’injustifiable, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers
libres », 2008.
Modernites34.indd 115 19/09/12 11:19
Modernites34.indd 116 19/09/12 11:19
II
Perspectives génériques :
empathie, affections, dynamique
Modernites34.indd 117 19/09/12 11:19
Modernites34.indd 118 19/09/12 11:19
L’empathie, l’expression, et l’expressivité
dans la poésie lyrique
Dans la vie de tous les jours, quand j’exprime ma douleur ou ma
colère, cela veut dire que je ressens de la douleur ou de la colère et que
je révèle cet état mental réel aux autres. Je fonds en larmes et mes mains
se crispent ; je dis : « Je suis accablée de douleur » ou : « Je suis folle de
rage. » L’expression artistique des émotions fonctionne au fond de la
même manière : les poètes romantiques avouent qu’ils expriment leurs
propres émotions dans et par leurs poèmes lyriques, et cela signifie
qu’ils ressentent vraiment ces émotions et les révèlent dans leurs poèmes.
Quelquefois, bien sûr, les émotions exprimées dans un poème lyrique
ne sont pas celles du poète lui-même, mais celles d’un personnage qu’il
crée, le « je » du poème ; mais souvent, et plus particulièrement chez les
poètes romantiques, les sentiments exprimés sont tout à fait sincères : ils
sont les sentiments, les émotions du poète lui-même1.
L’expression poétique d’une émotion peut être plus ou moins
expressive. Les poètes romantiques lyriques essayent d’exprimer leurs
émotions de la façon la plus expressive possible. Mais l’expression
n’est pas la même chose que l’expressivité. Je veux démontrer dans
1 Dans un passage bien connu de la Préface aux Lyrical Ballads (1800), Wordsworth écrivait : « I
have said that Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings : it takes its origin from
emotion recollected in tranquility » (William Wordsworth, The Poetical Works of William
Wordsworth, t. II, éd. Ernest de Sélincourt et Helen Darbishire, 2e éd., Oxford, Clarendon
Press, 1944, p. 400-401). « J’ai dit que la poésie est le débordement spontané de sentiments
puissants : elle trouve son origine dans une émotion remémorée dans la tranquilité » (trad.
Florence Gaillet de Chezelles, Wordsworth et la marche : parcours poétique et esthétique,
Grenoble, ELLUG, 2007, p. 198).
Modernites34.indd 119 19/09/12 11:19
120 Jenefer Robinson
cette contribution que le meilleur indice qu’une expression poétique
est véritablement expressive est qu’elle invite le lecteur/la lectrice à
ressentir de l’empathie pour le personnage qui parle dans le poème
lyrique, que ce soit le poète lui-même ou le personnage fictif qu’il a
inventé. Quand une expression poétique est vraiment expressive, les
lecteurs sont invités à ressentir de l’empathie pour celui qui semble
parler dans le poème, le « je » du poème lyrique.
Si le poème lyrique est un bon poème, il invite la lectrice non
seulement à partager les émotions exprimées à travers le poème, mais
aussi à réfléchir aux émotions qu’il évoque. Et ce n’est que lorsqu’on
y réfléchit après avoir lu le poème dans son entier, que l’on peut juger
si les émotions suscitées par le poème sont sentimentales, ou exagérées,
ou non crédibles. Il peut donc arriver qu’après avoir lu entièrement le
poème, le lecteur/la lectrice ne ressent plus les mêmes émotions que le
poète (ou le personnage qui parle pour lui). Mais même si on finit par
condamner le poème, avant de porter un pareil jugement, il faut d’abord
ressentir ou essayer de ressentir de l’empathie pour le personnage du
poème. Il y a un certain « effet que cela fait » de ressentir une émotion.
Les poèmes réellement expressifs permettent de susciter cet effet.
1. L’expression
Qu’es-ce que c’est qu’une émotion ? Quand j’éprouve l’émotion de
la douleur, premièrement, je juge que j’ai perdu quelque chose de très
important dans ma vie : ma mère est morte, j’ai perdu mon emploi, j’ai
perdu ma liberté parce qu’on m’a jeté en prison. Deuxièmement, ce
jugement mène à une suite de changements physiologiques et corporels :
dans le système nerveux végétatif, dans le système musculaire (les
expressions émotionnelles du visage, la posture, les mouvements du
corps), dans la voix, etc. Troisièmement, ces changements corporels
préparent aux actions appropriées au jugement. Si je suis souffrante,
ma voix devient plus faible, mon cœur bat plus lentement, mon
visage exprime de la douleur, le maintien de mon corps s’effondre.
En général, on devient las, on dépense moins d’énergie, probablement
pour ménager ses forces parce que sa vie est soudainement devenue
beaucoup plus éprouvante. La plupart de ces changements corporels
sont visibles par les autres, de sorte qu’ils savent maintenant que
Modernites34.indd 120 19/09/12 11:19
L’empathie, l’expression et l’expressivité dans la poésie lyrique 121
l’on a besoin de réconfort. Finalement, nombre de ces changements
corporels peuvent être ressentis. On dit qu’on ressent la douleur2.
D’ordinaire, lorsqu’on exprime de la douleur, cela signifie d’abord
qu’on l’éprouve véritablement – c’est sa propre douleur – et ensuite
qu’on la révèle aux autres d’une certaine façon. Puisqu’une émotion
comprend des éléments divers, il y a diverses manières de l’exprimer.
Quand j’exprime ma douleur, je peux exprimer les jugements qui
font partie de mon émotion, en disant, par exemple : « J’ai perdu
ma mère bien-aimée ; il y a soudain un grand vide dans ma vie. » Je
peux révéler ma douleur par mes expressions faciales, mes pleurs, le
tremblement de mes mains, ou bien par mes actes. Par exemple, je
cesse de travailler ; je me retire du monde. Dans tous les cas, exprimer
mes émotions, c’est les révéler de sorte que les autres puissent les
reconnaître en me regardant ou en m’écoutant. On peut apercevoir
les émotions sur le visage, dans l’inflexion de la voix, et à travers les
sentiments, les désirs, les jugements qu’on avoue.
Anna Christina Ribeiro a fait remarquer que la plupart des poèmes
sont écrits à la première personne, et que c’est l’une des caractéristiques
les plus importantes de la poésie lyrique, qui la distingue d’autres
formes de poésie, telles que l’épopée ou la poésie dramatique3. À vrai
dire, la plupart des poèmes romantiques sont écrits comme si c’était
le poète lui-même qui nous parlait. Le plus souvent, la voix du poème
s’identifie à la voix du poète lui-même. Ainsi, dans « Le Vallon »,
Lamartine déclare :
J’ai trop vu, trop senti, trop aimé dans ma vie,
Je viens chercher vivant le calme du Léthé ;
Beaux lieux, soyez pour moi ces bords ou l’on oublie :
L’oubli seul désormais est ma félicité 4.
Est-ce le poète lui-même qui nous parle dans ces vers ? Il est possible
que ce soit le cas, que le poète exprime ses propres sentiments. Mais,
parfois aussi, le poète crée un personnage qui parle en son nom. Peu
importe ! Nous autres, lecteurs et lectrices, lisons les mots du poème
2 Pour une théorie plus détaillée des émotions, voir mon livre Deeper than Reason : Emotion
and Its Role in Literature, Music, and Art, Oxford, Clarendon Press, 2005, spécialement les
chapitres i-iii.
3 Anna Christina R ibeiro, « Towards a Philosophy of Poetry », Midwest Studies in Philosophy,
vol. 33, no 1, septembre 2009, p. 61-77.
4 Alphonse de L amartine, « Le Vallon », Méditations poétiques [1820], in Œuvres poétiques
complètes, éd. présentée, établie et annotée par Marius-François Guyard, Paris, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 1963, p. 19-20.
Modernites34.indd 121 19/09/12 11:19
122 Jenefer Robinson
comme s’ils sortaient de la bouche du poète. Nous apprécions la poésie
lyrique comme si c’étaient les mots mêmes du poète que nous écoutions.
Le poète qui exprime ses émotions à travers ses vers ne les révèle
pas par des gestes, des actions, des symptômes physiologiques, mais par
les mots de son poème. Ainsi, Lamartine exprime son sentiment – fort
romantique – que « l’âme, en pleine jeunesse, [est] déjà lasse et détachée
de la vie5 ». Entouré du calme de la nature, il soupire après le calme
éternel de la mort. Lamartine aurait pu dire tout simplement : « J’en ai
marre de la vie. » (Ce n’est pas une restitution très exacte !) Mais son
texte est de loin beaucoup plus complexe et beaucoup plus expressif. Il
n’y a peut-être pas de mot pour décrire cette émotion. Mais la description
qu’il en fait semble traduire une tristesse ou une lassitude journalière.
D’abord, il juge que le monde n’a plus d’intérêt pour lui, qu’il a « trop
vu, trop senti, trop aimé » dans sa vie. Pour lui, le monde se présente
comme ennuyeux (et lassant) ; il veut oublier le monde ordinaire (« the
weariness, the fever and the fret », comme l’écrivait un autre poète
romantique6) ; tout ce à quoi il aspire désormais, c’est la solitude et le
repos. C’est son point de vue sur la vie, l’aspect sous lequel les choses
se présentent à lui. Le grand philosophe anglais R. G. Collingwood
fait observer justement à ce sujet que l’expression artistique cherche à
individualiser les émotions, non à les généraliser7. Dire « Je suis triste »
ou « J’en ai marre », c’est généraliser ; c’est catégoriser l’émotion avec un
mot, « tristesse » par exemple. Mais le poème qui exprime une émotion
décrit cette émotion d’une manière très individuelle ; il distingue la
tristesse de Lamartine de toute autre tristesse au monde.
Ce n’est pas seulement le sens des mots qui importe ; c’est
aussi la musique des vers – le son, le rythme et la rime –, qui non
seulement décrit l’état d’âme du poète, mais aussi en quelque sorte
l’illustre, l’exemplifie. La « voix » du poème a une certaine inflexion
émotionnelle. Le rythme des vers reflète les mouvements de l’âme.
Par exemple, quand Lamartine dit : « L’oubli seul désormais est ma
félicité », non seulement la phrase est très belle, mais aussi elle exprime
parfaitement la langueur qu’éprouve le poète.
Bien sûr, l’expression artistique n’est pas exactement la même chose
que l’expression dans la vie quotidienne. Le poète est un « artisan » qui
essaie de s’exprimer dans les vers qu’il a construit avec soin ; il essaie
5 Id., Méditations poétiques, Paris, Classiques Larousse, 1942, note 5, p. 39.
6 John K eats, « Ode to a Nightingale » [1819], in The Poems of John Keats, éd. Jack Stillinger,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1978, p. 369-372.
7 Robin George Collingwood, The Principles of Art, Oxford, Clarendon Press, 1938.
Modernites34.indd 122 19/09/12 11:19
L’empathie, l’expression et l’expressivité dans la poésie lyrique 123
de créer quelque chose de beau et d’émouvant, de sorte que les lecteurs
puissent apprécier ce qu’il exprime. Comme le dit Collingwood, quand
le poète exprime ses émotions, il essaie de découvrir exactement ce qu’il
ressent : exprimer ses émotions, c’est les clarifier pour soi ainsi que pour
tous ceux qui essaient de les comprendre en lisant le poème. L’expression
poétique d’une émotion n’est pas simplement le « symptôme » d’une
émotion. Exprimer ses émotions, c’est les comprendre d’une certaine
façon. Cependant, la structure et la fonction de l’expression poétique
d’une émotion restent au fond semblables à celles de l’expression d’une
émotion dans la vie quotidienne. Dans tous les cas, quand j’exprime
mon émotion, je révèle cette émotion aux autres en dévoilant certaines
de ses composantes : un jugement, une attitude, un point de vue, un ton
de voix, un mouvement du corps qui reflète un mouvement de l’âme, etc.
2. L’expressivité
Quelle est la différence entre l’expression et l’expressivité ?
L’expression, dans un poème, semble avoir son origine dans l’esprit du
poète, ou du moins dans celui du personnage qui nous parle à travers
le poème : celui que j’ai appelé le « je » du poème. Ce personnage
« s’exprime » en révélant dans le poème ses propres sentiments, ses
émotions, ses désirs, ses croyances, etc. L’expression est accomplie par le
poète lui-même ou par le personnage qui parle, pour ainsi dire, pour lui
dans le poème. L’expression, au sens propre du terme, est réalisée par le
poète qui révèle franchement ses émotions, ses désirs ou ses sentiments.
En revanche, l’expressivité est la manière d’exprimer une émotion.
En général, les gestes et les mots les plus expressifs sont ceux qui
réussissent le mieux à communiquer une émotion aux autres. Ce que
je veux soutenir, c’est que les mots et les gestes les plus expressifs sont
ceux qui réussissent à clarifier l’émotion qu’ils expriment – ou qu’ils
semblent exprimer – en communiquant un certain « effet que cela
fait » de ressentir cette émotion.
Il me semble qu’il est très important de noter que les expressions
peuvent être plus ou moins expressives. Dans la vie de tous les jours,
il est nécessaire de reconnaître rapidement ce que veulent dire les
expressions d’autrui. Je dois savoir tout de suite si vous êtes mon
ennemi ou mon ami, si vous êtes offensé par quelque chose que j’ai fait
ou si vous l’avez trouvé plutôt amusant, si ce quelque chose vous a fait
peur ou vous a dégoûté. Il peut être très important pour moi de savoir
tout cela. Mais souvent il importe peu que les expressions soient très
expressives. Votre sourire me signifie que vous ne me menacez pas. Il
Modernites34.indd 123 19/09/12 11:19
124 Jenefer Robinson
n’est pas nécessaire que vous vous agenouilliez devant moi en criant :
« Oh ! mon amie, je t’aimerai toujours ! » D’un autre côté, un geste
peut être très expressif, même s’il n’exprime pas une émotion sincère.
Il peut communiquer l’effet que cela fait de ressentir une certaine
émotion, même si l’on n’éprouve pas cette émotion à ce moment-là.
L’expressivité n’est donc ni nécessaire ni suffisante à l’expression.
Dans la vie quotidienne, on dit des gens que leur comportement est
plus ou moins « expressif ». Il y a quelques années, j’ai vu le grand chef
d’orchestre britannique Adrian Boult diriger à plus de quatre-vingts ans.
Même s’il menait bien le concert, ses gestes n’étaient pas du tout expressifs :
ses mains ne bougeaient guère. En revanche, le grand chef d’orchestre
américain Leonard Bernstein dirigeait lui aussi avec une grande maîtrise,
mais en faisant de grands gestes, comme un oiseau battant des ailes : ses
gestes étaient très expressifs. Il communiquait à son orchestre ainsi qu’aux
auditeurs, à travers les mouvements de son corps, les émotions exprimées
par la musique. Les musiciens de Boult comprenaient sans aucun doute
parfaitement ses gestes, parce qu’ils avaient l’habitude de jouer dans son
orchestre ; mais il était beaucoup plus difficile pour les auditeurs de les
saisir : en général, les gestes du chef d’orchestre indiquent les mouvements
expressifs de la musique. Sans de grands gestes, les auditeurs sont obligés
d’écouter la musique avec beaucoup plus d’attention (ce qui n’est pas une
mauvaise chose en soi !).
J’examine le cas de ces chefs d’orchestre afin d’illustrer le concept
de « gestes » plus ou moins expressifs. En général, les gens s’expriment
dans la vie quotidienne d’une manière plus ou moins expressive. Ce
qui importe pour la vie sociale, c’est qu’ils parviennent d’ordinaire
à communiquer leur état mental. Et, comme je l’ai déjà dit, il n’est
souvent pas nécessaire de s’exprimer d’une manière très expressive.
Néanmoins, les gestes expressifs aident à clarifier de façon significative
l’émotion que l’on exprime.
Il en va de même pour la poésie lyrique. Un poème peut être plus
ou moins expressif. Même s’il n’exprime pas les émotions propres du
poète, il peut être expressif. Mais, à mon avis, les plus grandes œuvres
de la poésie lyrique sont celles qui expriment les émotions mêmes du
poète (ou du personnage qui parle en son nom dans le poème) de la
manière la plus expressive. En outre, ce que je veux souligner ici, c’est
que les poèmes lyriques les plus expressifs réussissent à clarifier les
émotions qu’ils expriment en communiquant un certain « effet que
cela fait » de ressentir les émotions exprimées.
Modernites34.indd 124 19/09/12 11:19
L’empathie, l’expression et l’expressivité dans la poésie lyrique 125
Certains philosophes croient que lorsqu’on dit qu’un poème
« exprime de la tristesse », par exemple, cela veut tout simplement dire
que « le poème est triste ». Mais il y a beaucoup de poèmes tristes sans
être du tout expressifs. J’ai composé un poème de ce genre dans mon
livre Deeper than Reason. Permettez-moi d’en composer un en français :
Mon amant est un voleur :
Il m’a volé mon cœur.
Je suis pleine de douleur.
Je suis toujours en pleurs.
Les mots sont peut-être tristes, mais l’effet du poème est ridicule.
Il nous fait plutôt sourire que pleurer. Écoutons maintenant Alfred
de Musset cherchant – comme moi – à faire revenir un amour perdu :
Voyez ! La lune monte à travers ces ombrages.
Ton regard tremble encor, belle reine des nuits ;
Mais du sombre horizon déjà tu te dégages,
Et tu t’épanouis.
Ainsi de cette terre, humide encor de pluie,
Sortent, sous tes rayons, tous les parfums du jour :
Aussi calme, aussi pur, de mon âme attendrie
Sort mon ancien amour8.
Comme les vers de Lamartine déjà cités, ces lignes sont une
expression des émotions du poète lui-même. Et, tout comme eux, elles
sont très expressives. Pourquoi ?
Musset décrit « ces sapins à la sombre verdure », « cette gorge
profonde aux nonchalants détours », « ces sentiers amoureux » où il
errait autrefois avec son amante : « Lieux charmants, beau désert où
passa ma maîtresse ». Il décrit alors la lune qui monte dans le ciel,
avec calme et majesté, et il compare l’astre qui sort des « ombrages »
et son ancien amour qui, lui aussi, s’élève : l’amour sort des ombrages
de sa mémoire et « s’épanouit ».
Pourquoi cette description est-elle si expressive ? Ribeiro, je l’ai
déjà dit, a écrit que la plupart des véritables poèmes sont écrits à la
première personne. Elle croit que correspondant à cette première
personne, il y a un lecteur ou une lectrice qui s’identifie avec la
personne qui parle ou semble parler dans le poème9. Elle ne veut pas
dire que nous autres lecteurs croyons vraiment être la personne qui
parle, mais que nous croyons que nous pourrions avoir écrit ces mêmes
8 Alfred de Musset, « Souvenir » [février 1841], in id., Poésies complètes, éd. établie et annotée
par Maurice Allem, Paris, « Bibliothèque de la Pléiade », 1957, p. 404-409.
9 A. C. R ibeiro, « Towards a Philosophy of Poetry », art. cité, p. 69-70.
Modernites34.indd 125 19/09/12 11:19
126 Jenefer Robinson
mots (si nous avions un peu plus de talent poétique). Notre expérience
du poème est donc très personnelle.
Je ne suis pas exactement d’accord avec l’idée que le lecteur s’identifie
à celui qui parle dans le poème. En lisant les lignes de Musset, je ne crois
pas que je suis le grand poète romantique. Il me serait impossible de
m’identifier à lui. Nous sommes trop différents l’un de l’autre. Et, pour
la même raison, je ne crois pas que j’aurais pu écrire les vers précités.
Néanmoins, tandis que je lis le poème, j’éprouve de l’empathie pour le
poète (ou pour celui qui parle en son nom). Cela veut dire que j’imagine
« de l’intérieur » les émotions qu’il semble éprouver et qu’il décrit dans
le poème. Comme Peter Goldie l’a souligné, imaginer « de l’intérieur »
les émotions, les pensées, etc., d’une autre personne, c’est précisément
éprouver de l’empathie pour lui10.
Goldie a insisté sur le fait que l’empathie demande une
« caractérisation » de celui envers qui on la ressent. Il faut comprendre,
en quelque sorte, le tempérament, les croyances, la manière de vivre,
etc., de celui pour lequel on ressent de l’empathie. Le même auteur
dit, par exemple, qu’il lui serait très difficile de ressentir de l’empathie
pour Marie Stuart, puisqu’il n’est ni reine, ni femme, ni catholique,
ni dévot, et qu’il ne vit pas au xvie siècle. Mais je ne crois pas qu’il en
faille beaucoup pour éprouver de l’empathie à l’égard de quelqu’un. Je
ne suis pas moi-même une spécialiste de la poésie française, quoiqu’à
une certain période de ma vie, j’ai lu assez souvent de la poésie lyrique
romantique. Je sais que Musset est l’un des plus grands poètes français
romantiques et qu’il avait une liaison avec George Sand, mais je connais
mal sa biographie. Néanmoins, en lisant son poème, et même si je ne suis
ni poète, ni homme, ni née au xixe siècle, je peux m’imaginer être un
poète romantique errant dans la forêt où il marchait autrefois avec sa
bien-aimée, contemplant la lune montante et se souvenant de son amour
perdu. Certes, je ne peux pas m’identifier à lui. Mais en lisant le poème,
j’éprouve de l’empathie pour le « je » du poème. Je peux m’imaginer
être celui qui parle dans le poème. Comment cela se peut-il ?
Un poème doit être récité à voix haute. Ribeiro nous rappelle qu’en
récitant le poème à voix haute, on parle à la première personne ; c’est
moi qui dit :
Aussi calme, aussi pur, de mon âme attendrie
Sort mon ancien amour.
10 Peter G oldie, The Emotions : A Philosophical Perspective, Oxford, Clarendon Press, 2002,
p. 197-198.
Modernites34.indd 126 19/09/12 11:19
L’empathie, l’expression et l’expressivité dans la poésie lyrique 127
Or il y a une technique bien établie pour exciter une émotion, la
méthode Velten. Je répète simplement plusieurs fois de suite : « je suis
triste » « je suis triste » « je suis triste », et, après un certain temps, je
deviens vraiment triste. De la même façon, si je dis à voix haute :
J’ai trop vu, trop senti, trop aimé dans ma vie,
Je viens chercher vivant le calme du Léthé ;
ou
Aussi calme, aussi pur, de mon âme attendrie
Sort mon ancien amour
je commence peut-être à ressentir ces mêmes sentiments.
Musset nous invite à nous imaginer comment ce serait d’être là
dans la forêt, en se souvenant avec tendresse de son ancien amour.
Il nous invite à « simuler » ce que le poète voit, ce qu’il touche, et ce
qu’il ressent. La théorie de la « simulation » a démontré que les mêmes
circuits neuronaux sont actifs lorsque nous voyons un mouvement que
lorsque nous imaginons voir ce même mouvement. Par conséquent,
les mêmes circuits neuronaux sont probablement actifs lorsque que
nous imaginons voir un mouvement et lorsque faisons nous-même
un mouvement semblable. En lisant les vers de Musset, on peut par
conséquent ressentir de façon très intime ce qu’a éprouvé le poète. Et
quand il décrit son amour s’épanouissant comme la lune dans le ciel,
non seulement nous comprenons sur le plan intellectuel ce qu’il veut
dire, mais nous pouvons en quelque sorte ressentir nous-mêmes cet
épanouissement. En somme, Musset nous encourage non seulement à
comprendre son état mental, mais aussi à le partager. Et en éprouvant
cette empathie pour le poète, nous comprenons « l’effet que cela fait »
de ressentir ces mêmes émotions.
Collingwood ne fait pas de distinction entre l’expression et
l’expressivité. Il dit qu’exprimer des émotions, c’est les clarifier, autant
pour le poète que pour les lecteurs. Il dit que les lecteurs d’un poème
doivent recréer dans leur propre expérience les sentiments exprimés
dans le poème. Or, comme je l’ai expliqué plus haut, on peut exprimer
une émotion de façon plus ou moins expressive. Et il y a une grande
différence entre l’expression et l’expressivité. Mais de toute façon, c’est
lorsqu’un poète réussit à écrire un poème qui exprime ses émotions d’une
manière très expressive qu’il réussit à évoquer ces mêmes émotions chez
ses lecteurs et lectrices : on ressent de l’empathie pour le « je » du poème ;
on se met à la place de ce « je ». Cela ne veut pas dire que l’expressivité
n’est rien d’autre que l’évocation des émotions des lecteurs. Loin s’en
faut ! Ce que je veux soutenir dans cet article, c’est que le critère d’une
Modernites34.indd 127 19/09/12 11:19
128 Jenefer Robinson
expression vraiment expressive réside dans le fait qu’elle permet aux
lecteurs de ressentir de l’empathie pour le « je » du poème.
Souvent, après avoir partagé les émotions exprimées par le poème,
on commence à réfléchir aux émotions qu’il a suscitées. En fait, ce n’est
qu’après avoir lu le poème entier et en l’examinant que l’on peut juger si
oui ou non les émotions évoquées sont bien à propos. Peut-être décidera-
t-on que les sentiments romantiques exprimés par Musset sont exagérés
et ridicules, qu’ils ne sont pas crédibles. Il peut aussi arriver qu’après
avoir lu le poème entier, le lecteur ne ressente plus les mêmes émotions
que le poète ou le personnage qui parle pour lui. Peut-être éprouve-t-on
même une réaction émotionnelle négative envers les émotions suscitées
par le poème : par exemple, je peux avoir honte d’avoir été émue par un
poème trop sentimental. Mais avant de porter un tel jugement, il faut
d’abord ressentir ou, à tout le moins, essayer de ressentir de l’empathie
envers le personnage qui s’exprime dans le poème. Afin de juger
correctement les émotions exprimées dans le poème, il faut d’abord
ressentir ces émotions. Et les bons poèmes lyriques permettent aux
lecteurs d’éprouver ces émotions telles qu’elles sont. Il y a un certain
« effet que cela fait » de ressentir une émotion. Les poèmes lyriques les
plus expressifs laissent entrevoir cet effet11.
Jenefer Robinson
University of Cincinnati
Bibliographie
Collingwood, Robin George, The Principles of Art, Oxford, Clarendon
Press, 1938.
Goldie, Peter, The Emotions : A Philosophical Perspective, Oxford,
Clarendon Press, 2002.
K eats, John, The Poems of John Keats, éd. Jack Stillinger, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press, 1978.
L amartine, Alphonse de, Méditations poétiques [1820], Paris, Classiques
Larousse, 1942.
—, Œuvres poétiques complètes, éd. présentée, établie et annotée par
Marius-François Guyard, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade »,
1963.
11 J’ai examiné la distinction entre l’expression et l’expressivité sous un angle plus général dans
le domaine des arts dans mon article « Expression and Expressiveness in Art », Postgraduate
Journal of Aesthetics on-line, vol. 4, no 2, août 2007, publié en ligne : http://www.british-aes-
thetics.org/uploads/Expression%20and%20Expressiveness%20in%20Art.pdf.
Modernites34.indd 128 19/09/12 11:19
L’empathie, l’expression et l’expressivité dans la poésie lyrique 129
Musset, Alfred de, Poésies complètes, éd. établie et annotée par Maurice
Allem, Paris, « Bibliothèque de la Pléiade », 1957.
Ribeiro, Anna Christina, « Towards a Philosophy of Poetry », Midwest
Studies in Philosophy, vol. 33, no 1, septembre 2009, p. 61-77.
Robinson, Jenefer, Deeper than Reason : Emotion and Its Role in Literature,
Music, and Art, Oxford, Clarendon Press, 2005.
—, « Expression and Expressiveness in Art », Postgraduate Journal of
Aesthetics on-line, vol. 4, no 2, août 2007, publié en ligne : http://www.
british-aesthetics.org/uploads/Expression%20and%20Expressiveness%20
in%20Art.pdf.
Wordsworth, William, The Poetical Works of William Wordsworth, t. II, éd.
Ernest de Sélincourt et Helen Darbishire, 2e éd., Oxford, Clarendon Press,
1944.
Modernites34.indd 129 19/09/12 11:19
Modernites34.indd 130 19/09/12 11:19
« Cette émotion appelée poésie » (Pierre Reverdy)1
Reverdy est un des poètes qui a le plus fortement et le plus constamment
lié la poésie à l’émotion, au point de les identifier l’une à l’autre dans le
titre d’un de ses textes théoriques les plus célèbres2, que j’ai choisi de
reprendre à mon compte. Mais en même temps, il s’est toujours attaché à
distinguer soigneusement « cette émotion appelée poésie » de celles que
tout un chacun peut éprouver dans le cours de son existence. La poésie,
à ses yeux, ne saurait se borner à exprimer ces dernières : elle vise à
les transformer en « une émotion neuve et proprement poétique », de
type esthétique et non plus psychologique : « Si l’œuvre produit alors
une émotion, c’est une émotion purement artistique et non pas du même
ordre que celle qui nous agite si un accident violent survient dans la rue
sous nos yeux3. »
L’émotion poétique s’oppose donc à tout pathétique. Pourtant, la
poésie de Reverdy semble bien faire place aux incidents et aux accidents
de la rue ou de la vie, et à l’expression des affects parfois violents qui
1 Ce texte a paru une première fois dans un ouvrage collectif sur L’Émotion poétique, publié par
Ridha Bourkhis aux éditions Sahar (Tunis, 2010).
2 C’est le texte d’une causerie radiophonique, publié d’abord dans le Mercure de France (no 1044,
1er août 1950) et repris en tête d’un des volumes des Œuvres complètes de Reverdy : Cette émo-
tion appelée poésie : écrits sur la poésie, 1932-1960, Paris, Flammarion, 1974 (abrégé ci-après
en CEAP), p. 7-36 ; Œuvres complètes, éd. préparée, présentée et annotée par Étienne-Alain
Hubert, Paris, Flammarion, 2010, 2 vol. (abrégé ci-après en OC I et II), t. II, p. 1282-1294.
3 « Essai d’esthétique littéraire », Nord-Sud, no 4-5, juin-juillet 1917, repris dans Nord-Sud, Self
defence et autres écrits sur l’art et la poésie (1917-1926), Paris, Flammarion, 1975 (abrégé ci-
après en NS), p. 41 et 46 (OC I, p. 475 et 477).
Modernites34.indd 131 19/09/12 11:19
132 Michel collot
s’emparent de nos cœurs et de nos corps. Témoins ces vers qui terminent
un poème des Ardoises du toit :
À cause de la peur on referme la porte
Cette émotion était trop forte
La lueur qui baisse et remonte
On dirait un sein qui bat4
Je m’interrogerai sur cette apparente contradiction entre la
théorie et la pratique de Reverdy, en m’appuyant sur sa conception du
lyrisme, et en proposant une redéfinition de l’émotion poétique, qui
tienne compte à la fois de sa différence et de sa dépendance vis-à-vis
de l’expérience émotionnelle.
3. Une émotion pure
Depuis son premier essai consacré à « L’Émotion », qui remonte
à 1917, jusqu’à la causerie radiophonique qui donne son titre à ma
communication, et qui date de 1950, Reverdy semble avoir eu pour
principal souci de se démarquer à la fois du romantisme qui fait de la
poésie l’expression des sentiments personnels, et du naturalisme qui
tire des effets pathétiques du spectacle de la vie sociale.
Le propre de la modernité littéraire et artistique, dont Reverdy a été
l’un des premiers et des plus brillants théoriciens, est d’accorder moins
d’importance aux sujets qu’aux moyens d’expression. Le but de l’écrivain
et de l’artiste moderne, est à ses yeux, « de créer, par une œuvre esthétique
faite de ses propres moyens, une émotion particulière que les choses de la
nature, à leur place, ne sont pas en mesure de provoquer en l’homme » :
En effet, si les spectacles de la nature étaient capables de vous procurer cette
émotion-là, vous n’iriez pas dans les musées, ni au concert, ni au théâtre, et
vous ne liriez pas de livres. Vous resteriez où et comme vous êtes, dans la vie,
dans la nature. Ce que vous allez chercher au théâtre, au musée, au concert et
dans les livres, c’est une émotion que vous ne pouvez trouver que là – non pas
une de ces émotions sans nombre, agréables ou pénibles, que vous dispense la
vie, mais une émotion que l’art seul peut vous donner5.
Plus que tout autre genre littéraire, la poésie doit « se dégager » des
« sentiments » liés aux événements banals ou extraordinaires, dont
le roman tire ses effets6. Les « sentiments » du poète eux-mêmes ne
sont que des « éléments » parmi d’autres de la création poétique, qui
doivent être soumis à une élaboration artistique qui les met en forme
4 « Sentinelle », in Les Ardoises du toit, 1918 ; repris dans Plupart du temps : poèmes, 1915-1922,
Paris, Gallimard, 1945, reparu dans la collection « Poésie » en 1969, p. 202 (OC I, p. 195).
5 « Cette émotion appelée poésie », art. cité (CEAP, p. 14-15, OC II, p. 1284).
6 Id., « L’Émotion », Nord-Sud, no 8, octobre 1917 (NS, p. 56 ; OC I, p. 484).
Modernites34.indd 132 19/09/12 11:19
«Cette émotion appelée poésie» (Pierre Reverdy) 133
et les transforme profondément. C’est à ce prix que l’on peut créer
l’émotion, au lieu de se borner à l’exprimer :
Il est faux de vouloir que l’émotion d’où l’œuvre est née soit identique à celle
que l’œuvre fera naître à son tour. – L’une est un point de départ l’autre un
résultat. […]
Un artiste emploie, comme élément pur, le résultat d’une émotion née en lui ;
pour tout autre l’art consiste à expliquer une émotion ressentie afin de la faire
partager à autrui.
De là ne peut sortir rien de neuf. C’est une représentation […]. – C’est un
délayage inutile et vain, au lieu d’une création par concentration7.
L’émotion véritablement poétique, au sens étymologique du mot
poiesis, suppose une authentique création, qui l’arrache à la sphère des
affects passivement vécus, celle des Erlebnisse, pour la faire accéder à
l’ordre de l’expression consciente et active, celle l’Erfahrung :
La poésie n’est pas dans l’émotion qui nous étreint dans quelque circonstance
donnée – car elle n’est pas une passion. Elle est même le contraire d’une pas-
sion. Elle est un acte. Elle n’est pas subie, elle est agie. Elle peut être dans
l’expression particulière suscitée par une passion, une fois fixée dans l’œuvre
qu’on appelle un poème et seulement dans l’émotion que cette œuvre pourra,
à son tour, provoquer. […] Elle est un fait nouveau, certainement relié aux
circonstances qui peuvent émouvoir le poète dans la nature, mais ce n’est
que formé par les moyens dont dispose le poète que ce fait, chargé de poésie,
viendra prendre la place qui lui revient dans la réalité 8.
Les émotions éprouvées au cours de la vie ne sont qu’une matière
première, que le poète doit refondre pour produire un effet entièrement
nouveau, « toute émotion, pour être exprimée, doit être transformée9 » :
« Il faut se garder de l’expression directe d’une émotion, d’un sentiment
vécus. Il faut tout encaisser, tout recevoir, bien et mal, bon et mauvais –
mettre à la fonte toute cette ferraille et, le jour où le besoin d’exprimer
le fond est venu, ressortir un métal tout neuf, méconnaissable10 […]. »
Cette transformation du matériau affectif s’apparente à une
transmutation alchimique :
Car le poète est un four à brûler le réel.
De toutes les émotions brutes qu’il reçoit, il sort parfois un léger diamant d’une
eau et d’un éclat incomparables. Voilà toute une vie comprimée dans quelques
7 « Certains avantages d’être seul », Sic, no 32, octobre 1918 (NS, p. 134 ; OC I, p. 542) ; c’est
l’auteur qui souligne.
8 En vrac : notes [1956], Paris, Flammarion, 1989, p. 202 (OC II, p. 981-982).
9 « Pour en finir avec la poésie », Verve, vol. I, no 3, 1er juin 1938 (CEAP, p. 123 ; OC II, p. 1206).
10 En vrac, op. cit., 1989, p. 45 (OC II, p. 847).
Modernites34.indd 133 19/09/12 11:19
134 Michel collot
images et quelques phrases11.
Hostile à toute effusion sentimentale, Reverdy insiste sur le travail
de condensation que suppose l’opération poétique :
Aujourd’hui la puissance lyrique ne saurait se passer de concentration.
Il ne s’agit pas d’exploiter une émotion initiale et de la délayer, mais, au
contraire, de réaliser dans l’œuvre un faisceau d’émotions natives directe-
ment issues du fonds intime du poète et de livrer à l’esprit du lecteur cette
force concentrée capable de provoquer en lui une émotion forte et d’alimenter
une riche efflorescence de sentiments esthétiques12.
Reverdy a une conception essentiellement dynamique et dialectique
de l’émotion, qui est étymologiquement liée au mouvement ; elle donne
au poète « l’élan nécessaire à sa création13 », mais elle doit disparaître
comme telle pour renaître différente dans l’œuvre : « Ce n’est pas au
départ que l’on peut juger la valeur poétique d’une émotion, mais à
l’arrivée – quand elle a abouti à l’œuvre, alors que l’émotion primitive
est, elle-même, annulée14. »
Il s’agit moins en fait d’une disparition que d’une épuration : « plus
[l’]œuvre sera loin de [l’]émotion » initiale, écrit Reverdy, « plus elle
en sera la transformation méconnaissable et plus elle aura atteint le
plan où elle était […] destinée à s’épanouir et vivre, ce plan d’émotion
libérée où se transfigure, s’illumine et s’épure l’opaque et lourde
réalité15 ». Cette catharsis ou cette sublimation de l’émotion se confond
pour Reverdy avec la poésie elle-même, qui a le pouvoir d’inverser le
signe de l’affect qui lui a donné naissance, en tirant une jouissance
esthétique des pires souffrances :
Et ce passage de l’émotion brute, confusément sensible ou morale, au plan
esthétique où, sans rien perdre de sa valeur humaine, s’élevant à l’échelle,
elle s’allège de son poids de terre et de chair, s’épure et se libère de telle sorte
qu’elle devient, de souffrance pesante du cœur, jouissance ineffable d’esprit,
c’est ça la poésie16.
Cette purification, qui nous fait passer des affres du cœur au
plaisir de l’esprit, n’est pas exempte de résonances spiritualistes, mais
elle reste essentiellement, aux yeux de Reverdy, un effet de l’art, d’un
11 Le Gant de crin, Paris, Plon, 1927 ; rééd. Flammarion, 1968 (abrégé ci-après en GC), p. 14
(OC II, p. 541-639, cit. p. 546).
12 Ibid., p. 40 (OC II, p. 560-561).
13 En vrac, op. cit., p. 42 (OC II, p. 845).
14 « Le poète secret et le monde extérieur » , Verve, vol. I, no 4, 15 novembre 1938 (CEAP, p. 133 ;
OC II, p. 1210).
15 En vrac, op. cit., p. 42-43 (OC II, p. 845).
16 « Cette émotion appelée poésie », art. cité (CEAP, p. 36 ; OC II, p. 1294).
Modernites34.indd 134 19/09/12 11:19
«Cette émotion appelée poésie» (Pierre Reverdy) 135
art pur de toute référence et de toute influence, « où la conception
domine l’imitation », et qui, tel le cubisme, « dépouill[e] l’objet de sa
valeur sentimentale » pour produire une « émotion esthétique » « où
le cœur n’a nul besoin d’être engagé17 ».
Émancipé de ses attaches avec l’objet comme avec le sujet, l’émotion
poétique semble le pur produit du seul pouvoir des mots : « le mystère
qui se dégage d’une œuvre dont le lecteur est ému sans s’expliquer
comment elle a été composée est la plus haute émotion qu’on ait jamais
pu atteindre en art18 ». « Ce sont les œuvres d’art pur qui provoquent
l’émotion pure19 », celle qui « n[aît] en dehors de toute imitation, de
toute évocation, de toute comparaison20 », de la seule beauté de leur
forme :
J’entends par lyrisme ce qui en art est propre à provoquer une telle émotion.
Deux mots bien accouplés le font jaillir, une image inouïe. Il réside dans une
phrase belle, que le mystère de sa signification et la qualité des mots qui la
composent suspendent au-dessus du cours normal de nos idées21.
Cette émotion inscrite dans la forme même du message poétique, en
est inséparable, et donc plus durable que tout autre, car elle renaît à
chaque fois qu’un lecteur réénonce les mots du poème :
Non pas cette émotion […] plus ou moins profonde ou à fleur de peau que nous
procure un événement plus ou moins dramatique de la réalité vécue, mais
une émotion d’un autre ordre – gratuite en apparence, mais qui ne doit pas
l’être autant qu’il semble puisqu’elle dure souvent beaucoup plus longtemps
que celles qui se résolvent dans le seul circuit de la sensibilité et parfois aussi
longtemps que celui qui l’a une fois ressentie. Émotion d’ordre esthétique
indéfiniment renouvelable parce qu’elle s’insère dans l’être même de celui qui
la reçoit et lui apporte une augmentation de lui-même. Émotion provoquée
par ce qui est dit, certes, mais surtout par la façon dont c’est dit, le timbre
sur lequel c’est dit 22.
Dans émotion, il y a mot, comme aime à le rappeler Michel Deguy.
Pour un poète, l’émotion est liée à la résonance et à la composition
du poème : « la poésie n’est intelligible à l’esprit et sensible au cœur
que sous la forme d’une certaine combinaison de mots, en quoi elle se
17 « Note éternelle du présent », Minotaure, no 1, 1er juin 1933 ; repris dans Note éternelle du pré-
sent : écrits sur l’art, 1923-1960, Paris, Flammarion, 1973 (abrégé ci-après en NEP), p. 24-25
(OC II, p. 1169).
18 « L’Émotion », art. cité (NS, p. 60 ; OC I, p. 486).
19 GC, p. 28 (OC II, p. 554).
20 Ibid., p. 32 (OC II, p. 556).
21 « Lyrisme », Gazette des sept arts, no 3, 10 février 1923 (NS, p. 184-185 ; OC I, p. 576).
22 « Cette émotion appelée poésie », art. cité (CEAP, p. 30-31 ; OC II, p. 1292).
Modernites34.indd 135 19/09/12 11:19
136 Michel collot
concrète23 ». L’émotion poétique est une émotion écrite, qui s’épanche
en un sang d’encre : « tout ce qui reste du cœur d’un poète, c’est ce que
lui-même en a dit24 ».
Un poème de Sources du vent illustre parfaitement cette conception
de l’émotion détachée de tout ancrage personnel et référentiel, inscrite
dans la texture même du texte, et liée à la seule résonance des mots qui
le composent. Voici le début et la fin de ce poème, intitulé « Note » :
Les douze notes éveillèrent une émotion
en vibrant dans le silence et la nuit
Une autre toute seule dans le carré du ciel se détacha
Les mots rayonnaient sur la table
D’où vient ce sentiment
Quelquefois l’auteur n’en a pas et son œuvre nous emporte
Les mots assemblés formaient un tout
plus vivant qu’un personnage de music-hall
[…]
Et l’auteur avait disparu emportant son secret
Tous les assistants comprenaient ce qu’il avait voulu dire
Une émotion unique les étreignait
Bientôt ils oublièrent l’auteur la table les mots la lumière
Il ne restait plus que l’émotion sublime – dégagée de tout – l’humanité25
On peut voir dans ce poème et dans les thèses de Reverdy sur
l’émotion une des premières et des meilleures expressions d’une
esthétique moderniste, qui promeut l’autonomie radicale d’un art
résolument non mimétique, qui refuse de se réduire à l’expression
d’un sujet et/ou à l’imitation d’un objet26. Si un tel art peut encore
faire place à l’émotion, c’est à condition qu’elle soit liée à la seule forme
de l’œuvre. Et si la poésie peut encore être lyrique, c’est d’un lyrisme
formel, musical ou littéral.
Mais la poétique de Reverdy ne saurait être réduite à un pur et
simple formalisme. Sa pensée est plus complexe, et sa pratique me
semble bien souvent contredire ses affirmations théoriques les plus
tranchées.
4. Un lyrisme paradoxal
23 « Circonstances de la poésie », L’Arche, novembre 1946 (CEAP, p. 43 ; OC II, p. 1233).
24 Ibid. (CEAP, p. 23 ; OC II, p. 1288).
25 « Note », in Sources du vent [1929], repris dans Main d’œuvre : poèmes, 1913-1949, Paris,
Mercure de France, 1949 ; éd. revue, 1989, p. 245-246 (OC II, p. 209).
26 C’est ce que fait, de manière à mes yeux trop peu nuancée, Laurent Jenny dans La Fin de
l’intériorité : théorie de l’expression et invention esthétique dans les avant-gardes françaises
(1885-1935), Paris, PUF, 2002.
Modernites34.indd 136 19/09/12 11:19
«Cette émotion appelée poésie» (Pierre Reverdy) 137
En même temps qu’il semble lier exclusivement l’émotion poétique
à la mise en forme du poème, Reverdy se réclame d’un lyrisme qui fait
aussi une place au sujet et à l’objet de l’écriture.
La poésie n’est pas un simple jeu de l’esprit. Ce n’est pas pour se distraire ou
pour distraire un public quelconque que le poète écrit. Ce qui l’inquiète c’est
son âme et les rapports qui la relient, malgré tous les obstacles, au monde
sensible et extérieur27.
À travers le jeu des mots, c’est un je qui se révèle et s’invente :
« Le poète écrit pour se réaliser, se connaître, se former, se créer et
rendre à soi-même palpable le malaise ou la joie qui bouillonnent au
fond de lui28. » Ce que le poète exprime, ce n’est pas « sa personne
brute et commune », « mais ce qu’il pressent de plus rare, de plus
extraordinaire dans ses facultés, ce secret, cet intime, ce singulier »,
« cet inconnu » qu’il porte en soi, « dont il sent » « obscurément qu’il
est fait » et « dont il ne peut se prouver à lui-même qu’il l’a qu’en
écrivant29 ».
L’émotion poétique, c’est cette « émotion inconnue qui fait trembler
[l]a lèvre » du poète dans « Le cœur tournant », poème liminaire de
Ferraille30, recueil de 1937 dont le titre évoque ce matériau affectif
que la vie nous fournit et que la poésie doit refondre. Pour formuler
cette intime altérité, le poète doit échapper aux expressions toutes
faites qui ne véhiculent que les sentiments les plus communs, et
inventer une parole parlante ; « c’est la façon de dire ces choses qui
les rendra justement inédites31 » et produira une émotion neuve, parce
que « cette façon, ce timbre sont ce qu’il y a de plus révélateur de […]
ce que l’auteur a de plus authentiquement personnel, qu’il ne saurait
donner autrement que par ce qu’il écrit32 ».
La recherche d’une langue et d’une forme nouvelles sont donc
inséparables d’une quête de soi, qu’il ne faut pas confondre avec
l’expression d’un moi. Or cette quête, qui ne saurait se passer des
mots, passe aussi par les choses. « Le poète est un plongeur qui va
chercher dans les plus intimes profondeurs de sa conscience33 » ; et
27 « Poésie », Le Journal littéraire, 7 juin 1924 (NS, p. 204 ; OC I, p. 593).
28 [Le poète écrit pour se réaliser…], Le Journal des poètes, no 10, 30 janvier 1932 (CEAP,
p. 167 ; OC II, p. 1160).
29 « Cette émotion appelée poésie », art. cité (CEAP, p. 29 ; OC II, p. 1291).
30 « Le cœur tournant », in Ferraille [1937], in Main d’œuvre, op. cit., p. 327-328 (OC II, p. 275-
276).
31 « Cette émotion appelée poésie », art. cité (CEAP, p. 29 ; OC II, p. 1291).
32 Ibid. (CEAP, p. 31 ; OC II, p. 1292).
33 « Poésie », art. cité (NS, p. 204-205 ; OC I, p. 593).
Modernites34.indd 137 19/09/12 11:19
138 Michel collot
c’est la rencontre de ces mouvements extérieurs avec ceux de l’âme qui
produira l’é-motion poétique ; « Notre plus grande intimité nous ne
pouvons l’exprimer qu’avec des matériaux qui nous sont extérieurs et
étrangers34. »
Le poète qui est à la recherche de « son âme » ne pourra la
trouver que dans « les rapports qui la relient » « au monde sensible
et extérieur35 ». Il « cherche le trait d’union de son être profond avec
tout ce qui lui est étranger, mais sympathique dans l’univers36 » : « La
poésie est uniquement une opération de l’esprit du poète exprimant
les accords de son être sensible au contact de la réalité37 » ; et
réciproquement « le contact de l’âme avec les choses est poésie38 ».
Le lyrisme, tel que le conçoit Reverdy, « c’est l’étincelle jaillie au
choc d’une sensibilité solide au contact de la réalité39 ». L’émotion
poétique n’est pas un état intérieur, comme l’indique le préfixe ex- qui
marque une sortie de soi ; elle n’existe qu’à condition de s’extérioriser
en s’exprimant dans les mots mais aussi dans les choses. C’est le contact
avec la réalité qui révèle au poète son intime altérité.
5. Le « lyrisme de la réalité »
Le lyrisme reverdien est donc un lyrisme de la réalité. Je rappelle
la définition qu’en donne Reverdy dans Le Gant de crin, et que j’ai
commentée dans La Matière-émotion 40
■ On a voulu tuer le romantisme. Il a la vie dure, il fallait le tuer.
Mais il est revenu sous toutes les autres appellations et dans le naturalisme
primitif même.
Quand on s’est débarrassé du romantisme on est tombé généralement dans
une désolante platitude.
Or, ce qu’il faut faire, qui est très simple mais extrêmement difficile, c’est fixer
le lyrisme de la réalité. Et là devrait se borner tout le rôle de l’art, impuis-
sant à rivaliser avec la réalité mais réellement propre à en fixer le lyrisme,
que les artistes seuls sont aptes à bien dégager. On pourrait tirer de là cette
définition : l’art est l’ensemble des moyens propres à fixer le lyrisme mouvant
34 « La Nature aux abois », Verve, vol. II, no 8, 1er juin 1940 (NEP, p. 32 ; OC II, p. 1214).
35 « Poésie », art. cité (NS, p. 204 ; OC I, p. 593).
36 [Le poète écrit pour se réaliser…], art. cité (CEAP, p. 167 ; OC II, p. 1160).
37 « Circonstances de la poésie », art. cité (CEAP, p. 46 ; OC II, p. 1234).
38 GC, p. 51 (OC II, p. 567).
39 Ibid., p. 35 (OC II, p. 558).
40 Voir Michel Collot, « Le “lyrisme de la réalité” », in La Matière-émotion, Paris, PUF, 1997,
p. 205-215.
Modernites34.indd 138 19/09/12 11:19
«Cette émotion appelée poésie» (Pierre Reverdy) 139
et émouvant de la réalité 41.
Comment comprendre cette alliance paradoxale entre des termes
habituellement considérés plutôt comme incompatibles ? Elle procède
d’un double refus : celui du romantisme, qui réduirait le lyrisme à
la seule expression des sentiments personnels, et enfermerait le poète
dans son monde intérieur ; et celui du naturalisme, qui réduirait la
réalité à une objectivité fallacieuse, source de platitude. Si la réalité
peut être la matière du lyrisme, c’est qu’elle n’existe que par et pour
un sujet, qui lui-même s’élargit à son contact et l’investit dans le
mouvement de l’émotion :
Il est le sujet et l’objet. Il est ce qui est à exprimer. Ce n’est pas l’Océan qu’il
veut exprimer, la grandeur de l’Océan furieux sous le ciel d’orage, mais ce
qu’il est devenu, l’immensité de ce qu’il est lui-même devenu au spectacle de
l’Océan furieux sous l’orage 42.
Reverdy anticipe la définition qu’Emil Staiger donne du lyrisme,
caractérisé, selon lui, par « l’intrication du monde intérieur et du
monde extérieur43 ». L’émotion poétique naît de la rencontre entre
le monde et une conscience capable d’en embrasser la totalité et la
complexité en établissant entre les choses des rapports inédits :
Le vrai poète […] est celui qui a, comme première force, le sens de la réalité
[…]. Or, plus le sens de la réalité s’élargit, se développe et grandit en force,
plus l’intérêt étroit et particulier s’efface devant l’ensemble universel ; ce n’est
plus une chose isolée que l’on perçoit, mais ses rapports avec les autres choses
et ces rapports des choses entre elles et avec nous sont la trame extrêmement
ténue et solide à la fois de l’immense, de la profonde, de la savoureuse réa-
lité 44.
L’instrument privilégié qui permet au poète d’établir ainsi entre
des « réalités plus ou moins éloignées » des « rapports » « lointains et
justes45 », c’est l’image, qui renouvelle à la fois notre vision du monde
et nos sentiments :
Le propre du poète est de penser et de se penser en images […]. Sa faculté
majeure est de discerner, dans les choses, des rapports justes mais non évi-
dents qui, dans un rapprochement violent, seront susceptibles de produire,
par un accord imprévu, une émotion que le spectacle des choses elles-mêmes
serait incapable de nous donner. Et c’est par cette révélation d’un lien secret
41 GC, p. 14-15 (OC II, p. 546).
42 « Notes, 1942-1944 », in Michel Collot et Jean-Claude M athieu (dir.), Reverdy aujourd’hui,
Paris, Presses de l’École normale supérieure, 1991, p. 159 (OC II, p. 1092).
43 Voir Emil Staiger, Les Concepts fondamentaux de la poétique [1946], trad. et annoté par
Raphaël Célis et Michèle Gennart, avec la collab. de René Jongen, Bruxelles, Lebeer-
Hossmann, 1990.
44 GC, p. 52 (OC II, p. 567-568).
45 « L’Image », Nord-Sud, no 13, mars 1918 (NS, p. 73 ; OC I, p. 495).
Modernites34.indd 139 19/09/12 11:19
140 Michel collot
entre les choses, dont nous constatons que nous n’avions jusque-là qu’une
connaissance imparfaite, que l’émotion spécifiquement poétique est obtenue.
[…]
Ce qui, tout en s’opposant diamétralement à la conception de la poésie comme
vague état d’âme sentimental, ne veut toutefois pas dire que les sentiments
n’ont rien à voir avec la poésie, mais bien que le rôle du poète n’est pas du tout
d’exploiter ceux que tout le monde éprouve sur le vif, mais d’en apporter et
d’en susciter de nouveaux – et d’enrichir par là le champ de la sensibilité et
de la conscience humaines, dans un renouvellement constant des aspects de la
réalité46.
Le lyrisme de la réalité n’est ni un réalisme ni un sentimentalisme :
il n’est pas plus la formulation fidèle d’un sentiment personnel qu’une
imitation servile du réel; il ne se borne pas à les exprimer mais vise à
les recréer l’un et l’autre et l’un par l’autre pour produire une émotion
neuve, qui ne relève pas de la mimesis mais de la poiesis. Il nous impose
de revoir nos catégories esthétiques et philosophiques, de remettre en
cause le dualisme qui sépare le sujet et l’objet, le langage et le réel. Il
naît à la rencontre du moi, du monde et des mots, de leur interaction
et de leur transformation réciproque :
Car la poésie n’est pas plus dans les mots que dans le coucher du soleil ou
l’épanouissement splendide de l’aurore – pas plus dans la tristesse que dans
la joie. Elle est dans ce que deviennent les mots atteignant l’âme humaine,
quand ils ont transformé le coucher du soleil ou l’aurore, la tristesse ou la
joie. Elle est dans cette transmutation opérée sur les choses par la vertu des
mots et les réactions qu’ils ont les uns sur les autres dans leurs arrangements
– se répercutant dans l’esprit et sur la sensibilité 47.
On voit donc que tout en affirmant le rôle majeur dévolu au langage
dans la production de l’émotion poétique, Reverdy ne réduit pas celle-
ci à sa seule dimension esthétique, mais la relie à une véritable co-
naissance au monde et de soi-même, pour reprendre l’expression de
Claudel48. L’é-motion ainsi comprise est ce mouvement par lequel le
poète sort des limites de sa personne pour s’agrandir en s’ouvrant
au monde. Le lyrisme, selon Reverdy, « apparaît chaque fois que
l’auteur se fait une révélation au-dessus de lui-même. […] Il est une
aspiration vers l’inconnu, une explosion indispensable de l’être dilaté
par l’émotion vers l’extérieur49 ».
46 « La fonction poétique » [janvier 1948], Mercure de France, no 1040, 1er avril 1950 (CEAP,
p. 56-58 ; OC II, p. 1272-1273) ; c’est l’auteur qui souligne.
47 Ibid. (CEAP, p. 34-35 ; OC II, p. 1294).
48 Voir Paul Claudel, « Traité de la Co-naissance au monde et de soi-même » [1904], in Art
Poétique, éd. présentée et annotée par Gilbert Gadoffre, Paris, Gallimard, 1984, p. 63-134.
49 « Pierre Reverdy m’a dit… », entretien avec Benjamin Péret, Le Journal littéraire, 18 octobre
1924 (NS, p. 231 ; OC I, p. 596).
Modernites34.indd 140 19/09/12 11:19
«Cette émotion appelée poésie» (Pierre Reverdy) 141
L’émotion s’apparente ainsi à une véritable conversion, mais elle ne
passe pas nécessairement par une introversion, mais plutôt par une
extraversion. Un récit de jeunesse intitulé « La Conversion » relate
l’entrée en religion d’un personnage qui ressemble fort à Reverdy lui-
même. La conversion religieuse y est précédée et peut-être préparée
par une autre, toute poétique : la venue à l’écriture apparaît déjà
comme une métamorphose de l’âme, mais ce bouleversement intérieur
s’accompagne d’une ouverture au monde extérieur :
Après il n’y a plus qu’un homme tout seul écrivant contre le verre de la lampe
*
Les sentiments passent sortent et se déforment
Comment peut-on regarder ce qu’on avait senti
Juger ce que l’on a écrit
[…]
Qu’importe qu’on se trompe si ce qui sort est plus nouveau
Et si l’émotion intérieure se transforme
L’atmosphère vibre au-dessus du mur
Les arbres craquent
Le feu se mêle à l’air qui chasse les oiseaux
La terre plie
Ce n’est rien
Mais on se jette à tout le monde
En criant50
L’« émotion intérieure » est devenue une « atmosphère » à la fois
physique et affective, enveloppant le moi, le monde et les mots qui
résonnent et rayonnent dans le blanc de la page comme des cris dans
l’air. On note que ce récit est fait à la troisième personne et que le poète
est désigné par le pronom indéfini on, très fréquent dans les poèmes
de Reverdy.
Il ne faut pas confondre cette impersonnalité délibérée avec une
quelconque froideur ou impassibilité, comme l’on fait souvent les
premiers lecteurs de Reverdy, qui l’ont traité de « poète cubiste », et
comme le font encore certains de ses commentateurs, qui parlent à son
propos d’une « poésie objective ».
Ses premiers poèmes, il est vrai, font une large place aux objets,
mais à travers leur évocation, Reverdy cherche à produire une émotion
d’autant plus efficace qu’elle est tout entière contenue en quelques
mots qui donnent à voir un monde et à entendre une voix.
50 « La Conversion » [1928], in Risques et périls [1930], Paris, Flammarion, 1972, p. 74 (OC I,
p. 749).
Modernites34.indd 141 19/09/12 11:19
142 Michel collot
Pour donner un exemple ce lyrisme paradoxalement objectif, je
commenterai pour conclure un poème extrait des Ardoises du toit, que
je cite dans sa version originale :
Air
Oubli
Porte fermée
Sur la terre inclinée
Un arbre tremble
Et seul
Un oiseau chante
Sur le toit
Il n’y a plus de lumière
Que le soleil
Et les signes que font tes doigts51
Ce poème illustre bien la distance prise par Reverdy vis-à-vis du
lyrisme traditionnel : le pronom je en est absent, il n’y est fait mention
d’aucun événement dramatique ni d’aucun sentiment pathétique ;
il ne fait appel à aucun effet rhétorique. Le début du poème est
particulièrement abrupt ; il fait se succéder et se heurter brutalement
deux substantifs dépourvus de déterminant, isolés chacun sur une
ligne. L’un est abstrait, l’autre concret ; le premier évoque la sphère de
la subjectivité humaine ; le second, le monde des objets. On a affaire
ici à ce rapprochement entre des réalités plus ou moins éloignées qui
caractérise selon Reverdy l’image poétique.
Les premiers syntagmes sont simplement juxtaposés, sans aucun
lien logique ou grammatical explicite. Nous sommes ici en-deçà de
la phrase, comme souvent chez Reverdy. Cette syntaxe nominale
met entre parenthèse le point de vue du locuteur, qui semble viser à
l’objectivité et à la neutralité maximale. C’est le style de l’annotation,
de la « chose vue ». Les choses semblent d’ailleurs envahir la scène
du poème. Les verbes qui apparaissent dans les vers suivants ont en
effet pour sujets des objets ou un animal : « un arbre », « un oiseau »,
« le soleil ». Seul le dernier vers évoque un geste et un corps humains.
Mais cette présence reste allusive et indéterminée : on ignore qui fait
« ces signes », et quels en sont le sens et le destinataire.
Il n’en reste pas moins qu’à la relecture, ces énoncés qui pouvaient
sembler parfaitement objectifs se révèlent encadrés par l’évocation
51 « Air », Les Ardoises du toit [1918], fac-similé in OC I, annexes.
Modernites34.indd 142 19/09/12 11:19
«Cette émotion appelée poésie» (Pierre Reverdy) 143
d’une relation humaine et affective, et régis par une énonciation
de type lyrique : même si le sujet de l’énonciation n’apparaît jamais
explicitement sous la forme d’un pronom de la première personne,
sa présence est impliquée par l’allocution et par les tournures à
valeur déictique qui abondent dans ce poème. L’emploi du présent et
d’articles définis réfère cette scène à l’ici-maintenant du locuteur et
suggère qu’elle fait partie de son univers familier.
Dès lors, le lecteur ne peut s’empêcher de réinterpréter le poème, et de
tisser entre les notations isolées des rapports, logiques ou analogiques,
métaphoriques ou métonymiques. C’est ainsi que la « porte fermée »
apparaît désormais comme une métaphore de l’« oubli », à moins
que sa fermeture n’en soit la cause ou la conséquence. La syntaxe
nominale, qui ne fait pas la distinction entre sujet et prédicat, se prête
à exprimer une relation antéprédicative au monde, où le sujet ne se
distingue pas de l’objet. Si l’on est sensible à cette intrication lyrique
de l’objectif et du subjectif, la métaphore d’usage qui fait « trembler »
l’arbre retrouve sa résonance affective. On s’aperçoit que l’adjectif
« seul » est lui-même isolé, typographiquement et syntaxiquement ;
il n’est pas sûr qu’il s’applique exclusivement à l’oiseau : il pourrait
également renvoyer à la solitude du poète qui, lui aussi, « chante » dans
le vide. Cette solitude est confirmée par la disparition de la lumière ;
aux ultimes éclats du soleil qui décline « sur le toit » correspondent les
« signes » qu’un « toi » fait avec ses « doigts », et qui désignent peut-
être aussi les derniers mots du poème lui-même.
Les rapports à distance qui se nouent entre signifiés et signifiants,
et qui donnent à entendre cet « air ou chant sous le texte » dont
parlait Mallarmé52 et qu’évoque sans doute aussi le titre du poème.
Ce sont d’abord ces échos qui lui confèrent une dimension lyrique,
toute musicale, liée à la résonance des mots. Mais l’émotion qui s’en
dégage tient aussi à l’évocation d’un univers-solitude. Le lecteur est
tenté de reconstituer un petit récit, relatant une séparation, provisoire
ou définitive, que traduisent, à divers niveaux, les multiples ruptures
syntaxiques, sémantiques et typographiques.
Parmi plusieurs scenarios possibles, on pourrait retenir celui-ci : le
poète vient de quitter son allocutaire, et recherche ou redoute l’oubli
qui va se refermer, comme la porte, sur ce qui les a unis. Il se retrouve
seul, et tremblant, dans un monde désormais désert : pour lui comme
52 Stéphane M allarmé, « Le Mystère dans les Lettres » [1896], in Œuvres complètes, t. II, éd.
présentée, établie et annotée par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade », 2003, p. 234.
Modernites34.indd 143 19/09/12 11:19
144 Michel collot
pour le soleil, il est temps de partir ; il se console en proférant un chant
ou en écoutant celui de l’oiseau, et en se retournant une dernière fois
pour voir les signes que lui fait l’autre, en guise d’au revoir ou d’adieu,
ou en traçant lui-même avec ses doigts, dans l’air ou sur la page, un
ultime message.
Mais c’est précisément ce que le poème ne veut pas dire, et le poète
non plus. L’absence de liens syntaxiques, logiques ou chronologiques
explicites laisse le lecteur libre de combiner les fragments de ce récit
éclaté en fonction de sa propre sensibilité. Et l’émotion peut ainsi
déborder la scène sentimentale et la sphère privée pour s’étendre au
monde entier : c’est l’arbre qui tremble, le soleil qui s’en va, et l’oiseau
qui chante. Cette extension de l’émotion à l’univers caractérise le
lyrisme de la réalité :
Il ne s’agit plus, c’est aujourd’hui un fait acquis, d’émouvoir par l’exposé plus
ou moins pathétique d’un fait divers, mais aussi largement, aussi purement
que le peuvent faire, le soir, un ciel chargé d’étoiles – la mer douce, grandiose
et tragique – ou un grand drame muet joué par les nuages sous le soleil53.
Ce dépassement de l’anecdote donne à l’émotion une résonance
cosmique et proprement poétique. Pour l’atteindre, il faut
paradoxalement couper court aux épanchements du lyrisme
romantique ; Reverdy refuse le « ronflement sonore, les effets de
voix » ; il dit moins, pour suggérer davantage :
Enfin, je ne crois pas qu’on puisse raisonnablement se proposer d’emporter
l’âme d’un lecteur, d’un auditeur, dans un grand courant d’air, mais plutôt
qu’il s’agit de la toucher au point le plus sensible d’un coup sec qui saura
l’émouvoir. Le choc n’a l’air de rien, mais l’émotion s’étend ensuite, augmente,
s’irradie, ou conquiert la sensibilité entière, brusquement54.
C’est en faisant une large place aux sous-entendus que ce lyrisme
ténu et retenu « va vers l’inconnu, vers la profondeur55 ». C’est en
disant moins qu’il suggère davantage. La sobriété et l’impersonnalité
des premiers poèmes de Reverdy, les silences qui les scandent ne sont
pas des obstacles à l’émotion et à la communication poétiques; ils sont
autant d’invitations faites au lecteur de faire sienne la parole du poète,
et à combler les blancs du poème, pour partager et prolonger l’émotion
qu’il exprime et qu’il suscite. « Cette émotion appelée poésie » réside
donc bien dans les mots du poème et dans la façon dont il s’écrit et se
dit ; mais si elle est exempte de tout pathos et de toute emphase lyrique,
elle n’en est pas moins porteuse d’un lyrisme paradoxal, ce lyrisme de
53 « Pierre Reverdy m’a dit… », art. cité (NS, p. 231 ; OC I, p. 597) ; c’est l’auteur qui souligne.
54 « Lyrisme », art. cité (NS, p. 184 ; OC I, p. 576).
55 « Pierre Reverdy m’a dit… », art. cité (NS, p. 230 ; OC I, p. 596).
Modernites34.indd 144 19/09/12 11:19
«Cette émotion appelée poésie» (Pierre Reverdy) 145
la réalité qui unit dans une relation mouvante et émouvante, le moi, le
monde et les mots.
Michel Collot
Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle
Bibliographie
Claudel, Paul, « Traité de la Co-naissance au monde et de soi-même »
[1904], in Art Poétique, éd. présentée et annotée par Gilbert Gadoffre,
Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1984, p. 63-134.
Collot, Michel, « Le “lyrisme de la réalité” », in La Matière-émotion, Paris,
PUF, coll. « Écriture », 1997.
Jenny, Laurent, La Fin de l’intériorité : théorie de l’expression et invention
esthétique dans les avant-gardes françaises (1885-1935), Paris, PUF, coll.
« Perspectives littéraires », 2002.
M allarmé, Stéphane, « Le Mystère dans les Lettres » [1896], in Œuvres
complètes, t. II, éd. présentée, établie et annotée par Bertrand Marchal,
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2003.
Reverdy, Pierre, Les Ardoises du toit, Paris, Pierre Reverdy, 1918 (fac-
similé in OC I, annexes).
—, Le Gant de crin, Paris, Plon, coll. « Le Roseau d’or », 1927 ; rééd.
Flammarion, 1968. Abrégé en GC (OC II, p. 541-639).
—, Risques et périls, Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, 1930 ;
rééd. Flammarion, 1972.
—, « Notes, 1942-1944 », transcrites et présentées par François Chapon
et Étienne-Alain Hubert, in Michel Collot et Jean-Claude M athieu (dir.),
Reverdy aujourd’hui, Actes du colloque Rencontres sur la poésie moderne
(22, 23, 24 juin 1989), Paris, Presses de l’École normale supérieure, 1991,
p. 151-184 (OC II, p. 1085-1124).
—, Plupart du temps : poèmes, 1915-1922, Paris, Gallimard, 1945 ; rééd.
coll. « Poésie », 1969. « Sentinelle » [Les Ardoises du toit, 1918], p. 202 (OC
I, p. 195).
—, Main d’œuvre : poèmes, 1913-1949, Paris, Mercure de France, 1949 ; éd.
revue, 1989 : « Note » [Sources du vent, 1929], p. 245-246 (OC II, p. 209) ;
« Le cœur tournant » [Ferraille, 1937], p. 327-328 (OC II, p. 275-276).
—, En vrac : notes, Monaco, Éd. du Rocher, 1956 ; rééd. Paris, Flammarion,
1989 (OC II, p. 815-1034).
—, Note éternelle du présent : écrits sur l’art, 1923-1960, Paris, Flammarion,
1973. Abrégé en NEP : « Note éternelle du présent » [1933], p. 7-35 (OC II,
p. 1162-1170) ; « La Nature aux abois » [1940], p. 31-35, (OC II, p. 1214-
1216).
Modernites34.indd 145 19/09/12 11:19
146 Michel collot
—, Cette émotion appelée poésie : écrits sur la poésie, 1932-1960, Paris,
Flammarion, 1974. Abrégé en CEAP : « Cette émotion appelée poésie »
[1950], p. 7-36 (OC II, p. 1282-1294) ; « Circonstances de la poésie » [1946],
p. 37-52 (OC II, p. 1231-1237) ; « La fonction poétique » [1948/1950], p. 53-
74 (OC II, p. 1272-1281) ; « Pour en finir avec la poésie » [1938], p. 119-126
(OC II, p. 1205-1207) ; « Le poète secret et le monde extérieur » [1938],
p. 127-135 (OC II, p. 1208-1211) ; [Le poète écrit pour se réaliser…] (1932),
p. 165-167 (OC II, p. 1160).
—, Nord-Sud, Self defence et autres écrits sur l’art et la poésie (1917-1926),
Paris, Flammarion, 1975. Abrégé en NS : « Essai d’esthétique littéraire »
[1917], p. 39-47 (OC I, p. 474-478) ; « L’Émotion » [1917], p. 52-60 (OC I,
p. 482-490) ; « L’Image » [1918], p. 73-75 (OC I, p. 495-496) ; « Certains
avantages d’être seul » [1918], p. 130-135 (OC I, p. 540-542) ; « Lyrisme »
[1923], p. 183-185 (OC I, p. 576-577) ; « Poésie » [1924], p. 204-207 (OC I,
p. 593-594) ; « Pierre Reverdy m’a dit… », entretien avec Benjamin Péret
[1924], p. 227-233 (OC I, p. 595-597).
—, Œuvres complètes, éd. préparée, présentée et annotée par Étienne-Alain
Hubert, Paris, Flammarion, coll. « Mille & une pages », 2010, 2 vol. Abrégé
en OC I et II.
Staiger, Emil, Les Concepts fondamentaux de la poétique [1946], trad. et
annoté par Raphaël Célis et Michèle Gennart, avec la collab. de René Jongen,
Bruxelles, Lebeer-Hossmann, 1990.
Modernites34.indd 146 19/09/12 11:19
Voix et émotions dans Daniel Deronda de George Eliot
There is a great deal of unmapped country
within us which would have to be taken
into account in an explanation of our gusts
and storms1.
Daniel Deronda, liv. III, chap. xxiv.
Traiter du pouvoir des émotions dans Daniel Deronda (1876)
reviendrait à étudier le roman tout entier, sous toutes ses facettes,
tant il est vrai qu’il est fondé sur l’analyse de ce qu’elles apportent
à l’être humain, comment elles le façonnent et le conduisent, étant
au centre même de l’être. George Eliot avait travaillé cette question
à partir de textes scientifiques, elle s’intéressait aux théories de son
temps sur le sujet ; il est en permanence question des émotions dans ce
roman, comme il y est question d’affects, de sentiments, de passions
– et même de ce que nous appelons aujourd’hui l’« inconscient ».
L’originalité de l’auteur est de croiser les émotions avec l’écriture d’un
vrai roman musical. George Eliot, on le sait, aimait la musique, ses
lettres le disent sans cesse, elle était une musicienne douée, elle jouait
du piano, elle chantait en duo avec G. H. Lewes, son compagnon, et
donnait des soirées musicales, elle allait aussi fréquemment au concert
1 « Il y a en nous de vastes territoires non cartographiés dont il faudrait tenir compte pour expli-
quer nos bourrasques et nos tempêtes. » George Eliot, Daniel Deronda, texte présenté, traduit
et annoté par Alain Jumeau, Paris, Gallimard, coll. « Folio-classique », 2010, t. I, p. 378-379.
Par la suite, nous citerons la traduction d’Alain Jumeau et nous donnerons le texte anglais en
note.
Modernites34.indd 147 19/09/12 11:19
148 élisabeth Rallo Ditche
et à l’opéra, elle appréciait tout particulièrement Haendel, Beethoven,
Mendelssohn, Bellini. Dans Daniel Deronda, elle n’utilise pas la
musique et la voix simplement comme thèmes : tous les personnages
sensibles sont musiciens, tous ont un rapport étroit à la musique et
au chant, et toutes les voix s’entendent sans cesse dans la trame du
récit. Dans les grandes scènes du roman, presque chaque fois qu’un
personnage parle, il est fait allusion à sa voix en tant qu’elle exprime
ses émotions. La voix et la musique jouent un rôle particulier dans
la construction des personnages, dans la signification profonde des
événements romanesques, dans l’écriture même de l’auteur. Celle-
ci a réfléchi sur le rôle de la musique et des émotions musicales,
elle privilégie l’écoute comme vertu première, parce qu’elle ouvre à
autrui et favorise l’empathie, et elle en tire des effets romanesques
remarquables2. Elle a donné au langage musical, à la voix chantée et
parlée une place à part entière dans le texte et un sens plein pour
exprimer les émotions : c’est ce qu’on voudrait examiner ici.
1. Certains chantent, d’autres pas : les indifférents et les
médiocres
Les personnages principaux – et positifs – dans le roman ont tous
des rapports étroits avec la musique et le chant : leur aptitude au
bonheur dépend de leur sens musical. Daniel Deronda, Gwendolen
Harleth, Mirah Cohen chantent, et tous auraient pu ou ont songé à
faire carrière, mais seule Mirah deviendra chanteuse de récital. La
mère de Daniel est une grande chanteuse lyrique, l’Alcharisi, qui a
eu son heure de gloire et a quitté la scène parce qu’elle a eu peur, à
tort, de perdre sa voix et de n’être plus rien. Les autres personnages
qui sont autour d’eux – et qui les aiment – aiment la musique ; un des
personnages marquants du roman est un grand musicien, Herr Klesmer,
dont le nom renvoie à une tradition musicale des juifs ashkénazes (le
mot klezmer, qui désignait à l’origine les instruments, vient de klei et
zemer, « instrument de chant »). Un personnage échappe à l’univers
musical : Grandcourt, que Gwendolen épouse pour éviter la ruine et
ses conséquences, et pour sauver sa famille, Grandcourt qui a autant
de sens musical qu’un serpent – et tout son venin.
2 Voir Beryl Gray, George Eliot and Music, Londres, Palgrave Macmillan, 1989 ; Alisa Clapp-
Itnyre, Angelic Airs, Subversive Songs : Music as Social Discourse in the Victorian Novel,
Athens, Ohio University Press, 2002 ; Phyllis Welliver, Women Musicians in Victorian
Fiction, 1860-1900 : Representations of Music, Science and Gender in the Leisured Home,
Aldershot, Ashgate, 2000.
Modernites34.indd 148 19/09/12 11:19
Voix et émotions dans Daniel Deronda de George Eliot 149
Il est le portrait du tyran domestique, et Hans Meyrick, l’ami de
Daniel Deronda, l’appelle le duc Alphonso : George Eliot s’est sans
doute inspirée d’un poème d’Elizabeth Browning, My Last Duchess,
qui traite du duc de Ferrare, Alfonso II, dont la femme mourut dans
des circonstances mystérieuses, mais aussi de l’opéra de Donizetti
Lucrezia Borgia, qui a été créé en 1833 – Hans Meyrick remarque
que Grandcourt n’a pas la voix de baryton pour chanter le rôle. Le
personnage est essentiel pour comprendre ce qu’est une âme « non
musicale », Stendhal aurait dit : « une âme basse ». Grandcourt a les
traits du tyran de mélodrame, il est si parfaitement ignoble qu’il n’a
aucune chance de plaire au lecteur, car il n’a aucune excuse, aucune
fêlure qui pourrait le rendre au moins pitoyable. Lush, son « homme
à tout faire », le décrit comme ayant un « caractère très spécial3 ». Il a
été épris (en fait, on ne sait rien de cette passion) de sa maîtresse, il a
eu quatre enfants avec elle, mais au moment du récit, il n’éprouve rien
pour eux. Il ne pense qu’aux apparences, il est imprévisible, irrationnel
dans ses désirs, sa volonté s’exerce apparemment sans raison, comme
l’a théorisé Schopenhauer dans Le Monde comme volonté et comme
représentation, que George Eliot connaît bien. Il est dépourvu de
sensibilité, n’éprouve pas d’émotions et ne peut donc en aucune façon
aimer la musique… à moins que le fait de ne pas aimer la musique soit
le signe de son insensibilité. Il n’aime pas entendre chanter, surtout
les femmes, il associe le chant en privé à des « braillements4 ». Au-delà
même de la caricature de l’aristocratie anglaise de son temps, Eliot peint
une âme condamnée, une âme insensible à l’art. Cette condamnation
établit un lien entre la sensibilité et le sens des valeurs, la sphère
morale : Grandcourt est incapable d’assumer son rôle d’aristocrate, de
père, il n’a aucun sens moral, sa « virilité » est illusoire car l’absence
de sensibilité chez lui ne veut en aucun cas dire qu’il est responsable
et actif. Il est au contraire assez veule et velléitaire, toutes ses charges
l’ennuient, tout engagement lui pèse. Pour parfaire ce portrait, il
faut parler de sa voix. Dans un roman où la voix parlée comme la
voix chantée des personnages sont sans cesse évoquées, la rareté des
notations sur la voix de Grandcourt est bien entendu remarquable.
Son intonation, en revanche, est nettement soulignée : il marque des
pauses entre les réponses qu’il fait, comme pour se laisser le temps
3 Daniel Deronda, t. I, p. 382. Liv. III, chap. xxv : « He’s a peculiar character, is Henleigh
Grandcourt, and it has been growing on him of late years. »
4 Ibid., t. II, p. 247. Liv. VI, chap. xlviii : « Then he said, languidly, “I don’t see why a lady
should sing. Amateurs make fools of themselves. A lady can’t risk herself in that way in
company. And one doesn’t want to hear squalling in private.” »
Modernites34.indd 149 19/09/12 11:19
150 élisabeth Rallo Ditche
de réfléchir, ou bien parce qu’une certaine lenteur fait partie de
son être même : « c’était un magnifique lézard d’une espèce jusque-
là inconnue, pas du genre vif, à se précipiter comme une flèche5 ».
On sait qu’il a une voix traînante, un ton « languissant », celui-là
même du gentleman anglais qui s’ennuie et qui est revenu de tout,
comme il le laisse entendre à Gwendolen quand il fait sa connaissance.
Lorsqu’il terrorise sa femme, froidement, il semble à Gwendolen que
sa voix est proprement « diabolique6 ». Ce cynique est véritablement
antihéroïque, et c’est son absence de sens musical, sa voix perfide,
sans charme et sans « couleur », qui en est la preuve la plus évidente.
Gwendolen, elle, est bel et bien musicienne, mais elle n’est pas
totalement musicienne, comme on va le voir. La jeune femme est le
personnage le plus complexe du roman, ses rapports avec la musique sont
une sorte d’image de la mauvaise façon de considérer l’art. Gwendolen
chante et sa voix, « une voix de soprano d’une puissance modérée », est
acceptable, au moins dans les salons, elle a « de l’oreille », « si bien que
son chant donnait du plaisir à des auditeurs ordinaires7 ». Mais pour
le grand musicien Klesmer, elle n’est qu’un médiocre amateur. Elle a
essayé en vain de le charmer par son chant. Il ne mâche pas ses mots
pour condamner la musique qu’on pratique dans les salons victoriens :
« vous savez mal produire vos notes ; et la musique que vous chantez
est indigne de vous. C’est une forme de mélodie qui exprime un stade
enfantin de la culture – un truc chaloupé, factice, flottant – les passions
et les pensées d’un peuple dont l’horizon manque d’ampleur. Il y a
une sorte de sottise contente d’elle-même dans toutes les phrases d’une
telle mélodie : aucun cri de passion mystérieuse, profonde… aucun
conflit… aucun sentiment de l’universel. Les hommes se rabaissent en
l’entendant8 ». Les jeunes filles chantent pour séduire et plaire, être
admirées, non parce qu’elles sentent combien la musique exprime les
5 Ibid., t. I, p. 197. Liv. II, chap. XIII : « Grandcourt after all was formidable – a handsome
lizard of a hitherto unknown species, not of the lively, darting kind. »
6 Ibid., t. II, p. 254. Liv. VI, chap. xlviii : « “And to ask her about her relations with Deronda ?”
said Grandcourt, with the coldest possible sneer in his low voice, which in poor Gwendolen’s ear
was diabolical. »
7 Ibid., t. I, p. 82-83. Liv. I, chap. v : « Her voice was a moderately powerful soprano (some one
had told her it was like Jenny Lind’s), her ear good, and she was able to keep in tune, so that
her singing gave pleasure to ordinary hearers ».
8 Ibid., t. I, p. 84. Ibid. : « “Still, you are not quite without gifts. You sing in tune, and you have
a pretty fair organ. But you produce your notes badly ; and that music which you sing is beneath
you. It is a form of melody which expresses a puerile state of culture – a dawdling, canting, see-
saw kind of stuff – the passion and thought of people without any breadth of horizon. There
is a sort of self-satisfied folly about every phrase of such melody ; no cries of deep, mysterious
passion – no conflict – no sense of the universal. It makes men small as they listen to it.” »
Modernites34.indd 150 19/09/12 11:19
Voix et émotions dans Daniel Deronda de George Eliot 151
émotions et les passions. Elles sont en fait de médiocres musiciennes,
ce qui s’accompagne d’une médiocrité d’âme, de superficialité, de
mondanité. Gwendolen n’échappe pas à ces critiques.
Lorsqu’elle cherche un emploi pour gagner sa vie et celle des siens,
elle pense à devenir chanteuse lyrique et tout naturellement s’adresse au
« maître » Klesmer pour avoir son avis. Un maître exceptionnel, dont
on ne peut traiter ici en détail, mais qui représente dans le roman le
musicien accompli. Klesmer est un véritable artiste, il connaît le métier
et le milieu des chanteurs lyriques de son temps, il a jugé Gwendolen
et la décourage d’embrasser cette carrière. Elle voudrait atteindre la
célébrité et, même si elle sait qu’il faudra faire des sacrifices, elle n’a
en fait aucune idée de la condition qui est faite aux chanteuses et aux
actrices, ni du travail qu’il faut fournir pour se faire une place dans
ce monde. Klesmer l’en dissuade sans ménagements pour son orgueil :
« vous ne parviendrez jamais à mieux que la médiocrité9 ». Mais
Gwendolen est moins condamnée pour sa prétention injustifiée que
pour la manière pragmatique dont elle considère la carrière d’artiste.
Elle pense à l’argent et à la reconnaissance (elle veut atteindre « un
rang aussi élevé que possible10 »), pas à l’art, et c’est ce qui montre une
certaine sécheresse de cœur, son narcissisme, son manque d’élévation
spirituelle. Pour Klesmer, la vie d’un artiste convient aux êtres
d’exception, qui aiment la perfection et sont prêts à tout sacrifier à
elle ; les honneurs viennent après, de surcroît. Et surtout, à cause de
son narcissisme de jeune fille gâtée, Gwendolen n’est pas en mesure
d’éprouver assez d’émotions pour être une vraie musicienne.
Quand Daniel devient le mentor de Gwendolen et qu’il essaie de
la conseiller, il revient au problème de son rapport à la musique. Il
donne son opinion sur le fait de pratiquer la musique en privé : même
sans exceller, cela fait côtoyer l’excellence et montre les « richesses
spirituelles du monde11 ». Si Gwendolen use de la musique de cette
manière, elle aura plus d’émotions positives, elle vibrera pour
le Beau, elle progressera aussi moralement. Elle découvrira de
nouveaux territoires au-delà de son ego, la musique lui permettant
de les parcourir : comme l’écrit Schopenhauer, la musique est le
monde, et Gwendolen comprendra mieux le monde par son expérience
9 Ibid., t. I, p. 356. Liv. III, chap. xxiii : « my judgment is : – you will hardly achieve more than
mediocrity ».
10 Ibid., t. I, p. 347. Ibid. : « Naturally, I should wish to take as high rank as I can. »
11 Ibid., t. II, p. 52. Liv. V, chap. xxxvi : « Excellence encourages one about life generally ; it
shows the spiritual wealth of the world. »
Modernites34.indd 151 19/09/12 11:19
152 élisabeth Rallo Ditche
de la musique. Daniel a déposé une sorte de graine dans le cœur de
Gwendolen, la « bonne graine » qui ne demande qu’à germer ; la fin
« ouverte » du roman laisse à penser qu’elle fleurira.
2. Les personnages musicaux
Daniel Deronda est une « âme de fabrique fine », il est musicien,
profondément et totalement. Jeune homme, « Daniel n’avait pas
seulement une de ces voix de garçon saisissantes qui semblent créer
devant nos yeux un ciel et une terre idylliques, mais aussi un remarquable
don pour la musique et […] il s’était composé des accompagnements
au piano tout en chantant de mémoire12 ». La carrière d’artiste ne
le tente pas, il en rejette même l’idée avec une certaine violence, car
il est « farouchement hostile à l’idée de se déguiser pour chanter
devant toutes ces personnes élégantes qui ne verraient rien d’autre
en lui qu’un jouet merveilleux13 ». Mais il n’oublie pas son amour de
la musique et continue à chanter, d’une voix qui est désormais un
baryton léger, les airs d’opéra qu’il aime, pour lui-même et aussi dans
les réceptions où il est invité. Il dira à Gwendolen se contenter de sa
médiocrité pour ne pas renoncer au plaisir que la musique lui procure
et pour les bienfaits moraux qu’elle dispense : « Je supporte l’idée que
ma propre musique ne vaut pas grand-chose, mais le monde serait plus
triste si je pensais que la musique elle-même ne vaut pas grand chose.
L’excellence vous encourage dans la vie en général ; elle vous montre
les richesses spirituelles du monde14. »
Toute sa vie est traversée par la musique : fils d’une grande
chanteuse (mais il ne le saura que tardivement), il s’éprendra d’une
vraie musicienne, la jeune Mirah, et l’épousera. Comment aurait-il
pu épouser une femme qui n’ait pas un lien avec la musique ? Mais
son attachement à cet art est surtout fondé sur la certitude que la
musique élève spirituellement, qu’elle permet à l’âme d’être plus fine
et plus sensible, qu’elle permet de mieux écouter autrui. Lorsqu’il
cherche le frère que Mirah a perdu, il entre dans une synagogue et est
profondément ému par les chants, il s’abandonne « à cette impression
12 Ibid., t. I, p. 238. Liv. II, chap. xvi : « Daniel had not only one of those thrilling boy voices
which seem to bring an idyllic heaven and earth before our eyes, but a fine musical instinct, and
had early made out accompaniments for himself on the piano, while he sang from memory. »
13 Ibid., t. I, p. 240. Ibid. : « he set himself bitterly against the notion of being dressed up to sing
before all those fine people, who would not care about him except as a wonderful toy ».
14 Ibid., t. II, p. 52. Liv. V, chap. xxxvi : « I can bear to think my own music not good for much,
but the world would be more dismal if I thought music itself not good for much. Excellence
encourages one about life generally ; it shows the spiritual wealth of the world. »
Modernites34.indd 152 19/09/12 11:19
Voix et émotions dans Daniel Deronda de George Eliot 153
très forte que produisent les liturgies chantées, indépendamment du
sens précis des paroles15 ». Il est étonné lui-même par la puissance de
son émotion personnelle : « On aurait pu imaginer qu’il s’agissait de
l’irruption du divin dans l’obscurité, avant qu’il y eût aucune vision à
interpréter16. » C’est bien d’élévation spirituelle qu’il s’agit, d’émotion
puissante qui emporte et donne un sens aux choses et au monde. Toute
sa capacité à entendre se tourne vers autrui : Daniel est à l’écoute des
autres, quels qu’ils soient, et son pouvoir sur les autres vient de cela : il
est l’image même de la compassion. Il a une personnalité accueillante,
prête « à concevoir des territoires dépassant sa propre expérience17 »,
il ne pense pas que Mordecai est fou, il l’écoute. Il est d’une sensibilité
exceptionnelle, il peut « se projeter, par l’imagination, dans ce que les
autres viv[ent]18 », cela lui confère une force particulière, un pouvoir
d’attirer et de guider les autres grâce à la solidarité qu’il leur témoigne.
Le personnage a donné lieu à de nombreuses analyses, et on trouve
sous la plume des critiques les mots d’« androgyne » ou d’« ange »
pour le qualifier. Dans « Daniel Deronda : une conversation », Henry
James, qui aimait beaucoup ce roman et s’en est inspiré pour Portrait
of a Lady, fait dire à un de ses personnages : « He is not a man at
all19. » S’il n’est pas un homme, ce n’est pas faute d’avoir insisté sur
sa virilité : « Plus rien de séraphique : tout est terrestre et viril20 »,
écrit le narrateur. Pourtant, au mieux, on voit en lui « un ange mâle »,
qui associe en lui des attributs féminins et masculins idéaux21. Les
arguments sont précis, l’apparence de Daniel est celle d’un homme,
15 Ibid., t. I, p. 491. Liv. IV, chap. xxxii : « Deronda, having looked enough at the German
translation of the Hebrew in the book before him to know that he was chiefly hearing Psalms
and Old Testament passages or phrases, gave himself up to that strongest effect of chanted
liturgies which is independent of detailed verbal meaning – like the effect of an Allegri’s
Miserere or a Palestrina’s Magnificat. »
16 Ibid., t. II, p. 492. Ibid. : « He wondered at the strenght of his own feeling ; it seemed beyond
the occasion – what one might imagine to be a divine influx in the darkness, before there was
any vision to interpret. »
17 Ibid., t. II, p. 127. Liv. V, chap. xl : « His nature was too large, too ready to conceive regions
beyond his own experience, to rest at once in the easy explanation, “madness”, whenever a
consciousness showed some fullness and conviction where his own was blank. »
18 Ibid., t. II, p. 148. Liv. VI, chap. xli : « And Deronda’s conscience included sensibilities beyond
the common, enlarged by his early habit of thinking himself imaginatively into the experience
of others. »
19 Henry James, « Daniel Deronda : A Conversation » [1876], in Selected Literary Criticism,
Londres, Heinemann, 1963, p. 35.
20 G. Eliot, Daniel Deronda, t. I, p. 261. Liv. II, chap. xvii : « Not seraphic any longer :
thoroughly terrestrial and manly ; but still of a kind to raise belief in a human dignity which
can afford to recognize poor relations. »
21 Voir P. Welliver, Women Musicians in Victorian Fiction…, op. cit., p. 238 sqq.
Modernites34.indd 153 19/09/12 11:19
154 élisabeth Rallo Ditche
calme et fort, mais il a en lui un cœur « féminin », une lumière
intérieure, une compassion toutes féminines. Pourtant, le lecteur n’a
guère l’impression d’entendre ou de voir un personnage « androgyne » ;
sa faculté d’écoute est liée plutôt à son amour de l’humanité, qui peut
aussi être une qualité masculine : on peut même être étonné de lire
le contraire. Il a « cette sensibilité chargée de sympathie, capable
d’une perception très fine, qui allait de pair avec sa tendance à la
réflexion22 », pourquoi en faire une qualité « féminine » ? Il est d’une
« fibre vive et sensible23 », il éprouve une compassion « plus vive que
celle d’une femme » pour la vie de sa mère, il est capable de méditer de
façon passionnée, il vibre d’émotion dans les moments forts de sa vie, il
met au service des autres son extraordinaire faculté d’écoute. George
Eliot construit bel et bien un personnage d’homme sensible, et cette
sensibilité a à voir avec son sens musical plus qu’avec une quelconque
androgynie.
On ne saurait oublier un personnage « musical » essentiel dans le
roman, sorte de figure prophétique et angélique, Mordecai Cohen. Il
vibre sans cesse, comme une harpe, et souvent Daniel est à l’unisson.
La première fois que Daniel le rencontre, il pense à « un prophète de
l’Exil » ou à « un poète de la Renaissance juive à l’époque médiévale24 »,
et le passage mis en exergue du chapitre lxiii le relie expressément à la
figure de Moïse, qui est décrit comme un artiste et un créateur. Il n’est
pas lié directement à la musique, mais les émotions qu’il éprouve et
qu’il suscite chez les autres, et en particulier chez Daniel, sont comme
une symphonie. La métaphore musicale est utilisée par le narrateur
pour insister sur le lien entre les émotions particulièrement vives de
ce personnage qui ne vit que pour son rêve et ce qu’il peut créer en
autrui, en particulier en Daniel Deronda, qui reprendra le flambeau
qu’on lui a tendu.
3. Voix de femmes : la bien-aimée et la mère
22 G. Eliot, Daniel Deronda, t. II, p. 129. Liv. V, chap. xl : « The more exquisite quality of
Deronda’s nature – that keenly perceptive sympathetic emotiveness which ran along with his
speculative tendency – was never more thoroughly tested. »
23 Ibid., t. II, p. 370. Liv. VII, chap. lv : « Of such quick, responsive fibre was Deronda made,
under that mantle of self-controlled reserve into which early experience had thrown so much of
his young strength. »
24 Ibid., t. I, p. 516. Liv. IV, chap. xxxiii : « the thought glance[s] through Deronda that precisely
such a physiognomy as [Mordecai’s] might have possibly been seen in a prophet of the Exile, or
in some New Hebrew poet of the mediæval time ».
Modernites34.indd 154 19/09/12 11:19
Voix et émotions dans Daniel Deronda de George Eliot 155
Daniel ne peut épouser qu’une chanteuse, mais celle-ci est l’opposé
de sa mère, tout en partageant avec elle le privilège d’être une artiste.
Daniel, certes attiré par Gwendolen, préférera Mirah, la jeune
cantatrice juive. Leur rencontre se fait sous le signe de l’opéra, c’est la
voix de Daniel que Mirah entendra d’abord, avant même de le voir. Il
chante un air de l’Otello de Rossini, sur des paroles de Dante – Nessun
maggior dolore/ Che ricordarsi del tempo felice/ Nella miseria25 –,
alors qu’il rame sur la rivière. Il ralentit, et la « chute » pianissimo de
la complainte mélodique est entendue par Mirah. Lorsqu’il la prendra
dans sa barque, elle lui demandera si c’était lui qui chantait, avec une
voix parlée qui rappellera à Daniel la mélodie26.
Par la suite, Daniel découvre le talent de Mirah, sa voix, son sens
musical. Il aime sa voix, qu’il qualifie plusieurs fois d’« exquise », il
explique qu’on pourrait croire son chant entièrement naturel, bien
que Mirah ait beaucoup travaillé dès son enfance : c’est l’apanage du
véritable artiste. La voix de Mirah a une « qualité merveilleuse », le
« chant contenu, où la mélodie semble être simplement le produit de
l’émotion27 ». Une scène romanesque est consacrée à une prestation de
Mirah devant Herr Klesmer. Elle chante l’Ode à l’Italie de Leopardi,
puis de la musique allemande, et Klesmer reconnaît en elle une vraie
musicienne. La voix de Mirah est de celles qui donnent « l’impression
de s’adresser, comme le chant amoureux de l’oiseau, à des oreilles
proches et bien-aimées28 ». Elle a chanté très tôt, elle a essayé, sous
la contrainte de son père, de chanter dans les rôles lyriques, mais sa
voix faiblit et elle est menacée d’être « vendue » au plus offrant pour
subvenir à ses besoins et à ceux de son père. Mirah s’est sauvée et
a renoué avec la religion de sa mère, qui du reste lui chantait des
berceuses et des hymnes, l’initiant ainsi au chant dès son plus jeune
25 « Il n’y a pas de plus grande douleur/ que de se souvenir des temps heureux/ dans la misère »
(Dante, L’Enfer, ch. V, v. 121-123, trad. Jacqueline Risset).
26 Ibid., t. I, p. 267. Liv. II, chap. xvii : « “It was you, singing ?” she went on, hesitatingly –
“Nessun maggior dolore.” The mere words themselves uttered in her sweet undertones seemed
to give the melody to Deronda’s ear. » Voir Laurent Bury, « La cantatrice juive. Variations
victoriennes sur l’aphonie », Sillages critiques, no 7, 2005, publié en ligne (http://sillagescri-
tiques.revues.org/919) : « Peut-être n’est-il pas indifférent que George Eliot ait précisément
choisi, avec Otello, un drame qui se joue autour de la différence raciale. Les vers, tirés de
la Divine Comédie (Inferno, 121-123), furent repris par Berio, librettiste de Rossini, pour le
troisième et dernier acte de l’opéra inspiré par le drame de Shakespeare. Ils sont chantés en
coulisses par un gondolier, sur un rythme de barcarolle, et Desdémone les entend alors qu’elle
craint de ne plus revoir son époux, condamné à l’exil. »
27 G. Eliot, Daniel Deronda, t. II, p. 217. Liv. VI, chap. xlv : « that wonderful, searching quality
of subdued song in which the melody seems simply an effect of the emotion ».
28 Ibid., t. I, p. 498. Liv. IV, chap. xxxii : « It was the sort of voice that gives the impression of
being meant like a bird’s wooing for an audience near and beloved. »
Modernites34.indd 155 19/09/12 11:19
156 élisabeth Rallo Ditche
âge. La voix de la mère de Mirah a une importance certaine ; Mirah se
souvient d’un cantique juif dont les paroles ne sont que des zézaiements,
seule l’intonation reste vivante, la voix de la mère par-delà le temps :
« un petit cantique qui avait des passages étrangement mélancoliques,
et des syllabes qui ressemblaient vraiment au zézaiement d’un enfant
pour ses auditeurs ; mais la voix avec laquelle elle l’interpréta était
chargée d’une tendresse encore plus douce, encore plus envoûtante
que celle que l’on percevait dans ses autres chants29 ». Privées du sens,
seules la voix et l’émotion sont présentes, et agissent sur l’auditeur.
Mirah n’aurait pas pu être chanteuse lyrique : comme Daniel, elle
déteste l’idée de jouer un rôle sur scène. Le poids des conventions
victoriennes pèse aussi sur le personnage : une jeune fille pure ne
saurait faire carrière dans ce milieu d’artistes, on comprend pourquoi
la vocation de chanter en récital et de donner des leçons de chant
correspond mieux au personnage de Mirah. Quoi qu’il en soit, Mirah
suscite des émotions tendres et fortes chez les auditeurs : pour Daniel,
les douces modulations de sa voix sont encore plus émouvantes que
la plus parfaite harmonie de couleurs, il souhaite ne jamais cesser
d’entendre sa voix. Mirah dit d’ailleurs à Deronda qu’elle se souvient
des voix mieux que de tout le reste : « Je pense qu’elles pénètrent
sûrement plus profondément en nous que d’autres choses. J’ai souvent
imaginé que le Ciel était peuplé de voix30 », et Daniel confirme ses
dires en lui rappelant son émotion lorsqu’il a entendu les chants de
la synagogue. Les deux personnages communiquent par la musique
avant même de s’être dit leur amour.
En contrepoint de la femme aimée, Deronda rencontre sa mère, une
mère qui l’a abandonné enfant et qu’il retrouve alors qu’elle est très
malade, car elle veut lui révéler son origine et lui raconter son histoire
avant de mourir. Leonora Charisi, de son nom de scène Alcharisi, dont
on ne saura jamais le timbre, a fait une brillante carrière de chanteuse
lyrique. Mais pour cela, elle a abandonné son mari et donné son fils à
sir Hugo Mallinger pour qu’il l’élève comme un gentleman anglais. Elle
assure l’avoir fait pour Daniel autant que pour elle, pour le libérer de
son origine juive. Elle-même a renié cette origine, elle refuse tout lien
avec le judaïsme et toutes les contraintes qu’il fait peser sur les femmes.
29 Ibid., t. I, p. 500. Ibid. : « she sang a little hymn of quaint melancholy intervals, with syllables
that really seemed childish lisping to her audience ; the voice in which she gave it forth had
gathered even a sweeter, more cooing tenderness than was heard in her other songs ».
30 Ibid., t. I, p. 497. Ibid. : « “Is it not wonderful how I remember the voices better than anything
else ? I think they must go deeper into us than other things. I have often fancied heaven might
be made of voices.” »
Modernites34.indd 156 19/09/12 11:19
Voix et émotions dans Daniel Deronda de George Eliot 157
Son père a essayé de l’asservir, mais elle s’est battue pour être libre :
« Il lui était odieux de penser que les femmes juives étaient perçues
dans le monde chrétien comme une sorte de matériau pour fabriquer
des chanteuses et des actrices. Comme si cela ne nous rendait pas
plus enviables ! C’est une chance d’échapper à la servitude31. » Même
lorsqu’elle retrouve son fils, elle se sent incapable de lui donner quoi
que ce soit, même une once de tendresse, alors que Daniel est plein de
compassion pour elle. Seules sa voix, ses modulations, ses intonations
établiront une sorte de lien entre eux. L’Alcharisi est l’avers d’une
figure de cantatrice dont Mirah est le revers. Elle représente certes une
tentative d’émancipation féminine, mais elle est aussi l’image de celle
qui paie lourdement son désir. Sa seule réussite, paradoxale puisqu’elle
donne raison à son père, est d’avoir fait de son fils un jeune homme
cultivé et respecté dans la société victorienne qui ignore ses origines,
et ce fils pourra se faire entendre pour mener à bien sa mission. Mirah
réussit à concilier la vocation artistique et la condition de femme, elle
épouse Daniel et pourra sans doute continuer à chanter, puisqu’elle
n’a pas choisi la scène. Daniel est profondément à l’écoute des autres et
sa sensibilité lui permet de comprendre les désirs féminins, il sait être
un soutien sans jouer de son pouvoir, il sera – sans doute, puisque la
fin ouverte du roman laisse les personnages libres de leur destin – un
admirable compagnon de voyage.
4. L’écriture, les émotions, la musique
Est autem in dicendo etiam quidam
cantus obscurior.
Cicéron, Orator, xviii, 5732.
Mais George Eliot ne se contente pas d’écrire un roman sur la
musique, elle écrit aussi un roman musical. Daniel Deronda est
véritablement un roman « expérimental » à bien des titres, et aussi
sur le plan du croisement entre musique et littérature. Une des scènes
romanesques les plus étonnantes est celle de la rencontre de Daniel avec
sa mère. Eliot indique très souvent les intonations des personnages, on
l’a vu, et ces intonations les caractérisent, mieux encore qu’un portrait
traditionnel. Mais il s’agit ici d’une utilisation tout à fait singulière,
d’une véritable « symphonie musicale de voix parlées », orchestrée
31 Ibid., t. II, p. 302. Liv. VII, chap. li : « He hated that Jewish women should be thought of by
the Christian world as a sort of ware to make public singers and actresses of. As if we were not
the more enviable for that ! That is a chance of escaping from bondage. »
32 « Il y a dans le parler une sorte de chant indéfinissable. »
Modernites34.indd 157 19/09/12 11:19
158 élisabeth Rallo Ditche
avec soin. Dans le chapitre li, il n’y a pas moins de quinze mentions
du ton des voix ; dans le chapitre liii, qui est plus court, et qui relate
le second entretien de Daniel avec sa mère, il y en a autant. Eliot
n’ignorait pas les théories de Darwin : les organes vocaux sont efficients
au plus haut degré comme moyen d’expression ; l’expression vocale
est un moyen de coordination sociale et de résolution des conflits. Le
cerveau limbique, qui est le siège des émotions, est plus développé chez
les mammifères, cela inclut la possibilité de moduler, d’apprendre
et d’inventer de nouvelles formes : cette habileté est essentielle dans
l’invention spécifiquement humaine de la musique ; seul l’être humain
a un contrôle cortical sur la voix, ce qui est un préréquis pour le
chant. D’autre part, on a débattu sur la parenté entre voix parlée et
musique : une des plus anciennes explications est que la musique est
une réminiscence de l’expression vocale des émotions. On a remarqué
l’aspect musical du discours : quand on le module, le timbre d’une voix
chantée peut mettre en jeu les mêmes éléments que le discours.
Là s’arrête la similitude, du reste, car la musique a ses propres
codes qui varient selon les cultures, mais cette parenté permet à
George Eliot de créer son « écriture musicale » propre. Le baryton
léger Daniel et sa mère, grande cantatrice dont on ne connaît pas le
timbre, mais qui semble être inspirée d’un contralto de l’époque, se
parlent avec des intonations, des modulations, des tonalités telles
que ce qu’entend le lecteur devient un duo lyrique. L’homme, par sa
voix, peut articuler, de manière audible pour l’autre, sa volonté et ses
émotions, faculté unique, proprement humaine. La voix altérée est
celle que l’on prend sous le coup d’une émotion, faire mention de la
voix et de ses transformations ou de ses altérations revient à évoquer
des émotions33. Le narrateur fait état des modulations de la voix des
personnages. Tantôt la mère domine, par sa voix mélodieuse, par un
timbre fort, par sa fermeté, alors que la voix de Daniel tremble de
timidité ou qu’elle est voilée par la passion. Tantôt, c’est le fils qui
domine, calme et ferme comme à son ordinaire, alors que la voix de
la mère exprime une tendresse mélodieuse ou une détresse cachée. La
mère écoute son fils, et écoute plutôt le rythme de sa voix, comme si
celui-ci dominait son oreille34 : l’Alcharisi écoute la voix de son fils plus
33 Francesco Giannattasio, « Du parlé au chanté : typologie des relations entre la musique et le
texte », in Jean-Jacques Nattiez (dir.), Musiques : une encyclopédie pour le xxie°siècle, Arles,
Actes Sud – Paris, Cité de la Musique, 2007, p. 1050-1087.
34 Daniel Deronda, t. II, p. 343. Liv. VII, chap. liii : « Deronda paused in his pleading : his
mother looked at him listeningly, as if the cadence of his voice were taking her ear, yet she
shook her head slowly. »
Modernites34.indd 158 19/09/12 11:19
Voix et émotions dans Daniel Deronda de George Eliot 159
que ses paroles, et cette voix lui apprend à le connaître. Mais à la
fin de l’entrevue, lorsque l’Alcharisi repousse doucement la tendresse
de Daniel pour ne pas fléchir elle-même, Daniel laisse entendre un
sanglot, brisure de la voix, émotion extrême et dernier élément sonore
avant une étreinte en guise d’adieu. Toute l’entrevue, qui a permis
aux deux personnages de se parler enfin, à Daniel de connaître ses
origines et de mieux se comprendre – « Il se sentit vieilli. Tous les
désirs et toutes les inquiétudes qu’il avait éprouvés dans son enfance
au sujet de sa mère avaient disparu35 » –, à l’Alcharisi d’honorer la
mémoire de son père et de se mettre en paix avec sa conscience avant
de mourir, de faire la connaissance aussi de ce fils délaissé et de savoir
à quel point il était digne d’être aimé, est sous le signe de cette musique
que les deux personnages aiment et dont ils vivent, mais aussi sous le
signe de l’écoute qui structure leur personnalité de façon différente.
Alors que l’Alcharisi a fait carrière grâce à son don musical, Daniel
met toute sa sensibilité de musicien au service de l’écoute d’autrui, de
la compassion et de l’empathie. Son don à lui est de savoir entendre.
Seul un écrivain sensible à la musique et aux voix, un véritable
connaisseur de l’opéra, pouvait écrire ces scènes de cette façon,
quelqu’un qui est devenu, par amour pour la musique, un « écouteur »,
quelqu’un qui perçoit avec une sensibilité musicale toute production
sonore36. Dans ce roman, les émotions sont liées à la qualité « musicale »
des âmes. Éprouver des émotions et être musicien est tout un : mais
cela ne suffit pas pour accéder à une véritable hauteur morale, un saut
qualitatif est encore nécessaire. L’âme musicale doit s’ouvrir à l’écoute
des autres, et non seulement à leur voix, mais aussi à leur être le plus
intime : ainsi, Gwendolen doit parcourir un long chemin pour se hisser
à la hauteur que lui a montrée Daniel, elle doit oublier d’être à sa
propre écoute pour entendre ce que les autres ont à lui demander, à lui
dire, comme elle aurait dû « chanter plus large », ainsi que Klesmer le
lui conseillait. Ainsi, Daniel a reçu le don musical mais en fait un autre
usage : c’est au service de son peuple et des autres qu’il met ses qualités
morales, liées à sa sensibilité hors du commun, à son empathie. Les
émotions sont la condition de la qualité musicale de l’individu au plus
35 Ibid., t. II, p. 349. Ibid. : « He felt an older man. All his boyish yearnings and anxieties about
his mother had vanished. »
36 « De fait, lorsqu’on écoute un énoncé verbal, c’est précisément ses différents degrés de pré-
gnance et de récurrence structurale qui permettent de percevoir cet énoncé comme parlé ou
chanté. D’où s’ensuit qu’il existe entre le parler de tous les jours et le chant plus qu’une conti-
guïté évidente : une étroite corrélation. » F. Giannattasio, « Du parlé au chanté… », art. cité,
p. 1051.
Modernites34.indd 159 19/09/12 11:19
160 élisabeth Rallo Ditche
profond du cœur, elles sont portées par la voix, parlée ou chantée,
elles sont aussi la condition de leur qualité morale. Grandcourt ne
saura jamais ce qu’il perd en refusant de se laisser toucher par la voix
de Mirah, il perd tout simplement ce qui fait l’humanité d’un être
humain : pouvoir être touché par la voix humaine de l’autre, et s’élever
vers les « richesses spirituelles du monde ».
Élisabeth Rallo Ditche
Université de Provence (Aix-Marseille)
Bibliographie
Bury, Laurent, « La cantatrice juive. Variations victoriennes sur l’aphonie »,
Sillages critiques, no 7, 2005, publié en ligne : http://sillagescritiques.revues.
org/919.
Clapp-Itnyre, Alisa, Angelic Airs, Subversive Songs : Music as Social
Discourse in the Victorian Novel, Athens, Ohio University Press, 2002.
Eliot, George, Daniel Deronda [1876], texte présenté, traduit et annoté par
Alain Jumeau, Paris, Gallimard, coll. « Folio-classique », 2010, 2 vol.
Giannattasio, Francesco, « Du parlé au chanté : typologie des relations
entre la musique et le texte », in Jean-Jacques Nattiez (dir.), Musiques : une
encyclopédie pour le xxie°siècle, Arles, Actes Sud – Paris, Cité de la Musique,
2007, p. 1050-1087.
Gray, Beryl, George Eliot and Music, Londres, Palgrave Macmillan, 1989.
James, Henry, Selected Literary Criticism, éd. Morris Shapira, Londres,
Heinemann, 1963.
Welliver, Phyllis, Women Musicians in Victorian Fiction, 1860-1900 :
Representations of Music, Science and Gender in the Leisured Home,
Aldershot, Ashgate, 2000.
Modernites34.indd 160 19/09/12 11:19
Les affects entre parenthèses :
W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec
On a déjà souvent souligné l’absence remarquable de pathos qui
caractérise W ou le souvenir d’enfance, le récit autobiographique
de Georges Perec1. La biographie de l’écrivain est pourtant de celles
qui auraient particulièrement donné prise au pathétique : l’enfance
qu’il raconte dans le livre est celle d’un enfant juif pendant la guerre,
qui devient très tôt orphelin – Perec a quatre ans quand son père,
engagé volontaire, meurt sur le champ de bataille ; il en a six quand
sa mère est déportée à Auschwitz, d’où elle ne reviendra pas. Le
livre frappe plus généralement par la discrétion dont fait preuve
le narrateur, concernant l’expression des affects. Un retrait qu’il
souligne lui-même, déclarant, dans la partie autobiographique : « je
sais que ce que je dis est blanc, est neutre2 » ; de cette blancheur, de
cette neutralité de style qui caractérise le livre aurait pu résulter une
forme de sécheresse ou de platitude3. Or W ou le souvenir d’enfance
1 Récit, on le sait, qui n’est pas seulement autobiographique, puisque composé de deux textes :
une fiction qui commence par narrer les aventures de Gaspard Winckler, seul survivant d’une
indicible catastrophe, que l’on charge de partir à la recherche d’un enfant naufragé, lui-même
nommé Gaspard Winckler, dont il aurait justement hérité le nom. Dans la seconde partie du
livre, cette histoire s’interrompt pour faire place à celle de l’île W, lieu utopique qui se révèle
petit à petit le décalque d’un camp de concentration.
2 Georges P erec, W ou le souvenir d’enfance [1975], Paris, Gallimard, 1993, p. 63.
3 D’autant que le récit n’offre à son lecteur qu’une série d’« anecdotes maigres », comme l’auteur
les qualifie lui-même : « le récit fragmentaire d’une vie d’enfant pendant la guerre, un récit
pauvre d’exploits et de souvenirs, fait de bribes éparses, d’absences, d’oublis, de doutes, d’hy-
pothèses, d’anecdotes maigres ». Ibid., quatrième de couverture.
Modernites34.indd 161 19/09/12 11:19
162 Maryline Heck
est un livre particulièrement émouvant, qui impressionne souvent très
fortement son lecteur. Paradoxe apparent qui invite à revenir sur les
liens complexes, voire ambivalents que l’écriture perecquienne peut
entretenir avec l’expression de l’émotion.
Il s’agirait, tout d’abord, de décrire un peu précisément les formes
de ce retrait singulier des affects dans le texte. On pourrait commencer
en citant l’incipit, désormais célèbre, de la partie autobiographique :
Je n’ai pas de souvenirs d’enfance. Jusqu’à ma douzième année à peu près,
mon histoire tient en quelques lignes ; j’ai perdu mon père à quatre ans, ma
mère à six ; j’ai passé la guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans.
[…]
Cette absence d’histoire m’a longtemps rassuré : sa sécheresse objective, son
évidence apparente, son innocence, me protégeaient, mais de quoi me proté-
geaient-elles, sinon précisément de mon histoire, de mon histoire vécue, de
mon histoire réelle, de mon histoire à moi qui, on peut le supposer, n’était
ni sèche, ni objective, ni apparemment évidente, ni évidemment innocente 4 ?
La sécheresse évoquée est notamment celle des affects ; tout se passe
comme si, avec son histoire, avec ses souvenirs, avaient été oubliées les
émotions de l’enfant. La discrétion des sentiments liés aux parents et
à leur disparition est particulièrement frappante. En témoigne le récit
pour le moins laconique que Perec fait de leur mort. Il raconte ainsi
comment son père mourut le jour de l’armistice, « une mort idiote et
lente », commente-t-il :
Mon père fut fait prisonnier alors qu’il avait été blessé au ventre par un tir
de mitrailleuses ou par un éclat d’obus. Un officier allemand accrocha sur
son uniforme une étiquette portant la mention « À opérer d’urgence » et il fut
transporté dans l’église de Nogent-sur-Seine, dans l’Aube, à une centaine de
kilomètres de Paris ; l’église avait été transformée en hôpital pour les prison-
niers de guerre ; mais elle était bondée et il n’y avait sur place qu’un seul infir-
mier. Mon père perdit tout son sang et mourut pour la France avant d’avoir
été opéré. Messieurs Julien Baude, contrôleur principal des Contributions
indirectes, âgé de trente-neuf ans, domicilié à Nogent-sur-Seine, avenue
Jean-Casimir-Perier, no 13, et René Edmond Charles Gallée, maire de ladite
ville, dressèrent l’acte de décès le même jour à neuf heures. Mon père aurait
eu trente et un ans trois jours plus tard5.
Il évoque quelques pages plus loin la mort probable de sa mère à
Auschwitz :
Nous n’avons jamais pu retrouver de trace de ma mère ni de sa sœur. Il est
possible que, déportées en direction d’Auschwitz, elles aient été dirigées sur
un autre camp ; il est possible aussi que tout leur convoi ait été gazé en arri-
vant. […]
4 Ibid., p. 17.
5 Ibid., p. 57-58.
Modernites34.indd 162 19/09/12 11:19
Les affects entre parenthèses : W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec 163
Ma mère n’a pas de tombe. C’est seulement le 13 octobre 1958 qu’un décret
la déclara officiellement décédée, le 11 février 1943, à Drancy (France). Un
décret ultérieur, du 17 novembre 1959, précisa que, « si elle avait été de natio-
nalité française », elle aurait eu droit à la mention « Mort pour la France 6 ».
Dans les deux cas, Perec reprend à son compte le vocabulaire
des documents administratifs, documents qui sont tout ce qui lui
reste de ces êtres dont la disparition s’est faite hors de sa vue : une
disparition sans trace autre que celle de ces papiers officiels, sans
restes, notamment dans le cas de sa mère, qui n’a pas eu de sépulture
– contrairement au père, dont la mort est matérialisée par la petite
tombe d’un cimetière militaire. La voix du narrateur tend à s’effacer
derrière le jargon administratif ; perce surtout une certaine ironie,
une forme d’amertume, dans l’évocation de ce père qui « perdit tout
son sang et mourut pour la France avant d’avoir été opéré » – mention
« Mort pour la France » à laquelle la mère, elle, n’aura pas droit. La
voix neutre du vocabulaire administratif n’est pas sans faire écho à
celle, froide et totalement dépourvue d’affects, de la seconde partie de
la fiction, où le narrateur détaille avec un flegme absolu les tortures
les plus atroces infligées aux athlètes W ; ses précisions vétilleuses,
tatillonnes, offrant une évidente parodie de la prose des dignitaires
nazis.
La tristesse de Perec, quant à elle, ne se fait guère entendre. Celle de
l’enfant qu’il fut ne s’exprime dans le livre que de manière « oblique »
– pour reprendre le terme utilisé par Philippe Lejeune pour qualifier
les stratégies autobiographiques de Perec7 –, au détour par exemple
d’un commentaire que lui inspirent ses livres de classe :
Moi, j’aurais aimé aider ma mère à débarrasser la table de la cuisine après
le dîner. Sur la table, il y aurait eu une toile cirée à petits carreaux bleus ;
au-dessus de la table, il y aurait eu une suspension avec un abat-jour presque
en forme d’assiette, en porcelaine blanche ou en tôle émaillée, et un système
de poulies avec un contrepoids en forme de poire. Puis je serais allé chercher
mon cartable, j’aurais sorti mon livre, mes cahiers et mon plumier de bois, je
les aurais posés sur la table et j’aurais fait mes devoirs. C’est comme ça que ça
se passait dans mes livres de classe 8.
Le chagrin, le manque éprouvé par l’enfant se dessinent seulement
en creux, dans les revers de l’évocation de cette image d’Épinal un peu
conventionnelle, forgée sur le modèle des livres d’école.
6 Ibid., p. 61-62.
7 Cf. Philippe L ejeune, La Mémoire et l’oblique : Georges Perec autobiographe, Paris, POL,
1991.
8 G. P erec, W, op. cit., p. 99.
Modernites34.indd 163 19/09/12 11:19
164 Maryline Heck
Les descriptions que Perec fait des photographies de son enfance
frappent de même par leur caractère objectif, neutre, par la rigueur
quasi scientifique avec laquelle l’écrivain les mène. Il détaille en effet
très scrupuleusement les quelques photographies qui lui restent de son
enfance, images qui font partie, comme les documents officiels, des
rares vestiges à demeurer de son passé. Il évoque ainsi une image qui le
représente en compagnie de sa mère, décrivant méthodiquement le visage
de cette dernière puis le sien, avec un remarquable souci d’exhaustivité.
Ma mère a des cheveux sombres gonflés par-devant et retombant en boucles
sur sa nuque. Elle porte un corsage imprimé à motifs floraux, peut-être fermé
par un clip. Ses yeux sont plus sombres que les miens et d’une forme légè-
rement plus allongée. Ses sourcils sont très fins et bien dessinés. Le visage
est ovale, les joues bien marquées. Ma mère sourit en découvrant ses dents,
sourire un peu niais qui ne lui est pas habituel, mais qui répond sans doute à
la demande du photographe.
J’ai des cheveux blonds avec un très joli cran sur le front (de tous les sou-
venirs qui me manquent, celui-là est peut-être celui que j’aimerais le plus
fortement avoir : ma mère me coiffant, me faisant cette ondulation savante) 9.
Le manque « le plus fort », celui de sa mère, coiffeuse, mettant en
forme ses cheveux, ne s’autorise ainsi à s’exprimer qu’entre parenthèses.
1. Une « incarnation » des affects
Que les sentiments éprouvés envers les figures parentales soient
difficilement exprimables s’explique sans doute aussi par le silence
qui entoura les conditions de leur disparition. La mort de ses
parents ne fut en effet jamais clairement annoncée à Perec enfant.
Elle resta, de la part des adultes qui l’entouraient, objet de censure.
Il évoque ainsi, dans W, à propos de son père, « cette mort que je
n’avais jamais apprise, jamais éprouvée, jamais connue ni reconnue,
mais qu’il m’avait fallu, pendant des années et des années, déduire
hypocritement des chuchotis apitoyés et des baisers soupirants des
dames10 ». On trouve un écho de ce passage plus loin dans le livre,
lorsque le narrateur raconte son souvenir erroné d’une fracture de
l’omoplate. Une série de faux souvenirs émaillent en effet le texte de
W, témoignant de l’incertitude de la mémoire chez Perec. Il affirme
ainsi avoir longtemps eu le souvenir d’une fracture de l’omoplate qu’il
se serait fait, enfant, en tombant en arrière sur une patinoire ; il se
rendit compte des années plus tard, en retrouvant un ancien camarade
9 Ibid., p. 73-74.
10 Ibid., p. 59.
Modernites34.indd 164 19/09/12 11:19
Les affects entre parenthèses : W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec 165
de classe, qu’il lui avait littéralement « volé » l’accident dont il avait
été victime :
L’événement eut lieu, un peu plus tard ou un peu plus tôt, et je n’en fus pas
la victime héroïque mais un simple témoin. Comme pour le bras en écharpe
de la gare de Lyon, je vois bien ce que pouvaient remplacer ces fractures émi-
nemment réparables qu’une immobilisation temporaire suffisait à réduire,
même si la métaphore, aujourd’hui, me semble inopérante pour décrire ce qui
précisément avait été cassé et qu’il était sans doute vain d’espérer enfermer
dans le simulacre d’un membre fantôme. Plus simplement, ces thérapeutiques
imaginaires, moins contraignantes que tutoriales, ces points de suspension,
désignaient des douleurs nommables et venaient à point justifier des cajole-
ries dont les raisons réelles n’étaient données qu’à voix basse11.
À voix basse, ou plus vraisemblablement pas du tout… Le « bras
en écharpe de la gare de Lyon » évoqué ici renvoie à un autre souvenir
« écran » de Perec, datant de la séparation de l’enfant avec sa mère,
gare de Lyon : celle-ci l’avait fait envoyer dans les Alpes par un convoi
de la Croix-Rouge, pour le protéger des rafles ; restée seule à Paris,
elle sera arrêtée, puis déportée. Perec fut longtemps persuadé, à tort,
d’avoir eu alors un bras en écharpe, conséquence d’une autre fracture
imaginaire. On voit bien, en effet, ce que ces « douleurs nommables »
pouvaient représenter, la fracture du bras venant comme métaphoriser
une autre déchirure, bien plus difficilement dicible. Tout se passe
comme si les douleurs du corps, plus matérielles, tangibles, avaient été
un moyen d’offrir une incarnation à une souffrance morale autrement
indicible (« ce qui précisément avait été cassé »).
Le récit de fiction pourrait corroborer une telle interprétation, dont
le héros, Gaspard Winckler, se donne comme une sorte de double du
narrateur du récit autobiographique (tous deux étant des narrateurs
« autodiégétiques », faisant le récit de leur propre histoire). Or ce
personnage a lui-même un avatar, le petit Gaspard Winckler, enfant
dont il a, apprendrons-nous au cours du récit, hérité du nom. Un système
d’échos se tisse ainsi entre les héros de la fiction et le narrateur du récit
autobiographique. Gaspard Winckler est lui aussi sujet à d’importantes
souffrances physiques : « Gaspard était un garçon malingre et
rachitique, que son infirmité condamnait à un isolement presque
total. Il passait la plupart de ses journées accroupi dans un coin de sa
chambre, négligeant les fastueux jouets que sa mère ou ses proches lui
offraient quotidiennement, refusant presque toujours de se nourrir12. »
Il est également « sourd-muet ». Or, poursuit le narrateur, « tous les
11 Ibid., p. 113-114.
12 Ibid., p. 36.
Modernites34.indd 165 19/09/12 11:19
166 Maryline Heck
médecins consultés étaient formels sur ce point, aucune lésion interne,
aucun dérèglement génétique, aucune malformation anatomique ou
physiologique n’étaient responsables de sa surdimutité, qui ne pouvait
être imputée qu’à un traumatisme enfantin dont, malheureusement, les
tenants et les aboutissants étaient encore inconnus, bien que l’enfant
eût été montré à de nombreux psychiatres13 ». Le récit de fiction figure
ainsi de façon plus explicite que l’autobiographie un enfant qu’un
« traumatisme enfantin » a rendu mutique ; et dont la souffrance, aussi
indicible que celle de l’enfant du récit autobiographique, trouve une
forme d’inscription dans son corps.
Cette idée d’une souffrance impossible à dire ou à éprouver
constitue d’ailleurs une thématique récurrente dans l’œuvre de Perec.
On la retrouve dans Un homme qui dort, lorsque le protagoniste est aux
prises avec un « malaise insidieux, engourdissant, à peine douloureux
et pourtant insupportable14 ». Dans La Disparition également, où elle
est au cœur de l’intrigue, les membres du clan maudit souffrant et
mourant, même, de ne pouvoir nommer l’objet de leur tourment : ce
E, lettre qui est dans le livre invisible et imprononçable – mais qui
s’incarne sur leur peau sous la forme d’une cicatrice, « fin sillon
blafard » qui signe leur condamnation à mort –, donnant une autre
forme de réalisation à cette incarnation dans le corps des signes d’une
souffrance autrement impossible à nommer.
Dans W, la difficulté de faire l’épreuve des affects se trouve liée à
la disparition des figures parentales – et peut-être, plus encore, à la
perte du souvenir de cette disparition. Une telle hypothèse situerait le
retrait des affects du côté d’un refoulement, d’une forme de censure – ce
que les propos de J.-B. Pontalis, l’ancien analysant de Perec, semblent
eux aussi suggérer. Le psychanalyste a en effet évoqué son ancien
patient dans une série de récit de « cas », sous des noms d’emprunt,
derrière lesquels l’identité de l’écrivain est néanmoins aisément
décelable. Or l’idée d’une censure des affects revient dans plusieurs
de ces textes. Pontalis évoque notamment à différentes reprises une
forme de retrait du corps et des affects chez Perec, au profit d’une
13 Ibid., p. 40.
14 Georges P erec, Un homme qui dort [1967], Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1990, p. 17.
Modernites34.indd 166 19/09/12 11:19
Les affects entre parenthèses : W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec 167
tendance marquée à ce qu’il nomme la « mentalisation15 ». Ainsi, à
propos du cas « Simon » : « D’emblée, je fus sensible à la dissociation
qui opérait en lui et qui avait dû s’y installer assez tôt pour déterminer
tout son fonctionnement mental : prévalence du processus de pensée,
expression nulle ou a minima des affects16. »
Le psychanalyste évoque aussi un « refus » de l’émotion, de la
douleur en particulier. Encore à propos de « Simon », il parle d’un
« refus » d’« aller à la rencontre » de sa douleur : « Paradoxalement,
c’est parce que la douleur psychique était chez Simon singulièrement
manquante – et même les formes les plus habituelles de l’angoisse –
qu’il m’a fait découvrir ce que pouvait signifier l’expérience de la
douleur et le refus organisé d’aller à sa rencontre17. »
L’expression de « refus organisé » laisse entendre comment il aurait
pu y avoir, dans le discours de l’analysant Perec, mise en place de
barrières, de moyens de défense contre l’émotion. Dans son écriture,
c’est à la pratique des contraintes notamment que l’on pourrait penser,
comme le suggère Pontalis lui-même, dans un entretien plus récent :
Quand Perec est venu me voir, il m’a dit n’avoir aucun souvenir d’enfance. Je
n’en ai pas de preuve mais je pense qu’il n’aurait pas pu écrire ce livre [W]
sans l’analyse. Il s’est passé entre nous quelque chose de très curieux : depuis
plusieurs séances, rien ne surgissait de l’interprétation de ses rêves, puis un
jour, j’ai trouvé les mots et cette carapace joueuse – il était très oulipiste –
mais très défensive s’est effritée et les sanglots ont éclaté. Je ne me souviens
pas de ce que j’avais pu dire mais j’avais trouvé le point sensible, la faille,
trouvé l’accès au lieu de la détresse18.
C’est surtout l’impossibilité des affects négatifs, de la souffrance,
de la tristesse, que Pontalis souligne chez son patient.
Le retrait des affects dans l’écriture perecquienne tient sans doute
à une impossibilité ou à une défense, peut-être inconsciente, contre
les émotions et ce qu’elles pourraient laisser affleurer. Il semble
cependant aussi être en partie volontaire et participer, dans l’écriture
15 « J’en vins, à partir de nombreux récits de rêves, à entendre tout le discours de ce patient comme
une activité compulsive de substitution. J’avais aussi un concept à ma disposition qui, peut-être
parce qu’il n’est pas « consigné » dans le Vocabulaire, restait libre et opérant pour moi : la men-
talisation, […] où je vois le processus inverse et symétrique de la conversion, supposant comme
elle une sorte de dissociation entre le corps et les représentations mais, ici, c’était tout ce qui
émane de la pulsion qui se trouvait aussitôt projeté, évacué sur la scène mentale et soumis à un
travail minutieux de division, de dislocation, à un processus sans fin de liaison. » Jean-Bertrand
Pontalis, Entre le rêve et la douleur [1977], Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1983, p. 234.
16 « Sur la douleur (psychique) », ibid., p. 264.
17 Ibid., p. 263.
18 « Entretien avec J.-B. Pontalis », Les Moments littéraires, no 19, 1er semestre 2008, p. 31.
Modernites34.indd 167 19/09/12 11:19
168 Maryline Heck
autobiographique notamment, d’une intention bien consciente de ne
pas exhiber l’intime.
2. D’une voix blanche
C’est à la pudeur de Perec que l’on touche là, pudeur quasi légendaire,
maintes fois soulignée par la critique19. Le mot de « pudeur » est ainsi
le premier du portrait en neuf points que Philippe Lejeune fait de
Perec autobiographe dans La Mémoire et l’oblique.
Perec est si pudique que le mot « pudeur » semble lui-même un peu grossier
pour parler de ce retrait, de cette discrétion. Ce n’est pas seulement le refus
de « la rengaine usée du papa-maman, zizi-panpan » (comme il dit dans « Les
lieux d’une ruse ») qui le fait rester à l’écart de l’étalage de la sexualité ou de
fantasmes érotiques auquel s’abandonnent d’autres autobiographes contem-
porains. […]. Mais la vraie pudeur est ailleurs : c’est celle des sentiments20.
« Cette discrétion est si profonde qu’elle s’exerce aussi de soi à soi,
dans l’écriture la plus solitaire, la moins publique, celle des agendas,
des carnets, où les confidences passionnelles sont rares », note aussi
Lejeune21. Les parenthèses de W pourraient en être l’une des traces.
C’est une semblable pudeur qui explique peut-être le curieux terme
d’« enrobage » que le narrateur du récit autobiographique utilise pour
évoquer précisément les émotions et leur expression dans son texte.
Il affirme ainsi, à propos de deux textes écrits sur ses parents, bien
avant la rédaction de W ou le souvenir d’enfance, mais qu’il choisit
d’inclure dans le livre :
Quinze ans après la rédaction de ces deux textes, il me semble toujours que je
ne pourrais que les répéter : quelle que soit la précision des détails vrais ou
faux que je pourrais y ajouter, l’ironie, l’émotion, la sécheresse ou la passion
dont je pourrais les enrober, les fantasmes auxquels je pourrais donner libre
cours, les fabulations que je pourrais développer, quels que soient, aussi, les
progrès que j’ai pu faire depuis quinze ans dans l’exercice de l’écriture, il me
semble que je ne parviendrai qu’à un ressassement sans issue22.
On pourrait voir, dans la connotation relativement péjorative du
terme « enrober », l’expression de la pudeur un peu puritaine de
Perec. Le mot fait de l’émotion quelque chose de surajouté, de faux,
qui ne saurait être consubstantiel au discours ; l’idée que celle-ci
serait forcément de l’ordre d’un inauthentique pourrait renvoyer
aussi à l’oubli de l’enfance et à la difficulté de l’adulte à établir des
19 Voir notamment sur ce point l’article de David Bellos, « La pudeur de Perec », Poésie, no 94,
octobre 2002, p. 39-49.
20 P. L ejeune, La Mémoire et l’oblique, op. cit., p. 40.
21 Ibid.
22 G. P erec, W, op. cit., p. 62.
Modernites34.indd 168 19/09/12 11:19
Les affects entre parenthèses : W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec 169
relations justes avec sa mémoire, face à laquelle les affects seraient
comme nécessairement réduits à une fonction d’enrobage. Perec, en
tout cas, ne semble guère se faire d’illusions concernant la teneur
de ce qu’il pourrait encore écrire sur ses parents, propos qui ne
sauraient être que « fantasmes » ou « fabulations ». La « précision des
détails vrais ou faux » : la formule suggère bien la relation tortueuse
que le narrateur peut entretenir avec ce passé, qui place comme des
équivalents le vrai et le faux – on a du mal à concevoir quelle forme de
précision des détails faux pourraient donner à son texte…
Ce constat d’un « ressassement sans issue » amène Perec, dans la
suite du passage, à décrire son écriture comme « blanche », « neutre » :
Je ne sais pas si je n’ai rien à dire, je sais que je ne dis rien ; je ne sais pas si ce
que j’aurais à dire n’est pas dit parce qu’il est l’indicible (l’indicible n’est pas
tapi dans l’écriture, il est ce qui l’a bien avant déclenchée) ; je sais que ce que
je dis est blanc, est neutre, est signe une fois pour toutes d’un anéantissement
une fois pour toutes23.
La blancheur évoquée pourrait être celle que laisse l’effacement
des affects et des voix. Gaspard Winckler, le narrateur de la fiction,
affirmait ainsi au début de son récit vouloir précisément, pour relater
les événements dont il a été le témoin, « adopter le ton froid et serein de
l’ethnologue. Ce n’est pas la fureur bouillante d’Achab qui m’habite,
mais la blanche rêverie d’Ishmaël, la patience de Bartleby. C’est à eux,
encore une fois, après tant d’autres, que je demande d’être mes ombres
tutélaires24 ». Cette revendication d’un discours dénué d’affects, d’un
« ton froid » contre la « fureur bouillante » d’un Achab, résonne
comme en écho au constat d’une parole neutre que fait le narrateur du
récit autobiographique.
Perec écrit, dans la suite du passage du récit autobiographique : « je
ne retrouverai jamais, dans mon ressassement même, que l’ultime reflet
d’une parole absente à l’écriture, le scandale de leur silence et de mon
silence : je n’écris pas pour dire que je ne dirai rien, je n’écris pas pour
dire que je n’ai rien à dire25 ». La précision finale est pour lui un moyen
de se démarquer des voies qu’il refuse d’emprunter : le « ressassement »
de l’écriture, l’« anéantissement » dont elle se fait le signe ne permettent
pas de l’assimiler aux « écritures blanches » contemporaines, fondées
sur une conscience désenchantée et ressassante. Perec ici ne se situe
pas du côté d’un Blanchot. Il n’écrit pas « pour dire qu’[il] n’a rien à
23 Ibid., p. 62.
24 Ibid., p. 14-15.
25 Ibid., p. 63.
Modernites34.indd 169 19/09/12 11:19
170 Maryline Heck
dire26 » : s’exprime son refus de faire du rien, du silence un but de la
littérature. L’« indicible » serait pour l’écriture point de départ et non
visée, « ce qui l’a bien avant déclenchée ».
Tout le paradoxe de ce passage réside dans le fait que Perec y
définit son écriture comme blanche ; il y affirme l’hétérogénéité de la
parole et de l’écriture, qui ne peut porter qu’un « silence ». Or cette
page est indéniablement l’une de celles où se fait le plus distinctement
entendre sa voix, l’une des plus émouvantes aussi. Comme si c’était
dans l’aveu même de l’impossibilité de l’écriture à porter autre chose
qu’un silence, qu’une absence, que sa parole pouvait affleurer au plus
près du texte, et l’émotion sourdre le plus fortement.
On pourrait lire ce paradoxe comme celui de la « voix blanche »,
cette voix que neutralise précisément un trop-plein d’émotions. La
blancheur du texte de Perec pourrait de même apparaître comme la
manifestation a contrario de l’excès de l’émotion, de son débordement,
dès lors que l’écriture s’engage sur ces terrains particulièrement
sensibles que sont ceux de la perte des parents. De l’émotion, elle
offrirait ainsi une représentation en creux.
Le rapport de cette « parole blanche » aux affects paraît dès lors
pour le moins ambivalent : cette voix comme « neutralisée » peut être
une manière pour le narrateur de se tenir au plus près de l’éprouvé
en suggérant l’informulable de sa douleur ; cette voix qui « ne dit
rien » pourrait cependant aussi se faire moyen de tenir en respect
les affects, voire de les mettre à distance – d’opérer sur les émotions
ce contrôle qu’évoquait Pontalis. L’écriture « blanche » pourrait être
une autre forme de barrage contre l’irruption de l’affect que celui que
les contraintes oulipiennes peuvent échafauder ; elle se ferait tentative
d’écrire l’émotion, mais aussi d’écrire contre elle, possédant un pouvoir
de coercition comparable à celui des contraintes. Manière de donner
voix aux affects mais tout à la fois de les faire taire – et il ne faudrait
pas sous-estimer la violence que peut renfermer cette affirmation de
neutralité. Le texte de W laisse ainsi percevoir l’intensité que peut porter
cette blancheur, dans la mesure où elle n’y serait pas tant synonyme de
platitude qu’indice de la puissance de l’affect, de la densité émotionnelle
que la voix du narrateur peut laisser irradier, fût-ce en sourdine ou en
creux.
Maryline Heck
Université de Tours
26 Je souligne.
Modernites34.indd 170 19/09/12 11:19
Les affects entre parenthèses : W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec 171
Bibliographie
Bellos, David, « La pudeur de Perec », Poésie, no 94, octobre 2002, p. 39-49.
Lejeune, Philippe, La Mémoire et l’oblique : Georges Perec autobiographe,
Paris, POL, 1991.
Perec, Georges, Un homme qui dort, Paris, Denoël, 1967 ; rééd. Gallimard,
coll. « Folio », 1990.
—, W ou le souvenir d’enfance, Paris, Denoël, 1975 ; rééd. Gallimard, coll.
« L’Imaginaire », 1993.
Pontalis, Jean-Bertrand, Entre le rêve et la douleur, Paris, Gallimard, coll.
« Connaissance de l’inconscient », 1977 ; rééd. coll. « Tel », 1983.
—, « Entretien avec J.-B. Pontalis », Les Moments littéraires, no 19, 1er
semestre 2008, p. 17-36.
Modernites34.indd 171 19/09/12 11:19
Modernites34.indd 172 19/09/12 11:19
Entre humeur et émotion :
la mélancolie mobile de Jacques Roubaud et W. G. Sebald
Dans un des chapitres posthumes de L’Homme sans qualités de Robert
Musil, Ulrich médite sur la dynamique du sentiment, « inséparable
d’une constante modification de tout ce qui lui est lié extérieurement et
intérieurement1 ». Le terme de « sentiment », que les traducteurs ont
choisi de préférence à « émotion », ne signale pas la force d’irruption,
le caractère d’événement que peut comporter l’émotion ; mais il a le
mérite d’ouvrir largement le champ de l’engagement affectif, ainsi
qu’y invite la réflexion de Musil. Notamment, le sentiment participe
de l’humeur comme de l’émotion, sorte de fonds commun labile à
partir duquel les distinguer. Pareil continuum apparaît clairement
dans l’analyse de Musil : chaque sentiment, dit-il, « quand il atteint
une certaine intensité et une certaine durée, se crée un monde choisi,
irrésistible, son propre monde, ce qui n’est pas sans jouer son rôle
dans les rapports humains2 ! ». Si les variations d’intensité et de durée
valent pour l’émotion comme pour l’humeur, la tendance à saturer
l’intérieur et l’extérieur d’une même tonalité impérieuse caractérise
plus spécialement l’humeur, et en particulier la mélancolie.
1 Robert Musil, L’Homme sans qualités [1930-1932], trad. de l’allemand par Philippe Jaccottet,
et par Jean-Pierre Cometti et Marianne Rocher-Jacquin pour les textes nouveaux, Paris,
Éd. du Seuil, 2004, IV, chap. 54 (« Naïve description de la formation d’un sentiment »), t. II,
p. 485.
2 Ibid., p. 487.
Modernites34.indd 173 19/09/12 11:19
174 élisabeth Cardonne-Arlyck
Entre émotion et humeur, la démarcation est donc fluide. Chacune peut
se changer en l’autre. Les sentiments, remarque Musil, « n’apparaissent
jamais purs, mais toujours, uniquement, sous forme d’approximation. En
d’autres termes encore : le processus de mise en forme et de consolidation
n’est jamais achevé3 ». Ce processus, qui articule sentiment et action l’un
à l’autre en une « relation de renforcement et de résonance mutuelle4 »,
peut jouer pareillement entre émotion et humeur. Le philosophe Peter
Goldie reprend ainsi la réflexion de Musil en déplaçant les termes de
« mise en forme » et de « consolidation » vers l’intrication de l’émotion
non seulement avec l’action, mais avec l’humeur : « Ainsi, l’humeur
peut se consolider en émotion. Et […] l’émotion peut se brouiller en se
défocalisant dans la non-spécificité de l’humeur5. » On note les termes
privatifs que Goldie applique à l’humeur (« défocalisant », « non-
spécificité ») : celle-ci se définit à partir de l’émotion, par un manque.
La difficulté à cerner indépendamment l’humeur dont témoignent ces
soustractions se retrouve à travers les analyses philosophiques des
émotions, même lorsqu’elles partent d’une conception forte de l’humeur,
telle que la Stimmung heideggérienne. Ainsi, dans une étude portant
sur « la personne entre humeurs et affects », René Rosfort et Giovanni
Stanghellini proposent-ils une série bipartite d’oppositions6 : les émotions
sont focalisées, intentionnelles, motivées, articulées, déterminées,
directes ; les humeurs sont non focalisées, non intentionnelles, non
motivées, inarticulées, indéterminées, non dirigées. Les seuls traits qui
échappent à cette caractérisation privative portent sur la temporalité :
les humeurs sont soutenues, alors que les émotions sont instantanées7.
Le caractère durable, quoique diffus, des humeurs les rapproche du
tempérament, en lequel elles peuvent se consolider et se fondre. Les
émotions, en revanche, sont, selon le raccourci de Goldie, « complexes,
épisodiques, dynamiques, et structurées8 ». Bien que, comme Rosfort et
Stanghellini, il nuance ces dichotomies, celles-ci n’en manifestent pas
moins une répartition élémentaire dans laquelle les émotions occupent le
3 Ibid., IV, chap. 55 (« Sentiment et comportement. L’incertitude du sentiment »), t. II, p. 497.
4 Ibid., p. 494.
5 Peter G oldie, The Emotions : A Philosophical Exploration, Oxford, Clarendon Press, 2000,
p. 148. Je traduis.
6 René Rosfort et Giovanni Stanghellini, « The Person Between Moods and Affects »,
Philosophy, Psychiatry, Psychology, vol. 13, no 3, septembre 2009, p. 251-266.
7 Hippocrate avait marqué ce trait : « Si retrait (phobos) et abattement (dysthymie) durent long-
temps, un tel état est en relation avec la bile noire (mélancolique). » H ippocrate, Aphorismes 6,
23, trad. par Jackie P igeaud dans De la mélancolie : fragments de poétique et d’histoire, Paris,
Dilecta, 2005, p. 139.
8 P. G oldie, The Emotions, op. cit., p. 5. Je traduis.
Modernites34.indd 174 19/09/12 11:19
Entre humeur et émotion : la mélancolie mobile de Jacques Roubaud et W. G. Sebald 175
pôle positif, déterminant, du champ affectif, et les humeurs, le négatif,
déterminé par son contraire parce qu’incernable directement.
Pourtant, hormis l’amour, quelle expérience affective a fait l’objet,
depuis l’Antiquité grecque, d’une attention plus soutenue et plus diverse
(médicale, philosophique, littéraire, iconographique) que l’humeur
mélancolique ? « [S]’agissant de l’infigurable mélancolie, remarque
Jean Starobinski, les figures ne seront jamais assez nombreuses, dans
leur insuffisance, pour tenter de lui donner corps […] 9. » Le nom même
de la mélancolie, qui l’assigne à la bile noire – en survivante unique des
quatre humeurs d’Hippocrate – témoigne de cet effort pour donner corps
à l’humeur fuyante. La résistance qu’elle oppose à toute figuration qui
prétendrait la contenir fait ainsi de la mélancolie le modèle exemplaire
de l’humeur, telle que la philosophie des émotions s’efforce de la
définir. Les faces multiples et mouvantes qu’elle présente d’une époque
historique à l’autre dans la littérature et l’art, sa prégnance dans les
représentations contemporaines, seraient le revers des difficultés que
rencontre la réflexion philosophique à la catégoriser. Plus contrainte sa
définition, plus expansive sa représentation.
Dans son analyse de l’interaction entre sentiment (émotion et humeur
conjointes) et action, Musil insiste sur la dimension temporelle qui
leur permet de se former, de se renforcer, et finalement de s’affaiblir
mutuellement. C’est ce processus lui-même qui constitue, dans son
déploiement, la vie affective. L’humeur et l’émotion peuvent toutefois
s’y distinguer par leur modalité temporelle : la première, nébuleuse,
dépourvue d’objet précis, et sans bords, se caractérise par une durée
indéterminée, alors que la seconde, dirigée vers un objet spécifique,
suit un cours plus net et tend à s’épuiser plus rapidement. Bien qu’il ne
s’agisse là que de traits plus ou moins saillants selon les cas, et sujets
à correction, émotion et humeur se différencieraient ainsi d’abord par
leurs tempos respectifs. Or la littérature, comme la musique, peut,
par ses seules différences de tempo, rendre perceptibles, sans les
nommer, émotions ou humeurs dans leurs mouvements les plus fins.
Ou elle peut les nommer à côté, de biais, par intermédiaire ou relai.
Prêter attention à de telles possibilités qu’offrent la littérature et, plus
généralement, les arts correspond à ce que le poéticien Charles Altieri
appelle une perspective « adverbiale10 » : celle-ci considère les affects
9 Jean Starobinski, La Mélancolie au miroir : trois lectures de Baudelaire, Paris, Julliard,
1989, p. 49.
10 Charles A ltieri, The Particulars of Rapture : An Aesthetics of the Affects, Ithaca, Cornell
University Press, 2003, p. 9 sqq.
Modernites34.indd 175 19/09/12 11:19
176 élisabeth Cardonne-Arlyck
comme des modalités de l’action (perspective proche de celle de Musil),
en opposition avec la perspective adjectivale, qui classe (approche
cognitive, qu’Altieri juge insuffisante) : « Les adjectifs, affirme-t-il,
trient efficacement le monde parce qu’ils fournissent à la croyance un
réseau stable de suppositions11. » Je me définis en cet instant triste,
effrayée ou joyeuse, par exemple. Une perspective adverbiale, qui suit
les affects dans la complexité mouvante, et souvent indéfinissable, de
leur emmêlement à l’action, permet une approche, qu’Altieri appelle
performative, des émotions.
Mon intention n’est pas de mettre la distinction d’Altieri à l’épreuve,
mais de considérer, selon une semblable « perspective adverbiale »,
certaines modalités de l’humeur mélancolique (et ses possibles connexions
avec l’émotion), dans deux œuvres narratives contemporaines : le récit
en sept volumes de Jacques Roubaud, ‘le grand incendie de Londres’
– en particulier La Bibliothèque de Warburg –, et les narrations en
prose de W. G. Sebald – en particulier Les Anneaux de Saturne. Ces
deux œuvres, en lesquelles la mélancolie est un motif récurrent, ont
d’abord en commun de présenter celle-ci comme une humeur, et non pas
de la circonscrire d’emblée, à l’instar de récits de dépression tels que
Face aux ténèbres de William Styron, aux troubles qui la manifestent.
Conserver à cette humeur son nom ancien, c’est ainsi maintenir ouvert
« l’immense territoire mélancolique12 », comme l’appelle Roubaud, en
refusant d’enfermer son réseau complexe d’affects dans une nosographie
centrée sur le sujet ; c’est garder ouverte la possibilité que l’expérience
affective de ce sujet dépasse sa seule psyché – « la maison forte de la
mélancolie13 », selon la formule de Sebald – et que, en manifestant
quelque chose de son rapport à la réalité, la mélancolie révèle aussi
quelque chose de cette dernière.
11 Ibid., p. 10-11.
12 Jacques Roubaud, La Fleur inverse : essai sur l’art formel des troubadours, Paris, Ramsay,
1986, p. 87.
13 W. G. Sebald, Campo Santo [2003], trad. de l’allemand par Patrick Charbonneau et Sibylle
Muller, Arles, Actes Sud, 2009, p. 116.
Modernites34.indd 176 19/09/12 11:19
Entre humeur et émotion : la mélancolie mobile de Jacques Roubaud et W. G. Sebald 177
3. Obsessions
‘le grand incendie de Londres’, « prose de mémoire » à six branches
publiée en sept volumes14, a, entre autobiographie et fiction, un statut
indécidable. « Prosateur non romancier », se déclare Roubaud15. Conçu
dès le départ comme une entreprise de longue haleine, l’ensemble est
régi par le nombre, par un système de digressions fréquentes, réglées en
incises et bifurcations, et par un protocole précis de rédaction : écriture
au présent, sans retours en arrière ni ratures, et composition mentale à
l’aide d’une technique que Roubaud appelle « mains mnémoniques16 »,
inspirée des « arts de mémoire » de la Renaissance. Quelque liberté
que l’écrivain ait pu prendre avec sa propre méthode, et quelque place
que celle-ci fasse à la contingence (le clinamen oulipien), l’insistance
que Roubaud met à en exposer l’extrême complexité relève certes de
la contrainte oulipienne, mais pointe aussi vers une obsession du
système, dont le cycle, de la première branche à la dernière, narre
les manifestations. Outre la méthode de composition enchevêtrée du
cycle lui-même (à l’intérieur de chaque branche et entre elles), dont
Roubaud déplie peu à peu les principes jusqu’à La Dissolution finale,
il décrit aussi les modes de composition qui ont présidé à l’écriture
d’autres ouvrages, notamment ses premiers livres de poèmes, Signe
d’appartenance et Trente et un au cube, fort complexes eux aussi. Les
méthodes s’emboîtent.
La méthode, cependant, n’est pas sans risque pour l’entreprise
qu’elle régit. Si elle permet de lancer le projet de narration et de le
soutenir sur plus de deux décennies, elle offre aussi la jouissance
périlleuse d’une élaboration sans cesse croissante, jusqu’au point
où cette élaboration excède le pouvoir de la pratiquer. Moteur de
la narration, elle en porte aussi l’échec éventuel17. Cette valence
contradictoire, et la mélancolie latente qui la sous-tend, marquent la
« Feuille mentale » selon laquelle, dans La Boucle, Roubaud imagine la
rédaction du cycle : « [J]e vois le mur de la chambre de prose circulaire,
comme en un donjon (où je suis prisonnier, peut-être pas volontaire,
14 J. Roubaud, Le Grand Incendie de Londres : récit, avec incises et bifurcations, 1985-1987,
Paris, Éd. du Seuil, 1989 ; La Boucle, Paris, Éd. du Seuil, 1993 ; Mathématique : récit, Paris,
Éd. du Seuil, 1997 ; Poésie : récit, Paris, Éd. du Seuil, 2000 ; La Bibliothèque de Warburg : ver-
sion mixte, Paris, Éd. du Seuil, 2002 ; Impératif catégorique : récit, Paris, Éd. du Seuil, 2008 ;
La Dissolution, Caen, Nous, 2008.
15 Id., Poésie, op. cit., p. 66.
16 Id., La Dissolution, op. cit., p. 402.
17 Le titre de La Dissolution, où la digression atteint la phrase elle-même, qui se pulvérise en
niveaux successifs marqués de couleurs différentes, signale que ce risque est assumé.
Modernites34.indd 177 19/09/12 11:19
178 élisabeth Cardonne-Arlyck
cela dépend). L’écriture, chapitre après chapitre, de chaque branche
s’effectue en spirale descendante ; c’est-à-dire que le récit proprement
dit […] s’achève, topologiquement, sur la même verticale du cylindre
qu’est la feuille, mais en dessous18. » Et la description continue. Dans
cet emprisonnement, « peut-être pas volontaire », dans le donjon de
la méthode, la mélancolie, tacitement, menace. La « maison forte de
la mélancolie » de W. G. Sebald n’est pas loin. L’humeur noire est
d’abord un risque de la méthode.
On ne saurait imaginer, en revanche, moins oulipien que W.
G. Sebald. « Je n’ai jamais aimé faire les choses systématiquement »,
affirme-il, soulignant la dimension impulsive et aléatoire de son
travail, fondé sur des recherches fragmentaires et des rencontres de
hasard19. Ses quatre « proses narratives20 » sont des textes autonomes,
quoique, de l’un à l’autre, se reconnaisse, comme dans ‘le grand
incendie de Londres’, le même narrateur à la première personne. Bien
que sa proximité biographique à l’auteur incite, comme dans le récit
de Roubaud, à les identifier, la relation entre eux demeure flottante.
Du fait que l’humeur définit l’interaction du sujet avec son milieu et
avec les circonstances, la difficulté à situer l’instance narrative s’étend
à l’humeur, qu’elle empêche d’assigner sans équivoque. L’humeur peut
être privée d’un sujet qui l’éprouve. Ou elle peut être démultipliée.
C’est le cas dans les récits de Sebald où le narrateur se double d’un
second ou même d’un troisième interlocuteur dont il rapporte le récit,
à la manière emboîtée de Thomas Bernhard, ainsi que de personnages
qui réfractent les affects. Si le narrateur de troisième degré n’intervient
que ponctuellement, le deuxième peut occuper le centre du récit, comme
le protagoniste éponyme d’Austerlitz ou les interlocuteurs successifs
des Émigrants. Inversement, dans Vertiges, le narrateur intègre dans
son récit des épisodes empruntés à des écrivains élus dont il se fait le
chroniqueur : Stendhal, Casanova, Kafka. Il rapporte ces épisodes de
la même manière parcellaire et idiosyncratique qu’il narre, dans Les
Anneaux de Saturne, les histoires de personnages, soit historiques tels
que Swinburne ou Conrad, soit contemporains tels que le poète Michael
18 J. Roubaud, La Boucle, op. cit., p. 266-267. C’est Roubaud qui souligne.
19 Arthur Lubow, « Crossing Boundaries », in Lynne Sharon Schwartz (dir.), The Emergence of
Memory : Conversations with W. G. Sebald, New York, Seven Stories Press, 2007, p. 162 (je
traduis).
20 W. G. Sebald, Les Émigrants : quatre récits illustrés [1992], trad. de l’allemand par Patrick
Charbonneau, Arles, Actes Sud, 1999 ; Les Anneaux de Saturne [1995], trad. de l’allemand
par Bernard Kreiss, Arles, Actes Sud, 1999 ; Vertiges [1990], trad. de l’allemand par Patrick
Charbonneau, Arles, Actes Sud, 2001 ; et enfin Austerlitz [2001], trad. de l’allemand par
Patrick Charbonneau, Arles, Actes Sud, 2002.
Modernites34.indd 178 19/09/12 11:19
Entre humeur et émotion : la mélancolie mobile de Jacques Roubaud et W. G. Sebald 179
Hamburger, en qui Sebald voit un alter ego21. La diction des narrateurs
secondaires et des personnages réfringents ne se différenciant pas
de celle du narrateur principal, une même tonalité élocutoire circule
d’un sujet à l’autre et, avec elle, l’humeur qu’elle porte. La prégnance
de celle-ci tient donc d’abord à la structure emboîtée du récit. Par
ailleurs, tout adonné à l’aléa que se dise Sebald, ses récits apparaissent
comme une galerie de personnages obsessionnels, acharnés à quelque
unique projet, ou collectionneurs invétérés. Une figure emblématique
en est le médecin et naturaliste Thomas Browne, récurrent dans Les
Anneaux de Saturne, et dont Sebald cite sur quatre pages le contenu,
largement imaginaire et hétéroclite, du Musœum clausum22. Or, comme
Browne, le narrateur de Sebald aime à inventorier. Si, ainsi que le
dit Jean Clair, « [c]ollectionner et un passe-temps mélancolique23 »,
l’humeur saturnienne se répercute, sans se désigner, entre l’obsession
des personnages et la texture du récit.
L’humeur, donc, peut avoir part à la méthode ou à la facture du
récit, sans être nommée. Dans l’espace du texte, elle forme ce que
Matthew Ratcliffe, partant de la conception heideggérienne de la
Stimmung, appelle « la structure de fond de l’intentionnalité », que
« présuppose la possibilité d’émotions intentionnellement dirigées24 ».
Les humeurs, ajoute Ratcliffe, « constituent les divers moyens par
lesquels nous pouvons faire l’expérience des choses comme nous
important25 ». L’obsession, à quelque niveau qu’elle opère, révèle ce
qui importe ; l’humeur qui s’y attache manifeste ainsi la modalité
affective de l’expérience des choses ; mélancolique, elle les constate ou
les anticipe abolies.
Méthode emballée et inventaire débridé correspondent en effet
l’un et l’autre à l’effort, vaincu d’avance, pour recenser le passé, en
retenir des fragments. Pour Roubaud comme pour Sebald, le récit
est un acte de mémoire. Et pour l’un et l’autre, celui-ci est lié à la
21 Ces divers fragments de vies étant présentés « comme de simples échantillons de ce qui advient
dans le monde », selon la formulation de Benjamin, « dans le conteur, la figure du chroniqueur
s’est conservée ». Walter Benjamin, « Le conteur » [1936], trad. de l’allemand par Maurice de
Gandillac, revue par Pierre Rusch, in Œuvres III, Paris, Gallimard, coll. « Folio-essais »,
2000, p. 132-133.
22 W. G. Sebald, Les Anneaux de Saturne, op. cit., p. 351-354.
23 Jean Clair, « La mélancolie du savoir », in id. (dir.), Mélancolie : génie et folie en Occident,
Paris, RMN-Gallimard, 2005, p. 202.
24 Matthew R atcliffe, « The Phenomenology of Mood and the Meaning of Life », in Peter G oldie
(éd.), The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion, Oxford, Oxford University Press,
2009, p. 350.
25 Ibid., p. 355.
Modernites34.indd 179 19/09/12 11:19
180 élisabeth Cardonne-Arlyck
destruction. Pour Roubaud, ce qui fut détruit en amont, c’est d’abord
le jardin d’enfance, hortus conclusus dont le donjon de la méthode
serait la figure inversée ; mais, en aval, le récit détruit aussi ce qu’il
capte du passé ; en fixant le souvenir, il en oblitère l’émotion, il le
transforme en simulacre. Il efface en conservant. L’émotion perdue,
reste l’humeur de cette perte, la mélancolie. Pour Sebald, qui songeait
avant sa mort accidentelle en 2001 à focaliser son prochain récit sur
son enfance bavaroise, le passé est irrémédiablement contaminé par
le silence maintenu en Allemagne après la guerre – non seulement sur
les atrocités causées par les nazis, mais sur la destruction des villes
par les Alliés. Le récit est obligatoire ; il vise à rendre visibles les
marques de destruction que l’observateur attentif découvre, par orbes
concentriques, à travers l’histoire et les continents. Les « anneaux de
Saturne » sont de tels orbes, inéluctablement mélancoliques.
Pour Roubaud, donc, la destruction de la mémoire est un effet induit,
mais sombrement délibéré et analysé, du récit ; pour Sebald, elle en
est le mobile affectif et l’impératif moral. Cette différence essentielle
a un impact sur la tonalité émotionnelle de leurs récits respectifs.
Même lorsqu’elle décrit deuil profond ou mélancolie, la voix narrative
du ‘grand incendie de Londres’ maintient une certaine sobriété, un
certain détachement. Jamais dite, l’émotion est inférée ; c’est un effet
de lecture, qui tient au décalage, précisément, entre le ton retenu et
l’objet de la description : c’est le manque, et la basse continue de la
mélancolie sous-jacente, qui engagent l’imagination. Chez Sebald, au
contraire, la pluralité narrative va de pair avec l’extrême ductilité
d’affects intenses qui circulent parmi les personnages, les choses et
les lieux, entre humeur, émotion et sensation : c’est la mobilité et la
porosité des affects qui pénètrent l’imagination.
4. Jacques Roubaud : le récit, objet perdu de la mélancolie
Selon Michel Vanni, reprenant à son tour la conception
heideggérienne, l’humeur ne se perçoit qu’en crise : « Si nous voulons
parler d’orientation de l’action par la Stimmung, nous devons alors
dire que cette orientation ne se révèle et ne devient lisible, que dans le
moment de crise. Le plus souvent, l’arrière-fond humoral n’apparaît
pas, n’est pas lisible, et ceci pour le personnage comme pour le
lecteur26. » De fait, La Bibliothèque de Warburg comme Les Anneaux
de Saturne ont pour impulsion première une crise de mélancolie.
26 Michel Vanni, « Stimmung et identité narrative », Vox Poetica, http ://www.vox-poetica.org/t/
pas/vanni2.html ; mis en ligne le 10 novembre 2005 ; consulté le 19 mai 2012.
Modernites34.indd 180 19/09/12 11:19
Entre humeur et émotion : la mélancolie mobile de Jacques Roubaud et W. G. Sebald 181
La Bibliothèque de Warburg, cinquième branche du ‘grand
incendie de Londres’, débute sur la relation d’une descente à pied
du Mississippi, accomplie par Roubaud en 1976, soit plus de vingt
ans auparavant. Partant in medias res, lors d’une tornade dans le
Minnesota, Roubaud revient ensuite en arrière, pour présenter les
préparatifs du voyage. Puis vient la question, au paragraphe suivant :
« Soit. Mais pourquoi ? pourquoi partir ? pourquoi ainsi, et là ? »
Je cite le début de la réponse, qui s’étend sur les deux paragraphes
suivants, soit huit pages :
J’étais, c’est vrai, cette année-là, fort sombre. J’étais seul. Cela ne suffit pas.
Seul, je le suis généralement. Je peux, selon les jours, être seul heureusement,
efficacement ; selon les autres platement ; ou pire. Car être seul tantôt rend
ivre : ivresse d’un temps entier disponible, à employer, à rendre intense, à
concentrer en méditations, en labeurs, à occuper sans distraction, sans hési-
tations, d’un seul tenant […] ; il y a tant à faire ; tantôt, au contraire, sans
qu’il soit possible d’identifier le pourquoi de cette bascule dans le contraire
fébrile d’un emploi du temps, être seul rend sobre : il y a soudain trop de
temps qu’il ne faudrait pas gaspiller, pas assez de temps pour ne pas le dépen-
ser à vide, trop de moyens possibles de le rendre plein. Il y a maintenant
beaucoup trop de manières de ne pas remplir les heures qu’il ne faudrait pas
laisser s’évanouir. C’est un temps désemployé, vacant 27.
La mélancolie, que Roubaud ne nomme que deux pages plus
loin, vous tombe dessus, venue d’on ne sait où. Roubaud, comme les
philosophes, la définit d’abord par son opposé, non pas affectif, mais
pratique : « le contraire fébrile d’un emploi du temps ». C’est un état
physique d’asthénie fiévreuse, qu’accompagne une sorte de démence de
la relation au temps : il ne faudrait pas le gaspiller parce qu’on en a
trop, on le perd parce qu’on n’en a pas assez ou parce qu’on a trop de
possibilités d’en faire quelque chose et trop de façons de n’en rien faire.
L’accumulation de paradoxes conjoignant excès et défaut traduit l’état
de crise et la difficulté à situer la mélancolie. Comme la folie, celle-ci
vous désaccorde avec ce qui est, pour Roubaud, un principe de survie :
l’activité de l’esprit en prise avec ce qu’il appelle le « temps réel », c’est-
à-dire le temps du calendrier et des horloges, temps des nombres et de
la mesure. Marquage des dates et des heures, rituel des anniversaires
et programme journalier, les nombres non seulement rythment le
temps vécu, mais, comme dans La Vie mode d’emploi, de Georges
Perec, génèrent et règlent le récit. Assailli par l’humeur, le sujet sort
de la mesure. Il a, dit Roubaud, « cessé d’être accordé au temps. Or on
peut cesser d’être en temps réel non seulement un peu, ou beaucoup,
27 J. Roubaud, La Bibliothèque de Warburg, op. cit., p. 12.
Modernites34.indd 181 19/09/12 11:19
182 élisabeth Cardonne-Arlyck
mais passionnément, à la folie28 ». Plonger, en somme – à l’instar des
personnages de la nouvelle de Borges, « Tlön, Uqbar, Orbis Tertius » –,
dans un univers parallèle, où le temps est radicalement autre.
Lorsque l’humeur est nommée, elle qualifie non le narrateur, mais
les fêlures du plafond. La menace de s’écrouler se projette moins du
sujet sur le milieu qui l’entoure qu’elle ne semble provenir de celui-ci :
Ce sont les temps que je nommerai les temps du plafond. Le plafond est paral-
lèle à homme couché. Il a ses paysages offerts à la délectation morose ; forte-
ment couturés de lignes visibles et invisibles, de craquelures géographiques,
de méandres mélancoliques, marqués, peints à l’à quoi bon 29.
Dans sa traduction de l’Ecclésiaste, Sous le soleil : Vanité des
vanités, Jacques Roubaud écrit que « [l]’Ecclésiaste est le livre de
l’“à quoi bon”, du deuil, de la tentation mélancolique, de la spirale
suicidaire30 ». Sous l’apparence désinvolte d’un haussement d’épaules,
la formule « à quoi bon », récurrente à travers l’œuvre de Roubaud,
désigne pour lui un continuum redoutable, qui inclut le suicide de
son jeune frère en 1961. En déplaçant sur le plafond la mélancolie et
le sentiment de la vanité de toutes choses, Roubaud pose à distance
une relation au monde qui n’est pas pour lui sans danger ni gravité.
Alors que, dans l’œuvre de Sebald, tout être, tout lieu ou toute chose
peuvent exsuder la mélancolie, Roubaud circonscrit celle-ci en double
démoniaque et indépendant de la conscience : c’est le « démon bicolore
du plafond (noir et blanc, la couleur photographique : noir des pensées
noires qui se broient, blanc des vacances de l’espoir) 31 ». « [J]e ne crois
pas être mélancolique », affirme-t-il d’ailleurs32. La mélancolie n’est
pas pour lui un tempérament, mais une situation.
Pas de pathos immédiat de la mélancolie, donc, mais une description
aiguë des perturbations qu’elle cause dans la relation au temps. En
parallèle, cependant, le suicide de son frère (dont Roubaud révèle les
circonstances par bribes successives d’une branche à l’autre du ‘grand
incendie de Londres’) – ce suicide, de par les réticences mêmes qui
l’enserrent, pèse sourdement sur la narration, comme un secret étouffé,
qu’on ne peut déplier que peu à peu. Quoique de manière plus limitée que
les écrits de Sebald, le cycle du ‘grand incendie de Londres’ est lui aussi
issu du silence et de la destruction qu’il recouvre. À la fin du premier
28 Ibid., p. 13.
29 Ibid., p. 14. C’est Roubaud qui souligne.
30 J. Roubaud, Sous le soleil : Vanité des vanités, Paris, Bayard, 2004, p. 11.
31 Id., La Bibliothèque de Warburg, op. cit., p. 18.
32 Id., Le Grand Incendie de Londres, op. cit., p. 370.
Modernites34.indd 182 19/09/12 11:19
Entre humeur et émotion : la mélancolie mobile de Jacques Roubaud et W. G. Sebald 183
chapitre de La Bibliothèque de Warburg, une incise nous apprend que,
en entreprenant de descendre le Mississippi, Roubaud comptait user
des heures de marche pour mettre au point, « non seulement de manière
statique, mais dans son mouvement33 », le plan du projet extrêmement
ambitieux, exigeant des années de préparation et d’exécution, qu’il avait
conçu peu après la mort de son frère en 1961 et qui devait conjoindre
poésie, mathématique et roman. Or ce projet, qu’il appelle « le Grand
Tout, ou BIG TOO34 », nous savons depuis l’Avertissement qui introduit
la première branche, Le Grand Incendie de Londres, qu’il ne fut jamais
réalisé, et que le cycle de prose est issu de cet échec, dont il narre les
différentes étapes. Je cite le début de cet Avertissement, rédigé en
octobre 1978, soit deux ans après la descente du Mississippi :
En traçant aujourd’hui sur le papier la première de ces lignes de prose (je les
imagine nombreuses), je suis parfaitement conscient du fait que je porte un
coup mortel, définitif, à ce qui, conçu au début de ma trentième année comme
alternative à la disparition volontaire, a été pendant plus de vingt ans le pro-
jet de mon existence35.
De cette phrase mélancolique est issu pour nous le cycle de prose
tout entier, dans les centaines de pages de ses sept volumes. Certes, la
narration, sombre ou allègre selon le sujet, change également de tonalité
en son long cours : le premier volume est marqué par la mort d’Alix
Cléo, la jeune épouse de Roubaud, en 1983, soit trente mois avant que
celui-ci n’entreprenne son œuvre de prose ; le dernier volume disperse
sereinement l’entreprise par l’émiettement systématique du récit. Mais
toute phrase liminaire influence jusqu’au bout notre lecture. Quelque
distancée, donc, ou amusée que s’avère la narration du ‘grand incendie
de Londres’, et comiques certains épisodes, notre lecture demeure
sous l’influence sourde du « coup mortel, définitif » qu’annonce
l’Avertissement – sous le coup d’une fin volontaire. En qualifiant ainsi
de « coup mortel » l’abandon du projet, Roubaud déplace sur la création
littéraire la mort volontaire, dont il enraye la tentation, désormais logée
dans le passé. Mais, en entreprenant de raconter l’échec du projet, qu’il
qualifie rétrospectivement de « magma mégalomane36 », il maintient
présente l’alternative entre suicide et création, et, par là, réaffirme tout
ensemble l’importance vitale qu’a pour lui la littérature, et l’horizon
mortel sur lequel ouvre la mélancolie.
33 Id., La Bibliothèque de Warburg, op. cit., p. 39.
34 Ibid. C’est Roubaud qui souligne.
35 J. Roubaud, Le Grand Incendie de Londres, op. cit., p. 7.
36 Id., La Bibliothèque de Warburg, op. cit., p. 40.
Modernites34.indd 183 19/09/12 11:19
184 élisabeth Cardonne-Arlyck
Celle-ci, écrit le psychanalyste Pierre Fédida en se démarquant de
Freud, « est moins la réaction régressive à la perte de l’objet que la capacité
fantasmatique (ou hallucinatoire) de le maintenir vivant comme objet
perdu37 ». C’est là exactement (maintenir vivant comme objet perdu) ce
qu’accomplit le cycle du ‘grand incendie de Londres’. En reprises spiralées
de branche en branche, le récit confère à cet objet perdu qu’est le projet,
poursuivi pendant dix-sept ans avant d’être finalement abandonné, la
consistance fictive de sa longue description. Au fil des livres, cependant,
et du temps, le projet, en tant que fiction désirable et perdue, a changé :
[A]u commencement de l’écrire, je n’ignorais pas que l’effort d’élucidation
auquel j’allais me livrer (et longuement ; j’ai su tout de suite qu’il serait long)
allait mettre en jeu plus qu’une délinéation de ruines. J’allais raconter, mais
aussi reconstituer d’une manière imaginative. C’est dire que la démarche
serait apparentée à celle du roman, à celle de la fiction38.
Reconstitué « d’une manière imaginative », le projet renoncé est
bien, comme l’objet perdu de la mélancolie, maintenu vivant. Mais
l’effort d’élucidation qui anime cette reconstitution fictive va bien au-
delà du projet lui-même, en cercles concentriques. Il englobe l’histoire
du narrateur et de sa famille, ainsi que, dans la mesure où elles se
recoupent, l’histoire du pays : la Résistance, à laquelle le père et la grand-
mère de Roubaud participèrent de façon éminente, le communisme
de l’après-guerre, la guerre d’Algérie, le réseau Jeanson, et les essais
nucléaires au Sahara. Plus largement, la composition de ce « Mémoire »
personnel vise à formuler un « Traité de la faculté de mémoire39 ».
Partis de l’élucidation d’une crise de mélancolie, nous voici parvenus à
l’élucidation du fonctionnement de la mémoire, mélancolique lui aussi.
À travers et par-delà les passes noires qu’analyse le narrateur,
la mélancolie s’avère ainsi constituer le moteur profond du récit. Le
mélancolique, écrit Marie-Claude Lambotte, « hanté par la perspective
de l’inaccomplissement de toutes choses, plutôt que de s’abandonner
à l’inertie fatale, s’adonne au contraire corps et âme aux entreprises
humaines, en les intégrant à des systèmes de plus en plus complexes,
autre manière de pallier la répétition de l’impuissance originelle40 ».
Les Essais de Montaigne, l’encyclopédique Anatomie de la mélancolie
de Robert Burton (dont Sebald dit qu’il « s’est installé sa vie durant
dans la mélancolie comme dans une maison41 ») furent ainsi entrepris
37 Pierre F édida, L’Absence, Paris, Gallimard, 1978, p. 65-66.
38 J. Roubaud, La Bibliothèque de Warburg, op. cit., p. 41. C’est Roubaud qui souligne.
39 Ibid., p. 40.
40 Marie-Claude L ambotte, Esthétique de la mélancolie, Paris, Aubier, 1984, p. 8.
41 W. G. Sebald, Campo Santo, op. cit., p. 118.
Modernites34.indd 184 19/09/12 11:19
Entre humeur et émotion : la mélancolie mobile de Jacques Roubaud et W. G. Sebald 185
comme ressources contre l’humeur noire. Si, pour Roubaud, la
mélancolie fut ce qui présida à l’élaboration d’un projet toujours plus
complexe et de moins en moins réalisable, et, par là, ce qui mena à son
inévitable ruine, elle constitue aussi la force de résistance qui continue
de faire vibrer cette ruine en la représentant. « [L]a mélancolie, dit
Giorgio Agamben dans Stanze, ne parvient à s’approprier son objet
que dans la mesure où elle en affirme la perte42. » « De toute façon,
déclare Roubaud du ‘grand incendie de Londres’, c’est un tombeau43. »
5. W. G. Sebald : la mélancolie est-elle endogène ou exogène ?
Dans Les Anneaux de Saturne comme dans La Bibliothèque de
Warburg, un voyage à pied, entrepris pour sortir d’un accès de vacuité,
donne son impulsion à la narration. Celle-ci commence en ces termes :
En août 1992, comme les journées du Chien approchaient de leur terme, je
me mis en route pour un voyage à pied dans l’est de l’Angleterre, à travers le
comté de Suffolk, espérant parvenir ainsi à me soustraire au vide qui gran-
dissait en moi à l’issue d’un travail assez absorbant44.
Bien que Sebald ne s’y attarde pas, la séquence effort intellectuel
– vide intérieur – voyage à pied esquisse un scénario proche de celui
décrit par Roubaud. Mais l’attitude des narrateurs vis-à-vis des
circonstances – et donc celle à laquelle ils invitent leur lecteur – diffère
radicalement : l’humour de Roubaud, qui désamorce le pathos, est
clair et fiable ; celui de Sebald, qui renchérit sur le drame, est sombre
et désarçonnant. Ainsi la tornade que Roubaud décrit au tout début
de sa descente du Mississippi passe-t-elle rapidement sans le moindre
dommage, alors que les étranges « journées du Chien » lors desquelles
a lieu la randonnée dans le Suffolk nous engagent d’emblée dans le
monde des signes néfastes, le monde de Saturne. Le souvenir de la
liberté euphorique d’une marche solitaire vire rapidement au noir :
[…] l’antique superstition selon laquelle certaines maladies de l’esprit et du
corps s’enracineraient en nous de préférence sous le signe du Chien m’appa-
raît aujourd’hui plus que justifiée. Par la suite, en effet, je ne fus pas seule-
ment aux prises avec le souvenir d’une belle liberté de mouvement mais aussi
avec celui de l’horreur paralysante qui m’avait saisi à plusieurs reprises en
constatant qu’ici également, dans cette contrée reculée, les traces de la des-
truction remontaient au plus lointain passé 45.
42 Giorgio Agamben, « L’objet perdu », in Stanze : parole et fantasme dans la culture occidentale,
trad. de l’italien par Yves Hersant, Paris, Payot, Rivages, 1994, p. 38.
43 J. Roubaud, Le Grand Incendie de Londres, op. cit., p. 183.
44 W. G. Sebald, Les Anneaux de Saturne, op. cit., p. 13.
45 Ibid.
Modernites34.indd 185 19/09/12 11:19
186 élisabeth Cardonne-Arlyck
Si nous ne sommes pas invités à croire aux maléfices du signe du
Chien, nous le sommes au contraire à prendre au sérieux « l’horreur
paralysante » qui affecte le narrateur et, à travers elle, la destruction
qui la cause. Comme Justine, la protagoniste du film de Lars von
Trier, Melancholia, le narrateur de Sebald est un lecteur de signes ou,
plus exactement, un capteur ultra-sensible d’une destruction partout
présente. Qu’il traverse le Suffolk, comme dans Les Anneaux de Saturne,
qu’il voyage de Vienne à Venise et Vérone, comme dans Vertiges, ou aux
Pays-Bas et en Belgique, comme dans Austerlitz, le narrateur est assailli
par les marques de désastres accumulés au cours des âges, désastres
naturels, mais surtout désastres dus à la violence humaine.
La destruction qui affecte le narrateur de Sebald n’est pas celle d’un
projet individuel, fût-il vital, comme dans ‘le grand incendie de Londres’,
ou celle qui guette chacun de nous, mais celle de l’histoire humaine tout
entière, dans la suite de ses atrocités. Là où Roubaud met à distance
et analyse une expérience interne, Sebald éprouve et internalise une
situation externe. Et cela intensément. Il poursuit en effet ainsi :
Et c’est peut-être pour cette raison qu’une année jour pour jour après le début
de mon voyage, je me trouvai dans l’incapacité quasi totale de me mouvoir, si
bien qu’il fallut me transporter à l’hôpital de la capitale régionale, Norwich,
où j’entrepris, du moins en pensée, de rédiger les pages qui suivent46.
Sebald, comme Roubaud, porte aux dates une attention extrême.
Pour celui-ci, elles rythment le temps en configurations signifiantes.
Pour celui-là, les coïncidences de dates relient entre eux, de façon
mystérieuse et parfois alarmante, des événements distants dans l’espace
ou le temps, sans rapport causal avéré, mais que leur rapprochement
même dote de force convaincante. Ainsi la connexion entre quasi-
paralysie et spectacle répété de la destruction est-elle implicitement
confirmée par l’exacte correspondance de dates : « une année jour pour
jour ». Et malgré le scrupule que marque « peut-être », la connexion
s’impose. Ce qui la sous-tend, en effet, c’est, selon les termes de Sebald,
« la question qui en dernier ressort ne peut pas […] être tranchée sur
le plan clinique : la mélancolie est-elle un état endogène ou exogène47 ? ».
Si elle est exogène, ses symptômes, tels que la paralysie qui affecte le
narrateur un an après son excursion dans le Suffolk, ou l’acedia qui
détruit graduellement le protagoniste éponyme d’Austerlitz, ainsi que
le Dr Henry Selwyn, Paul Bereyter et Ambros Adelwarth dans Les
Émigrants, – ces symptômes témoignent d’un mal social profond qu’il
46 Ibid., p. 13-14.
47 Id., Campo Santo, op. cit., p. 114.
Modernites34.indd 186 19/09/12 11:19
Entre humeur et émotion : la mélancolie mobile de Jacques Roubaud et W. G. Sebald 187
s’agit de désigner pour pouvoir y résister. En accueillant dans ses récits
les voix et les vies de personnages mélancoliques, souvent exilés par la
guerre ou l’oppression, Sebald multiplie les êtres et les circonstances à
travers lesquels s’atteste le caractère exogène de la mélancolie, et son rôle
de révélateur historique. « Car il n’est pas de témoignage de culture, dit
Benjamin, qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie48. »
Avant que la crise de mélancolie ne terrasse le narrateur, la
destruction et la perte irrémédiable qui en sont cause le frappent à
coups répétés au cours de sa marche. Elles le saisissent avec la force
et la soudaineté d’une émotion, qui déstabilise la relation de son corps
au lieu et au moment. L’espace ou la durée semblent se distendre, se
rétrécir, ou s’abolir sous ses yeux, en un accès d’inquiétante étrangeté.
Du fait que pareils accès sont imprévisibles et peuvent survenir
inexplicablement à tout moment de la narration, le lecteur se trouve
un peu devant le récit comme devant un compagnon énigmatique,
dont on guette des réactions qu’on ne comprend pas tout à fait. Étant
donné, par ailleurs, que ces accès sont éphémères et relatés au passé
par un narrateur qui maîtrise de bout en bout un récit formellement
très sophistiqué, le lecteur est aussi invité à porter sur eux le regard
d’un observateur sympathique, parfois même amusé. Semblables
impressions d’inquiétante étrangeté apparaissent souvent au début
des récits. Ainsi, lorsque le narrateur des Anneaux de Saturne est
hospitalisé, il est pris par le désir impérieux de s’assurer que la réalité
extérieure ne s’est pas « évanouie à jamais ». Il poursuit ainsi :
[À] la nuit tombante, [ce désir] devint si fort qu’après avoir réussi à me glis-
ser par-dessus le bord du lit, moitié à plat ventre, moitié sur le flanc et, une
fois au sol, à rejoindre le mur à quatre pattes, je me redressai malgré les
douleurs que cela me causait, me hissant à grand-peine, cramponné à l’appui
de fenêtre. Dans la posture crispée d’une créature qui vient d’adopter pour
la première fois la station debout, je me tins ensuite contre la vitre et ne pus
m’empêcher de songer à la scène dans laquelle le pauvre Gregor, s’agrippant
de ses petites pattes tremblantes au dossier de son siège, regarde par la fe-
nêtre de sa chambre […] 49.
Et comme le personnage de Kafka, le narrateur ne reconnaît
pas la ville pourtant familière qui s’étend sous ses yeux. Présentée
comme une pensée irrépressible (« je ne pus m’empêcher de songer »),
la comparaison avec le protagoniste de La Métamorphose colore la
précision gestuelle du pathétique froid et de l’inquiétante étrangeté
48 W. Benjamin, « Sur le concept d’histoire » [1940], trad. de l’allemand par Maurice de
Gandillac, revue par Pierre Rusch, in Œuvres III, op. cit., p. 433.
49 W. G. Sebald, Les Anneaux de Saturne, op. cit., p. 14-15.
Modernites34.indd 187 19/09/12 11:19
188 élisabeth Cardonne-Arlyck
propres à Kafka50. Celui-ci, que l’on retrouve sous les traits du Dr K.
dans Vertiges, fait partie de la galerie de mélancoliques qui peuplent les
récits, comme les faces et les voix multipliés d’une unique expérience,
variable, mais largement partagée51.
Sebald pousse donc bien plus loin que Roubaud la description des
affects, qui peuvent aller jusqu’à de véritables hallucinations. Ainsi,
dans Vertiges, le narrateur, parcourant Vienne des journées entières,
croit voir des personnes qu’il n’a pas rencontrées depuis des années
et dont certaines sont mortes, comme « le poète Dante, menacé du
bûcher et banni de sa ville52 » ; lorsque le narrateur presse le pas pour
le rattraper, le poète tourne une rue et disparaît. Malgré l’humour de
cette rencontre manquée, l’exil de Dante le range évidemment parmi
les figures d’opprimés mélancoliques. Et son apparition n’est pas sans
ressembler à ce que Benjamin appelle « la véritable image historique
dans son surgissement fugitif53 ».
*
La mélancolie, donc, rythme les récits de Jacques Roubaud et W.
G. Sebald, sur différents tempos. Les crises, aiguës mais espacées,
l’intensifient et la concentrent en expérience soudaine de l’humeur.
Moins dramatiques mais non moins efficaces, vocabulaire et figures la
diffusent à une autre allure au long des récits. Dans le cycle du ‘grand
incendie de Londres’, la récurrence des divers noms de l’humeur
noire, le retour répété de l’échec, la prégnance de la photographie,
explicitement liée à la mélancolie, forment une sorte de rythme
fondamental de l’humeur, que n’entament ni la litote, ni l’humour ; ils
la renforceraient plutôt. Dans Les Anneaux de Saturne, comme dans
les autres récits de Sebald, les narrateurs seconds et les personnages
épisodiques multiplient la parole et le ton mélancoliques, formant,
comme le récit de l’échec chez Roubaud, une sorte de basse continue.
50 Sebald parle du « regard aussi empathique que glacé » de Kafka. Id., Campo Santo, op. cit., p. 192.
51 Sa présence, au tout début du récit, montre aussi comment l’expérience même de la mélan-
colie est filtrée par la littérature – aussi bien d’ailleurs que par l’art, comme en font preuve,
entre maintes autres, la présence récurrente de La Leçon d’anatomie du docteur Tulp, de
Rembrandt, dans Les Anneaux de Saturne, l’évocation du peintre Frank Auerbach (renom-
mé Max Ferber) dans Les Émigrants, ou telles références, dans Austerlitz, aux Funérailles à
Lausanne, de Turner, et à L’Année dernière à Marienbad, d’Alain Resnais.
52 W. G Sebald, Vertiges, op. cit., éd. « Folio », 2003, p. 43.
53 W. Benjamin, « Sur le concept d’histoire », art. cité, p. 432. Sur la réflexion de Sebald sur l’his-
toire, et sa proximité avec la pensée de Benjamin, voir le livre de Muriel P ic, L’Image papillon,
suivi de W. G. Sebald, L’Art de voler, trad. de l’allemand avec Patrick Charbonneau, Dijon,
Les Presses du réel, 2009. Voir également Eric Santner, On Creaturely Life : Rilke, Benjamin,
Sebald, Chicago, University of Chicago Press, 2006.
Modernites34.indd 188 19/09/12 11:19
Entre humeur et émotion : la mélancolie mobile de Jacques Roubaud et W. G. Sebald 189
De plus, et contrairement à Roubaud, les accès brefs de trouble
perceptif créent, comme les émotions, des liens affectifs immédiats
entre le narrateur et l’environnement qu’il parcourt, soumis à la
destruction. Si donc l’humeur importe et nous affecte dans les livres
de Roubaud et de Sebald, c’est pour son caractère obsessionnel même.
Sebald, dans son refus de détourner son regard de la destruction,
Roubaud, dans sa persistance à reconstruire un projet sur ses échecs,
manifestent des manières de résistance qui, en elles-mêmes, sont
sombrement revigorantes. Le mélancolique, comme l’a vu Freud et
comme Sebald le dit de Kafka, a la capacité de contempler sans ciller
la réalité. L’obsession qui la caractérise peut être un mode de rythme,
quand l’écriture ou le travail artistique lui confèrent une forme.
Élisabeth Cardonne-Arlyck
Vassar College
Bibliographie
Agamben, Giorgio, Stanze : parole et fantasme dans la culture occidentale,
trad. de l’italien par Yves Hersant, Paris, Payot, Rivages, 1994.
A ltieri, Charles, The Particulars of Rapture : An Aesthetics of the Affects,
Ithaca, Cornell University Press, 2003.
Benjamin, Walter, « Le conteur » [1936], trad. de l’allemand par Maurice de
Gandillac, revue par Pierre Rusch, in Œuvres III, Paris, Gallimard, coll.
« Folio-essais », 2000, p. 114-151.
—, « Sur le concept d’histoire » [1940], trad. de l’allemand par Maurice de
Gandillac, revue par Pierre Rusch, ibid., p. 427-443.
Clair, Jean, « La mélancolie du savoir », in id. (dir.), Mélancolie : génie et
folie en Occident, Paris, RMN-Gallimard, 2005, p. 202-208.
Fédida, Pierre, L’Absence, Paris, Gallimard, 1978.
Goldie, Peter, The Emotions : A Philosophical Exploration, Oxford,
Clarendon Press, 2000.
L ambotte, Marie-Claude, Esthétique de la mélancolie, Paris, Aubier, 1984.
Lubow, Arthur, « Crossing Boundaries », in Lynne Sharon Schwartz (dir.),
The Emergence of Memory : Conversations with W. G. Sebald, New York,
Seven Stories Press, 2007.
Musil, Robert, L’Homme sans qualités [1930-1932], trad. de l’allemand par
Philippe Jaccottet, et par Jean-Pierre Cometti et Marianne Rocher-Jacquin
pour les textes nouveaux, Paris, Éd. du Seuil, 2004, 2 vol.
Pic, Muriel, L’Image papillon, suivi de W. G. Sebald, L’Art de voler, trad.
de l’allemand avec Patrick Charbonneau, Dijon, Les Presses du réel, 2009.
Pigeaud, Jackie, De la mélancolie : fragments de poétique et d’histoire,
Paris, Dilecta, 2005.
Modernites34.indd 189 19/09/12 11:19
190 élisabeth Cardonne-Arlyck
R atcliffe, Matthew, « The Phenomenology of Mood and the Meaning
of Life », in Peter Goldie (éd.), The Oxford Handbook of Philosophy of
Emotion, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 347-371.
Rosfort, René et Stanghellini, Giovanni, « The Person Between Moods and
Affects », Philosophy, Psychiatry, Psychology, vol. 13, no 3, septembre 2009,
p. 251-266.
Roubaud, Jacques, La Fleur inverse : essai sur l’art formel des troubadours,
Paris, Ramsay, 1986.
—, Le Grand Incendie de Londres : récit, avec incises et bifurcations, 1985-
1987, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Fiction & Cie », 1989.
—, La Boucle, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Fiction & Cie », 1993.
—, Mathématique : récit, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Fiction & Cie », 1997.
—, Poésie : récit, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2000.
—, La Bibliothèque de Warburg : version mixte, Paris, Éd. du Seuil, coll.
« Fiction & Cie », 2002.
—, Sous le soleil : Vanité des vanités, Paris, Bayard, 2004.
—, Impératif catégorique : récit, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2008.
—, La Dissolution, Caen, Nous, 2008.
Santner, Eric, On Creaturely Life : Rilke, Benjamin, Sebald, Chicago,
University of Chicago Press, 2006.
Sebald, W. G., Vertiges [Schwindel, Gefühle, 1990], trad. de l’allemand par
Patrick Charbonneau, Arles, Actes Sud, 2001.
—, Les Émigrants : quatre récits illustrés [Die Ausgewanderten, 1992], trad.
de l’allemand par Patrick Charbonneau, Arles, Actes Sud, 1999.
—, Les Anneaux de Saturne [Die Ringe des Saturns, 1995], trad. de
l’allemand par Bernard Kreiss, Arles, Actes Sud, 1999.
—, Austerlitz [2001], trad. de l’allemand par Patrick Charbonneau, Arles,
Actes Sud, 2002.
—, Campo Santo [2003], trad. de l’allemand par Patrick Charbonneau et
Sibylle Muller, Arles, Actes Sud, 2009.
Starobinski, Jean, La Mélancolie au miroir : trois lectures de Baudelaire,
Paris, Julliard, 1989.
Vanni, Michel, « Stimmung et identité narrative », Vox Poetica, http ://
www.vox-poetica.org/t/pas/vanni2.html ; mis en ligne le 10 novembre 2005 ;
consulté le 19 mai 2012.
Modernites34.indd 190 19/09/12 11:19
La critique : ou Les stratégies de l’émotion
Mouvement, force, masse, sortie hors de soi : si émotion et
puissance1 se répondent et offrent une symétrie bien commode autour
du rapport passif/actif aux affects (en subir : être assujetti, ou en
provoquer : être sujet), elles s’opposent aussi très exactement sur
quelques-uns de nos binômes existentiels : féminin/masculin, affect/
raison, sujet/objet, nature/culture. L’articulation de l’émotion avec la
dyade passion-raison en dérive directement : soit l’émotion est vécue
comme dangereuse et incontrôlable, soit elle rend libre et symbolise la
vie. Le critique, quant à lui, joue sur les deux tableaux : profitant du
pouvoir du langage et du discours, il se sert à la fois de ses émotions de
lecture et de sa raison critique. Il stigmatise ainsi la littérature (son
pouvoir et ses modalités opératoires), peut-être même stéréotypise-t-
il certaines de ses postures, révélant la façon dont elle exacerbe ses
effets. Non seulement la critique utilise un certain type d’émotions
pour parvenir à ses fins, mais elle profite de ce désir toujours latent
d’institutionnalisation des émotions de lecture. Envisager l’interaction
de l’émotion et de la puissance en littérature par le prisme de la
1 Capacité à être affecté (trouble ou agitation passagère causée par la surprise, la peur la joie…),
l’émotion est mouvement et, par son étymologie commune avec l’émeute, dynamique collective.
La puissance, selon Aristote, est possibilité pour une chose d’être ou de ne pas être, d’être
quelque chose ou autre chose : « On appelle “puissance” le principe du mouvement ou du
changement qui est dans un autre être ou dans le même en tant qu’autre. […] C’est aussi la
faculté d’être changé ou mû par un autre être, ou par soi-même en tant qu’autre » (A ristote,
Métaphysique, Δ, 12, trad. et notes par Jean Tricot, Paris, J. Vrin, 1991, t. I, p. 191). La puis-
sance, du point de vue contemporain, renvoie au pouvoir de commander, de dominer, et à sa
propre capacité à imposer son autorité.
Modernites34.indd 191 19/09/12 11:19
192 Frédérique Toudoire-Surlapierre
critique, c’est chercher à comprendre ce qui se joue chez ce lecteur
écrivant. La critique participe d’une stratégie sociale et culturelle
qui s’appuie sur des débordements émotionnels dont elle profite,
puisqu’elle en tire sa notoriété, ses valeurs et ses codes, par le biais
de toute une « politique de la représentation2 », pour reprendre une
expression de Louis Marin. La critique joue des effets de tribune – en
cela, elle s’apparente à une volonté de juridiction des émotions et à
une « rhétorique du contrôle3 », révélant d’une part à quel point le
langage est contraint (il subit ce pouvoir-là), d’autre part dans quelle
mesure il est le point de rencontre (la lutte) de l’émotion et de la
puissance. Toute une rhétorique du contrôle accompagnant le discours
des passions stigmatise cette confiscation du pouvoir que la critique
cherche à récupérer (donner son avis sur l’œuvre d’un autre est un
signe de puissance, mais aussi la reconnaissance d’une autorité) et
dont les querelles critiques sont l’un des symptômes exacerbés. Qu’un
livre fasse scandale signifie justement qu’on en parle plus qu’on ne
devrait. Symptômes fort stratégiques d’un débordement de paroles qui
révèle à la fois un surinvestissement et un déplacement des émotions,
les réactions affectives du critique (je commente un livre parce qu’il
m’a ému) se transforment parfois en puissance anticipatrice (je choisis
de parler d’un livre pour qu’il ait un impact sur les autres, et le simple
fait d’en parler n’est rien d’autre qu’une imitation préfigurative de
cet effet). La vérification de son pouvoir intellectuel est source de
plaisir pour elle, la critique exprime autant ce qu’elle a à dire que
son goût (sa satisfaction) d’en être arrivée là. Elle fait partie d’une
stratégie de répartition de la relation entre auteur et lecteur, dans
laquelle elle s’immisce comme « un tiers bien disant4 » (Julien Gracq),
plus ou moins gênant, puisqu’il crée une relation triangulaire qui ne
s’imposait pas d’emblée.
Il n’est guère surprenant, dès lors, que l’interaction de l’émotion et
de la puissance confère une telle place aux pulsions et aux fantasmes.
Plus encore, c’est cette relation triangulaire qui transforme l’émotion
en libido (c’est-à-dire en puissance érotique), par un investissement
pulsionnel dont on peut interroger la fonction et la valeur symbolique.
L’émotion se déclenche par les jeux de l’imagination et par les
anticipations qu’elle provoque, elle découle d’une représentation
2 Louis M arin, Politiques de la représentation, Paris, Kimé, 2005.
3 Vinciane Despret, Ces émotions qui nous fabriquent : ethnopsychologie de l’authenticité,
Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2001, p. 197.
4 Julien Gracq, En lisant, en écrivant, Paris, J. Corti, 1980, p. 178.
Modernites34.indd 192 19/09/12 11:19
La critique : ou Les stratégies de l’émotion 193
encouragée (excitée) par des fantasmes. Barthes et Doubrovsky n’ont
pas parlé fortuitement du « plaisir esthétique » de la critique, de ce
plaisir purement formel offert par la représentation de fantasmes qui,
selon Freud dans ses Essais de psychanalyse appliquée5, déguisent
ou recouvrent des jouissances moins avouables. Si l’émotion, la
sensualité, l’érotisme et la sexualité ont été investis comme autant de
modalités de la critique, le statut du désir et le pouvoir d’Éros dans
l’activité littéraire (ce que le désir fait lire) ne sont pas uniquement les
symptômes plus ou moins sublimés d’une relation maître/disciple. Il ne
suffit pas que Platon ait motivé (et utilisé) la puissance et la vitalité de
l’Éros dans l’acquisition de la connaissance. Soumis à la tentation des
pulsions, l’esprit n’a pas seulement affaire à lui-même, mais à quelque
chose qui ne semble pas être lui, qui le touche au plus profond de lui-
même et qui provient du corps. Sous l’emprise de ses pulsions, le moi
est poussé « vers quelque chose d’inconnu, sans avoir conscience de ce
qui le pousse ni aucun sentiment de l’objet de la pulsion6 » (Fichte).
La pensée tente alors de rationaliser la pulsion, en en faisant « une
attente nostalgique, tournée vers l’impossible, vers l’altérité7 ». En
cela, la pulsion ne relève jamais seulement de l’instinct, elle est le
produit d’une réflexion du moi sur lui-même8. Quelle est la nature du
désir critique ? Que peut la critique sur la littérature en termes de
pulsions et de raisons ? Que font interpréter les émotions, comment
font-elles lire, analyser le critique littéraire ? Que font-elles choisir ou
retenir, ou au contraire qu’empêchent-elles de comprendre et à quoi
empêchent-elles de réfléchir ? Dans quelle mesure l’émotion peut-elle
être « génératrice de pensée9 » (Bergson) ?
1. « Je le veux, je l’ordonne » (v. 369)
Si Britannicus (1669) est, de toute évidence, un objet de prédilection
de la critique, c’est que cette pièce en révèle le pouvoir par la
fascination qu’elle exerce. Elle est une formidable théâtralisation du
5 Voir notamment Sigmund F reud, « La création littéraire et le rêve éveillé » [1908], trad. de
l’allemand par Marie Bonaparte et M me E. Marty, in Essais de psychanalyse appliquée, Paris,
Gallimard, 1971, p. 69-81.
6 F ichte, Fondement du droit naturel [1796-1797], cité par Henry M aldiney, « Pulsion et pré-
sence » [1976], in Penser l’homme et la folie, 3e éd., Grenoble, Millon, 2007, p. 110.
7 Jean-Christophe G oddard, « Pulsion et réflexion chez Fichte. Une éthique pulsionnelle », in
id. (dir.), La Pulsion, Paris, J. Vrin, 2006, p. 40.
8 Ibid., p. 48.
9 Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion [1932], Paris, PUF, 1969,
p. 40.
Modernites34.indd 193 19/09/12 11:19
194 Frédérique Toudoire-Surlapierre
rôle de l’activité critique quand émotion et puissance se libèrent pour
s’affronter. Il n’est pas anodin que ce soit avec cette pièce que Racine
ait voulu rivaliser avec Corneille, choisissant de situer les affects dans
le champ des tragédies politiques. Corneille et Racine incarnent la
dualité d’un modèle occidental fondé sur la toute-puissance d’affects
que la volonté, la puissance et l’intellectualisation vont surmonter et
maîtriser (Corneille). La culture est la manière dont nous cultivons
nos émotions (elle les esthétise et les induit). Si l’émotion se caractérise
par des réactions physiologiques qui relèvent pour la plupart d’une
dépense énergétique, celle-ci est perçue comme problématique
quand son intensité et sa quantité entraînent une perte de contrôle,
autrement dit lorsqu’il existe un décalage pour le sujet entre ses
anticipations perceptives et cognitives et son répertoire de réponses
disponibles. Exprimer ses émotions est un acte social qui correspond
à une dramatisation des conduites. Depuis Platon, existe toute une
psychologie politique de la passion qui va de pair avec une culture
des émotions. Les culturaliser implique aussi qu’elles peuvent se
dénaturaliser. L’émotion garde en mémoire l’histoire au sein de laquelle
elle est s’est constituée. Le corps n’est pas l’unique herméneute des
émotions ; le contexte social (les événements impliqués dans la situation)
peut tout aussi bien l’être. L’authenticité des émotions renvoie donc à la
vocation culturelle de l’homme mais, sous la forme du contraste (accès
véridique à ce qui est vrai), elle renvoie à son contraire, le mensonge,
c’est-à-dire à la capacité et la propension de l’être humain à se leurrer.
Effet et construction d’un système sémiotique, l’analyse des émotions
permet d’interpréter les usages qu’une société en fait et les valeurs
qu’elle lui confère, deux formes de récupération, en quelque sorte,
de l’émotion par l’intellect qui retrouve ainsi sinon une mainmise
sur elle, du moins sa place auprès d’elle. La littérature réinvestit,
pour sa part, ces émotions sous la forme des passions, dont l’une des
expressions les plus archétypales, et probablement les plus rentables,
est le « crime passionnel », comme pour nous rassurer sur notre
capacité à commettre l’extrême (Racine). Les disputes et controverses
des critiques entre eux montrent bien que l’appropriation d’un texte
(en délivrant son sens) est une captation et un ravissement, autrement
dit une forme de pouvoir symbolique : le texte doit émouvoir, de
même que le critique doit emporter l’adhésion du public. Retenons
pour l’heure trois des motifs majeurs de la critique racinienne : le
ravissement (Doubrovsky), l’étonnement (Barthes) et la sidération
(Starobinski). Le propre du héros racinien, selon Roland Barthes,
consiste à s’autoriser à « convertir la passion en droit » ; « le rapport
Modernites34.indd 194 19/09/12 11:19
La critique : ou Les stratégies de l’émotion 195
d’autorité est extensif au rapport amoureux10 ». Néron représente la
fusion (confusion) de la passion et du pouvoir. Les premiers mots sur
scène de Néron sont des ordres : « Pour la dernière fois, qu’il s’éloigne,
qu’il parte,/ Je le veux, je l’ordonne » (v. 368-369) ; ils font écho à
Corneille faisant dire (sans complexe) à Auguste : « Je suis maître de
moi comme de l’univers ;/ Je le suis, je veux l’être » (Cinna, v. 1696-
1697), vers qui fascineront les critiques et les écrivains. Ce n’est pas un
hasard que Doubrovsky se soit tant attaché à la dialectique du héros
chez Corneille. Ce vers est emblématique de sa propre fascination
envers la toute-puissance de la volonté du héros cornélien, mais
également de sa propre démarche critique en tant que dé-monstration
du culte cornélien de la maîtrise, du fait que le héros cornélien confond
(subordonne) son existence à sa volonté et que sa nature héroïque tient
à cette évidente identification de l’être et du vouloir. Dès lors, le célèbre
conflit cornélien de la passion (qui est d’abord corporelle, l’émotion
ayant besoin du corps pour s’épancher) et de la volonté (qui dépend
de l’âme) est aussi une représentation théâtralisée de la puissance
émotionnelle de la littérature. Le théâtre du xviie siècle a mis l’émotion
au premier plan de sa scène, postulant tout un héritage de la purgation
des passions, qu’il s’évertue à maîtriser par un système de codification
théâtrale particulièrement contraignant. Britannicus concrétise et
sublime de façon exemplaire les enjeux esthétiques mais aussi moraux
d’un théâtre classique qualifié par l’émotion et la puissance : « Écrire
classique, c’est vouloir être en même temps l’agent d’une domination et
l’objet d’un amour11 », autrement dit, c’est unir la poétique au pouvoir.
« Commandez qu’on vous aime, et vous serez aimé » (v. 458) :
peu importe, sans doute, que ce conseil de Narcisse à Néron soit si
démesurément improbable, il ne peut que réjouir le public, tant il
satisfait simultanément chez lui son désir de pouvoir et sa demande
d’amour, se faisant gratification érotique et dessein politique. Mais ces
deux conjonctions privent aussi le sujet de sa liberté ; il ne peut plus
choisir, puisqu’il lui faut les deux : « il n’y a pas amour ou pouvoir, il
y a amour et pouvoir. Désir et demande exigent une convergence que
Narcisse, d’ailleurs, sait fort bien être impossible, et qu’en analyste
10 Roland Barthes, Sur Racine [1963], in Œuvres complètes, nouv. éd. rev., corr. et présentée
par Éric Marty, Paris, Éd. du Seuil, 2002, t. II, p. 105, 77.
11 Serge Doubrovsky, « Roland Barthes, une écriture tragique » [1981], in Parcours critique II
(1959-1991), texte établi par Isabelle Grell, Grenoble, ELLUG, 2006, p. 80. Il cite d’ailleurs
Roland Barthes disant : « je suis plus classique que la théorie du texte que je défends » dans
Roland Barthes par Roland Barthes (ibid., p. 73).
Modernites34.indd 195 19/09/12 11:19
196 Frédérique Toudoire-Surlapierre
pervers, il propose comme un leurre12 ». Racine invente un Néron qui
y croit, ordonnant donc l’impossible : « Éloigné de ses yeux j’ordonne,
je menace » (v. 496). Mais cet avis de Narcisse à Néron est aussi la plus
belle expression d’une « toute-croyance » en la puissance des mots sur
les êtres, formidable et terrible mise en pratique d’une rhétorique
qui « ordonne sa lecture13 », pour reprendre l’expression de Michel
Charles. Comme si les pouvoirs de Néron sur les autres étaient infinis :
illusion (ou erreur d’interprétation) que corrobore Burrhus dans une
affirmation aux accents tout de même bien cornéliens : « On n’aime
point, Seigneur, si l’on ne veut aimer » (v. 790).
2. « Madame, en le voyant, songez que je vous voi » (v. 690)
Dans son commentaire de Britannicus, Serge Doubrovsky prolonge
les analyses du Sur Racine de Barthes, dans un enchâssement critique
qui est aussi l’un des pouvoirs discursifs de l’émotion sur la raison.
Il s’attarde plus précisément sur cette « impuissance verbale » de
Néron, sa perte de voix face à Junie, dont il fait le revers de la toute-
puissance maternelle, révélatrice « de la pensée infantile et des régimes
totalitaires14 ». Racine toutefois a conféré un (grand) plaisir à Néron,
celui de la pulsion scopique que Doubrovsky qualifie de « dernière
jouissance à consommer15 ». Racine dénonce les séduisants leurres
(appâts) d’un « État-spectacle16 » qui joue des effets de captation d’un
spectateur (voyeur) : « Madame, en le voyant, songez que je vous voi »
(v. 690), déclare Néron à Junie. Le bénéfice est double pour l’auteur :
il puise ses ressorts esthétiques dans l’érotisation d’un « plaisir de
nuire ». « Scénographie sadique de Néron17 », commente Doubrovsky,
qui n’est autre qu’une revanche sur l’enfance (sur Agrippine),
renversant ce rapport de force en un « plaisir pris à l’exercice de la
domination18 ». Junie est d’autant plus en son pouvoir qu’elle exerce
un effet sur les images de Néron. Or « l’assujettissement de l’éros au
12 Id., « L’arrivée de Junie dans Britannicus : la tragédie d’une scène à l’autre » [1978], in Pierre
Ronzeaud (éd.), Racine/Britannicus, Paris, Klincksieck, 1995, p. 118 ; c’est l’auteur qui sou-
ligne.
13 Michel Charles, Rhétorique de la lecture, Paris, Éd. du Seuil, 1977, p. 47.
14 S. Doubrovsky, « L’arrivée de Junie… », art. cité, p. 117.
15 Ibid., p. 122.
16 Ibid., p. 119.
17 Ibid., p. 127.
18 John E. Jackson, Éros et pouvoir : Büchner, Shakespeare, Corneille, Racine, Neuchâtel, À la
Baconnière, 1988, p. 92.
Modernites34.indd 196 19/09/12 11:19
La critique : ou Les stratégies de l’émotion 197
pouvoir » et « la médiation de l’image pour assurer la jouissance19 »
métaphorisent aussi certaines des spéculations et des abus de la
critique à l’égard de la littérature. S’appuyant sur un lexique de la
représentation et de la vue, Starobinski, dans L’Œil vivant, s’est
attaché plus particulièrement à la place de la pulsion scopique dans le
pouvoir sensuel de la littérature : « Voir ouvre tout l’espace au désir,
mais voir ne suffit pas au désir. L’espace visible atteste à la fois ma
puissance de découvrir et mon impuissance d’atteindre20. » La vision
est le sens intermédiaire et intercesseur qui rend lisibles la nature et
l’épanchement des émotions, elle atteste par là même leur puissance
sur l’homme. Ainsi, « voir désigne un élan affectif incontrôlé, l’acte
d’une convoitise qui se repaît amoureusement, insatiablement, de la
présence de l’être désiré, dans la hantise du malheur imminent, et
dans le pressentiment d’une malédiction ou d’une punition attachée
à cette vue passionnée. Le verbe voir, chez Racine, contient ce
battement sémantique entre le trouble et la clarté, entre le savoir et
l’égarement21. » Non seulement voir contient cette interaction entre
émotion et puissance, mais par sa façon même d’écrire et de critiquer,
Starobinski reprend à son compte cette dualité : force rhétorique et
explicative de ses analyses et immense séduction de sa parole. Il est l’un
de ceux qui ont fait de l’activité critique l’espace discursif du primat
des sens. Significativement, il revient, à la fin de son introduction
intitulée « Le voile de Poppée », sur la fonction du critique, qu’il
qualifie de « regard surplombant » et d’« intuition identifiante » : « Il
ne faut refuser ni le vertige de la distance, ni celui de la proximité :
il faut désirer ce double excès où le regard est chaque fois près de
perdre tout pouvoir22. » Toute l’ambivalence de la posture critique est
signifiée dans ce rêve de réciprocité, de face-à-face et d’immédiateté,
alors même que la relation critique est forcément dissymétrique et
diachronique : « Il n’est pas facile de garder les yeux ouverts pour
accueillir le regard qui nous cherche23 », conclut Starobinski. La
structure théâtrale décuple la puissance critique qui se complaît
dans cette théâtralisation. Si la nature scénique du pouvoir repose
très exactement sur la force des compensations narcissiques qu’elle
peut prodiguer, peut-on affirmer pour autant qu’elle en révèle la
19 Ibid., p. 94.
20 Jean Starobinski, « Le voile de Poppée », in L’Œil vivant : Corneille, Racine, Rousseau,
Shakespeare, Paris, Gallimard, 1961, p. 13.
21 Id., « Racine et la poétique du regard », ibid., p. 75-76 ; c’est l’auteur qui souligne.
22 Id., « Le voile de Poppée », art. cité, p. 27.
23 Ibid.
Modernites34.indd 197 19/09/12 11:19
198 Frédérique Toudoire-Surlapierre
nature ? Plaisir d’une dénégation qui ne signifierait pas forcément que
le sujet doive lutter contre elle (Néron revenant sur ce qu’il vient de
déclarer : « Que dis-je ? »), mais qui s’offre plutôt le luxe (le plaisir)
de s’assumer comme dénégation. Cette impuissance verbale est aussi
« la chance du fantasme24 », en ce qu’il est une des incarnations de
l’idée de puissance (posséder l’objet comme par magie). Néron entend
exercer son autorité sur le domaine érotique et sentimental, il cherche
à assouvir « l’érotisation de son sentiment de pouvoir25 », grâce à la
« puissance de captation » exercée par « l’image de sa domination26 ».
Certains critiques, comme Doubrovsky et Jackson, se saisissent
alors du terme racinien d’« idole », soulignant ce contrôle d’autrui
par l’image qui révèle autant la fascination qu’exerce celle-ci que sa
puissance de captation. Néron peut bien exhiber un « désir d’exercer
le pouvoir, […] par fascination spectaculaire, de se constituer en
idole27 », ce n’est jamais qu’un repli compensatoire : « le seul moyen, si
l’on veut exercer la toute-puissance sur un ou des sujets impuissants,
c’est de se constituer, pour eux, en idole. L’expérience amoureuse,
dûment comprise et retournée, se convertit en leçon politique28 ».
Mais la première ne vaut que pour autant qu’elle permet de pallier
les déficiences, sinon les échecs, de la seconde. Doubrovsky cite alors
le vers de Néron : « J’aime (que dis-je aimer ?) j’idolâtre Junie » (v.
384). L’idolâtrie est une captation exponentielle, « prise et surprise,
vue médusante29 », une séquestration visuelle qui s’emballe. La
paralysie est l’envers (le contraire) de l’émotion, et la puissance, elle,
résulte, selon Freud dans ses Essais de psychanalyse30, de l’influence
exercée par une personne toute-puissante sur un sujet impuissant.
La conjonction du fantasme et de l’idole provoque la fétichisation du
pouvoir, tout en permettant son esthétisation. Le fantasme se reverse
en une pulsion scopique qui prend la forme d’une revanche voyeuriste
à la fois érotisée et obsessionnelle – qui n’est autre que la définition du
pouvoir littéraire. Néron joue d’une « médiation dans l’assouvissement
24 J. E. Jackson, Éros et pouvoir, op. cit., p. 91.
25 Ibid., p. 92 ; c’est l’auteur qui souligne.
26 J. E. Jackson, Éros et pouvoir, op. cit., p. 93 ; c’est l’auteur qui souligne.
27 S. Doubrovsky, « L’arrivée de Junie… », art. cité, p. 124.
28 Ibid., p. 119 ; c’est l’auteur qui souligne.
29 Ibid.
30 Voir S. F reud, « Psychologie collective et analyse du moi » [1921], trad. de l’allemand par
Janine Altounian, Pierre Cotet, André Bourguignon et Alain Rauzy, in Essais de psychana-
lyse, Paris, Payot, 1981, p. 123-217.
Modernites34.indd 198 19/09/12 11:19
La critique : ou Les stratégies de l’émotion 199
du sentiment de puissance31 ». Charles Mauron – que cite Doubrovsky
– souligne à quel point le public est voyeur des tourments de la jeune
héroïne : « Néron derrière son rideau regarde voluptueusement
souffrir Junie ; mais nous la regardons aussi, et Racine l’a regardée
plus que personne32. » Freud insiste sur le renversement de l’actif au
passif de la pulsion scopique : en regardant l’autre, je manifeste mon
désir d’être regardé par l’autre ; l’autre vient ainsi à la place du sujet
désiré ; c’est la forme narcissique de la pulsion scopique33. Le sujet qui
voit l’autre ne se situe pas à sa place, mais il est représenté dans et par
l’autre, ainsi l’activité de l’autre lui apparaît comme la sienne propre,
et c’est seulement dans cette image qu’il peut se figurer comme désiré.
Le critique joue en cela un rôle de premier plan, il « vient à son tour
inscrire sa jouissance de la tragédie jouissant d’elle-même. Fantasme
alors devenu réalité, créant l’objet d’un plaisir irremplaçable : jouir
de jouer (se jouer, faire jouer, être joué) 34 ». Se dévoilent la nature et
l’efficace d’un critique initiant le lecteur et chargé d’authentifier ses
fantasmes ; sa force et son pouvoir sont à leur comble, puisque c’est
sa jouissance qui devient référentielle et mimétique : non seulement
elle sert de modèle à toutes les autres, mais elle les légitime et les
authentifie.
3. « Parlez. Nous sommes seuls » (v. 709)
« Comment lire la critique ? » se demande Barthes, sinon comme
un « lecteur au second degré », acceptant d’être le voyeur d’un plaisir
pris par autrui ? « [J]’observe clandestinement le plaisir de l’autre,
j’entre dans la perversion ; le commentaire devient alors à mes yeux
un texte, une fiction, une enveloppe fissurée. Perversité de l’écrivain
(son plaisir d’écrire est sans fonction), double et triple perversité du
critique et de son lecteur, à l’infini35. » Et lorsque le critique, disant
31 J. E. Jackson, Éros et pouvoir, op. cit., p. 94.
32 Charles M auron, L’Inconscient dans la vie et l’œuvre de Racine [1957], Gap, Ophrys, 1997,
p. 78. Notons que tous les critiques (Barthes, Doubrovsky, Starobinski, Mauron, Jackson) for-
ment autour de cette pièce de Racine une constellation critique qui est en soi une représentation
de la position de la critique face à ce texte.
33 Voir S. F reud, Trois essais sur la théorie sexuelle [1905], trad. de l’allemand par Pierre Cotet
et Franck Rexand-Galais, in Œuvres complètes : psychanalyse, op. cit., t. VI (1901-1905),
Paris, PUF, 2007, p. 90 ; id., « Pulsions et destins de pulsions » [1915], trad. de l’allemand par
Janine Altounian, André Bourguignon, Pierre Cotet et Alain Rauzy, ibid., t. XIII (1914-1915),
Paris, PUF, 1994, p. 174-177.
34 S. Doubrovsky, « L’arrivée de Junie… », art. cité, p. 127.
35 Roland Barthes, Le Plaisir du texte [1973], Paris, Éd. du Seuil, coll. « Points », 1982, p. 31 ;
c’est l’auteur qui souligne.
Modernites34.indd 199 19/09/12 11:19
200 Frédérique Toudoire-Surlapierre
son plaisir (ou son déplaisir, mais c’est la même chose), laisse parler
ses pulsions, c’est toute son activité intellectuelle qui prend la forme
d’une transgression. Critique par principe conflictuelle puisqu’elle
provoque le surgissement du refoulé : la satisfaction de la pulsion
nécessite d’être déplacée pour pouvoir s’observer elle-même : le
sadique est aussi le voyeur de son propre plaisir. « Vous êtes en des
lieux tout pleins de sa puissance./ Ces murs mêmes, Seigneur, peuvent
avoir des yeux,/ Et jamais l’empereur n’est absent de ces lieux » (v.
712-714). Comment Junie pourrait-elle être plus claire ? Junie,
explique Barthes, « retourne le malheur de Britannicus en grâce et le
pouvoir de Néron en impuissance, l’avoir en nullité, et le dénuement en
être36 ». Comment ne pas entendre aussi dans cette réplique de Junie
les pouvoirs de Néron, l’efficacité de son stratagème et la puissance
de sa vengeance ? « La manipulation d’autrui exige du manipulateur
qu’il fasse accepter à l’autre son désir à soi comme désir de l’autre et,
inversement, que le manipulé prenne le désir de l’autre pour son propre
désir37. » La passion est perçue comme une altérité faite à soi même,
comme s’il fallait associer la passion et les autres pour l’extérioriser
(et projeter loin de soi son pouvoir). En cela, elle est « une mainmise
sur autrui, une mainmise destinée à maintenir l’autre dans sa fonction
de miroir, dans la fonction spéculaire qui serait la sienne, et qu’on
pourrait résumer dans une formule du type : “Je t’aime passionnément
afin que tu me renvoies une image positive de moi-même38” ». De sorte
que régner sur ses passions ne peut se faire sans les autres et que se
maîtriser comporte toujours une gratification sociale et un impact
communautaire, comme le rappelle Foucault dans L’Usage des plaisirs
de son Histoire de la sexualité.
Parlez. Nous sommes seuls. Notre ennemi trompé
Tandis que je vous parle est ailleurs occupé.
Ménageons les moments de cette heureuse absence (v. 709-711).
Le plaisir du spectateur est redoublé par l’incapacité de Britannicus
à comprendre que « dans le monde intégralement politisé de la Cour,
les relations d’éros sont inséparables de la lutte pour le pouvoir39 ».
Britannicus est « coupable d’aveuglement40 » selon John E. Jackson :
il ne voit pas ce qui saute aux yeux, piètre herméneute des émotions
36 R. Barthes, Sur Racine, op. cit., p. 129 ; c’est l’auteur qui souligne.
37 S. Doubrovsky, « L’arrivée de Junie… », art. cité, p. 119-120 ; c’est l’auteur qui souligne.
38 John E. Jackson, Passions du sujet : essais sur les rapports entre psychanalyse et littérature,
Paris, Mercure de France, 1990, p. 154.
39 Id., Éros et pouvoir, op. cit., p. 84.
40 Ibid. ; c’est l’auteur qui souligne.
Modernites34.indd 200 19/09/12 11:19
La critique : ou Les stratégies de l’émotion 201
de Junie, incapable de décoder les doubles sens, les connotations
et les implicites de ses répliques… Britannicus ne connaît pas la
sémiotique, encore moins l’herméneutique, activité interprétative
dont le spectateur profite pleinement. Le dramaturge expérimente
scéniquement deux types de lecteur (critique). Néron, qui n’est pas
aimé de Junie, en profite pleinement. Il excelle et jouit littéralement
du spectacle des signes que celle-ci lui offre (il sait capturer des
images dont son imagination bénéficie explicitement et il en tire du
plaisir), quand Britannicus, l’heureux élu, ne sait qu’en faire. Néron
le bon critique quand Britannicus serait le mauvais ? Est-ce à dire
que l’amour ne serait donc ni un gage ni un guide herméneutique,
qu’il serait donc insuffisamment signifiant ? S’opposent ainsi à une
« critique sémantique » ce qu’Umberto Eco qualifie de « critique
sémiosique », c’est-à-dire le « processus par lequel le destinataire,
face à la manifestation linéaire du texte, la remplit de sens41 », et
une « critique sémiotique », qui explique « pour quelles raisons
structurales le texte peut produire ces interprétations sémantiques
(ou d’autres, alternatives) 42 ». Repoussé par Junie, Néron transforme
ce rejet en un moteur dramatique extraordinaire, puisqu’il l’enlève
à Britannicus. « La structure du désir est triangulaire : elle va
du moi au moi par l’autre, du mâle au mâle par la femelle ; dans le
monde racinien comme dans le monde freudien, il n’est de libido que
phallique […] 43. » Paralysie, fantasme et voyeurisme : ces modalités
émotionnelles apparemment passives se traduisent par un rapt dont
le corollaire esthétique et érotique est le ravissement, tous deux
révélateurs des enjeux critiques de cette pièce. La critique a souvent
vu dans la surpuissance manipulatrice et sadique de Néron un conflit
des identifications sexuelles : « les rôles sexuels se distribuent, l’actif
et le passif s’ordonnent au paradigme parler/obéir/se taire44 ». Et si
dans cette pièce, c’est Agrippine (mère castratrice par excellence)
qui incarne le fantasme d’une toute-puissance, elle n’en parle qu’à
l’imparfait : « Et que derrière un voile, invisible, et présente/ J’étais
de ce grand corps l’âme toute-puissante » (v. 95-96). Agrippine,
dépourvue d’affects, entend conserver le pouvoir qui opère sur elle
comme une « compensation érotique » : d’un point de vue verbal, cette
interaction passe par une métaphore d’un corps devenu le substitut
41 Umberto Eco, Les Limites de l’interprétation [1990], trad. de l’italien par Myriem Bouzaher,
Paris, Le Livre de poche, 1994, p. 36.
42 Ibid.
43 S. Doubrovsky, « L’arrivée de Junie… », art. cité, p. 128.
44 Ibid., p. 118.
Modernites34.indd 201 19/09/12 11:19
202 Frédérique Toudoire-Surlapierre
de l’État : « Le Sénat fut séduit. Une loi moins sévère/ Mit Claude
dans mon lit, et Rome à mes genoux » (v. 1136-1137). Le processus
s’inverse avec Junie, elle lit et interprète par cette émotion qui
manque précisément à Agrippine pour garder toute sa lucidité (et
donc rester en vie). Les qualités du critique seraient-elles donc d’être
émotionnellement assujetti, contestable mais sagace ? Les rapports
d’Éros et du pouvoir sont des rapports conflictuels : soit le conflit est
l’indice d’un antagonisme propre à ces deux instances, soit il révèle
leur solidarité véritable45. Avancer que l’un impose de renoncer à
l’autre peut signifier deux choses : soit que l’un exclut l’autre, soit que
le choix n’est crucial que du fait de leur trop grande proximité, d’où la
tendance ou le désir de les confondre.
« Dans ce qu’il écrit, chacun défend sa sexualité46 », écrit Roland
Barthes : « Les images de la virilité sont mouvantes […] 47. » La
tentation (l’écart) entre un Barthes écrivant le plaisir (Le Plaisir du
texte, ou Fragments d’un discours amoureux) et celui du Degré zéro de
l’écriture n’est pas seulement à saisir la démarche d’un jeune critique
cherchant à faire ses preuves théoriques, à s’écarter de la norme en
transgressant un héritage critique classique. Qu’il s’agisse de S/Z ou
encore de Sur Racine48, Barthes subvertit l’analyse critique des œuvres
classiques par l’émotion, les sentiments, mais aussi la sexualisation de
son écriture. Doubrovsky qualifie la critique barthésienne de « zone
érogène » de la littérature49, appelant à sa rescousse le mot de Sartre
dans Situations, II : « le rapport de l’auteur au lecteur est analogue
à celui du mâle à la femelle50 » ; en sexualisant cette relation et en
lui conférant une différence générique, Sartre laisse entendre que
la littérature est toujours une émanation des pouvoirs de la libido.
Pierre Bourdieu a mis en évidence, dans La Domination masculine,
les ambivalences de la sexualité et des fantasmes de possession qu’on
45 J. E. Jackson, Éros et pouvoir, op. cit., p. 7-8.
46 Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes [1975], in Œuvres complètes, op. cit.,
t. IV, p. 728 ; c’est l’auteur qui souligne.
47 Id., « Éloge des larmes », Fragments d’un discours amoureux [1977], in Œuvres complètes, op.
cit., t. V, p. 224.
48 Rappelons-nous la controverse entre Barthes et Picard, qui répond au Sur Racine de Barthes
(1963) par un pamphlet intitulé Nouvelle critique ou nouvelle imposture (1965), auquel
Doubrovsky répondra à son tour, en se situant sur un plan non pas émotionnel mais théorique,
avec Pourquoi la nouvelle critique (1966). Cf. Raymond P icard, Nouvelle critique ou nouvelle
imposture, Paris, J.-J. Pauvert, 1965 ; Serge Doubrovsky, Pourquoi la nouvelle critique : cri-
tique et objectivité, Paris, Mercure de France, 1966.
49 S. Doubrovsky, « Roland Barthes, une écriture tragique », art. cité, p. 71.
50 Jean-Paul Sartre, « Qu’est-ce que la littérature ? », in Situations, II, Paris, Gallimard, 1948,
p. 134.
Modernites34.indd 202 19/09/12 11:19
La critique : ou Les stratégies de l’émotion 203
lui associe, et qui correspondent à la « somatisation des rapports
sociaux de domination51 ». Le désir masculin est possession ou
domination érotique, quand la libido féminine est « désir de la
domination masculine, comme subordination érotisée, ou même,
à la limite, comme reconnaissance érotisée de la domination52 » ;
notre vision du monde divisée « en genres relationnels, masculin
et féminin53 », en dérive exactement. La société légitime ainsi « une
relation de domination en l’inscrivant dans une nature biologique qui
est elle-même une construction sociale naturalisée54 ». En distinguant
émotion et puissance et en séparant implicitement le féminin (du côté
de l’émotion) et le masculin (du côté de la puissance), Doubrovsky
dénonce ainsi « l’agressivité phallique », « l’arrogance systématique
du discours autocratique et autosuffisant », quand l’écriture au
féminin serait davantage « déstructuration, déconstruction du
Logos55 ». Freud, dans sa leçon consacré à « La féminité56 », fait du
masochisme un trait constitutif du féminin que Doubrovsky oppose au
« sadisme57 » de la masculinité de l’écriture barthésienne, s’appuyant
sur une phrase de Barthes dans La Chambre claire : « Il me fallait
convenir que mon plaisir était un médiateur imparfait », la mort de
la mère est vécue (ou plutôt écrite) comme une perte de la « féminité
ultime, biologique ». « Chez Barthes, le style de Barthes est tout entier
au masculin, l’écriture est tout entière féminine58 », écrit Doubrovsky.
Barthes rend masculine la jouissance et l’oppose à l’émotion qu’il
range du côté du féminin : cette opposition ne reprendrait-elle pas la
distinction qu’il effectue entre plaisir et jouissance ? La critique, entre
lecture et écriture, se positionne au croisement des tensions entre
masculin et féminin, entre jouissance et plaisir :
L’émotion : pourquoi serait-elle antipathique à la jouissance (je la voyais à
tort tout entière du côté de la sentimentalité, de l’illusion morale) ? C’est un
trouble, une lisière d’évanouissement : quelque chose de pervers, sous des
dehors bien-pensants ; c’est même, peut-être, la plus retorse des pertes, car
elle contredit la règle générale, qui veut donner à la jouissance une figure
51 Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Paris, Éd. du Seuil, 1998, p. 29.
52 Ibid., p. 27.
53 Ibid., p. 28 ; c’est l’auteur qui souligne.
54 Ibid., p. 29.
55 S. Doubrovsky, « Roland Barthes… », art. cité, p. 81.
56 S. F reud, « La féminité », Nouvelle suite des leçons d’introduction à la psychanalyse [1932],
trad. de l’allemand par Janine Altounian, André Bourguignon, Alain Rauzy et Rose-Marie
Zeitlin, in Œuvres complètes, op. cit., t. XIX (1931-1936), Paris, PUF, 1995, p. 199.
57 S. Doubrovsky, « Roland Barthes… », art. cité, p. 82.
58 Ibid., p. 83.
Modernites34.indd 203 19/09/12 11:19
204 Frédérique Toudoire-Surlapierre
fixe : forte, violente, crue : quelque chose de nécessairement musclé, tendu,
phallique59.
4. « Elle va donc bientôt pleurer Britannicus ? » (v. 1311)
Est-ce à dire que la littérature partage avec les femmes la
modalité la plus visible et la plus littérale de l’émotion : les larmes ?
« Depuis quand les hommes (et non les femmes) ne pleurent-ils plus ?
Pourquoi la “sensibilité” est-elle à un certain moment retournée en
“sensiblerie60” ? » Britannicus est « un prince qui pleure », rappelle
Narcisse à Néron ; or non seulement les larmes vont à l’encontre de la
virilité (vis : la force), mais elles sont perçues (interprétées) comme
une faiblesse. Volontiers attribuées aux lectrices ou aux spectatrices,
elles connotent un certain discours politique et social. En tant que
débordement d’émotions, elles reflètent la façon dont nous utilisons
notre image. En pleurant, nous affirmons « un être autre » qui est en
réalité une façon d’affirmer un « n’être pas » (pour ne pas assumer
la responsabilité de nos actes ou paroles) : les larmes participent
donc de la stratégie d’un sujet qui se ment à lui-même pour mieux
se défaire de ses responsabilités et de sa culpabilité. Et parce que
les femmes sont plus émotives que les hommes, elles apprennent à
contrôler et à négocier le pouvoir, montrant ainsi qu’elles n’ont pas
besoin de contrôle externe. Freud fait de la culture une instance qui
relie libidinalement les membres de la communauté les uns aux autres,
de sorte qu’Éros est structurellement confronté à la loi avec laquelle
il doit sans cesse composer ou ruser61. L’être humain détourne une
partie de l’énergie de la pulsion sexuelle (ou de ses pulsions dérivées,
comme la pulsion scopique) et l’emploie à des travaux intellectuels
ou artistiques auxquels la culture accorde, sous une forme ou une
autre, une rétribution. La sublimation est un des effets de culture,
elle permet de se réapproprier des pulsions en les transformant en
modalités créatrices. Si les pulsions ne sont pas de l’ordre de la morale,
elles portent cependant ce que Nietzsche appelle « l’empreinte de nos
évaluations62 ». La prééminence des instincts doit interroger aussi
59 R. Barthes, Le Plaisir du texte, op. cit., p. 42.
60 Id., « Éloge des larmes », chap. cité, p. 224.
61 Voir S. F reud, Le Malaise dans la culture [1929-1930], trad. de l’allemand par Pierre Cotet,
René Lainé et Johanna Stute-Cadiot, in Œuvres complètes : psychanalyse, op. cit., t. XVIII
(1926-1930), Paris, PUF, 1994, p. 294-295.
62 F. Nietzsche, Fragments posthumes, IX, 5 [1], § 181, cité par P. Wotling, cité par Patrick
Wotling, « Le sens de la notion de pulsion chez Nietzsche. “Une facilité que l’on se donne” ? »,
in J.-C. G oddard (dir.), La Pulsion, op. cit., p. 100 ; c’est l’auteur qui souligne.
Modernites34.indd 204 19/09/12 11:19
La critique : ou Les stratégies de l’émotion 205
leurs conditions d’apparition et les valeurs qu’ils recouvrent. De sorte
que si les larmes sont un des stéréotypes émotionnels de la littérature,
elles opèrent également comme un signal social et mimétique pour le
lecteur, comme pour le convaincre par avance que le livre a atteint
sa cible. Répondant à la question de Narcisse : « Vous l’aimez ? »,
Néron évoque les larmes de Junie, à défaut de conquérir son cœur. Ses
larmes sont l’emblème de son pouvoir auctorial : « Excité d’un désir
curieux/ Cette nuit je l’ai vue arriver en ces lieux,/ Triste, levant au Ciel
ses yeux mouillés de larmes,/ Qui brillaient au travers des flambeaux
et des armes » (v. 385-388). Les larmes, souligne Jackson, « donnent à
celui qui les perçoit un pouvoir sur celui qui les verse. Pleurer devant
autrui, c’est à la fois lui avouer une émotion véritable et lui demander
consolation, c’est manifester une transparence intérieure sur laquelle
l’autre pourra dès lors choisir d’exercer ou non sa puissance63 ». Si
Britannicus et Junie, lors de leur dernière entrevue (acte V, scène i),
pleurent l’un devant l’autre dans une réciprocité amoureuse chère à la
littérature des sentiments, leurs larmes diffèrent dans leurs causes :
Junie pleure des dangers du pouvoir, des implications politiques de
la focalisation fantasmatico-érotique de Néron ; quand Britannicus
sanglote (un peu) sur son sort. Nul besoin de rappeler que Barthes, dans
ses Fragments d’un discours amoureux, a fait l’« Éloge des larmes ».
Pleurer, c’est d’abord « impressionner quelqu’un, faire pression sur
lui (“Vois ce que tu fais de moi64”) ». En exerçant ce chantage, les
larmes sont cette instrumentalisation des émotions qui signe (comme
une signature) un pouvoir qui s’exerce subrepticement, de biais, non
par l’argumentation mais par l’émotion. Mais pleurer, c’est aussi faire
l’épreuve d’un pouvoir sur soi-même, c’est se laisser prendre par ses
propres sentiments. Je pleure pour me prouver que ma douleur n’est
pas une illusion : « les larmes sont des signes, non des expressions. Par
mes larmes, je raconte une histoire, je produis un mythe de la douleur,
et dès lors je m’en accommode : je puis vivre avec elle, parce que, en
pleurant, je me donne un interlocuteur empathique qui recueille le
plus “vrai” des messages, celui de mon corps, non celui de ma langue :
“Les paroles, que sont-elles ? Une larme en dira plus65” ». Les larmes
rendent visibles le pouvoir de l’illusion et la puissance affabulatrice
de l’être humain, son goût des histoires valant sans doute autant que
la séduction des images. Si les larmes diffèrent encore au théâtre selon
63 J. E. Jackson, Éros et pouvoir, op. cit., p. 85.
64 R. Barthes, « Éloge des larmes », chap. cité, p. 225.
65 Ibid.
Modernites34.indd 205 19/09/12 11:19
206 Frédérique Toudoire-Surlapierre
qu’elles sont dites ou jouées, Jean-Paul Sartre rappelle toutefois, dans
Esquisse d’une théorie des émotions, qu’un acteur qui pleure sur scène
pleure toujours vraiment : « Si l’émotion est un jeu, c’est un jeu auquel
nous croyons66. » Articulant l’émotion à la croyance en soulignant la
dimension ludique et contagieuse de l’émotion, il déjoue et disqualifie
par avance nos présupposés sceptiques d’une émotion provoquée : « La
véritable émotion est tout autre : elle s’accompagne de croyance67. »
L’émotion peut bien être subie, on choisit toutefois d’y croire, se
soumettant aux modalités, aux impératifs et aux conséquences de cette
adhésion. Le pari des émotions littéraires va consister à rendre visible
ce qui est lisible, rendant ainsi les émotions à leur nature première :
le corps. Mais la lisibilité de l’émotion renvoie aussi à une modalité
sociale. L’émotion peut aussi bien trahir le sujet en se reversant sur
lui. Au critique de départager les émotions (en les hiérarchisant) : il
les verbalise, les qualifie et les interprète, autrement dit il leur donne
du sens et des valeurs, effectuant un rapprochement entre les émotions
fictives du texte et celles, réelles, du lecteur : il les rationalise, mais il
les permet et les valorise également. Cette différence est emblématique
de l’écart entre le pouvoir de la littérature et les moyens dont dispose
la critique pour se faire aimer – fantasme qui est à même de provoquer
de vraies larmes. Comme l’écrit Barthes dans Critique et vérité, « non
point : faites-moi croire à ce que vous dites, mais plus encore : faites-
moi croire à votre décision de le dire68 ».
Les larmes du critique sont sans doute moins l’expression d’un
quelconque abandon que la volonté de vérification d’un pouvoir sur
la littérature. Ce qui se joue dans cette interaction entre émotion
et puissance, c’est aussi la question de la forme et du genre, ou plus
exactement le choix d’une forme par rapport à une esthétique, rapport
qui se noue autour de la notion de genre (générique et sexuel) et de la
nature du plaisir de lecture. On pourrait donc choisir dans ou par
l’écriture de son genre sexuel, mais aussi dans ou par sa lecture ? Comme
l’écrit Barthes que cite Doubrovsky, « le sens et le sexe deviennent
l’objet d’un jeu libre, au sein duquel les formes (polysémiques) et les
pratiques (sensuelles), libérées de la prison binaire, vont se mettre en
état d’expansion infinie. Ainsi peuvent naître un texte gongorien et une
66 Jean-Paul Sartre, Esquisse d’une théorie des émotions [1939], Paris, Le Livre de poche, 2000,
p. 82.
67 Ibid., p. 96.
68 Roland Barthes, Critique et vérité [1966], in Œuvres complètes, op. cit., t. II, p. 799.
Modernites34.indd 206 19/09/12 11:19
La critique : ou Les stratégies de l’émotion 207
sexualité heureuse69 », signes d’une « volonté de jouissance70 » que la
critique convoite à la littérature et qu’elle entend lui prendre, parfois
de plein gré, parfois de force, parfois en cachette. Barthes envisage la
critique en termes de plaisir pris ou reçu (et non pas donné) : est-ce à
dire que la critique ne pourrait accéder à la jouissance ? La critique
« porte toujours sur des textes de plaisir, jamais sur des textes de
jouissance71 », parce que l’activité critique est justement prise dans
« une visée tactique, un usage social et bien souvent une couverture
imaginaire72 ». Le « texte de plaisir […] contente, emplit, donne de
l’euphorie ; celui qui vient de la culture, ne rompt pas avec elle, est lié
à une pratique confortable de la lecture. Texte de jouissance : celui qui
met en état de perte, celui qui déconforte73 ». C’est donc cet « état » que
convoiterait, que jalouserait même la critique ? Le pouvoir émotionnel
de la littérature tient à la façon dont elle laisse affleurer les processus
primaires dans les processus secondaires, quand l’écrivain superpose
à la scène ordinaire de la conscience « l’autre scène » (celle de notre
inconscient). Lieu de décharge et de compensation narcissique, la
littérature intercale entre les pulsions et les passions « la surface
doublement réfléchissante d’un langage qui a, en même temps, la
fonction d’un trait d’union » ; le « monde des pulsions » donne ainsi
son sens à l’existence même de l’organisation de la conscience74. La
critique reproduit cette ambivalence fondatrice des instincts et des
affects qui sont le résultat d’une élaboration intellectuelle opérée par
un processus corporel (comme un besoin de se reprendre ou de se
ressaisir).
« Ce sont nos besoins qui interprètent le monde : nos instincts,
leur pour et leur contre. Chaque instinct est un certain besoin de
domination, chacun possède sa perspective qu’il voudrait imposer
comme norme à tous les autres instincts75. » Selon Nietzsche, les
pulsions interagissent en fonction de l’autorité qu’elles ont les
unes sur les autres. Elles évaluent leurs rapports de force et elles
69 Id., Roland Barthes par Roland Barthes, op. cit., p. 708. Texte repris par S. Doubrovsky,
« Roland Barthes… », art. cité, p. 70-71.
70 Roland Barthes, Le Plaisir du texte, op. cit., p. 25 ; c’est l’auteur qui souligne.
71 Ibid., p. 37 ; c’est l’auteur qui souligne.
72 Ibid., p. 24.
73 Ibid., p. 25 ; c’est l’auteur qui souligne.
74 J. E. Jackson, Passions du sujet, op. cit., p. 242. Pour tout ce raisonnement, voir les analyses
de Jackson ibid., p. 229-242.
75 Friedrich Nietzsche, Fragments posthumes, XII, 7 [60], cité par P. Wotling, « Le sens de la
notion de pulsion… », art. cité, p. 102.
Modernites34.indd 207 19/09/12 11:19
208 Frédérique Toudoire-Surlapierre
reconnaissent leur maître. Les pulsions ne se déclenchent que si la
structure hiérarchique ou les rapports de force en présence rendent
probable l’exécution de l’ordre (donc de l’obéissance) : « Tout le
phénomène de la volonté repose ainsi sur une logique de la passion et
du commandement76. » Ce sont donc les pulsions qui déclenchent le
processus de la volonté, et non l’inverse comme le croyait la tradition
philosophique. L’affect (l’émotion) est autant affaire de sensibilité
(capacité à être affecté) que capacité d’agir ou de commander, c’est-à-
dire d’affecter de manière contraignante. Unir émotion et puissance
est donc loin d’être saugrenu. La singularité du théâtre racinien tient
à ce qu’il est fondé sur une « relation d’autorité », mais que « cette
relation se mène, non seulement hors de toute société, mais même hors
de toute socialité77 ». Or « la nature exacte du rapport d’autorité »
mérite selon Barthes d’être précisée, elle n’est pas seulement une
question de puissance ni d’abus de pouvoir : « A est coupable, B est
innocent. Mais comme il est intolérable que la puissance soit injuste, B
prend sur lui la faute de A : le rapport oppressif se retourne en rapport
punitif, sans que pourtant cesse jamais entre les deux partenaires
tout un jeu personnel de blasphèmes, de feintes, de ruptures et de
réconciliations. Car l’aveu de B n’est pas une oblation généreuse : il
est la terreur d’ouvrir les yeux sur le Père coupable78 », c’est-à-dire
la Loi, c’est-à-dire l’Autorité. C’est Néron faisant l’aveu d’amour, c’est
la relation triangulaire qu’il impose à Junie et Britannicus, mais c’est
aussi le rapport des critiques contemporains à la pièce de Racine, et
leur aveu d’une fascination non encore assouvie. En filigrane se pose
la question de l’autorité en tant qu’« articulation entre les passions
du moi et les passions de l’autre79 ». Platon explique dans le Gorgias
(491d-e) que l’autorité est celle que l’on exerce sur ses plaisirs et sur ses
passions, de sorte qu’il subordonne l’âme et la passion à un problème
politique80. C’est le politique qui confère ainsi à la passion sa forme
particulière. Un parallèle avec l’autorité littéraire semble s’imposer,
tant ces données se transfèrent aisément dans le champ littéraire.
Les émotions sont aussi « des moyens utilisés par des tendances
inconscientes pour se satisfaire symboliquement, pour rompre un état
76 Ibid., p. 107.
77 R. Barthes, Sur Racine, op. cit., p. 85.
78 Ibid., p. 95 ; c’est l’auteur qui souligne.
79 V. Despret, Ces émotions qui nous fabriquent, op. cit., p. 195.
80 P laton, Gorgias, 491d-e, trad. inédite, introduction et notes par Monique Canto, Paris, GF-
Flammarion, 1987, p. 228-229.
Modernites34.indd 208 19/09/12 11:19
La critique : ou Les stratégies de l’émotion 209
de tension insupportable81 ». L’émotion peut également être considérée
comme une réponse à des modalités inconscientes, elle est alors perçue
comme un phénomène de refus ou de censure, exprimant une tension
qui n’a pas conscience de sa signification, elle est mue par « un lien de
causalité » et « un lien de compréhension82 ». Le paradoxe de l’émotion
tient à la réunion des deux positions : on a conscience de l’émotion
comme structure affective de la conscience, et en même temps « la
conscience émotionnelle est d’abord irréfléchie83 ». En cela, perdure
toujours une part médiatique de négociation et de rétribution dans
l’émotion : « Passer de la lecture à la critique, c’est changer de désir,
c’est désirer non plus l’œuvre, mais son propre langage. Mais par là-
même aussi, c’est renvoyer l’œuvre au désir de l’écriture, dont elle
était sortie84. » Si on a tant fustigé le pouvoir de la critique, capable
de faire ou défaire une carrière littéraire (pouvoir sans doute plus
fantasmatique que réel), ce fantasme même est révélateur d’une
tension entre émotion et raison perçue justement comme un enjeu de
pouvoir, conférant au critique son aura et sa puissance. Et s’il profite
tant des deux, c’est parce qu’il s’est dispensé de l’obligation de choisir.
Frédérique Toudoire-Surlapierre
ILLE, Université de Haute-Alsace
Bibliographie
A ristote, Métaphysique, trad. et notes par Jean Tricot, Paris, J. Vrin,
« Bibliothèque des textes philosophiques-poche », 1991, 2 vol.
Barthes, Roland, Sur Racine, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Pierres vives »,
1963 ; repris dans Œuvres complètes, nouv. éd. revue, corrigée et présentée
par Éric Marty, Paris, Éd. du Seuil, 2002, 5 vol., t. II (1962-1967), p. 51-196.
—, Critique et vérité, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Tel Quel », 1966 ; repris
ibid., p. 757-801.
—, Le Plaisir du texte, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Tel Quel », 1973 ; repris
ibid., t. IV (1972-1976), p. 217-264.
—, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Éd. du Seuil, coll.
« Écrivains de toujours », 1975 ; repris ibid., p. 575-771.
—, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Tel
Quel », 1977 ; repris ibid., t. V (1977-1980), p. 25-298.
81 J.-P. Sartre, Esquisse d’une théorie des émotions, op. cit., p. 58.
82 Ibid., p. 37.
83 Ibid., p. 81.
84 R. Barthes, Critique et vérité, op. cit., p. 801.
Modernites34.indd 209 19/09/12 11:19
210 Frédérique Toudoire-Surlapierre
Bergson, Henri, Les Deux Sources de la morale et de la religion [1932],
Paris, PUF, « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1969.
Bourdieu, Pierre, La Domination masculine, Paris, Éd. du Seuil, coll.
« Liber », 1998.
Charles, Michel, Rhétorique de la lecture, Paris, Éd. du Seuil, coll.
« Poétique », 1977.
Despret, Vinciane, Ces émotions qui nous fabriquent : ethnopsychologie de
l’authenticité, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2001.
Doubrovsky, Serge, Pourquoi la nouvelle critique : critique et objectivité,
Paris, Mercure de France, 1966.
—, « L’arrivée de Junie dans Britannicus : la tragédie d’une scène à l’autre »
[1978], in Pierre Ronzeaud (éd.), Racine/Britannicus, Paris, Klincksieck,
coll. « Parcours critique », 1995, p. 105-129.
—, « Roland Barthes, une écriture tragique » [1981], in Parcours critique II
(1959-1991), texte établi par Isabelle Grell, Grenoble, ELLUG, 2006, p. 53-
83.
Eco, Umberto, Les Limites de l’interprétation [1990], trad. de l’italien par
Myriem Bouzaher, Paris, Le Livre de poche, coll. « Biblio-essais », 1994.
Freud, Sigmund, Trois essais sur la théorie sexuelle [1905], trad. de
l’allemand par Pierre Cotet et Franck Rexand-Galais, in Œuvres complètes :
psychanalyse (éd. sous la dir. d’André Bourguignon, Pierre Cotet et Jean
Laplanche), t. VI (1901-1905), Paris, PUF, 2007, p. 59-181.
—, « La création littéraire et le rêve éveillé » [1908], trad. de l’allemand
par Marie Bonaparte et M me E. Marty, in Essais de psychanalyse appliquée,
Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1971, p. 69-81 ; nouvelle traduction : « Le
poète et l’activité de fantaisie », trad. de l’allemand par Pierre Cotet et
Marie-Thérèse Schmidt, in Œuvres complètes, op. cit., t. VIII (1906-1908),
Paris, PUF, 2007, p. 159-171.
—, « Pulsions et destins de pulsions » [1915], trad. de l’allemand par Janine
Altounian, André Bourguignon, Pierre Cotet et Alain Rauzy, in Œuvres
complètes, op. cit., t. XIII (1914-1915), Paris, PUF, 1994, p. 163-187.
—, « Psychologie collective et analyse du moi » [1921], trad. de l’allemand
par Janine Altounian, Pierre Cotet, André Bourguignon et Alain Rauzy, in
Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981, p. 123-217 ; repris sous le titre
« Psychologie des masses et analyse du moi », in Œuvres complètes, op. cit.,
t. XVI (1921-1923), Paris, PUF, 1991, p. 1-83.
—, Le Malaise dans la culture [1929-1930], trad. de l’allemand par Pierre
Cotet, René Lainé et Johanna Stute-Cadiot, in Œuvres complètes, op. cit.,
t. XVIII (1926-1930), Paris, PUF, 1994, p. 245-333.
—, « La féminité », Nouvelle suite des leçons d’introduction à la psychanalyse
[1932], trad. de l’allemand par Janine Altounian, André Bourguignon,
Alain Rauzy et Rose-Marie Zeitlin, in Œuvres complètes, op. cit., t. XIX
Modernites34.indd 210 19/09/12 11:19
La critique : ou Les stratégies de l’émotion 211
(1931-1936), Paris, PUF, 1995, p. 195-219.
Goddard, Jean-Christophe, « Pulsion et réflexion chez Fichte. Une éthique
pulsionnelle », in id. (dir.), La Pulsion, Paris, J. Vrin, coll. « Théma »,
2006, p. 37-56.
Gracq, Julien, En lisant, en écrivant, Paris, José Corti, 1980.
Jackson, John E., Éros et pouvoir : Büchner, Shakespeare, Corneille, Racine,
Neuchâtel, À la Baconnière, coll. « Langages », 1988.
—, Passions du sujet : essais sur les rapports entre psychanalyse et
littérature, Paris, Mercure de France, 1990, p. 154.
M aldiney, Henry, « Pulsion et présence » [1976], in Penser l’homme et la
folie, 3e éd., Grenoble, Millon, coll. « Krisis », 2007, p. 107-135.
M arin, Louis, Politiques de la représentation, éd. établie par Alain Cantillon
et al., Paris, Kimé, coll. « Le Collège en acte », 2005.
M auron, Charles, L’Inconscient dans la vie et l’œuvre de Racine, Gap,
Ophrys, 1957 ; rééd. 1997.
Picard, Raymond, Nouvelle critique ou nouvelle imposture, Paris, J.-
J. Pauvert, coll. « Libertés », 1965.
P laton, Gorgias, trad. inédite, introduction et notes par Monique Canto,
Paris, GF-Flammarion, 1987.
Sartre, Jean-Paul, Esquisse d’une théorie des émotions, Paris, Hermann,
1939 ; rééd. Le Livre de poche, coll. « Références-philosophie », 2000.
—, « Qu’est-ce que la littérature ? », in Situations, II, Paris, Gallimard,
1948.
Starobinski, Jean, « Le voile de Poppée », in L’Œil vivant : Corneille,
Racine, Rousseau, Shakespeare, Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin »,
1961, p. 9-27.
—, « Racine et la poétique du regard », ibid., p. 69-89.
Wotling, Patrick, « Le sens de la notion de pulsion chez Nietzsche. “Une
facilité que l’on se donne” ? », in J.-C. Goddard (dir.), La Pulsion, op. cit.,
p. 73-111.
Modernites34.indd 211 19/09/12 11:19
Les directeurs
Ancien élève de l’ENS, Emmanuel Bouju est professeur de littérature générale
et comparée à l’université Rennes 2 et Visiting Professor à l’université
Harvard. Il est l’auteur de Réinventer la littérature : démocratisation et
modèles romanesques dans l’Espagne postfranquiste (préface de Jorge
Semprún, PUM, 2002) et La Transcription de l’histoire : essai sur le roman
européen de la fin du xxe siècle (PUR, 2006). Il est responsable du Groupe
phi, dont il a dirigé les ouvrages collectifs aux PUR : Littératures sous contrat
(2002), L’Engagement littéraire (2005), Littérature et exemplarité (avec
Alexandre Gefen, Guiomar Hautcœur et Marielle Macé, 2007) et L’Autorité
en littérature (2010).
Alexandre Gefen est chargé de recherche au Centre d’étude de la littérature
française (CNRS-Université Paris-Sorbonne). Théoricien de la littérature, il
travaille notamment sur la notion de fiction. Il codirige le Projet ANR « Les
Pouvoirs de l’art ». Il a édité les Œuvres Marcel Schwob (Les Belles Lettres,
2002), et il est notamment l’auteur des anthologies La Mimèsis (Flammarion,
2012) et Vies imaginaires (Gallimard, à paraître).
Modernites34.indd 212 19/09/12 11:19
MODERNITÉS 1 : D’Hérodiade à Mirabelle (épuisé)
MODERNITÉS 2 : Criminels et policiers (épuisé)
MODERNITÉS 3 : Mondes perdus 172 pages – 10,67 euros
MODERNITÉS 4 : écritures discontinues 205 pages – 12,19 euros
MODERNITÉS 5 : Ce que modernité veut dire (I) 192 pages – 15,24 euros
MODERNITÉS 6 : Ce que modernité veut dire (II) 240 pages – 16,77 euros
MODERNITÉS 7 : Le retour de l’archaïque 224 pages – 16,77 euros
MODERNITÉS 8 : Le sujet lyrique en question 304 pages – 22,87 euros
MODERNITÉS 9 : Écritures de l’objet 316 pages – 16,77 euros
MODERNITÉS 10 : Poétiques de l’instant 184 pages – 16,77 euros
MODERNITÉS 11 : L’Instant romanesque 192 pages – 16,77 euros
MODERNITÉS 12 : Surface et intériorité 224 pages – 16,77 euros
MODERNITÉS 13 : Ruptures, continuités 192 pages – 16,77 euros
MODERNITÉS 14 : Dire le secret 347 pages – 21,34 euros
MODERNITÉS 15 : écritures du ressassement 336 pages – 21,34 euros
MODERNITÉS 16 : Enchantements
En hommage à Yves Vadé, un parcours collectif pour découvrir les thèmes,
les figures et les formes énonciatives de l’enchantement, ce lien «‑magique‑ »
que la littérature et l’art modernes ne cessent de renouer, de renouveler.
(Textes réunis et présentés parJean-Pierre Saïdah).
Un volume de 289 pages – 23 euros
MODERNITÉS 17 : Frontières de la fiction
Reposant, dans le cadre des débats les plus récents, la question des limites
de l’espace littéraire, ce livre interroge les définitions de la fiction, dans un
trajet à la fois théorique et historique. Publié en coédition avec Nota Bene,
ce volume fait partie des travaux du groupe « Fabula ». (Textes réunis et
présentés par René Audet et Alexandre Gefen).
Un volume de 436 pages – 25 euros
MODERNITÉS 18 : L’auteur entre biographie et mythographie
Reposer à la croisée de la théorie de la littérature et de la pratique de
l’enseignement la question controversée de l’auteur, tenter de démêler la
trame de cette fable en cessant d’opposer biographie et mythographie,
histoire et légende, portrait et icône‑ : telle est l’ambition de ce volume
collectif, le premier de la collection « Littérature Enseignement Recherche »
(Textes réunis et présentés par Brigitte Louichon et Jérôme Roger).
Un volume de 298 pages – 23 euros
Modernites34.indd 213 19/09/12 11:19
214 Auteur
MODERNITÉS 19 : L’invention du solitaire
Pourquoi la littérature moderne est-elle l’affaire d’un écrivain solitaire ?
Pourquoi, de Rousseau à Kafka, de Chateaubriand à Beckett et à aujourd’hui,
ce lien essentiel entre écrire et être seul ? Ce livre décrit, en trois moments,
l’histoire de l’invention du solitaire – c’est-à-dire : à la fois la fabrication de
l’écrivain comme être isolé et séparé, mais aussi ce qu’il découvre, la littérature
même comme sacerdoce artistique. (Textes réunis et présentés par Dominique
Rabaté)
Un volume de 400 pages – 25 euros
Modernités 20 : Champ littéraire fin de siècle, autour de Zola
Le « post-naturalisme » est un angle d’approche fécond pour mieux
comprendre ce qui se joue au tournant des deux siècles. Les regards croisés
sur les œuvres de Zola, Rosny, Mirbeau, Bourget, Huysmans, France, Péguy
ou sur les poètes naturistes cherchent à frayer de nouvelles pistes pour l’étude
d’une période charnière, avide de recherches et de formes nouvelles. (Textes
réunis et présentés par Béatrice Laville)
Un volume de 230 pages – 22 euros
Modernités 21 : Deuil et littérature
La tâche du deuil ? Maintenir vivants comme objet perdu ceux qui ont
disparu. L’écriture, dans sa nouvelle définition romantique, relève de la
même mission paradoxale, de la même ambition mélancolique et salvatrice.
Suivant sur deux siècles les figures des endeuillés romantiques, des veufs fin-
de-siècle, des orphelins de la Grande Guerre jusqu’aux manifestations les plus
contemporaines, ce volume explore l’incessant dialogue qui se tisse entre les
vivants et les morts. (Textes réunis par Pierre Glaudes et Dominique Rabaté).
Un volume de 441 pages – 25 euros
Modernités 22 : Déclins de l’allégorie ?
Qu’en est-il de l’allégorie depuis Courbet et Baudelaire ? à quoi se reconnaît-
elle ? Quelles sont ses procédures opératoires, ses déclinaisons modernes ?
Telles sont les questions, d’ordre généalogique et esthétique, que pose ce
volume qui fait apparaître une véritable hantise de l’allégorie dans tout l’art
moderne. (Textes réunis par Bernard Vouilloux).
Un volume de 240 pages – 22 euros
Modernités 23 : Les enseignements de la fiction
à quoi sert la fiction ? Quelle expérience nouvelle propose-t-elle au lecteur, et
comment l’enseigner dans une institution scolaire et universitaire où sa place
et ses vertus supposées tendent à s’élargir alors même que sa prééminence
relève d’un impensé ? à ces interrogations fortes que peut se poser tout
enseignant de la maternelle à l’université, des chercheurs en didactique
et en littérature ont tenté d’apporter des contributions croisées. (Série
« Littérature, Enseignement, Recherche ». Textes réunis et présentés par
Michel Braud, Béatrice Laville et Brigitte Louichon).
Un volume de 232 pages – 22 euros
Modernites34.indd 214 19/09/12 11:19
Article 215
Modernités 24 : L’irressemblance. Poésie et autobiographie
Depuis le romantisme, les poètes questionnent la relation ambiguë entre le
lyrisme et l’expérience vécue, tandis que l’aveu autobiographique invente des
voies nouvelles qui le rapprochent de la poésie. Le présent volume interroge
ce double mouvement de débordement d’un genre vers l’autre, là où le sujet
– poétique ou autobiographique – peut être dit irressemblant à lui-même.
(Textes réunis et présentés par Michel Braud et Valéry Hugotte).
Un volume de 208 pages – 22 euros
Modernités 25 : L’art et la question de la valeur
Au moment où la promotion semble massivement prendre la place de la
critique, il importe de reposer collectivement, après d’autres, la question de
la valeur de l’art. Ce volume tente de penser à nouveaux frais une économie
de la valeur littéraire, ou plus généralement de la valeur esthétique, en
interrogeant la fabrique qu’en proposent les œuvres, des plus consacrées aux
plus marginales. (Textes réunis par Dominique Rabaté).
Un volume de 264 pages – 23 euros
Modernités 26 : Le lecteur engagé : critique - enseignement - politique
Au moment où la notion d’engagement en littérature connaît un reflux général,
notamment chez les écrivains et les intellectuels, il importait de reprendre la
question sous l’angle peu exploré du lecteur : qu’est-ce que s’engager dans,
par, avec et pour la lecture ? « Ce n’est pas volontaire, vous êtes embarqué »,
disait déjà Pascal. Les actes de ce 3e colloque « Enseignement et littérature »
témoignent de l’actualité souvent cruciale de cette apostrophe, tant du côté de
l’enseignement, que de la critique et de la traduction, à l’aune de la rumeur
insistante de l’histoire et du politique. (Textes réunis par Isabelle Poulin et
Jérôme Roger.)
Un volume de 248 pages – 23 euros
Modernités 27 : Mauvais genre. La satire littéraire moderne
Si la forme générique en vers de la satire périclite au xviiie siècle, c’est pour
devenir un mode qui envahit le théâtre, le roman comme la poésie. Il convient
donc d’envisager véritablement une poétique satirique du côté de ses cibles,
dans la déstabilisation des valeurs, dans son hybridation et sa tendance
à la réflexivité, en analysant ses stratégies mobiles du xixe siècle jusqu’à
aujourd’hui. (Textes réunis par Sophie Duval et Jean-Pierre Saïdah).
Un volume de 466 pages – 26 euros
Modernités 28 : L’Album contemporain pour la jeunesse : nouvelles
formes, nouveaux lecteurs ?
L’extraordinaire inventivité de l’album pour la jeunesse, la singularité
créatrice qu’il permet d’exprimer aujourd’hui font l’objet de cette enquête
collective. Forme hybride, l’album se nourrit du dialogue entre texte et image.
Il revisite à sa façon le patrimoine littéraire. Il sait réfléchir ses capacités à
représenter, et façonne même aujourd’hui un lecteur apte à vivre grâce lui une
véritable expérience esthétique où le plaisir et l’intranquillité vont de pair.
(Série « Littérature, Enseignement, Recherche ». Textes réunis et présentés
par Christiane Connan-Pintado, Florence Gaiotti et Bernadette Poulou).
Un volume de 314 pages – 26 euros
Modernites34.indd 215 19/09/12 11:19
216 Auteur
Modernités 29 : Puissances du mal
Le titre de cet ouvrage collectif désigne l’empire nouveau qu’exerce sur la
sensibilité moderne un Mal qui échappe aux représentations chrétiennes.
Ce mal envahit tous les lieux d’ancienne innocence, opérant une sorte de
révolution anthropologique. Il est Légion, et l’art moderne ne cesse de
représenter – avec effroi et complaisance - les innombrables visages qu’il
prend. Le panorama est vertigineux : ce livre propose quelques lignes de
perspective pour rendre compte de cette fascination moderne, qui n’avait
jamais fait l’objet d’une telle investigation. (Textes réunis et présentés par
Pierre Glaudes et Dominique Rabaté).
Un volume de 472 pages – 26 euros.
Modernités 30 : Poétiques de la durée
Comment le récit ou la poésie peuvent-ils communiquer au lecteur
l’expérience de la durée, comment peuvent-ils figurer le flux du temps de
l’existence qui s’écoule ? Les auteurs des xixe et xxe siècles y répondent en
explorant les voies de la rupture du récit romanesque, de la saisie immédiate
du courant de conscience, ou en posant, au-delà de l’instant, une durée que
le poète accepte ou dans laquelle il se reconnaît. (Textes réunis et présentés
par Michel Braud).
Un volume de 198 pages – 22 euros.
Modernités 31 : En quel nom parler ?
Les écrivains des deux derniers siècles ont cherché à refonder la légitimité
(politique, artistique) de la parole singulière en articulant individu et
collectivité : parler en son nom propre, ou parler au nom d’un groupe…
Il s’agit, dans le présent volume, de voir comment la littérature forge des
modes nouveaux de délégation entre voix individuelle et expression d’une
communauté. (Textes réunis et présentés par Dominique Rabaté).
Un volume de 368 pages – 26 euros.
Modernités 32 : Sens de la langue, sens du langage : poésie, grammaire,
traduction
Quelque chose se perd, dès l’école, dans l’enseignement de la littérature.
Appelons cette chose le « sens du langage ». SprachSinn, ce terme repris
à Wilhelm von Humboldt, désigne la façon dont le langage agit, qu’il est
une force avant d’être, dans la langue, une nomenclature. C’était le sens
premier de la rhétorique chez Aristote. Dans la mesure où le formalisme
s’est quasiment substitué à toute autre approche des textes, il importait
de remettre au premier plan l’activité du langage, telle qu’elle s’observe
de l’intérieur, dans la littérature et dans la traduction. (Textes réunis par
Chantal Lapeyre, Isabelle Poulin, Jérôme Roger.)
Un volume de 198 pages – 22 euros.
Modernites34.indd 216 19/09/12 11:19
Article 217
Modernités 33 : Nihilismes ?
Faut-il réduire à une pure négativité le programme esthétique du nihilisme ?
Ne doit-on pas aussi entendre la force de cette énergie du désespoir, la
puissance d’un soupçon fructueux ? Ce livre entreprend de faire l’histoire
(philosophique, culturelle et littéraire) de cet attrait vers le Rien et des
figures de la destruction qui y sont mobilisées. (Textes réunis et présentés
par Éric Benoit et Dominique Rabaté).
Un volume de 399 pages - 29 euros
Prochain volume de Modernités à paraître : ???????????
Modernites34.indd 217 19/09/12 11:19
Modernites34.indd 218 19/09/12 11:19
Commande
Le numéro 34 de Modernités
est disponible auprès de votre libraire habituel au prix de
26 euros
ou, à défaut, par correspondance, aux Presses Universitaires de Bordeaux
en remplissant ce bon de commande
Nom et prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qté Titre ISBN
Frais d’expédition*
Total
* compter 4,30 pour le premier volume et 1,30 par volume suivant
Mode de règlement :
chèque bancaire ou postal, à l’ordre de M. L'agent comptable de l'université Michel de
Montaigne-Bordeaux 3.
virement bancaire ou postal : Trésorerie générale de la Gironde de Bordeaux
code banque : 10071 code guichet : 3300 n° de compte : 00001000010/clé35
Date et signature
Bon de commande à retourner avec votre règlement aux
Presses Universitaires de Bordeaux
Domaine universitaire - Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
33607 Pessac
http://pub.u-bordeaux3.fr/
Les volumes de Modernités sont aussi disponibles sur le site
"Le Comptoir Des Presses d'Universités"
http://www.lcdpu.fr
Modernites34.indd 219 19/09/12 11:19
Mis en page et imprimé par
Pleine Page à Bordeaux
en septembre 2012
Modernites34.indd 220 19/09/12 11:19
S-ar putea să vă placă și
- Lire, se mêler à la poésie contemporaine.: Littérature françaiseDe la EverandLire, se mêler à la poésie contemporaine.: Littérature françaiseEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Pierre Audiat - La Biographie de L'oeuvre LittéraireDocument296 paginiPierre Audiat - La Biographie de L'oeuvre LittéraireAndromacaxanthusÎncă nu există evaluări
- Les Écrivains devant l'impressionnisme de Denys Riout: Les Fiches de Lecture d'UniversalisDe la EverandLes Écrivains devant l'impressionnisme de Denys Riout: Les Fiches de Lecture d'UniversalisÎncă nu există evaluări
- ROBIN, Regine - Nous Autres, Les AutresDocument354 paginiROBIN, Regine - Nous Autres, Les AutresRodrigo FonsecaÎncă nu există evaluări
- À la recherche du temps perdu de Marcel Proust: Les Fiches de lecture d'UniversalisDe la EverandÀ la recherche du temps perdu de Marcel Proust: Les Fiches de lecture d'UniversalisÎncă nu există evaluări
- Potlatch - I.L. - Guy Debord (FR)Document174 paginiPotlatch - I.L. - Guy Debord (FR)fruuxx100% (1)
- Une saison en enfer: un recueil de poèmes en prose d'Arthur RimbaudDe la EverandUne saison en enfer: un recueil de poèmes en prose d'Arthur RimbaudÎncă nu există evaluări
- Les Mots de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisDe la EverandLes Mots de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisÎncă nu există evaluări
- Aline Mura-Brunel - Silences Du Roman - Balzac Et Le Romanesque Contemporain (Faux Titre 252) (2004) PDFDocument328 paginiAline Mura-Brunel - Silences Du Roman - Balzac Et Le Romanesque Contemporain (Faux Titre 252) (2004) PDFDhafer OuazÎncă nu există evaluări
- La Demeure, La Souche: APPARENTEMENTS DE L'ARTISTE GEORGES DIDI-HUBERMANDocument178 paginiLa Demeure, La Souche: APPARENTEMENTS DE L'ARTISTE GEORGES DIDI-HUBERMANZhao Benqi ZhaoÎncă nu există evaluări
- Didi-Huberman, Georges - Ressemblance Mythifiee Et Ressemblance Oubliee Chez Vasari - La Legende Du Portrait SurDocument67 paginiDidi-Huberman, Georges - Ressemblance Mythifiee Et Ressemblance Oubliee Chez Vasari - La Legende Du Portrait SurAnonymous Ko9TtBC40% (1)
- Topographies Du Souvenir - WITTE, Bernd (Dir.)Document144 paginiTopographies Du Souvenir - WITTE, Bernd (Dir.)Bruno GaudêncioÎncă nu există evaluări
- Le neveu de Rameau: Analyse complète de l'oeuvreDe la EverandLe neveu de Rameau: Analyse complète de l'oeuvreÎncă nu există evaluări
- Les salons littéraires: De l'hôtel de Rambouillet… sans précautionDe la EverandLes salons littéraires: De l'hôtel de Rambouillet… sans précautionÎncă nu există evaluări
- La Communauté Désoeuvrée PDFDocument22 paginiLa Communauté Désoeuvrée PDFMoi RomeroÎncă nu există evaluări
- LArt Du Portrait Conceptuel. Deleuze Et PDFDocument10 paginiLArt Du Portrait Conceptuel. Deleuze Et PDFslim tobeÎncă nu există evaluări
- Les Ecrits de Jean Starobinski PDFDocument44 paginiLes Ecrits de Jean Starobinski PDFSoledad RodriguezÎncă nu există evaluări
- A Bossert Histoire de La Littérature AllemandeDocument816 paginiA Bossert Histoire de La Littérature AllemandeAndré BlitteÎncă nu există evaluări
- DIDI-HUBERMAN Georges - Ma Pratique Est D'écriture Autant Que de RegardDocument1 paginăDIDI-HUBERMAN Georges - Ma Pratique Est D'écriture Autant Que de RegardEduardo SterziÎncă nu există evaluări
- Inventaire Blasie CendrarsDocument372 paginiInventaire Blasie CendrarsFRANCISCO JAVIER PIZARRO OBAIDÎncă nu există evaluări
- Petit traité de l’insignifiance: Ces mots qui ne valent rien ou presqueDe la EverandPetit traité de l’insignifiance: Ces mots qui ne valent rien ou presqueÎncă nu există evaluări
- Esthétique (Friedrich Hegel (Hegel, Friedrich) )Document1.346 paginiEsthétique (Friedrich Hegel (Hegel, Friedrich) )Anas Benayad100% (1)
- Textes Sur Attila JoszefDocument126 paginiTextes Sur Attila JoszefSylvia NerinaÎncă nu există evaluări
- (Faux Titre 358) Perec - Zeitlichkeit - Reggiani, Christelle - Perec, Georges-L' Éternel Et L'éphémère - Temporalités Dans L'œuvre de Georges Perec-Rodopi (2010) PDFDocument194 pagini(Faux Titre 358) Perec - Zeitlichkeit - Reggiani, Christelle - Perec, Georges-L' Éternel Et L'éphémère - Temporalités Dans L'œuvre de Georges Perec-Rodopi (2010) PDFnbozekidisÎncă nu există evaluări
- Cahier #22: Jean DubuffetDocument5 paginiCahier #22: Jean DubuffetHerne EditionsÎncă nu există evaluări
- Lire dans la nuit et autres essais: Pour Jacques DerridaDe la EverandLire dans la nuit et autres essais: Pour Jacques DerridaÎncă nu există evaluări
- GiDe, A. Les Limites de L'artDocument32 paginiGiDe, A. Les Limites de L'artDavidÎncă nu există evaluări
- L'Archive D'un Coup de DésDocument941 paginiL'Archive D'un Coup de DésAlexander CaroÎncă nu există evaluări
- LIVRE-REVUE-LITTÉRATURE-nº 52-Georges BatailleDocument137 paginiLIVRE-REVUE-LITTÉRATURE-nº 52-Georges Bataillesdoreau001Încă nu există evaluări
- Les Impasses de l'Art moderne: Langage et crise du sensDe la EverandLes Impasses de l'Art moderne: Langage et crise du sensÎncă nu există evaluări
- Stévance. Duchamp, Compositeur PDFDocument295 paginiStévance. Duchamp, Compositeur PDFLorenaÎncă nu există evaluări
- Soupault - Aui Est Vous de Bernard MolinoDocument55 paginiSoupault - Aui Est Vous de Bernard MolinoAndres Santana MedinaÎncă nu există evaluări
- La Littérature à l'ère de la photographie de Philippe Ortel: Les Fiches de Lecture d'UniversalisDe la EverandLa Littérature à l'ère de la photographie de Philippe Ortel: Les Fiches de Lecture d'UniversalisÎncă nu există evaluări
- Poétique d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisDe la EverandPoétique d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisÎncă nu există evaluări
- Tragédie: Les Grands Articles d'UniversalisDe la EverandTragédie: Les Grands Articles d'UniversalisÎncă nu există evaluări
- VI - Usages Et Variations (249-376) PDFDocument128 paginiVI - Usages Et Variations (249-376) PDFgfyourslfÎncă nu există evaluări
- Revue Formules, Revue Des Littératures À Contraintes #5 Pastiches Collages Et Autres ReecrituresDocument304 paginiRevue Formules, Revue Des Littératures À Contraintes #5 Pastiches Collages Et Autres ReecrituresSCHIAVETTA Angel BernardoÎncă nu există evaluări
- 1le Clézio Lecteur de MichauxDocument5 pagini1le Clézio Lecteur de MichauxWriterInc100% (1)
- Avec Les Poèmes. Par Serge MartinDocument244 paginiAvec Les Poèmes. Par Serge MartinAbdelaziz AlarabyÎncă nu există evaluări
- LAPPRAND M (2020) Pourquoi L'oulipoDocument177 paginiLAPPRAND M (2020) Pourquoi L'oulipoAlexandre GuimarãesÎncă nu există evaluări
- Zola Ou La Fenêtre Condamnée, La Crise de La Représentation Dans Les Rougon-MacquartDocument1.793 paginiZola Ou La Fenêtre Condamnée, La Crise de La Représentation Dans Les Rougon-MacquartCharlotte WangÎncă nu există evaluări
- Nicephore Baudelaire 0514Document61 paginiNicephore Baudelaire 0514MarianadeCaboÎncă nu există evaluări
- Pouillaude - Les Inconsoleės Ou La Noirceur Lyrique Du Deesir - Alain Buffard - 5 - 3 - 2020 - 320 Pages - P5-7 PDFDocument6 paginiPouillaude - Les Inconsoleės Ou La Noirceur Lyrique Du Deesir - Alain Buffard - 5 - 3 - 2020 - 320 Pages - P5-7 PDFWilfried LaforgeÎncă nu există evaluări
- Devant Le Temps. Didi-HubermanDocument5 paginiDevant Le Temps. Didi-Hubermanmorgan385Încă nu există evaluări
- Dubuffet Jean Asphyxiante Culture Ed AugmenteeDocument120 paginiDubuffet Jean Asphyxiante Culture Ed Augmenteewawaou412Încă nu există evaluări
- Le Magazine LittéraireDocument4 paginiLe Magazine LittéraireJesus Alberto Peña PeñaÎncă nu există evaluări
- La Route de Cormac McCarthy (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreDe la EverandLa Route de Cormac McCarthy (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreÎncă nu există evaluări
- Hokusai, le fou génial du Japon moderne: Essai sur l'artDe la EverandHokusai, le fou génial du Japon moderne: Essai sur l'artÎncă nu există evaluări
- Berardi, Franco - Le Ciel Est Enfin Tombé Sur La Terre (1978, Éditions Du Seuil) - Libgen - LiDocument197 paginiBerardi, Franco - Le Ciel Est Enfin Tombé Sur La Terre (1978, Éditions Du Seuil) - Libgen - LiAla AfiÎncă nu există evaluări
- Pierre Missac - Aphorisme Et Paragramme PDFDocument7 paginiPierre Missac - Aphorisme Et Paragramme PDFMark CohenÎncă nu există evaluări
- Manuel et anthologie de littérature belge à l'usage des classes terminales de l'enseignement secondaire: Anthologie littéraireDe la EverandManuel et anthologie de littérature belge à l'usage des classes terminales de l'enseignement secondaire: Anthologie littéraireÎncă nu există evaluări
- Bibliographie Des Écrits de Maurice BlanchotDocument92 paginiBibliographie Des Écrits de Maurice BlanchotParham ShahrjerdiÎncă nu există evaluări
- Zazie dans le métro de Raymond Queneau (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreDe la EverandZazie dans le métro de Raymond Queneau (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreÎncă nu există evaluări
- À Lyon 2, Un Étudiant Dénonce Une Obsession Pour Les Questions de Genre Et de RaceDocument8 paginiÀ Lyon 2, Un Étudiant Dénonce Une Obsession Pour Les Questions de Genre Et de RaceAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- (Bibliothèque D'humanisme Et Renaissance Vol. 54 Iss. 1) Henri Busson - LA PRATIQUE RELIGIEUSE DE MONTAIGNE (1992) (10.2307 - 20679238) - Libgen - LiDocument17 pagini(Bibliothèque D'humanisme Et Renaissance Vol. 54 Iss. 1) Henri Busson - LA PRATIQUE RELIGIEUSE DE MONTAIGNE (1992) (10.2307 - 20679238) - Libgen - LiAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- La Folie Identitaire Est Ce Qui Nous Menace Le Plus - K. Les Juifs, L'europe, Le XXIe SiècleDocument11 paginiLa Folie Identitaire Est Ce Qui Nous Menace Le Plus - K. Les Juifs, L'europe, Le XXIe SiècleAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- (MétaphysiqueS) Emmanuel Alloa - Élie During - Choses en Soi - Métaphysique Du Réalisme-Presses Universitaires de France (PUF) (2018)Document571 pagini(MétaphysiqueS) Emmanuel Alloa - Élie During - Choses en Soi - Métaphysique Du Réalisme-Presses Universitaires de France (PUF) (2018)Asher GutkindÎncă nu există evaluări
- André Comte-Sponville - L'esprit de L'athéisme - Introduction À Une Spiritualité Sans Dieu 2006, Editions Albin Michel PDFDocument140 paginiAndré Comte-Sponville - L'esprit de L'athéisme - Introduction À Une Spiritualité Sans Dieu 2006, Editions Albin Michel PDFAsher Gutkind100% (1)
- (Bibliothèque D'humanisme Et Renaissance Vol. 16 Iss. 1) Henri Busson - LA PRATIQUE RELIGIEUSE DE MONTAIGNE (1954) (10.2307 - 20673680) - Libgen - Li PDFDocument11 pagini(Bibliothèque D'humanisme Et Renaissance Vol. 16 Iss. 1) Henri Busson - LA PRATIQUE RELIGIEUSE DE MONTAIGNE (1954) (10.2307 - 20673680) - Libgen - Li PDFAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Catalogue QuartoDocument40 paginiCatalogue QuartoAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Marion - Grondin PDFDocument5 paginiMarion - Grondin PDFAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- À La Recherche Du Socialisme Démocratique. La Pensée Politique de George Orwell Et de Simone Weil - Revue EspritDocument11 paginiÀ La Recherche Du Socialisme Démocratique. La Pensée Politique de George Orwell Et de Simone Weil - Revue EspritAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Sur Grondin Sens VieDocument11 paginiSur Grondin Sens VieAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Renaud Barbaras - L&rsquo Appartenance. Vers Une Cosmologie PhénoménologiqueDocument12 paginiRenaud Barbaras - L&rsquo Appartenance. Vers Une Cosmologie PhénoménologiqueAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Arthur Chevallier - Le Faux Débat Sur Les Bombardements Alliés Contre L'allemagne Nazie - Le PointDocument5 paginiArthur Chevallier - Le Faux Débat Sur Les Bombardements Alliés Contre L'allemagne Nazie - Le PointAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Littérature Et Exemplarité - Not Erudition, Empathy L'exemplarité Morale de La Littérature Selon Martha Nussbaum - Presses Universitaires de RennesDocument16 paginiLittérature Et Exemplarité - Not Erudition, Empathy L'exemplarité Morale de La Littérature Selon Martha Nussbaum - Presses Universitaires de RennesAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Wolff Francis - L'universel, Seule Voie Possible de L'émancipation - AOC Media - Analyse Opinion CritiqueDocument8 paginiWolff Francis - L'universel, Seule Voie Possible de L'émancipation - AOC Media - Analyse Opinion CritiqueAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Quand Claude Simon Réécrit Hommage À La Catalogne - JJ RosatDocument20 paginiQuand Claude Simon Réécrit Hommage À La Catalogne - JJ RosatAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Agreg Ext Lve Espagnol 1274877Document19 paginiAgreg Ext Lve Espagnol 1274877Asher GutkindÎncă nu există evaluări
- Bernard Lahire, Sociologue - Chacun Est Renvoyé À Sa Condition de Classe - ASH - Actualités Sociales HebdomadairesDocument4 paginiBernard Lahire, Sociologue - Chacun Est Renvoyé À Sa Condition de Classe - ASH - Actualités Sociales HebdomadairesAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Réalisme Moral (A) - L'Encyclopédie PhilosophiqueDocument28 paginiRéalisme Moral (A) - L'Encyclopédie PhilosophiqueAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Constructivisme Métaéthique (A) - L'Encyclopédie PhilosophiqueDocument24 paginiConstructivisme Métaéthique (A) - L'Encyclopédie PhilosophiqueAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Création (A) - L'Encyclopédie PhilosophiqueDocument27 paginiCréation (A) - L'Encyclopédie PhilosophiqueAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Éducation Politique Et Art Du Roman Réflexions Sur 1984 - JJ RosatDocument20 paginiÉducation Politique Et Art Du Roman Réflexions Sur 1984 - JJ RosatAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Alain Supiot - La Refondation de L'europe Ne Pourra Se Faire Sans Sortir Des Traités ActuelsDocument9 paginiAlain Supiot - La Refondation de L'europe Ne Pourra Se Faire Sans Sortir Des Traités ActuelsAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- IliadeDocument34 paginiIliadesorinrrrÎncă nu există evaluări
- Création (GP) - L'Encyclopédie PhilosophiqueDocument8 paginiCréation (GP) - L'Encyclopédie PhilosophiqueAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- The Aporias of PropertyDocument8 paginiThe Aporias of PropertyAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Neostoicisme - Philosophie Par Gros TempsDocument5 paginiNeostoicisme - Philosophie Par Gros TempsAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Amselle - Contre Le Relativisme, L'humanisme - Sur Francis Wolff, Plaidoyer Pour L'universel (2019)Document5 paginiAmselle - Contre Le Relativisme, L'humanisme - Sur Francis Wolff, Plaidoyer Pour L'universel (2019)Asher GutkindÎncă nu există evaluări
- Le Hantement Du Monde - Barrières D'espèces, Barrières D'espaceDocument42 paginiLe Hantement Du Monde - Barrières D'espèces, Barrières D'espaceAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Sansonetti-Que Nous Disent Les Sérologies ? Covid-19, Chronique D'une Émergence AnnoncéeDocument10 paginiSansonetti-Que Nous Disent Les Sérologies ? Covid-19, Chronique D'une Émergence AnnoncéeAsher GutkindÎncă nu există evaluări
- Le Reporting RSEDocument4 paginiLe Reporting RSENGATCHOU AROUNAÎncă nu există evaluări
- Sociologie PolitiqueDocument7 paginiSociologie PolitiqueMatio ZaraÎncă nu există evaluări
- Suis-Je Prêt (E) À Devenir Manager Coach - Devenir Manager Coach Avec MerlinDocument1 paginăSuis-Je Prêt (E) À Devenir Manager Coach - Devenir Manager Coach Avec MerlinMartin COIGNETÎncă nu există evaluări
- 2187 20161113 PDFDocument15 pagini2187 20161113 PDFelmoudjahid_dzÎncă nu există evaluări
- Barbaras - L'ambiguïté de La Chair. Merleau-Ponty Entre Philosophie Transcendantale Et Ontologie de La VieDocument8 paginiBarbaras - L'ambiguïté de La Chair. Merleau-Ponty Entre Philosophie Transcendantale Et Ontologie de La VieBad AÎncă nu există evaluări
- APPEL - AOUT 2023 REVUE DELLA AFRIQUE - VOL - 5 No 13-1Document3 paginiAPPEL - AOUT 2023 REVUE DELLA AFRIQUE - VOL - 5 No 13-1Issa Justin LaougueÎncă nu există evaluări
- Mémoire - CopieDocument85 paginiMémoire - CopieÆbđęł Wāhäb100% (1)
- Suisse Plan D'études 2021 - 2022Document64 paginiSuisse Plan D'études 2021 - 2022Pura SainteÎncă nu există evaluări
- TP2 de La Classe TS7Document3 paginiTP2 de La Classe TS7aliÎncă nu există evaluări
- Valeur Absolue - Feuille D'exercicesDocument2 paginiValeur Absolue - Feuille D'exercicesAkram FadelÎncă nu există evaluări
- Rapport DpeDocument61 paginiRapport DpeHassan NhiriÎncă nu există evaluări
- PongeDocument102 paginiPongeSilvia Corolenco100% (1)
- Séquence 2-Les NombresDocument9 paginiSéquence 2-Les NombresElisaM98Încă nu există evaluări
- Sujet : En quoi les différences entre les garçons et les filles observées durant la Socialisation primaire influencent-elles les choix d’orientation scolaires et professionnels différents des hommes et des femmesDocument5 paginiSujet : En quoi les différences entre les garçons et les filles observées durant la Socialisation primaire influencent-elles les choix d’orientation scolaires et professionnels différents des hommes et des femmesMme et Mr LafonÎncă nu există evaluări
- Flyer ParcoursupDocument4 paginiFlyer ParcoursupSidya ToureÎncă nu există evaluări
- (Mod) (TD) HelicoptereDocument2 pagini(Mod) (TD) Helicoptereess_mnsÎncă nu există evaluări
- Guide Orientation 2024 OMNES EducationDocument25 paginiGuide Orientation 2024 OMNES Educationsa.st.lemaitreÎncă nu există evaluări
- Formation Analyse Des Donnc3a9esv2019 1 PDFDocument49 paginiFormation Analyse Des Donnc3a9esv2019 1 PDFHoussem HaddedÎncă nu există evaluări