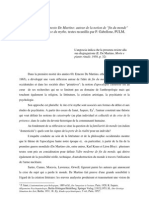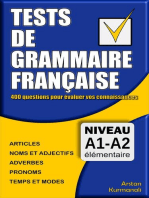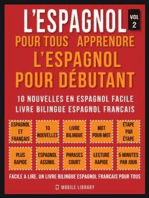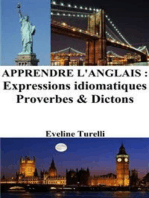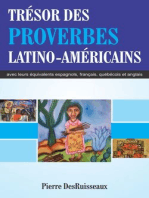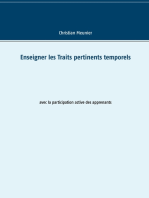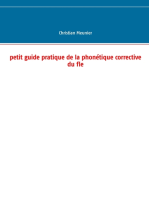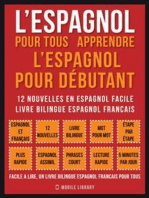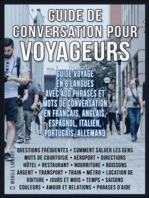Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
O.Remaud-Langue Des Temps Sombres
Încărcat de
Iannu DolmannTitlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
O.Remaud-Langue Des Temps Sombres
Încărcat de
Iannu DolmannDrepturi de autor:
Formate disponibile
La langue des temps sombres
Canetti, Klemperer, Benjamin
Olivier Remaud
Quels rapports la violence entretient-elle avec la langue*? Que se passe-
t-il lorsqu’elle prend la langue vivante pour cible, qu’elle la transforme en
une langue majoritaire qui tend à gommer les usages linguistiques minori-
taires, voire en une langue totalitaire qui épuise l’imagination verbale en la
soumettant à l’emprise de la servitude volontaire? Peut-être devons-nous
commencer par définir la logique intime de la violence – nous aborderons
ensuite la question de son hybridation monstrueuse avec la langue. Dans
l’un des textes qui composent le recueil Difficile liberté, Lévinas remarque
que l’action violente est une « action où l’on agit comme si on était seul à
agir: comme si le reste de l’univers n’était là que pour recevoir l’action; est
violente, par conséquent, aussi toute action que nous subissons sans en être
en tous points les collaborateurs1 ». La violence possède donc deux caracté-
ristiques. D’une part, elle s’alimente d’une illusion constitutive, c’est-à-dire
d’une fiction de la volonté qui s’imagine tellement sur-puissante et auto-
nome qu’elle pense pouvoir déterminer à elle seule le sort du « reste de
l’univers ». D’autre part, elle n’est jamais une véritable action puisqu’elle
empêche autrui de se la réapproprier et de devenir lui-même co-acteur. En
songeant peut-être à Spinoza, Lévinas suggère que la violence se forme dès
le moment où un individu décide de ne plus appartenir au monde commun
des actions et estime, tel un « empire dans un empire », qu’il est la cause
unique de ses faits comme de ses gestes2. Cette décision subjective est à
l’évidence une décision de maîtrise qui contredit la nécessité du sens
commun, que l’on entendra ici comme un sens de la communauté. Elle
conduit immanquablement à rejeter autrui dans le monde des effets pour
mieux parfois le transformer en une éternelle victime. Dans l’Idiot de Dos-
toïevsky, le prince Mychkine incarne à merveille la figure du semblable qui
« reçoit » toujours l’action. Mais lorsque le jeu de la volonté avec ses pro-
* Ce texte a été publié dans Diogène n. 189, printemps 2000, p. 14–32. Il est issu
d’une conférence donnée à l’Institut des Hautes Études sur la Justice (Paris, avril
1999). Je remercie A. Garapon et T. Pech de leur invitation.
1 « Éthique et esprit », Lévinas (1988), p. 18.
2 La formule est de Spinoza, voir Éthique, III, préface.
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
218 Olivier Remaud
pres miroirs devient démesuré, l’individu tyrannique finit toujours par
confondre la réalité du monde avec la confiance excessive qu’il accorde à
ses préjugés. Depuis au moins les analyses du psychiatre Minkowski, on
sait bien que plus la certitude qui accompagne naturellement le préjugé
s’étend et prend de l’ampleur jusqu’à frôler le délire, et plus la violence est
susceptible d’augmenter.
I. Puissance et survivance
Lorsqu’il remonte à la compréhension des structures fondamentales de la
violence et de la puissance par le biais d’une analyse de la paranoïa, Ca-
netti porte sur la folie le même type de regard que l’auteur du Traité de
psychopathologie. Attentif à l’être psychique conscient de l’homme, et non
à l’aspect nerveux des maladies mentales, Minkowski avait insisté sur le
rôle de la « conviction délirante » dans l’économie générale de la folie et
développé l’idée que la logique du fait psycho-pathologique s’appuie tou-
jours sur un certain nombre de certitudes absolues3. Le délire se fonde sur
une série d’évidences inflexibles qui expliquent notamment que le monde
de la folie apparaît au clinicien souvent plus cohérent que celui de l’homme
dit « normal ». En prenant pour modèle le cas de Schreber, ancien Président
du Sénat de Dresde et grand paranoïaque devant l’Éternel, Canetti dégage
également « l’aspect intérieur » de la puissance ainsi que son but. Faute de
savoir exactement comment on l’« obtient », il s’efforce de connaître ce
qu’elle « vise ». À partir de l’exemple d’un individu qui est radicalement
convaincu d’être l’unique survivant d’une catastrophe effroyable au terme
de laquelle l’humanité aurait connu sa ruine, il montre que ce que vise la
puissance, c’est la survie. En une phrase lapidaire, Canetti résume sa thèse
centrale: « la situation de survie est la situation centrale de la puissance4 ».
Que faut-il entendre ici par « survie »?
Ce qui est en question, c’est un certain rapport de la vie à la mort, d’où
se déduit une position de puissance. Rappelons que Freud lui-même an-
nonce dans ses Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, pu-
bliées en 1915 dans le bruit et la fureur, combien la guerre des tranchées
est en train de désillusionner l’humanité en lui imposant une nouvelle vi-
sion de la mort. Non seulement le mythe « d’une communauté de civilisa-
tion » et l’illusion d’une « citoyenneté du monde » s’effondrent ensemble,
mais chacun découvre de surcroît, en son for intérieur, qu’il ne lui est plus
possible de « dénier » la mort. Dorénavant « on est forcé de croire en elle5 ».
Certes, Canetti n’apprécie guère Freud et encore moins les freudiens que
3 Voir Minkowski (1966), p. 14–16.
4 « Puissance et survie , Canetti (1989), p. 32–33.
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
La langue des temps sombres 219
leur jargon éloigne des réalités psychiques6. Ce qu’il met sous le terme de
« survie » désigne pourtant un rapport de la vie à la mort qui s’avère tout
aussi « ambivalent » et marqué par une dénégation identique. Le « survi-
vant » continue en effet de dénier la mort parce qu’il ne croit pas à sa mort
personnelle. De même, le « héros » s’apparente au « survivant » car il a be-
soin de se confronter à la mort pour se sentir véritablement vivre. Plus les
morts s’entassent et plus la perception de son existence individuelle est jus-
tifiée7. La clé du délire paranoïaque réside dans la systématisation de cette
impression de survivance. Lorsqu’il est poussé à son extrême, le délire pa-
ranoïaque correspond exactement à une représentation de la vie qui ne peut
plus être vécue autrement que sur le mode d’une immortalité arrachée à la
boue des circonstances et conquise sur la quantité des morts que l’on n’est
pas soi-même.
Le cas de Schreber fascine Canetti parce qu’il lui fournit simultanément
une analogie d’expérience avec le pouvoir souverain. À l’égal du para-
noïaque, le pouvoir souverain se caractérise par le « besoin d’invulnérabi-
lité » et la « passion de survivre8 ». Il se soustrait aux fictions contractualis-
tes en éliminant le pacte qui consacre traditionnellement la sortie définitive
de l’état de violence naturelle. Le nouveau contexte des « sombres temps »,
selon l’expression de Hannah Arendt, l’événement de la bombe atomique et
les diverses flambées de nationalisme ont révélé à Canetti que la violence
et la mort sont consubstantielles à la souveraineté. Conduit par les faits
eux-mêmes au bord de la falaise, il n’hésite pas à avancer que le cas Schre-
ber est une « réplique exacte » de tous les souverains, Hitler y compris.
Comme Schreber, Hitler a en effet l’impression d’être un survivant. Pour
lui, « le sentiment de la masse des morts est décisif9 ». Les morts de la
5 Du même coup, non seulement le « secret de l’héroïsme » est découvert mais la
vie « est redevenue intéressante, elle a retrouvé tout son contenu », dans Freud
(1981), p. 29.
6 Sur les différences entre Freud et Canetti, on se reportera à l’article de Revault
d’Allonnes (1995), p. 99–106.
7 « Quiconque a fait la guerre connaît ce sentiment d’élévation au-dessus des
morts. Le deuil des camarades peut le recouvrir; mais ceux-ci sont peu nombreux,
tandis que le nombre des morts ne fait qu’augmenter. Le sentiment de force qui
vient d’être en vie contrairement à eux est plus fort que toute affliction, c’est un
sentiment d’élection, tandis que le destin de tous les autres est manifestement iden-
tique. Du simple fait que l’on est encore là, on se sent de quelque façon le meilleur.
On a fait ses preuves, puisqu’on vit. On s’est affirmé entre beaucoup, puisque tous
ces gisants ne vivent point. Qui réussit à survivre souvent est un héros. Il est plus
fort. Il possède davantage de vie », dans Canetti (1986), p. 242 (c’est l’auteur qui
souligne).
8 Ibid., p. 490.
9 « Hitler d’après Speer », Canetti (1989), p. 219.
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
220 Olivier Remaud
guerre de 1914 sont ses morts: « c’est sa masse proprement dite » et cette
« masse des victimes assassinées réclame son accroissement10 ». En tant que
survivant, Hitler doit lui rester fidèle. Soumis à l’« illusion de croissance
continue » qui gouverne la masse dont il est le réchappé, il choisit par
conséquent de poursuivre la gloire et la grandeur dans l’approfondissement
du désastre de la Première Guerre mondiale. Avec l’extension de la guerre,
les morts du temps présent ne cessent de s’ajouter aux morts du temps
passé. Très rapidement, ils forment de nouveau une seule masse à l’unique
dimension et en vertu d’un cercle infernal, le sentiment de survie d’Hitler
se renforce.
II. La langue blessée
De l’hypothèse d’une volonté individuelle toute-puissante à l’analyse de
la constitution autiste de la souveraineté, comment la violence en vient-elle
à croiser la notion de langue? En reprenant la formule de Lévinas, peut-on
« recevoir l’action » dans la langue? Pour aborder ces deux points, une défi-
nition minimale et fonctionnelle de la langue est ici nécessaire. Si l’on suit
les enseignements des linguistes, parmi lesquels Saussure dans son Cours
de linguistique générale ou encore Benveniste, il convient de distinguer la
langue de la parole. Dans les termes de Chomsky, le propre de la langue
est d’offrir une « compétence » que la parole se charge de réaliser et de
mettre en action, un peu comme les muscles donnent vie à la simple ossa-
ture. La parole, elle, se définit comme la somme des actes qui permettent à
une compétence de devenir une « performance ». Aussi est-ce par la parole,
dans sa dimension concrète, que l’on peut remonter au plan abstrait de la
langue, cette dernière jouant en fait le rôle d’une sorte de transcendantal de
toutes les expériences de langage. Tout le monde dispose de la langue, qui
désigne le plan du collectif, tandis qu’il dépend de l’individu en particulier
d’opérer son passage à l’acte. De ce point de vue, non seulement la diffé-
rence entre la langue et la parole rend le langage possible mais la langue
permet également à chacun de saisir ce que dit son semblable. La langue
est la capacité de la parole tout comme elle est le trésor de la communauté
humaine.
Cet équilibre fonctionnel entre la langue et la parole se maintient-il
lorsque la violence s’immisce dans le langage? À cette question, il convient
de répondre par la négative car en s’appliquant aux mots, la violence tente
de viser la langue dans son essence, à la fois comme condition de la parole
et milieu du sens commun. Ce faisant, elle exerce son emprise sur l’intimité
de l’individu. Elle cherche à brouiller le rapport que chacun entretient avec
10 Ibid., p. 222 (c’est l’auteur qui souligne).
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
La langue des temps sombres 221
la langue fondamentale et collective qui est la sienne. Tel est bien ce que
pressent Arendt lorsqu’elle affirme que, même durant les temps les plus
amers, sa langue maternelle n’est pas devenue folle11.
On trouve une analyse remarquable de ce jeu pervers de la violence avec
la langue dans l’ouvrage que Victor Klemperer consacre à la « LTI », une
abréviation latine qui désigne la « Langue du Troisième Reich » (Lingua
Tertii Imperii). En mêlant les deux plans de l’expérience vécue et de l’ob-
servation scientifique, Klemperer décrit l’évolution de l’esprit d’une nation
– en l’occurrence, l’Allemagne des années 1930 et suivantes – à partir des
modifications que subit son vocabulaire. Il analyse avec minutie les
comportements linguistiques d’une époque qui est très exactement confron-
tée à ce que Canetti nomme la « situation de puissance ». Son expérience de
professeur de philologie l’autorise à être particulièrement attentif aux nom-
breux phénomènes de mémoire involontaire qui lui révèlent, mieux qu’au-
cun autre signe, le travail destructeur d’une langue manipulée. Dans la mé-
moire involontaire, c’est en effet une sorte de langue inconnue qui parle à
la place de la parole. On se doute que cette langue inconnue est encore la
langue allemande. Mais l’atmosphère d’« inquiétante étrangeté » qui entoure
chacun des termes qui est prononcé conduit le philologue à penser que la
parole quotidienne se trouve trop régulièrement dessaisie d’elle-même et
traversée par d’incontrôlables résurgences sémantiques:
on cite toujours cette phrase de Talleyrand, selon laquelle la langue serait là pour
dissimuler les pensées du diplomate (ou de tout homme rusé et douteux en géné-
ral). Mais c’est exactement le contraire qui est vrai. Ce que quelqu’un veut déli-
bérément dissimuler, aux autres ou à soi-même, et aussi ce qu’il porte en lui in-
consciemment, la langue le met au jour12.
Tout se passe comme si une autre langue s’exprimait dans la parole.
Cette autre langue n’est pas la langue qui conditionne l’exercice de la pa-
role et enrichit le sens commun mais la « langue du vainqueur » que tout le
monde, y compris les « vaincus », adoptent sans y penser. L’épicier du quar-
tier invoque ainsi une « radieuse Weltanschauung » pour ponctuer ses fins
de phrase sans savoir naturellement que cette expression était particulière-
ment en vogue dans les cénacles néo-romantiques du début du siècle et que
la décision politique et gouvernementale d’en renouveler l’usage revendique
explicitement cette longue tradition d’opposition à la pensée logique et ra-
tionnelle13. Un tel exemple montre bien que la LTI mise sur le « potentiel
énergétique dont dispose tout syntagme ». Ce type de potentiel continue
11« Ce n’est tout de même pas la langue allemande qui est devenue folle! », voir
Arendt (1997), p. 240.
12 Klemperer (1998), p. 35.
13 Ibid., p. 191–198 (ch. 22).
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
222 Olivier Remaud
d’agir même lorsqu’on le décroche de son « réseau historique d’origine14 »
et il attend, à l’image d’une petite bombe à retardement, le moment de son
explosion. Les mots de la LTI sont comparables à de « minuscules doses
d’arsenic; on les avale sans y prendre garde, elles semblent ne faire aucun
effet, et voilà qu’après quelque temps, l’effet toxique se fait sentir15 ». Lors-
qu’une formule revient en mémoire, c’est presque toujours par surprise et
sans que l’individu puisse jamais savoir précisément d’où elle provient.
À l’image du novlangue d’Orwell, la LTI mobilise beaucoup de termes
qui sont déjà connus de tous. Par le jeu des combinaisons verbales, entre
les préfixes qu’elle retire et les suffixes qu’elle ajoute, elle donne progressi-
vement à ces termes de la vie quotidienne une autre signification. Adepte
des usages détournés, elle les réinvestit très souvent dans un contexte non
neutre en les répétant de manière abusive. Les nazis ont ainsi employé le
mot « fanatique » de façon si obsessionnelle et décalée qu’ils ont réussi à
contredire la langue allemande elle-même, qui a pourtant toujours connoté
négativement ce terme, en lui prêtant pour la première fois un sens laudatif.
La répétition tue le sens, comme un poison qui agit lentement ou, selon
l’expression que Klemperer emprunte à Schiller pour mieux l’appliquer à la
LTI, comme une « langue qui poétise et pense à ta place ». Et la parole
n’est plus dès lors la conscience de la langue.
III. Croyance et déresponsabilisation
La meilleure manière de bloquer toute évolution réelle des usages lin-
guistiques semble donc de figer la syntaxe et d’immobiliser les signifiants.
On frappe la langue en son cœur et l’on invalide par la même occasion la
part la plus disponible de la mémoire collective. La grammaire de tous les
jours ne canalise plus que des expressions prédéterminées auxquelles finis-
sent par correspondre des affects eux-mêmes modelés.
À cet égard, il faut certainement méditer longuement sur le passage dans
lequel Klemperer relate sa rencontre, après la guerre, avec l’un de ses an-
ciens élèves qui a décidé de ne pas se porter candidat à la réhabilitation.
Selon toute vraisemblance, ce jeune homme n’a jamais été militant. Pour
quelles raisons n’a-t-il pas demandé à être reconnu « victime du nazisme »,
à titre de personne qui aurait été contrainte d’adhérer au Parti? Pourquoi
n’a-t-il pas souhaité l’effacement public de sa honte? Klemperer se rend
compte avec stupéfaction que c’est la langue elle-même qui retient son an-
cien élève. Malgré l’incommensurabilité des crimes révélés, c’est elle qui le
14 Comme l’écrit Roger (1998), p. 204–205.
15 Klemperer (1998), p. 40.
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
La langue des temps sombres 223
pousse à déclarer à propos d’Hitler: « Je vous accorde tout cela. Ce sont les
autres qui l’ont mal compris, qui l’ont trahi. Mais en lui, en LUI, je crois
encore16 ». Telle est la force de ce que Klemperer nomme la « langue de
croyance ». Cette langue ne modifie pas seulement l’organisation séman-
tique du souvenir et l’histoire des usages linguistiques, elle crée une sorte
de dette incessible qui ne résulte d’aucune promesse préalable. Paradoxe
maximal de l’identité: comment, sans avoir passé aucun contrat, peut-on
s’enchaîner par la langue à une croyance?
Dans Masse et puissance, Canetti avance une hypothèse sur la nature de
l’ordre qui nous autorise peut-être à comprendre comment – et non pour-
quoi – un individu peut continuer, une fois la guerre terminée et les crimes
connus, à croire en un dictateur avéré. Que se passe-t-il en effet dans une
expérience de masse? Lorsqu’un individu « entre » dans une masse (qu’il
s’agisse de rites religieux de grande échelle ou d’une manifestation popu-
laire), il perd conscience de son identité. Il se « décharge » de toutes les
« charges de distance » qui pèsent sur lui dans la vie quotidienne. L’expé-
rience de masse est d’abord vécue sous la forme d’une sortie de soi qui
procure le « soulagement » spécifique de devenir enfin semblable à l’autre17.
Pour Canetti, le schizophrène fait également une expérience de masse (on
retrouve l’importance paradigmatique du cas de Schreber). Mais il trans-
porte la masse en lui. Au sens propre, il l’intériorise. Dans la mesure où
une masse vit en lui, le schizophrène se sent continuellement persécuté par
un certain nombre d’« aiguillons ». Ces aiguillons proviennent d’ordres qui
lui sont envoyés par une multitude incalculable d’âmes logées fantasmati-
quement à l’intérieur de son corps. Le monde subjectif du schizophrène est
un monde harcelé dont il tente parfois lui aussi de sortir afin de se « déchar-
ger » de la douleur causée par ces innombrables aiguillons.
Cette description de l’expérience de masse, dans son double aspect col-
lectif et individuel, amène Canetti à réfléchir plus profondément sur la na-
ture de l’ordre. Selon lui, tout ordre se décompose en un « aiguillon » et
une « impulsion »:
L’impulsion contraint qui le reçoit à l’exécuter, et ce conformément au contenu de
l’ordre. L’aiguillon reste au fond de celui qui exécute l’ordre. Quand les ordres
fonctionnent normalement, comme on l’attend d’eux, l’aiguillon reste invisible. Il
est secret, insoupçonné; ou alors, il se manifestera presque imperceptiblement par
une légère résistance précédant l’exécution de l’ordre. Mais l’aiguillon s’enfonce
profondément dans la personne qui a exécuté un ordre, et y demeure sans change-
ment. Il n’est pas de réalité psychique plus immuable. Le contenu de l’ordre persiste
dans l’aiguillon; sa force, sa portée, ses limites, tout a été préfiguré à jamais à l’ins-
16 Ibid., p. 163 (les majuscules sont dans le texte).
17 Canetti (1986), p. 14–15.
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
224 Olivier Remaud
tant même où l’ordre a été donné. Des années entières peuvent passer, voire des di-
zaines d’années, avant que cette partie engloutie et emmagasinée de l’ordre, son
image exacte en petit, fasse sa réapparition. Mais il faut savoir que jamais un ordre
ne s’efface; jamais son exécution ne l’épuise, il est mis en réserve pour toujours18.
L’aiguillon désigne une certaine mémoire de l’ordre. Il lui permet de ne
pas limiter ses effets au seul instant de l’exécution et d’agir sur la longue
durée. Le simple fait d’exécuter un ordre détermine la vie future de l’exé-
cutant. On n’oublie jamais un ordre. Son contenu prend la forme d’un des-
tin qui peut demeurer inconnu pendant des années mais qui resurgit à un
moment ou un autre, le plus souvent de manière involontaire. Plus ce
contenu se manifeste tardivement et plus il finit par apparaître à l’ancien
exécutant comme une cause naturelle qui devait arriver, contre laquelle per-
sonne ne pouvait s’élever. Significativement, cette assimilation de l’ordre
n’interdit pas sa mise à distance. L’aiguillon ne se borne pas à prolonger
l’ordre. Son autre fonction est de légitimer, en dernier recours, une psycho-
logie du déni de responsabilité. L’aiguillon devient alors « un intrus » dont
se sert l’exécutant pour ne pas s’accuser lui-même. C’est bien plutôt l’ai-
guillon qu’il accuse, cette
instance étrangère, le vrai fautif pour ainsi dire, qu’il transporte partout avec lui.
Plus l’ordre était étranger, moins on se sent en faute à cause de lui, plus il conti-
nue à vivre nettement détaché en aiguillon. Il est le témoin perpétuel que l’on n’a
pas été soi-même l’auteur de tel ou tel acte. On se sent sa victime, et il ne reste
alors pas le moindre sentiment pour la vraie victime19.
En suivant cette analyse de Canetti, on se dit que l’« aiguillon » est peut-
être le ressort le plus profond, et le plus commun, des « langues de
croyance ». Certes, l’ancien élève de Klemperer n’a pas connu d’expérien-
ces de masse, s’il est vrai qu’il n’a jamais été militant. Mais l’on sait que
le conditionnement linguistique des sociétés totalitaires est chaque fois si
efficace qu’il n’est jamais besoin d’aller assister à des meetings pour y suc-
comber. Truffée de slogans et d’« effets barnum », la langue change de vi-
sage. Elle devient littéralement « hystérique » (Klemperer). Chacun de ses
mots figure un ordre insidieux qui « aiguillonne » à son insu la mémoire
collective. Lévinas définissait la violence, on s’en souvient, par le fait de
« recevoir l’action » sans y collaborer « en tous points ». Avec Klemperer et
Canetti, on comprend maintenant que recevoir une action dans la langue ce
n’est pas seulement utiliser malgré soi les expressions d’une langue stéréo-
typée. C’est aussi être gouverné par les mots eux-mêmes. À tel point que
l’on néglige tragiquement, lorsque le moment se présente, l’impératif de la
vigilance personnelle ou la nécessité du monde commun20.
18 Ibid., p. 324.
19 Ibid., p. 352.
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
La langue des temps sombres 225
Le prix de cette attitude est d’autant plus lourd à payer que chacun es-
time pouvoir échapper aux effets pernicieux de la « langue de croyance »,
comme s’il suffisait d’y réfléchir une bonne fois. Mais dans un tel contexte,
personne ne le peut vraiment, pas même le philologue professionnel. Ce
qui vaut pour le mal de mer vaut également pour la langue:
À l’extrémité où nous étions, on était encore hors d’atteinte: on regardait, l’air
intéressé, on riait, on prenait un air narquois. Et puis, les vomissements se rappro-
chèrent, les rires se turent et, de notre côté aussi, on courut au bastingage. J’ob-
servais attentivement autour et à l’intérieur de moi. Je me disais qu’il existait
bien quelque chose comme une observation objective et que j’y avais été formé,
qu’il existait une volonté ferme, et je me réjouissais à la perspective du petit dé-
jeuner – cependant, mon tour arriva et je fus contraint de me précipiter au bastin-
gage exactement comme les autres21.
Le philologue est dans la même situation que l’homme ordinaire qui croit
pouvoir éviter le mal de mer et qui se rend compte, au dernier moment, que
cela lui est rigoureusement impossible. Il répète à son tour les expressions
qu’il entend autour de lui sans exercer son esprit critique de savant. Tout en
se reprochant régulièrement de n’être pas assez strict sur ses propres choix
de langage, il constate avec amertume qu’il cède lui aussi, malgré son sa-
voir, aux faux atours de la « langue de croyance » et qu’il lui arrive de per-
dre, comme bon nombre des collègues, la mémoire des vrais usages.
IV. La langue responsable
Comment donc retrouver un usage raisonnable de la langue? Comment
penser la responsabilité dans la langue? Pour le dire autrement, les mots
peuvent-ils maintenir « ouverts les accès entre les êtres22 »? Le cas des lan-
gues totalitaires est certainement exemplaire. Mais ce cas extrême ne doit
20 Dans son article sur Lessing, Hannah Arendt parle du phénomène d’« émigra-
tion intérieure » qui « implique d’une part qu’il y avait des hommes, à l’intérieur de
l’Allemagne, qui se conduisaient comme s’ils n’appartenaient plus au pays, comme
des exilés, et d’autre part, [qui] indique qu’ils n’étaient pas réellement exilés, mais
s’étaient retirés en un domaine intérieur, dans l’invisibilité du penser et du sentir ».
Et elle poursuit en écrivant que « ce serait une erreur d’imaginer que cette forme
d’émigration, exil hors du monde en un domaine intérieur, n’a existé qu’en Allema-
gne, tout comme ce serait une erreur d’imaginer qu’une telle émigration a pris fin
avec la fin du Troisième Reich » (voir Arendt, 1986). Il est évident que la « langue
de croyance », telle que l’entend Klemperer, rend celui qui l’utilise d’autant plus
étranger au monde commun et à son héritage futur qu’elle interdit tout usage res-
ponsable des mots.
21 Klemperer (1998), p. 69–70.
22 « Le métier du poète », dans Canetti (1989), p. 339 (c’est l’auteur qui souli-
gne).
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
226 Olivier Remaud
pas nous faire oublier que toute langue peut être autant folie pure que sa-
gesse accomplie. Là aussi Canetti a bien compris le schéma de puissance
qui habite la langue et qui la rend curieusement ambiguë. La tendance des
mots n’est pas toujours de communiquer, ni de rapprocher les hommes.
Souvent, les mots favorisent un enfermement dans cette langue privée que
chacun a pris soin d’élaborer pour son usage personnel23. Du reste, chaque
individu possède un « masque acoustique », c’est-à-dire une langue secrète
qui lui sert à se défendre d’autrui et à préserver son univers propre. Il arrive
néanmoins que la langue assume le devoir de la « métamorphose ». Par
« métamorphose », Canetti entend notamment la capacité à « sentir ce qu’un
être est derrière ses mots », une attention toute particulière au caractère pro-
téiforme de la vie concrète24. La langue est ainsi déchirée entre deux postu-
lations: l’une qui la tire vers un usage résolument privé et qui plonge l’indi-
vidu dans la contemplation compulsive de son intériorité malade et autoac-
cusatrice, comme on le voit chez presque tous les personnages de roman ou
de théâtre de Canetti; l’autre qui débarrasse la langue de ses mécanismes
de culpabilité, lève les masques de l’identité fragile et libère la possibilité
de se remémorer un monde commun. Le problème est que l’action violente
s’alimente de la première tendance et empêche souvent la langue de se réa-
liser adéquatement dans une parole que l’on partage.
On le sait, ce sont les chocs de l’Histoire qui suscitent la responsabilité.
Ce sont eux qui intimisent les événements et transforment subitement ce
qui est de l’ordre du politique en un « destin personnel25 ». Canetti en
convient lui aussi lorsqu’il dit ne plus vouloir « séparer ce qui est public
de ce qui est privé ». Devant l’avancée foudroyante des « ennemis de l’hu-
manité », qui contraint ces deux mondes à s’interpénétrer « d’une manière
jusqu’alors inouïe », il ajoute que le poète mais aussi l’homme en général
ne peuvent rester « au-dessus de leur temps26 ». Si « l’humanité n’est sans
défense que là où elle ne possède pas d’expérience, pas de souvenir27 »,
c’est à la langue de déterminer une position de liberté et de responsabilité
pour un individu qui veut vivre le présent comme présent dans une
23 C’est en écoutant les discours impétueux de Karl Kraus que Canetti a compris
combien « l’individu a une forme linguistique par laquelle il se détache de tous les
autres […], que les mots sont des coups qui rebondissent sur les mots des autres;
qu’il n’y a pas de plus grande illusion que de croire que la langue serait un moyen
de communiquer entre les êtres », voir « Karl Kraus. École de la résistance », Canetti
(1989), p. 57–58. Sur ce point, lire l’article de Schneider (1981), p. 384–402.
24 « Le métier du poète », dans Canetti (1989), p. 340.
25 Ce « destin personnel » est celui de l’exil comme le note Arendt juste après
l’incendie du Reichstag (le 27 février 1933), voir Arendt (1997), p. 237.
26 Voir la « remarque préliminaire » à Canetti (1989), p. 7.
27 « Hermann Broch », dans Canetti (1989), p. 29.
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
La langue des temps sombres 227
époque qui ne trouve cependant plus les marques de son histoire cons-
ciente.
Cette tâche n’est pas simple. Elle est même d’autant plus difficile que
l’étonnement, source naïve du regard authentiquement philosophique, a
considérablement changé de nature. À l’époque où il écrit son « Discours à
l’occasion du 50e anniversaire d’Hermann Broch », en novembre 1936, Ca-
netti observe qu’il vit dans un temps
où on peut s’étonner des choses les plus opposées: de l’effet millénaire d’un livre
par exemple et, simultanément, du fait que tous les livres n’agissent pas plus
longtemps. De la croyance en des dieux et, simultanément, du fait que nous ne
nous agenouillions pas à toute heure devant de nouveaux dieux. De la sexualité
dont nous sommes frappés et, simultanément, du fait que ce clivage ne s’étende
pas plus profondément. De la mort que nous ne voulons jamais et, simultanément,
du fait que nous ne mourions pas dans le sein maternel déjà de chagrin sur les
choses qui nous attendent. L’étonnement fut sans doute une fois ce miroir dont il
est volontiers question, qui produisait les phénomènes sur une surface plus plane
et plus calme. Aujourd’hui, ce miroir est brisé; et les éclats de l’étonnement sont
devenus petits. Mais dans l’éclat le plus petit même, nul phénomène ne se reflète
plus seul; impitoyablement, il entraîne son opposé; quoi que tu voies, et si peu
que tu voies, cela s’annule à nouveau, du simple fait que tu le voies28.
L’impossibilité d’une représentation unique, la brisure du reflet simple et
la multiplication conséquente des points de vue, tout cela ressemble fort à
l’expérience babélique des langues qui, loin d’être négative en elle-même
dans l’œuvre de Canetti, peut néanmoins conduire au repliement excessif
de l’individu sur sa langue privée. La métaphore du miroir n’est pas sans
profondeur. Elle signale la perte d’un rapport de désignation naturelle et
univoque entre les mots et les choses (un mot pour une seule chose), pre-
mier pas dans le processus de privatisation de l’existence. La fragmentation
de l’étonnement et la cassure du miroir confirment l’épuisement d’une lan-
gue qui n’est plus capable de fournir une expérience commune, sinon dans
le ressassement aveugle de termes identiques29.
Dans ces conditions, il appartient au poète de redonner vie à la langue.
Le Discours présente ses trois devoirs: d’abord, le poète doit être « voué à
son temps », tel un « chien » qui renifle chacune des odeurs spécifiques de
l’époque; puis, il doit « résumer son temps » et faire preuve d’une « passion
28Ibid., p. 15 (les italiques sont de Canetti).
29« Mais ces mots qui ne peuvent s’entendre, qui isolent, qui créent une sorte de
forme acoustique, ne sont pas rares ou nouveaux, inventés par des créatures sou-
cieuses de leur unicité: ce sont les mots les plus couramment employés, des phrases
toutes faites; ce qu’il y a de plus commun; ce qui a été dit des centaines de milliers
de fois; et c’est cela, précisément, que les gens utilisent pour signifier leur volonté
propre », voir « Karl Kraus. École de la résistance », dans Canetti (1989), p. 58.
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
228 Olivier Remaud
d’universalité qu’aucune tâche de détail ne puisse rebuter, qui ne fasse abs-
traction de rien, n’oublie rien, n’omette rien et ne se facilite en rien les
choses »; enfin, il doit exiger de lui-même qu’il « se dresse contre son
temps » afin de ne pas se figer dans l’« image compréhensive et unitaire »
qu’il en a et d’être en mesure de conserver un pouvoir de contradiction30.
Canetti insiste sur l’absolue nécessité de respecter ces trois devoirs car
c’est là l’unique manière de répondre à la brusque complication des temps.
L’obscurcissement du présent est tel qu’il oblige chacun à « appartenir à
son propre temps contre son propre temps » et qu’il contraint plus particu-
lièrement le poète à assumer son rôle de « gardien des métamorphoses31 ».
On retrouve dans ces propos l’esprit de la deuxième Considération inac-
tuelle, sur « l’utilité et les inconvénients de l’histoire pour la vie ». Nietz-
sche y dénonce l’hypertrophie du sens historique en affirmant a contrario
la nécessité d’oublier pour vivre. Mais il définit aussi plus finement le ca-
ractère « inactuel » – ou « intempestif » selon les traductions – dans les ter-
mes d’une double expérience qui consiste d’une part à ne pas être le « fils
de son temps » et d’autre part à « se souvenir à propos32 ». En pensant la
responsabilité comme une expérience du temps et de la langue, Canetti de-
meure fidèle à la double exigence nietzschéenne de déprise et de reprise du
présent. À ses yeux, être responsable demande d’aiguiser son sens du temps
pour mieux se préparer au geste de la conservation comme à celui de la
critique. Tandis que le premier redonne toutes les filiations et tous les héri-
tages, le second les redistribue et se charge de les réinventer. C’est en ce
sens que ni le poète, ni aucun autre citoyen ne sont « au-dessus de la
somme de souvenirs » qu’ils portent en eux33.
30 « Hermann Broch », dans Canetti (1989), p. 15–20.
31 On a déjà souligné que la vie multiforme était la matière de la poésie. Canetti
introduit cette nouvelle expression de « gardien des métamorphoses » en ces termes:
« Dans un monde orienté sur l’exploit et la spécialisation; qui ne voit que les som-
mets, auxquels on tend dans une sorte de limitation linéaire; qui applique toutes ses
forces à la froide solitude des sommets; qui méprise toutefois et efface ce qui se
trouve à côté, le multiple – le réel même –, qui ne concourt pas au sommet; dans un
monde qui interdit de plus en plus la métamorphose, parce qu’elle contrarie le but
unique de la production; un monde qui accroît inconsidérément les moyens de son
auto-destruction et, dans le même temps, cherche à étouffer les qualités humaines
acquises antérieurement, qui pourraient encore exister et le contrarier; dans un tel
monde, qu’on qualifierait de plus obnubilé qui soit, il paraît essentiel que quelques-
uns [les poètes] continuent, malgré tout, à exercer ce don de la métamorphose », voir
« Le métier du poète », dans Canetti (1989), p. 339. Sur les différents sens de cette
notion de « métamorphose », lire les commentaires de Ishaghpour (1990), notamment
p. 31–50 et p. 93–94. La première formule est empruntée à Esposito (1993), p. 73–
78, dans ses analyses sur la notion de responsabilité chez Canetti.
32 Nietzsche (1990), p. 98.
33 « Hermann Broch », Canetti (1989), p. 16.
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
La langue des temps sombres 229
V. L’éthique du narrateur
Convoquer à cet endroit de l’analyse la figure de Benjamin semblera
peut-être paradoxal. D’une part, son objet n’est pas la langue totalitaire, à
la différence de Klemperer; d’autre part, on le présente rarement comme un
penseur du récit. D’ailleurs, quels remèdes la narration est-elle capable
d’apporter à la « barbarie » du xxe siècle? Benjamin n’écrit-il pas que la
Grande Guerre de 1914–1918 a appauvri les hommes « en expérience
communicable » et que les survivants « sont revenus muets du front34 »?
L’essai sur Le narrateur suggère pourtant que l’expérience de la narration
est potentiellement une expérience de la « métamorphose » et qu’elle main-
tient « ouverts les accès entre les êtres » selon l’expression de Canetti.
Benjamin n’oublie jamais la valeur profondément thérapeutique de la
narration. Sur le plan autobiographique, il sait combien le récit que lui fît
sa mère de ses origines familiales l’a aidé à sortir de la maladie lorsque,
enfant, il hésitait, sous l’emprise de la fièvre, entre vivre ou mourir. L’évo-
cation du passé de ses ancêtres, la transcendance propre du souvenir méta-
morphosé de surcroît par la chaleur de la parole maternelle, lui ont fait ad-
mettre qu’il était inutile de s’abandonner à la tentation de la mort35. La
douleur ne résiste pas à la narration. La raison en est simple: le narrateur,
quel qu’il soit, apparaît toujours à qui l’écoute ou le lit comme « quelqu’un
qui revient de loin ». Après avoir parcouru la distance des souvenirs, il en
tire une « autorité » pour son récit et une « utilité » pour autrui. Ces deux
critères expliquent que la narration soit au croisement du récit et de
l’éthique.
S’agissant du récit, le narrateur ne cherche ni à démontrer son dire ni à
expliquer la façon dont les événements qu’il décrit s’enchaînent. Il s’appa-
rente au chroniqueur, et non à l’historien, parce qu’il tient à préserver l’es-
pace d’une mémoire que quelqu’un répétera un jour. La vraie mémoire,
celle qui se transmet, exige la « sobriété » de la chronique. Aucune histoire,
34 « Le narrateur », Benjamin (1991), p. 206.
35 « La douleur était un barrage qui ne résistait qu’au début à la narration; plus
tard, lorsque celle-ci avait pris des forces, la douleur se minait et était emportée
dans l’abîme de l’oubli. Les caresses frayaient un lit à ce torrent. Je les aimais car
la main de ma mère ruisselait déjà d’histoires qui devaient bientôt, en abondance,
s’échapper de sa bouche. Ce furent elles qui dévoilèrent le peu que j’appris de mes
ancêtres. On évoquait devant moi la carrière d’un aïeul, les mœurs réglées d’un
grand-père, comme si on voulait ainsi me faire comprendre à quel point il était pré-
maturé de me dessaisir par une mort précoce des atouts majeurs que j’avais dans
ma main grâce à mon origine. Ma mère examinait deux fois par jour la distance qui
me séparait encore de cette mort. Elle portait aussitôt, précautionneusement, le ther-
momètre près de la fenêtre ou de la lampe, et maniait le petit tube effilé comme si
ma vie y eût été enfermée », dans Benjamin (1998), p. 82–83.
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
230 Olivier Remaud
selon Benjamin, ne pourra retenir l’attention d’un auditeur si le narrateur
ajoute à la multiplicité des faits une surcharge de détails explicatifs ou psy-
chologiques. La narration n’a pas besoin de l’abondance. Elle ne s’occupe
que de tisser les histoires entre elles, comme dans les Contes des mille et
une nuits où Schéhérazade « à propos de chaque passage de ses histoires, se
souvient d’une autre histoire36 ». C’est un modèle qui substitue à la notion
d’auteur celui de l’échange continuel d’une parole collective. Toutes les
narrations commencent par rapporter les conditions de la première prise de
parole et ensuite seulement le narrateur s’installe dans le récit en son nom
propre. Ce qui importe dans une narration, c’est bien le fait que celui qui
raconte une histoire inaugure à nouveau quelque chose qui a déjà
commencé, en trouvant place dans une nécessité qui lui préexiste. Le narra-
teur profite en quelque sorte d’une bifurcation du sens pour prendre le re-
lais de la narration et suivre ses labyrinthes.
Si cette manière de raconter n’est pas celle d’un auteur de roman, c’est
parce que le narrateur incite continuellement l’auditeur à participer à l’his-
toire qui lui est racontée. Tandis que l’auteur rejette le lecteur dans la soli-
tude d’un récit impartageable, le narrateur inscrit l’auditeur dans l’espace
d’une mémoire héritée. À la différence de ce qui se produit pour le couple
de l’auteur et du lecteur, la relation du narrateur et de l’auditeur est une
relation forcément vivante, « de compagnie », qui exclut « l’assimilation pri-
vée » au sens digestif du terme37. Elle invite l’auditeur à profiter des multi-
ples coudes de la narration pour devenir à son tour un narrateur.
Au moment où l’histoire passe d’un individu à un autre, le narrateur peut
être de « bon conseil » et se montrer utile. Au dynamisme du récit s’ajoute
alors l’épaisseur d’une éthique. Que le conseil soit « bon » démontre à lui
tout seul qu’il ne vient jamais de l’extérieur, comme une pièce rapportée,
mais qu’il continue de tisser les fils d’une histoire qui possède déjà une
mémoire: « Un conseil, en effet, est peut-être moins réponse à une question
que suggestion à propos de la continuation d’une histoire (qui est en train
d’être développée). Pour qu’on nous le donne, ce conseil, il faut donc que
nous commencions par nous raconter38 ». L’essence de la responsabilité
pourrait bien reposer dans le conseil ainsi défini. Car un conseil n’est donné
que si celui qui le sollicite est le même que celui qui ouvre le dialogue.
Seul un narrateur peut venir demander conseil à un autre narrateur en lui
présentant sa propre histoire. Le conseil légitime l’initiative des paroles in-
dividuelles. Mais il révèle également la permanence du sens commun
36« Le narrateur », Benjamin (1991), p. 219.
37C’est l’expression de J.-M. Monnoyer dans son commentaire qui précède Ben-
jamin (1991), p. 203.
38 « Le narrateur », Benjamin (1991), p. 208.
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
La langue des temps sombres 231
puisque le partage du récit auquel il aboutit rend les narrateurs co-narra-
teurs. Si la violence divise les hommes en ruinant les fondements de l’ac-
tion éthique, comme on l’a suggéré avec Lévinas, le conseil tend plutôt à
les rapprocher dans l’unité d’une expérience transmise et réappropriée. À
ce titre, il possède une valeur d’orientation pour l’individu. Il élève même
le narrateur au rang d’une « image en laquelle le juste se retrouve lui-
même »39. En commençant à se raconter, chacun comprend dès lors qu’il
exerce une langue qui n’est pas étrangère au monde des hommes et qui
« est résolue à ne pas renoncer à soi40 ».
Quelles conclusions générales peut-on tirer de cette analyse des rapports
entre la langue et la violence qui rassemble trois auteurs aussi différents
que Canetti, Klemperer et Benjamin? J’en vois au moins deux. D’une part,
la violence qui affecte la langue brouille considérablement les coordonnées
temporelles du champ de l’expérience humaine jusqu’à dépouiller tout indi-
vidu de sa capacité à se raconter. Lorsque la parole n’est plus la conscience
de la langue, l’usage temporel de la raison par lequel chacun reconnaît les
marques de son histoire est rendu impossible. Le sens commun se résorbe
progressivement dans un discours qui s’uniformise en cédant toujours plus
à des usages dont la mémoire est imposée. D’autre part, le fait d’être dé-
possédé de la langue interdit très certainement à une époque de se nommer
elle-même en éclairant son propre rapport à l’actualité. Le présent est vécu
comme un temps de transition qui n’a ni commencement ni fin, une sorte
de temporalité élastique et inquiétante qui attend que les circonstances – et
non la conscience historique – tracent d’elles-mêmes une frontière entre un
avant et un après. À ce moment précis, l’esprit humain s’effraie de ne plus
être en mesure d’expérimenter l’histoire les yeux ouverts. Aux antipodes de
la morne indifférence se situe alors l’interrogation vivante de toute expé-
rience historique du présent: sans une éthique de la langue, une conscience
d’époque est-elle vraiment possible?
39 C’est peut-être cette « image », sur laquelle se clôt l’essai sur Le narrateur, qui
conduit Arendt à rappeler, dans son portrait de Benjamin, que « toute époque pour
laquelle son propre passé est devenu problématique à un degré tel que le nôtre, doit
se heurter finalement au phénomène de la langue; car dans la langue ce qui est
passé a son assise indéracinable, et c’est sur la langue que viennent échouer toutes
les tentatives de se débarrasser définitivement du passé », Arendt (1986), p. 304.
Pour l’étymologie de la notion de conseil (Rat) et sa valeur d’orientation, voir les
remarques de Gagnebin (1994), p. 87–112, sur la perte du conseil qui désoriente et
désempare au contraire l’individu (Ratlosigkeit).
40 À propos de l’un de ses textes (« Crise de mots »), Canetti écrit: « Je voulais
écrire là-dedans ce qu’il advient d’une langue qui est résolue à ne pas renoncer à
soi: le thème véritable de ce morceau est la langue, non l’orateur », dans « Re-
marque préliminaire » à Canetti (1989), p. 8.
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
232 Olivier Remaud
Bibliographie
Arendt, Hannah: entretien avec G. Gaus, Seule demeure la langue maternelle, in:
La tradition cachée. Paris: UGE, 10/18, 1997, trad. S. Courtine-Denamy,
p. 221–256.
– De l’humanité dans de « sombres temps ». Réflexion sur Lessing, in: Vies politi-
ques. Paris: Tel-Gallimard 1986, trad. B. Cassin & P. Lévy, p. 11–41.
Benjamin, Walter: Le narrateur. Réflexions à propos de l’œuvre de Nikolas Leskov,
in: Écrits français, présentés et introduits par J.-M. Monnoyer. Paris: Gallimard
1991, p. 205–229.
– Enfance berlinoise, trad. J. Lacoste, Les Lettres nouvelles-Maurice Nadeau,
1998.
Canetti, Élias: Masse et puissance. Paris: Tel-Gallimard 1986, trad. R. Rovini.
– La conscience des mots. Paris: Albin Michel 1989, trad. R. Lewinter.
Esposito, Roberto: Nove pensieri sulla politica. Bologne: Il Mulino 1993.
Freud, Sigmund: Considérations actuelles sur la guerre et la mort, in: Essais de
psychanalyse, Paris: Payot 1981, trad. P. Cotet, A. Bourguignon & A. Cherki,
p. 9–40.
Gagnebin, Jeanne-Marie: Histoire et narration chez Walter Benjamin. Paris: l’Har-
mattan 1994.
Ishaghpour, Youssef: Elias Canetti. Métamorphose et identité. Paris: La Différence,
1990.
Klemperer, Victor: LTI. La langue du IIIème Reich. Paris: Albin Michel 1998, trad.
E. Guillot.
Lévinas, Emmanuel: Éthique et esprit, in: Difficile liberté. Paris: Albin Michel
1988, p. 13–23.
Minkowski, Eugène: Traité de psychopathologie. Paris: PUF 1966.
Nietzsche, Friedrich: De l’utilité et des inconvénients de l’histoire pour la vie, in:
Œuvres philosophiques complètes, éd. G. Colli & M. Montinari. Paris: Galli-
mard 1990, T. II (1), p. 93–169.
Revault d’Allones, Myriam: Le faux éclat de la mort, in: Élias Canetti. Paris: édi-
tions du Centre Pompidou 1995, p. 99–106.
Roger, Philippe: Victor Klemperer. Le philologue et les fanatiques, in: Critique.
Paris: Minuit, nº 612, mai 1998, p. 195–210.
Schneider, Michel: Élias Canetti: la défusion des langues, in: Le Temps de la réfle-
xion, Paris: Gallimard 1981, II, p. 384–402.
Autorendaten lizenziert für Prof. Olivier Remaud
Aus: Nour, Soraya (Hrsg.); The Minority Issue: Law and the Crisis of Representation (BPW 153)
2009 Copyright Duncker & Humblot GmbH, Berlin
S-ar putea să vă placă și
- ATS - DS4 - SujetDocument2 paginiATS - DS4 - SujetLolo57Încă nu există evaluări
- La colère et la joie: Pour une radicalité créatrice et non une révolte destructriceDe la EverandLa colère et la joie: Pour une radicalité créatrice et non une révolte destructriceÎncă nu există evaluări
- Pour Une Théorie de La Violence (Georges Labica)Document10 paginiPour Une Théorie de La Violence (Georges Labica)ernesto_colocolinoÎncă nu există evaluări
- Dictionnaire sur l’antisémitisme - Tome 1: EssaiDe la EverandDictionnaire sur l’antisémitisme - Tome 1: EssaiÎncă nu există evaluări
- Philo Hitlerisme LevinasDocument9 paginiPhilo Hitlerisme LevinasMyrvia GeorgeÎncă nu există evaluări
- Par la révolution, la paix: Essai sur les sciences politiquesDe la EverandPar la révolution, la paix: Essai sur les sciences politiquesÎncă nu există evaluări
- Finitude Et Justice. Tous Les Hommes Sont MortelsDocument9 paginiFinitude Et Justice. Tous Les Hommes Sont MortelsMihaela BumbacÎncă nu există evaluări
- Essai LittératureDocument2 paginiEssai Littératurelipsymamba64Încă nu există evaluări
- Marie-Hélène Brousse La GuerreDocument9 paginiMarie-Hélène Brousse La Guerrehadar_poratÎncă nu există evaluări
- Les illusions de la psychogénéalogie: Nos ancêtres ont bon dos !De la EverandLes illusions de la psychogénéalogie: Nos ancêtres ont bon dos !Încă nu există evaluări
- Lecture Analytique Le Dernier Jour D'un CondamnéDocument6 paginiLecture Analytique Le Dernier Jour D'un CondamnéNahla Gaaya100% (1)
- Poly Arendt AndersDocument6 paginiPoly Arendt AndersCha AiÎncă nu există evaluări
- Inhumanité HumaineDocument2 paginiInhumanité HumainematelbrtÎncă nu există evaluări
- Fiche de Revision HLP 2021 L Humanite en Question Partie 2Document8 paginiFiche de Revision HLP 2021 L Humanite en Question Partie 2Nour GshakabzvÎncă nu există evaluări
- Fiche de Lecture - 1984 - Alison LOVINFOSSEDocument20 paginiFiche de Lecture - 1984 - Alison LOVINFOSSEalisonlovinfosseÎncă nu există evaluări
- Suicide - Mode - D - Emploi - Histoire - Technique - Actualité (1982)Document145 paginiSuicide - Mode - D - Emploi - Histoire - Technique - Actualité (1982)lsfoster100% (2)
- Mais Qui Ose en Affronter Les Suites Emil Cioran eDocument13 paginiMais Qui Ose en Affronter Les Suites Emil Cioran ePatouche MatthysÎncă nu există evaluări
- ANNEXES TEXTES - Libres Jusqu'à La MortDocument5 paginiANNEXES TEXTES - Libres Jusqu'à La MortBOUDALIERÎncă nu există evaluări
- Faire Croire en 22 DissertationsDocument174 paginiFaire Croire en 22 DissertationsAnas KmsÎncă nu există evaluări
- Atala8 PoreeDocument17 paginiAtala8 PoreeGie PerspectivesÎncă nu există evaluări
- Dans La Main Droite de Dieu - Psychanalyse Du Fanatisme (French Edition)Document64 paginiDans La Main Droite de Dieu - Psychanalyse Du Fanatisme (French Edition)Βασίλης ΔεδούσηςÎncă nu există evaluări
- Dialectique Et Amour de Soi Chez RousseauDocument27 paginiDialectique Et Amour de Soi Chez RousseauveraÎncă nu există evaluări
- Peut-On Accepter La Mort de Bonne FoiDocument5 paginiPeut-On Accepter La Mort de Bonne FoiCREPELÎncă nu există evaluări
- Analyse D'un Extrait de L'Etranger D'albert CamusDocument3 paginiAnalyse D'un Extrait de L'Etranger D'albert CamusNourÎncă nu există evaluări
- Extrait Extrait 0Document53 paginiExtrait Extrait 0louise antheaumeÎncă nu există evaluări
- Meynard - Le Suicide (Review)Document4 paginiMeynard - Le Suicide (Review)ROBERT BARBOSAÎncă nu există evaluări
- Le Mal de Vérité Ou Lutopie de La Mémoire (Coquio, Catherine)Document366 paginiLe Mal de Vérité Ou Lutopie de La Mémoire (Coquio, Catherine)Dalva LimaÎncă nu există evaluări
- 9782813201331Document9 pagini9782813201331Stéphane FrankovichÎncă nu există evaluări
- Cadre Général - Bardo Au RéseauDocument12 paginiCadre Général - Bardo Au RéseauBastien DÎncă nu există evaluări
- La Condition Humaine Cours STMGDocument2 paginiLa Condition Humaine Cours STMGKUKIÎncă nu există evaluări
- Notre Relation A La Mort - Sigmund FreudDocument35 paginiNotre Relation A La Mort - Sigmund FreudnathaliebariseleÎncă nu există evaluări
- Riflessione Donatella AntonelliDocument4 paginiRiflessione Donatella AntonelliChiara CanessaÎncă nu există evaluări
- 2008 RedecouvrirloeuvredeSimonedeBeauvoir-Le Sang Des Autres-1945Document8 pagini2008 RedecouvrirloeuvredeSimonedeBeauvoir-Le Sang Des Autres-1945Emy POTTIERÎncă nu există evaluări
- L'Holocauste Des Ames - Gregoire DumitrescoDocument163 paginiL'Holocauste Des Ames - Gregoire Dumitrescotiby_olimpÎncă nu există evaluări
- Après La Tragédie, La Farce ! Ou Comment L'histoire Se Répète - Slavoj ZizekDocument242 paginiAprès La Tragédie, La Farce ! Ou Comment L'histoire Se Répète - Slavoj ZizekGabrielGauny100% (1)
- L'Épreuve Du Désastre, Alain BrossatDocument10 paginiL'Épreuve Du Désastre, Alain BrossatguillaumeÎncă nu există evaluări
- La Violance Et Le SacréDocument9 paginiLa Violance Et Le SacréZineb HarbouliÎncă nu există evaluări
- Fictions de La Catastrophe Et NihilismeDocument11 paginiFictions de La Catastrophe Et Nihilismejean-paul engelibert100% (1)
- Rosat - 1984, Une Pensée Qui Ne Passe PasDocument4 paginiRosat - 1984, Une Pensée Qui Ne Passe PasSherlock DestinyÎncă nu există evaluări
- L'Apocalypse Selon de MartinoDocument9 paginiL'Apocalypse Selon de MartinomiroirdelamerÎncă nu există evaluări
- L'absurdeDocument2 paginiL'absurdeyoussef chaat100% (1)
- André Glucksmann - Liberté, Egalité, FraternitéDocument40 paginiAndré Glucksmann - Liberté, Egalité, FraternitéFondapol100% (2)
- Luc Dardenne Sur L'affaire Humaine Critique Toudi 2012Document4 paginiLuc Dardenne Sur L'affaire Humaine Critique Toudi 2012dfghÎncă nu există evaluări
- Histoire Mondiale Du Communisme - Vol 2Document1.139 paginiHistoire Mondiale Du Communisme - Vol 2bogdan2276Încă nu există evaluări
- Fiche FDV Et Resilience1Document3 paginiFiche FDV Et Resilience1Omar OuÎncă nu există evaluări
- Nietzsche-et-le-communisme-Geordes BatailleDocument4 paginiNietzsche-et-le-communisme-Geordes Bataillemauricio.vegaÎncă nu există evaluări
- La Nature Du Totalitarisme (Hannah Arendt) (Z-Library)Document79 paginiLa Nature Du Totalitarisme (Hannah Arendt) (Z-Library)Modeste AnneyÎncă nu există evaluări
- Idées À DévelopperDocument3 paginiIdées À DévelopperAntoine OriouÎncă nu există evaluări
- Arendt Le Systeme TotalitaireDocument9 paginiArendt Le Systeme TotalitaireJean DamascèneÎncă nu există evaluări
- La Communauté Désoeuvrée PDFDocument22 paginiLa Communauté Désoeuvrée PDFMoi RomeroÎncă nu există evaluări
- Dossier La Violence Et Le Sacré René GirardDocument7 paginiDossier La Violence Et Le Sacré René GirardRobert LamotheÎncă nu există evaluări
- JFP-01 Les Conséquences Subjectives - 230228 - 081338Document3 paginiJFP-01 Les Conséquences Subjectives - 230228 - 081338BBÎncă nu există evaluări
- Paroles Gelées: TitleDocument31 paginiParoles Gelées: TitleŁukasz ŚwierczÎncă nu există evaluări
- Les Méandres Du Récit Du GénocideDocument16 paginiLes Méandres Du Récit Du Génocidechaka diarrassÎncă nu există evaluări
- Questions Sur La PesteDocument3 paginiQuestions Sur La PesteAlianza FrancesaÎncă nu există evaluări
- LeiboviciDocument12 paginiLeiboviciLeiboviciÎncă nu există evaluări
- CPC 022 0141Document17 paginiCPC 022 0141OumassiÎncă nu există evaluări
- LTI-exemplier 2Document40 paginiLTI-exemplier 2Iannu DolmannÎncă nu există evaluări
- Emmanuelle Pireyre.-Fictions-documentairesDocument9 paginiEmmanuelle Pireyre.-Fictions-documentairesMónica BernabéÎncă nu există evaluări
- Roland Barthes-Leçon Doc Étudiants.Document22 paginiRoland Barthes-Leçon Doc Étudiants.Iannu Dolmann100% (4)
- 1912 7 JolyDocument8 pagini1912 7 JolyIannu DolmannÎncă nu există evaluări
- Défasciser La Langue - MéthodesDocument1 paginăDéfasciser La Langue - MéthodesIannu DolmannÎncă nu există evaluări
- Opacité critique-Jean-Marie-GleizeDocument19 paginiOpacité critique-Jean-Marie-GleizeIannu DolmannÎncă nu există evaluări
- Dec Citto 2014 01 0007Document26 paginiDec Citto 2014 01 0007Iannu DolmannÎncă nu există evaluări
- MacKinnon Sexuality 1989 Traduction RP 2012Document31 paginiMacKinnon Sexuality 1989 Traduction RP 2012Iannu DolmannÎncă nu există evaluări
- La Pensée Politique Dans Loccident MédiévalDocument18 paginiLa Pensée Politique Dans Loccident MédiévalIannu DolmannÎncă nu există evaluări
- La Royauté Castillane Du XIe Au XIVe SiècleDocument19 paginiLa Royauté Castillane Du XIe Au XIVe SiècleIannu DolmannÎncă nu există evaluări
- Nora P. PrésentationDocument9 paginiNora P. PrésentationIannu DolmannÎncă nu există evaluări
- Larrivée Au Pouvoir Des TrastamareDocument10 paginiLarrivée Au Pouvoir Des TrastamareIannu DolmannÎncă nu există evaluări
- Mrenault ThesefanonDocument371 paginiMrenault ThesefanonAnonymous Ko9TtBC4Încă nu există evaluări
- VIVAS LACOUR 2018 DiffusionDocument351 paginiVIVAS LACOUR 2018 DiffusionIannu DolmannÎncă nu există evaluări
- Meef 1 2019 2020 Copie 2Document3 paginiMeef 1 2019 2020 Copie 2Iannu DolmannÎncă nu există evaluări
- FOR2 Fiche D'informations Complémentaires L2, L3, LP, M1 Et M2Document1 paginăFOR2 Fiche D'informations Complémentaires L2, L3, LP, M1 Et M2Iannu DolmannÎncă nu există evaluări
- TV5MONDE Dossier de PrensaDocument18 paginiTV5MONDE Dossier de PrensaIannu DolmannÎncă nu există evaluări
- SCHAEFFER - Qué Es Un Género Literario (ENTERO)Document63 paginiSCHAEFFER - Qué Es Un Género Literario (ENTERO)Gio IuÎncă nu există evaluări
- AILS Séjours Linguistiques - Bourse Plan MarshallDocument4 paginiAILS Séjours Linguistiques - Bourse Plan MarshallsejourlinguistiqueÎncă nu există evaluări
- Grille Evaluation Exp. EcriteDocument1 paginăGrille Evaluation Exp. Ecritem313Încă nu există evaluări
- Vincent Descombes - L'équivoque Du Symbolique PDFDocument30 paginiVincent Descombes - L'équivoque Du Symbolique PDFMTPÎncă nu există evaluări
- Jeu de Loie SuperlatifDocument8 paginiJeu de Loie SuperlatifMauricio KisteÎncă nu există evaluări
- UNINE FLSH Ressources Niveau A1Document1 paginăUNINE FLSH Ressources Niveau A1Lily AnaÎncă nu există evaluări
- OE EntretienDEmbauche EnseignantDocument4 paginiOE EntretienDEmbauche EnseignantBárbara MartinsÎncă nu există evaluări
- Les Comptines Et Leurs Utilites Dans Le Developpement de L'enfantDocument9 paginiLes Comptines Et Leurs Utilites Dans Le Developpement de L'enfanthaykalham.piano9588100% (1)
- Adjectifs Et Les Pronoms PossessifsDocument3 paginiAdjectifs Et Les Pronoms PossessifsYahia BobÎncă nu există evaluări
- Apprendre À Lire en CP Et en CE1 (PDFDrive)Document108 paginiApprendre À Lire en CP Et en CE1 (PDFDrive)Abdel Mottaleb100% (1)
- O 06 Accord Nom Genre Nombre IrregularitesDocument2 paginiO 06 Accord Nom Genre Nombre IrregularitesJacqueline FahmiÎncă nu există evaluări
- Le Participe Présent Et Le GérondifDocument5 paginiLe Participe Présent Et Le GérondifYesenia ToledoÎncă nu există evaluări
- En2 Ibk Eval 02Document12 paginiEn2 Ibk Eval 02GarensDolcema100% (1)
- Grammaire 6aep RésuméDocument1 paginăGrammaire 6aep Résumébleu merÎncă nu există evaluări
- RA16 C4 FRA etudelangue-themeProposProdEcrit-dm 619922Document5 paginiRA16 C4 FRA etudelangue-themeProposProdEcrit-dm 619922Kanto Gaëlle ANDRIAMAHARAVOÎncă nu există evaluări
- Alphabet Oghamique - WikipédiaDocument8 paginiAlphabet Oghamique - WikipédiaBastien Guillemat Compte IIÎncă nu există evaluări
- (Free Scores - Com) - Charpentier Marc Antoine Te Deum 36220Document3 pagini(Free Scores - Com) - Charpentier Marc Antoine Te Deum 36220Alexander LamónÎncă nu există evaluări
- COURS 4-ÉnonciationDocument3 paginiCOURS 4-ÉnonciationxÎncă nu există evaluări
- Analyse Linéaire 1Document4 paginiAnalyse Linéaire 1chloe.delecourt2007Încă nu există evaluări
- P2 CE2CM1 Dictées LGJLJ Picot T1 EducoulDocument8 paginiP2 CE2CM1 Dictées LGJLJ Picot T1 Educoulmélanie barbierÎncă nu există evaluări
- Je Mémorise Et Je Sais Écrire Des Mots Au Cm1 - 2017... Wawacity - RedDocument168 paginiJe Mémorise Et Je Sais Écrire Des Mots Au Cm1 - 2017... Wawacity - RedCédric PussetÎncă nu există evaluări
- Liens Logiques - Cause - Consequence - But - Opposition - HACDocument2 paginiLiens Logiques - Cause - Consequence - But - Opposition - HACMoniÎncă nu există evaluări
- Examen 4apDocument1 paginăExamen 4apHana Brhm100% (1)
- Exemples Epreuves TEF - LS 2023Document8 paginiExemples Epreuves TEF - LS 2023tania.xlyÎncă nu există evaluări
- L'année de Sixième en FrançaisDocument8 paginiL'année de Sixième en FrançaisjennaneÎncă nu există evaluări
- Introduction LangageDocument162 paginiIntroduction LangageMonde De CharlotteÎncă nu există evaluări
- S - Ind. PrésentDocument1 paginăS - Ind. PrésentLau LauÎncă nu există evaluări
- Verbes IrreguliersDocument10 paginiVerbes IrreguliersMouke touréÎncă nu există evaluări
- 2016 CLEO Programmation - CE1-CE2Document3 pagini2016 CLEO Programmation - CE1-CE2Trois PlumesÎncă nu există evaluări
- Langage Et CommunicationDocument7 paginiLangage Et CommunicationBrahimBenchennaÎncă nu există evaluări
- 7C Bleu Blanc Rouge 1 Parcours de La Langue FrancaiseDocument234 pagini7C Bleu Blanc Rouge 1 Parcours de La Langue Francaiseliamason0903Încă nu există evaluări
- Tests de grammaire française: 400 questions pour évaluer vos connaissancesDe la EverandTests de grammaire française: 400 questions pour évaluer vos connaissancesEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (3)
- Maîtrisez l’anglais en 12 sujets: Livre trois: 182 mots et phrases intermédiaires expliquésDe la EverandMaîtrisez l’anglais en 12 sujets: Livre trois: 182 mots et phrases intermédiaires expliquésÎncă nu există evaluări
- Anglais ( L’Anglais Facile a Lire ) 400 Mots Fréquents (4 Livres en 1 Super Pack): 400 mots fréquents en anglais expliqués en français avec texte bilingueDe la EverandAnglais ( L’Anglais Facile a Lire ) 400 Mots Fréquents (4 Livres en 1 Super Pack): 400 mots fréquents en anglais expliqués en français avec texte bilingueEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (3)
- le vocabulaire anglais pour comprendre 80% des conversations: parlez et comprendre l'anglaisDe la Everandle vocabulaire anglais pour comprendre 80% des conversations: parlez et comprendre l'anglaisEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (2)
- L’Espagnol Pour Tous - apprendre l’espagnol pour débutant (Vol 2): 10 nouvelles en espagnol facile, un livre bilingue espagnol francaisDe la EverandL’Espagnol Pour Tous - apprendre l’espagnol pour débutant (Vol 2): 10 nouvelles en espagnol facile, un livre bilingue espagnol francaisEvaluare: 3 din 5 stele3/5 (1)
- Vocabulaire DELF B2 - 3000 mots pour réussirDe la EverandVocabulaire DELF B2 - 3000 mots pour réussirEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (34)
- Apprendre l’allemand - Texte parallèle - Collection drôle histoire (Français - Allemand)De la EverandApprendre l’allemand - Texte parallèle - Collection drôle histoire (Français - Allemand)Evaluare: 3.5 din 5 stele3.5/5 (2)
- Apprendre l'Anglais : Expressions idiomatiques ‒ Proverbes et DictonsDe la EverandApprendre l'Anglais : Expressions idiomatiques ‒ Proverbes et DictonsÎncă nu există evaluări
- Anglais Pour Les Nulles - Livre Anglais Français Facile A Lire: 50 dialogues facile a lire et photos de los Koalas pour apprendre anglais vocabulaireDe la EverandAnglais Pour Les Nulles - Livre Anglais Français Facile A Lire: 50 dialogues facile a lire et photos de los Koalas pour apprendre anglais vocabulaireEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Le langage corporel : interpréter les signes non verbauxDe la EverandLe langage corporel : interpréter les signes non verbauxEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (3)
- Trésor des Proverbes Latino-Américains avec leurs équivalents espagnols, français, québécois et anglaisDe la EverandTrésor des Proverbes Latino-Américains avec leurs équivalents espagnols, français, québécois et anglaisÎncă nu există evaluări
- Enseigner les Traits pertinents temporels: avec la participation active des apprenantsDe la EverandEnseigner les Traits pertinents temporels: avec la participation active des apprenantsÎncă nu există evaluări
- Petit guide pratique de la phonétique corrective du fleDe la EverandPetit guide pratique de la phonétique corrective du fleEvaluare: 1 din 5 stele1/5 (1)
- L’Anglais facile a lire - Apprendre l’anglais (Vol 1): 12 histoires en anglais et en français pour apprendre l’anglais rapidementDe la EverandL’Anglais facile a lire - Apprendre l’anglais (Vol 1): 12 histoires en anglais et en français pour apprendre l’anglais rapidementEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (72)
- Apprendre l'Italien : Proverbes et ExpressionsDe la EverandApprendre l'Italien : Proverbes et ExpressionsEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (4)
- Le Participe passé dans tous ses états: Petit traité de l'Accord du Participe passé avec être et avoirDe la EverandLe Participe passé dans tous ses états: Petit traité de l'Accord du Participe passé avec être et avoirÎncă nu există evaluări
- L’Espagnol Pour Tous - apprendre l’espagnol pour débutant (Vol 1): 12 nouvelles en espagnol facile, un livre bilingue espagnol francaisDe la EverandL’Espagnol Pour Tous - apprendre l’espagnol pour débutant (Vol 1): 12 nouvelles en espagnol facile, un livre bilingue espagnol francaisÎncă nu există evaluări
- Anglais - Livre Bilingue Anglais Français Facile A Lire: 50 dialogues facile a lire et photos pour apprendre anglais vocabulaireDe la EverandAnglais - Livre Bilingue Anglais Français Facile A Lire: 50 dialogues facile a lire et photos pour apprendre anglais vocabulaireEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (1)
- Anglais ( L’Anglais facile a lire ) - Apprendre Anglais Utile en Voyage: Un livre anglais debutant avec 400 phrases pour apprendre anglais vocabulaire pour voyageursDe la EverandAnglais ( L’Anglais facile a lire ) - Apprendre Anglais Utile en Voyage: Un livre anglais debutant avec 400 phrases pour apprendre anglais vocabulaire pour voyageursEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Anglais Pour Les Nulles - Livre Anglais Français Facile A Lire (4 livres en 1 Super Pack): 200 dialogues facile a lire et 200 photos pour apprendre anglais vocabulaireDe la EverandAnglais Pour Les Nulles - Livre Anglais Français Facile A Lire (4 livres en 1 Super Pack): 200 dialogues facile a lire et 200 photos pour apprendre anglais vocabulaireEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (1)
- Apprendre le portugais - Texte parallèle (Français - Portugais) Collection drôle histoireDe la EverandApprendre le portugais - Texte parallèle (Français - Portugais) Collection drôle histoireEvaluare: 2 din 5 stele2/5 (1)
- Anglais ( L’Anglais Facile a Lire ) Dictionnaire des mots de base: Dictionnaire anglais francais des 850 mots anglais essentiels, avec traduction et exemples de phrasesDe la EverandAnglais ( L’Anglais Facile a Lire ) Dictionnaire des mots de base: Dictionnaire anglais francais des 850 mots anglais essentiels, avec traduction et exemples de phrasesEvaluare: 3.5 din 5 stele3.5/5 (3)
- Guide de Conversation pour Voyageurs: Guide Voyage en 6 langues, avec 400 phrases et mots de conversation en Francais, Anglais, Espagnol, Italien, Portugais et AllemandDe la EverandGuide de Conversation pour Voyageurs: Guide Voyage en 6 langues, avec 400 phrases et mots de conversation en Francais, Anglais, Espagnol, Italien, Portugais et AllemandÎncă nu există evaluări
- Anglais (L’Anglais Facile a Lire) - Apprendre L’Anglais Avec Des Images (Vol 11): 400 images et mots essentiels, en texte bilingue, sur la quarantaine, le coronavirus, la transmission de virus, pandémie et termes médicauxDe la EverandAnglais (L’Anglais Facile a Lire) - Apprendre L’Anglais Avec Des Images (Vol 11): 400 images et mots essentiels, en texte bilingue, sur la quarantaine, le coronavirus, la transmission de virus, pandémie et termes médicauxÎncă nu există evaluări
- Anglais ( L’Anglais facile a lire ) - Apprendre L’Anglais Avec Des Images (Super Pack 10 livres en 1): 1.000 mots, 1.000 images, 1.000 textes bilingues (10 livres en 1 pour économiser et apprendre l'anglais plus rapidement)De la EverandAnglais ( L’Anglais facile a lire ) - Apprendre L’Anglais Avec Des Images (Super Pack 10 livres en 1): 1.000 mots, 1.000 images, 1.000 textes bilingues (10 livres en 1 pour économiser et apprendre l'anglais plus rapidement)Evaluare: 2.5 din 5 stele2.5/5 (2)