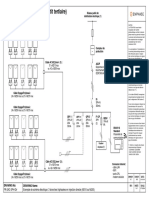Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Où Va La Technoscience - Anne-Laure Boch PDF
Încărcat de
vvasileTitlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Où Va La Technoscience - Anne-Laure Boch PDF
Încărcat de
vvasileDrepturi de autor:
Formate disponibile
Où va la technoscience ?
Avant-Propos
A l’heure où nous découvrons quotidiennement des
transgressions éthiques dans les laboratoires de haute
sécurité par des « chercheurs » qui se sont soumis au dieu-
argent, les réflexions de personnes comme l’éminente
neurochirurgienne et philosophe Anne-Laure Boch sont
indispensables.
Je vous invite à la découvrir au travers de ces 2 vidéos et
d’un texte très complet.
Je vous invite aussi à faire un parallèle entre ce qu’elle
livre comme analyse et le développement d’un vaccin à codage
génétique jamais validé de manière respectueuse du protocole
scientifique, mais que l’on a décidé d’inoculer à 7 milliards
d’individus. Des milliards ont été déversés dans les poches
des industriels grâce à des pré-commandes avant même d’avoir
eu les résultats des quelques tests en cours de réalisation
sur l’humain.
Des apprentis-sorciers qui ont réussi à embarquer les
décideurs politiques dans leur grand saut vers l’inconnu.
Des gains probablement jamais égalés sont en cours de
réalisation dans le mépris de la vie humaine et… de la science
elle-même.
Liliane Held-Khawam
La face sombre du transhumanisme. 2 Vidéos
L’éthique à l’épreuve de la technoscience. Anne-Laure Boch,
neurochirurgienne et philosophe
Anne-Laure Boch alerte sur la face sombre du transhumanisme.
***
Où va la science ? Anne- Laure Boch
Où va la science ? Dévoiler le monde naturel ou créer un
nouveau monde ? La science nous promet un envol radieux,
délivré des pesanteurs de notre condition mortelle et
terrestre. Mais le futur pourrait être tout autre. Le cheval
emballé de la technoscience pourrait rencontrer plus tôt que
prévu le mur de la réalité. Ses prétentions infinies
pourraient se fracasser sur les limites d’un monde fini.
Limites écologiques, limites économiques, limites politiques
et sociales. Le désordre mondial qui vient fera rendre gorge
aux utopies technoprogressistes, dont le transhumanisme est le
dernier avatar. On peut le regretter… ou éprouver un secret
soulagement. Après tout, le rêve technoscientifique n’était-il
pas en train de virer au cauchemar ?
***
PUISQU’ON nous demande où va la science, qu’on nous permette
d’abord de rappeler d’où elle vient. Comme souvent en
philosophie, notre point de départ sera l’Antiquité grecque,
Aristote étant notre auteur de référence.
Dans l’Antiquité, il y a d’un côté la science « pure »
(épistèmè), de l’autre la technique (technè). L’épistèmè est
un mode de connaissance du monde naturel. Fondée sur des
propositions nécessaires, faisant appel à l’induction et au
syllogisme, elle exige un long travail d’observation, de
réflexion, d’abstraction, qui construit une sagesse (sophia).
La sophia est la science des premiers principes et des
premières causes. Elle débouche sur la contemplation
(theoria). Parce qu’elle vise la connaissance universelle et
certaine (« Ce que connaît la science ne peut pas être
autrement »), elle ne s’intéresse pas aux choses qui admettent
des changements, et réserve ses efforts aux « objets qui
existent de toute nécessité et qui ont, par suite, un
caractère éternel ».
Les objets de science sont naturels, spontanés, régis par des
lois régulières. La science les décrit et les contemple sans
prétendre les contraindre ou les modifier. Les astres sont
l’exemple même de ces objets réguliers, prévisibles, éternels…
On pourrait presque dire : parfaits.
Au contraire, la technè est tournée vers la pratique concrète
des choses, leur construction ou façonnage. « L’art (technè)
est une disposition accompagnée de raison et tournée vers la
création (poièsis). » Cette création ne concerne pas les
choses qui adviennent naturellement, du fait d’un principe
interne, mais celles qui dérivent de l’industrie humaine,
produites par un principe externe.
Dans la technoscience, ce que l’on sait (la science) est
profondément influencé par ce que l’on sait faire (la
technique), et vice-versa.
Elle vise le particulier, non l’universel. La création
technique n’est cependant pas radicalement séparée de la
naissance des choses naturelles : « D’une manière générale,
l’art (technè), dans certains cas, parachève ce que la nature
(physis) n’a pas la puissance d’accomplir, dans d’autres cas,
il imite la nature. »
Retenons l’opposition entre spéculation théorique et
réalisation pratique, les deux ne se mélangeant pas et chacune
évoluant pour son propre compte. Certes, il y a de la raison
(logon alèthous) dans la technè. Mais cette raison n’est pas
épistèmè, science. La science des Anciens est désintéressée,
éloignée de toute fin utilitaire. Comme la philosophie, dont
elle est une branche à part entière, elle contemple le monde,
dévoile sa vérité (alètheia), elle ne le crée pas.
Le monde moderne est le monde de la technoscience
À partir du XVIIème siècle, science et technique vont peu à peu
s’interpénétrer, pour aboutir à une nouvelle réalité, la
technoscience. Dans la technoscience, ce que l’on sait (la
science) est profondément influencé par ce que l’on sait faire
(la technique), et vice-versa. Tout d’abord, parce que le
scientifique connaît le monde « par les mêmes lois qui ont
servi à Dieu pour le créer ». La science permet donc une re-
création, une création en second, qui rendra effectivement
l’homme « comme maître et possesseur de la nature ».
C’est désormais l’expérimentation, et non la seule rigueur du
raisonnement, qui permet la certitude.
De la copie du monde, la science moderne passe à l’original,
si l’on peut dire. Et bientôt, l’intrication entre science et
technique va se matérialiser avec l’invention d’une méthode,
la méthode expérimentale, et au développement considérable que
lui vaudra son succès. C’est l’expérimentation qui va faire
évoluer la science pure vers une technoscience.
La science antique avait deux parties, qui se succédaient
toujours dans le même ordre : 1) observation de la nature ; 2)
élaboration d’une théorie à la lumière de la logique, qui
procède par induction (raisonnement par lequel on passe du
particulier à l’universel) et syllogisme (déduction médiate où
une conclusion procède nécessairement de propositions
précédentes).
La rigueur de la méthode, observation minutieuse puis
raisonnement approprié, était garante de la certitude de la
connaissance. Point n’était donc besoin d’une quelconque
vérification, la théorie se suffisait à elle-même, elle était
aboutissement nécessaire et suffisant.
La science moderne, elle, se compose de trois parties : 1)
observation de la nature ; 2) élaboration d’une théorie
quantifiable ; 3) vérification de cette théorie au
laboratoire, grâce à une construction artificielle qu’on
appelle « l’expérimentation ».
Le laboratoire, lieu de l’action technique, devient le lieu de
la science, sa zone d’action. De contemplation, la science
devient action.
L’expérimentation est le retour sur la théorie qui manquait à
la science antique. Elle la parachève en ce que nulle théorie
ne peut se maintenir sans le sceau de la vérification
expérimentale. C’est désormais l’expérimentation, et non la
seule rigueur du raisonnement, qui permet la certitude.
Pour rendre possible la vérification effective de la théorie
par l’expérimentation, le savant va avoir besoin d’aide. Il a
besoin d’une construction pratique, ce que lui apporte la
technique. La technique sert d’abord à réaliser le système
expérimental devenu indispensable à la science. Elle permet de
construire un petit monde, manipulable à souhait, en lieu et
place du grand, celui dont sont toujours tirées les premières
observations.
Il y a, dans la science moderne, un mélange des différentes
étapes de son élaboration, avec une rétroaction des unes sur
les autres. L’observation est maintenant guidée par la
théorie, qui construit l’expérimentation mais s’y soumet en
dernier ressort. Et l’expérimentation retentit sur
l’observation.
Gaston Bachelard a bien rendu compte de cet enchevêtrement, où
théorie et expérimentation se répondent mutuellement :
« Déjà, l’observation a besoin d’un corps de précautions qui
conduisent à réfléchir avant de regarder, qui réforment du
moins la première vision, de sorte que ce n’est jamais la
première observation qui est la bonne. L’observation
scientifique est toujours une observation polémique ; elle
confirme ou infirme une thèse antérieure, un schéma préalable,
un plan d’observation ; elle montre en démontrant ; elle
hiérarchise les apparences ; elle transcende l’immédiat ; elle
reconstruit le réel après avoir reconstruit ses schémas.
Naturellement, dès qu’on passe de l’observation à
l’expérimentation, le caractère polémique de la connaissance
devient plus net encore. Alors il faut que le phénomène soit
trié, filtré, épuré, coulé dans le moule des instruments,
produit sur le plan des instruments. Or, les instruments ne
sont que des théories matérialisées. Il en sort des phénomènes
qui portent de toutes parts la marque théorique. »
L’expansion du monde technique, le monde créé au laboratoire
par et pour la science, évince progressivement le monde
naturel.
Il y a un va-et-vient entre science et technique, aucune des
deux instances ne pouvant prétendre être le terme de l’autre.
Ce va-et-vient a été extraordinairement fécond : au fur et à
mesure de son développement, il a entraîné d’immenses progrès
techniques ; et les progrès techniques ont été à l’origine de
progrès scientifiques.
Par ailleurs, l’expansion du monde technique, le monde créé au
laboratoire par et pour la science, évince progressivement le
monde naturel, celui qui était à l’origine des premières
observations. Le laboratoire, lieu de l’action technique,
devient le lieu de la science, sa zone d’action. De
contemplation, la science devient action. Action de création,
de réalisation : le réel n’est plus simplement un donné qu’il
faut dévoiler. Il est une nouveauté à inventer chaque jour.
« La véritable phénoménologie scientifique est bien
essentiellement une phénoménotechnique. Elle renforce ce qui
transparaît derrière ce qui apparaît. Elle s’instruit par ce
qu’elle construit. La raison thaumaturge dessine ses cadres
sur le schéma de ses miracles. La science suscite un monde,
non plus par une impulsion magique, immanente à la réalité,
mais bien par une impulsion rationnelle, immanente à
l’esprit. Après avoir formé, dans les premiers efforts de
l’esprit scientifique, une raison à l’image du monde,
l’activité spirituelle de la science moderne s’attache à
construire un monde à l’image de la raison. L’activité
scientifique réalise, dans toute la force du terme, des
ensembles rationnels. »
La science, qui était sophia, devient technè. Son savoir
devient pouvoir (Francis Bacon), plus précisément pouvoir-
faire. Et ce, même dans les domaines qui semblent à première
vue les plus théoriques. L’exemple de la physique quantique
est à ce titre éloquent. Il s’agissait, au début du XXème
siècle, de résoudre un problème d’école : calculer le
rayonnement du « corps noir », corps idéal supposé absorber
tous les photons incidents.
De nos jours, on estime que 30 % du Produit Intérieur Brut
(PIB) des États-Unis dépend d’activités qui ont un rapport, de
près ou de loin, avec les avancées de la physique quantique −
ne serait-ce que l’informatique !
Il en est sorti, en quelques décennies, une physique
extraordinairement abstraite – si abstraite que d’aucuns la
disent « impensable ». Et pourtant… De nos jours, on estime
que 30 % du Produit Intérieur Brut (PIB) des États-Unis dépend
d’activités qui ont un rapport, de près ou de loin, avec les
avancées de la physique quantique − ne serait-ce que
l’informatique !
Notons que le passage d’une forme de science à l’autre
(science sophia à science technè) ne s’est pas fait dans tous
les domaines en même temps. La biologie en est longtemps
restée à la conception ancienne, où l’observation du monde
naturel dominait. Au XIXème siècle, le travail du naturaliste
consiste encore essentiellement en une tâche d’observation, à
visée de classification.
La persistance prolongée de méthodes aristotéliciennes en
biologie a pu faire dire à certains que cette science n’était
entrée dans la modernité que depuis la découverte du support
moléculaire de l’information génétique, voire qu’elle ne
s’était proprement constituée en « science » qu’à partir de ce
moment – James D. Watson et Francis Crick étant alors les
pères, non seulement de la biologie moderne, mais de la
biologie tout court. Depuis, la biologie a bien rattrapé son
retard en matière de « scientificité »…
Technoscience ou technologie ?
Si la technoscience est au cœur du monde moderne, un autre
terme est aujourd’hui largement employé. Il s’agit du mot
« technologie ». La technologie, comme l’indique l’étymologie,
c’est le logos de la technique, le discours sur la technique.
On retrouve ce mot, dans son emploi premier, par exemple dans
Instituts Universitaires de Technologie, qui sont bien des
écoles consacrées à l’étude des techniques.
Mais, force est de reconnaître que ce n’est pas dans cette
acception que le terme est le plus souvent employé. Il est
employé comme un synonyme de technique – technique de pointe,
en général. Cette extension d’emploi est-elle une simple
impropriété ? Ou a-t-elle une signification, un sens qui se
cache derrière ce glissement sémantique, à première vue
inutile puisque aboutissant à une redondance ?
L’imagination est éveillée, non par la technique elle-même, la
technique réelle, mais par le discours sur la technique, la
technologie. Ce discours justifie les prétentions exorbitantes
de la technoscience dans le monde réel.
Notons d’abord le contexte psychologique. C’est lui qui doit
nous guider, car c’est lui qui explique presque tout. Si le
terme « technique » est neutre, « technologie » est nettement
flatteur. Il y a de l’emphase dans la substitution d’un mot
par l’autre. On dit « les nouvelles technologies » et la voix
vibre… Ou bien, on parle de « haute technologie », avec
émerveillement.
La technologie, c’est par exemple un appareil « bourré
d’électronique », « ultrasophistiqué », « futuriste »… La
projection de tous les bienfaits que recèlent les mots
« nouveau », « technologie », etc., excite l’imaginaire,
transcendant la réalité prosaïque. L’imagination est éveillée,
tenue en haleine, non par la technique elle-même, la technique
réelle, mais par le discours sur la technique, la technologie.
Ce discours, qui confond technique réelle et technique rêvée,
justifie les prétentions exorbitantes de la technoscience dans
le monde moderne. De façon délibérée, il cherche à brouiller
les limites entre l’effectif et le souhaité. Le « techno-
discours », c’est toute la propagande qui accompagne,
soutient, promeut les innovations techniques. En somme, du
marketing, de la publicité. La technoscience s’y soumet avec
complaisance.
Dès ses débuts, la science moderne reconstruit la nature à son
image. La technologie est la néo-nature rêvée puis créée de
toutes pièces par la science. Elle est notre monde artificiel,
qui partout a remplacé le naturel.
La prédilection pour le terme « technologie » révèle aussi la
fonction du discours dans l’élaboration même de la
technoscience. Si la technique contemporaine et la science
sont liées d’étroite façon, c’est qu’elles procèdent toutes
deux du même logos, du même discours. L’évolution d’une
science éthérée et impuissante vers une technoscience
hyperpuissante était contenue en germe dans les prémisses
pourtant éloignées de toute réalisation pratique.
Dès ses débuts, la science moderne reconstruit la nature à son
image. Elle appréhende la nature de façon théorique, puis
s’applique à réaliser ses visions. Alors, naît la « technique
technologique », toute empreinte de la pensée scientifique,
c’est-à-dire de la façon dont la science pense le monde. La
technologie est la néo-nature rêvée puis créée de toutes
pièces par la science. Elle est notre monde artificiel, qui
partout a remplacé le naturel.
La science, prestataire de service
Munis des puissants instruments de la technoscience, savants
et chercheurs ont acquis une position centrale dans le monde
moderne, ce monde artificiel qu’ils ont façonné peu à peu. Ils
sont désormais dépositaires des valeurs les plus élevées de la
société. Le public demande à faire confiance, à garder
l’espoir, à rêver : nous voilà qui proposons nos services en
toute modestie, services qui sont acceptés avec empressement.
Et la reconnaissance morale s’accompagne d’une reconnaissance
pratique faite d’avantages bien réels – pourquoi s’en priver ?
En même temps, les scientifiques ont payé cette position
éminente du prix de leur liberté. Traditionnellement, la
science faisait partie des « arts libéraux ». Elle était
l’occupation raffinée de quelques-uns qui avaient assez de
fortune et de culture pour s’adonner aux plaisirs de l’esprit.
Ces aristocrates de la science n’avaient de compte à rendre à
personne, et certainement pas à un public bien incapable de
comprendre les tenants et aboutissants de leurs spéculations
intellectuelles.
De nos jours, les sciences pures n’ont pas bonne presse. « A
quoi ça sert ? » est la question, empreinte de soupçon, que
pose un public soucieux des deniers que l’État attribue à la
recherche.
Depuis, les choses ont bien changé. L’accès à la science s’est
démocratisé, ce dont il faut se réjouir. Mais ces
scientifiques plus nombreux sont aussi plus dépendants de
leurs commanditaires, en l’occurrence les pouvoirs, publics ou
privés, dispensateurs de crédits et de postes. Ils sont
devenus les employés d’une société avide d’innovation, et qui
exige un retour sur investissement.
De nos jours, les sciences pures n’ont pas bonne presse. « À
quoi ça sert ? » est la question, empreinte de soupçon, que
pose un public soucieux des deniers que l’État attribue à la
recherche. Pas question d’entretenir des savants occupés à
l’élaboration d’une œuvre strictement intellectuelle, s’ils ne
prouvent qu’ils rendent un service tangible à la collectivité.
Service qui est d’ordre matériel, bien évidemment. Une avancée
purement intellectuelle, sans conséquence matérielle, est
considérée comme nulle et non avenue, bénéficiant aux seuls
individus privés et, au fond, scandaleusement égoïstes.
Cela est flagrant dans la presse de vulgarisation
scientifique, qui a un grand rôle de diffusion d’une certaine
idée de la science auprès du public. Ce qui est au premier
plan, ce ne sont jamais les spéculations intellectuelles
désintéressées, la science en tant que moyen de connaissance
du monde. Ce sont les applications matérielles qui signent le
« progrès » si désirable.
Les sciences fondamentales ne survivent que parce qu’on les
suppose indispensables pour la recherche appliquée.
In fine, seules les recherches qui débouchent sur de telles
applications sont dignes d’intérêt, pour ne pas dire de
finances. La recherche est un « projet »… devant déboucher sur
un brevet, ou reconnaître son échec et s’interrompre. On est
passé d’une science où les applications pratiques étaient
données de surcroît à une science qui a son origine et son
terme dans des préoccupations matérielles. La science est
instrumentalisée par la technique, elle-même au service de la
vie quotidienne des gens.
Les sciences fondamentales, d’ailleurs, ne survivent que parce
qu’on les suppose indispensables pour la recherche appliquée.
Ainsi, les mathématiques ne sont licites que parce qu’elles
permettent de faire des progrès en statistique ou en
informatique. De même, la physique des particules élémentaires
est rebaptisée « physique des hautes énergies », titre plus
alléchant pour un public directement concerné par sa facture
d’électricité.
Les hommes de science, eux-mêmes, semblent résignés à leur
nouveau rôle de serviteurs de la collectivité. Obligés de
justifier comme jamais l’intérêt de leurs travaux, ils passent
une bonne partie de leur temps à écrire des projets dans
lesquels ils dissertent sur les débouchés pratiques de leurs
recherches. Pas d’autre solution pour trouver de l’argent,
essentiel pour leurs laboratoires.
En contrepartie, ils montent dans la hiérarchie sociale. On
sollicite leur avis sur les problèmes les plus divers, leur
diagnostic sur les imperfections résiduelles de la communauté,
leur concours pour améliorer la civilisation. Et ils peuvent
répondre, se prévalant du respect dû à leur corporation, « en
tant qu’homme de science ». Ils apportent leur pierre au grand
but commun, à savoir le bonheur dans et par la consommation.
Sur l’échiquier de la consommation sans entrave, l’homme de
science est un pion essentiel. Le scientifique n’est plus le
maître de la vérité, ni le maître du monde. Il n’a plus pour
mission d’élucider le monde, mais de satisfaire les
consommateurs.
Sur l’échiquier de la consommation sans entrave, l’homme de
science est un pion essentiel. C’est par la grâce de ses
productions techniques que le monde nous est livré, en un
vaste marché où il suffit de prendre. Dans ce contexte, le
scientifique n’est plus un maître – ni maître de la vérité, ni
maître du monde. Plus un maestro, tout juste un maître
d’œuvre, un machiniste qui permet que, sur scène, le spectacle
soit le plus plaisant possible.
Il n’a plus pour mission d’élucider le monde, mais de
satisfaire les consommateurs. Les consommateurs ne sauraient
vivre sans lui. L’existence des uns serait intolérable sans le
perpétuel concours de l’autre. Pas d’art pour l’art, pas non
plus de savoir pour le savoir, tout pour la consommation : tel
est le dogme prosaïque d’une société dont la mesquinerie
semble croître à mesure de sa richesse.
Par l’intermédiaire de la technique, la science est devenue le
prestataire de service de cette société, et son prestige
supposé masque son esclavage réel.
La nouvelle frontière
Or, voici que le marché a découvert une nouvelle terre de
conquête : le corps. Le corps, c’est la nouvelle frontière à
investir par la technoscience… et par la société de
consommation. Ce corps si précieux, si fragile, si imparfait.
Ce corps dont les « performances » sont sujettes à des
améliorations infinies. Performances physiques, performances
psychiques : dans la marionnette humaine, il y a tant de
ficelles à tirer !
Jusqu’à présent, la technoscience s’attaquait au monde
extérieur. Le monde intérieur relevait de la médecine, qui
visait à réparer les fonctions défaillantes, à les remettre
dans un état « normal », c’est-à-dire défini par une norme
naturelle.
L’homme moderne est mal à l’aise face à la technique. Il a
honte quand il compare son état misérable, son état d’homme
naturel, à la splendeur de la machine.
Faible ambition quand on la compare à celle de nos modernes
transhumanistes ! Eux nous promettent rien de moins que la
création d’une nouvelle espèce, sans plus de référence
naturelle. Les thuriféraires des NBIC (Nanotechnology,
Biotechnology, artificial Intelligence, Cognitive science)
parlent d’une avancée majeure, une rupture inouïe vouée à
révolutionner l’homme et la nature − ou ce qu’il en reste. Les
organes usés par le vieillissement ou la maladie seront
régénérés à l’infini et augmentés par les nanotechnologies.
Des neuro-implants décupleront nos facultés mentales, prélude
à la connexion directe du cerveau à l’ordinateur et à la
création d’une « pensée hybride ». Dans le même temps, on
pratiquera une sélection rigoureuse des embryons conçus par
fécondation in vitro. Seuls les plus « performants » seront
conservés et implantés − éventuellement dans un utérus
artificiel −, voire clonés, pour améliorer peu à peu l’espèce
humaine.
Au bout de tous ces progrès, ce sera « la mort de la mort ».
Enfin, le surhomme immortel pourra s’arracher à la glaise
terrestre et voler à la conquête de mondes nouveaux, la
colonisation spatiale parachevant le rêve de devenir maître et
possesseur de la nature toute entière.
Note LHK
https://www.businessinsider.fr/pourquoi-elon-musk-veut-envoyer
-une-bombe-atomique-sur-mars/
Pour les transhumanistes, la condition humaine est une prison,
et tout ce qui permet de s’en affranchir est souhaitable.
Faut-il qu’ils soient mal dans leur peau pour désirer leur
propre effacement au profit d’une chimère homme-machine !
Faut-il qu’ils soient tenaillés par ce que Günther Anders
appelait « la honte prométhéenne » !
Note LHK
https://lilianeheldkhawam.com/2020/08/08/la-suppression-du-cas
h-une-etape-vers-le-transhumanisme-big-reset/
Selon Anders, l’homme moderne est mal à l’aise face à la
technique. Il a honte quand il compare son état misérable, son
état d’homme naturel, à la splendeur de la machine. Honte
devant les machines, les produits techniques qu’il a créés
lui-même, ou plutôt que d’autres ont créés pour lui.
Le nouveau médecin technoscientifique est là pour guérir
l’homme de sa honte prométhéenne. Il est là pour construire le
cyborg qui va reléguer l’homme naturel aux oubliettes de
l’évolution des espèces. Demain, ouvrier qualifié bien dirigé
par des ingénieurs inventifs, il implantera des fonctions
nouvelles dans ce terreau fertile qu’est la chair. Sous son
bistouri, le corps ne sera plus un donné, il deviendra un
support. Il ne sera plus une fin, mais un moyen.
Le nouveau médecin technoscientifique est là pour guérir
l’homme de sa honte prométhéenne. Il est là pour construire le
cyborg qui va reléguer l’homme naturel aux oubliettes de
l’évolution des espèces.
Bien sûr, seuls les riches auront les moyens d’accéder à de
telles techniques, tellement consommatrices d’énergie et de
matériaux rares. Avec, à la clé, une société encore plus
inégalitaire, encore plus violente. Imaginons cette société,
où des humains augmentés voisineront avec ces « chimpanzés du
futur » que seront devenus les hommes naturels.
Les uns, poussés à toujours plus de prédation pour assurer le
fonctionnement et la maintenance des gadgets dont dépendra
leur vie. Les autres, acculés à la misère, fourbissant leurs
armes dans l’attente de l’ultime révolte qui emportera un
monde détesté. Pris d’assaut par des vagues de miséreux qui
auront pour eux le nombre et l’énergie du désespoir, ce monde
retournera tôt ou tard à la barbarie. La technoscience, dont
nous sommes si fiers, ne sera plus alors qu’un lointain
souvenir.
Où va la science ?
La science nous promet un envol radieux, délivré des
pesanteurs de notre condition mortelle et terrestre. Mais le
futur pourrait être tout autre. Le cheval emballé de la
technoscience pourrait rencontrer plus tôt que prévu le mur de
la réalité. Ses prétentions infinies pourraient se fracasser
sur les limites d’un monde fini. Limites écologiques, limites
économiques, limites politiques et sociales.
Pour honorer ses immenses promesses, la technoscience a besoin
d’un monde riche, stable, ordonné. Le monde tel qu’il est,
monde surpeuplé, pollué et dégradé, épuisé par l’exploitation
intensive de ressources non renouvelables, ravagé par les
guerres et les inégalités sociales, hanté par des hordes de
déracinés, ce monde qui est sur le point de basculer dans le
chaos permettra-t-il encore que la devise comtienne, « Ordre
et Progrès », soit plus qu’un doux rêve ?
Le désordre mondial qui vient fera rendre gorge aux utopies
technoprogressistes, dont le transhumanisme est le dernier
avatar. On peut le regretter… ou éprouver un secret
soulagement. Après tout, le rêve technoscientifique n’était-il
pas en train de virer au cauchemar ?
Anne-Laure Boch
source : https://sciences-critiques.fr
via https://lilianeheldkhawam.com
S-ar putea să vă placă și
- Bruno Latour - Les Microbes. Guerre Et Paix, Suivi de Irréductions-Paris - A.M. Métailié (1984) PDFDocument281 paginiBruno Latour - Les Microbes. Guerre Et Paix, Suivi de Irréductions-Paris - A.M. Métailié (1984) PDFPaolo GodoyÎncă nu există evaluări
- Les Theories de La Connaissance - Besnier Jean-MichelDocument49 paginiLes Theories de La Connaissance - Besnier Jean-MichelBenjamin Lassauzet50% (2)
- Prise en Main de Microsoft Office Excel 2016Document713 paginiPrise en Main de Microsoft Office Excel 2016max80% (5)
- Canalisations de Gaz NaturelDocument120 paginiCanalisations de Gaz NaturelJean-David DelordÎncă nu există evaluări
- Calendrier Des Examens Semestre Impair Janvier 2022 AlphaDocument28 paginiCalendrier Des Examens Semestre Impair Janvier 2022 AlphaMeg JustMegÎncă nu există evaluări
- Esprit ScientifiquesDocument8 paginiEsprit Scientifiquesabakarmahamatfaouzi825Încă nu există evaluări
- Cours La Science I 1°) 2°)Document2 paginiCours La Science I 1°) 2°)chapatÎncă nu există evaluări
- Sciences Et TechniquesDocument4 paginiSciences Et TechniquesMariame TandiaÎncă nu există evaluări
- La Science La Raison La VéritéDocument9 paginiLa Science La Raison La VéritéSacha Bollaro100% (1)
- EPISTEMOLOGIE OkDocument6 paginiEPISTEMOLOGIE OkMamadou Moustapha SarrÎncă nu există evaluări
- 2011 - 10 - 20 - Jeudi de L'imaginaire Jean-Marc Lévy-LeblondDocument46 pagini2011 - 10 - 20 - Jeudi de L'imaginaire Jean-Marc Lévy-LeblondFrançois AlexandreÎncă nu există evaluări
- 65fc0d2a33ee0 - Introduction Au Thème, Voc, Étude de TexteDocument7 pagini65fc0d2a33ee0 - Introduction Au Thème, Voc, Étude de TexteQuran Stream إذاعة القرآن الكريمÎncă nu există evaluări
- Les Nouvelles Questions Posees A La Science-EtienneKlein PDFDocument8 paginiLes Nouvelles Questions Posees A La Science-EtienneKlein PDFagfa1Încă nu există evaluări
- La restauration de l'homme: C. S. Lewis contre le scientismeDe la EverandLa restauration de l'homme: C. S. Lewis contre le scientismeÎncă nu există evaluări
- Basarab Nicolescu, L'homme Peut-Il Vivre Sans Spiritualité?Document14 paginiBasarab Nicolescu, L'homme Peut-Il Vivre Sans Spiritualité?Basarab Nicolescu100% (3)
- La Planète Laboratoire 1Document16 paginiLa Planète Laboratoire 1bn100% (16)
- Science Experience Et NatureDocument5 paginiScience Experience Et NatureLam LêÎncă nu există evaluări
- La ScienceDocument6 paginiLa ScienceFawzia BenyahiaÎncă nu există evaluări
- Y A-T-Il Une Place Pour La Philosophie Dans Une Société Qui Accorde Toute Sa Confiance À La Raison Scientifique Et À La Réussite Technique - SAMABACDocument8 paginiY A-T-Il Une Place Pour La Philosophie Dans Une Société Qui Accorde Toute Sa Confiance À La Raison Scientifique Et À La Réussite Technique - SAMABACbeavoguipaulbarre047Încă nu există evaluări
- Enquête Sur Les OVNIS - Voyage Aux Frontières de La ScienceDocument286 paginiEnquête Sur Les OVNIS - Voyage Aux Frontières de La ScienceismaelÎncă nu există evaluări
- Corrige Sujets Philosophie Bac 2021 Amerique Nord 2Document13 paginiCorrige Sujets Philosophie Bac 2021 Amerique Nord 2lapi fabiÎncă nu există evaluări
- ScienceDocument20 paginiSciencezarroug zarrougÎncă nu există evaluări
- L'ADN Communique Dans L'universDocument6 paginiL'ADN Communique Dans L'universGreenLegend100% (1)
- La TechniqueDocument5 paginiLa Techniquemzt5z6mpdcÎncă nu există evaluări
- Le Monde Humain Est-Il Fondamentalement Technique ?Document3 paginiLe Monde Humain Est-Il Fondamentalement Technique ?ltontini30Încă nu există evaluări
- La Technique E Le VesDocument18 paginiLa Technique E Le VesCarla ArmandoÎncă nu există evaluări
- Qu'est-Ce Que La Science ? de La Philosophie À La Science - Les Origines de La RDocument32 paginiQu'est-Ce Que La Science ? de La Philosophie À La Science - Les Origines de La RkerenÎncă nu există evaluări
- Texte 1013Document13 paginiTexte 1013Louis Yannick EssombaÎncă nu există evaluări
- Virus, parasites et ordinateurs: Le troisième hémisphère du cerveauDe la EverandVirus, parasites et ordinateurs: Le troisième hémisphère du cerveauÎncă nu există evaluări
- Chap6 La ScienceDocument11 paginiChap6 La SciencezeldasunarteÎncă nu există evaluări
- Conversation Sur... Les Multivers (Etc.) (Z-Library)Document295 paginiConversation Sur... Les Multivers (Etc.) (Z-Library)Hicham YangÎncă nu există evaluări
- Privatisation de La ScienceDocument24 paginiPrivatisation de La ScienceFederico Lorenc ValcarceÎncă nu există evaluări
- L'Être Subconscient DR E (... ) Géley Gustave Bpt6k77243xDocument201 paginiL'Être Subconscient DR E (... ) Géley Gustave Bpt6k77243xgussviiÎncă nu există evaluări
- 2.la Démarche Scientifique, Relation Science-Société PDFDocument4 pagini2.la Démarche Scientifique, Relation Science-Société PDFkimmik100% (1)
- Jousset-Couturier, Béatrice-Le Transhumanisme - Faut-Il Avoir Peur de L'avenir - Eyrolles (2016)Document198 paginiJousset-Couturier, Béatrice-Le Transhumanisme - Faut-Il Avoir Peur de L'avenir - Eyrolles (2016)najah69100% (2)
- ScienceDocument15 paginiSciencePhilippe ARNOULDÎncă nu există evaluări
- Séance 4Document3 paginiSéance 4Johnny Le princeÎncă nu există evaluări
- Null 1Document15 paginiNull 1Louis Yannick EssombaÎncă nu există evaluări
- Faut Il Croire A ToutDocument424 paginiFaut Il Croire A Toutolivier_chauvin1Încă nu există evaluări
- Citton 2018Document17 paginiCitton 2018Evelyn FrosiniÎncă nu există evaluări
- Demain Les PosthumainsDocument15 paginiDemain Les PosthumainsFranck DubostÎncă nu există evaluări
- La Vérité en Science Expérimentale Cours CompletDocument7 paginiLa Vérité en Science Expérimentale Cours Completmsm le plus beau des reubeusÎncă nu există evaluări
- Citation SciencesDocument13 paginiCitation SciencesME CISSÉÎncă nu există evaluări
- Tourreilles Aurelien 2019Document413 paginiTourreilles Aurelien 2019Sami CherkaouiÎncă nu există evaluări
- Les Avantages Et Les Inconvénients de La ModernitéDocument13 paginiLes Avantages Et Les Inconvénients de La Modernitéhorny negroÎncă nu există evaluări
- Bernard D'espagnat - Physique Contemporaine Et Intelligibité Du Monde PDFDocument7 paginiBernard D'espagnat - Physique Contemporaine Et Intelligibité Du Monde PDFRicardo CabralÎncă nu există evaluări
- La Réalité Multifactuelle: 1. La Troisième Loi de Newton en Tant Que Principe Épistémologique Dans L'enquête PhysiqueDocument21 paginiLa Réalité Multifactuelle: 1. La Troisième Loi de Newton en Tant Que Principe Épistémologique Dans L'enquête Physiquepablo aravenaÎncă nu există evaluări
- HG20-TE-09-19-Corrige Chapitre 1Document2 paginiHG20-TE-09-19-Corrige Chapitre 1SomaÎncă nu există evaluări
- Futur Sans AvenirDocument2 paginiFutur Sans AvenirihcenusÎncă nu există evaluări
- Plaidoyer Pour Les SciencesDocument61 paginiPlaidoyer Pour Les Sciencesvincent.jullien29Încă nu există evaluări
- 534 B 8 Dade 2162Document5 pagini534 B 8 Dade 2162abass kabeÎncă nu există evaluări
- Feuilletage 2661Document13 paginiFeuilletage 2661Afef RabaouiÎncă nu există evaluări
- LEFEBVRE Henri - Espace Et Politique (Le Droit À La Ville II)Document117 paginiLEFEBVRE Henri - Espace Et Politique (Le Droit À La Ville II)El CheÎncă nu există evaluări
- Methode Experimentale Et OvnisDocument32 paginiMethode Experimentale Et Ovnislyon60Încă nu există evaluări
- Morin L Evenement SphinxDocument21 paginiMorin L Evenement Sphinxana_parisíÎncă nu există evaluări
- L'homme Et La ScienceDocument9 paginiL'homme Et La ScienceDorsaf FerjeniÎncă nu există evaluări
- La Logique de La DecouverteDocument3 paginiLa Logique de La DecouverteLam LêÎncă nu există evaluări
- Aristote Et La Méthode Scientifique NetherDocument7 paginiAristote Et La Méthode Scientifique NetherIbrahim BekkaliÎncă nu există evaluări
- Cahen, Pour La Science de L'histoireDocument17 paginiCahen, Pour La Science de L'histoireWiktor OstaszÎncă nu există evaluări
- Durkheim - La Science Sociale Et L'action - 1. Cours de Science Sociale Leçon D'ouverture (1888)Document21 paginiDurkheim - La Science Sociale Et L'action - 1. Cours de Science Sociale Leçon D'ouverture (1888)abderrahman33Încă nu există evaluări
- Mecanique Quantique HT-3 PDFDocument23 paginiMecanique Quantique HT-3 PDFlkdhfldhfÎncă nu există evaluări
- La Sociologie en France Au XIXe Siècle - Émile DurkheimDocument17 paginiLa Sociologie en France Au XIXe Siècle - Émile DurkheimEnzo PitonÎncă nu există evaluări
- Le Temps N'est Plus Celui de L'information Il Est Devenu Celui de La Résistance PDFDocument1 paginăLe Temps N'est Plus Celui de L'information Il Est Devenu Celui de La Résistance PDFvvasileÎncă nu există evaluări
- Covid-19 Les Tests Diagnostiques. Quelques Notions Essentielles Avec Exemples (Fiabilité, Sensibilité, Spécificité, Valeurs Prédictives)Document1 paginăCovid-19 Les Tests Diagnostiques. Quelques Notions Essentielles Avec Exemples (Fiabilité, Sensibilité, Spécificité, Valeurs Prédictives)vvasileÎncă nu există evaluări
- Groupe Grothendieck - Dix Thèses Sur La Technoscience - o Privire Asupra Lumii de Azi PDFDocument11 paginiGroupe Grothendieck - Dix Thèses Sur La Technoscience - o Privire Asupra Lumii de Azi PDFvvasileÎncă nu există evaluări
- Et Si Le - SRA'' Expliquait La Covid-19 - PDFDocument1 paginăEt Si Le - SRA'' Expliquait La Covid-19 - PDFvvasileÎncă nu există evaluări
- Appareil Juxtaglomérulaire - Wikipédia PDFDocument1 paginăAppareil Juxtaglomérulaire - Wikipédia PDFvvasileÎncă nu există evaluări
- Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone - Wikipédia PDFDocument1 paginăSystème Rénine-Angiotensine-Aldostérone - Wikipédia PDFvvasileÎncă nu există evaluări
- Sraa - SCD T 2005 0212 Dupuis PDFDocument302 paginiSraa - SCD T 2005 0212 Dupuis PDFvvasileÎncă nu există evaluări
- ALIZE LCPC MU v1.5 FR PDFDocument116 paginiALIZE LCPC MU v1.5 FR PDFSoumana Abdou100% (1)
- Memoire Inj Messaoud BENZOUAIDocument168 paginiMemoire Inj Messaoud BENZOUAIManong ShegueyÎncă nu există evaluări
- Af Sen GaeDocument42 paginiAf Sen GaeعبداللهبنزنوÎncă nu există evaluări
- Format Eur FrancaiseDocument1 paginăFormat Eur FrancaiseAdnan NandaÎncă nu există evaluări
- Observons:: Nature Du Complément Circonstanciel de TempsDocument2 paginiObservons:: Nature Du Complément Circonstanciel de TempsMehdi YMÎncă nu există evaluări
- 3 Branches Triphasées en Injection Directe M215 Ou M250Document1 pagină3 Branches Triphasées en Injection Directe M215 Ou M250MbgardÎncă nu există evaluări
- RSE & EthiqueDocument6 paginiRSE & Ethiquealemor2369Încă nu există evaluări
- TP2Document4 paginiTP2Youssef Don RajawiÎncă nu există evaluări
- Thèse Data IntegrityDocument83 paginiThèse Data IntegrityBasma YagoubiÎncă nu există evaluări
- Analyse D'une Situation de Communication en TaDocument2 paginiAnalyse D'une Situation de Communication en Taroger martin bassong batiigÎncă nu există evaluări
- Arval - Cofrastra 40Document16 paginiArval - Cofrastra 40helder.fradeÎncă nu există evaluări
- Exercice D'application Optique VDocument1 paginăExercice D'application Optique VARDALAn MohamedÎncă nu există evaluări
- Depliant ELM MasterDocument3 paginiDepliant ELM MasterYazid AbouchihabeddineÎncă nu există evaluări
- ExcisionDocument54 paginiExcisionAbdou Razak OuédraogoÎncă nu există evaluări
- Observatoire National de La Filiere Riz Du Burkina Faso (Onriz)Document6 paginiObservatoire National de La Filiere Riz Du Burkina Faso (Onriz)toni_yousf2418Încă nu există evaluări
- Racines Carrees BaseDocument8 paginiRacines Carrees Basejulien9562Încă nu există evaluări
- Introduction À La RobotiqueDocument19 paginiIntroduction À La RobotiqueRazzougui SarahÎncă nu există evaluări
- AnnexeDocument168 paginiAnnexeMoez AliÎncă nu există evaluări
- Controle Et Suivi Chantier RoutierhjhDocument14 paginiControle Et Suivi Chantier Routierhjhعثمان البريشيÎncă nu există evaluări
- Jadwal Genap 2223-2Document2 paginiJadwal Genap 2223-2nowo benyÎncă nu există evaluări
- 2nd - Exercices Corrigés - Variations D'une FonctDocument1 pagină2nd - Exercices Corrigés - Variations D'une Fonctalyahmed610Încă nu există evaluări
- Caplp Externe Genie Electrique Electrotechnique Et Energie Epreuve 1 Doc RessourcesDocument28 paginiCaplp Externe Genie Electrique Electrotechnique Et Energie Epreuve 1 Doc RessourcesOus SàmàÎncă nu există evaluări
- The Cuban Missile CrisisDocument8 paginiThe Cuban Missile Crisismilan.bodis523Încă nu există evaluări
- Cahier D Exercices Ile Aux Mots 8hDocument88 paginiCahier D Exercices Ile Aux Mots 8hCizÎncă nu există evaluări
- Chapitre 1 LES OUTILS MATHEMATIQUESDocument9 paginiChapitre 1 LES OUTILS MATHEMATIQUESa.ddÎncă nu există evaluări
- Exam. F.CDocument2 paginiExam. F.CmidsmasherÎncă nu există evaluări
- Tube VentouriDocument10 paginiTube VentouriMohammed BoulbairÎncă nu există evaluări