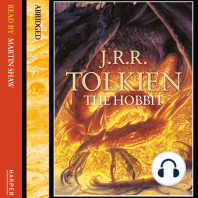Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Ricardo Principes 2
Încărcat de
Amine ReggaeTitlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Ricardo Principes 2
Încărcat de
Amine ReggaeDrepturi de autor:
Formate disponibile
David Ricardo (1817)
Des principes de lconomie politique et de limpt
Traduit de lAnglais par Francisco Solano Constancio et Alcide Fonteyraud., 1847 partir de la 3e dition anglaise de 1821. ***
Augment des notes de Jean-Baptiste Say Chapitres XVII XXXII
Un document produit en version numrique par Pierre Tremblay, Collaborateur bnvole Courriel: muishkin42@hotmail.com Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales" Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html Une collection dveloppe par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi en collaboration avec la Bibliothque Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
Cette dition lectronique a t ralise par Pierre Tremblay, collaborateur bnvole, muishkin42@hotmail.com
dans la bibliothque virtuelle Les Classiques des sciences sociales
partir de:
Ricardo, David (1772-1823) Des principes de lconomie politique et de limpt (1817)
Chapitres XVII XXXII
Traduit de lAnglais en 1847 par Francisco Solano Constancio et Alcide Fonteyraud, partir de
la 3e dition anglaise de 1821. 584 pages.
Collection des principaux conomistes, Tome 13 ; uvre complte de David Ricardo, Volume 1, Paris : Osnabrck ; O. Zeller, 1966, Rimpression de ldition 1847, pages 51-443.
Une dition lectronique ralise partir du fac-simil de l'dition originale telle que reproduite par la Bibliothque Nationale de France: http://www.gallica.bnf.fr/ Polices de caractres utilises : Pour le texte: Times New Roman, 12 points. Pour les citations : Times New Roman, 10 points. Pour les notes de bas de page : Times New Roman, 10 points. dition lectronique ralise le 6 juillet 2002 avec le traitement de textes Microsoft Word 1997 sur Windows 98. Mise en page sur papier format LETTRE (US letter, 8.5 x 11)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
Table des matires
Premier fichier (de deux)
Prface de lauteur Avertissement pour la troisime dition Chapitre I De la valeur Section premire Section II Section III Section IV Section V Section VI Section VII Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI Chapitre VII Chapitre VIII Chapitre IX Chapitre X Chapitre XI Chapitre XII Chapitre XIII Chapitre XIV Chapitre XV Chapitre XVI De la rente de la terre Du profit foncier des mines Du prix naturel et du prix courant Des salaires Des profits Du commerce extrieur De limpt Des impts sur les produits naturels Des impts sur les rentes De la dme De limpt foncier Des impts sur lor Des impts sur les maisons Des impts sur les profits Des impts sur les salaires
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
Table des matires
Deuxime fichier (de deux)
Chapitre XVII Chapitre XVIII Chapitre XIX Chapitre XX Chapitre XXI Chapitre XXII Chapitre XXIII Chapitre XXIV Chapitre XXV Chapitre XXVI Chapitre XXVII Chapitre XXVIII Chapitre XXIX Chapitre XXX Chapitre XXXI Chapitre XXXII
Des impts sur les produits non agricoles De la taxe des pauvres Des changements soudains dans les voies du commerce Des proprits distinctives de la valeur des richesses Des effets de laccumulation sur les profits et les intrts des capitaux Des primes lexportation et des prohibitions limportation Des primes accordes la production De la doctrine dAdam Smith sur la rente de la terre Du commerce colonial Du revenu brut et du revenu net De la monnaie et des banques De la valeur comparative de lor, du bl, et de la main-duvre, dans les pays riches et dans les pays pauvres Des impts pays par le producteur De linfluence que loffre et la demande ont sur les prix Des machines De lopinion de M. Malthus sur la rente
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
Chapitre XVII.
DES IMPTS SUR LES PRODUITS NON AGRICOLES.
Table des matires
Par le mme principe quun impt sur le bl en lve le prix, un impt sur toute autre denre la fera galement renchrir. Si le prix de cette denre ne haussait pas dune somme gale celle de limpt, elle ne rapporterait pas au producteur le mme profit quil retirait auparavant, et il dplacerait son capital pour lui donner un autre emploi. Les impts sur toute espce de choses, quelles soient de ncessit ou de luxe, tant que la valeur de la monnaie reste la mme, en feront toujours hausser la valeur dune somme au moins gale celle de limpt 1. Un impt sur les objets manufacturs, ncessaires pour
1
M. Say observe quun manufacturier ne peut pas faire payer au consommateur tout le montant de limpt lev sur sa marchandise, parce que la hausse du prix en diminuera la consommation. Si cela arrivait, si la consommation diminuait, lapprovisionnement ne diminuerait-il pas promptement aussi ? Pourquoi le manufacturier continuerait-il son commerce, si ses profits tombaient au-dessous du niveau des profits des autres industries ? M. Say parat avoir oubli aussi dans ce passage la doctrine quil a soutenue ailleurs, que les frais de production dterminent le plus bas prix des choses, le prix au-dessous duquel elles ne
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
lusage de louvrier, aurait le mme effet quun impt sur le bl, qui ne diffre des autres choses ncessaires, que parce quil est, entre toutes, la premire et la plus importante ; et cet impt produirait prcisment les mmes effets sur les profits des capitaux et sur le commerce tranger. Mais un impt sur les objets de luxe naurait dautre effet que de les faire renchrir. Il retomberait en entier sur le consommateur, et il ne saurait ni faire hausser les salaires, ni faire baisser les profits. Les impts quon lve sur un pays pour les frais de la guerre ou pour les dpenses ordinaires du gouvernement, et dont le produit est principalement destin lentretien douvriers improductifs, sont pris sur lindustrie productive du pays ; et tout ce quon peut pargner sur de telles dpenses, est en gnral autant dajout au revenu ou mme au capital des contribuables. Quand on lve, par la voie dun emprunt, 20 millions pour les dpenses dune anne de guerre, ce sont 20 millions que lon enlve au capital productif de la nation. Le million annuel quon lve par des impts pour payer les intrts de cet emprunt, ne fait que passer des mains de ceux qui le paient dans celles de ceux qui le reoivent, des mains du contribuable dans celles du crancier de ltat. La dpense relle, ce sont les 20 millions, et non lintrt quil faut en payer 1.
tombent pas dune manire durable, car alors la production sarrte ou diminue. Liv. II, chap. 4. Limpt, dans ce cas, porte donc en partie sur le consommateur, qui paie le produit plus cher, et en partie sur le producteur, qui, limpt dduit, se trouve lavoir moins vendu. Le trsor public profite de ce que le consommateur paie de plus, et du sacrifice que le producteur est oblig de faire dune partie de ses profits. Cest leffort de la poudre qui agit la foi sur le boulet quelle chasse, et sur le canon quelle fait reculer. Liv. III, chap. 8. (Note de lAuteur). Jai dj eu occasion de remarquer que M. Ricardo admet trop gnralement et sans restriction que les capitaux et lindustrie se retirent dune production qui ne donne pas des profits gaux aux profits des autres commerces. Dans presque tous les genres dindustrie, il se trouve des capitaux tellement engags quon ne pourrait les retirer de leur emploi sans altrer considrablement leur valeur. Les talents et les travaux industriels eux-mmes ne changent pas dobjet sans de graves inconvnients. On aime mieux continuer travailler dans un genre qui rapporte moins, parce quil y aurait plus de perte encore changer ; et cet effet se perptue quelquefois un demi-sicle durant, cest--dire tout le temps que dure bien souvent la forme dadministration et le systme des contributions. Il est impossible de ngliger des circonstances qui influent si puissamment sur les rsultats ; on risque beaucoup de se tromper quand on na les yeux fixs que sur quelques grands principes, et quon ne veut compter pour rien les modifications quils reoivent des considrations accessoires. Les circonstances agissent en vertu de principes tout aussi incontestables, et qui, de mme que les principes les plus gnraux, dpendent de la nature des choses. - J.-B. SAY. Melon dit que les dettes dun tat sont des dettes de la main droite la main gauche dont le corps ne se trouve pas affaibli. A la vrit, la richesse gnrale nest point diminue par le paiement des intrts ou arrrages de la dette : les intrts sont une valeur qui passe de la main du contribuable dans celle du rentier de ltat : que ce soit le rentier ou le contribuable qui laccumule ou la consomme, peu importe la socit, jen conviens ; mais le principal de cette rente o est-il ? il nest plus. La consommation qui a suivi lemprunt a emport un capital qui ne rapportera plus de revenu. La socit est prive, non du montant des rentes, puisquil passe dune main dans lautre, mais du revenu dun capital dtruit. Ce capital, s'il avait t employ productivement par celui qui l'a prt l'tat, lui aurait galement procur un intrt ; mais cet intrt aurait t fourni par une vritable production, et ne serait pas sorti de la poche d'un concitoyen. - J.-B. SAY, liv. III, chap. 9. Ce passage est conu et rendu selon le vritable esprit de la science. (Note de l'Auteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
Que les intrts de l'emprunt soient ou ne soient pas pays, la nation ne s'en trouvera ni plus ni moins riche. Le gouvernement aurait pu lever d'un coup les 20 millions par le moyen d'impts, et dans ce cas, il aurait t inutile de lever pour un million d'impts annuels. Cela n'aurait cependant pas chang la nature de l'opration. On aurait pu forcer un individu de donner 2000 1. pour une seule fois, au lieu de payer 100 1. tous les ans ; et il pourrait aussi convenir davantage cet individu d'emprunter ces 2000 1., et den payer 100 1. d'intrts par an au prteur, plutt que de prendre la plus forte de ces deux sommes sur son propre fonds. Dans l'un de ces cas, c'est une transaction prive entre A et B ; dans l'autre, c'est le gouvernement qui garantit B le paiement des intrts qui doivent galement tre pays par A. Si la ngociation et t entre particuliers, il n'en aurait pas t fait d'acte authentique, et il aurait t peu prs indiffrent pour le pays que A excutt ponctuellement son contrat avec B, ou qu'il retnt injustement les 100 1. par an en sa possession. L'intrt de la nation, en gnral, serait que le contrat s'excutt ponctuellement ; mais quant la richesse nationale, le seul objet d'intrt est de savoir lequel de A ou de B rendra ces 100 1. plus productives ; mais 1'gard de cette question, la nation n'a ni le droit ni les moyens de la dcider. Il serait possible que A, gardant cette somme pour son usage, la dissipt d'une manire improductive ; et il serait possible aussi qu'au contraire ce ft B qui la dissipt, tandis que A l'emploierait d'une manire productive. Sous le seul point de vue de l'utilit nationale, il pourrait tre plus ou moins dsirer que A payt ou ne payt pas la somme ; mais les principes de la justice et de la bonne foi, qui sont d'une tout autre importance, ne doivent point cder des considrations d'un intrt bien moindre ; et par consquent, si on rclamait l'intervention du gouvernement, les tribunaux obligeraient A excuter son contrat. Une dette garantie par la nation ne diffre en rien d'une telle ngociation. La justice et la bonne foi exigent que les intrts de la dette nationale continuent d'tre pays, et que ceux qui ont avanc leurs capitaux pour l'avantage gnral, ne soient pas forcs de renoncer leurs justes prtentions, sous le prtexte que cela convient ltat 1. Mais, cette considration part, il nest pas du tout sr que lutilit publique gagnt quelque chose au sacrifice de la justice politique ; il nest nullement certain que ceux quon librerait du paiement des intrts de la dette nationale, employassent cet argent dune manire plus productive que ceux qui il est incontestablement d. En supprimant la dette nationale, le revenu dune personne pourrait monter de 1,000 1. 1,500 1. ; mais celui dune autre baisserait de 1,500 1. 1,000 1. Les revenus de ces deux individus, ensemble, montent prsent 2,500 1. ; et ils ne vaudraient pas davantage aprs la banque-route. Si lobjet de tout gouvernement est de lever des impts, il y aurait le mme capital et le mme revenu imposable dans un cas que dans lautre.
1
A Dieu ne plaise que je veuille quaucun Gouvernement manque de parole aux cranciers de ltat ; mais si jamais pareil malheur arrive entre Palerme et dimbourg, on lira en tte de ldit un beau prambule dans lequel il sera dit : Attendu que les cranciers de ltat ont prt, non pour Iavantage gnral, mais pour retirer un bon intrt de leurs fonds ; attendu quils ont prt, non nous, mais, des gouvernants qui nous ont prcds, qui non-seulement ntaient pas nous, mais ont employ cet argent nous combattre, nous ou le systme que nous chrissons ; attendu quils nont t guids par aucun sentiment de confiance, mais plutt par le dsir davoir une proprit que limpt natteint pas, et quon peut vendre la Bourse du jour an lendemain ; attendu que la nation nest point engage par le vote de lgislateurs qui se disaient ses reprsentants, mais qui ne reprsentaient en ralit que la volont des ministres occups du doux emploi de dissiper les fonds de tous ces emprunts, etc., etc. - J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
Ce nest donc pas le paiement des intrts de la dette nationale, qui accable une nation, et ce nest pas en supprimant ce paiement quelle peut tre soulage. Ce nest que par des conomies sur le revenu, et en rduisant les dpenses, que le capital national peut saccrotre ; et lanantissement de la dette nationale ne contribuerait en rien augmenter le revenu ni diminuer les dpenses. Cest la profusion des dpenses du gouvernement et des particuliers, ce sont les emprunts qui appauvrissent un pays ; par consquent, toute mesure qui pourra tendre encourager lconomie du gouvernement et des particuliers soulagera la dtresse publique, sans doute, mais cest une erreur et une illusion de croire quon peut soulager une nation du poids dun fardeau qui laccable, en ltant de dessus une classe de la socit qui doit le supporter, pour le faire peser sur une autre qui, suivant tous les principes dquit, ne doit supporter que sa part. On aurait tort de conclure de tout ce que je viens de dire que je regarde le systme des emprunts comme le meilleur moyen de fournir aux dpenses extraordinaires de ltat. Cest un systme qui tend a nous rendre moins industrieux, nous aveugler sur notre situation. Si les frais dune guerre montent a 40 millions par an, et que la part dun particulier, pour subvenir cette dpense annuelle, soit de 100 l., il tchera, si lon exige de lui le paiement total et immdiat de cette somme, dpargner promptement 100 1. sur son revenu. Par le systme des emprunts, on nexige de lui que lintrt de ces 100 1., ou 5 1. par an ; il croit quil lui suffit dpargner ces 5 1. sur sa dpense, et il se fait illusion, se croyant aussi riche en fonds que par le pass. La nation et son gouvernement, en raisonnant et en agissant de la sorte, npargnent que les intrts de 40 millions, ou de 2 millions ; et ils perdent nonseulement tous les intrts ou le profit que 40 millions de capital employs productivement auraient rendus, mais ils perdent encore 38 millions, diffrence entre leur pargne et leur dpense ordinaire. Si, comme je lai observ plus haut, chacun avait faire un emprunt particulier, afin de contribuer pour toute sa part aux besoins de ltat, ds que la guerre serait termine, limpt cesserait, et toutes les denres, reviendraient linstant leur taux naturel. A pourrait avoir payer, sur son fonds particulier, B, lintrt de largent que ce dernier lui aurait prt pendant la guerre, pour lui donner les moyens de payer sa quote-part des dpenses publiques ; mais la nation ne sen mlerait pas. Un pays qui a laiss une grande dette saccumuler, se trouve plac dans une situation artificielle ; et quoique le montant de ses impts et laugmentation du prix du travail puissent navoir et naient probablement dautre inconvnient, par rapport aux pays trangers, que linconvnient invitable de payer ces impts, il est cependant de lintrt de tout contribuable de se soustraire cette charge, en en rejetant le paiement sur les autres. Le dsir de transporter sa personne et son capital dans un autre pays o on soit exempt de pareilles charges, devient la longue irrsistible, et finit par vaincre la rpugnance naturelle que tout le monde prouve renoncer son pays natal et aux objets de ses premires affections. Un pays qui sest plong daris les embarras quentrane ce systme artificiel, ferait bien de sen dbarrasser par le sacrifice mme dune portion de son capital, suffisante pour racheter sa dette. La conduite qui conviendrait un particulier convient galement une nation. Un
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
particulier qui a 10,000 1. de fortune, qui lui rapportent 500 l., sur lesquelles il est tenu de payer 100 1. par an, ne possde rellement que 8,000 l., et il serait aussi riche en continuant de payer 100 1. par an ou en sacrifiant une fois pour toutes 2,000 1. Mais qui serait, demandera-t-on , lacheteur des proprits quil serait oblig de vendre pour se procurer ces 2,000 1. ? La rponse est toute simple. Le crancier national, qui doit recevoir ces 2,000 l., aura besoin de placer son argent ; et il sera dispos le prter au propritaire foncier, ou au manufacturier, ou leur acheter une partie des proprits quils ont vendre. Les capitalistes eux-mmes contribueraient beaucoup amener ce rsultat. On a souvent propos un plan de ce genre ; mais nous ne sommes, je le crains, ni assez sages ni assez vertueux pour ladopter. On doit cependant admettre que, pendant la paix, nos efforts doivent tre dirigs vers le paiement de la portion de dette qui a t contracte pendant la guerre, et quaucun dsir dallger un fardeau, qui, je lespre, nest que temporaire, ne doit nous dtourner un instant de ce grand objet. Aucun fonds damortissement ne peut contribuer dune manire efficace diminuer la dette de ltat, sil nest tir de lexcdant du revenu sur la dpense publique. Il est regretter que le fonds damortissement de lAngleterre ne le soit que de nom ; car il nexiste pas, chez nous, dexcdant de la recette sur la dpense. Ce ne sont que les conomies qui pourraient le rendre ce quil devrait tre, un fonds rellement capable dteindre la dette nationale. Si, au moment o une nouvelle guerre clatera, nous navons pas teint une grande partie de notre dette, il arrivera de deux choses lune : ou tous les frais de cette nouvelle guerre seront pays par des impts levs anne par anne, ou bien il faudra qu la fin de la guerre, et peut-tre mme avant, nous nous soumettions une banqueroute nationale. Ce nest pas quil nous soit impossible de supporter encore un surcrot assez considrable de dette, car il est impossible dassigner des bornes aux ressources dune grande nation ; mais certes il y a des bornes aux sacrifices dargent que les particuliers peuvent consentir faire continuellement, pour le seul privilge de pouvoir vivre dans leur pays natal 1.
1
M. Robert Hamilton est, ma connaissance, le premier qui ait averti les Anglais quon nteint aucune partie de sa dette quand on emprunte dun ct plus quon ne rembourse de lautre ; quil vaut mieux ne rien rembourser et emprunter un peu moins, parce quon pargne du moins alors les frais de lopration. Je regarde nanmoins comme important de voir lopinion dun homme aussi capable que M. Ricardo, et qui connat aussi bien la nature des fonds publics en gnral, et des fonds anglais en particulier, confirmer entirement la doctrine du savant acadmicien ddimbourg ; je regarde comme important de voir M. Ricardo nous annoncer que si, au moment dune nouvelle guerre, le Gouvernement britannique na pas rembours une portion considrable de la dette (ce qui ne sachemine pas, puisque durant la paix il laugmente chaque anne) ; ou bien sil ne trouve pas le moyen de faire payer chaque anne la nation la dpense extraordinaire que cette guerre occasionnera (ce qui nest point possible, puisquon a de la peine trouver de nouveaux impts pour payer seulement lintrt de ces frais extraordinaires) ; de le voir, dis-je, nous annoncer que, sauf ces deux suppositions, qui sont inadmissibles, la banqueroute est invitable. Smith avait dit que les caisses damortissement semblaient avoir eu pour objet moins de rembourser la dette que de laccrotre. Mais Hamilton et Ricardo ont creus ce sujet jusquau fond, et y ont fait pntrer une lumire laquelle dsormais aucune fallacieuse doctrine ne saurait rsister. M. Ricardo, avec une sagacit admirable, rduit ici la question ses termes essentiels. Contracter une dette, cest se charger dun fardeau dont la banqueroute elle-mme ne saurait vous librer, puisque son effet ne serait pas daugmenter les revenus des particuliers de tout ce que limpt lverait de moins ; mais seulement daugmenter les revenus des contribuables (qui ne paieraient plus cette portion de limpt) aux dpens des rentiers (qui ne la recevraient plus). Et quel est leffet de ce fardeau invitable ? de rendre plus dure la condition des habitants du pays, de les exciter secouer cette importune charge sur les paules de leurs concitoyens en sloignant,
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
Quand une denre est un prix de monopole, elle a atteint le plus haut prix auquel le consommateur puisse consentir lacheter. Les denres natteignent ce prix de monopole que lorsquil est impossible dimaginer aucun moyen den augmenter la quantit, et lorsque, par consquent, il ny a de concurrence que dun seul ct, cest--dire, parmi les acheteurs. Le prix de monopole peut, une poque, tre beaucoup plus haut ou plus bas qu une autre, parce que la concurrence entre les acheteurs doit dpendre de leur fortune et de leurs gots ou de leurs caprices. Ces vins exquis, qui ne sont produits qu'en trs-petite quantit, et ces ouvrages de l'art, qui, par leur excellence ou leur raret, ont acquis une valeur idale seront changs contre des quantits trs-diffrentes des produits du travail ordinaire, selon que la socit sera riche ou pauvre, selon que ces produits seront abondants ou rares, et selon qu'elle se trouvera dans un tat de barbarie ou de civilisation. La valeur changeable d'une chose qui est un prix de monopole n'est donc nulle part rgle par les frais de production. Les produits immdiats de la terre ne sont pas au prix de monopole ; car le prix courant de l'orge et du bl est aussi bien rgl par les frais que leur production a cots, que celui du drap ou de la toile. La seule diffrence consiste en ce qu'une portion du capital employ en agriculture, c'est--dire la portion qui ne paie pas de rente, rgle le prix du bl ; tandis que, dans la production des ouvrages manufacturs, chaque portion de capital est employe avec les mmes rsultats ; et comme aucune portion ne paie de loyer, chacune d'elles sert galement de rgulateur du prix. D'ailleurs le bl, ainsi que tous les produits agricoles, peut tre augment en quantit par l'emploi d'un plus gros capital sur la terre, et par consquent ces denres ne sauraient jamais tre un prix de monopole. .Dans ce cas il y a concurrence parmi les vendeurs ainsi que parmi les acheteurs. Il n'en est pas de mme pour ce qui regarde la production de ces vins exquis ou de ces ouvrages prcieux des arts dont nous venons de parler ; leur quantit ne saurait tre augmente ; et rien ne met des bornes leur prix que la fortune et la volont des acheteurs. La rente de ces vignobles peut augmenter au del de toute limite raisonnable ; car aucun autre terroir ne pouvant donner de tels vins, aucun ne peut entrer en concurrence. Le bl et les produits agricoles d'un pays peuvent, la vrit, se vendre pendant un certain temps un prix de monopole ; mais cela ne peut avoir de dure que lorsqu'il n'est plus possible d'employer, d'une manire productive, de nouveaux capitaux sur les terres, et que, par consquent, les produits ne peuvent tre augments. Alors, toutes les terres cultives et tous les capitaux employs sur les terres rapporteront une rente qui sera diffrente selon la diffrence des produits. Alors aussi, tout impt qui pourra tre mis sur le fermier, tombera sur le propritaire et non sur le consommateur. Le fermier ne peut lever le prix de son bl ; car, par notre supposition, il est dj au plus haut prix auquel les acheteurs veuillent ou puissent
en se soustrayant par lmigration aux privations, aux gnes, aux frais qui rsultent de la dilapidation antrieure dun grand capital. Il prouve que le remde ce mal ne peut venir que de la restitution de ce capital ; mais pour restituer un capital, il faut laccumuler lentement en dpensant chaque anne moins quon ne reoit. Or, tout homme de bon sens se demande de qui lon peut attendre cette sage conduite : sera-ce dun gouvernement intress dpenser, multiplier le nombre de ses salaris pour multiplier ses cratures ? sera-ce de ces salaris eux-mmes intresss conserver leurs places et leur faveur aux dpens des contribuables ? ou bien sera-ce dune reprsentation nationale forte et indpendante, intresse mnager la bourse du peuple, qui est la sienne ? - J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
10
l'acheter. Il ne se contentera pas dun moindre taux de profits que celui que retirent de leurs fonds les autres capitalistes, et par consquent il naura dautre alternative que dobtenir une rduction de la rente ou de quitter son industrie. M. Buchanan regarde le bl et les produits agricoles comme tant au prix de monopole, parce que ces produits paient une rente. Selon lui, toutes les denres qui paient une rente doivent tre au prix de monopole, et il en conclut que tout impt sur les produits agricoles doit tomber sur le propritaire et non sur le consommateur.
Le prix du bl, dit-il, qui rapporte toujours une rente, ntant, sous aucun rapport, modifi par les frais de production, ces frais doivent tre pris sur la rente, et par consquent, lorsque ces frais haussent ou baissent, il nen rsulte pas un prix plus haut ou plus bas, mais une rente plus ou moins leve. Sous ce point de vue, tout impt sur les domestiques de ferme, sur les chevaux ou sur les instruments dagriculture, est rellement un impt foncier, dont le poids tombe sur le fermier pendant la dure de son bail, et sur le propritaire quand il faut le renouveler. De mme tous les instruments dagriculture perfectionns, qui pargnent des dpenses au fermier, tels que les machines battre ou faucher le bl, tout ce qui lui rend laccs du march plus ais, comme de bonnes routes, des canaux et des ponts, quoique diminuant le cot primitif du bl, nen lve cependant pas le prix courant. Tout ce qui est donc pargn par ces amliorations appartient au propritaire et fait partie de sa rente.
Il est vident que si lon accorde M. Buchanan le principe sur lequel se fonde son argument, cest--dire, que le prix du bl rapporte toujours une rente, il faudra admettre toutes les consquences quil en tire et qui en dcoulent. Des impts sur le fermier ne tomberaient donc point, dans ce cas, sur le consommateur, mais sur la rente, et tous les perfectionnements en agriculture augmenteraient celle-ci. Jespre cependant avoir montr, avec assez dvidence, que tant que toutes les terres dun pays ne sont pas cultives, et cultives par les mthodes les plus perfectionnes, il y aura toujours une portion de capital employ sur la terre qui ne rapportera point de rente ou de profit, et que cest cette portion de capital - dont le produit, comme celui des manufactures, se partage entre les profits et les salaires, - qui rgle le prix du bl. Le prix du bl qui ne rapporte pas de rente tant donc modifi par les frais de sa production, ces frais ne sauraient tre pris sur la rente ; et la suite de laugmentation de ces frais sera donc un surhaussement de prix, et non une diminution de la rente 1.
1
L'industrie manufacturire augmente ses produits a proportion de la demande, et les prix baissent ; mais
on ne peul pas augmenter ainsi les produits de la terre, et il faut toujours un haut prix pour empcher que la consommation n'excde la demande. Buchanan, tom. IV, pag. 40. Est-il possible que M. Buchanan puisse soutenir srieusement que les produits de la terre ne peuvent tre augments quand la demande en devient p1us considrable. (Note de l'Auteur.): M. Buchanan suppose, je pense, que la tendance qu'a la population devancer les moyens de subsistance (V. les raisons irrsistibles qu'en donne Malthus), tablit une demande telle, que le prix des subsistances excde toujours ce qui serait rigoureusement ncessaire pour payer les seuls profits du capital et de lindustrie employs la culture des terres. C'est cet excdant qui compose le profit du propritaire foncier, la rente qu'un fermier consent payer, mme lorsqu'il n'y a aucun capital rpandu sur la terre qu'il loue. Le prix des produits territoriaux, comme tous autres, est toujours fix en raison compose de l'offre et de
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
11
II est singulier qu'Adam Smith et M. Buchanan, qui, tous deux, conviennent que les impts sur les produits agricoles, l'impt foncier, et la dme, tombent tous sur le profit du propritaire foncier, et non sur les consommateurs des produits de l'agriculture, admettent nanmoins qu'un impt sur la drche tomberait sur le consommateur de bire, et ne porterait pas sur la rente du propritaire. Largument dAdam Smith est un expos si bien trac de la manire dont jenvisage limpt sur la drche, ainsi que tout autre impt sur les produits agricoles, que je ne peux pas mempcher de le transcrire, en loffrant la mditation du lecteur.
Dailleurs, il faut toujours que la rente et les profits des terres en orge se rapprochent de ceux des autres terres galement fertiles et galement bien cultives. Sils taient au-dessous, il y aurait bientt une partie des terres en orge qui serait mise en une autre culture ; et sils taient plus forts, plus de terre serait bientt employe produire de lorge. Quand le prix ordinaire de quelque produit particulier de la terre est mont ce quon peut appeler un prix de monopole, un impt sur cette production fait baisser ncessairement la rente et le profit de la terre o elle croit 1. Si lon mettait un impt sur le produit de ces vignobles prcieux, dont les vins sont trop loin de remplir la demande effective pour que leur prix ne monte pas toujours au del de la proportion naturelle du prix des productions des autres terres galement fertiles et galement bien cultives, cet impt aurait ncessairement leffet de faire baisser la rente et le profit de ces vignobles. Le prix de ces vins tant dj le plus haut quon en puisse retirer, relativement la quantit qui en est communment envoye au march, il ne pourrait pas slever davantage, moins quon ne diminut cette quantit. Or, on ne saurait diminuer cette quantit sans quil en rsultt une perte encore plus grosse, parce que la terre o ils croissent ne pourrait pas tre consacr une autre genre de culture dont le produit ft de valeur gale. Ainsi tout le poids de limpt porterait sur la rente et le produit du vignoble ; et bien dire, il porterait sur la rente. Mais le prix ordinaire de lorge na jamais t un prix de monopole ; la rente et le profit des terres en orge nont jamais t au del de leur proportion naturelle la demande ; or, il est clair que dans le cas dont il est ici question, la demande n'tant jamais borne, et l'offre I'tant toujours (puisque l'tendue des terres cultivables l'est), le produit des terres doit tre un prix monopole, qui s'lve d'autant plus, que les facults des consommateurs s'augmentent. II ne faut pas dire que la quantit des terres cultivables n'est pas borne tant qu'il en reste d'incultes. Si les produits possibles des terres actuellement incultes, soit en raison des difficults provenant de la distance ou des difficults provenant des douanes, doivent revenir plus chers au consommateur que le bl qu'il achte au prix monopole de son canton, il est vident que ces terres ne peuvent point, par leur concurrence, faire baisser le bl dans son canton. J'avoue d'ailleurs que je ne vois aucun motif suffisant de renoncer l'opinion de Smith, qui regarde la terre comme un grand outil, une machine propre faire du bl, quand elle est convenablement manoeuvre, et qui trouve tout simple que le propritaire de cette machine, quelque titre qu'il la possde, la loue ceux qui en ont besoin. C'est le besoin qu'on a des produits qui est la premire source du prix qu'ou y met. Si la concurrence des producteurs fait baisser ce prix au niveau des frais de production, ce n'est pas une raison pour que les propritaires de terres rduisent leurs prtentions au niveau de rien ; car, quoique les fonds de terre n'aient rien cot dans I'origine, l'offre de leur concours est ncessairement born, et les bornes de la quantit offerte sont aussi lun des lments de la valeur. - J.-B. SAY. Jaurais voulu que le mot profit et t supprim. Il faut que le docteur Smith croie que les profits des fermiers de ces vignobles prcieux sont au-dessus du taux ordinaire des profits. Sils ne ltaient pas, ils ne paieraient point limpt, moins quil ne leur ft possible de le rejeter sur le propritaire ou sur le consommateur. (Note de lAuteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
12
avec ceux des autres terres galement fertiles et galement bien cultives. Les diffrents impts qui ont t tablis sur la drche, la bire et lale, nont jamais fait hisser le prix de lorge ; ils nont jamais rduit la rente et le profit 1 des terres en orge. Le prix de la drche a mont certainement, pour le brasseur, en proportion des impts mis sur cette denre ; et ces impts, runis aux droits sur la bire et lale, ont constamment fait monter le prix de ces denres pour le consommateur, ou bien, ce qui revient au mme, ils en ont fait baisser la qualit. Le paiement dfinitif de ces impts est constamment retomb sur le consommateur, et non sur le producteur.
M. Buchanan fait sur ce passage les remarques suivantes :
Un droit sur la drche ne peut jamais rduire le prix de lorge ; car, moins quon ne put vendre aussi cher lorge convertie en drche que dans son tat naturel, il nen viendrait pas au march la quantit ncessaire. Il est donc clair que le prix de la drche doit monter proportion du droit mis dessus ; car il serait impossible autrement de fournir la demande. Le prix de lorge est cependant autant un prix de monopole que celui du sucre ; ils rapportent lun et lautre une rente et le prix courant de tous les deux a galement perdu tout rapport avec ce quils ont pu coter dans lorigine.
Il paratrait donc que M. Buchanan est persuad quun droit sur la drche doit en lever le prix, mais quun impt sur lorge qui sert prparer la drche ne ferait point hausser le prix de lorge ; et par consquent, que si la drche est frappe dun impt, il sera pay par le consommateur ; si lorge est impose, limpt en sera pay par le propritaire ; car il prouvera une diminution dans sa rente. Daprs lopinion de M. Buchanan, lorge est donc un prix de monopole, ou au plus haut prix que les acheteurs soient disposs en donner ; mais la drche, qui est prpare avec de lorge, nest pas au prix de monopole, et par consquent elle peut renchrir proportion des impts dont on pourrait la frapper. Lopinion de M. Buchanan, sur les effets dun droit sur la drche, me semble tre en contradiction directe avec lopinion quil a mise au sujet dun impt semblable, celui sur le pain. Un droit sur le pain, dit-il, sera acquitt en dfinitive, non par un surhaussement de prix, mais par une rduction de la rente 2. Si un droit sur la drche fait hausser le prix de la bire, il faut bien quun droit sur le pain fasse renchrir le pain. Largument suivant, de M. Say, est fond sur les mmes considrations que celui de M. Buchanan.
La quantit de vin ou de bl que produit une terre, reste peu prs la mme, quel que soit limpt dont la terre est greve ; limpt lui enlverait la moiti, les trois quarts mme de son produit net, ou, si lon veut, de sa rente, que la terre serait nanmoins exploite pour en retirer la moiti ou le quart que limpt nabsorberait pas. Le taux de la rente, cest--dire la part du propritaire, baisserait ; voil tout. On en sentira la raison, si lon considre que, dans le cas suppos, la quantit de denres produites par la terre, et envoye au march, reste nanmoins la mme. Dun autre
1 2
Voyez la note prcdente. Tom. III, pag. 355.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
13
ct, les motifs qui tablissent la demande de la denre restent les mmes aussi. Or, si la quantit des produits qui est offerte, si la quantit qui est demande, doivent, malgr ltablissement ou lextension de la contribution foncire, rester nanmoins les mmes, les prix ne doivent pas varier non plus ; et si les prix ne varient pas, le consommateur des produits ne paie pas la plus petite portion de cet impt. Dira-t-on que le fermier, celui qui fournit lindustrie et les capitaux, partage avec le propritaire le fardeau de limpt ? On se trompera, car la circonstance de limpt na pas diminu le nombre des biens louer, et na pas multipli le nombre des fermiers. Ds quen ce genre aussi, les quantits offertes et demandes sont restes les mmes, le taux des rentes a d rester le mme. Lexemple du manufacturier de sel, qui ne peut faire supporter ses consommateurs quune partie de limpt, et celui du propritaire foncier, qui ne peut sen faire rembourser la plus petite partie, prouvent lerreur de ceux qui soutiennent, en opposition avec les conomistes, que tout impt retombe dfinitivement sur les consommateurs. Liv. III, chap. 8.
Si limpt enlevait la moiti, les trois quarts mme du produit net de la terre sans que le prix des produits hausst, comment ces fermiers pourraient-ils retirer les profits ordinaires des capitaux qui ne paieraient que des rentes modiques, ayant exploiter cette sorte de terres qui exige beaucoup plus de travail pour rendre un produit donn que des terres dune meilleure qualit ? La rente serait mme abandonne en entier, que ces fermiers retireraient toujours de leur industrie des profits moindres que ceux des autres commerces, et ils ne continueraient par consquent cultiver leurs terres quautant quils pourraient lever le prix de leurs produits 1.
1
Jai distingu dans mon conomie politique les profits du fonds de terre des profits du capital employ sa culture ; jai mme distingu, en parlant de ce capital, celui qui a t employ par le propritaire en btiments, en cltures, etc., de celui du fermier, qui consiste principalement en bestiaux et en avances de frais de culture. Le premier capital est tellement engag dans la terre laquelle il a t consacr, quon ne peut plus len sparer : cest une valeur ajoute la valeur du sol, et qui en subit toutes les chances, bonnes ou mauvaises. Lorsquon est forc dabandonner la culture dune terre, on est forc dabandonner les irrigations, les cltures, et mme la plupart des btiments quon avait faits dans la vue de lexploiter. Cette portion du capital est donc devenue fonds de terre. Il nen est pas de mme des bestiaux et des avances de frais ; on retire ces dernires valeurs, on les emploie ailleurs quand on abandonne un fonds de terre. Cest ordinairement cette portion du capital qui appartient au fermier, et qui se retire lorsquelle ne rend plus des profits ordinaires. Or, je dis que lorsquune terre est directement ou indirectement greve dimpts, ce nest pas le profit de lindustrie et du capital du fermier qui en supporte le faix, parce qualors ses talents, ses travaux et son argent, qui se sont mis en avant pour un mtier o lon gagnait autant que dans tout autre, cteris paribus, abandonneraient une terre qui ne leur offrirait plus que des profits infrieurs, sil fallait en dduire de nouvelles charges. Ds lors, au premier renouvellement de bail, il faudrait bien que le propritaire baisst le prix de son bail ; autrement il ne trouverait point de locataires. En supposant que limpt montt de cette manire, jusqu ravir au propritaire la totalit du fermage, du produit net, je ne vois pas que le fermier, quelque infrieure que ft la qualit des terres, quelque coteuse que ft la culture, y perdt encore rien, puisquil a d sarranger pour en tre rembours par les produits avant den payer un fermage. M. Ricardo me semble demander sur quoi il retiendra le montant de limpt dont il fait lavance, lorsquil na point de fermage payer. Mais je nappelle du nom de fermage ou produit net dune terre que ce qui revient au propritaire aprs que limpt est acquitt ou retenu par le fermier. Que si limpt ne peut
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
14
Si limpt tombait sur les fermiers, il y en aurait moins de disposs affermer des biens fonds ; sil tombait sur les propritaires, il y aurait bien des fermes qui ne seraient points loues, car elles ne rapporteraient pas de fermage. Mais sur quels fonds ceux qui produisent du bl sans payer de fermage, prendraient-ils de quoi payer limpt ? Il est vident que limpt doit tomber sur le consommateur. Comment une telle terre pourrait-elle payer un impt gal la moiti ou aux trois quarts de sa production, ainsi que M. Say lnonce dans le passage suivant ?
On voit en cosse de mauvais terrains ainsi cultivs par leurs propritaires, et qui ne pourraient ltre par aucun autre. Cest ainsi encore que nous voyons dans les provinces recules des tats-Unis des terres vastes et fertiles dont le revenu tout seul ne suffit pas pour nourrir leur propritaire : elles sont cultives nanmoins ; mais il faut que le propritaire les cultive lui-mme, cest--dire, quil porte le consommateur lendroit du produit, et quil ajoute au profit de son fonds, qui est peu de chose ou rien, les profits de ses capitaux et de son industrie, qui le font vivre dans laisance. On connat que la terre, quoique cultive, ne donne aucun profit, lorsquaucun fermier ne veut payer de fermage ; cest une preuve quelle ne permet de retirer que les profits du capital et de lindustrie ncessaires sa culture. SAY, liv. II, chap. 9, 3e d.
tre pay, mme avec le sacrifice de tout le produit net ; si le fisc veut avoir encore de plus une portion du profit du capital et du profit industriel du fermier, il est clair que celui-ci quitte la partie, et que nul autre ne voulant prendre sa place pour travailler avec trop peu de profit, ou sans profit, la terre reste en friche. M. Ricardo peut dire quun certain nombre de terres, commencer par les qualits les plus mauvaises, devant toujours se trouver dans ce cas, une extension dimpts doit toujours faire abandonner quelques cultures, diminuer par consquent la quantit de bl porte au march, ce qui en fait hausser le prix ; or, du moment que le prix hausse, cest le consommateur qui paie limpt. Je rponds, avec Adam Smith, quun systme durable dimpts insupportables agit la manire dun climat inhospitalier, dun flau de la nature ; il contrarie la production, et la production des substances alimentaires contrarie entrane la dpopulation. Le dfaut de population excde souvent mme, par des causes que dcouvre lconomie politique, mais qui ne peuvent tre dveloppes ici, le dfaut de production des aliments. Cest ainsi que la dpopulation de lgypte a excd le dclin de son agriculture. Il ne faut donc pas tre surpris si des terres quou laisse en friche ne font pas monter le prix du bl. - .J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
15
Chapitre XVIII.
DE LA TAXE DES PAUVRES.
Table des matires
Nous avons vu que les impts sur les produits agricoles et sur les profits du fermier retombent sur les consommateurs de ces produits ; car si le fermier navait pas le moyen de sindemniser de limpt par le renchrissement de ces denres, ses profits se trouvant rduits par l au-dessous du niveau gnral des profits, il se trouverait forc de dtourner son capital vers un autre genre de commerce. Nous avons vu ainsi quil ne pouvait rejeter limpt sur son propritaire en en dduisant la valeur sur le prix de la rente ; car le fermier qui ne paierait pas de rente, aussi bien que celui qui cultiverait une meilleure terre, serait sujet limpt, soit quil ft assis sur les produits immdiats de la terre ou sur les profits du fermier. Jai aussi tch de faire voir que, si un impt tait gnral, et quil affectt galement tous les profits, ceux du manufacturier comme ceux de lagriculteur, il noprerait ni sur le prix des marchandises ni sur celui des produits immdiats de la terre, mais il serait immdiatement ou dfinitivement pay par les producteurs. Un impt sur les rentes, ainsi quil a dj t observ, ne tomberait donc que sur le propritaire, et ne saurait par aucun moyen tre rejet sur le fermier,
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
16
Limpt pour les pauvres 1 tient de la nature de tous ces impts, et selon les circonstances diffrentes, il tombe sur le consommateur des produits agricoles et des marchandises, sur les
1
Voici ltat actuel de cette lgislation clbre que la famine et une crise sociale menaante viennent de naturaliser en Irlande. Les distributions domicile ont t supprimes, et cette dfense ne flchit que dans certains cas exceptionnels, o des secours habilement distribus peuvent servir a complter au dehors des salaires insuffisants, et viter lencombrement du Work-house. II nest donc plus question ici de mendicit, ni de vasselage, ni daumnes ddaigneusement verses par la main du riche : il y a rmunration accorde par la paroisse des hommes qui lui consacrent leurs efforts, leur temps. Dans te fait, les ateliers de charit, que recommandait dj lacte de la 43e anne du rgne dlisabeth, et que les gouvernements modernes se htent douvrir aux poques o sagite le lion populaire, affam et irrit ; ces ateliers, qui nont, dailleurs, reu dorganisation dfinitive quen Angleterre, font pour le travail ce que les greniers dabondance font, ou sont censs faire, pour les subsistances. Ils tiennent de la main-duvre en rserve, et peuvent tre appels des dpts de salaires. Quand le travail se ralentit dans les manufactures, le flot des ouvriers que la grve jette inoccups dans les villes et dans les champs, se dirige sur les Work-house, y pntre et y sjourne jusquau moment o les capitaux redevenus abondants font mouvoir de nouveau les cent bras des machines. Alors le reflux commence, et ce sont les ateliers de charit que dsertent les travailleurs. Comme agent conomique, ce systme prsente donc des avantages incontestables, car il pose sous ldifice manufacturier des tais solides et puissants : - comme agent moralisateur, il est peut-tre plus recommandable encore. Ainsi lindigent peut entrer tte haute dans ces asiles o lattendent, sil est vigoureux, du travail et des salaires ; sil est vieux et infirme, des soins, du repos, des salles spacieuses o se rchauffent ses membres glacs ; sil est enfant, le lait de nourrices mrites, et ces nids tapisss de linge blanc et quon appel1e crches. Adulte, il reoit le prix de son uvre actuelle ; vieillard, le prix des richesses quil a prpares et semes pour les gnrations nouvelles ; enfant, le prix de son travail futur, et peut-tre de son gnie. Sous le double rapport de la rgularisation du mouvement industriel et de la dignit humaine, les Work-houses sont donc une institution salutaire en principe, salutaire en fait ; et, sil est arriv souvent, comme Andover, comme en dautres districts, que ltat ait fait payer cher aux malheureux le secours quil leur donne, ou plutt quil change contre leur temps et leurs sueurs ; sil est arriv que, sous prtexte de viande, on leur ait laiss ronger des os et dinfmes rebuts, et que, sous prtexte de travail, on les ait puiss avec le tread-mill, et abrutis avec cette infernale invention de travail inutile, - sombre reproduction des supplices mythologiques dIxion et de Sysyphe ; sil est arriv enfin, que ces lieux de refuge aient t transforms en ghennes, ce nest ni linstitution elle-mme, ni aux lgislateurs quil faut en demander compte. Quelque gnreux et sages que soient des ministres, ils ne peuvent faire quil ne se glisse dans les rangs des administrateurs des mes cruelles ou insouciantes, - ce qui revient au mme, quand il sagit de la tutelle des pauvres. Il serait tout aussi absurde de rendre le Gouvernement anglais responsable de ces tristes accidents, que de lui attribuer les insolences des plus vils limiers de police, ou les fureurs que tels ou tels soudards commettent sur le bords de 1Indus ou du Brahmapooter. La torture est bien sortie du livre le plus doux, le plus misricordieux, lvangile ; comment stonner de voir jaillir dun acte du Parlement des abus et des infamies ? Ny a-t-il pas ici-bas, perdues dans le nombre, des femmes qui portent au front le stigmate des martres? comment ny aurait-il pas des hommes portant la stigmate des mauvais directeurs de Workhouse ? Sans doute, lexistence quon y a faite aux pauvres, na pas les douceurs et les joies ineffables dun Phalanstre, dune Icarie, dune Utopie, dune le de Barataria, ou de toute autre villgiature dessine la plume, et btie sur le terrain capricieux de lhypothse et des souscriptions : sans doute les rglements veulent que le mari soit spar de sa femme et de ses enfants, et quil impose son me cette privation momentane au profit de son corps * ; sans doute, enfin, le Work-house a pris aux yeux du pauvre une teinte morne, une physionomie de gele qui len loigne souvent ; mais tous ceux qui ont visit ces tablissements, et ont suivi attentivement les rsultats de la rforme de 1834, doivent rester convaincus de lminente supriorit de la loi actuelle et de lexagration outre de la plupart des lgies crites ladresse des dignitaires de Sommerset-Street. Nous en avons parcouru plusieurs, sous le coup de ces prventions que nous prenions pour une philanthropie claire, et nous avons t doucement surpris de voir rgner partout lordre, la propret, labondance, la dcence. Certes, dans un asile ouvert toutes les infirmits, et o lon peut entendre gmir lenfant qui nat, ct du vieillard qui expire, on ne peut esprer trouver la gat, la fracheur dun pensionnat de demoiselles : mais ce quon y cherche, cest un travail modr, cest une nourriture abondante, cest une infirmerie constamment et largement pourvue ; cest, en un mot, une
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
17
profits du capital ou sur la rente. Cest un impt qui pse dune manire accablante sur les profits du fermier, et qui peut, par consquent, tre regard comme affectant le prix des produits agricoles. Selon le degr dans lequel il frappe la fois les profits du manufacturier et ceux du cultivateur, il deviendra un impt gnral sur les profits du capital, et il noccasionnera point de changement dans le prix des produits agricoles ni dans celui des ouvrages manufacturs ; et proportion de limpossibilit o se trouvera le fermier de se ddommager, en levant le prix de ses denres, de la portion de limpt qui pse particulirement sur lui, ce sera un impt sur le fermage, et il sera pay par le propritaire. Pour connatre donc laction quexerce la taxe des pauvres une poque dtermine quelconque, lon doit sassurer si elle affecte alors, dans un degr gal ou ingal, les profits du fermier et du manufacturier, et, en mme temps, si les circonstances sont telles quelles permettent au fermier dlever le prix des produits de sa terre. On prtend que la taxe des pauvres est leve sur le fermier, proportion de sa rente, et que, par consquent, celui qui ne paie que peu ou point de rente, ne devrait payer quun faible
existence assure. Ces choses, je les ai rencontres presque partout, et l o elles nexistent pas, le cri de lopinion, le contrle des inspecteurs, la rumeur publique les font bientt rtablir. Il est triste, jen conviens, je le dplore, de vendre au travailleur lexistence matrielle au prix de sa libert et des joies de la famille ; mais les abus, qui accompagnent tout systme de charit lgale, sont bien autrement dplorables. Mieux vaut mille fois les scandales isols du rgime actuel que le spectacle des luttes honteuses que se livraient la paroisses entre elles pour se dcharger de lentretien des indigents, sous prtexte de je ne sais quelles conditions de domicile : - comme si la charit tait une affaire de clocher, et comme si, en passant dun bourg un autre, on pouvait perdre le droit dtre secouru par ses frres. - La grande et forte main du pays sest substitue aujourdhui ces petits gosmes locaux ; et si lon ne voit plus, comme jadis, les pauvres se marier pour percevoir double taxe, des filles estimes dautant plus prcieuses quelles ont plus de btards offrir en dot lpoux, et les enfants pulluler comme autant de titres la bienfaisance publique ; si lon ne voit plus les paroisses acquitter la plus grande partie du salaire des agriculteurs, et les indigents se livrer ce farniente dlectable, cette flnerie de lazzarone, que M. Gustave de Beaumont nous a dpeints si spirituellement ; en revanche, on ne voit plus les ouvriers honntes repousss impitoyablement des Work-houses, ni une cour dassises juger en un an 4,700 conflits entre les paroisses et les indigents. Excut avec bienveillance, le rgime actuel nous parait donc fort supportable. Il ne prsente ni le gaspillage ruineux dune bienfaisance publique aveugle, ni les caprices de la charit prive, dont il seconde dailleurs les gnreux efforts, en faisant donner par ltat lexemple de la sollicitude pour les classes ouvrires. Plus doux, il manquerait ces deux rsultats, et ramnerait lAngleterre aux dilapidations, et, par suite, aux turpitudes qui grossissent si tristement la fameuse enqute de 1833. Personne ne savisera certes de trouver barbares, sauvages, des rglements qui crent un abri pour les infirmits sociales, allgent le fardeau des scessions industrielles, et vont jusqu permettre lusage du tabac dans lintrieur des Work-houses. Nous avons pu contempler dans une vaste cour, avec un tonnement ml de joie, six ou huit vieilles femmes assises, le visage tourn vers un mlancolique soleil de janvier, et fumant leur pipe sur les dbris de leur jeunesse et de leur sant, avec une philosophie digne de matrones indiennes. Nous avons assist, de plus, dans lasile de Manchester, des exhibitions de ctelettes, de lgumes, tout fait rassurantes sur la frocit des directeurs, et qui nous firent ajourner la maldiction qui leur tait destine. En Angleterre, comme dans la plupart des pays dits civiliss, le vice est donc moins dans le systme qui soulage les pauvres, que dans celui qui les cre, dans les vestiges daristocratie, de despotisme, de fodalit, qui gnent la libre expansion de la pense, de la richesse, de lgalit. Les Work-houses sont les tristes correctifs du servage, de la douane, des privilges, des substitutions : supprimez les uns, vous supprimez les autres et la question du pauprisme touche sa fin. A. F. * On peut consulter pour connatre lensemble de lacte de1834, les notes que M. Garnier, intelligence vive et lucide, a jointes a son beau travail sur lEssai de Malthus. - Edit. Guillaumin.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
18
impt, ou nen point payer du tout. Si cela tait vrai, limpt des pauvres, en tant quil porte sur la classe des cultivateurs, tomberait entirement sur les propritaires, sans pouvoir tre rejet sur le consommateur des produits de la terre. Mais je ne crois pas que cela soit vrai. La taxe des pauvres nest pas calcule daprs la rente que le fermier paie au propritaire ; elle est proportionne a la valeur annuelle de sa terre, soit que cette valeur annuelle provienne du capital du propritaire ou du capital du fermier. Deux fermiers qui affermeraient des terres de deux qualits diffrentes dans une mme paroisse, et dont lun paierait une rente de 100 1. par an pour cinquante acres de la terre la plus fertile, et lautre la mme somme de 100 1. pour mille acres de la terre la moins fertile, paieraient une somme pareille pour la taxe des pauvres, si aucun de ces fermiers ne cherchait amliorer sa terre; mais si le fermier de la mauvaise terre, comptant sur un trs-long bail, se dcidait amliorer grand frais les facults productives de sa terre, au moyen dengrais , de desschements, de cltures, etc., il contribuerait, dans ce cas, limpt des pauvres, non proportion de la rente paye au propritaire, mais du produit annuel quaurait la terre. La valeur de limpt pourrait tre gale ou plus forte que la rente ; mais que cela ft ou non, il est certain quaucune partie de cet impt ne serait paye par le propritaire. Le fermier laurait calcul davance ; et si le prix des produits ne suffisait pas pour le rembourser de tous ses frais, en y joignant ce surcrot de charge pour les pauvres, il nentreprendrait point ces bonifications. Il est donc vident que, dans ce cas, limpt est pay par le consommateur ; car, sil net pas exist de pareil impt, les mmes bonifications auraient t entreprises, et on aurait retir du capital employ le taux ordinaire et gnral des profits, avec une diminution dans le prix du bl. Il ny aurait rien de chang ltat de la question, si le propritaire, ayant fait ces bonifications, et augment la rente de sa terre de 100 1. 500 1. Dans ce cas, limpt pserait galement sur le consommateur ; car, si le propritaire se dcide dpenser une forte somme sur sa terre, cest dans lespoir den retirer une rente qui pt lindemniser de ses dbourss ; et cette rente dpendrait son tour dune hausse dans le prix du bl, non-seulement suffisante pour payer lexcdant de rente, mais encore pour acquitter limpt dont la terre se trouverait greve. Mais si, en mme temps, tout le capital du manufacturier contribuait, pour sa part, la taxe des pauvres, dans la mme proportion que le capital dpens par le fermier ou le propritaire en amliorations agricoles, alors ce ne serait plus un impt partiel sur les profits du capital du fermier ou du propritaire, ce serait un impt sur le capital de tous les producteurs, et, par consquent, il ne pourrait plus tre rejet ni sur le consommateur des produits immdiats de la terre, ni sur le propritaire. Les profits du fermier ne se ressentiraient pas plus de limpt que ceux du manufacturier, et le premier ne pourrait pas plus que le second prendre ce prtexte pour lever le prix de sa denre. Ce nest point la baisse absolue des profits, cest leur baisse relative qui dtourne les capitaux dun commerce quelconque ; cest la diffrence entre les profits qui attire le capital dun emploi vers un autre. Il faut cependant convenir que dans ltat actuel de la taxe des pauvres en Angleterre, une plus grande partie de cette contribution tombe sur le fermier que sur le manufacturier, eu gard aux profits respectifs de chacun, le fermier tant impos daprs les productions quil retire de la terre, et le manufacturier ne ltant que daprs la valeur des btiments dans
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
19
lesquels il travaille, sans aucun gard la valeur des machines, du travail industriel, ni du capital quil peut employer. Il sensuit que le fermier peut lever le prix de ses produits de la totalit de cette diffrence ; car, puisque limpt est ingal dans sa rpartition, et quil atteint surtout ses profits, le fermier aurait moins davantage consacrer son capital lagriculture, qua lemployer dans un autre commerce, si les produits de la terre ne montaient pas de prix. Si, au contraire, limpt et pes avec plus de force sur le manufacturier que sur le fermier, le premier aurait pu lever le prix de ses marchandises de tout le montant de la diffrence, par la raison mme qui, en de pareilles circonstances, aurait dtermin le fermier lever le prix des produits de la terre. Dans un pays dont lagriculture acquiert tous les jours une nouvelle extension, si les impts pour les pauvres psent particulirement sur lagriculture, ils seront pays, partie par ceux qui emploient les capitaux et qui en retireront moins de profits, et partie par le consommateur des produits de la terre, qui les paiera plus cher. Dans un tel tat de choses, limpt peut, dans certaines circonstances, devenir mme avantageux aux propritaires, au lieu de leur tre nuisible ; car, si limpt pay par les cultivateurs des terres de la plus mauvaise qualit, est plus fort, relativement a la quantit du produit obtenu, que limpt pay par les fermiers des terres les plus fertiles, la hausse dans le prix du bl, qui doit stendre tous les bls, fera plus quindemniser ces derniers fermiers du montant de limpt. Ils conserveront cet avantage pendant tout le temps que dureront leurs baux ; mais, leur expiration, il passera aux propritaires. Voil quel serait leffet de la taxe des pauvres dans un tat de prosprit croissante de la socit ; mais dans un tat stationnaire ou rtrograde, sil tait impossible de retirer les capitaux employs la culture des terres, dans le cas o lon augmenterait le taux de limpt, la partie qui tomberait sur lagriculture serait paye, pendant la dure des baux, par les fermiers ; mais lexpiration des baux, elle tomberait presque en entier sur les propritaires. Le fermier qui, pendant la dure de son prcdent bail, aurait consacr son capital des amliorations agricoles, serait impos, par cette nouvelle taxe, daprs la nouvelle valeur que la terre aurait acquise par ses amliorations, et serait forc de payer sur ce pied pendant son bail, quoique par l ses profits pussent se trouver rduits au-dessous du taux gnral ; car le capital quil a dbours peut se trouver tellement identifi avec la terre, quil soit impossible de len sparer. Si en effet, le fermier ou son propritaire (en supposant que ce ft ce dernier qui et fait les avances) pouvaient retirer ce capital en rduisant ainsi la valeur annuelle de la terre, la part de limpt diminuerait proportion. Et comme les produits diminueraient en mme temps, ils hausseraient de prix ; ce qui servirait de compensation limpt, dont la charge serait reporte sur le consommateur, sans quaucune partie en tombt sur la rente. Mais cela est impossible, au moins pour ce qui regarde une certaine partie du capital, sur laquelle par consquent limpt sera pay par les fermiers pendant le cours de leurs baux, et par les propritaires, leur expiration. Cette contribution additionnelle, en tant quelle tomberait dune manire ingale sur les manufacturiers, serait dans un pareil cas, ajoute au prix de leurs marchandises ; car il ne peut y avoir de raison pour que leurs profits soient rduits au-
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
20
dessous du taux gnral des profits, quand il leur serait si ais de dtourner leurs capitaux vers lagriculture 1.
Dans une partie antrieure de cet ouvrage, jai tabli la diffrence qui existe entre la rente proprement dite et la rtribution paye, sous ce nom, au propritaire pour les profits que le fermier a retirs de lemploi du capital du propritaire ; mais peut-tre nai-je pas suffisamment distingu les diffrents rsultats qui seraient la suite des diffrents emplois de ce capital. Comme une partie de ce fonds,une fois quil est employ lamlioration de la terre, sidentifie avec elle, et tend augmenter sa force productive, la rtribution paye au propritaire pour lusage de la terre est strictement de la nature de la rente, et est sujette aux mmes lois. Que les amliorations soient faites aux frais du propritaire ou du fermier, on ne les entreprendra pas, moins quil ny ait une grande probabilit que le profit qui en rsultera sera au moins gal celui quon pourrait tirer de tout autre emploi du mme capital ; mais une fois ces avances faites, le retour obtenu sera entirement de la nature dune rente, et sujet toutes ses variations. Quelques-unes de ces dpenses cependant namliorent la terre que pour un temps limit, et naugmentent point ses facults productives dune manire permanente. Tels sont des btiments et autres amliorations prissables qui ont besoin dtre constamment renouveles, et qui, par consquent, naugmentent point le revenu rel du propritaire. (Note de lAuteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
21
Chapitre XIX.
DES CHANGEMENTS SOUDAINS DANS LES VOIES DU COMMERCE.
Table des matires
Un pays trs-riche en manufactures est particulirement expos des revers et a des accidents temporaires, provenant du transport des capitaux dun emploi dans un autre. Les demandes des produits de lagriculture sont uniformes ; et elles ne sont pas sous linfluence de la mode, du prjug ou du caprice. Pour la conservation de la vie, il faut de la nourriture, et ds lors la demande de subsistances doit se soutenir dans tous les temps et dans tous les pays. Il nen est pas de mme pour ce qui regarde les objets manufacturs, dont la demande dpend, non-seulement des besoins, mais encore du got et du caprice des acheteurs. De plus, un nouvel impt peut dtruire les avantages comparatifs quun pays retirait auparavant de la fabrication dune certaine marchandise, ou bien la guerre peut faire tellement hausser le fret et lassurance, que ces produits manufacturs ne puissent plus soutenir la concurrence avec les ouvrages fabriqus dans les diffrents pays o ces produits taient exports auparavant.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
22
Dans tous ces cas, ceux qui se trouvent engags dans la fabrication de ces articles, prouveront une grande crise, et feront sans doute quelques pertes. Ces maux seront sentis, nonseulement au moment du changement, mais encore pendant tout lintervalle qui scoulera avant que les industriels donnent une nouvelle direction leurs capitaux et aux bras dont ils disposent, en les dirigeant vers un autre genre dindustrie. Le mal ne se fera pas sentir seulement dans le pays o ces difficults ont pris naissance : il stendra galement ceux o ce pays exportait auparavant ses marchandises. Nul pays ne peut longtemps importer, sans exporter en mme temps, comme il ne saurait ex porter longtemps sans importer. Sil arrive donc quelque circonstance qui empche un pays dimporter la quantit ordinaire de marchandises trangres, la fabrication de quelques-uns des objets que lon exportait ordinairement diminuera ncessairement ; et quoique la valeur totale des productions du pays nen souffre que peu de variation, - le capital employ restant le mme, - ces produits ne seront plus ni aussi abondants ni si bon march, et le changement dans lemploi des capitaux entranera une grande dtresse. Si, par lemploi de 10,000 1. st. dans la fabrication des tissus de coton destins lexportation, nous importions chaque anne trois mille paires de bas de soie de la valeur de 2,000 1., et que, par linterruption du commerce, nous fussions obligs de dtourner ce capital de la fabrication des tissus de coton, pour lemployer dans celle des bas, nous continuerions toujours obtenir des bas pour la valeur de 2,000 l., pourvu quaucune partie du capital net t dtruite ; mais au lieu davoir trois mille paires de bas, nous pourrions nen avoir que deux mille cinq cents. Dans le passage des capitaux de lindustrie du coton celle des bas de soie, les particuliers pourraient prouver une grande gne, sans que nanmoins la valeur du capital national en souffrit beaucoup, et sans que la quantit de la production annuelle se trouvt diminue 1. Une guerre qui clate aprs une longue paix, ou une paix qui succde une longue guerre, occasionne en gnral une grande dtresse dans le commerce. Ces vnements changent considrablement la nature des emplois auxquels les capitaux taient consacrs auparavant dans chaque pays ; et pendant que sen opre le nouveau classement, le capital fixe dort, sanantit mme parfois, et les ouvriers nont plus assez de travail. La dure de cette crise sera plus ou moins longue, selon le degr de rpugnance que la plupart des hommes prouvent quitter le genre dindustrie dans lequel ils ont pendant longtemps t dans lhabitude
1
Le Commerce nous permet daller chercher une marchandise dans les lieux o elle existe et de la transporter dans dautres lieux o on la consomme. Il nous donne donc les moyens daccrotre la valeur dune marchandise de toute la diffrence entre les prix courants de ces diffrentes localits. - J.-B. SAY. Cela est parfaitement vrai. Mais comment se cre cette valeur additionnelle ? En ajoutant aux frais de production : 1 les frais de transport ; 2 les profits affrents au capital avanc par le marchand. - La marchandise indique par lauteur haussera de valeur par les raisons mmes qui font hausser celle de tous les autres produits, cest--dire par le surcrot de travail consacr leur production et leur transport, avant quelles atteignent le consommateur. Il ne faut donc pas considrer ceci comme un des avantages qui naissent du commerce. En examinant cette question de plus prs, on trouve que les bienfaits du commerce se rduisent nous permettre dacqurir, non des objets plus chers, mais des objets plus utiles. (Note de lAuteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
23
demployer leur capital. La dtresse est souvent aussi prolonge par les restrictions et prohibitions auxquelles donnent naissance les jalousies absurdes qui existent entre les diffrents tats de la rpublique commerciale. La dtresse qui provient dun changement dans les voies du commerce est souvent confondue avec celle qui accompagne une diminution du capital national et un tat rtrograde de la socit ; et il serait difficile dindiquer des signes certains au moyen desquels on pt distinguer lune de lautre. Cependant, lorsque cette dtresse se fait sentir immdiatement la suite du passage de la guerre la paix, la connaissance que nous avons de lexistence dune pareille cause rend trsprobable cette opinion que les fonds pour lentretien des travailleurs ont plutt t dtourns de leurs canaux ordinaires que notablement entams, et fait esprer quaprs quelques souffrances passagres, la nation reprendra de nouveau sa prosprit. Il faut aussi se rappeler que ltat rtrograde dune nation est toujours un tat anormal. Lhomme parvient de lenfance lge viril, et alors il dcline jusqu la mort ; mais cette marche nest pas celle des nations. Une fois quelles sont parvenues leur plus grande force, il se peut quelles ne puissent plus avancer au del de ce terme ; mais leur tendance naturelle est de continuer pendant des sicles maintenir leur richesse et leur population dans le mme tat de prosprit. Dans les pays riches et puissants, o il y a de grands capitaux placs en machines, la dtresse provenant dun changement de direction dans le commerce sera plus sensible que dans des pays plus pauvres, o il y a proportionnellement une moindre valeur en capital fixe, et une plus grande en capital circulant, et o par consquent il se fait plus douvrage par la main des hommes. Il nest pas aussi difficile de retirer un capital circulant quun capital fixe, de lemploi dans lequel il peut tre engag. Il est souvent impossible de faire servir un genre de manufacture les machines construites pour un autre ; mais lhabillement, la nourriture et le logement dun ouvrier quelconque, peuvent lui servir galement dans toute branche de travail ; - en dautres termes, le mme ouvrier peut recevoir la mme nourriture, le mme habillement, le mme logement, quoiquil soit employ un autre genre doccupation. Ce mal est cependant un de ceux auxquels une nation riche doit se soumettre, et il ne serait pas plus raisonnable de sen plaindre, qu un riche ngociant de saffliger que son navire soit expos aux dangers de la mer, pendant que la chaumire de son pauvre voisin se trouve labri de tout risque. Lagriculture mme nest pas labri de ces accidents, quoique un moindre degr. La guerre, qui interrompt les relations dun pays commercial avec les autres tats, empche souvent lexportation du bl, des pays o il peut tre produit peu de frais, dans dautres pays qui, sous ce rapport, sont moins favoriss de la nature. Dans de pareilles circonstances, une quantit extraordinaire de capital est dirige vers lagriculture dans le pays qui importait auparavant du bl, et qui devient par l indpendant des secours de ltranger. A la fin de la guerre, les obstacles limportation cessent, et une concurrence funeste au producteur national commence ; il ne peut sy soustraire sans faire le sacrifice dune partie de son capital. Le meilleur expdient pour un tat, serait de mettre un impt dont la valeur dcrotrait de temps en temps, sur limportation des bls trangers, pendant un nombre limit dannes, afin
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
24
doffrir au cultivateur national lopportunit de retirer graduellement son capital de lagriculture 1. En adoptant une pareille mesure, le pays pourrait ne pas faire de son capital, la distribution la plus avantageuse, mais limpt temporaire auquel il se trouverait assujetti serait avantageux une classe particulire de la socit, celle dont le capital aurait t consacr faire crotre les subsistances ncessaires au pays pendant la suspension de limportation. Si de pareils efforts, faits dans un moment critique, entranaient le risque de se trouver ruin au moment o les besoins cesseraient, personne ne voudrait exposer son capital dans un pareil emploi. Outre les profits ordinaires des capitaux, le fermier sattendrait tre indemnis du risque auquel il serait expos par une affluence subite de bl, et par consquent le prix pour le consommateur, dans la saison o celui-ci aurait le plus besoin dapprovisionnement, prouverait une hausse due non-seulement, au renchrissement de la culture du bl dans le pays, mais encore la prime dassurance quil serait oblig de payer, pour le risque particulier auquel cet emploi expose le capital. Et quoiquil rsultt un plus grand avantage pour le pays de limportation du bl bon march, il serait peut-tre convenable de mettre, pendant quelques annes, un droit sur limportation de cette denre. En traitant de la rente nous avons vu qu chaque augmentation de lapprovisionnement du bl, et chaque diminution de son prix, qui en est la suite, on dgagera les capitaux employs sur les mauvaises terres ; et les terrains dune qualit suprieure qui, dans ce cas, ne paieraient pas de rente, deviendraient la mesure commune par laquelle se rglerait le prix naturel du bl. Quand il serait 4 1. le quarter, des terres infrieures, que lon peut dsigner par le n 6, pourraient tre cultives ; on sarrterait au n 5 3 1. au n 4 et ainsi de suite. Si le bl, par leffet dune abondance permanente, tombait 3 l. 10 sch., le capital employ dans le n 6 cesserait son emploi ; car ce nest que quand le bl vaut 4 l., que ce capital peut rapporter les profits ordinaires, mme tant exempt de rente. Il serait donc dplac pour tre employ fabriquer les produits avec lesquels on achterait et lon importerait tout le bl que lon rcoltait sur le n 6. Dans ce nouvel emploi, il deviendrait ncessairement plus lucratif pour le capitaliste ; car, sil pouvait obtenir plus de bl par la culture de la terre dont il ne paie pas de rente, que par la fabrication dun produit quelconque avec lequel il peut acheter du bl, son prix ne pourrait pas tre au-dessous de 4 1.
1
On trouve dans le dernier volume du Supplment a lEncyclopdie britannique, a l'article : Du commerce et de la lgislation des crales, les excellentes observations qui suivent : Si une poque future nous devons revenir sur nos pas, il faudra, pour favoriser le passage des capitaux des terrains pauvres a des, industries plus lucratives, agir au moyen dune chelle dcroissante de droits. Ainsi on pourrait abaisser annuellement de 4 a 5 sch. par quarter, le droit de 80 sch., qui est actuellement la limite o commence la libre importation des crales. Arriv 50 sch., on ouvrirait les ports en scurit, et le systme restrictif pourrait tre a jamais aboli. Quand ce salutaire vnement aura t accompli, il ne sera plus ncessaire dentrer, par voie de lgislation, en lutte avec la nature. Le capital et le travail du pays se dirigent sur les branches dindustrie qui rpondent le mieux notre situation gographique, notre caractre national, ou nos institutions politiques. Le bl de la Pologne, les cotons de la Caroline schangeront contre les produits de Birmingham et les mousselines de Glascow. Le vritable gnie du commerce, celui qui assure jamais la prosprit dun pays, est compltement incompatible avec les allures clandestines et timides du monopole. Les peuples de la terre tant comme les diffrentes provinces du mme royaume, doivent retirer de la libert illimite des changes dimmenses avantages locaux et gnraux. Tout cet article de lEncyclopdie britannique mrite une attention srieuse : bien crit, savamment pens, il dnote chez lauteur une connaissance profonde du sujet. (Note de lAuteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
25
On a pourtant prtendu que lon ne pouvait pas retirer le capital engag dans la terre, parce quil se convertit en dpenses quon ne peut plus recouvrer, telles que celles des engrais, des cltures, des desschements, etc., qui sincorporent la terre, et en deviennent insparables. Cela est vrai jusqu un certain point ; mais le capital qui se compose de btail, de moutons, de meules de foin ou de bl, de charrettes, etc., peut tre retir ; et il reste calculer, si ces objets doivent continuer tre employs sur la terre, malgr le bas prix du bl, ou sil ne vaut pas mieux les vendre, et employer leur valeur autre chose. Supposons, cependant, que le fait soit tel quon lnonce, et quaucune partie du capital ne puisse tre retire 1, le fermier, dans ce cas, continuerait cultiver du bl, et en rcolter prcisment la mme quantit, quel quen ft le prix ; car il ne serait pas de son intrt den rcolter moins, puisque, sil nemployait pas son capital de cette manire, il nen obtiendrait aucun profit. Il ny aurait aucune importation de bl, car on le vendrait au-dessous de 3 l. 10 sch., plutt que de ne pas le vendre ; et, dans le cas suppos, le ngociant qui en importerait de ltranger ne pourrait point le donner au-dessous de ce prix. A la vrit, les fermiers qui cultiveraient des terres de cette qualit infrieure, souffriraient de la baisse dans la valeur changeable de leurs denres; mais quel effet en prouverait le pays ? Nous aurions prcisment la mme quantit de toutes sortes de produits ; mais les produits immdiats de la terre, et le bl, se vendraient bien meilleur march. Le capital dun pays se compose de ses produits ; et comme ils seraient les mmes quauparavant, la reproduction sen ferait toujours dans la mme proportion. Le bas prix du bl ne rapporterait cependant les profits ordinaires des capitaux que sur les terres n 5, qui, dans ce cas, ne paieraient pas de rente, et celle de toutes les terres dune qualit suprieure baisserait ; les salaires baisseraient en mme temps, tandis que les profits monteraient. A quelque bas prix que tombt le bl, si le capital ne pouvait tre retir de la terre, et si la demande naugmentait pas, limportation du bl serait impossible, car le pays en produirait la mme quantit quauparavant. Bien quil y et un partage diffrent du produit, bien que quelques classes de la socit y gagnassent, et que dautres y perdissent, la somme totale de la production serait exactement la mme, et la nation, prise collectivement, ne se trouverait ni plus riche ni plus pauvre.
1
Tout le capital engag dans la terre, quelle que soit dailleurs son importance, doit, lexpiration du bail, rester au propritaire, et non au fermier. La rmunration accorde au propritaire pour lusage de ce capital lui reviendra toujours sous forme de rente ; mais cette rente elle-mme cesserait du jour o, avec une quantit donne de capital, on pourrait rcolter sur des terres loignes plus de bl que sur celle o ont t verss les capitaux. Si la situation du pays exige limportation de crales trangres, si , avec la mme somme de frais, on peut rcolter 1100 quarters, au lieu de 1000 quarters, il se formera ncessairement alors une rente de 100 1. st. Mais si au dehors on obtient 1200 quarters, la culture indigne sera abandonne, car elle ne donnera mme plus le taux gnral des profits. Mais quelque forts que soient les capitaux engags dans la terre, il ne faudrait pas voir dans tout ceci un inconvnient bien grave. Tout capital quon dpense aboutit ou doit aboutir une augmentation de produits : - il est essentiel de ne pas perdre de vue cette considration fondamentale. Quimporte, ds lors, la socit que la moiti de son capital, ou mme que la totalit de ce capital sanantisse, si lon en retire un produit annuel plus considrable. Ceux qui dploreraient la perte du capital dans des cas pareils, me sembleraient sacrifier la fin aux moyens. (Note de lAuteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
26
Mais une baisse relative dans le prix du bl a toujours cet heureux rsultat daccrotre le fonds destin payer le travail ; car, sous le nom de profits, une part plus considrable reviendra la classe productive, et une moindre part, sous le titre de rente, la classe improductive. Cela est vrai, mme en admettant que le capital ne peut pas tre retir de la terre, et quil doit y tre employ ou rester sans emploi. Si pourtant une grande partie de ce capital pouvait tre retire, comme il est vident que cela est .possible, elle ne le sera cependant que lorsquelle rapportera davantage au propritaire dans un autre emploi. Cette portion de capital ne sera donc retire que lorsquelle pourra tre employe dune manire plus productive et pour le propritaire et pour le public. Le propritaire consent perdre la portion de capital quil ne peut dgager de la terre ; car avec la portion quil lui est possible den retirer, il peut obtenir une plus grande valeur et une plus grande quantit de produits agricoles, que sil voulait tirer parti de la portion de capital quil laisse dans la terre. Il se trouve prcisment dans la position dune personne qui aurait construit grands frais des machines dans une manufacture, machines qui auraient t tellement perfectionnes par de rcentes dcouvertes, quil en serait rsult une diminution dans le prix de ses produits. Ce serait un sujet bien digne de calcul pour lui, de savoir sil doit abandonner ses vieilles machines, et les remplacer par dautres plus parfaites, en perdant toute la valeur des anciennes, ou continuer tirer parti de leur puissance, comparativement faible. Quel serait lhomme qui, dans de telles circonstances, saviserait de lui conseiller de ne point adopter les nouvelles machines, par la raison que cela diminuerait ou dtruirait mme la valeur des anciennes ? Tel est cependant le raisonnement de ceux qui voudraient que lon dfendit limportation du bl, raisonnement fond sur ce quelle tend diminuer ou mme anantir cette partie du capital du fermier qui est pour jamais identifie avec la terre. Ils ne voient pas que tout commerce tend augmenter la production, et que, par cet accroissement, le bien-tre gnral est augment, quoiquil puisse en rsulter quelque perte partielle. Pour tre daccord avec eux-mmes, ils devraient chercher arrter tout perfectionnement en agriculture et en manufactures, et toutes les inventions de machines ; car, quoique tous ces perfectionnements contribuent labondance gnrale, et par consquent au bonheur de toute la socit, ils ne manquent pourtant jamais, au moment o ils sont introduits, de dtriorer ou danantir une partie du capital existant des cultivateurs et des manufacturiers. La culture des terres, ainsi que tous les autres commerces, surtout dans un pays commerant, est sujette une raction, qui, dans un sens oppos, succde laction produite par une forte cause excitante. Cest ainsi que, si une guerre interrompt limportation du bl, la hausse de prix qui sensuivra attirera les capitaux vers lagriculture, par lappt des gros profits quun tel emploi prsente. Il en rsultera probablement quil y aura plus de capital employ, et quil sera apport au march plus de denres du sol quil nen faut pour la demande du pays. Dans ce cas, le prix du bl tombera par leffet de la surabondance, et jusqu ce que le terme moyen de loffre se trouve de niveau avec celui de la demande, les cultivateurs seront sous le coup dune crise douloureuse.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
27
Chapitre XX.
DES PROPRITS DISTINCTIVES DE LA VALEUR ET DES RICHESSES.
Table des matires Un homme est pauvre ou riche, dit Adam Smith, selon le plus ou moins de choses ncessaires, utiles ou agrables, dont il peut se procurer la jouissance.
La valeur diffre donc essentiellement de la richesse ; car la valeur ne dpend pas de labondance, mais bien de la difficult ou de la facilit de production. Le travail dun million dhommes produira toujours la mme valeur industrielle, sans produire toujours la mme richesse. Par linvention de machines, par plus dhabilet, par une division mieux entendue du travail, ou par la dcouverte de nouveaux marchs o lon peut faire des changes plus avantageux, un million dhommes peut, dans un tat donn de 1a socit, doubler ou tripler les richesses, les choses ncessaires, utiles ou agrables, que produisait auparavant le mme nombre douvriers ; mais on najouterait rien par l la valeur des produits. En effet, tout
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
28
augmente ou baisse de valeur proportion de la facilit ou de la difficult de production, ou, en dautres mots, proportion de la quantit de travail employe dans la production. Supposons quavec un capital donn, le travail dun certain nombre douvriers puisse produire mille paires de bas ; et que, par des inventions de machines, le mme nombre dhommes puisse en produire deux mille paires, ou quen continuant produire mille paires, il puisse, de plus, fabriquer cinq cents chapeaux. Dans ce cas, la valeur des deux mille paires de bas, ou celle des mille paires de bas jointe celle des cinq cents chapeaux, sera exactement la mme quavaient les mille paires de bas avant lintroduction des machines, parce que ces diffrents produits seront le rsultat de la mme quantit de travail. Mais la valeur de la masse gnrale des denres se trouvera cependant diminue ; car, quoique la valeur des produits, augments par suite des procds perfectionns, soit exactement gale en valeur la quantit produite avant ce perfectionnement, il y a aussi un effet produit sur la portion de marchandises non encore consommes, et qui ont t fabriques avant lintroduction des procds perfectionns. La valeur de ces marchandises se trouvera rduite ; car il faut quelle tombe, quantits gales, au niveau de celle des marchandises produites sous linfluence des procds perfectionns ; et la socit, malgr la quantit augmente de ses produits et le surcrot de richesse et de moyens de jouissance, aura, somme totale, moins de valeurs. En augmentant constamment la facilit de production, nous diminuons constamment la valeur de quelques-unes des choses produites auparavant, quoique, par ce mme moyen, nous accroissions non-seulement la richesse nationale, mais encore la facult de produire pour lavenir. Grand nombre derreurs, en conomie politique, ont pris leur source dans cette manire fausse de regarder laugmentation de la richesse et laugmentation de la valeur comme des expressions synonymes, et dans les fausses notions sur ce qui constitue la mesure commune de la valeur. Lun, regardant le numraire comme la mesure de la valeur, croit quune nation devient riche ou pauvre, selon que ses produits, de quelque nature quils soient, peuvent schanger contre plus ou moins de numraire. Dautres regardent le numraire comme un agent trs-commode dchange, mais non comme une mesure convenable, par laquelle on puisse estimer la valeur des choses ; daprs eux, la vritable mesure de la valeur, cest le bl 1, et un pays est riche ou pauvre, selon que ses produits peuvent lui procurer en change plus ou moins de bl. Il en est encore dautres qui regardent un pays comme pauvre ou riche, selon la quantit de travail quil peut payer 2. Mais pourquoi lor, le bl ou le travail, seraientils la mesure commune de la valeur plutt que le charbon ou le fer, que le drap, le savon, la
1
Adam Smith dit que la diffrence entre le prix rel et le prix nominal des denres et du travail, nest point un objet de simple spculation, mais peut, au contraire, tre quelquefois trs-utile dans la pratique. Je suis de son avis ; mais le prix rel du travail et des denres ne peut pas plus tre dtermin par leur prix en marchandises, qui est la mesure relle adopte par Adam Smith, que par ce quils valent en or ou en argent, qui est la mesure nominale. Louvrier ne reoit un prix rellement lev pour son travail, que quand avec son salaire il peut acheter le produit de beaucoup de travail. (Note de lAuteur.) M. Say (con. polit., liv. I, chap. II) conclut que largent a aujourdhui peu prs la mme valeur quil avait sous Louis XIV, parce que la mme quantit dargent achte la mme quantit de bl. (Note de lAuteur.) Dans un autre endroit de mon conomie politique, je donne les raisons qui me font croire que, bien que la valeur daucune espce de choses ne soit invariable, la valeur du bl est sur un grand nombre dannes communes la moins variable de toutes. - J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
29
chandelle, ou tout autre objet ncessaire louvrier ? Comment, en un mot, une denre quelconque, ou toutes les denres ensemble, pourraient-elles constituer une mesure commune, lorsque la mesure elle-mme se trouve tre sujette prouver des variations dans sa valeur ? Le bl, ainsi que lor, peut, par la difficult ou la facilit de sa production, varier de 10, 20 ou 30 pour 100, relativement aux autres choses ; pourquoi donc dire toujours que ce sont ces autres choses qui ont vari, et non le bl ? Il ny a de denre invariable que celle qui, dans tous les temps, exige pour sa production le mme sacrifice de travail et de peines. Nous nen connaissons point de semblables, mais nous pouvons en parler et en raisonner, par hypothse, comme si elle existait ; et nous pouvons perfectionner la thorie de la science en faisant voir clairement que toutes les mesures adoptes jusqu prsent pour apprcier la valeur sont absolument inapplicables 1.
1
La valeur est une qualit inhrente certaines choses ; mais cest une qualit qui, bien que trs-relle, est essentiellement variable, comme la chaleur. Il ny a point de valeur absolue, de mme quil ny a point de chaleur absolue ; mais on peut comparer la valeur dune chose avec la valeur dune autre, de mme quon peut dire quune eau o lon plonge le thermomtre, et qui le fait monter quarante degrs, a autant de chaleur apparente que tout autre liquide qui fait monter le thermomtre au mme degr. Pourquoi la valeur est-elle perptuellement variable ? La raison en est vidente : elle dpend du besoin quon a dune chose qui varie selon les temps, selon les lieux, selon les facults que les acheteurs possdent ; elle dpend encore de la quantit de cette chose qui peut tre fournie, quantit qui dpend elle-mme dune foule de circonstances de la nature et des hommes. La valeur ne peut tre mesure que par la valeur. Si lon entreprenait de mesurer la valeur des choses par une autre de leurs proprits, ce serait comme si lon voulait mesurer leur poids par leur forme ou par leur couleur ; mais toute valeur tant essentiellement variable, aucune na la qualit ncessaire dune mesure : linvariabilit. Aucune ne peut donc servir donner une ide exacte dune autre valeur qui est dans un autre temps ou dans un autre lieu On ne peut pas dire quune chose qui a cot deux guines Londres, vaut le double de celle qui a cot une guine Paris, parce que la guine, lorsquelle est Paris, ne vaut pas ce quelle vaut Londres. On ne peut mme pas dire quune chose qui valait Londres, il y a dix ans, une guine, a conserv sa mme valeur, parce quelle sy vend encore une guine ; car il faudrait pour cela avoir la certitude que, dans Londres mme, une guine ne vaut ni plus ni moins que ce quelle valait il y a dix ans. Or, cette certitude, on ne peut lavoir. Rien nest donc plus chimrique que de vouloir proposer une mesure des valeurs et un moyen de comparer deux valeurs, moins que ces deux valeurs ne soient en prsence. Alors, en effet, on peut les comparer : chaque chose a son prix courant, qui est la valeur que les circonstances du moment y attachent en chaque lieu.. On peut donc dire quen un lieu, en un moment donn, une chose dont le prix courant est de cinq, dix, cent fois le prix courant dune autre chose, vaut cinq fois, dix fois, cent fois autant que cette dernire. Alors toute espce de chose peut servir de point de comparaison pour estimer la valeur dune autre chose, pourvu que lune et lautre aient un prix courant. On peut donc dire quune maison vaut aujourdhui cinq cent mille hectolitres de bl, aussi bien que 20,000 francs;. et, si nous disons de prfrence 20,000 francs, cest parce que nous connaissons mieux en gnral la valeur de 20,000 francs, que celle de cinq cent mille hectolitres de bl, quoiquelle soit la mme dans 1e cas suppos. En raisonnant sur lconomie politique, on est oblig bien souvent de considrer un mme objet deux poques successives, comme lorsquon recherche linfluence de limpt sur la valeur dun produit. Il faut se former une ide du produit avant limpt et aprs limpt ; mais comme cette valeur peut changer par dautres causes ; comme la valeur au terme de comparaison, de largent, par exemple, peut varier aussi dans lintervalle, il faut toujours sous-entendre, en parlant dune cause qui agit sur quelques valeurs que ce soient, que lon regarde laction des autres causes comme semblable dans les deux cas. En disant, par exemple, que telle circonstance a fait monter le prix dune chose de 2 francs 3 francs, je suppose que la marchandise appele franc na prouv aucune variation ; et si elle en a prouv, il est de droit quil faut faire mon rsultat une correction quivalente. Quoique cette restriction soit de droit, M. Ricardo, au commencement de son ouvrage, a eu soin de lexprimer positivement.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
30
Et en supposant mme quune de ces mesures ft une mesure exacte de la valeur, elle ne le serait cependant pas de la richesse ; car la richesse ne dpend pas de la valeur. Un homme est riche ou pauvre, selon labondance des choses ncessaires ou dagrment dont il peut disposer, et elles contribuent galement aux jouissances du possesseur, que leur valeur changeable contre de largent, du bl ou du travail, soit forte ou faible. Cest en confondant les ides de valeur et de richesse quon a prtendu quen diminuant la quantit des marchandises, cest--dire des choses ncessaires, utiles ou agrables la vie, on pouvait augmenter les richesses. Si la valeur tait la mesure de la richesse, on ne pourrait pas nier cette proposition, car la raret des choses en augmente la valeur. Mais si Adam Smith a raison, si la richesse se compose des choses de ncessit et dagrment ; dans ce cas elle ne saurait augmenter par la diminution de ces choses. Il est vrai quune personne qui possde un objet rare, est plus riche, si, au moyen de cet objet, elle peut se procurer une plus grande quantit de choses ncessaires et agrables la vie ; mais le fonds gnral duquel est tire larichesse des autres personnes sen trouve ncessairement diminu.
Que leau devienne rare, dit lord Lauderdale, et quelle soit le partage exclusif dun seul individu, sa richesse personnelle crotra ; car leau, dans ce cas, aura une valeur ; et si la richesse nationale se compose de la somme des fortunes individuelles, par ce moyen la richesse gnrale se trouvera aussi augmente.
La richesse de cet individu augmentera, nul doute ; mais comme il faudra que le fermier vende une partie de son bl, le cordonnier une partie de ses souliers, et que tout le monde se prive dune partie de son avoir dans lunique but de se procurer de leau quils avaient auparavant pour rien, ils seront tous appauvris de toute la quantit de denres quils sont forcs de consacrer cet objet, et le propritaire de leau aura un profit prcisment gal leur perte. La socit jouira toujours de la mme quantit deau et de la mme quantit de denres; mais la distribution en sera diffrente. Cest cependant dans la supposition quil y a seulement monopole deau, et non disette ; car si leau manquait, la richesse nationale et individuelle se trouverait rellement rduite, en tant quelle serait prive dune portion dun des objets qui servaient aux jouissances gnrales. Non-seulement le fermier avait moins de bl donner en change pour les autres denres qui pourraient lui tre ncessaires ou agrables ; mais il prouverait, comme tout autre individu, une diminution dans la jouissance dun objet aussi essentiel son bien-tre. Il y aurait donc, non-seulement une rpartition diffrente des richesses, mais il y aurait encore perte relle de richesse. Cest pourquoi lon pourrait dire de deux pays qui possderaient une quantit gale de toutes les choses ncessaires, utiles ou agrables la vie, quils sont galement riches ; mais
Ces explications mont paru ncessaires pour apprcier convenablement ce que lauteur a dit et va dire sur le sujet de la mesure des valeurs. - J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
31
la valeur de leurs richesses respectives dpendra de la facilit ou difficult comparative avec laquelle ces richesses sont produites. Si une machine perfectionne nous donnait le moyen de faire deux paires de bas, au lieu dune, sans employer plus de travail, on donnerait double quantit de bas en change dune aune de drap. Si une pareille amlioration avait lieu dans la fabrication du drap, les bas et le drap schangeraient dans les mmes proportions quauparavant ; mais ils auraient tous les deux baiss de valeur, puisquil faudrait en donner double quantit en les changeant contre des chapeaux, de lor ou dautres marchandises en gnral, pour obtenir une quantit dtermine de ces objets. Que lamlioration stende la production de lor et de toute autre denre, et les anciennes proportions seront de nouveau rtablies. Il y aura double quantit de produits annuels, et par consquent la richesse nationale sera double ; mais elle naura point augment de valeur 1.
1
Toute cette doctrine est puise dans mon Trait dconomie politique (liv. II, chap. IV), mais lauteur en tire une conclusion oppose, cest--dire que la richesse nest pas la mme chose que la valeur, tandis que jtablis que la richesse nest que la valeur des choses. Ce quil y a de singulier, cest quAdam Smith dit dans une circonstance comme Ricardo, et dans beaucoup dautres circonstances, comme moi. On sent bien que des auteurs dun si grand sens, et accoutums ne juger que daprs lobservation, ne peuvent tre diviss sur ce point essentiel que par un malentendu ; or , cest ce malentendu quil faut claircir. Que la richesse nest autre chose que la valeur courante des choses quon possde, cest un point de fait. Lorsquon veut connatre ses richesses, on fait un tat gnral de tout ce quon possde ; on met la suite de chaque article le prix quon en pourrait tirer si lon voulait sen dfaire ; et le total compose la richesse quon a voulu connatre. Mais il ne faut point perdre de vue les proprits inhrentes la valeur, parce que ces mmes proprits sont inhrentes la richesse, qui nest autre chose que de la valeur. Ces proprits sont 1 dtre variables, ainsi que je lai dit dans ma prcdente note : un inventaire nindique une somme de richesses que pour le temps et le lieu o il est dress. Ds te mois suivant peut-tre, plusieurs prix auront vari, et il ne sera plus exact. Ces prix sont diffrents dans la ville voisine : si lon sy transporte avec ses richesses, elles ne seront plus exactement les mmes. En conclure que ce nest pas de la richesse, ce serait vouloir conclure que la chaleur nest pas de la chaleur, parce quil fait frais le matin et chaud midi. Ces proprits sont encore, 2 dtre relatives : cest--dire que dans linventaire suppos, si lvaluation totale de la proprit slve 100,000 francs, cela ne veut dire autre chose, sinon que la valeur de tous ces objets est gale a la valeur quont, dans le mme endroit, vingt mille cus de cinq francs pesant chacun vingt-cinq grammes au titre de 9/10 dargent fin. De ce que le rapport entre la valeur des effets et la valeur des cus peut cesser dtre la mme, il ne sensuit pas encore que la valeur ne soit pas de la richesse ; il sensuit seulement que dans le moment de lvaluation telle richesse en effets est gale telle richesse en argent. Si les effets viennent baisser de valeur, ou si largent devient plus prcieux, le rapport ne sera plus le mme ; il en rsultera seulement que le possesseur des effets sera moins riche par rapport au possesseur de largent, ou celui-ci plus riche relativement lautre. Maintenant, avec ces donnes, essayons de rsoudre la grande difficult. Comment se fait-il que lorsquun objet devient plus abondant, lorsque les bas, par exemple, tombent moiti prix, je sois tout la fois moins riche en valeur et plus riche en jouissances ? La somme de mes bas ports linventaire sera moindre, et cependant mes jouissances seront accrues, puisque jaurai un plus grand nombre de paires. Ici lon fait sans sen douter une question multiple, cest--dire plusieurs questions dans une seule ; voil pourquoi il se peut quil y ait plusieurs rponses, et que ces rponses soient toutes justes, au moins dans le point de vue sous lequel on considre la question. Si vous vous considrez comme possesseur dune certaine quantit de bas, et que les bas tombent moiti prix, non seulement relativement largent, mais relativement toute autre espce de marchandise, alors cette portion de vos richesses a diminu de moiti relativement toutes les autres ; ou, ce qui revient au mme, toutes les autres richesses ont doubl par rapport celle-l. Si vous acquriez en vendant une paire de bas six livres de sucre, vous nen acquerrez plus que trois : vos jouissances en bas seront demeures les mmes : mais si vous voulez les changer contre des jouissances en sucre, vous nobtiendrez plus de ces dernires quune moiti de ce que vous auriez obtenu. La somme des moyens de jouissances qui existaient dans la socit, na ni augment ni diminu ; la somme des richesses non plus ; la valeur de toutes les
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
32
Quoique Adam Smith ait donn de la richesse une ide exacte et dont jai dj plus dune fois fait mention, il en donne ensuite une explication diffrente, en disant quun homme doit tre riche ou pauvre, selon quil peut disposer de plus ou moins de travail. Cette manire de voir est essentiellement diffrente de la premire, et est certainement inexacte ; car, supposons que les mines fussent devenues plus productives, en sorte que lor et largent eussent baiss de valeur, par la plus grande facilit de leur production ; ou que le velours tant fabriqu avec beaucoup moins de travail quauparavant, la valeur en tombt de moiti ; la richesse de tous les consommateurs de ces articles se trouverait augmente. Un particulier pourrait, dans ce cas, augmenter la quantit de sa vaisselle ; un autre pourrait acheter une quantit double de velours ; mais, quoique possesseurs de cette quantit additionnelle de vaisselle et de velours, ils ne pourraient pas employer plus douvriers que par le pass ; car la valeur changeable du velours et de la vaisselle ayant baiss, ils seraient obligs de sacrifier une plus grande portion de cette sorte de richesse au paiement de la journe de louvrier. La richesse ne saurait donc tre estime par la quantit d e travail quelle peut payer. De tout ce quon vient de dire, il rsulte que la richesse dun pays peut saccrotre de deux manires : par lemploi dune portion plus considrable de revenu consacr lentretien des travailleurs, - ce qui non-seulement augmentera la quantit, mais encore la valeur de la masse des produits : ou encore, par laugmentation des forces productives du mme travail, - ce qui ajoutera labondance, mais naugmentera point la valeur des produits. Dans le premier cas, non-seulement un pays deviendra riche, mais encore la valeur de ses richesses saccrotra. Il senrichira par lconomie, en rduisant ses dpenses en objets de luxe et dagrment, et en employant le fruit de ses pargnes la reproduction. Dans le second cas, il se peut quil ny ait ni rduction dans les dpenses de luxe et dagrment, ni augmentation de travail productif employ ; mais avec la mme quantit de travail, les produits seront plus considrables : la richesse saccrotra, mais non la valeur 1.
marchandises par rapport aux bas (largent compris) a hauss prcisment autant que la valeur des bas a baiss ; car, encore une fois, il est de lessence de la valeur dtre relative. Quand on considre dans les choses une qualit absolue, comme la jouissance qui rsulte de leur usage, on nen considre plus la valeur changeable. On considre une jouissance, et non plus une richesse. Que si vous considrez les bas, non plus comme une marchandise dj produite, mais comme une marchandise pouvant se produire, et qui, en baissant la moiti de son ancien prix, vous permet den consommer une double quantit, ou, ce qui revient au mme, une qualit le double plus belle, sans pour cela faire un plus grand sacrifice, alors vous considrez la valeur des bas dans son rapport avec la valeur de votre revenu, et vous vous trouvez, relativement ce produit en particulier, le double plus riche que vous ntiez, puisquau moyen du mme sacrifice vous obtenez en ce genre une double jouissance. Cest en ce sens que, bien que la valeur soit la seule mesure de la richesse, une baisse de prix est une augmentation de richesse, puisque alors votre revenu a doubl par rapport aux bas ; et si les perfectionnements dans les procds de la production avaient t pareils pour tous les autres produits, votre richesserevenu serait vritablement double. Cest comme si le fonds do vous tirez votre revenu avait doubl, soit que ce fonds ft en terres, en capital, ou bien en talents industriels. Cette doctrine est fort importante ; elle est rigoureusement conforme la nature des choses, et par consquent inbranlable, et elle explique des difficults o lon sest perdu jusqu prsent. - J.-B. SAY. Les deux hypothses de M. Ricardo me semblent se rduire ceci : Les richesses dun pays saugmentent de deux faons : soit lorsque les fonds productifs s'accroissent, soit
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
33
De ces deux manires d'augmenter la richesse, on doit prfrer la seconde, puisqu'elle produit le mme effet sans nous priver de nos jouissances ni les diminuer, ce qui est invitable dans la premire. Le capital d'un pays est cette portion de sa richesse qui est employe dans le but dune production venir. Il peut s'accrotre de mme que la richesse. Un surcrot de capital contribuera aussi effectivement la production de la richesse future, qu'il provienne des amliorations dans les connaissances pratiques et dans les machines, ou de l'emploi dune plus grande partie du revenu dans la reproduction ; car la richesse tient toujours la quantit des produits, sans gard pour la facilit avec laquelle on peut stre procur les instruments qui servent la production. Une certaine quantit de vtements et de vivres suffira aux besoins et lentretien dun mme nombre dhommes, et fera faire la mme quantit douvrage, que ces objets soient le fruit du travail de cent hommes ou de deux cents ; - mais ces vtements et ces subsistances auront double valeur si les deux cents hommes ont t employs les produire. Malgr les modifications quil a introduites dans la quatrime et dernire dition de son Trait dconomie politique, M. Say me parat avoir t trs-malheureux dans sa dfinition de la valeur et des richesses. Il considre ces deux termes comme synonymes et dclare que tout homme est riche en proportion de laccroissement de valeur que reoivent ses proprits et de labondance des marchandises quil peut acheter. La valeur des revenus saccrot, ditil, ds que, par des causes quelconques, ils peuvent nous donner une plus grande quantit de produits. Daprs M. Say, si donc la difficult de produire du drap venait doubler, et si, par consquent, le drap schangeait contre une quantit de marchandises deux fois plus
lorsque, sans tre plus grands, ils produisent davantage. Ajoutons-y quelques claircissements. Par fonds productifs, j'entends les terres productives, les capitaux productifs, l'industrie productive. M. Ricardo, disciple en cela de Smith, n'entend que le travail. Dans sa premire hypothse, les capitaux accrus par l'pargne entretiendraient un plus grand nombre de travailleurs. Il y aurait plus de choses produites ; mais ces choses tant le rsultat de plus de services productifs, seraient dans le mme rapport de valeur avec les services productifs. Le pays aurait plus de producteurs (capitalistes ou industrieux), mais aussi il aurait plus de consommateurs. Chacun, avec le mme revenu, n'obtiendrait que la mme quantit de produits. M. Ricardo regarde cette augmentation de richesses comme la moins dsirable. L'autre augmentation, en effet, est plus propre procurer chacun la libre disposition de plus de produits, de plus de jouissances. Elle consiste en un plus grand parti tir des mmes fonds productif ; d'o rsulte, sans la moindre diminution dans le revenu, une baisse dans la valeur des produits qui permet chacun d'tre mieux pourvu. (Voyez ma dernire note, page 252.) Le revenu reste le mme quand le fonds productif rend le double de produits, quoique moins chers de moiti. C'est une chose de fait que le raisonnement explique. Si par un meilleur procd on double le produit des terres en pommes de terre, par exemple, si l'on fait produire chaque arpent cent setiers 3 fr. au lieu de cinquante setiers 6 fr., dans les deux cas l'arpent rapporte 300 fr. ; mais dans le premier cas, le produit est moiti prix, et relativement ce produit, non-seulement les revenus fonciers, mais tous les revenus sont doubls. De mme, s'il est question d'un perfectionnement qui fait qu'un capital donne un produit double ; si, comme il est arriv dans la fabrication des fils et tissus de coton, des machines valant 30,000 fr. ont donn le double des produits, de ce que la mme somme produisait avec autant de travail et des machines moins parfaites, alors les produits de ce capital ont successivement baiss de prix par la concurrence. On en a eu le double en quantit, qui, en baissant de prix, ont nanmoins valu autant en somme. Les revenus capitaux n'en ont pas t altrs ; mais pour la mme somme de revenu, chacun a pu obtenir le double de produits en cotonnades : le public a rellement t le double plus riche relativement aux cotonnades. - J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
34
grande, il doublerait de valeur : cela est incontestable. Mais dans le cas o la production de ces marchandises se trouverait facilite sans que celle du drap devnt plus coteuse, et o, par consquent, le drap schangerait encore contre une quantit de marchandises double, M. Say soutiendrait encore que la valeur du drap a doubl ; tandis que, daprs mes propres vues sur la matire, il devrait dire que le drap a conserv sa valeur premire, et que ces marchandises ont baiss de moiti. M. Say ne manque-t-il pas de logique lorsquil dit que les progrs de la production peuvent faire quon cre, avec les mmes procds, deux sacs de bl au lieu dun, que la valeur de ces sacs baisse consquemment de moiti, et que, nanmoins, le drapier, qui change ses toffes contre deux sacs de bl, obtiendra une valeur double de celle quil recevait, alors quil recevait un seul sac de bl pour son drap. Si deux sacs ont maintenant la valeur quun seul sac avait prcdemment, il recevra exactement la mme valeur, et rien de plus : il obtient, sans doute, une somme de richesse et dutilit double, il reoit deux fois plus de ce quAdam Smith appelle valeur en usage, mais non de ce quon entend par valeur en change, ou valeur proprement dite. Cest pourquoi M. Say a tort quand il considre comme synonymes les termes de valeur, dutilit ; de richesse. Je pourrais mme en appeler M. Say, et emprunter, au bnfice de ma cause et de la diffrence essentielle qui existe entre la valeur et les richesses, plusieurs chapitres de ses ouvrages ; tout en reconnaissant, cependant, que dans dautres passages il combat mes ides. Il mest, on le pense bien, impossible de concilier ces pages contradictoires, et je les dsigne M. Say lui-mme, pour quil me fasse lhonneur de discuter mes observations dans une dition future de son ouvrage, et quil y introduise les explications que tout le monde, comme moi, juge ncessaires pour la parfaite entente de ses doctrines. 1 . Dans lchange de deux produits, ce que nous changeons rellement ce sont les services productifs qui ont servi les crer. Trait dconomie politique, dit. GUILLAUMIN, p. 346. 2. Il ny a chert vritable que celle provenant des frais de production : et une chose rellement chre est celle qui cote beaucoup produire. 3. La valeur de tous les services productifs ncessaires pour la cration dun produit, constitue les frais de production de cet article. 4. Cest lutilit qui dtermine la demande dune marchandise : mais ce sont les frais de production qui servent de limite cette demande. Quand son utilit ne suffit mme pas pour lever la valeur au niveau des frais de production, cette chose ne vaut pas ce quelle a cot ; et il y faut voir la preuve que les mmes services productifs auraient pu tre employs plus avantageusement dans une autre branche dindustrie. Les propritaires des fonds productifs, ceux qui disposent de capital, de terre ou de travail, sont constamment occups comparer les frais de production avec la valeur dchange, ou, ce qui retient au mme, la valeur des diffrentes marchandises entre elles. En effet, les frais de production ne sont autre chose que la valeur des services productifs consacrs la cration dune marchandise ; et la valeur dun service productif nest autre chose que celle de la marchandise produite. Do il suit que la valeur dune marchandise, la valeur dun service productif, la valeur des frais de production
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
35
sont des valeurs quivalentes, toutes les fois quon laisse prendre aux choses leur cours naturel. 5. La valeur des revenus saccrot donc du moment o ils nous procurent - nimporte par quels moyens - une plus grande somme de produits. 6. Le prix sert de mesure la valeur des choses, et leur valeur sert mesurer leur utilit. 7. Lchange fait librement montre pour le temps, le lieu, la situation sociale o lon se trouve, le prix que nous attachons aux choses changes. 8. Produire, cest crer de la valeur en donnant de lutilit aux choses qui nen ont pas, ou en augmentant celle quelles ont dj, et par consquent en faisant natre des demandes. 9. Lutilit cre constitue un produit. La valeur changeable qui en rsulte est seulement la mesure de cette utilit et de la production qui vient davoir lieu. 10. Lutilit que les habitants de certaines contres reconnaissent une chose, ne peut tre apprcie que par le prix quils consentent en donner. 11. Le prix est la mesure de lutilit que notre jugement attache a un produit, et de la satisfaction que nous prouvons en le consommant : en effet personne ne se livrerait cette consommation si, pour le mme prix, on pouvait se procurer une utilit, une jouissance plus grande. 12. Une valeur incontestable est la quantit de toute autre chose quon peut obtenir, du, moment quon le dsire, en change de la chose dont on veut se dfaire, p. 314, dit. Guillaumin. Sil ny a rellement de chert que celle qui nat des frais de production, comment dire quune marchandise peut hausser de valeur sans que les frais de production augmentent, et par cela seul quelle schangera contre une quantit plus grande de certaines denres dont le cot aura diminu ? Quand je donne deux mille fois plus de drap pour une livre dor que pour une livre de fer, cela prouve-t-il que jaccorde lor une utilit deux mille fois plus grande quau fer ? Certainement non : cela prouve simplement - comme la reconnu M. Say au paragraphe 2, - que la production de lor est deux mille fois plus difficile, plus coteuse que celle du fer. Si les frais de production de ces deux mtaux taient les mmes, jen donnerais le mme prix ; mais si lutilit tait rellement le fondement de la valeur des choses, il est probable que je donnerais davantage pour le fer. Cest la concurrence des producteurs perptuellement occups, dit lauteur, comparer les frais de production avec la valeur de la chose cre, qui rgle la valeur des diffrentes marchandises. Si donc je donne un shilling pour un pain et 21 shillings pour une guine, il ne faut pas y voir la mesure de lutilit que jattribue chacune de ces denres. Dans le numro 4 M. Say dfend, presque sans modification, la doctrine que j'ai mise relativement la valeur. Au rang des services productifs il place ceux qu'on retire de la terre,
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
36
du capital, du travail : je n'admets, moi, l'exclusion complte de la terre, que le capital et le travail. La diffrence provient ici de la diversit de nos vues sur la rente territoriale. Je .la considre, moi, comme le rsultat d'un monopole partiel qui, loin de rgler les prix, en subit au contraire l'influence. Je crois que si tous les propritaires renonaient, par un gnreux effort, toutes leurs rentes, le prix des produits agricoles ne baisserait pas : car il y aurait toujours une certaine proportion de ces produits crs sur des terres qui ne paient pas et ne peuvent pas payer de rentes, - l'excdant du produit sur les frais suffisant peine pour couvrir les profits du capital. Pour conclure, et quoique personne n'estime plus haut que moi les avantages qui peuvent rsulter pour toutes les classes de consommateurs de l'abondance et du bas prix rel des marchandises, je ne puis tomber d'accord avec M. Say quand il value le prix dune marchandise par l'abondance des autres marchandises contre lesquelles elle s'change. Je suis, cet gard, de l'avis d'un crivain distingu, M. Destutt de Tracy, qui dit que mesurer une chose, c'est la comparer avec une quantit donne de cette autre chose qui nous sert de terme de comparaison, d'talon, d'unit. Mesurer, dterminer une longueur, une valeur, un poids, c'est donc rechercher combien ils contiennent de mtres, de francs, de grammes, en un mot, d'units d'une mme nature 1. Le franc n'est une mesure de valeur, que pour une certaine quantit du mtal dont sont faits les francs, moins que les francs et la chose qu'on doit mesurer ne puissent tre rapports quelqu'autre mesure commune aux deux. Or, je crois qu'on peut effectivement trouver ce terme de comparaison, car les francs et la marchandise dtermine tant le rsultat de la mme somme de travail, le travail peut tre considr comme une mesure commune servant dterminer leur valeur relle et relative. Ceci, je suis heureux de le dire, me parat tre aussi l'avis de M. Destutt de Tracy. Il dit : Comme il est certain que nos facults physiques et morales sont nos seules richesses primitives, lemploi de ces facults constitue aussi notre seul trsor l'origine des socits ; et c'est par consquent de notre activit, de notre intelligence, que dcoulent les choses que nous nommons richesses, aussi bien celles qui sont le plus ncessaires que celles qui sont simplement une valeur d'agrment. Il est vident, aussi, que toutes ces choses reprsentent uniquement le travail qui les a cres ; et si elles ont une valeur, ou deux valeurs diffrentes, elles les reoivent de la somme de travail dont elles manent. 2 M. Say, en parlant du mrite et des imperfections du bel ouvrage d'Adam Smith, l'accuse d'avoir commis une erreur, en attribuant au seul travail de l'homme le pouvoir de produire
1
Elments d'Idologie, c. IV, p. 99. Dans cet ouvrage, M. de Tracy a group, d'une manire utile et habile, les principes gnraux de l'conomie politique, et je suis fch d'ajouter qu'il y fortifie, par son autorit, les dfinitions que nous a donnes M. Say de la valeur, des richesses, et de l'utilit. J'ai dit que la valeur qu'on met aux choses est la mesure de leur utilit, de la satisfaction qu'on peut tirer de leur usage, en ce sens que lorsque deux choses ont le mme prix courant, c'est une preuve que les hommes de ce lieu et de ce temps estiment qu'il y a le mme degr de satisfaction retirer de la consommation de l'une ou de l'autre. Mais j'aurais eu trs-grand tort si l'on pouvait infrer de ce que j'ai dit que lorsque le prix d'une chose baisse, son utilit diminue. L'utilit d'une chose qui baisse de prix se rapproche alors de l'utilit de l'air, qui ne nous cote rien, quoique fort utile. Du reste, il n'y aurait pas eu de cercle vicieux a dire que la valeur est la mesure de lutiiit, et l'utilit la mesure de la valeur, si ces quantits suivaient une marche absolument pareille dans leurs variations; ce qui n'est pas. - J.-B. Say.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
37
des valeurs. Une analyse plus exacte, dit M. Say, prouve que ces valeurs sont dues l'action du travail, ou plutt de l'industrie de l'homme combine avec l'action des agents que lui fournit la nature, et avec celle des capitaux.. Ce principe mconnu l'empche d'tablir la vraie thorie des machines, par rapport la production des richesses. En contradiction avec l'opinion d'Adam Smith, M. Say, dans le quatrime chapitre du premier livre de son Trait d'conomie politique, parle de la valeur que les agents naturels, tels que la lumire du soleil, l'air, la pression de l'atmosphre, donnent aux choses, en remplaant souvent le travail de l'homme, et quelquefois en travaillant la production en communaut avec lui 1. Mais ces agents naturels, quoiquils ajoutent beaucoup la valeur dutilit naugmentent jamais la valeur changeable dune chose, et cest celle dont parle ici M. Say. Aussitt quau moyen de machines, ou par nos connaissances en physique, nous forons les agents naturels faire louvrage que lhomme faisait auparavant, la valeur changeable de cet ouvrage tombe en consquence. Sil fallait dix hommes pour faire tourner un moulin bl, et quon dcouvrt que, par le moyen du vent ou de leau, le travail de ces dix hommes pourrait tre pargn, la farine qui serait le produit de laction du moulin tomberait ds ce moment de valeur, en proportion de la somme de travail pargn ; et la socit se trouverait enrichie de toute la valeur des choses que le travail de ces dix hommes pourrait produire, - les fonds destins lentretien des travailleurs nayant pas prouv par l la moindre diminution M. Say mconnat toujours la diffrence qui existe entre la valeur en change et la valeur dutilit. M. Say accuse le docteur Smith de navoir pas fait attention la valeur donne aux choses par les agents naturels et par les machines, en raison de ce quil considrait la valeur de toutes choses comme tant drive du seul travail de lhomme ; mais il ne me parat pas que cette accusation soit prouve ; car, dans aucun endroit de son ouvrage, Adam Smith ne dprcie les services que ces agents naturels et les machines nous rendent, mais il caractrise avec beaucoup de justesse la nature de valeur quils ajoutent aux choses. Ils sont utiles, en ce
1
Le premier homme qui a su amollir les mtaux par le feu n'est pas le crateur actuel de la valeur que ce
procd ajoute au mtal fondu. Cette valeur est le rsultat de l'action physique du feu jointe l'industrie et aux capitaux de ceux qui emploient le procd. De celte erreur, Smith a tir cette fausse consquence, c'est que toutes les valeurs produites reprsentent un travail rcent ou ancien de l'homme, ou, en d'autres termes, que la richesse n'est que du travail accumul ; d'o par une seconde consquence tout aussi fausse, le travail est la seule mesure des richesses ou des valeurs produites. Ces dernires consquences, c'est M. Say qui les tire, et non le docteur Smith ; elles sont fondes si lon ne distingue pas la valeur davec la richesse ; mais Adam Smith, quoiquil ait avanc que la richesse consiste dans labondance des choses ncessaires, utiles, ou agrables la vie, aurait admis que les machines et les agents naturels peuvent ajouter beaucoup a la richesse dun pays : cependant il naurait point accord que ces objets pussent rien ajouter la valeur changeable des choses. Note de lAuteur, quoi M. Say rpond : De mes dernires notes on peut infrer ma rponse celle-ci. Laction gratuite des agents naturels, quand elle remplace laction onreuse des hommes et des capitaux, fait baisser la valeur des produits. Comme toute valeur est relative, la valeur des produits ne peut pas baisser sans que la valeur des revenus (ou des fonds productifs qui donnent ces revenus) naugmente. Les consommateurs sont dautant plus riches, que les produits sont meilleur march. Jai prouv ailleurs que la baisse des produits provenant dune conomie dans les frais de production naltrait en rien les revenus des producteurs ; un homme qui parvient faire par jour deux paires de bas 3 francs gagne autant que lorsquil en faisait une 6 francs. - J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
38
quils augmentent labondance des produits, et quils ajoutent notre richesse en augmentant la valeur dutilit ; mais, comme ils travaillent gratuitement, comme on ne paie rien pour lusage de lair, de la chaleur du soleil, ni de leau, les secours quils nous prtent najoutent rien la valeur changeable 1.
1
M. Ricardo, en rapprochant divers passages pris en plusieurs endroits de mes ouvrages, sans pouvoir citer les dveloppements que jy donne, ni les restrictions que jy mets, y trouve de lobscurit et des contradictions. Il peut tre fond ; mais a-t-il clairci cette obscurit ? a-t-il lev ces contradictions ? Si lon prend le mot richesses dans sa signification la plus tendue, les richesses de lhomme sont tous les biens qui, tant sa disposition, peuvent, de quelque manire que ce soit, satisfaire ses besoins, ou seulement ses gots Dans ce sens, lair que nous respirons, la lumire du soleil, et mme lattachement de notre famille et de nos amis, sont des richesses. Ce sont des richesses quon petit appeler naturelles. Dans un sens plus restreint, et lorsquil est question seulement des biens que possdent un homme riche, une nation riche, on trouve que les richesses sont des choses qui, pouvant satisfaire les besoins et les gots des hommes en gnral, nont pu devenir leur proprit quau moyen de quelques difficults quils ont vaincues ; do il est rsult pour ces choses une valeur, cest--dire la qualit de ne pouvoir tre acquises quau moyen dun sacrifice gal celui quelles ont cot. Si je consens donner un boisseau de froment pour obtenir deux livres de caf ; cest parce que jestime que la satisfaction que je me promets de deux livres de caf vaut les difficults quil ma fallu vaincre pour crer un boisseau de froment. Si le propritaire des deux livres de caf pense de mme relativement au boisseau de froment, je dis que la valeur changeable du boisseau de froment est deux livres de caf, et rciproquement ; et si lune ou lautre de ces choses trouve schanger contre une pice de 5 francs, je dis que lune ou lautre sont une portion de richesses gale 5 francs ; quelles le sont par leur valeur changeable, et en proportion de cette valeur changeable. Valeur changeable et richesse sont donc synonymes. Or, cette richesse ainsi entendue, et quon pourrait nommer sociale, en ce quelle ne peut exister que parmi les hommes en socit, est celle qui fait lobjet des recherches de lconomie politique *, parce que seule elle est susceptible de saccrotre, de se distribuer et de se dtruire. Maintenant la grande difficult est de faire concorder les lois de la richesse sociale, ou de lconomie politique, avec cella de la richesse naturelle. Lorsquun produit se multiplie par le meilleur emploi que nous faisons de nos terres, de nos capitaux, et de notre industrie, il y a plus dutilit (soit de richesse naturelle) produite, et en mme temps la production de la richesse sociale semble tre moindre, puisque la valeur changeable du produit diminue. La richesse sociale ne suit donc pas la mme marche que la richesse naturelle : de l les difficults o se sont perdus Lauderdale et bien dautres, et les contradictions apparentes que M. Ricardo me reproche. Je mestimerai dautant plus heureux de le satisfaire, que les mmes doutes sont ns dans lesprit dun homme qui me tient de prs par le sang et par Iamiti, et qui les a consigns dans un crit publi rcemment ** ; la mme rponse servira pour tous deux, non sans quelque avantage peut-tre pour les progrs de la science. Pour se former une ide juste des choses, je pense quil faut se reprsenter la nature entire, les capitaux accumuls par lhomme, et les facults industrielles de lhomme, comme le grand fonds o se forment, et duquel naissent toutes les utilits, toutes les richesses naturelles et sociales qui servent a satisfaire plus ou moins compltement tous les besoins, tous les gots des hommes. Les portions de ce fonds qui nont pas besoin dtre sollicites, le soleil, par exemple, qui nous fournit une lumire et une chaleur si ncessaires au dveloppement des tre organiss, sont des fonds productifs appartenant chacun de nous, dune valeur infinie, pour ce qui est de lutilit quon en tire, puisque cette utilit est infinie, inpuisable. Dautres fonds, tels, par exemple, quun capital productif, nappartiennent pas tout le monde. Ils ne peuvent faire leur office que parce quils sont des proprits : lconomie politique en assigne les motifs. Leur valeur peut tre assimile a la valeur des fonds naturels, en ce quelle est proportionne a la quantit dutilit qui peut en natre. Ainsi un fonds capital, territorial et industriel, duquel sont sortis cinquante boisseaux de froment, vaudrait dix fois autant relativement cette espce de produit, si, dans un espace de temps pareil, par un perfectionnement quelconque, on parvenait en tirer cinq cents,. Il reste connatre quels sont ceux qui profitent de cette augmentation, ceux qui sont plus riches, non
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
39
seulement en richesses naturelles, mais en richesses sociales, en valeurs changeables, de tout cet accroissement dutilit produite. Si, par des causes dont la discussion est trangre lobjet de notre spculation prsente, la valeur changeable de chaque boisseau de bl se soutient malgr laugmentation survenue dans la quantit de bl produite, alors laugmentation de richesse produite est entirement au profit des producteurs, cest--dire des propritaires du fonds capital, du fonds territorial, et du fonds industriel, dont il est sorti cinq cents boisseaux au lieu de cinquante. Le revenu provenant de ces portions de fonds a dcupl. Si, comme il arrive plus frquemment, la valeur changeable de chaque boisseau de bl a baiss en raison de la plus grande quantit qui en a t produite, le profit obtenu est bien toujours dans la proportion de cinq cents cinquante ; mais ce profit est fait par la classe des consommateurs, lesquels sont aussi riches de ce quils paient de moins que les producteurs lauraient t de ce quils auraient vendu de plus. Leur revenu na pas dcupl, parce quils ne lemploient pas tout entier en froment ; mais la portion de revenu quils avaient coutume demployer en froment a dcupl, et toutes ces portions de revenu ainsi dcuples se monteraient, si elles taient runies, une somme gale la valeur dcuple du produit, en supposant quil net pas baiss de prix. Dans les deux cas, la socit a donc joui dune augmentation de valeurs comme dune augmentation dutilit. - J.-B. SAY. * Ce qui montre, pour le dire en passent, que lconomie politique est une science, bien nomme, puisque ce mot, daprs son tymologie, peut tre traduit par cette expression : Lois relatives aux richesses sociales. ** Principales causes de la richesse des peuples et des particuliers, par Louis Say, ngociant de Nantes, brochure de 178 pages. Paris, Dterville.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
40
Chapitre XXI.
DES EFFETS DE LACCUMULATION SUR LES PROFITS ET SUR LINTRT DES CAPITAUX.
Table des matires
Daprs la manire dont nous avons considr les profits des capitaux, il semblerait quaucune accumulation de capital ne peut faire baisser les profits dune manire permanente, moins quil ny ait quelque cause, galement permanente, qui dtermine la hausse des salaires. Si les fonds pour le paiement du travail taient doubls, tripls ou quadrupls, il ne serait pas difficile de se procurer bientt la quantit de bras ncessaires pour lemploi de ces fonds ; mais en raison de la difficult croissante daugmenter constamment la quantit de subsistances, la mme valeur en capital ne pourrait probablement pas faire subsister la mme quantit douvriers. Sil tait possible daugmenter continuellement, et avec la mme facilit, les objets ncessaires louvrier, il ne pourrait y avoir de changement dans le taux des profits et des salaires, quel que ft le montant du capital accumul. Cependant Adam Smith attribue toujours la baisse des profits laccumulation des capitaux et la concurrence qui en est la
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
41
suite, sans jamais faire attention la difficult croissante dobtenir des subsistances pour le nombre croissant douvriers que le capital additionnel emploie. Laccroissement des capitaux, dit-il, qui fait hausser les salaires, tend abaisser les profits 1. Quand les capitaux dun
1
Il mest impossible, voir la persistance avec laquelle Ricardo cherche tablir lantagonisme prtendu des salaires et des profits, et son impassibilit devant les dmentis que lexprience donne son systme, il mest impossible, dis-je, de ne pas croire une confusion dans les ides quil remue. Il a beau appeler Ad. Smith son secours pour le sauver de la ralit qui le combat, il a beau se couvrir de mystres dans certains passages, distinguer entre les hausses momentanes et les hausses prolonges, entasser les observations, prtendre que chaque obole ajoute aux salaires est une perte pour le manufacturier, nous faire chercher enfin dans les fanges du pauprisme les perles et le luxe du riche, il ne pourra faire que, par la solidarit qui relie les membres de la famille humaine, les souffrances ou les joies des uns ne retentissent, tt ou tard dans lme de tous. Chacune de ces grandes annes de crise, qui ont branl les socits anglaise, amricaine, franaise, et ont jet sur la place publique, dans le forum ardent et courrouc, les masses sans travail que vomissaient les manufactures ; chacune de ces annes aurait d enseigner laustre conomiste que les ouvriers sont la base de idifice industriel, et que lorsque la base dun difice sbranle le fate est bien prs de scrouler, en dautres termes, que la ruine frappe en mme temps en haut et en bas. Dun autre ct, chacune de ces annes radieuses, o lon vit les dbouchs sagrandir, les capitaux affluer dans toutes les industries pour les vivifier, le travail rouvrir, comme une formule magique, les portes muettes des ateliers, labondance secouer de toutes parts sur le monde ses merveilles et ses richesses, chacune de ces annes, disje, aurait d lui prouver que si les mauvais jours psent sur les chefs et sur les ouvriers, les jours de prosprit ont des rcompenses pour tous, sous forme de hauts salaires pour les uns, et de riches inventaires pour les autres. Je ne puis croire que Ricardo se soit tenu assez loin des vnements pour nen pas suivre la marche, et nen pas comprendre les enseignements, et ces vnements eussent t pour lui un espoir, et non une sorte danathme, si, mon humble avis, du moins, larme du raisonnement et de lobservation ne stait fausse entre ses mains. Je ne vois pas dautre moyen dexpliquer comment, toutes les fois quil indique une hostilit profonde dans les rangs des travailleurs, les faits rpondent au contraire par une union qui na rien certainement de la tendre affection que nous promet Fourier entre pages et pagesses, mais qui repose sur lintrt individuel, garanti par lintrt social, - du moins autant que le permettent toutes les charges qui sous le nom doctrois, de douanes, dimpts exagrs, de dettes publiques grvent le producteur et altrent les contrats conomiques. Au spectacle du dveloppement merveilleux de lindustrie, des progrs inesprs de la mcanique qui, dun ct, abaissent chaque jour la valeur courante des marchandises, et de lautre, provoquent laccroissement des salaires par limmensit de la tche quil sagit daccomplir et par la demande de travailleurs : au spectacle de cette double impulsion, ascendante pour le prix du travail, descendante pour le prix des produits, le savant auteur des Principes dconomie Politique na pas senti que, loin dtre pour le manufacturier une cause de ruine, lavilissement graduel de ses marchandises tait la base la plus sre de sa prosprit. Dans le fait, et par une aberration trange pour un aussi grand esprit, - aberration devant laquelle le respect a mme fait longtemps hsiter notre main, - Ricardo a confondu une diminution dans la valeur des produits avec une diminution des profits. Il a vu que, par la concurrence des producteurs, les inventions se succdent chaque jour dans le champ industriel, que les forces mcaniques se retrempent au contact de la science : il a vu que le gnie de lhomme, entassant ainsi les produits, luttait de prodigalit avec la nature elle-mme, et tendait faire des richesses sociales un fonds o les plus humbles vinssent puiser peu de frais ; et cet admirable travai1 d'galit, ce nivellement du bien-tre, il a cru qu'on ne pouvait l'accomplir qu'en retranchant des profits du manufacturier ce que l'on accordait, par l'abaissement du prix, au consommateur, par la hausse des salaires, aux classes laborieuses. Il na pas vu que c'est prcisment dans la salutaire action de ce double phnomne que reposent l'avenir de l'industrie et sa prosprit : car c'est ce double phnomne qui appelle la masse consommer les produits crs, et qui, par consquent, fait des besoins de tous un tat pour le travail de tous. Dire que parce qu'un fabricant fait ses ouvriers une part plus large dans la rpartition de la fortune publique il diminue d'autant son revenu et ses profits, c'est dire la fois une chose fausse et une chose dcourageante : - dcourageante, parce que, ou l'on introduirait la lutte et la haine dans les rangs des travailleurs, ou l'on condamnerait l'ouvrier un ilotisme barbare et des salaires minimes, ou l'on convierait le manufacturier une gnrosit impossible ; - fausse, en ce que plus une
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
42
marchandise diminue de valeur, plus elle appelle la consommation, et plu$ elle appelle la consommation plus les bnfices da fabricant se grossissent. Ne nions pas, ne refusons pas, surtout, par amour pour les abstractions, ce miracle perptuel de la production, qui appelle les plus humbles la vie physique, comme les appelait le Christ la vie morale. Quoi qu'on fasse ou dise, on n'chappera pas la force des choses ; et la force des choses veut que le capital ne se dpouille pas en faveur du travail, et qu'avant d'attenter ses profits, il prlve sur les salaires ce que l'tat du march ne peut plus lui donner. Si donc on voit un manufacturier hausser le prix de la maind'uvre, on peut tre sr que ses inventaires ont un aspect rassurant, que ses ateliers sont en pleine activit. Lorsque l'or s'coule en minces filets au profit des ouvriers, on peut tre convaincu qu'il coule larges flots dans la caisse des chefs d'industrie, et je ne sache pas un seul exemple o l'on ait vu les salaires grandir au sein d'une industrie languissante. Mais, dira-t-on, ne voyez-vous pas le taux de l'intrt s'abaisser de toutes parts, tandis que s'lve au contraire, avec la valeur des forces humaines, celle des subsistances. Ne voyezvous pas que le producteur hrite des dpouilles du capitaliste, du propritaire, du rentier, et que, dans ce dplacement de la richesse ; les caisses des uns s'emplissent aux dpens des caisses des autres ? Je reconnais facilement la dcadence du rentier et du .propritaire, cest--dire de l'lment oisif de la socit. Ils reprsentent des capitaux inertes qui doivent ncessairement perdre de leur prix au milieu de la multiplication gnrale des produits et des signes montaires : et 1eur fortune prsente mme quelque chose d'analogue ces monnaies qui s'usent par le frai, ou bien, - que l'on me permette cette comparaison peu conomique - des habits qui deviennent trop courts pour un corps que le temps dveloppe et grandit. Rien de plus juste et de plus naturel leur gard ; mais je nie positivement lautre partie de la proposition, celle qui veut envelopper sans la mme dchance toute cette classe des producteurs qui mettent en uvre leurs capitaux ; commanditent des industries, et font servir leurs sueurs d'hier fconder leurs sueurs du jour et du lendemain. Pour ceux-l, au contraire, le bien-tre saccrot, et il faudrait pousser bien loin lesprit de systme, pour mettre la position dun membre de la vnrable confrrie des merciers ou des drapiers du moyen-ge au-dessus de celle des manufacturiers puissants qui remuent des millions dans le Lancashire, Lyon, Mulhouse, et qui nous tonnent par le faste de leur existence. Sans doute les capitaux se sont multiplis linfini et sont alls, en spanchant sur le monde, fertiliser, comme de riches alluvions, les contres les plus pauvres, les plus striles sous le rapport industriel. Sans doute cette multiplication de la richesse a d en amener la dprciation ; sans doute, nous marchons vers une poque o les prodiges de la mcanique, commandite par le capital, feront de la chaussure, du vtement, de la nourriture, des choses presque aussi gratuites que lair, le ciel, le soleil, leau, llectricit : mais qui voudrait proscrire ces bienfaits, et qui ne voit, dailleurs, que si les valeurs sociales sont devenues plus nombreuses et ont baiss de prix, elles sont devenues, par cela mme, plus facilement accessibles ? Quimporte un capitaliste de voir dprir entre ses mains des richesses, si ces richesses se reproduisent linfini ; que lui importe de possder 100,000 fr., qui lui rapportent 10 p. %, ou 200,000 qui produisent un intrt de 5,000 fr. ; que lui importe encore de vendre, frais gaux, dix aunes de brocard 100 fr. ou vingt aunes 50 fr. ? Sa situation sera la mme, tandis que la socit en masse aura hrit de cette abondance qui sinfiltrera peu peu dans ses rangs les plus infimes. Dplorer cet avilissement des objets de consommation, ce serait donc dplorer la gratuit des rayons solaires, des forces naturelles, des fleuves ; ce serait mconnatre que la valeur est une chose abstraite, une vritable quation tablie entre les frais de production et la demande des diffrents produits, - rien de plus ; ce serait, en un mot, sacrifier la substance lattribut, la ralit lidal, et lcher niaisement la proie pour courir aprs lombre. Loin de sapitoyer sur la dprciation des capitaux, il faut donc, au contraire, sen rjouir au nom de toutes les classes de la socit ; car cette dprciation indique quils se sont multiplis, et cette multiplication indique quils se distribuent un plus grand nombre dindividus. Qui dit valeur excessive dun produit, dit monopole, consommation, restreinte, et par consquent, industrie sans dbouchs, sans profits ; qui dit valeur infime, dit consommation gnrale, et par suite, industrie florissante, sappuyant sur ces bases solides qui sont les besoins de tous. Si bien que lpoque la plus prospre pour la socit sera celle o les ateliers, sans cesse en activit, produiront avec une sorte de fivre ; o le travail, partout recherch, obtiendra de forts salaires ; o les produits, inondant les marchs, sy vendront assez bas prix pour que les plus pauvres y puissent atteindre, et assureront ainsi aux manufacturiers la clientle des masses, la seule qui, en ralit, puisse commanditer srement une entreprise. Voil les conclusions auxquelles et t conduit Ricardo sil et tudi de plus prs les faits et en et fait
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
43
grand nombre de riches commerants sont verss dans la mme branche de commerce, leur concurrence mutuelle tend naturellement en faire baisser les profits ; et quand les capitaux se sont pareillement grossis dans tous les diffrents commerces tablis dans la socit, la mme concurrence doit produire le mme effet dans tous. Adam Smith parle ici dune hausse des salaires, mais cest dune hausse momentane, provenant de laccroissement des fonds avant quil y ait accroissement de population ; et il parat ne pas stre aperu qu mesure que le capital grossit, louvrage que ce capital doit faire excuter augmente dans la mme proportion. Cependant M. Say a prouv de la manire la plus satisfaisante, quil ny a point de capital, quelque considrable quil soit, qui ne puisse tre employ dans un pays, parce que la demande des produits nest borne que par la production. Personne ne produit que dans lintention de consommer ou de vendre la chose produite, et on ne vend jamais que pour acheter quelque autre produit qui puisse tre dune utilit immdiate, ou contribuer la production future. Le producteur devient donc consommateur de ses propres produits, ou acheteur et consommateur des produits de quelque autre personne. Il nest pas prsumable quil reste longtemps mal inform sur ce quil lui est plus avantageux de produire pour atteindre le but quil se propose, cest--dire, pour acqurir
une analyse plus nette, plus exacte. Il net pas abouti dire que les profits doivent aller toujours en sabaissant ; dplorer la surabondance et lavilissement des capitaux : il neut pas surtout prt lautorit de son nom, de sa forte intelligence, aux sectes sans nombre qui se sont abattues avec fureur sur lconomie politique, pus lui arracher, sous forme de formules dangereuses et dsespres, un acte dabdication. Dernirement encore, un crivain, limagination brillante, qui excelle parer le clinquant de ses paradoxes dun style puissant et color ; un penseur qui, plong dans les abstractions transcendantales, ne saperoit pas que dans les sciences comme dans la nature, force de vouloir slever et planer, on arrive des rgions o le vide se forme, et o lair manque aux poumons, comme la nettet lintelligence ; M. Proudhon, -pour le nommer deux fois, - a rang cette dprciation graduelle et fatale des produits et des valeurs au nombre de ce quil veut bien appeler les contradictions conomiques. Il sest extasi sur cette divergence de phnomnes, qui veut que tandis que la socit senrichit par la multiplication des produits, elle sappauvrisse par la dpression de leur valeur : et il a creus cette anomalie, ou cette autonomie prtendue, avec un acharnement quil a pris pour de la profondeur, et qui est tout simplement de la navet. Il na pas vu, dune part, que ce jeu des richesses sociales est la chose du monde la plus simple, la plus naturelle, et que la base de toutes les valeurs tant, ici-bas, le travail, il est vident, il est fatal que moins les frais de production dune marchandise seront levs, plus flchira son prix courant, plus elle sera demande, et plus la production sagitera pour la rpandre de toutes parts. Il na pas vu ensuite, ce qui tait bien plus important et plus visible encore, que la socit senrichit, loin de sappauvrir, ds que la valeur des choses sabaisse, parce que cet abaissement est le signe de leur abondance. Loin donc quil y ait anomalie dans cette grande loi de la valeur, il sy trouve une harmonie salutaire, pleine denseignement, et quon ne peut mconnatre qu force darguties, de logomachie et de systmes systmatiques. Dans le fait, ce nest pas de valeurs que vit la socit ; cest de bl, de vtements, de meubles, et plus ces choses sont bas prix, plus une socit doit tre rpute opulente, parce que plus elle est mme den distribuer les bienfaits tous ses membres. La tendance actuelle de notre poque, de notre industrie, est prcisment de raliser ce beau programme, et de crer, pour ainsi dire, la dmocratie des prix et des produits, au profit du consommateur, qui paiera moins cher les marchandises, - de louvrier, dont le travail deviendra plus prcieux, - du capitaliste, qui verra grandir ses dbouchs. Quon mette, dailleurs, pour plus de scurit dans le raisonnement, lAngleterre, la France, lAllemagne, la Hollande, qui comptent par milliards des richesses dont lintrt sarrte 6, 5, 4, 3, ou mme 2 p. % ; quon mette ces grandes nations en face de ces peuples o de maigres capitaux provoquent lusure, et donnent des revenus douteux de 10, 20 ou 25 p. % ; quon fasse cette comparaison, et, quoiquen dise Ricardo , aid de M. Proudhon, le choix ne sera pas douteux. A. F.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
44
dautres produits. Il nest donc pas vraisemblable quil continue a produire des choses pour lesquelles il ny aurait pas de demande 1. Il ne saurait donc y avoir dans un pays de capital accumul, quel quen soit le montant, qui ne puisse tre employ productivement, jusquau moment o les salaires auront tellement hauss par leffet du renchrissement des choses de ncessit, quil ne reste plus quune part trs-faible pour les profits du capital, et que, par l, il ny ait plus de motif pour accumuler 2. Tant que les profits des capitaux seront levs, les particuliers auront un motif pour accumuler. Tant quun individu prouvera le dsir de satisfaire une certaine jouissance, il aura besoin de plus de marchandises, et la demande sera effective ds quil aura une nouvelle valeur quelconque offrir en change pour ces marchandises. Si on donnait 10,000 1. st. un homme qui en possde dj 100,000 1. de rente, il ne les serrerait pas dans son coffre ; il augmenterait sa dpense de 10,000 1. ; il les emploierait dune manire productive, ou il prterait cette somme quelque autre personne pour cette mme fin. Dans tous les cas, la demande saccrotrait, mais elle porterait sur des objets divers. Sil augmente sa dpense, il est probable quil emploiera son argent des constructions, des meubles, ou tout autre objet dagrment. Sil emploie ses 10,000 1. dune manire productive, il consommera plus de subsistances, dobjets dhabillement et de matires premires, qui serviraient mettre luvre de nouveaux ouvriers. Ce serait toujours une demande 3.
1
Adam Smith cite la Hollande comme un exemple de la baisse des profits provenant de laccumulation des capitaux et de la surabondance de capital affect chaque emploi. Le gouvernement hollandais emprunte 2 pour cent, et les particuliers qui ont bon crdit 3 pour cent. Mais il aurait fallu considrer que la Hollande est oblige dimporter presque tout le bl quelle consomme, et quen mettant de forts impts sur les objets ncessaires louvrier, elle augmente encore les salaires du travail. Ces faits expliquent assez le taux peu lev des profits et de lintrt en Hollande. Lexpression suivante est-elle tout--fait daccord avec le principe pos par M. Say ? Plus les capitaux disponibles sont abondants en proportion de ltendue des emplois, et plus on voit baisser lintrt des capitaux prts. Liv. II, chap. 8. Si des capitaux, quelque considrables quil soient, peuvent toujours trouver de lemploi dam un pays, comment peut-on dire quils sont abondants, compars avec ltendue de lemploi quils peuvent trouver ? (Note de lAuteur.) M. Ricardo tire ici une consquence parfaitement juste du principe tabli dans mon Trait dconomie politique, et il explique dune manire qui me parat trs-satisfaisante la baisse des profits-capitaux, ou intrts, mesure que les capitaux saccroissent, quoique les emplois se multiplient avec les capitaux. Il est galement certain que jai eu tort de dire que les capitaux peuvent tre plus ou moins abondants par rapport ltendue des emplois, ayant prouv ailleurs que les emplois se multiplient en proportion de labondance des capitaux. Les seuls cas o lobservation que jai faite aprs Smith pourrait tre relle, seraient ceux o la production est rendue si dsavantageuse, soit en raison des impts, ou par toute autre cause, quaucun produit ne vaut les sacrifices quil faudrait faire pour lobtenir. Il y a bien certainement des produits qui ne se font pas, par la raison que leur prix-courant est infrieur aux frais de leur production. Ne peut-on pas supposer ce cas pour un si grand nombre de produits, que le nombre des emplois de capitaux et de facults industrielles en soient considrablement rduits ? Adam Smith dit que, quand le produit dune branche particulire dindustrie excde ce quexige la demande du pays, il faut bien quon envoie le surplus ltranger pour lchanger contre quelque chose qui soit en demande dans lintrieur. Sans cette exportation une partie du travail productif du pays viendrait a cesser, et la valeur de son produit annuel diminuerait ncessairement. La terre et le travail de la GrandeBretagne produisent en gnral plus de bl, de lainages et de quincailleries que nen exige a demande du march intrieur. Il faut donc exporter le surplus et lchanger contre quelque chose dont il y ait demande dans le pays. Ce nest que par le moyen de lexportation que ce surplus pourra acqurir une valeur suffisante pour compenser le travail et la dpense quil en cote pour le produire. On serait tent de croire, daprs ce
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
45
On nachte des produits quavec des produits, et le numraire nest que lagent au moyen duquel lchange seffectue. Il peut tre produit une trop grande quantit dune certaine denre, et il peut en rsulter une surabondance telle dans le march, quon ne puisse en retirer ce quelle a cot ; mais ce trop plein ne saurait avoir lieu pour toutes les denres. La demande de bl est borne par le nombre de bouches qui doivent le manger ; celle des souliers et des habits, par le nombre des personnes qui doivent les porter ; mais quoique une socit, ou partie dune socit, puisse avoir autant de bl et autant de chapeaux et de souliers quelle peut ou quelle veut en consommer, on ne saurait en dire autant de tout produit de la nature ou de lart. Bien des personnes consommeraient plus de vin, si elles avaient le moyen de sen procurer. Dautres, ayant assez de vin pour leur consommation, voudraient augmenter la quantit de leurs meubles, ou en avoir de plus beaux. Dautres pourraient vouloir embellir leurs campagnes, ou donner plus de splendeur leurs maisons. Le dsir de ces jouissances est inn dans lhomme ; il ne faut quen avoir les moyens ; et un accroissement de production peut, seul, fournir ces moyens. Avec des subsistances et des denres de premire ncessit ma disposition, je ne manquerai pas longtemps douvriers dont le travail puisse me procurer les objets qui pourront mtre plus utiles ou plus dsirables. La baisse ou la hausse de profits, que cet accroissement de production et la demande qui en est la suite pourront occasionner, dpend uniquement de la hausse des salaires ; et la hausse des salaires, except pendant un temps limit, tient la facilit de produire les subsistances et les choses ncessaires a louvrier. Jai dit, pendant un temps limit, car il ny a rien de mieux tabli que ce principe, suivant lequel la quantit des ouvriers doit toujours, en dernire, analyse, se proportionner aux moyens de les payer. Il ny a quun seul cas, et celui-l nest que temporaire, dans lequel laccumulation du capital, accompagne du bas prix des subsistances, peut amener une baisse des profits ; ce cas est celui o les fonds destins faire subsister les ouvriers saccroissent plus vite que la population. Dans ce cas, les salaires seront forts et les profits faibles. Si tout le monde renonait lusage des objets de luxe, et ne songeait qu accumuler, il pourrait tre produit une quantit dobjets de ncessit, dont il ne pourrait pas y avoir de consommation immdiate. Il pourrait sans doute y avoir alors un engorgement gnral de ces produits, et par consquent il se pourrait quil ny et ni demande pour une quantit additionnelle de ces articles, ni profits esprer par lemploi dun nouveau capital. Si on cessait de consommer, on cesserait de produire, et cette concession nest pas en opposition avec le principe gnral. Dans un pays tel que lAngleterre, par exemple, il est difficile de supposer quil puisse y
passage, quAdam Smith en concluait que nous sommes dans la ncessit de produire un excdant de bl, dtoffer de laine et de quincailleries, et que le capital employ leur production ne saurait ltre dune autre manire. On a cependant toujours le choix de 1empioi donner son capital, et par consquent il ne peut jamais y avoir pendant longtemps excdant dun produit quelconque ; car, si cela tait, il tomberait audessous de son prix nature1, et le capital passerait un autre emploi plus lucratif. Il ny a pas dcrivain qui ait montr dune manire plus satisfaisante et plus habile que le docteur Smith la tendance quont les capitaux de quitter des emplois dans lesquels les produits ne suffisent pas payer tous les frais de production et de transport en y joignant les profits ordinaires. (Note de lAuteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
46
avoir de motif qui dtermine les habitants consacrer tout leur capital et leur travail la production exclusive des choses de premire ncessit. Quand des commerants placent leurs capitaux dans le commerce tranger ou de transport, cest toujours par choix, et jamais par ncessit. Ils ne le font que parce que leurs profits, dans ce commerce, sont un peu au-dessus de ceux du commerce intrieur. Adam Smith a observ, avec raison, que le besoin de nourriture tait, dans chaque individu, limit par la capacit borne de lestomac de lhomme ; mais que le dsir des choses commodes ou des objets de dcoration et dornement pour les difices, lhabillement, les quipages ou lameublement, parat navoir point de bornes ou de limite certaine. La nature a donc ncessairement limit la somme des capitaux qui peut, une poque quelconque, tre consacre avec profit lagriculture ; mais elle na point pos de limites la somme de capita1 qui peut tre consacre nous procurer les choses utiles lexistence, et propres lembellir. Nous procurer le plus grand nombre possible de ces jouissances, voil le but que nous nous proposons, et cest uniquement parce que le commerce tranger, ou celui de transport, parvient mieux ce but, que les commerants lentreprennent de prfrence la fabrication des objets dsirs, ou de ceux qui peuvent les remplacer dans le pays mme. Si, cependant, des circonstances particulires nous empchaient de placer nos capitaux dans le commerce tranger ou dans celui de transport, nous serions obligs de les employer, quoique moins avantageusement, chez nous ; et tant quil ny a point de limites au dsir de possder des choses commodes, des objets dornement pour les difices, lhabillement, les quipages et lameublement, il ne saurait y avoir dautres limites aux capitaux qui peuvent tre employs pour nous procurer ces objets, que celles des subsistances destines aux ouvriers qui doivent les produire. Adam Smith dit cependant que le commerce de transport nest point un commerce de choix, mais de ncessit ; comme si le capital qui y est vers ft rest strile sans un pareil emploi ; comme si le capital employ au commerce intrieur pouvait regorger sil ntait contenu dans de certaines limites. Quand la masse des capitaux dun pays, dit-il, est parvenue un tel degr daccroissement, quelle ne peut tre toute employe fournir la consommation de ce pays, et faire valoir son travail productif, alors le superflu de cette masse se dcharge naturellement dans le commerce de transport, et est employ rendre le mme service des pays trangers. On achte, avec une partie du produit superflu de lindustrie de la Grande-Bretagne, environ quatre-vingt-seize mille quarters de tabac dans la Virginie et le Maryland. Or, la demande de la Grande-Bretagne nen exige peut-tre pas plus de quatorze mille. Ainsi, si les quatre-vingt-deux mille restant ne pouvaient tre exports et changs contre quelque chose de plus demand dans le pays, limportation de cet excdant cesserait aussitt, et, avec elle, le travail productif de tous ceux des habitants de la Grande-Bretagne qui sont maintenant employs prparer les marchandises avec lesquelles ces quatre-vingt-deux mille quarters sont achets tous les ans. Mais cette portion du travail productif de la Grande-Bretagne ne pourrait-elle pas tre employe prparer des marchandises dune diffrente espce, avec lesquelles on aurait la facult dacheter quelque chose qui serait plus demand dans le pays ?
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
47
Et quand mme cela serait impossible, ne pourrait-on pas, quoique avec moins davantage, employer ce travail productif fabriquer les articles demands dans le pays, ou du moins en fournir dautres qui pussent les remplacer ? Si nous avions besoin de velours, ne pourrait-on pas essayer den faire ; et si nous ne pouvions pas y russir, ne serait-il pas possible de fabriquer plus de drap, ou quelque autre objet qui serait notre convenance ? Nous fabriquons des marchandises, et avec ces marchandises nous en achetons dautres ltranger, parce que nous pouvons nous les y procurer meilleur compte que si nous les fabriquions chez nous. Quon nous prive de ce commerce, et linstant nous fabriquerons de nouveau ces articles pour notre usage. Dailleurs cette opinion dAdam Smith est en contradiction avec toute sa doctrine gnrale sur cette matire. Si un pays tranger peut nous fournir une marchandise meilleur march que nous ne sommes en tat de le faire nousmmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions avec les produits de quelque industrie o nous excellions. Lindustrie gnrale du pays tant toujours en proportion du capital qui la met en uvre, elle ne sera pas diminue pour cela ; ... seulement ce sera elle chercher la manire dont elle peut tre employe son plus grand avantage. Et dans une autre endroit : Par consquent, ceux qui peuvent dis poser dune plus grande quantit de vivres quils ne peuvent en consommer, sont toujours prts donner ce surplus, ou, ce qui revient au mme, sa valeur en change dun autre genre de jouissances. Tout ce qui reste aprs avoir satisfait des besoins ncessairement limits, est donn pour flatter ces dsirs que rien ne saurait satisfaire, qui paraissent tout fait insatiables. Les pauvres, pour avoir de la nourriture, travaillent satisfaire les fantaisies des riches ; et, pour tre plus srs dobtenir cette nourriture, ils enchrissent lun sur lautre qui travaillera meilleur march, et qui mettra plus de perfection sou ouvrage. Le nombre des ouvriers saccrot par labondance de vivres, ou par les amliorations croissantes dans la culture des terres ; et comme la nature de leurs occupations est susceptible de la plus grande division de travail, la quantit de matires quils peuvent consommer augmente dans une proportion beaucoup plus forte que le nombre des ouvriers. De la nat une demande de toute sorte de matires que lindustrie des hommes peut employer en objets dutilit ou dornement, en habillements, quipages, ameublements, substances fossiles, minraux renferms dans le sein de la terre, et mtaux prcieux. Il rsulte donc de ces dveloppements quil nest pas de limites pour la demande, pas de limites pour lemploi du capital, toutes les fois que le capital donne quelques profits et que ces profits ne peuvent baisser que par suite de la hausse des salaires. Enfin rajouterai que la seule cause qui fasse hausser constamment les salaires, cest la difficult toujours croissante de se procurer de la nourriture et des objets de premire ncessit pour le nombre chaque jour croissant des ouvriers. Adam Smith a observ, avec raison, quil est extrmement difficile de fixer le taux des profits des capitaux. Le profit est sujet des variations telles, dit-il, que mme dans un commerce particulier, et plus forte raison dans les diffrentes branches de commerce en gnral, il serait difficile den dterminer le terme moyen ..... Et quant prtendre juger avec une certaine prcision de ce quil peut avoir t des poques antrieures, cest ce qui doit tre absolument impossible. Cependant, puisquil est vident quon paie cher la facult de
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
48
se servir de largent, toutes les fois que par son moyen on peut gagner beaucoup, il croit que le taux ordinaire de lintrt sur la place peut nous conduire nous former quelque ide du taux des profits, et que lhistoire des progrs de lintrt peut nous donner celle du progrs des profits. Certes, si le taux de lintrt pouvait tre connu avec prcision pendant une poque un peu considrable, il pourrait nous fournir une mesure assez exacte pour estimer le progrs des profits. Mais dans tous les pays, par suite de fausses notions en conomie politique, les gouvernements sont intervenus, pour empcher que le taux de lintrt ne stablt dune manire libre et quitable, en imposant de grosses et excessives amendes sur tous ceux qui prendraient un intrt au-dessus de celui fix par la loi. On lude probablement partout de semblables lois ; mais lhistoire nous apprend peu de choses ce sujet, et les crivains nous indiquent plutt lintrt fix par les lois, que son taux courant. Pendant la dernire guerre, les billets de lchiquier et de la marine, en Angleterre, ont prouv une perte telle, quen les achetant on a pu retirer 7 et 8 pour cent, ou mme un plus fort intrt de son argent. Le gouvernement a ngoci des emprunts un intrt au-dessus de 6 pour cent, et des particuliers se sont souvent vus forcs de payer, par des voies indirectes, plus de 10 pour cent pour lintrt de largent ; et nanmoins, pendant tout ce temps, lintrt lgal tait toujours au taux de 5 pour cent. Il y a donc fort peu de fond faire sur ce que les historiens peuvent dire de lintrt fixe et lgal, puisque nous voyons jusqu quel point il peut tre diffrent du taux courant. Adam Smith nous apprend que, depuis la trente-septime anne du rgne de Henri VIII jusqu la vingtime anne de Jacques Ier, le taux lgal de lintrt demeura 10 pour cent. Peu de temps aprs la restauration, il fut rduit 6 pour cent ; et, par le statut de la douzime anne de la reine Anne, 5 pour cent. Il croit que lintrt lgal a suivi, et non prcd le taux courant de lintrt. Avant la guerre dAmrique, le gouvernement anglais empruntait 3 pour cent, et dans la capitale, ainsi que dans beaucoup dautres endroits du royaume, les gens qui avaient bon crdit empruntaient 3 _, 4 et 4 _ pour cent. Le taux de lintrt, quoiquil soit en dernire analyse, et dune manire stable, dtermin par le taux des profits, est cependant sujet prouver des variations temporaires par d'autres causes. A la suite de chaque fluctuation dans la quantit et la valeur de l'argent, le prix des denres doit naturellement varier. Il varie encore, ainsi que nous l'avons dj fait voir, par le changement dans les rapports entre l'offre et la demande, quoique la production ne soit ni plus ni moins aise. Quand le prix courant des marchandises baisse par l'effet d'un approvisionnement abondant, d'une moindre demande ou d'une hausse dans la valeur de l'argent, un manufacturier garde en magasin une quantit extraordinaire de marchandises prtes pour la vente, plutt que de les livrer vil prix. Et pour faire face ses engagements, pour le paiement desquels il comptait auparavant sur la vente de ses articles, il est oblig d'emprunter crdit, et souvent un taux d'intrt plus lev. Cela, cependant, n'a qu'une courte dure ; car, ou l'espoir du manufacturier est fond, et le prix courant de ses marchandises montera; ou bien il s'aperoit que la diminution de la demande est permanente, et alors il ne cherche plus rsister la direction que le commerce a prise ; les prix baissent, et l'argent ainsi que l'intrt reprennent leur ancien taux. Si, par la dcouverte d'une nouvelle mine, par l'abus des
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
49
banques ou par toute autre cause, la quantit de la monnaie augmente considrablement, son effet dfinitif est d'lever le prix des choses en proportion de l'accroissement de la monnaie ; mais il y a probablement toujours un intervalle pendant lequel le taux de lintrt subit quelque variation. Le prix des fonds publics n'est pas un indice certain pour estimer le taux de l'intrt. En temps de guerre, le march est si surcharg de rentes sur ltat, par suite des emprunts continuels que fait le gouvernement, qu'avant que le prix de la rente ait eu le temps de prendre son juste niveau, une nouvelle opration financire ou des vnements politiques changent toute la situation. En temps de paix, au contraire, l'action du fonds d'amortissement, la rpugnance qu'prouve une certaine classe de gens donner leurs fonds un emploi autre que celui auquel ils sont habitus, qu'ils regardent comme trs-sr, et dans lequel les dividendes leur sont pays avec la plus grande rgularit ; toutes ces causes font monter les rentes sur l'tat, et abaissent par consquent le taux de l'intrt sur ces valeurs au-dessous du prix courant sur la place. Il faut observer encore que le gouvernement paie des intrts diffrents, selon la solidit de ses rentes. Pendant que le capital plac dans les 5 pour cent se vend 95 1. st., un billet de 1'chiquier de 100 liv. vaudra quelquefois 100 1. 5 sh., quoiquil ne porte que 4 1. 11 sh. 3 d. dintrt annuel. Lun de ces effets rapporte lacheteur, aux prix mentionns, un intrt de 5 _ pour cent ; lautre ne rapporte que 4 _. Les banquiers ont besoin dune certaine quantit de ces billets dchiquier, comme offrant un placement sr et ngociable. Si leur quantit dpassait de beaucoup cette demande, ils se trouveraient aussi bas que les 5 pour cent. La rente 3 pour cent par au aura toujours, comparativement, un prix plus haut que celle 5 pour cent ; car le principal de lune comme de lautre ne peut tre rembours quau pair, cest--dire, en donnant 100 1. st. en argent pour 100 1. st. de capital en rentes. Le prix courant de lintrt sur la place peut tomber 4 pour cent, et, dans ce cas, le gouvernement rembourserait au possesseur des 5 pour cent son capital au pair, moins quil ne consentt recevoir 4 pour cent, ou un intrt au-dessous de 5 pour cent. Le gouvernement ne retirerait aucun avantage de rembourser ainsi le possesseur des 3 pour cent, tant que le taux courant de lintrt ne serait pas descendu au-dessous de 3 pour cent par an. Pour payer les intrts de la dette nationale, lon retire quatre fois par an, et pendant peu de jours, de grandes sommes de monnaie de la circulation. Ces demandes de monnaie, ntant que temporaires, ont rarement de leffet sur les prix ; elles sont, en gnral, remplies moyennant le paiement dun taux plus lev dintrt 1.
1
Toute espce demprunt public, dit M. Say *, a linconvnient de retirer des usages productifs des capitaux ou des portions de capitaux pour les dvouer la consommation ; et de plus, quand ils ont lieu dans un pays dont le gouvernement inspire peu de confiance, ils ont linconvnient de faire monter lintrt des capitaux. Qui voudrait prter 5 pour Cent par an lagriculture, aux fabriques, au commerce, lorsquon trouve un emprunteur toujours prt payer un intrt de 7 8 pour cent ? Le genre de revenu qui se nomme profit des capitaux slve alors aux dpends du consommateur. La consommation se rduit par le renchrissement des produits, et les autres services productifs sont moins demands, moins bien rcompenss ; la socit, les capitalistes excepts, souffre de cet tat de choses. A la question, qui voudrait prter 5 pour cent par an lagriculture, aux fabriques, au commerce, lorsquon trouve un emprunteur toujours prt payer un intrt de 7 8 pour cent ? je rponds : tout homme prudent et sens. Parce que le taux de lintrt est 7 ou 8 pour cent l o le prteur court un risque extraordinaire, y a-t-il une raison pour quil soit aussi haut dans les endroits o les prteurs sont labri de pareils risques ? M. Say convient que le taux de lintrt tient celui
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
50
Chapitre XXII.
DES PRIMES LEXPORTATION ET DES PROHIBITIONS A LIMPORTATION.
Table des matires
Une prime accorde lexportation du bl tend en abaisser le prix pour le consommateur tranger, mais na point deffet permanent sur son prix dans les marchs de lintrieur. Supposons que, pour retirer des capitaux les profits ordinaires, il soit ncessaire que le bl se vende en Angleterre 4 1. st. le quarter ; dans ce cas, il mie pourrait tre export dans les pays trangers o il ne se vendrait que 3 1. 15 sh. Mais si lon donnait 10 sh. par quarter de prime dexportation, on pourrait le vendre, dans le march tranger, 3 1. 10 sh., et par cons-
des profits; mais il ne sensuit pas que le taux des profits dpende du taux de lintrt ; lun est la cause, lautre leffet, et il est impossible que des circonstances quelconques puissent les faire changer de place. (Note de lAuteur.) * conom. Politiq. Liv. III, chap. 9.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
51
quent il en rsulterait le mme profit pour le cultivateur de bl, soit quil le vendit 3 l. 10 sh. dans le march tranger, ou 4 1. dans le pays mme. Une prime qui ferait donc baisser le prix du bl anglais, dans un pays tranger, au-dessous de ce quy cote la production du bl, aurait naturellement pour effet daugmenter la demande de bl anglais, en diminuant celle des bls du pays. Ce surcrot de demande de bl anglais ne saurait manquer den faire hausser le prix en Angleterre, et de lempcher de baisser, sur le march tranger, jusquau taux o la prime tend le faire descendre. Mais les causes qui pourraient agir de la sorte sur le prix courant du bl en Angleterre, nauraient pas le moindre effet sur son prix naturel, ou sur les frais rels de production. Pour rcolter du bl, il ny aurait besoin ni de plus de bras ni de plus de fonds, et par consquent, si les profits du capital du fermier ntaient auparavant quen galit avec ceux des capitaux des autres commerants, aprs la hausse des prix ils les surpasseraient considrablement. En grossissant les profits du fermier, la prime agira comme un encouragement lagriculture, et le capital employ en manufactures en sera retir pour tre employ sur les terres jusqu ce quon ait fait face laccroissement des demandes extrieures. Quand cela sera arriv, le prix du bl tombera de nouveau, dans le march de lintrieur, son prix naturel et forc, et les profits reviendront leur niveau accoutum. Un approvisionnement plus abondant, agissant de mme dans le march tranger, fera aussi baisser le prix du grain dans le pays o il est export, et, par l , les profits du ngociant qui l'exporte se trouveront rduits au taux le plus bas auquel il puisse faire ce commerce. L'effet d'une prime d'exportation sur le bl n'est donc, en dernier rsultat, ni d'en lever ni d'en abaisser le prix dans le march intrieur, mais bien de faire baisser le prix du bl, pour le consommateur tranger, de tout le montant de la prime, dans le cas o le bl n'aurait pas t plus bas prix dans le march tranger que dans celui de l'intrieur ; et de le faire baisser dans une proportion moindre, dans le cas o le prix dans l'intrieur aurait t plus lev que celui du march tranger. Un crivain, en traitant, dans le cinquime volume de la Revue d'dimbourg, des primes pour l'exportation du bl, a trs-clairement fait voir quels en taient les effets sur la demande de l'tranger et de l'intrieur. Il a aussi observ avec raison que ces primes ne pouvaient manquer d'encourager l'agriculture du pays qui exporte ; mais il parait imbu de la mme erreur qui a gar le docteur Smith, et, je crois, la plupart des autres auteurs qui ont trait de cette matire. Il suppose que, parce que c'est le prix du bl qui rgle, en dernier rsultat, les salaires, c'est aussi ce mme prix qui doit rgler celui de toutes les autres choses. Il dit que la prime, en augmentant les profits du fermier, servira d'encouragement l'agriculture; en faisant monter le prix du bl pour les consommateurs nationaux, elle diminuera pendant ce temps leurs facults d'acheter cet objet de premire ncessit, et rduira ainsi leur richesse relle. Il est cependant vident que ce dernier effet ne peut tre que temporaire ; car les salaires des consommateurs industrieux ayant t auparavant rgls par la concurrence, ce mme principe les ramnera encore aux mmes proportions, en faisant hausser le prix en argent du travail, et, par ce moyen, celui des autres denres jusqu'au niveau du prix en argent du bl. La prime d'exportation fera donc, en dernier rsultat, hausser le prix en argent du bl dans le march du pays, non pas directement, mais au moyen de l'accroissement de demande
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
52
dans le march tranger, et du renchrissement qui s'ensuit dans la prix rel du pays ; et cette hausse du prix en argent, quand une fois elle se sera tendue aux autres denres, deviendra par consquent permanente. Si jai cependant russi faire voir que le surhaussement des salaires en argent ne fait pas monter le prix des produits, mais quun tel surhaussement affecte toujours les profits, il doit sensuivre que le prix des produits ne montera pas par leffet de la prime. Mais une hausse temporaire dans le prix du bl, occasionne par une plus forte demande de ltranger, ne produirait aucun effet sur le prix en argent des salaires. Le renchrissement du bl est caus par une concurrence de demande pour cet article, dont lapprovisionnement tait auparavant exclusivement destin au march national. Par leffet de la hausse des profits, il y a plus de capitaux employs dans lagriculture, et lon obtient par l un surcrot dapprovisionnement ; mais tant quil nest pas obtenu, le haut prix en est absolument ncessaire pour rgler la consommation sur lapprovisionnement, ce que la hausse des salaires empcherait. Le renchrissement du bl est la suite de sa raret, et cest ce qui en fait diminuer la demande par les acheteurs nationaux. Si les salaires montaient, la concurrence augmenterait, et un nouveau surhaussement du prix du bl deviendrait ncessaire. Dans cet expos des effets produits par les primes dexportation, nous navons point suppos dvnement qui fit hausser le prix naturel du bl, lequel prix rgle, en dernire analyse, son prix courant ; car nous navons point suppos quil fallt un surcrot de travail pour forcer la terre donner une quantit dtermine de produits, et il ny a que cela qui puisse faire monter le prix naturel. Si le prix naturel du drap tait de 20 sh. par verge, une grande augmentation de demandes du dehors pourrait en faire monter le prix 25 sh., ou au del ; mais les profits que ferait alors le fabricant de drap ne manqueraient pas dattirer les capitaux vers cette fabrication ; et quoiquelle pt doubler, tripler ou quadrupler, elle finirait par tre satisfaite ; et le drap baisserait de nouveau son prix naturel de 20 sh. Il en arriverait autant pour ce qui concerne lapprovisionnement du bl. Quoique nous en exportions deux, trois ou huit cent mille quarters par an, il finirait par tre produit son prix naturel, lequel ne varie jamais, moins quune diffrente quantit de travail ne devienne ncessaire la production. Il ny a peut-tre pas, dans tout louvrage si justement clbre dAdam Smith, de conclusions plus susceptibles dtre contestes que celles quon lit dans le chapitre des primes dexportation. Il parle dabord du bl comme dune denre dont la production ne saurait saccrotre par leffet dune prime dexportation ; il suppose invariablement que la prime ninflue que sur la quantit dj produite, et quelle nencourage point une nouvelle production. Dans les annes dabondance, dit-il, la gratification, en occasionnant une exportation extraordinaire, tient ncessairement le prix du bl, dans le march intrieur, au-dessus du taux auquel il descendrait naturellement... Quoique la gratification soit souvent suspendue pendant les annes de chert, la grande exportation quelle occasionne dans les annes dabondance doit avoir souvent pour effet dempcher plus ou moins que labondance dune anne ne soulage la disette dune autre. Ainsi, dans les annes de chert, tout aussi bien que dans celles dabondance, la prime dexportation tend de mme, ncessairement, faire
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
53
monter le prix en argent du bl de quelque chose plus haut quil naurait t sans cela dans le march intrieur 1. Adam Smith parat avoir senti parfaitement que la justesse de son raisonnement dpendait uniquement de la question de savoir si laugmentation du prix en argent du bl, en rendant sa culture plus profitable au fermier, ne doit pas ncessairement en encourager la production. Je rponds, dit-il, que cela pourrait arriver si leffet de la prime tait de faire monter le prix rel du bl, ou de mettre le fermier en tat dentretenir, avec la mme quantit de bl, un plus grand nombre douvriers de la mme manire que sont communment entretenus les autres ouvriers du voisinage, largement, mdiocrement ou petitement. Si louvrier ne consommait que du bl, et sil nen recevait que ce qui suffirait strictement pour sa nourriture, il pourrait y avoir quelque raison de supposer que la part de louvrier ne peut en aucun cas tre rduite ; mais les salaires en argent ne montent quelque fois pas, et jamais ils ne montent proportionnellement aux prix en argent du bl, parce que le bl ne forme quune partie de la consommation de louvrier, - quoique ce soit la partie la plus importante. Si louvrier dpense la moiti de son salaire en bl, et lautre moiti en savon, en chandelle, en bois brler, en th, en sucre, en habillement, etc., tous objets que lon suppose ne pas avoir prouv de hausse, il est clair quil serait aussi bien pay avec un boisseau et demi de bl, lorsquil vaut 16 sch. le boisseau, quavec deux boisseaux, dont chacun ne vaudrait que 8 sch., ou avec 24 sch. en argent, qui quivaudraient 16 sch., quil recevait auparavant. Son salaire ne monterait que de 50 pour cent, tandis que le bl hausserait de 100 pour cent, et par consquent il y aurait un motif suffisant pour consacrer plus de capitaux lagriculture, si les profits des autres commerces continuaient tre les mmes quauparavant. Mais une telle hausse des salaires engagerait en mme temps les manufacturiers retirer leurs capitaux des manufactures, pour les consacrer lagriculture ; car tandis que le fermier augmenterait le prix de ses denres de 100 pour cent, les salaires de ses ouvriers nayant
1
Dans un autre endroit il sexprime de la manire suivante : Quelque extension que la prime puisse occasionner dans les ventes ltranger, dans une anne quelconque, cette extension se fait toujours entirement aux dpens de march intrieur, attendu que chaque boisseau de bl que la prime fait exporter, serait rest dans le marche intrieur, o il aurait augment dautant la consommation et fait baisser le prix de la denre. Il faut observer que la prime sur le bl, comme toute autre prime pour lexportation, tablit sur la nation deux impts diffrents : le premier est limpt auquel il faut quil contribue pour dfrayer la prime, et le second est limpt qui rsulte du prix renchri de la denre dans le march intrieur ; impt qui, pour cette espce particulire de marchandise, se paie par toute la masse du peuple, toute la masse devant ncessairement acheter du bl. Par consquent, lgard de cette marchandise en particulier, le second impt est de beaucoup le plus lourd des deux... Par consquent, par chaque 5 schellings pour lesquels le peuple contribue au paiement du premier de ces deux impts, il faut quil contribue pour 6 livres sterling et 4 schellings lacquittement du second ... Par consquent, lexportation extraordinaire de bl, occasionne par la prime, non-seulement resserre chaque anne le march et la consommation intrieure de tout ce dont elle tend le march et la consommation chez ltranger, mais encore par les entraves la population et lindustrie du pays, sa tendance, en dernier rsultat, est de gner et de comprimer lextension graduelle du march intrieur, et par l de diminuer la longue, bien loin de laugmenter, la consommation totale et le dbit du bl. (Note de 1Auteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
54
hauss que de 50 pour 100, le manufacturier se verrait aussi dans la ncessit de payer 50 pour cent de plus ses ouvriers, nayant en mme temps aucune compensation, pour ce surcrot de dpense, dans le renchrissement de ses produits. Les capitaux se porteraient donc, des manufactures vers lagriculture, jusqu ce que lapprovisionnement du bl ft de nouveau descendre les prix 8 sch. Le boisseau, et ft baisser les salaires 16 sch. par semaine. Alors le manufacturier obtiendrait les mmes profits que le fermier, et les capitaux, dans chaque emploi, se trouveraient balancs. Voil, dans le fait, la manire dont la culture du bl acquiert toujours plus dtendue, et fournit aux besoins croissants du march. Les fonds pour l'entretien des ouvriers augmentent, et les salaires haussent. L'tat d'aisance de l'ouvrier l'engage se marier, la population s'accrot, et la demande de bl en lve le prix relativement aux autres choses. Plus de capitaux sont employs profitablement dans l'agriculture et continuent y affluer, tant que l'approvisionnement n'gale pas la demande ; car alors le prix baisse de nouveau, et les profits de l'agriculteur et du manufacturier reviennent au mme niveau. Il n'est d'aucune importance pour la question qui nous occupe, que les salaires restent stationnaires aprs le renchrissement du bl, ou qu'ils montent modrment ou excessivement ; car le manufacturier aussi bien que le fermier paient des salaires, et ils doivent cet gard tre galement affects par la hausse du prix du bl. Mais leurs profits respectifs sont atteints d'une manire ingale, puisque le fermier vend ses denres plus cher, tandis que le manufacturier donne ses produits au mme prix qu'auparavant. C'est pourtant l'ingalit des profits qui engage les capitalistes dtourner leurs capitaux d'un emploi vers un autre ; il y aura par consquent une plus forte production de bl, et une moindre d'objets manufacturs. Les objets manufacturs ne monteraient pas de prix en raison de la moindre quantit qui en serait fabrique ; car on en obtiendrait un approvisionnement de l'tranger, en change du bl export. Lorsqu'une prime fait monter le prix du bl, ce prix peut tre ou ne pas tre lev, relativement celui des autres marchandises. Dans le cas o le prix relatif du bl hausse, il est hors de doute que le fermier fera de plus torts profits, et qu'il y aura un appt pour le dplacement des capitaux, tant que le prix du bl ne tombera pas de nouveau par l'effet d'un approvisionnement abondant. Si la prime ne fait point hausser le prix du bl relativement celui des autres marchandises, quel tort cela peut-il faire au consommateur national, part l'inconvnient de payer l'impt ? Si le manufacturier paie son bl plus cher, il en est indemnis par le plus haut prix auquel il vend les produits avec lesquels il achte en dfinitive le bl dont il a besoin. L'erreur d'Adam Smith provient de la mme source que celle de l'auteur de l'article de la Revue d'dimbourg, car ils croient tous deux que le prix en argent du bl rgle celui de tous les autres produits nationaux 1.
Il dtermine, dit Adam Smith, le prix en argent du travail, qui doit toujours ncessairement tre tel qu'il mette l'ouvrier en tat d'acheter une quantit de bl suffisante pour l'entretien de sa personne et de sa famille, selon que le matre qui le
1
Cest aussi lopinion de M. Say, Liv. III, chap. 8.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
55
met en uvre se trouve oblig par l'tat progressif, stationnaire ou dcroissant de la socit, de lui fournir cet entretien abondant, mdiocre ou chtif... En dterminant le prix en argent de toutes les autres parties du produit brut de la terre, il dtermine celui des matires premires de toutes les manufactures. En dterminant le prix en argent du travail, il dtermine celui de la main-d'uvre et de toutes les applications de l'industrie ; et en dterminant l'un et l'autre de ces prix, il dtermine le prix total de l'ouvrage manufactur. Il faut donc ncessairement que le prix en argent du travail, et de toute chose qui est le produit de la terre ou du travail, monte ou baisse en proportion du prix en argent du bl.
J'ai dj essay de rfuter cette opinion d'Adam Smith. En considrant la hausse du prix des choses comme une consquence ncessaire du renchrissement du bl, il raisonne comme s'il n'existait pas d'autre fonds qui pt fournir ce surcrot de dpense. Il a entirement nglig les profits qui crent ce fonds par leur diminution sans lever le prix des produits. Si cette opinion du docteur Smith tait fonde, les profits ne pourraient jamais tomber rellement, quelle que ft l'accumulation des capitaux. Si, lorsque les salaires haussent, le fermier pouvait renchrir son bl, et si le marchand de drap, le chapelier, le cordonnier, et tout autre fabricant pouvaient galement augmenter le prix de leurs marchandises en proportion du surhaussement des salaires, le prix de tous les produits de ces diffrents commerants pourrait bien hausser, si on l'estimait en argent ; mais relativement, il resterait le mme. Chacun de ces fabricants pourrait acheter la mme quantit de marchandises aux autres fabricants ; et puisque ce sont les marchandises, et non l'argent, qui constituent la richesse, le reste leur importerait fort peu. Tout le renchrissement des matires premires et des marchandises ne ferait de tort qu'aux seules personnes dont les fonds consisteraient en or ou en argent, ou dont le revenu annuel serait pay dans une quantit fixe de ces mtaux, sous la forme de lingots ou de numraire. Supposons l'usage des monnaies entirement abandonn, et tout commerce born des changes. Je demanderai si, dans un cas semblable, la valeur changeable du bl monterait par rapport aux autres produits ? Si lon rpond affirmativement, il nest donc pas vrai que ce soit la valeur du bl qui rgle la valeur des autres produits ; car, pour pouvoir en rgler la valeur, il faudrait que le bl ne changet pas de valeur relative par rapport ces produits. Si lon rpond ngativement, il faudra alors soutenir que le bl, quon le rcolte sur un sol fertile ou ingrat, avec beaucoup ou peu de travail, laide de machines ou sans leur secours, schangera toujours contre une quantit gale de tous les autres produits. Je dois cependant avouer que, quoique la teneur gnrale des doctrines dAdam Smith se rapporte lopinion que je viens de citer, il parat pourtant, dans le passage suivant de son livre, avoir eu une ide exacte de la nature de la valeur. La proportion entre la valeur de lor et de largent, et la valeur des marchandises dune autre espce quelconque, dpend dans tous les cas, dit-il, de la proportion quil y a entre la quantit de travail ncessaire pour amener au march une quantit dtermine dor et dargent, et celle qui est ncessaire pour y faire arriver une quantit dtermine de toute autre sorte de marchandises. Navoue-t-il pas ici pleinement que, si une quantit de travail plus considrable devient indispensable pour faire arriver au march une certaine marchandise, pendant quune autre peut y arriver sans
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
56
augmentation de frais, la premire haussera de valeur relative ? Sil fallait autant de travail pour porter du drap et de lor au march, la valeur relative de chacun de ces objets ne varierait pas ; mais sil fallait plus de travail pour faire arriver au march du bl ou des souliers, le bl et les souliers ne monteraient-ils pas relativement au drap et lor monnay ? Adam Smith regarde aussi les primes comme ayant pour effet de causer une dgradation dans la valeur de largent. Une dgradation de la valeur de largent, dit-il, qui est leffet de la fcondit des mines, et qui se fait sentir galement ou presque galement dans la totalit, ou peu sen faut, du monde commerant, est de trs-peu dimportance pour un pays en particulier. La hausse qui en rsulte dans tous les prix en argent ne rend pas plus riches ceux qui les reoivent, mais du moins elle ne les rend pas plus pauvres. Un service en argenterie devient rellement meilleur march ; mais toutes les autres choses, gnralement, restent exactement comme elles taient auparavant, quant leur valeur relle. Cette observation est on ne peut pas plus correcte.
Mais cette dgradation de la valeur de largent, qui, tant le rsultat ou de la situation particulire dun pays, ou de ses institutions politiques, na lieu que pour ce pays seulement, entrane des consquences tout autres ; et bien loin quelle tende rendre personne plus riche, elle tend rendre chacun plus pauvre. La hausse du prix en argent de toutes les denres et marchandises, qui, dans ce cas, est un fait particulier ce pays, tend y dcourager plus ou moins toute espce dindustrie au dedans, et mettre les nations trangres porte de livrer presque toutes les diverses sortes de marchandises pour moins dargent que ne le pourraient faire les ouvriers du pays, et, par l, de les supplanter, non-seulement dans les marchs trangers, mais mme dans leur propre march intrieur.
Jai essay de faire voir ailleurs quune diminution partielle de la valeur de largent, capable daffecter la fois les produits de lagriculture et ceux des manufactures, ne peut jamais tre permanente. Dire, dans ce sens, que largent prouve une dprciation partielle, cest comme si lon disait que tous les produits ont renchri ; mais tant quon aura la libert de les acheter avec de lor et de largent dans le march le moins cher, on les exportera en change des produits des autres pays qui sont meilleur march, et la diminution de la quantit de ces mtaux augmentera leur valeur dans lintrieur ; les marchandises reprendront leur niveau ordinaire, et celles qui conviennent aux marchs trangers seront exportes comme .par le pass. Ce nest donc pas l, je pense, une raison quon puisse allguer contre les prime. Si donc la prime faisait hausser le prix du bl comparativement aux autres choses, le fermier y trouverait du profit, et il y aurait plus de terres mises en culture ; mais si la prime ne changeait pas la valeur du bl relativement aux autres choses, dans ce cas, la prime ne pourrait avoir dautre inconvnient que celui consistant la payer, et cet inconvnient, je suis loin de chercher en dissimuler les effets ou en diminuer limportance.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
57
Il semble, dit le docteur Smith, que nos propritaires ruraux, en imposant sur limportation des bls trangers de gros droits qui, dans les temps dune abondance moyenne, quivalent une prohibition, et en tablissant les primes dexportation, aient pris exemple sur la conduite de nos manufacturiers. Par ces moyens, les uns comme les autres ont cherch faire monter la valeur de leurs produits. Peut-tre nont-ils pas fait attention la grande et essentielle diffrence tablie par la nature entre le bl et presque toutes les autres sortes de marchandises. Lorsquau moyen dun monopole dans le march intrieur, ou dune prime accorde lexportation, on met nos fabricants de toiles ou de lainages mme de vendre leurs marchandises un prix un peu meilleur que celui auquel ils les auraient donnes sans cela, on lve non-seulement le prix nominal, mais le prix rel de leurs marchandises ; on les rend quivalentes plus de travail et plus de subsistances ; on augmente non-seulement le profit nominal de ces fabricants, mais leur profit rel, leur richesse et leur revenu rels..... On encourage rellement ces manufactures.... Mais quand, laide de mesures semblables, vous faites hausser le prix nominal du bl et son prix en argent, vous nlevez pas sa valeur relle, le revenu rel de nos fermiers ni de nos propritaires ruraux ; vous nencouragez pas la production du bl. La nature des choses a imprim au bl une valeur relle, qui ne saurait changer par leffet dune simple variation de son prix en argent. Dans le monde entier, cette valeur sera gale la quantit de bras quelle peut faire subsister.
Jai dj tch de faire voir que le prix courant du bl doit, en raison de laugmentation de la demande par leffet dune prime dexportation, excder son prix naturel jusqu ce que lon obtienne le surcrot dapprovisionnement ; et, dans ce cas, il doit revenir son prix naturel. Mais le prix naturel du bl nest pas aussi stable que celui des autres marchandises, parce que, ds que la demande de bl augmente considrablement, il faut livrer la culture des terres dune qualit infrieure, qui, pour produire une quantit dtermine de bl, exigeront plus de travail, ce qui fera hausser le prix du bl. Leffet dune prime permanente sur lexportation du bl serait donc de le faire tendre constamment la hausse ; ce qui, comme je lai fait voir ailleurs, ne manque jamais de faire hausser la rente 1. Les propritaires ruraux ont donc un intrt non-seulement temporaire, mais permanent, aux prohibitions dimportation du bl, et aux primes accordes son exportation ; mais les manufacturiers nont point dintrt permanent aux primes dexportation de leurs produits manufacturs : leur intrt, cet gard, nest que temporaire. Des primes accordes lexportation des objets manufacturs ne peuvent manquer, ainsi que le docteur Smith le dit, de faire hausser le prix courant des objets manufacturs ; mais elles ne feront pas monter le prix naturel de ces objets. Le travail de deux cents hommes produira une quantit de marchandises double de celle que cent hommes pouvaient fabriquer auparavant ; et par consquent, aussitt que la somme ncessaire de capital aura t consacre fournir la quantit requise dobjets fabriqus, ils reviendront leur prix naturel. Ce nest donc que pendant cet intervalle qui suit la hausse du prix courant des denres, et qui prcde laccroissement de la production, que les manufacturiers peuvent faire de gros profits; car aussitt que les prix seront descendus, leurs profits devront baisser au niveau des autres profits.
1
Voyez le chapitre de la Rente.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
58
Loin donc daccorder Adam Smith que les propritaires ruraux nont pas un intrt aussi grand la prohibition de limportation du bl, que les industriels en ont la prohibition des produits manufacturs, je soutiens, au contraire, que les propritaires ruraux y ont un intrt bien plus fort ; - les avantages quils tirent de cette prohibition tant permanents, tandis que le manufacturier nen profite que pour un temps donn. Le docteur Smith observe que la nature a tabli une grande et essentielle diffrence entre le bl et les autres marchandises ; mais la consquence quil faut en tirer est prcisment loppos de celle quen tire Adam Smith ; car cest prcisment cette diffrence qui cre la rente, et qui fait que les propritaires ruraux trouvent un intrt la hausse du prix naturel du bl. Au lieu davoir mis en parallle les intrts du manufacturier avec ceux du propritaire foncier le docteur Smith aurait d comparer les intrts du premier avec ceux du fermier, qui sont trs-distincts des intrts du propritaire. Le manufacturier na pas dintrt la hausse du prix naturel de ses produits, pas plus que le fermier nen a la hausse du prix naturel du bl ou de tout autre produit immdiat du sol, quoique lun et lautre soient intresss ce que le prix courant de leurs produits slve au-dessus de leur prix naturel. Le propritaire foncier, au contraire, a lintrt le plus marqu la hausse du prix naturel du bl, puisque le surhaussement de la rente est la suite invitable de la difficult quil y a produire des denres de premire ncessit, difficult qui peut seule faire hausser leur prix naturel. Or, puisque des primes dexportation et des prohibitions limportation du bl en augmentent la demande, et forcent livrer la culture des terrains plus ingrats, elles occasionnent ncessairement une augmentation des frais de production. Le seul effet quoccasionne une prime accorde lexportation des objets manufacturs ou celle du bl, est de porter une portion de capital vers un emploi quon naurait pas cherche sans cela. Il en rsulte une distribution nuisible du capital national ; cest un leurre qui sduit le manufacturier, et qui lengage commencer ou continuer un genre de commerce comparativement moins profitable. Cest le plus mauvais des impts ; car il ne rend pas aux trangers tout ce quil te aux nationaux, la balance en perte tant supporte par une distribution moins avantageuse du capital national. Si, par exemple, le prix du bl en Angleterre tait de 4 1. st., tandis quil serait en France de 3 1. 15 sh., une prime de 10 sh. finirait par le rduire en France 3 1. 10 sh. en le maintenant en Angleterre au prix de 4 1. LAngleterre paierait un impt de 10 sh. sur chaque quarter de bl quelle exporterait, et la France ne gagnerait que 5 sh. sur chaque quarter quelle importerait dAngleterre. Voil donc une valeur de 5 sh. par quarter absolument perdue pour la socit, en raison dune mauvaise distribution de son capital, qui tend diminuer la masse totale, non pas probablement du bl, mais bien de quelque autre objet de ncessit ou dagrment. M. Buchanan parat avoir senti le vice du raisonnement du docteur Smith, au sujet des primes, et il fait sur le dernier passage de cet auteur, que jai cit plus haut, des rflexions trs-judicieuses. En soutenant, dit M. Buchanan, que la nature a confr au bl une valeur relle que les simples variations de son prix en argent ne sauraient faire varier, le docteur Smith confond la valeur dutilit avec la valeur changeable du bl. Un boisseau de bl ne peut pas nourrir plus de monde pendant la disette que pendant les poques dabondance ; mais un boisseau de bl schangera contre une plus grande quantit dobjets de luxe ou dutilit, quand il est rare, que lorsquil est abondant ; et les propritaires fonciers, qui ont un
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
59
surplus de subsistances leur disposition, deviendront par consquent plus riches dans des temps de disette, et ils changeront ce surplus contre une plus grande somme de jouissances. Cest donc tort que lon prtend que si la prime occasionne une exportation force de bl, elle ne produira pas de mme une hausse relle de son prix. Lensemble du raisonnement de M. Buchanan, sur cet effet particulier des primes, me parat parfaitement clair et concluant. Cependant M. Buchanan, pas plus que le docteur Smith et lauteur de larticle de la Revue ddimbourg, ne me paraissent avoir des ides exactes sur linfluence que le renchrissement de la main-duvre doit avoir sur les objets manufacturs. Daprs la manire de voir qui lui est particulire, et que jai dj rapporte ailleurs, M. Buchanan pense que le prix du travail na aucun rapport avec le prix du bl, et par consquent il croit que la valeur relle du bl pourrait monter et monte en effet sans influer sur le prix du travail. Pour le cas, cependant, o le prix du travail se ressentirait de cette hausse, il soutient, avec Adam Smith et l'auteur de l'article de la Revue ddimbourg, que le prix des objets manufactures devrait monter en mme temps ; hors ce cas, je ne conois pas comment il pourrait distinguer une telle hausse du bl d'avec une baisse dans la valeur de l'argent, ou comment il pourrait arriver un rsultat diffrent de celui du docteur Smith. Dans une note, la page 276 1 du premier volume de la richesse des Nations, M. Buchanan s'exprime ainsi : Mais le prix du bl ne rgle pas le prix en argent de tous les autres produits bruts de la terre. Il ne rgle ni le prix des mtaux ni celui de beaucoup d'autres matires utiles, telles que la houille, le bois, les pierres, etc.; et comme il ne rgle pas le prix du travail, il ne rgle pas non plus celui des objets manufacturs ; en sorte que la prime, en tant qu'elle lve le prix du bl, forme incontestablement un avantage rel pour le fermier. Ce n'est donc pas sous ce rapport que l'on peut en contester l'utilit. Il est hors de doute que ces primes offrent un encouragement lagriculture, par la hausse qu'elles oprent dans le prix du bl. La question se rduit donc savoir s'il convient d'encourager l'agriculture par un tel moyen. Les primes sont avantageuses au fermier, en ce qu'elles ne font point hausser le prix du travail ; car, si elles produisaient un tel effet, elles feraient hausser le prix de toutes les autres choses proportion, et ne prsenteraient alors aucun encouragement l'agriculture. Il faut cependant convenir que la tendance dune prime accorde l'exportation dune marchandise quelconque, est de faire baisser un peu la valeur de l'argent. Tout ce qui facilite l'exportation tend augmenter la quantit de l'argent dans le pays qui exporte ; et au contraire, tout ce qui s'oppose l'exportation tend diminuer la quantit de largent, L'effet gnral de l'impt est de diminuer l'exportation par la hausse qu'il occasionne dans les prix des produits imposs, et de s'opposer par consquent l'introduction de l'argent. Nous avons expliqu cela plus en dtail dans nos observations gnrales sur l'impt. Le docteur Smith a parfaitement dvelopp les effets nuisibles du systme mercantile, qui navait pour but que de faire hausser le prix des marchandises dans le pays, en repoussant la concurrence des produits trangers ; mais ce systme ntait pas plus funeste aux cultivateurs
1
dition anglaise.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
60
quaux autres classes de la socit. En forant les capitaux prendre une direction quils nauraient pas autrement suivie, ce systme diminuait la somme totale des produits. Le prix, qui se maintenait constamment plus haut, ntait pas d la raret des produits, mais la seule difficult de la production ; et par consquent, quoique les possesseurs de ces produits les vendissent plus cher, cependant, considrant la quantit de capital quil leur avait fallu employer pour les obtenir, ils nen tiraient rellement pas de plus gros profits 1. Les manufacturiers eux-mmes, en leur qualit de consommateurs, auraient pay ces produits plus cher, et par consquent il n'est pas exact de dire que le surhaussement de prix occasionn, par les rglements des matrises et par de forts droits sur l'importation des produits trangers, est partout, et en dernier rsultat, pay par les propritaires, les fermiers et les ouvriers du pays. Il est d'autant plus ncessaire d'insister sur ce point, que les propritaires fonciers allguent prsent l'autorit d'Adam Smith pour prouver qu'il faut mettre de pareils et de forts droits sur l'introduction des bls trangers. C'est ainsi que les frais de production, et, par consquent, le prix de plusieurs objets manufacturs, ayant augment pour les consommateurs par suite dune faute de lgislation, on a, sous prtexte de justice, exig de la nation qu'elle consentt endurer de nouvelles extorsions. Parce que nous payons tous plus cher le linge, la mousseline et les tissus de coton, on croit qu'il est juste que nous payions le bl galement plus cher. Parce que, dans la distribution gnrale du travail sur notre globe, nous avons empch que le travail, chez nous, fournit la plus grande quantit possible de produits manufacturs, on voudrait nous en punir encore en diminuant les facults productives du
1
M. Say pense que lavantage des manufacturiers nationaux est plus que temporaire. Un gouvernement, ditil, qui dfend absolument lintroduction de certaines marchandises trangres, tablit un monopole en faveur de ceux qui produisent cette marchandise dans lintrieur, contre ceux qui la consomment ; cest--dire que ceux de lintrieur qui la produisent, ayant le privilge exclusif de la vendre, peuvent en lever le prix audessus du taux naturel, et que les consommateurs de lintrieur, ne pouvant Iacheter que deux, sont obligs de la payer plus cher. Liv. I, chap. 17. Mais comment peuvent-ils maintenir constamment leurs produits au-dessus de leur prix naturel, lorsque chacun de leurs concitoyens a la possibilit de se livrer du mme genre dindustrie ? Ils sont protgs contre la concurrence des trangers, mais non contre celle des nationaux. Le mal rel que ressent un pays par leffet de ces monopoles, sil est permis de leur donner ce nom, vient, non de ce quils font hausser le prix courant de ces produits, mais bien de ce quils en font hausser le prix rel et naturel. En augmentant les frais de production, ils sont cause quune portion de lindustrie du pays est employe dune manire moins productive. (Note de lAuteur.) M. Ricardo me parat avoir ici raison contre moi. En effet, quand le gouvernement prohibe un produit tranger, il ne saurait lever dans lintrieur les bnfices quon fait sur sa production au-dessus du taux commun des profits ; car alors les producteurs de lintrieur, en se livrant ce genre de production, en ramneraient bientt, par leur concurrence, les profits au niveau de tous les autres. Je dois donc, pour expliquer ma pense, dire que je regarde le taux naturel dune marchandise, comme tant le prix le plus bas auquel, on peut se la procurer par la voie du commerce, ou par toute autre industrie. Si lindustrie commerciale peut la donner meilleur march que les manufactures, et si le gouvernement force la produire par les manufactures, il force ds lors prfrer une manire plus dispendieuse. Cest un tort quil fait ceux qui la consomment, mais ce nest pas au profit de ceux qui la produisent. Cest sous ce point de vue que la critique de M. Ricardo est fonde ; mais la mesure que je combats nen est que plus mauvaise : elle augmente la difficult naturelle qui soppose la satisfaction de nos besoins, et cest sans profit pour personne. - J.-S. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
61
travail employ la cration des fruits de la terre. Il serait bien plus sage d'avouer les fautes qu'un faux calcul nous a fait commettre, en commenant ds ce moment revenir graduellement aux principes salutaires d'un commerce libre entre tous les peuples 1.
J'ai dj eu occasion, observe M. Say, de remarquer, en parlant de ce qu'on nomme improprement balance du commerce, que s'il convient mieux, au ngociant du pays, d'envoyer des mtaux prcieux l'tranger, plutt que toute autre marchandise, il est aussi de l'intrt de l'tat que ce ngociant en envoie ; car l'tat ne gagne et ne perd que par le canal de ses citoyens ; et, par rapport ltranger, ce qui convient le mieux aux citoyens, convient le mieux ltat : ainsi, quand on met des entraves lexportation que les particuliers seraient tents de faire de mtaux prcieux, on ne fait autre chose que les forcer remplacer cet envoi par un autre moins profitable pour eux et pour ltat. Quon fasse bien attention que je dis seulement, dans ce qui a rapport au commerce avec ltranger ; car les gains que font les ngociants sur leurs compatriotes, comme ceux quils font dans le commerce exclusif des colonies, ne sont pas, en totalit, des gains pour ltat. Dans le commerce entre compatriotes, il ny a de gain pour tout le monde que la valeur dune utilit produite 2. Liv. I, chap. 22, I.
Je ne comprends pas cette diffrence entre les profits du commerce intrieur et ceux du commerce tranger. Lobjet de tout commerce est daugmenter la production. Si, pour acheter une pipe de vin, je peux exporter des lingots qui ont t achets moyennant le produit du travail de cent jours, et que le gouvernement, en dfendant lexportation des lingots, me force acheter mon vin au moyen dune denre qui me cote la valeur produite par le travail de cent cinq jours, je perds le fruit de ces cinq jours de travail, et ltat le perd aussi bien que moi. Mais si ces transactions avaient lieu entre particuliers, dans diffrentes provinces dun mme pays, les individus et ltat en tireraient les mmes avantages si les acheteurs taient libres dans le choix des marchandises quils donneraient en paiement ; et les mmes
1
Il suffirait de la libert du commerce pour protger un pays comme la Grande-Bretagne, abondamment pourvu des diffrents produits de l'industrie humaine, des marchandises propres satisfaire les besoins de toute socit, contre le retour de la disette. Les nations de la terre ne sont pas fatalement condamnes tirer constamment au sort celle qui, parmi toutes, devra s'teindre dans la famine. A prendre le globe dans son ensemble, les subsistances y abondent toujours : et pour jouir jamais dun riche approvisionnement, nous navons qu renoncer nos prohibitions, nos restrictions, et cesser de lutter contre les vues bienfaisantes de la Providence. (Article sur la lgislation et le commerce des crales. Supplment lEncyclopdie britannique.) Les passages suivants ne sont-ils pas en contradiction avec celui que je viens de citer ? Outre quen tous pays le commerce intrieur, quoique moins aperu, parce quil est en toutes sortes de mains, est le plus considrable, cest aussi le plus avantageux. Les envois et les retours de ce commerce sont ncessairement les produits du pays. Trait dconomie politique, liv. I, chap. 9. Le gouvernement anglais na pas fait attention que les ventes 1es plus profitables sont celles quune nation se fait elle-mme, parce quelles ne peuvent avoir lieu quautant quil y a, par cette nation, deux valeurs produites : la valeur quon vend et celle avec laquelle on achte. Ibid., liv. I, chap. 7. Dans le XXVIe chapitre de cet ouvrage, je me propose dexaminer la solidit de cette doctrine. (Note de lAuteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
62
dsavantages, si le gouvernement forait les particuliers acheter avec des marchandises qui offriraient moins davantages. Si un fabricant peut, avec le mme capital, travailler une plus grande quantit de fer l o le charbon abonde, que l o il est rare, le pays gagnera dans le premier cas. Mais si nulle part dans le pays le charbon ne se trouvait en abondance, et quil importt cette quantit additionnelle de fer en donnant en change un produit cr au moyen du mme capital et du mme travail, il enrichirait galement le pays de toute cette quantit additionnelle de fer quil y introduirait. Dans le sixime chapitre de cet ouvrage, jai tch de faire voir que tout commerce tranger ou intrieur est utile, parce quil augmente la quantit des produits, et non parce quil en augmente la valeur. Nous le possderons pas une valeur plus forte, soit que nous fassions un commerce intrieur et tranger profitable, soit que, par les entraves des lois prohibitives, nous soyons obligs de nous contenter du commerce le moins avantageux. Les profits et la valeur produite seront les mmes. Les avantages reviennent toujours, en dernier rsultat, ceux que M. Say parat naccorder quau commerce intrieur. Dans ces deux cas, il ny a dautre gain que celui de la valeur dune utilit produite 1.
Outre les gains quon peut faire par le moyen dune utilit, et par suite dune valeur produite, on peut faire son profit des pertes dun autre homme. Lorsque cet autre homme est un compatriote ; la nation ne perd ni ne gagne par ce bnfice port dune poche dans lautre ; lorsque cet autre homme est dun autre pays, la nation dont le premier fait partie gagne ce que lautre nation perd. Je ne prtends pas justifier ce gain ; je me borne tablir le fait. - J.-B. SAY
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
63
Chapitre XXIII.
DES PRIMES ACCORDES LA PRODUCTION.
Table des matires
Il peut tre de quelque intrt de considrer les effets dune prime accorde la production agricole et celle des denres manufacturires, pour faire lapplication des principes que je me suis efforc dtablir sur les profits des capitaux, sur les produits annuels de la terre et du travail, et sur le prix relatif des objets fabriqus et des produits naturels. Supposons dabord quon mit un impt sur toutes les denres pour lever un fonds destin par le gouvernement donner des primes dencouragement pour la production du bl. Comme aucune portion de cet impt ne serait dpense par le gouvernement, et comme tout ce quil recevrait dune classe de personnes il le rendrait une autre, la nation, prise en fiasse, ne se trouverait ni plus riche ni plus pauvre par leffet dun tel impt et dune semblable prime. On conviendra sans doute que limpt sur les denres, qui fournirait ce fonds, aurait leffet de faire hausser le prix des objets imposs ; tous les consommateurs de ces objets contribueraient par consquent ce fonds, ou, en dautres mots, le prix naturel et forc de ces choses ayant hauss, leur prix courant hausserait de mme. Mais par la mme raison que le prix naturel de ces denres aurait hauss, celui du bl serait tomb. Avant quon et accord une prime la production, les fermiers auraient pu obtenir de leur bl un prix qui leur permt de
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
64
se rembourser de la rente, de leurs frais, et de retirer les profits ordinaires ; aprs la concession de la prime, ils recevraient plus que ces profits si le prix du bl ne tombait pas dune somme au moins gale la prime. Leffet de limpt et de la prime serait donc de faire hausser le prix des denres dune somme gale celle de limpt dont elles sont greves, et de faire baisser le prix du bl dune somme gale la prime. Il faut aussi observer quil ne pourrait tre fait de changement permanent la distribution des capitaux entre lagriculture et les manufactures ; car, comme il ny aurait point de variation ni dans le montant du capital, ni dans la population, il y aurait prcisment la mme demande de pain et douvrages manufacturs. Les profits du fermier ne seraient pas audessus du niveau gnral aprs la baisse du prix du bl, et les profits du manufacturier ne baisseraient pas non plus aprs le renchrissement des objets manufacturs. La prime ne rendrait donc pas ncessaire lemploi dun plus fort capital dans la production du bl, ni dun capital moindre dans les manufactures. Mais les intrts du propritaire foncier ne seraient-ils pas affects ? Par le mme principe quun impt sur les produits de la terre a leffet de faire baisser les rentes en bl sans changer la rente en argent, de mme une prime accorde la production et qui est prcisment loppos dun impt, ferait hausser les rentes en bl sans apporter aucun changement celle en argent. Le propritaire foncier recevra, dans ce cas, la mme rente en argent; et tandis quil paiera plus cher les objets manufacturs dont il aura besoin, il aura le bl meilleur march : il ne se trouvera donc vraisemblablement ni plus riche ni plus pauvre. Quant leffet quune pareille mesure pourrait avoir sur les salaires, il sagit de savoir si louvrier, par lachat des objets de sa consommation, paiera autant pour limpt quil gagnera, par leffet de la prime, sur les prix rduits de sa nourriture. Si ces deux quantits taient gales, les salaires nprouveraient point de variation ; mais si les objets imposs ntaient pas de ceux que louvrier consomme, son salaire tomberait, et lentrepreneur de travaux gagnerait toute la valeur de cette diffrence. Mais lentrepreneur de travaux nen tirerait cependant aucun avantage rel ; cela augmenterait le taux de ses profits, comme le ferait toute baisse des salaires ; mais mesure que louvrier contribuera pour une somme toujours moindre au fonds qui doit fournir la prime, et qui doit tre lev par contribution, lentrepreneur de travaux devra y contribuer pour une plus forte part, ou, en dautres mots, lentrepreneur devra fournir limpt, au moyen de sa dpense, une somme gale celle quil gagnera par leffet runi de la prime et de profits plus considrables. Il retire de plus forts profits de son capital, afin dtre ddommag, non-seulement de sa quote-part de limpt, mais encore de celle de ses ouvriers. La rtribution quil reoit pour la part de limpt des ouvriers se trouve dans la diminution des salaires, ou, ce qui revient au mme, dans laugmentation des profits. Quant sa propre part de la contribution, il la trouve dans la diminution du prix du bl quil consomme, et qui est leffet de la prime. Il est propos de distinguer ici les diffrents effets que produit sur les profits un changement dans la valeur relle du bl, estime en travail, et un changement dans la valeur relative du bl, qui proviendrait de limpt et des primes. Si le bl baisse par un changement de son prix estim en travail, non-seulement le taux des profits des capitaux changera, mais encore les profits absolus ; ce qui na pas lieu, comme nous venons de le faire voir, lorsque la
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
65
baisse est occasionne artificiellement par une prime. Dans la baisse de la valeur relle du bl, qui provient de ce quun moindre travail suffit pour produire un des articles les plus importants de la consommation de lhomme, le travail est rendu plus productif. Moyennant un mme capital, et lemploi du mme travail, on obtient une augmentation de produits ; par consquent, non-seulement le taux des profits saccrot, mais les profits absolus du capital augmentent aussi ; non-seulement chaque capitaliste aura un plus gros revenu en argent, sil emploie le mme capital en argent, mais encore ce revenu lui procurera une plus grande quantit de choses utiles et de jouissances. Dans le cas de la prime, lavantage quil tire du bas prix dun produit est compens par le dsavantage dtre oblig den payer un autre plus cher ; il retire de plus gros profits pour pouvoir payer ce prix plus lev, en sorte que sa condition ne se trouve en rien amliore. Quoique ses profits soient un taux plus lev, il ne peut cependant pas disposer dune plus grande portion du produit de la terre et de lindustrie nationale. Quand la baisse de la valeur du bl est amene par des causes naturelles, elle nest pas contrarie par la hausse des autres marchandises ; car ces marchandises, au contraire, baissent par suite de la baisse des produits naturels qui servent les fabriquer. Mais quand la baisse du bl sopre par des moyens artificiels, elle est toujours contrarie par la hausse relle de la valeur de quelque autre marchandise ; en sorte que , si lon achte le bl meilleur march, on paie dautres denres plus cher. Voil donc une nouvelle preuve quil ne rsulte aucun dsavantage particulier des impts sur les objets de premire ncessit, en raison de ce quils font hausser les salaires et baisser les profits. Les profits tombent, en effet ; mais cette baisse est simplement gale au montant de la portion de l'impt que l'ouvrier paie, laquelle doit, en tous cas, tre paye ou par celui qui l'emploie, ou par le consommateur des produits du travail de l'ouvrier. Que vous retranchiez 50 1. par an du revenu de l'entrepreneur de travaux; ou que vous ajoutiez 50 1. au prix des objets qu'il consomme, cela ne lintresse, lui et la socit, qu'autant que les autres classes d'individus pourraient ressentir les mmes effets. Si cette somme est ajoute au prix de la denre, un avare peut se soustraire limpt en ne consommant pas ; si elle est retranche indirectement du revenu de chacun, on ne peut viter de payer sa juste part des chargs publiques. Une prime sur la production du bl n'aurait donc pas d'effet rel sur les produits annuels de la terre et du travail du pays, quoiqu'elle rendit le bl relativement bon march, et les objets manufacturs relativement chers. Mais supposons maintenant quune mesure contraire ft adopte, et qu'on mt un impt sur le bl, afin de constituer un fonds qui servirait fournir des primes d'encouragement la production des objets manufacturs. Dans un tel cas, il est vident que le bl renchrirait, et, que les objets manufacturs baisseraient de prix. Le prix du travail resterait le mme, si le bon march des objets manufacturs procurait l'ouvrier autant de gain que la chert du bl lui cause de perte ; mais si cela n'arrivait point, les salaires devraient hausser, et les profits tomber, tandis que les rentes en
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
66
argent resteraient comme auparavant. Les profits doivent tomber parce que, ainsi que nous venons de l'expliquer, ce sera par ce moyen que la part de l'impt qui pse sur l'ouvrier se trouvera paye par ceux qui le font travailler. Par la hausse des salaires, l'ouvrier se trouvera ddommag de l'impt qu'il aura payer par le renchrissement du bl ; et, ne dpensant aucune partie de son salaire en objets manufacturs, il ne lui reviendra rien de la prime, qui sera reue en entier par les entrepreneurs de travaux ; tandis que l'impt sera en partie pay par les travailleurs. Il sera donn aux ouvriers une gratification, sous forme de salaire, pour cette charge additionnelle qui leur est impose, et cela rduira le taux des profits. Dans ce cas, il y aura galement une complication de mesures, dont le rsultat sera nul pour la nation. En examinant cette question, nous avons exprs mis de ct la considration de l'effet qu'une telle mesure pourrait avoir sur le commerce tranger ; nous avons raisonn plutt dans la supposition dun pays isol qui n'aurait point de rapports de commerce avec les autres tats. Nous avons fait voir que, comme la demande dans l'intrieur, pour du bl et des marchandises, resterait la mme, quelle que ft la direction que pourrait suivre la prime, il n'y aurait rien qui pt engager les particuliers retirer leurs capitaux d'un emploi pour les placer dans un autre ; mais cela n'aurait plus lieu s'il y avait un commerce avec l'tranger, et si ce commerce tait libre. En changeant la valeur relative des marchandises et du bl, et en modifiant dune manire si notable leur prix naturel, nous donnerions un trs-puissant encouragement l'exportation de ceux de ces produits dont le prix naturel aurait baiss, en encourageant par l galement l'importation des produits dont le prix naturel aurait hauss. C'est pourquoi une pareille mesure de finances pourrait changer entirement la distribution naturelle des capitaux dune manire avantageuse, il est vrai, aux pays trangers, mais ruineuse pour celui qui aurait adopt une mesure aussi absurde.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
67
Chapitre XXIV.
DE LA DOCTRINE DADAM SMITH SUR LA RENTE DE LA TERRE.
Table des matires On ne peut porter gnralement au march, dit Adam Smith, que ces parties seulement du produit de la terre dont le prix ordinaire est suffisant pour remplacer le capital quil faut employer pour les y porter, et les profits ordinaires de ce capital. Si le prix ordinaire est plus que suffisant, le surplus en ira naturellement la rente. Sil nest juste que suffisant, la marchandise pourra bien tre porte au march, mais elle ne peut fournir payer une rente au propritaire. Le prix sera-t-il ou ne sera-t-il pas plus que suffisant ? Cest ce qui dpend de la demande.
Le lecteur serait naturellement port croire, daprs ce passage, quil nest pas possible que son auteur se soit tromp sur la nature de la rente, et quil doit avoir senti que la qualit des terrains, que les besoins de la socit font dfricher, dpend du prix ordinaire des produits, et de la question de savoir si ce prix est suffisant pour remplacer le capital qui a d tre employ cette culture, en y joignant les profits ordinaires. Mais Smith avait adopt lopinion, quil y a quelques parties du produit de la terre dont la demande doit toujours tre telle, quelles rapporteront un prix plus fort que ce qui est suffisant pour les faire venir au march ; et il regardait les subsistances comme tant une de ces parties.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
68
Il dit encore : La terre, dans presque toutes les situations possibles, produit plus de nourriture que ce quil faut pour faire subsister tous ceux dont le travail concourt porter cette nourriture au march et mme pour les faire subsister de la manire la plus librale. Le surplus de cette nourriture est aussi toujours plus que suffisant pour remplacer avec profit le capital qui met en uvre ce travail. Ainsi il reste toujours quelque chose pour fournir une rente au propritaire.
Mais quelle preuve en donne-t-il ? Aucune, si ce nest lassertion, que les marais les plus dserts dcosse et de Norvge forment une espce de pturage pour des bestiaux qui, avec leur lait et laccroissement du troupeau, suffisent toujours, non-seulement faire subsister tous les gens que leur garde et entretien exigent, mais encore payer au fermier ou matre du troupeau les profits ordinaires de son capital. Quil me soit permis den douter. Je crois quil existe dans tout pays, depuis le moins avanc en civilisation jusquau plus civilis, des terres dune qualit telle quelles ne rendent que le produit suffisant pour remplacer le capital qui y est employ, avec les profits quon retire ordinairement des capitaux dans chaque pays. Nous savons que cela a lieu en Amrique, et cependant personne ne prtend que le fermage y soit rgl daprs des principes diffrents de ceux qui sont admis, pour lEurope. Mais quand il serait vrai que lAngleterre ft si avance en civilisation, quil ny restt actuellement plus de terres qui ne payassent de rente, il serait toujours vrai quil faut quil y ait eu autrefois de pareilles terres. Quil y en ait ou quil ny en ait pas, cela ne fait rien la question, car il suffit quon admette quil y a des capitaux employs, dans la Grande-Bretagne, sur des terres qui ne rendent que le capital dbours avec les profits ordinaires, soit que ces terres aient t depuis longtemps cultives, soient quelles ne laient t que rcemment 1. Si un fermier consent passer un bail de sept ou de quatorze ans pour une terre sur laquelle il se propose demployer un capital de 10,000 l., sachant bien quau prix actuel du grain et des produits de la terre, il peut remplacer le capital quil est oblig de dbourser, payer sa rente, et retirer les profits ordinaires ; ce fermier, dis-je, nemploiera pas 11000 l., moins que les dernires 1000 1. ne puissent, par leur pouvoir productif, lui donner les profits ordinaires des capitaux. Pour savoir sil doit ou ne doit pas employer cette dernire somme, il calculera uniquement si le prix des produits de lagriculture est suffisant pour le rembourser de ses frais et lui assurer ses profits ; car il sait bien quil naura pas payer de rente additionnelle. Sa rente ne sera pas augmente, mme lexpiration du bail ; car si le propritaire de la terre exigeait un surcrot de fermage en raison de l'emploi de ces 1,000 1. de plus sur la proprit, le fermier retirerait cette portion de son capital, puisque, dans le cas suppos, elle ne lui rapporte que les profits ordinaires et courants qu'il peut obtenir par tout autre placement de ce capital ; et par consquent il ne saurait consentir en payer un fermage, moins que le prix des produits de l'agriculture n'prouve une plus forte hausse, ou, ce qui revient au mme, moins que le taux ordinaire et courant des profits ne vienne baisser.
Or, cest prcisment ce que Smith nadmet pas, puisquil dit quil na vu si mauvais pturage dcosse qui ne rapportt quelque revenu foncier son propritaire. - J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
69
Si l'esprit pntrant d'Adam Smith se ft arrt sur ce point, il n'et jamais soutenu que la rente est un des lments du prix des produits agricoles ; car le prix est constamment rgl par le profit que l'on retire de cette dernire portion de capital employ dont on ne paie pas de rente ou de loyer. S'il et song ce principe, il n'aurait pas fait une distinction entre le fermage ou loyer des mines et celui des terres. Savoir, par exemple, dit Smith, si une mine de charbon de terre rapportera un loyer ou rente, c'est ce qui dpend en partie de sa fcondit et en partie de sa situation. On peut dire d'une mine, en gnral qu'elle est fconde ou quelle est strile, selon que la quantit de minral que peut en tirer une certaine quantit de travail est plus ou moins grande que celle qu'une mme quantit de travail tirerait de la plupart des autres mines de la mme espce. Quelques mines de charbon de terre, avantageusement situes, ne peuvent tre exploites cause de leur strilit, le produit ne vaut pas la dpense ; elles ne peuvent rapporter ni profit, ni loyer ou rente. Il y en a dont le produit est purement suffisant pour payer le travail, et remplacer avec les profits ordinaires le capital employ leur exploitation ; elles donnent quelques profits lentrepreneur, mais point au propritaire. Personne ne peut les exploiter plus avantageusement que le propritaire, qui, en faisant lui-mme l'entreprise, gagne les profits ordinaires sur le capital qu'il y emploie. Il y a en cosse beaucoup de mines de charbon qui sont exploites ainsi, et qui ne pourraient pas ltre autrement. Le propritaire n'en permettrait pas l'exploitation d'autres sans exiger une rente, et personne ne trouverait moyen de lui en payer une. Dans le mme pays, il y a d'autres mines de charbon qui seraient bien assez riches, mais qui ne peuvent tre exploites cause de leur situation. La quantit de minral suffisante pour dfrayer la dpense de l'exploitation, pourrait bien tre tire de la mine avec la quantit ordinaire ou mme encore moins que la quantit ordinaire de travail ; mais dans un pays enfonc dans les terres, peu habit, et qui na ni bonne route ni navigation, cette quantit de minral ne pourrait tre vendue. Toute la thorie de la rente se trouve, dans ce passage, explique admirablement et avec toute la clart possible ; mais il ny en a pas un mot qui ne soit galement applicable la terre aussi bien quaux mines, et cependant Adam Smith prtend que, il en est autrement des biens qui existent la surface de la terre. La valeur, tant de leur produit que de leur rente, est en proportion de leur fertilit absolue, et non de leur fertilit relative 1. Mais supposons quil ny ait point de terres qui ne rapportent une rente ; dans ce cas, le montant de la rente des terrains les plus ingrats devrait tre en proportion de lexcdant de la valeur du produit par-del le capital dpens et les profits ordinaires. Le mme principe rglerait la rente des terres dune qualit suprieure ou plus heureusement situes, et par consquent ces terres paieraient un loyer un peu plus fort que les prcdentes, en raison des
1
Le motif quen donne Smith na rien qui rpugne ma raison. Partout o il peut crotre des denres alimentaires, il peut natre des hommes pour les consommer. La demande, coup sr, va chercher les produits de ce genre, tandis quelle ne va pas chercher des houilles ou des bois de construction, lorsque la dpense quil faudrait faire pour les conduire au lieu de la consommation en excderait la valeur. Les dmonstrations de Malthus, qui prouvent que la population tend toujours surpasser les moyens de subsistances, confirment, ce me semble, la manire de voir de Smith. - J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
70
avantages suprieurs quelles possdent. On peut en dire autant des terres dune qualit encore suprieure et ainsi de suite jusquaux plus fertiles. Nest-il donc pas vident que cest daprs la fertilit relative des terres quon dtermine quelle sera la portion du produit qui sera paye comme rente, comme cest la richesse relative des mines qui dtermine cette portion de leur produit qui doit en constituer le loyer 1 ? Adam Smith ayant admis quil y a quelques mines que les propritaires seuls peuvent exploiter, en raison de ce que leur produit nest que suffisant pour dfrayer les dpenses de lexploitation et rapporter les profits ordinaires du capital employ, on se serait attendu le voir poser galement en principe, que cest prcisment cette espce de mines qui rgle le prix des produits. Si les anciennes mines sont insuffisantes pour fournir la quantit de charbon demande, le prix du charbon doit hausser, et il continuera renchrir jusqu ce que le propritaire dune mine nouvelle et dune qualit infrieure, trouve quil peut, en lexploitant, obtenir les profits ordinaires sur son capital. Si cette mine est mdiocrement riche, son propritaire naura pas besoin que la hausse du charbon soit trs-forte pour trouver de lintrt employer son capital lexploiter ; mais si elle est trs-pauvre, il est clair quil faudra que le prix du charbon continue hausser tellement quil puisse lui fournir le moyen de retirer ses frais, et dobtenir les profits ordinaires du capital. Il parat donc que cest toujours la mine la moins productive qui rgle le prix du charbon. Adam Smith est pourtant dune opinion diffrente. Il sexprime dans les termes suivants : Le prix de la mine la plus riche rgle le prix du charbon pour toutes les autres mines de son voisinage. Le propritaire et lentrepreneur trouvent tous deux quils pourront se faire, lun une plus forte rente, lautre un plus gros profit, en vendant un peu au-dessous de tous leurs voisins. Les voisins sont bientt obligs de vendre au mme prix, quoiquils soient moins en tat dy suffire, et quoique ce prix aille toujours en diminuant, et leur enlve mme quelquefois toute leur rente et tout leur profit. Quelques exploitations se trouvent alors entirement abandonnes ; dautres ne rapportent plus de rente, et ne peuvent plus tre continues que par le propritaire de la mine. Si la demande de charbon diminuait, ou si, par de nouveaux procds, la quantit en devenait plus considrable, le prix du charbon tomberait, et quelques mines seraient abandonnes ; mais, dans tous les cas, le prix doit suffire pour remplacer les frais et les profits de celles des mines qui ne sont pas greves dune rente. Cest donc la mine la moins fertile qui rgle le prix du charbon. Adam Smith en convient lui-mme dans un autre endroit, car il dit : Le prix le plus bas, auquel le charbon de terre puisse se vendre pendant un certain temps, est, comme celui de toutes les autres marchandises, le prix qui est simplement suffisant pour remplacer, avec les profits ordinaires, le capital employ le faire venir au march. Dans une mine dont le propritaire ne retire pas de rente, et quil est oblig dexploiter lui-mme ou dabandonner tout fait, le prix du charbon doit en gnral approcher beaucoup de ce prix.
Qui songe nier cela, puisque le fermage est le prix annuel du pouvoir productif de la nature, toutes les fois que ce pouvoir est devenu une proprit ? Sil arrive mme, dans certains cas, que ce pouvoir ne soit pas pay, cela empche-t-il quil le soit dans dautres cas ? Cela prouve-t-il que les produits du sol ne seraient pas moins chers si ce pouvoir productif ntait pay dans aucun cas ? - J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
71
Mais la mme cause, cest--dire labondance, et, par consquent le bas prix du charbon, de quelque source quelle provienne, en faisant abandonner lexploitation des mines qui ne paient pas de loyer ou qui nen paient quun trs-modique, aurait des effets analogues sur la culture des terres ; car cette grande abondance et ce bas prix conduiraient dlaisser des produits de la terre, rendraient ncessaire dabandonner la culture des terrains qui ne paient pas de rente, ou nen paient quune trs-modique. Si, par exemple, les pommes de terre devenaient la nourriture ordinaire et gnrale de notre nation, comme le riz lest chez quelques peuples, un quart ou une moiti des terres actuellement en culture serait vraisemblablement abandonn linstant ; car si, comme Adam Smith lassure, un acre de terre en pommes de terre produit six mille livres pesant de nourriture substantielle, ce qui est trois fois autant quen donnerait un acre de terre en bl, la population ne pourrait pas se dvelopper longtemps sur une chelle assez vaste pour suffire consommer la quantit de nourriture rcolte sur les terres o lon cultivait auparavant du bl. Il y aurait beaucoup de terrains abandonns, et les rentes tomberaient; et ce ne serait que lorsque la population aurait doubl ou tripl, quon pourrait cultiver de nouveau autant de terres, et payer de ces terres un aussi fort loyer que par le pass. Il ne serait pas pay non plus une plus forte part du produit brut au propritaire foncier, que ce produit consistt en pommes de terre suffisantes pour nourrir trois cents individus, ou, en bl, qui ne pourrait en nourrir que cent ; car, quoique les frais de production se trouvassent bien diminus, dans le cas o les salaires de louvrier seraient rgls principalement par le prix des pommes de terre et non par celui du bl, et quoique, par consquent, la somme totale du produit brut, - les travailleurs pays, - se trouvt considrablement augmente, cependant aucune partie de ce surplus nirait grossir la rente ; il irait constamment grossir les profits, lesquels montent toujours quand les salaires baissent, et tombent lorsque les salaires haussent. La rente suivra la mme marche, que lon cultive du bl ou des pommes de terre ; elle sera toujours gale la diffrence entre les quantits de produits obtenues par lemploi de capitaux pareils sur des terres de la mme ou de diffrente qualit ; et par consquent, tant que des terres dune mme qualit seront cultives et quil ny aura aucune variation dans leur fertilit et dans leurs avantages respectifs, le loyer sera toujours dans le mme rapport avec le produit brut. Adam Smith prtend cependant que la part du propritaire se trouvera augmente par suite de la diminution des frais de production, et quil recevra par consquent une plus grande part et une quantit plus considrable dun produit abondant que dun produit rare. Une rizire, dit-il, produit une plus grande quantit de nourriture que le champ de bl le plus fertile. Le produit ordinaire dun acre monte a ce quon dit, deux rcoltes par an, de trente soixante boisseaux chacune. Ainsi, quoique la culture exige plus de travailleurs, quand tous ces travailleurs ont subsist, il reste un plus grand excdant. Par consquent, dans les pays o le riz est la nourriture vgtale ordinaire et favorite du peuple, et o il compose la principale subsistance des laboureurs qui le cultivent, il doit revenir au propritaire, dans ce plus grand excdant, une portion plus forte que celle qui lui revient dans les pays bl. M. Buchanan remarque aussi : quil est bien clair que si la terre donnait un autre produit en plus grande abondance que le bl, et que ce produit devint la nourriture ordinaire du
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
72
peuple, la rente des propritaires des terres augmenterait proportion de labondance plus grande de ce produit. Si les pommes de terre devenaient la nourriture habituelle du peuple, il y aurait un intervalle assez long pendant lequel les propritaires fonciers prouveraient une trs-forte rduction dans leurs rentes. Ils ne recevraient probablement alors quune portion de subsistances bien moindre que celle quils en retirent prsent, tandis que ces subsistances descendraient au tiers de leur valeur actuelle. Mais tous les objets manufacturs lachat desquels le propritaire foncier dpense une partie de son fermage, nprouveraient dautre baisse que celle qui proviendrait de la baisse des matires premires dont ils sont fabriqus, baisse qui ne pourrait tre occasionne que par la fertilit plus grande des terres qui pourraient tre alors consacres leur production. Quand, par suite de laccroissement de la population, on viendrait livrer de nouveau la culture, des terres ayant les mmes qualits que celles quon cultivait auparavant pour en tirer la nourriture ncessaire, et quand on viendrait consacrer cette culture le mme nombre dhommes, le propritaire foncier retirerait, non-seulement la mme part du produit quauparavant, mais cette part aurait encore la mme valeur que par le pass. La rente serait donc la mme quauparavant ; cependant les profits seraient beaucoup plus levs, parce que le prix de la nourriture, et par consquent les salaires seraient bien plus bas. Les gros profits favorisent laccumulation du capital. La demande de bras augmenterait encore, et les propritaires retireraient un avantage permanent de la concurrence qui stablirait pour avoir des terres dfricher. La culture pourrait, mme, tellement samliorer, il pourrait en rsulter une telle abondance de denres alimentaires, que, naturellement, les mmes terres desserviraient les besoins dune population beaucoup plus considrable et paieraient des rentes beaucoup plus leves. De tels rsultats ne peuvent manquer dtre avantageux aux propritaires et saccordent, dailleurs, pleinement avec le principe que ces recherches doivent mettre hors de doute : savoir, que des profits extraordinaires ne peuvent jamais avoir quune dure fort limite, car lexcdant que donnent les produits du sol aprs le prlvement des bnfices suffisants pour encourager la production et lpargne, cet excdent, dis-je, retourne, en dfinitive, au propritaire. La baisse que dterminerait dans les salaires cette abondance de produits naturels aurait non-seulement pour rsultat daugmenter le rendement des terres dj cultives, mais encore dattirer vers elles de nouveaux capitaux, et, en mme temps, damener le dfrichement des travaux de qualit infrieure ; ce qui tournerait au profit des propritaires et de la classe entire des consommateurs. La terre cette machine qui produit la denre la plus importante - samliorerait et prendrait une valeur naturelle en face des demandes qui en seraient faites. Tous les avantages se feraient dabord sentir aux ouvriers, aux capitalistes et aux consommateurs : mais peu peu, et par la marche naturelle des faits, ils passeraient aux propritaires du sol.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
73
Indpendamment de ces amliorations qui intressent si vivement la socit et si faiblement le propritaire, lintrt du propritaire foncier est toujours en opposition avec celui du consommateur et du manufacturier. Le bl ne peut jamais se soutenir un haut prix quautant quil faut plus de travail pour le produire, quautant quil ncessite plus de frais de production. La mme cause faisant galement hausser les rentes, il est de lintrt du propritaire foncier que les frais de production du bl augmentent. Ce nest pourtant pas l lintrt du consommateur, qui voudrait que le bl ft toujours bas prix, relativement largent et aux marchandises ; car cest toujours avec des marchandises ou de largent que lon achte du bl. Il nest pas non plus de lintrt du manufacturier que le bl soit cher, car la chert du bl amne celle des salaires, sans amener celle des marchandises. Il faudra quil donne alors non-seulement plus de ses marchandises, ou, ce qui revient au mme, une plus forte valeur en marchandise, en change du bl quil consomme lui-mme ; mais il sera encore oblig de donner plus de marchandises ou plus de valeur pour payer le salaire de ses ouvriers, sans en recevoir de ddommagement. Toutes les classes de la socit souffriront donc par le renchrissement du bl, except la classe des propritaires. Les transactions entre le propritaire foncier et le public ne ressemblent pas aux transactions mercantiles, dans lesquelles on peut dire que le vendeur gagne aussi bien que lacheteur ; car, dans les premires, toute la perte est dun ct, et le gain de lautre ; et si, par limportation, lon pouvait se procurer du bl meilleur march, on verrait combien la perte qui rsulte de la non-importation est plus forte pour les uns que le gain ne lest pour les autres. Adam Smith ne fait jamais de distinction entre la valeur diminue de largent et la valeur augmente du bl, et voil pourquoi il pense que lintrt des propritaires fonciers nest point eu opposition avec celui du reste de fa socit. Dans le premier cas, cest largent qui a baiss relativement tous les autres produits : dans le second cas, cest le bl. Dans le premier cas, le bl et les marchandises continuent davoir la mme valeur relative ; dans le second cas, le bl est, comme largent, plus lev relativement aux marchandises. Lobservation suivante dAdam Smith est applicable au bas prix de largent ; mais elle ne lest nullement la valeur augmente du bl.
Si limportation (du bl) tait libre en tout temps, nos fermiers et nos propritaires ruraux retireraient vraisemblablement moins dargent de leur bl, une anne dans lautre, quils ne font prsent, que limportation est, par le fait, prohibe la plupart du temps 1 ; mais largent quils en retireraient aurait plus de valeur, achterait plus de marchandises de toute autre espce, et emploierait plus de bras. Par consquent leur richesse relle, leur revenu rel seraient les mmes qu prsent, quoique exprims par une moindre quantit dargent, et ds lors ils ne se trouveraient ni moins en tat de cultiver, ni moins encourags le faire quils ne le sont a prsent. Au contraire, comme une hausse dans la valeur de largent, procdant dune baisse dans le prix en argent du bl, fait baisser de quelque chose le prix de toutes les autres marchandises, elle donne lindustrie du pays o elle a lieu quelque avantage dans tous les marchs trangers, et tend par l accrotre et encourager cette industrie. Or, ltendue du march national pour le bl, doit tre en proportion de lindustrie gnrale du pays o il crot, ou du nombre de ceux qui produisent quelque autre
1
Nous avons fait voir dans une note prcdente les transformations radicales subies, depuis lpoque de Smith, par la lgislation des crales en Angleterre. A F.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
74
chose donner en change pour le bl ; et le march national tant, dans tout pays, le march le plus rapproch et le plus commode est aussi le plus vaste et le plus important ; par consquent cette hausse dans la valeur relle de largent, qui provient de la baisse du prix moyen du bl en argent, tend agrandir le march le plus vaste et le plus important pour le bl, et par consquent encourager la production bien loin de la dcourager.
La hausse ou la baisse du prix du bl provenant de labondance et du bas prix de lor et de largent, nintresse nullement le propritaire foncier, car tous les autres produits sen ressentiront de la manire expose par Adam Smith ; mais la chert relative du bl est toujours trs-avantageuse au propritaire foncier, qui, avec la mme quantit de bl, peut acqurir, non-seulement une plus grande somme dargent, mais encore une quantit plus considrable de tout ce quon peut acheter avec de largent.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
75
Chapitre XXV.
DU COMMERCE COLONIAL.
Table des matires
Dans ses observations sur le commerce colonial, Adam Smith a fait voir, de la manire la plus satisfaisante, les avantages dun commerce libre, et linjustice que les mtropoles font prouver aux colonies, en les empchant de vendre leurs produits sur le march o les prix sont le plus levs, et dacheter au contraire les objets manufacturs et leurs subsistances dans le march o ces choses sont au plus bas prix. Il a prouv que si on laissait chaque pays libre dchanger les produits de son industrie dans le temps et dans les endroits qui lui conviendraient, on obtiendrait ainsi la meilleure distribution possible du travail de lespce humaine, et lon sassurerait la plus grande abondance des choses ncessaires ou agrables la vie. Il a encore tch de faire voir que cette libert de commerce, qui est incontestablement avantageuse la socit en masse, lest galement chaque pays en particulier ; et que le systme dune politique troite, adopt par les tats de lEurope envers leurs colonies, nest pas moins nuisible aux mtropoles elles-mmes quil ne lest aux colonies, dont on sacrifie les intrts.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
76
Ainsi, comme tous les autres expdients misrables et nuisibles de ce systme mercantile que je combats, dit Adam Smith, le monopole du commerce des colonies opprime lindustrie de tous les autres pays, et principalement celle des colonies, sans ajouter le moins du monde celle du pays en faveur duquel il a t tabli, et tout au contraire, en la diminuant.
Cette partie de son sujet nest cependant pas traite dune manire aussi claire et aussi convaincante que celle o il montre linjustice du systme adopt envers les colonies. Sans prtendre dcider si le systme actuel, adopt par lEurope lgard de ses colonies, est ou non nuisible aux mtropoles, quil me soit permis de croire que la mre-patrie peut quelquefois retirer un avantage des entraves auxquelles elle assujettit les habitants de ses colonies. Qui peut douter, par exemple, que, supposant que lAngleterre ft une colonie de la France, ce dernier pays ne trouvt du profit faire payer lAngleterre une forte prime sur lexportation du bl, du drap, ou de toute autre marchandise ? En examinant la question des primes, et partant de la supposition que le bl se vendait en Angleterre 4 1. st. le quarter, nous avons vu quen accordant 10 sh. de prime sur lexportation, le bl serait revenu en France 3 1. 10 sh. Or, si le bl tait auparavant 3 1. 15 sh. le quarter en France, le consommateur franais aura gagn 5 sh. par quarter sur tout le bl import ; et si le prix naturel du bl en France tait auparavant de 4 1. les Franais auraient gagn en totalit les 10 sh., montant de la prime. La France profiterait donc par l de toute la perte que lAngleterre aurait supporte ; elle ne gagnerait pas seulement une partie de ce que lAngleterre aurait perdu ; mais, dans quelques cas, elle en aurait gagn la totalit. On pourra cependant objecter quune prime dexportation tant une mesure de police intrieure, ne peut pas facilement tre impose par la mre-patrie. Sil convenait la Jamaque aussi bien qua la Hollande de faire un change rciproque des produits de chacun de ces pays, sans lintervention de lAngleterre, il est bien certain que, si lon y mettait obstacle, les intrts de la Hollande et de la Jamaque en souffriraient ; mais si la Jamaque est force denvoyer ses produits en Angleterre, pour les y changer contre des marchandises hollandaises, il y aura un capital anglais et une agence anglaise employs dans un commerce dans lequel ni lun ni lautre nauraient t engags sans cela. Ce commerce y est attir par une prime que lAngleterre ne paie pas, et qui est paye par la Hollande et la Jamaque. Que la perte supporte en raison dune distribution dsavantageuse du travail dans deux pays, puisse tre profitable lun des deux, tandis que lautre souffre une perte encore plus forte que celle qui rsulte immdiatement dune telle distribution, cest une opinion quAdam Smith lui-mme a adopte ; et si elle est vraie, ce sera une preuve dcisive quune mesure qui peut tre trs-nuisible une colonie, peut tre dun avantage partiel pour la mre-patrie. En parlant des traits de commerce, Adam Smith sexprime ainsi :
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
77
Quand une nation soblige, par un trait, de permettre chez elle lentre de certaines marchandises dun pays tranger, tandis quelle les prohibe venant de tous les autres pays, ou bien dexempter les marchandises dun pays des droits auxquels elle assujettit celles de tous les autres, le pays, ou du moins les marchands et les manufacturiers du pays dont le commerce est ainsi favoris, doivent tirer de grands avantages de ce trait. Ces marchands et manufacturiers jouissent dune sorte de monopole dans le pays qui les traite avec tant de faveur. Ce pays devient un march la fois plus tendu et plus avantageux pour leurs marchandises : plus tendu, parce que les marchandises des autres nations ayant lexclusion ou tant assujetties des droits plus lourds, il absorbe une plus grande quantit de celles quils y portent ; plus avantageux, parce que les marchands du pays favoris, jouissant dans ce march dune espce de monopole, y vendront souvent leurs marchandises un prix plus lev que sils taient exposs la libre concurrence des autres nations.
Or, les deux nations qui font un tel trait de commerce peuvent tre la mre-patrie et ses colonies ; et Adam Smith admet, comme on voit, quune mtropole peut gagner opprimer ses colonies. Nous observerons cependant encore une fois qu moins que le monopole du march tranger ne se trouve entre les mains dune compagnie exclusive, les consommateurs trangers ne paieront pas les marchandises plus cher que les nationaux. Le prix quils paieront, les uns comme les autres, ne sloignera pas beaucoup du prix naturel de ces marchandises dans le pays qui les produit. Par exemple, lAngleterre, dans des circonstances ordinaires, pourra toujours acheter des marchandises franaises leur prix naturel en France, et la France aurait le mme privilge dacheter des marchandises anglaises leur prix naturel en Angleterre. Mais on achterait des marchandises ce prix, sans quil y et besoin dun trait de commerce. Quel serait donc lavantage ou le dsavantage dun semblable trait ? Voici quel serait le dsavantage qui en rsulterait pour le pays qui importerait. Par le trait, il serait forc dacheter une marchandise en Angleterre, par exemple, son prix naturel, tandis quil aurait peut-tre pu lavoir, dans quelque autre pays, un prix naturel plus bas. Le trait produit donc une distribution dsavantageuse des capitaux en gnral, dont souffre principalement le pays qui est born par trait au march le moins avantageux ; mais le trait ne donne aucun avantage au vendeur, en vertu dun prtendu monopole ; car la concurrence de ses compatriotes empche le vendeur de vendre ses marchandises au-dessus de leur prix naturel ; ce quil et fait, soit quil les exportt en France, en Espagne, aux Indes occidentales, soit quil les vendt pour la consommation de lintrieur. En quoi donc consiste lavantage de cette stipulation du trait ? Le voici. Il naurait pas t possible de fabriquer ces marchandises en Angleterre pour lexportation, si ce pays navait pas le privilge exclusif den approvisionner le march en question ; car la concurrence des pays dans lesquels le prix naturel est plus bas lui aurait t toute chance de pouvoir vendre ses marchandises. Cela inquiterait cependant fort peu lAngleterre, si elle tait bien sre de pouvoir vendre pour une valeur aussi forte dautres produits de ses manufactures, soit dans le march franais, soit autre part, avec le mme bnfice. Lobjet que lAngleterre se propose est dacheter en France pour une valeur de 5,000 1. st. de vins ; elle voudrait donc vendre dans un march quelconque, des marchandises qui puissent lui rapporter ces 5,000 1. st. Si la France lui accorde le monopole du drap, lAngleterre y enverra aussitt du drap pour
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
78
lchanger contre le vin dont elle a besoin ; mais si le commerce est libre, la concurrence de lindustrie des autres pays peut empcher que le prix naturel du bl ne soit assez bas pour quen le vendant, elle retire ces 5,000 1., en obtenant en mme temps les profits ordinaires du capital employ dans ce genre de manufacture. Il faut donc que lindustrie de lAngleterre se porte vers un autre objet. Mais il se peut quil ny ait aucun de ses produits, quelle puisse, eu gard la valeur actuelle de largent, vendre au prix naturel des marchandises des autres pays. Quelle en sera la consquence ? Comme les buveurs de vin, en Angleterre, sont encore disposs dpenser 5,000 1. st. en vin de France, il faudra quon exporte dans ce pays 5,000 1. st. en argent pour y acheter ce vin. Cette exportation de numraire en fera hausser la valeur en Angleterre, en la faisant baisser dans les autres pays ; et le prix naturel de tous les produits de lindustrie anglaise baissera aussi en mme temps ; car la hausse du prix de largent quivaut la baisse du prix des marchandises. On pourra alors se procurer les 5,000 1. par lexportation de marchandises anglaises ; car, aprs la rduction de leur prix naturel, elles pourront soutenir la concurrence avec les marchandises des autres pays. Il faudra cependant vendre une quantit plus considrable de marchandises bas prix pour obtenir les 5,000 1. dont on a besoin ; et quand on les aura obtenues, elles ne schangeront plus contre la mme quantit de vin quauparavant ; car pendant que la diminution de numraire en Angleterre y aura fait baisser le pris naturel des marchandises, laugmentation dargent en France y fera monter le prix naturel des marchandises et du vin. On importera donc moins de vin en Angleterre en change de ses produits, quand le commerce sera entirement libre, que lorsque ce pays sera particulirement favoris par des traits de commerce. Cependant, le taux des profits ne varierait pas ; le numraire aurait chang de valeur relative dans les deux pays, et lavantage que la France en retirerait, serait dobtenir une plus grande quantit de marchandise anglaises en change dune quantit dtermine de produits franais ; et la perte pour lAngleterre consisterait en ce quelle obtiendrait une moindre quantit de marchandises franaises en change des marchandises anglaises. Le commerce tranger se soutiendra donc toujours, quon y mette des entraves, quon lencourage, ou quil soit libre ; et il ne peut tre rgl que par le changement du prix naturel, et non par le changement de la valeur naturelle des frais de production dans chaque pays, et ce changement sopre ds quon altre la distribution des mtaux prcieux. Cette explication confirme lopinion que jai mise ailleurs, quil ny a pas dimpt, de prime ou de prohibition sur limportation ou lexportation des marchandises, qui ne donne lieu une diffrente distribution des mtaux prcieux, et qui, par consquent, ne modifie dans tout pays le prix naturel et le prix courant des marchandises. Il est donc vident que le commerce avec les colonies peut tre rgl de manire quil soit en mme temps moins avantageux pour les colonies et plus lucratif pour la mtropole, quun commerce parfaitement libre. De mme quil serait dsavantageux pour un consommateur dtre restreint nacheter que dans une seule boutique, de mme est-il nuisible pour une nation de consommateurs dtre force de nacheter que dans un seul pays. Si la boutique, ou le pays en question, peut fournir les marchandises demandes meilleur march, ils sont bien srs de les vendre sans avoir besoin pour cela daucun privilge exclusif ; et sils ne peuvent pas les livrer au prix le plus bas, lintrt gnral demanderait quon ne les encouraget point continuer un commerce quils ne peuvent pas faire avec un avantage gal celui de leurs
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
79
rivaux. La boutique et le pays qui vendraient exclusivement pourraient perdre ce changement demploi ; mais lintrt gnral nest jamais si bien assur que par la distribution la plus productive du capital gnral cest--dire par un commerce universellement libre. Laugmentation des frais de production ne diminue pas ncessairement la consommation dun produit, si ce produit est de premire ncessit ; car, quoique en gnral les ressources des consommateurs se trouvent diminues par la hausse dune marchandise quelconque, ils peuvent cependant renoncer la consommation de quelque autre produit dont les frais de production nont pas augment. Dans ce cas, loffre et la demande conserveront la mme proportion que par le pass : les frais de production seuls auront augment, et cependant le prix haussera ; et il doit hausser, pour mettre les profits du crateur du produit renchri au niveau des profits des autres commerces. M. Say convient que les frais de production sont le fondement du prix, et pourtant, dans plusieurs endroits de son livre, il soutient que le prix est rgl par la proportion entre loffre et la demande. Le rgulateur rel et dfinitif de la valeur relative de deux produits quelconques, cest ce que la production de chacun a cot, et non les quantits respectives de chacun de ces produits, ni la concurrence parmi les acheteurs. Selon Adam Smith, le commerce colonial de lAngleterre tant un de ceux dans lequel il ne peut avoir demploys que des capitaux anglais, fait monter le taux des profits de tous les autres commerces, et comme, selon lui, les hauts profits, ainsi que les forts salaires, font hausser le prix des produits, le monopole du commerce colonial a t, ce quil croit, nuisible la mre-patrie, dont il a diminu la facult de pouvoir vendre des objets manufacturs un prix aussi bas que les autres pays.
Par leffet du monopole, dit-il, laccroissement du commerce des colonies a bien moins t, pour le commerce gnral de la Grande-Bretagne, la cause dune addition ce quil tait auparavant, que celle dun changement total de direction. Secondement, ce monopole a contribu ncessairement maintenir, dans toutes les branches diffrentes du commerce de la Grande-Bretagne, le taux des profits un degr plus haut que celui o il se serait tenu naturellement, si le commerce avec les colonies anglaises et t ouvert toutes les nations. Or, tout ce qui fait monter dans un pays le taux ordinaire du profit plus haut quil naurait t sans cela, assujettit ncessairement ce pays en mme temps a un dsavantage absolu et un dsavantage relatif dans toutes les autres branches de commerce, dont il na pas le monopole. Il assujettit ce pays a un dsavantage absolu, attendu que, dans toutes les autres branches de commerce, ses marchands ne peuvent retirer ce plus gros profit sans vendre la fois, et les marchandises des pays trangers quils importent dans le leur, et les marchandises de leur propre pays quils exportent ltranger, plus cher quils ne les eussent vendues sans cela. Il faut, la fois, que leur propre pays vende plus cher quil naurait fait sans cela ; quil achte moins et vende moins ; quil jouisse moins et quil produise moins. ..... On entend souvent nos marchands se plaindre des hauts salaires de nos ouvriers, comme tant la cause de ce que les ouvrages de leurs fabriques ne peuvent soutenir la concurrence dans les marchs trangers ; mais on ne les entend jamais parler des hauts profits du capital. Ils se plaignent des gains excessifs des autres, mais ils ne disent rien du leur. Cependant les hauts profits du capital, en Angleterre,
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
80
peuvent contribuer, dans beaucoup de circonstances, autant que les hauts salaires quon y paie aux ouvriers, et, dans quelques circonstances, contribuent peut-tre davantage faire hausser le prix des ouvrages des fabriques anglaises.
Jadmets que le monopole du commerce avec les colonies doit dranger, et quelquefois dune manire dsavantageuse, la direction des capitaux ; mais daprs ce que jai dj dit au sujet des profits, on verra, je crois, quaucun dplacement du commerce tranger et aucun changement du commerce intrieur pour le commerce avec ltranger, ne sauraient affecter le taux des profits. La perte qui en rsultera est celle que je viens dexposer ; elle consiste dans une moins bonne distribution des capitaux et de lindustrie, et par suite dans une diminution de production. Le prix naturel des produits haussera, et par consquent, quoique le consommateur soit en tat dacheter pour une mme valeur en argent, il nobtiendra, avec cet argent, quune quantit moindre de marchandises. Et lors mme que le monopole aurait pour effet de faire hausser les profits, il noccasionnerait pas le moindre drangement dans les prix ; car le prix nest rgl ni par les salaires ni par les profits. Adam Smith lui-mme parait en convenir, quand il dit que le prix des choses, ou la valeur de lor et de largent, compare aux marchandises, dpend de la proportion quil y a entre la quantit de travail ncessaire pour faire arriver au march une certaine quantit dor et dargent, et la quantit de travail ncessaire pour y faire arriver une certaine quantit de marchandises dune autre espce. Cette quantit restera la mme, que les profits et les salaires montent ou baissent. Comment donc le prix peut-il hausser par leffet des hauts profits ?
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
81
Chapitre XXVI.
DU REVENU BRUT ET DU REVENU NET.
Table des matires
Adam Smith exagre toujours les avantages quun pays tire dun grand revenu brut 1, par opposition un grand revenu net. Plus grande sera la portion du capital dun pays consacr lagriculture, et plus la somme de travail productif que ce capital met en uvre deviendra considrable dans lintrieur du pays. Il en sera de mme de la valeur que son emploi ajoute aux produits annuels de la terre et de lindustrie de la communaut. Le capital employ dans les manufactures est celui qui, aprs le capital compar lagriculture, met en uvre la plus grande quantit de travail productif, et ajoute le plus grand accroissement de valeur la
Cest bon droit qu ne considrer que les intrts nationaux, Smith fait cas dun gros revenu brut, cest-dire dune grande masse dutilit produite. On ne devrait parler de revenu net que lorsquil est question des intrts dun particulier par opposition ceux dun autre. Le revenu net dun particulier se compose de la valeur du produit auquel il a concouru, soit par son industrie, soit par ses capitaux, soit par ses terres, moins ses dbourss. Mais comme tous les dbourss quil a faits sont des portions de revenus quil a payes dautres, la totalit de la valeur du produit a servi payer des revenus. Le revenu total dune nation se compose de son produit brut ; cest--dire de la valeur brute de tous ses produits qui se distribue entre les producteurs. Cette valeur, aprs plusieurs changes, se consommerait tout entire dans Ianne qui la vu natre, quelle nen serait pas moins encore le revenu de la nation ; de mme quun particulier qui a 20,000 fr. de revenu annuel, na pas moins 20,000 fr. de revenu annuel, quoiquil le mange tout entier chaque anne. Son revenu ne se compose pas seulement de ses pargnes. - J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
82
production annuelle. Le capital employ au commerce dexportation est le moins productif des trois 1. En admettant pour un moment que cela soit vrai, quel avantage rsultera-t-il pour un pays de lemploi dune grande quantit de travail productif, si; soit quil emploie cette quantit ou une quantit moindre, son revenu et ses profits runis doivent rester les mmes ? Le produit total de la terre et de lindustrie de tout pays se partage en trois portions, dont la premire est destine aux salaires, la seconde aux profits, et la troisime la rente. Ce nest que sur les deux dernires portions quon peut lever des impts, ou faire des pargnes : la premire, si elle est modique, tant toujours gale aux frais ncessaires de production, il serait tout fait indiffrent pour une personne qui sur un capital de 20,000 1. ferait 2,000 1. par an de profits, que son capital employt cent hommes ou mille, et que ses produits se vendissent 10,000 1. ou 20,0001., pourvu que, dans tous les cas, ses profits ne baissassent point au-dessous de 2,000 1. Lintrt rel dune nation nest-il pas aussi garanti ? et ds que son revenu net et rel, que ses rentes et profits sont les mmes, quimporte quelle se compose de dix ou de douze millions dindividus ? Ses facults pour lentretien descadres, darmes, et de toute autre sorte de travail improductif, doivent tre en proportion de son revenu net, et non de son revenu brut. Si cinq millions dhommes pouvaient produire la nourriture et lhabillement ncessaires pour dix millions, la nourriture et lhabillement de cinq millions constitueraient le revenu net. Le pays retirerait-il quelque avantage, si, pour produire ce mme revenu net, il fallait sept millions dhommes, cest--dire, sil fallait que sept millions dhommes fussent employs produire de la nourriture et de lhabillement pour douze millions ? La nourriture et lhabillement de cinq millions seraient toujours le revenu net. Lemploi dun plus grand nombre dhommes ne nous mettrait en tat ni dajouter un homme notre arme ou notre marine, ni de fournir une guide de plus aux impts 2.
1
M. Say est de la mme opinion quAdam Smith. Lemploi le plus productif aprs celui-l, dit-il, pour le pays en gnral, est celui des manufactures et du commerce intrieur, parce quil met en activit une industrie dont les profits sont gagns dans le pays, tandis que les capitaux employs par le commerce extrieur font gagner lindustrie et les fonds de terre de toute les nations indistinctement. Lemploi le moins favorable la nation est celui des capitaux employs au commerce de transport, de ltranger Itranger. Liv. II, chap. 8, 3. (Note de 1Auteur.) Si josais me permettre de faire une critique gnrale de la doctrine de M. Ricardo et de sa manire de traiter plusieurs questions dconomie politique, je dirais quil donne aux principes quil croit justes une telle gnralit quil en regarde les rsultats comme infaillibles. De ce principe, que la classe qui vit de salaires ne gagne que ce qui est rigoureusement ncessaire pour se perptuer et sentretenir, il tire cette consquence, quune industrie qui fait travailler sept millions douvriers nest pas plus avantageuse quune industrie qui en fait travailler cinq millions, se fondant sur ce que, dans lun et lautre cas, les ouvriers consommant tout ce quils gagnent, il ne reste pas plus du travail de sept millions que du travail de cinq millions. Cela ressemble tout fait la doctrine des conomistes du dix-huitime sicle, qui prtendaient que les manufactures ne servaient nullement la richesse dun tat, parce que la classe salarie consommant une valeur gale celle quelle produisait, ne contribuait en rien leur fameux produit net. In univevsalibus latet dolus, a dit Bacon, avec ce bon sens exquis qui la fait nommer le Pre de la saine philosophie. Lorsquon descendra de ces gnralits aux ralits quil faut toujours prendre pour guides, on trouvera que sur sept millions douvriers tous occups, il y aura plus dpargnes faites que sur cinq millions. Ce nest que dans la classe la plus grossire des simples manouvriers que les gains se bornent ce qui est rigoureusement ncessaire pour perptuer cette classe. Du moment quil y a un talent ajout aux facults du simple travailleur, il en rsulte une facult un peu moins commune et moins offerte, circonstance qui ajoute
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
83
Ce nest point en raison daucun avantage suppos provenant dune grande population, ni en raison du bonheur dont peut jouir un plus grand nombre dhommes, quAdam Smith donne la prfrence cet emploi de capital qui met en uvre la plus grande quantit dindustrie ; mais cest expressment en se fondant sur leffet quil lui suppose daugmenter la puissance nationale, car il dit que la richesse et la puissance de toute nation, en tant que la puissance dpend de la richesse, doit toujours tre en proportion de la valeur de sa production annuelle, qui constitue le fonds qui sert en dfinitive payer tout impt. Il est cependant vident que les facults de payer des impts sont en proportion du revenu net et non du revenu brut. Dans la distribution des emplois des capitaux entre tous les pays, le capital des peuples pauvres sera naturellement employ ces genres dindustrie qui font subsister une grande quantit de travailleurs dans lintrieur, parce que, dans de tels pays, on peut se procurer avec le plus de facilit la nourriture et les choses ncessaires pour une population croissante. Dans les pays riches, au contraire, o la nourriture est chre, les capitaux se porteront, si le commerce est libre, vers ces genres dindustrie qui exigent lemploi du plus petit nombre douvriers dans lintrieur : tels sont le commerce de transport, le commerce avec les pays trangers trs-lointains, dans lesquels les profits sont en proportion des capitaux, et non en proportion de la quantit de travail employ 1.
la valeur du travail qui en rsulte. Smith remarque quune intelligence remarquable, une probit scrupuleuse dans cette classe, sont payes au del du taux rigoureusement ncessaire pour perptuer la famille. Aussi voit-on un trs-grand nombre de familles de simples salaris qui font des conomies, augmentent leur bien-tre et leur mobilier, ce qui augmente la somme des pargnes de la socit. Mais quand mme il serait vrai que de sept millions douvriers tous occups il ne sortt pas plus dpargnes que de cinq millions, serait-ce une matire indiffrente que de nourrir lun ou lautre nombre ? Sous le rapport de la puissance nationale, la population, et une population active et industrieuse, nest-elle pas une puissance aussi ? Et si quelque Attila barbare, ou mme quelque Attila civilis attaquait un pays populeux, ne serait-il pas plus facilement repouss que sil ne rencontrait pour sopposer ses armes, que des capitalistes spculateurs occups dans le fond de leur comptoir balancer les prix-courants des principales places de lEurope et de lAmrique? Sous le rapport du bonheur, on peut dire de mme quil y a une plus grande masse de bonheur dans une population de sept millions qui gagne et consomme ce quelle gagne, lve sa famille, et jouit de lexercice de ses facults, que dans une population de cinq millions. Il semblerait que lhomme nest au monde que pour pargner et accumuler ! Il y est principalement pour consommer ce que la nature lui donne gratuitement et ce quil acquiert par son industrie- Produire et consommer, voil le propre de la vie humaine, voil sa fin principale ; cest ce que font les nations qui ne s1vent ni ne dclinent. Si elles peuvent y joindre des pargnes qui, en grossissant leurs capitaux, tendent leur industrie, cest une circonstance favorable sans doute, et vers laquelle elles doivent tendre autant quelles peuvent ; mais ce nest pas une condition essentielle de leur existence. - J.-B. SAY.
1
Il est heureux, dit M. Say, que la pente naturelle des choses entrane les capitaux prfrablement, non l
o ils feraient les plus gros profits, mais o leur action est le plus profitable la socit. Liv. II, chap . 8, 3. M. Say ne nous a pas dit quels taient ces emplois qui, tout en tant les plus profitables pour les particuliers, ne le sont pas de mme pour ltat. Si des pays, ayant des capitaux borns, mais des terres fertiles en abondance, ne se livrent pas de bonne heure au commerce tranger, cest parce que ce commerce prsente moins davantages aux particuliers, et quil est par consquent moins avantageux pour ltat. (Note de 1Auteur.) Ce que M. Ricardo se plaint de ne pas trouver dans mon ouvrage, y est dans un passage que lui-mme a cit quatre pages plus haut. Les emplois de capitaux qui, tout en procurant un profit au propritaire du
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
84
Quoique je convienne que, par la nature du fermage, un capital dtermin employ l'agriculture sur tous les terrains autres que ceux cultivs les derniers, met en activit une plus grande quantit de travail qu'un capital employ dans les manufactures ou dans le commerce, je ne saurais pourtant admettre qu'il y ait la moindre diffrence entre les quantits de travail mises en activit par un capital employ dans le commerce intrieur, et par un pareil capital employ dans le commerce tranger.
Le capital qui envoie Londres, dit Adam Smith, des ouvrages de fabrique cossaise, et rapporte dimbourg du bl anglais et des ouvrages de fabrique ang1ais, remplace ncessairement, dans chacune de ces oprations, deux capitaux appartenant des sujets de la Grande-Bretagne, et qui ont, tous les deux, t employs dans l'agriculture ou les manufactures de la Grande-Bretagne. Le capital qui est employ acheter des marchandises trangres pour la consommation intrieure, quand l'achat se fait avec le produit de l'industrie nationale, remplace aussi, par chaque opration de ce genre, deux capitaux distincts, mais dont un seulement est employ soutenir l'industrie nationale. Le capital qui envoie en Portugal des marchandises anglaises, et qui rapporte en Angleterre des marchandises portugaises, ne remplace, dans chacune des oprations qu'il fait, qu'un seul capital anglais ; l'autre est un capital portugais. Ainsi, quand mme les retours du commerce tranger de consommation seraient aussi prompts que ceux du commerce intrieur, le capital employ dans celui-ci ne donnerait toujours qu'un encouragement de moiti plus faible l'industrie ou au travail productif du pays.
Cet argument me parait fallacieux ; car, quoique deux capitaux, l'un portugais et l'autre anglais, soient employs, ainsi que le suppose le docteur Smith, il y aura cependant un capital employ au commerce tranger; double de celui qui sera employ au commerce intrieur. Supposons que lcosse emploie un capital de 1,000 livres sterling la fabrication des toiles, qu'elle change contre le produit d'un capital pareil employ en Angleterre la fabrication des soieries, ces deux pays emploieront ainsi 2,000 liv. sterl. et une quantit de travail proportionnelle. Supposons maintenant que lAngleterre dcouvre quelle peut obtenir de lAllemagne une plus grande quantit de toiles en change des soieries quelle tait dans lhabitude dexporter en cosse , et que lcosse, son tour, trouve quelle peut obtenir de la France plus de soieries en change de ses toiles quelle nen obtenait auparavant de lAngleterre ; dans ce cas, le commerce entre lAngleterre et lcosse ne cessera t-il pas linstant, et le commerce de consommation intrieure ne sera-t-il pas remplac par un commerce de consommation trangre ? Mais quoique deux capitaux additionnels entrent dans ce commerce, cest--dire le capital allemand et le capital franais, la mme somme de capital
capital, mettent en valeur les facults industrielles des gens du pays, ou les facults productives du sol, augmentent plus les revenus du pays que les emplois qui ne procurent dautre revenu que le simple profit du capital. Il y a mme des emplois de capitaux qui, malgr le profit quils procurent au capitaliste, ne fournissent aucun revenu au pays. Les bnfices quon fait dans le jeu des effets publics, tout bnfice qui ne saurait tre un profit pour l'un sans tre une perte pour quelque autre, est profitable pour le particulier qui gagne, sans1'tre pour le pays. - J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
85
cossais et anglais ne continuera-t elle pas tre employe, et ne mettra-t-elle pas en activit la mme quantit dindustrie que lorsque ces capitaux taient consacrs au commerce intrieur ?
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
86
Chapitre XXVII.
DE LA MONNAIE ET DES BANQUES.
Table des matires
On a dj tant crit sur la monnaie, que, dans le nombre des personnes qui soccupent de cette matire, il ny a gure que les gens prjugs qui puissent en mconnatre les vrais principes. Je me bornerai donc un aperu rapide de quelques unes des lois gnrales qui rglent la quantit et la valeur de la monnaie. Lor et largent, ainsi que toutes les autres marchandises, nont de valeur quen proportion de la quantit de travail ncessaire pour les produire et les faire arriver au march. Lor est quinze fois environ plus cher que largent, non pas que la demande en soit plus forte, ni que largent soit quinze fois plus abondant que lor, mais uniquement en raison de ce quil faut quinze fois plus de travail pour obtenir une quantit dtermine dor. La quantit de monnaie qui peut tre employe dans un pays dpend de sa valeur. Si lor seul tait employ pour la circulation des marchandises, il nen faudrait quun quinzime de ce qui serait ncessaire si largent tait consacr cette fonction.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
87
La monnaie en circulation ne saurait jamais tre assez abondante pour regorger ; car si vous en faites baisser la valeur, vous en augmenterez dans la mme proportion la quantit ; et en augmentant sa valeur vous en diminuerez la quantit 1. Tant que le gouvernement fait frapper des monnaies sans retenir les frais de monnayage, les pices de monnaies ont une valeur gale celle de toute autre pice de mme mtal, dun poids et dune finesse pareils. Mais si le gouvernement retient un droit de monnayage ou de seigneuriage, la pice de mtal frappe excdera en gnral la valeur de la pice non frappe de tout le montant de ce droit, parce quelle aura exig plus de travail, ou, ce qui revient au mme, la valeur du produit dune plus grande quantit de travail pour sa fabrication. Quand ltat seul bat monnaie, il ne peut pas y avoir de limites ce droit de monnayage ; car, en restreignant la quantit du numraire, on peut en lever la valeur indfiniment. Cest en vertu de ce principe que circule le papier monnaie. Toute sa valeur peut tre regarde comme reprsentant un seigneuriage. Quoique ce papier nait point de valeur intrinsque, cependant, si lon en borne la quantit, sa valeur changeable peut galer la valeur dune monnaie mtallique de la mme dnomination, ou de lingots estims en espces 2. Cest encore par le mme principe, cest--dire en bornant la quantit de la monnaie que des pices dun bas titre peuvent circuler pour la valeur quelles auraient eue si leur poids et leur titre taient ceux fixs par la loi, et non pour la valeur intrinsque du mtal pur quelles contiennent. Voil pourquoi, dans lhistoire des monnaies anglaises, nous trouvons que notre numraire na jamais t dprci aussi fortement quil a t altr. La raison en est quil na jamais t multipli en proportion de sa dprciation 3. Le point capital dans lmission du papier-monnaie, cest dtre parfaitement clair sur les effets qui rsultent du principe de la restriction dans les quantits mises en circulation. On voudra peine croire dans cinquante ans que les directeurs de la banque et les ministres ont soutenu la fois devant le Parlement, et devant les Comits nomms par les Parlements, que des missions de billets de la banque dAngleterre, - en les supposant, mne, affranchies de la facult qu'ont les porteurs de
1
Les usages de lor et de largent tablissent donc en chaque lieu un certain besoin de cette marchandise ; et
lorsque le pays en possde la quantit ncessaire pour satisfaire ce besoin, ce qui sintroduit de plus, ntant recherch de personne, forme des valeurs dormantes qui sont charge leurs possesseurs. J.-B. SAY, Liv. I, chap. 17. Dans une autre partie du mme chapitre, M. Say dit que si, pour les communications intrieures dun pays, il fallait lemploi de mille voitures, et quon en possdt quinze cents, tout ce qui excderait les mille serait inutile ; et de l il conclut que si un pays possdait plus que la quantit ncessaire de monnaie, lexcdant resterait sans emploi. (Note de lAuteur).
Cet exemple devrait suffire, ce semble, pour convaincre lauteur que la base de toute valeur est, non pas la quantit de travail ncessaire pour faire une marchandise, mais le besoin quon en a, balanc par sa raret. Le travail, ou en gnral les frais de production, sont une difficult vaincre qui borne la quantit dune marchandise quon peut apporter sur le march, et cest en ce quils sont un des lments de la valeur des choses. Mais quand cette raret est volontaire, leffet est le mme. - J.-B. SAY. Tout ce que je dis des monnaies dor est galement applicable celles dargent, et il serait inutile de les dsigner toutes les deux tout propos. (Note de lAuteur.).
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
88
rclamer des espces ou des lingots, - que ces missions dis-je, n'avaient pas et ne pouvaient pas avoir d'action sur le prix des marchandises ou des lingots, ni sur l'tat des changes. Aprs l'tablissement des banques, l'tat n'a plus lui seul le pouvoir de battre monnaie ou den faire l'mission. On peut tout aussi bien augmenter la monnaie en circulation, au moyen du papier de banque, que par des espces ; en sorte que si un tat altrait ses monnaies et en limitait la quantit, il ne pourrait en maintenir la valeur ; car les banques auraient la mme facult que le gouvernement d'augmenter la quantit de l'agent de la circulation. D'aprs ces principes, il est ais de voir que pour donner une valeur au papier-monnaie, il n'y a pas besoin qu'il soit payable vue en espces monnayes ; il suffit pour cela que la quantit de ce papier soit rgle d'aprs la valeur du mtal qui est reconnu comme mesure commune 1. Si l'or, d'un poids et d'un titre dtermin, tait cette mesure, on pourrait augmenter la quantit du papier chaque baisse dans la valeur de l'or, ou, ce qui revient au mme quant l'effet ; chaque hausse dans le prix des marchandises.
La banque d'Angleterre, dit le docteur Smith, pour avoir mis une trop grande quantit de papier, dont l'excdant lui revenait continuellement l'change, a t oblige, pendant. plusieurs annes de suite, de faire battre de la monnaie d'or jusqu' concurrence de 500,000 livres st. et de 1,000,000 dans une seule anne, ou, par valuation moyenne, jusqu' environ 850,000 liv. st. Pour fournir cette immense fabrication, la banque, a cause de l'tat us et dgrad o la monnaie d'or tait depuis quelques annes, se vit souvent oblige d'acheter jusqu'au prix de 4 liv. st. l'once l'or en lingots, qu'elle mettait bientt aprs sur le prix de 3 liv. st. 17 sh. 10 _ deniers l'once, ce qui lui faisait une perte de 2 _ 3 pour cent sur la fabrication dune somme aussi norme. Ainsi, quoique la banque n'et point de droit de seigneuriage payer, et quoique, proprement parler, la dpense de fabrication ft aux frais du gouvernement, cette libralit du gouvernement ne couvrit pas toute la dpense supporte par la banque.
D'aprs le principe nonc plus haut, il me semble trs-vident qu'en retirant de la circulation le papier qui rentrait ainsi la banque, la valeur de toute la monnaie, y compris celle
1
Cette vrit aurait pu tre nonce par dix auteurs judicieux, et nanmoins tre rvoque en doute par autant d'imbciles, si ce qui est arriv dans ces derniers temps aux billets de la banque d'Angleterre n'tait venu confirmer l'assertion par un mmorable exemple. Le gouvernement anglais ne pouvant, en 1797, rembourser la Banque les avances que cette compagnie lui avait faites, I'autorisa faire une vritable banqueroute, qui dure encore, et ne pas payer ses billets payables vue. Malgr ce manque de foi, et quoique la Banque n'ait point de valeur relle offrir pour gage de ses billets (car les engagements du Trsor ne sont que des promesses), nous avons vu rcemment les billets de banque remonter au pair des espces monnayes, non, comme on affecte de le dire, cause du crdit du gouvernement et de l'esprit national des Anglais qui s'obstine soutenir la valeur des billets (tout leur esprit national n'en pourrait empcher la dprciation si la somme grossissait), mais tout simplement parce que les besoins de la circulation exigent un agent de la circulation qui se monte une certaine somme, c'est--dire une somme qui gale la valeur courante dune certaine quantit d'or ou d'argent ; or cette somme parat avoir t peu excde par les missions de la banque d'Angleterre et des banques de province. C'est une des belles expriences qui aient t faites depuis le commencement de ce sicle en conomie politique, et il s'en prpare d'autres qui ne seront pas moins importantes - J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
89
des anciennes espces monnayes et uses et celle des nouvelles, aurait mont, et, dans ce cas, toutes les demandes sur la banque auraient cess d'tre. M. Buchanan n'est pourtant pas de cette opinion ; car il dit que la grande dpense que la banque a eu supporter cette poque fut occasionne, non comme le docteur Smith parat le supposer, par une mission excessive de papier, mais par l'tat dgrad de la monnaie mtallique, et par le haut prix du lingot qui en tait la consquence. On doit faire attention que la banque, n'ayant d'autre moyen de se procurer des guines 1 que denvoyer des lingots la monnaie pour tre frapps, tait toujours dans la ncessit d'mettre des guines neuves en paiement des billets qui lui revenaient, et quand les espces manquaient en gnral de poids, et que le prix des lingots tait haut proportion, on trouvait un intrt tirer les guines de poids de la banque en lui donnant son papier en change, et ensuite fondre ces guines, et en vendre l'or en lingots, avec profits, pour du papier de la banque, avec lequel on se procurait de nouvelles guines, qu'on fondait et qu'on vendait de mme. La banque doit toujours tre expose se voir ainsi puise de son or toutes les fois que les espces monnayes manqueront de poids, puisque, dans ce cas, il y a toujours un profit ais et certain changer constamment le papier de banque contre de l'or. Il est cependant bon d'observer que, quelle qu'ait t, cette poque, la gne et la dpense supportes par la banque par suite de l'coulement de ses espces, on ne crut pas ncessaire de la dispenser de l'obligation de donner des espces en paiement de ses billets. Il est clair que M. Buchanan pense que toute la monnaie en circulation doit descendre au niveau de la valeur des pices dgrades ; mais certes, en diminuant la quantit de la monnaie en circulation, tout le surplus peut tre lev la valeur des meilleures pices. Le docteur Smith parat avoir oubli le principe qu'il a pos lui-mme, dans le raisonnement qu'il fait au sujet de la monnaie des colonies. Au lieu d'attribuer sa dprciation sa trop grande abondance, il demande si, en admettant que les valeurs coloniales soient parfaitement solides, 100 1. st., payables dans quinze ans, pourraient valoir autant que 100 1. st. payables vue. Je rponds que oui, si le papier n'est pas trop abondant. L'exprience prouve cependant que toutes les fois qu'un gouvernement ou une banque a eu la facult illimite d'mettre du papier-monnaie, ils en ont toujours abus. Il s'ensuit que, dans tous les pays, il est ncessaire de restreindre l'mission du papier-monnaie, et de l'assujettir une surveillance ; et aucun moyen ne parat mieux calcul pour prvenir l'abus de
1
Dans les marchs que le gouvernement conclut avec les particuliers, et dans ceux que les particuliers
concluent entre eux, une pice de monnaie n'est reue, quelque dnomination qu'on lui donne, que pour sa valeur intrinsque, accrue de la valeur que l'utilit de son empreinte y ajoute. - J.-B. SAY, liv. I, chap. 24, 4. La monnaie d'argent est si peu un signe, que les pices de monnaie perdent de leur valeur en s'usant par le frottement ou par la friponnerie des rogneurs despces ; toutes les marchandises augmentent nominalement de prix en proportion de l'altration prouve par elles ; et si le gouvernement fait une refonte quitable et rtablit dans chaque pice la quantit de mtal fin qui s'y trouvait dans l'origine, les marchandises reprennent le prix qu'elles avaient alors, sauf les variations qui ont pu avoir lieu dans la valeur de ces marchandises, par des circonstances qui leur sont particulires. - J.-B. SAY, Liv. I, chap. 21, 6. (Note de l'Auteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
90
cette mission, qu'une disposition qui impose toutes les banques qui mettent du papier, de payer leurs billets, soit en monnaie dor, soit en lingots. Garantir le public 1 contre toutes les variations qui ne seraient pas dtermines par celles de l'talon lui-mme, effectuer les mouvements montaires au moyen de l'agent le moins coteux, serait atteindre le degr de perfection le plus lev auquel on puisse amener la circulation d'un pays. Or, on obtiendrait tous ces avantages si lon obligeait la banque dlivrer, au lieu de guines, et en change de ses billets, des lingots d'or et d'argent, valus au titre, et au prix de la monnaie : de cette manire, toutes les fois que le papier descendrait au-dessous de la valeur des lingots, on en rduirait immdiatement la quantit. Pour empcher que le papier ne s'levt au-dessus des lingots la banque serait en mme temps astreinte changer son papier contre l'or, au titre et au prix de 3 1. 17 s. l'once. Afin de ne pas surcharger les oprations de la banque, les quantits d'or demandes en change de papier, au taux de 3 liv. 17 s. 10 _ et celles offertes raison de 3 1. 17 s. devraient tre de vingt onces au moins. En d'autres termes, la banque serait oblige, partir de vingt livres, dacheter toutes les quantits dor qui lui seraient offertes au prix de 3 1. 17 s. 2 lonce et de vendre celles qui lui seraient demandes au prix de 3 liv. 17 s. 10 _ ; et le soin qu'auraient les administrateurs, de rgler la masse de leur papier la garantirait contre tous les inconvnients qui pourraient rsulter de ces dispositions. La loi devrait laisser en mme temps importer et exporter sans entraves tous les lingots. Ces oprations sur les lingots seraient d'ailleurs trs-rares si la banque s'attachait rapporter ses avances et ses missions au criterium que j'ai dj si souvent indiqu ; criterium qui consiste daris le prix des lingots au titre, indpendamment de la quantit gnrale de papier en circulation. On aurait dj ralis une grande partie de mon projet, si l'on obligeait la banque changer contre ses propres billets des lingots valus au titre et au prix de la monnaie. Ou pourrait mme, sans dangers pour la sret de ses rsultats, l'affranchir de la ncessit d'acheter toutes les quantits de lingots qui lui seraient offertes aux prix dtermins, surtout si les ateliers de la monnaie restaient ouverts au public. En effet, cette disposition tend seulement empcher que la monnaie ne s'carte de la valeur des lingots d'une diffrence plus grande que celle qui spare si lgrement la banque les prix d'achat de ceux de vente ; diffrence qui serait un degr approximatif vers cette uniformit tant dsire.
1 2
Toutes les lignes renfermes dans des guillemets sont extraites d'un pamphlet intitul : Projet dune Circulation conomique et sre. Ce pamphlet a t publi par moi, en 1816. (Note de lAuteur.) Le prix de 6 1. 17 s., que nous avons indiqu ici, est, ncessairement, un prix arbitraire : il y aurait peut-tre d'excellentes raisons pour le fixer un peu plus haut ou un peu plus bas. En disant 3 1. 17s., jai seulement voulu claircir le principe. Le prix devrait tre conu de manire ce que le possesseur de l'or trouvt de l'avantage le vendre la Banque plutt qu'i le faire monnayer par l'administration. La mme observation s'applique la quantit dsigne de vingt onces. Il pourrait tre tout aussi convenable de la porter dix ou quinze.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
91
Si la banque bornait capricieusement le montant de ses billets ; ils hausseraient de valeur, et l'or semblerait descendre au-dessous des limites auxquelles j'ai propose de fixer les achats de la banque. - Dans ce cas on le porterait la monnaie, et les coins qu'il aurait servi frapper, s'ajoutant la circulation, auraient pour effet d'en abaisser immdiatement la valeur et de la ranimer au taux de l'talon. - Mais ces moyens n'offrent ni la scurit, ni l'conomie, ni la promptitude de ceux que j'ai proposs, et auxquels la banque ne saurait opposer d'objection srieuse ; car il est videmment dans son intrt d'alimenter la circulation avec son papier plutt que d'obliger les autres l'alimenter avec du numraire. Sous l'empire d'un tel systme, avec une circulation ainsi dirige, la banque serait affranchie de tous les embarras, de toutes les crises. Les seules ventualits qui pourraient l'atteindre, sont ces vnements extraordinaires, qui jettent la panique sur tout un pays, et font que chacun recherche les mtaux prcieux, comme le moyen le plus commode pour raliser ou cacher sa proprit. - Il n'est pas de systme qui puisse garantir les banques contre de telles ventualits. Leur nature mme les y condamne, car, aucune poque, il ne peut y avoir dans une banque ou dans un pays assez d'espces ou de lingots pour satisfaire aux justes rclamations des capitalistes qui s'y pressent. - Si chacun voulait raliser le mme jour la balance de son compte chez son banquier, il arriverait souvent que la masse de billets de banque actuellement en circulation ne suffirait pas pour rpondre toutes les demandes. C'est une panique de ce genre qui a dtermin la crise de 1797, et non, comme on l'a suppos, les fortes avances que la banque avait faites au gouvernement. Ni la banque, ni le gouvernement n'taient alors coupables. - L'invasion soudaine des bureaux de la banque, prit naissance dans les craintes chimriques qui murent les esprits timides : elle et aussi bien clat dans le cas o la banque n'et fait aucune avance au gouvernement et o sa rserve et t double du montant actuel. - Il est mme probable que, si elle avait continu payer bureaux ouverts et en espces, elle aurait tu la panique avant d'arriver l'puisement de sa rserve 1.
1
Nous ne saurions donner de ce curieux et grave pisode financier un historique plus net et plus complet, que celui dont M. M. Culloch, a enrichi son dition .d'Ad. Smith, et dont nos puisons la traduction dans la belle dition franaise de M. Blanqui. On sent que ce morceau a t crit sur la brche, au spectacle des banques amricaines qui s'croulaient par centaines, des banques provinciales qui chancelaient avant de tomber, et d'un systme de crdit qui menaait de couvrir de ruines le sol de l'Angleterre, dj travaill par la crise industrielle, la disette et les soulvements politique. On pourra reconnatre, dans les lignes qui vont suivre, combien les vnements portent secours aux saines thories, on y pourra voir les mmes principes, les mmes vrits, crites avec des catastrophes et des faillites par la main du temps, et avec des mots et des phrases par les penseurs : car la logique de l'esprit humain n'est si grande que parce qu'elle pressent et devance la 1ogique des faits : La crise la plus importante dans l'histoire de la circulation du papier de la Grande-Bretagne eut lieu en 1797. En partie par suite des vnements rsultant de la guerre o nous tions alors engags, des prts l'empereur d'Allemagne, des traites faites sur le trsor par les agents anglais au dehors, et, en partie, et principalement peut-tre, par suite des larges avances accordes au gouvernement par la banque d'Angleterre, le change devint onreux en 1795, et, cette anne, ainsi que les annes suivantes, il fut demand la banque des quantits normes en espces. Il n'est pas douteux cependant que la dernire crise ne ft entirement due des causes politiques. Des bruits d'invasion, et mme de descentes qui auraient eu lieu sur les ctes, acquirent une certaine gravit pendant la fin de l'anne 1796 et le commencement de 1797. Cette alarme provoqua chez beaucoup de particuliers, mais surtout chez les petits fermiers et les marchands en dtail, un vif dsir de convertir la plus grande partie possible de leur fortune en espce. Une foule redoutable se prcipita sur la plupart des banques de province ; et la banqueroute de quelques-uns de ces tablissements Newcastle, ainsi qu'en d'autres parties du royaume, imprima une force nouvelle la premire panique. La
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
92
banque d'Angleterre fut assaillie de tous les points du territoire par des demandes d'argent, et le fonds d'espces et de lingots renferms dans ses coffres, qui s'tait lev en mars 1795 7,940,000 livres, se trouvait rduit, le samedi 25 fvrier 1797, 1,272,000 livres, avec la perspective d'une violente irruption pour le lundi suivant. Dans cette douloureuse circonstance, le conseil priv se runit et dcida que les paiements en espces seraient suspendus la banque jusqu' ce que le Parlement et pu statuer. A cet effet, un ordre du conseil fut promulgu le dimanche 26 fvrier 1797. Aussitt que commena la suspension, les principaux ngociants, banquiers et armateurs de Londres signrent la rsolution expresse d'accepter les billets de la banque d'Angleterre, et se portrent caution des efforts qu'ils tenteraient pour les faire accepter des autres. Cette rsolution prise conformment l'tat officiel des affaires de la banque qui fut rendu public, et jointe remploi de ses billets dans les paiements publics, prvint toute interruption dans leur circulation ; et, grce la modration qui prsida aux missions, ils continurent pendant trois ans tre parfaitement, quivalents l'or. La premire baisse dans la valeur des billets de banque compars l'or commena vers la fin de 1800. Les faibles rcoltes de cette anne amenrent une exportation considrable de mtaux prcieux ; mais au lieu de diminuer leurs missions, comme le leur ordonnaient les vrais principes, et comme ils eussent t obligs de le faire dans le cas o on leur et impos l'obligation de payer en argent, les directeurs ajoutrent encore la quantit de leurs billets existants, et la consquence immdiate fut que ceux-ci subirent une dprciation de 8 pour 100 compars avec l'or. Mais bientt aprs ils reprirent leur valeur ; et de 1803 1808 inclusivement, ils n'offraient plus qu'un escompte de 2 livres 13 sch. 3 deniers pour 100. En 1809 et 1810 cependant, les directeurs parurent avoir mpris tous les principes qui avaient jusque l gouvern leurs missions. La quantit moyenne de bank-notes en circulation, qui n'avait jamais dpass 17 millions _, ni t au-dessous de 16 millions _ dans aucune des annes de 1802 a 1808 inclusivement, s'leva en 1809 18,927,833 livres, et en 1810 22,541,523 livres. Les missions des banques de provinces accrurent dans un rapport encore plus grand, et comme il ne se manifesta pas un dveloppement relatif dans les affaires du pays, I'escompte sur les bank-notes s'leva, de 2 liv. 13 sch. 2 deniers vers le commencement de 1809, 13 livres 9 schellings 6 deniers, en 1810. Cette chute extraordinaire dans la valeur du papier compare celle de l'or, jointe comme elle le fut une baisse gale dans le change, excita au plus haut point l'attention, et en fvrier 1810, un comit de la Chambre des Communes fut dsign pour rechercher les causes du haut prix des lingots dor, et de l'tat du change. Le comit consulta plusieurs ngociants et banquiers, et son rapport, principalement rdig par M. Francis Horner, renferme une habile rfutation des chiffres et des doctrines poss par ceux qui soutenaient que la baisse du change et le haut prix des lingots devaient tre entirement attribus nos dpenses au dehors et l'tat spcial de nos relations avec les autres puissances, et ne tenaient nullement aux quantits additionnelles de papier qui taient venues grossir la circulation. Mais la Chambre des communes refusa de sanctionner le projet par lequel le comit invitait la banque reprendre ses paiements en espces au bout de deux ans. Aussi, en mai 1811, poque laquelle les guines emportaient couramment une prime, et o les bank-notes prouvaient un escompte avou de plus de 10 pour 100 compars aux lingots d'or, la Chambre des communes adopta, une grande majorit, la rsolution propose par M. Vansittart (actuellement lord Bexley), dclarant que les engagements de la banque d'Angleterre Avaient t jusqu'alors, et taient encore en ce moment considrs dans l'opinion publique comme quivalents la monnaie lgale du royaume. Cette rsolution, tellement extraordinaire qu'elle tait contraire au simple bon sens, dgagea les directeurs de la banque de toute crainte relativement lintervention du Parlement, et les encouragea accrotre le nombre de leurs billets en circulation. Les missions des banques provinciales saugmentrent encore plus rapidement que celles de la banque dAngleterre. La facilit dtre admis lescompte fut telle, que des individus qui pouvaient peine payer le timbre de leurs billets russirent trs-frquemment obtenir de vastes capitaux ; et comme ils ne risquaient rien personnellement, ils se livrrent audacieusement aux spculations les plus hasardes. M. Wakefield, dont la position lui offrit tant doccasions de recueillir des renseignements exacts, informa le comit dagriculture, en 1821, que jusqu lanne 1813, il existait des banques sur presque tous les points du territoire, qui foraient lentre de leur papier dans la circulation au prix dnormes dpenses pour elles-mmes, et, en beaucoup de cas, aux prix de leur ruine. Et parmi les diverses rponses qui furent adresses aux enqutes du conseil dagriculture en 1816 par les citoyens les plus intelligents des diffrents districts du pays, il en est peine une dans laquelle 1mission exagre des billets de banque ne soit pas particulirement dsigne comme lune des causes prdominantes de la hausse,
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
93
sans antcdent encore, qui avait atteint les rentes et les prix. Le prix du bl stait lev un chiffre extraordinaire pendant les cinq annes qui finirent en 1813. Mais partie en raison de la brillante rcolte de cette anne, partie, et principalement peut-tre par suite de louverture des ports hol1andais et du renouvellement des relations avec le continent, les prix .flchirent considrablement vers la fin de lanne 1813 et le commencement de 1814. Et cette baisse ayant produit un manque de confiance, et rpandu lalarme parmi les banques de province et leurs clients, dtermina une destruction de papier de province qui na pu tre gale que par celle de 1825. En 1814, 1815 et 1816, on ne vit pas moins de 240 banques suspendre leurs paiements ; 89 accusations de banqueroute furent lances contre ces tablissements, et cela dans le rapport dune accusation contre 10 _.banques de province existant en 1813. Les faillites qui souvrirent alors furent les plus dsastreuses, car elles atteignaient principalement les classes ouvrires, et dvoraient ainsi en un moment les fruits dune longue vie de travail et dconomie. Des milliers dindividus, qui avaient en 1812 rv laisance, se trouvrent dpourvus de toute vritable proprit, et plongs, comme par enchantement, sans quil y et faute de leur part, dans labme de la pauvret. La destruction du papier des banques de province en 1814, 1815 et 1816, en rduisant la masse totale mise en circulation, leva sa valeur, en 1816, une presque galit avec lor. Et cette hausse ayant matriellement facilit un retour aux paiements en espces, on commena tre gnralement convaincu de lopportunit quil y aurait rapporter le dcret sur les paiements en argent de la banque dAngleterre. Ceci fut effectu en 1819 par lacte 59 de Georges III, chap. 78, communment appel bill de Peel, parce quil avait t propos et obtenu la Chambre des communes par sir Robert Peel. On sera justement tonn que, malgr la leons svres des banqueroutes de 1793, 1814, 1815 et 1816, occasionnes dune manire si funeste par le systme des banques de province, il ne fut fait aucun pas en 1819, mme aprs la reprise des paiements en espces pour reconstituer ce systme et le fonder sur des bases plus solides. Les nations sont des coliers lents et rtifs, et il semble quune exprience complmentaire tait ncessaire pour convaincre le parlement et le peuple dAngleterre quil existait quelque chose de dfectueux dans un systme qui, dans deux circonstances antrieures, avait inond le pays de banqueroutes, et qui dcernait tout individu, mme pauvre ou sans principes, mais qui se sent port tre banquier, le droit dmettre des billets qui serviront comme monnaie dans les transactions habituelles de la socit. La crise qui survint en 1825 et 1826 fut le rsultat naturel de cet tat de choses, et et pu tre prvue par tout individu instruit des principes sur lesquels doivent se baser les oprations des banques, ou de lhistoire prcdente de ces banques dans le pays. Ces vnements persuadrent enfin le Parlement et le public de ce dont ils eussent d tre convaincus longtemps avant, cest--dire que le systme des banques prives en Angleterre et dans les Galles tait au plus haut degr faible et vicieux, et quil tait imprieusement ncessaire de le rformer et le fortifier. Dans ce dessein, lacte de 1708, limitant le nombre des associs dune banque six, fut rapport avec le consentement de la banque dAngleterre. Permission fut accorde dtablir des joint-stock banks, banques fonds runis ou par actions, composes dun nombre illimit dactionnaires, pour lmission de billets payables sur tous les points du territoire, mais au del dun rayon de soixante-cinq milles seulement, autour de Londres. On autorisa en mme temps linstitution, Londres, de joint-stock banks pour les dpts ou banques destines prendre soin de largent de leurs commettants. Aprs les restrictions imposes aux paiements en espces, en 1797, la Banque dAngleterre commena mettre, pour la premire fois, des, billets dune livre, opration dans laquelle elle fut imite par la plupart des banques de province. La premire retira ses billets dune livre peu aprs la reprise des paiements en espces, en 1821 ; mais les billets similaires des banques de province continurent a circuler, et formrent un des principaux canaux par lesquels elles faisaient pntrer leur papier dans la circulation. En 1826, cependant, lmission des billets dune livre fut dfinitivement prohibe aprs une certaine poque spcifie en Angleterre et dans les Galles; et, depuis 1829, il ne fut plus permis de crer des billets de moins de cinq livres. La dernire de ces mesures rparatrices, cest--dire la suppression de billets dune livre, a indubitablement ferm une des voies les plus aises et les plus sres dont se servaient les classes infrieures des banques de province pour couler leur papier, et elle a t sous ce rapport trs-avantageuse. Mais un grand nombre dautres routes leur demeurent ouvertes ; et lexemple de 1792-93, alors quil nexistait point de billets au-dessous de cinq livres en circulation, dmontre victorieusement que la suppression des billets dune livre noffre aucune scurit contre les sur-missions, les paniques, contre rien enfin, sinon contre une
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
94
Si l'on rflchit l'opinion des directeurs de la banque sur les rgles qui gouvernent les missions de papier, on verra qu'ils n'ont us de leur privilge qu'avec discrtion. Il est mme vident, quanims par des principes arbitraires, ils ny ont obi quavec une extrme prudence. - Les termes actuels de notre 1gislation leur conservent le pouvoir daccrotre ou de rduire, sans contrle et dans les proportions quils jugeront convenables, lensemble de la circulation. Un tel pouvoir ne devrait appartenir aucune association, pas mme ltat ; car il ne peut y avoir aucune garantie duniformit dans un systme o la volont seule des crateurs de la monnaie peut en dcrter laugmentation ou la diminution. La banque peut rduire aujourdhui la circulation aux limites les glus extrmes ; cest un fait que ne nieront mme pas ceux qui pensent avec les directeurs, quils nont pas le pouvoir de multiplier linfini les signes montaires. Je suis pleinement convaincu qu'il rpugne aux intrts et la volont de la banque, d'exercer ce privilge au dtriment du public, mais l'aspect des maux qui peuvent rsulter d'une rduction ou dune augmentation soudaine des agents montaires, je ne puis que dplorer la facilit avec laquelle l'tat a arm la banque d'une prrogative aussi formidable. Les difficults auxquelles taient restes soumises les banques provinciales avant la suspension des paiements en numraire ont d prendre, certaines poques, un caractre srieux. - Aux moindres symptmes d'une crise relle ou imaginaire, elles taient astreintes se pourvoir de guines et s'armer contre les exigences des porteurs. - Elles faisaient alors un appel la banque. Elles y changeaient leurs propres billets contre des guines, qu'un agent de confiance transportait ensuite leurs frais et risques. Aprs avoir accompli les fonctions
banqueroute universelle. Ce fut cependant de la seconde mesure, celle autorisant ltablissement des joint-stock banks, quon attendait les plus grands avantages. Peut-tre serait-ce une exagration que daffirmer que ces esprances ont t compltement dues ; mais, si quelques attentes ont t ralises, elles sont bien peu importantes. Il aurait t, en effet, facile de prdire, lorigine de cette institution, comme cela eut lieu, du reste, que le seul tablissement des joint-stock banks ne fournirait aucun remde contre les maux primitivement inhrents notre systme financier. Une banque avec sept, soixante-dix ou sept cents associs peut ntre pas appele plus de crdit quune autre banque avec cinq ou six, et peut-tre mme moins. La fortune des associs dune banque prive peut excder celle des associs dune vaste banque par actions ; et il est probable que les oprations de la plus petite banque tant conduites par les intrts eux-mmes, le seront plus prudemment et plus conomiquement que celles dune grande banque, qui doivent ncessairement tre confies des agents sur lesquels ne plane quun contrle inefficace. On ne peut concevoir de plus grande erreur que celle qui dcide que parce quune banque a un plus grand nombre dassocis, elle est plus digne de la confiance publique. Celle-ci devant dpendre de leur richesse et de leur intelligence, mais non de leur nombre : ce serait substituer la masse au mrite. La richesse seule ne peut suffire a mettre en rapport les missions de papier avec les besoins. Les joint-stock banks demeurent aussi loin, et, si cela est possible, plus loin mme de ce criterium que les banques prives. Cest, meffet, la plus grossire des erreurs et des illusions, que de supposer quil est possible de faire disparatre les fluctuations dans la masse et la valeur de la monnaie, par cela seul quelle sera fournie par diffrents agents. Tant quun individu ou une runion dindividus, quelque tars quils puissent tre, jouiront du privilge royal dmettre du papier sans autorisation ni obstacles, on verra ce papier saccrotre dmesurment aux poques de confiance, et disparatre aussitt que les prix et la confiance sbranleront. Si lon dsire que le pays soit jamais dvor par .une fivre intermittente; et livr tantt aux accs de surexcitation, tantt un tat datonie qui en est la suite invitable, il nest pas de meilleur moyen employer que notre systme financier actuel. Mais nous pensons que le lecteur se joindra nous, dans la pense quune fivre de cette nature est aussi fatale au corps politique quau corps physique ; et que si lon nopre une cure radicale, elle paralysera et dtruira le malade. MAC CULLOCH.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
95
auxquelles elles taient destines, les guines revenaient Londres, et il est fort probable qu'elles retournaient dans les caisses de la banque toutes les fois que ces dplacements successifs n'avaient pas eu assez d'action pour en diminuer le poids et les rduire au-dessous du type lgal. Si l'on adoptait le plan que j'ai propos de payer les billets de banque en lingots, il faudrait tendre ce privilge aux banques provinciales ou donner aux bank-notes le caractre de monnaie lgale. - Dans ce dernier cas, on se trouverait n'avoir introduit aucun changement dans la lgislation qui rgit ces tablissements ; car ils seraient alors sollicits, comme aujourd'hui, rembourser leur papier en billets de la banque d'Angleterre.
Ce systme, en nous permettant. de ne pas exposer les guines au frottement et la diminution de poids qui rsultent de dplacements multiplis, en nous affranchissant aussi de tous les frais de transports, nous procurerait dj une conomie considrable ; mais l'avantage qui rsulterait, pour la marche des petits paiements, serait bien plus sensible encore. En effet la circulation de Londres et des provinces s'effectuerait alors au moyen d'un agent bon march, le papier, et dlaisserait un agent onreux, l'or ; - ce qui enrichirait le pays de tous les bnfices que peut produire l'or abandonn. Il serait donc insens de renoncer de tels avantages, moins que l'on ne dcouvrt dans l'emploi d'un agent bas prix des inconvnients manifestes. La monnaie est dans l'tat le plus parfait quand elle se compose uniquement de papier, mais d'un papier dont la valeur est gale la somme d'or qu'il reprsente. L'usage du papier en place de l'or remplace un agent trs-dispendieux au moyen d'un autre qui l'est fort peu, ce qui met le pays, sans qu'il en rsulte aucune perte pour les particuliers, en tat d'changer tout l'or qu'il employait auparavant pour la circulation, contre des matires premires, des ustensiles et des subsistances, dont l'usage augmente la fois la richesse et les jouissances de la nation. Sous le point de vue de l'intrt national, il est tout fait indiffrent que ce soit le gouvernement ou une banque qui fasse l'mission d'un papier-monnaie, si cette mission est dirige d'aprs les sages principes que nous venons d'exposer. Que ce soit l'un ou l'autre qui l'mette, il en rsultera peu prs le mme accroissement de richesse nationale ; mais leffet ne sera pas le mme quant lintrt des particuliers. Dans un pays o le taux courant de l'intrt est de 7 pour cent, et o le gouvernement a besoin, pour des dpenses particulires, de 70,000 liv. st. par an, il importe beaucoup aux individus de ce pays, de savoir s'ils paieront ces 70,000 liv. par an impt annuel, ou s'ils pourront les obtenir sans payer pour cela dimpt. Supposons qu'il faille un million en argent pour prparer une expdition. Si le gouvernement mettait un million de papier-monnaie l'expdition se ferait sans qu'il en cott rien la nation ; mais si en dplaant ainsi un million d'argent monnay, une banque faisait l'mission d'un million de papier, et qu'elle le prtt au gouvernement a 7 pour cent, en dplaant de mme un million de numraire, le pays se trouverait grev d'un impt perptuel de 70,000 liv. par an. La nation paierait l'impt, la banque le recevrait, et la nation resterait, dans les deux cas, aussi riche qu'auparavant. L'expdition aura t rellement faite au moyen du systme, par lequel on rend productif un capital de la valeur d'un million, en le convertissant en denres, au lieu de le laisser improductif sous la forme de numraire ; mais l'avantage serait, toujours pour ceux qui mettraient le papier ; et comme le gouvernement reprsente la nation, la nation
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
96
aurait pargn l'impt, si elle, et non la banque, avait fait l'mission de ce million de papier-monnaie. J'ai dj observ que, s'il pouvait y avoir une entire garantie qu'on n'abuserait point de la facult d'mettre du papier-monnaie, il serait tout fait indiffrent pour la richesse nationale, prise collectivement, par qui ce papier ft mis ; et je viens de faire voir que le public aurait un intrt direct ce que ce ft ltat, et non une compagnie de marchands ou de banquiers, qui fit cette mission. Il serait cependant plus craindre que le gouvernement nabust de cette facult quune compagnie de banquiers. Une compagnie est, dit-on, plus dpendante des lois ; et quoiquil pt tre de son intrt de multiplier ses billets au-del des bornes prescrites par la prudence, elle serait force de sy renfermer, et de restreindre lmission de son papier, par la facult quauraient les particuliers dexiger des lingots ou des espces en change des billets de banque. On prtend que, si le gouvernement avait le privilge dmettre du papier, il ne respecterait pas longtemps cette disposition qui le gnerait ; on croit quil serait trop port sacrifier la tranquillit de lavenir lintrt du moment, et quil pourrait par consquent, en allguant des motifs durgence, se dbarrasser de toute entrave qui bornerait le montant de ses missions de papier. Cette objection est dun grand poids quant un gouvernement absolu ; mais dans un pays libre, avec une lgislature claire, la facult dmettre du papier avec la clause indispensable quil soit changeable au gr du porteur, pourrait tre en toute sret confie des commissaires nomms spcialement pour cet objet, et on pourrait les rendre entirement indpendants de linfluence des ministres. Le fonds damortissement est administr par des commissaires qui ne sont responsables de leur gestion quau parlement, et le placement des sommes qui leur sont confies se fait avec la plus grande rgularit ; quelle raison peut-il donc y avoir de douter que lmission du papier ne pt tre rgle avec la mme exactitude, si on la confiait une administration du mme genre 1 ?
On pourrait objecter que, quoique lavantage que tirerait ltat, et par consquent le public, de ce mode dmission de papier-monnaie, soit assez vident, puisquon convertirait par l une partie de la dette nationale portant un intrt pay par le public, en dette sans intrt ; on pourrait objecter, dis-je, que cependant cela serait nuisible au commerce ; en empchant les ngociants demprunter de largent, et descompter leurs lettres de change ce qui forme, en partie, la manire dont se fait lmission des billets de banque.
1
Si cette proposition faite au gouvernement anglais de se mettre la place de la banque de Londres et de celle des provinces, et de fournir, au lieu delles, le papier qui sert dagent de la circulation, tait adopte, lAngleterre acquitterait dun coup pour un milliard et demi de francs de sa dette, et se librerait dun intrt annuel de soixante-quinze millions de francs environ. Riais quest-ce que soixante-quinze millions dintrt lorsquon est oblig den payer annuellement pour environ un milliard (compris lintrt des bons du trsor) ? Dailleurs, tant que les dpenses du gouvernement ne seront contrles, comme prsent, que par une chambre de la majorit de laquelle les ministres disposent, on peut sattendre quaucune conomie ne tournera au profit de ltat. Soixante-quinze millions pargns sur lintrt de la dette ne sont, pour le gouvernement, quun moyen de dpenser soixante-quinze millions de plus en intrigues dans les cabinets de lEurope, en folies guerres dcores de beaux motifs, en grces et en moyens dinfluence pour maintenir la prpondrance de lintrt privilgi aux dpens du public. Il ny a dconomie profitable pour les nations que lorsquune reprsentation forte et indpendante tient vritablement les cordons de la bourse, et ne louvre que pour payer un petit nombre de fonctionnaires absolument indispensables pour maintenir lordre public. Jusque l il ne peut y avoir que des rapines lgalises. - J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
97
Cela suppose quil serait impossible de trouver de largent emprunter si la banque nen prtait pas, et que le taux courant de lintrt et des profits tient au montant de lmission de la monnaie et la voie par laquelle se fait cette mission ; mais comme le pays ne manquerait ni de drap, ni de vin, ni daucune autre marchandise, sil avait les moyens de lacheter, de mme on ne manquerait pas dy trouver de capitaux prter, pourvu que les emprunteurs eussent de bonnes garanties, et fussent disposs payer le taux courant de lintrt pour largent prt. Dans une autre partie de cet ouvrage, jai tch de faire voir que la valeur relle dune chose se rgle, non daprs les avantages accidentels dont peuvent jouir quelques-uns de ses producteurs, mais bien daprs la difficult relle quprouve le producteur le moins favoris. Il en est de mme par rapport lintrt de largent ; il ne se rgle pas daprs le taux auquel la banque veut prter, que ce soit 5, 4 ou 3 pour cent, mais bien daprs le taux des profits quon peut retirer de lemploi des capitaux, et qui est tout fait indpendant de la quantit ou de la valeur de largent. Quune banque prte un, dix ou cent millions, cela napportera aucun changement au taux courant de lintrt ; la banque ne fera que changer la valeur de la monnaie quelle mettra ainsi en circulation. Dans lun de ces cas, il faudra dix ou vingt fois plus de monnaie pour faire un certain commerce, quil nen faudrait dans lautre. La demande dargent la banque dpend donc du taux des profits quon peut retirer de son emploi, compar avec le taux dintrt auquel la banque le prte. Si elle prend moins que le taux courant de lintrt, elle peut prter indfiniment ; si elle prend plus que ce taux, il ny aura que des dissipateurs et des prodigues qui consentent lui emprunter. Cest pourquoi nous voyons que toutes les fois que le taux courant de lintrt excde 5 pour cent, qui est le taux auquel la Banque prte toujours, son bureau descompte est encombr de gens qui demandent de largent, et au contraire, quand le taux courant est, mme pour peu de temps, au-dessous de 5 pour cent les commis de ce bureau nont rien faire. Ce qui a donc fait dire que la banque dAngleterre avait, pendant les derniers vingt ans, donn de grands secours au commerce, en prtant de largent aux commerants, cest que pendant toute cette poque, elle a prt de largent au-dessous du taux courant de lintrt sur la place, cest--dire au-dessous du taux auquel les commerants pouvaient emprunter ailleurs ; mais, quant moi, javoue que cela me semble plutt une objection contre cet tablissement , quun argument en sa faveur. Que dirait-on dun tablissement qui approvisionnerait rgulirement la moiti des fabricants de drap, de laine, au-dessous du prix courant du march ? Quel bien cela ferait-il la communaut ? Cela ne donnerait pas plus dtendue notre commerce ; car la laine aurait t achete galement si on lavait vendue au prix courant du march. Cela ne ferait pas baisser le prix du drap pour le consommateur, parce que le prix, comme je lai dj dit, se rgle daprs ce que la production du drap cote aux fabricants les moins favoriss. Lunique effet que cela produirait serait donc de grossir les profits dune partie des fabricants de drap au del du taux gnral et ordinaire des profits des autres. Ltablissement suppos se priverait dune partie de ses justes profits pour en faire jouir une autre partie de la communaut. Tel est prcisment leffet de nos tablissements de banque. La loi fixe un taux dintrt au-
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
98
dessous de celui auquel on le trouve emprunter sur la place, et cest au taux lgal quon exige que la banque prte, en lui interdisant de prter un autre. Par la nature de son tablissement, la banque possde des fonds considrables quelle ne peut placer que de cette manire ; et il en rsulte quune partie des commerants du royaume en tire un avantage indu, et qui est tout fait perdu pour la nation, en obtenant ainsi un instrument du commerce un taux plus bas que les personnes qui sont forces dtre sous linfluence du prix courant de la place. La somme totale des affaires de commerce que la communaut peut faire, dpend de la quantit de son capital, cest--dire des matires premires, des machines, des subsistances, des navires, etc., employs la production. Aprs ltablissement dun papier-monnaie sagement rgl, les oprations des banques ne sauraient augmenter ni diminuer la somme de ce capital. Si le gouvernement faisait donc lmission dun papier-monnaie national, quoiquil nescomptt pas un seul effet, et ne prtt pas un seul schilling au public, il ny aurait pais la moindre altration dans le mouvement du commerce ; car il y aurait la mme quantit de matires premires, de machines, de subsistances, de navires, etc., et vraisemblablement il y aurait autant dargent prter, non pas, la vrit, 5 pour cent, taux fix par la loi, mais 6, 7 ou 8 pour cent, - ce qui serait le rsultat de la concurrence franche, sur le march, entre les prteurs et les emprunteurs. Adam Smith parle des avantages que les marchands retirent en cosse, par la manire dont les banques de ce pays traitent les commerants, en ouvrant des comptes courants, systme qui lui parait trs-suprieur celui adopt en Angleterre. Ces comptes courants, ou de caisse, sont des crdits que le banquier cossais donne aux ngociants, en sus des lettres de change quil leur escompte ; mais comme le banquier, mesure quil avance de largent et quil le met en circulation par une voie, se trouve dans limpossibilit dans mettre par une autre, il nest pas ais de concevoir en quoi cet avantage consiste. Si toute la circulation na besoin que dun million de papier, il nen circulera quun million ; il ne peut pas tre dune importance relle pour le banquier ou pour le commerant, que cette somme soit mise en escompte de lettres de change, ou quune partie seulement soit employe cet usage, le reste tant mis sous la forme de ces comptes de caisse. Il me semble ncessaire de dire quelques mots au sujet des deux mtaux, lor et largent, qui sont employs comme monnaie, surtout parce que cette question parait avoir, dans lesprit de beaucoup de personnes, jet de lobscurit sur les principes vidents et simples de la thorie des monnaies. En Angleterre, dit le docteur Smith, on ne fut pas lgalement admis sacquitter en or, mme longtemps aprs quon y et frapp des monnaies dor. Aucune loi ou proclamation publique ny fixait la proportion entre lor et largent; on laissait au march la dterminer. Si un dbiteur offrait de payer en or, le crancier avait le droit de refuser tout--fait, ou bien daccepter cette offre daprs une valuation de lor faite lamiable entre lui et son dbiteur. Dans un tel tat de choses, il est vident quune guine aurait tantt pass pour 22 sh. ou plus, et quelquefois elle naurait valu que 18 sh. ou moins, ce qui aurait dpendu uniquement du changement de la valeur courante relative de lor et de largent. Et toutes les variations
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
99
dans la valeur de lor, aussi bien que celles dans la valeur de largent, auraient t estimes en monnaie dor, comme si largent avait eu une valeur invariable, tandis que lor aurait t sujet monter ou baisser de prix. Quoique une guine passt pour 22 sh. au lieu de 18 sh., lor aurait pu ne pas avoir chang de valeur, cette diffrence tant uniquement due celle de largent ; et par consquent 22 sh. pouvaient navoir pas plus de valeur que 18 sh. nen avaient auparavant ; et, au contraire, toute cette diffrence aurait pu tre due lor, une guine qui valait 18 sh. ayant pu hausser jusqu valoir 22 sh. Si, maintenant, nous supposons la monnaie dargent rogne et en mme temps augmente en quantit, la guine pourrait passer pour 30 sh., parce que largent contenu dans ces 30 sh. de monnaie dgrade, pourrait navoir pas plus de valeur que lor dune guine. En rendant aux pices dargent monnay leur valeur intrinsque, largent monnay hausserait de prix ; mais lor paratrait tomber, car une guine ne vaudrait probablement pas alors plus de 21 bons shillings. Si lor devient aussi un moyen lgal de paiement, et que chaque dbiteur soit libre dacquitter une dette de 21 l. st., en payant 420 sh., ou 21 guines, il paiera en or ou en argent, selon quil aura lun ou lautre meilleur march. Sil peut, avec cinq quarters de froment, acheter autant dor en lingots que la monnaie en met dans vingt guines ; et si, avec la mme quantit de froment, il peut acheter autant dargent en lingots que la monnaie en emploie frapper 430 shillings, il aimera mieux acquitter sa dette en argent ; car il gagnera par l 10 shillings. Mais si, au contraire, il pouvait avec ce froment se procurer assez dor pour faire frapper 20 guines et demie, et seulement autant dargent quil en faudrait pour frapper 420 shillings, il prfrerait naturellement acquitter sa dette en or. Si la quantit dor quil pourrait obtenir ne rendait, tant frappe, que 20 guines ; et si largent obtenu de mme ne donnait que 420 shillings, il lui serait parfaitement gal dacquitter sa dette en or ou en argent. Ce nest donc pas une affaire de pur hasard ; ce nest jamais parce que lor convient mieux pour agent de la circulation dun pays riche, quon le prfre largent pour acquitter des dettes ; cela vient uniquement de ce quil est de lintrt du dbiteur de les acquitter dans ce mtal. Pendant un temps considrable, avant lanne 1797, date de la suspension des paiements en espces, lor tait si bas prix, compar largent, quil tait avantageux la banque dAngleterre, ainsi qu tout autre dbiteur, dacheter de lor, et non de largent, pour le faire frapper la monnaie, car on pouvait acquitter les dettes meilleur compte dans ces espces monnayes. Largent monnay fut, pendant une grande partie de cette poque, trs-dgrad ; mais comme il tait rare, il ne baissa jamais dans sa valeur courante, et cela, en raison du principe que je viens dexpliquer. Quoique la monnaie dargent ft si dgrade, ctait toujours lintrt des dbiteurs de payer en or. Si, cependant, cette monnaie dargent dgrade et t extrmement abondante, les dbiteurs auraient pu trouver de lavantage sen servir pour acquitter leurs dettes ; mais la quantit en tant borne, sa valeur se soutenait, et par consquent lor tait, dans le fait, la vritable monnaie courante.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
100
Personne nen a jamais dout ; mais on a prtendu que cela tait leffet de la loi qui avait dclar que largent ne serait pas un moyen lgal de paiement pour toute somme au-dessus de 25 1. st., moins quil ne ft pris daprs son poids, et au titre de la monnaie. Mais cette loi nempchait aucun dbiteur de payer une dette, quelque forte quelle ft, en argent monnay sortant de la Monnaie ; et si les cranciers ne payaient pas avec ce mtal, ce ntait ni par un effet du hasard ni par force, mais uniquement parce quil ne leur convenait pas de porter leur argent la Monnaie pour ly faire frapper, tandis quil leur convenait fort dy porter de lor. Il est vraisemblable que si la quantit de cette monnaie dgrade dargent en circulation et t extrmement multiplie, et quelle et t en mme temps un moyen lgal de paiement, il est probable, dis-je, quune guine et acquis de nouveau la valeur de 30 shillings ; mais, dans ce cas, cest le shilling dgrad qui aurait baiss de valeur, et non la guine qui aurait mont. Il parat donc que, tant que ces mtaux ont t lgalement recevables en paiement des dettes dune valeur quelconque, on est rest constamment expos des variations dans la mesure principale de la valeur. Lor ou largent ont t tour tour cette mesure ; ce qui provint entirement des variations dans la valeur relative des deux mtaux Aussi toutes les fois quun des deux cessa dtre la mesure de la valeur, on le fondit en le retirant de la circulation, parce que sa valeur en lingots excdait celle quil avait en monnaie. Ctait un inconvnient quil importait beaucoup de faire disparatre ; mais telle est la marche lente de toute amlioration, que, quoique Locke let dmontr sans rplique, et que les crivains qui, depuis, ont crit sur les monnaies, en aient fait mention, ce nest que dans la dernire session du Parlement, en 1816, quil a t dclar que lor seul tait un moyen de paiement lgal pour toute somme excdant quarante shillings. Le docteur Smith ne parat pas avoir bien compris les effets qui rsultent demployer la fois deux mtaux comme monnaie courante et comme moyen lgal de paiement des dettes, quel quen soit le montant ; car il dit : Dans le fait, pendant tout le temps que dure et continue une proportion dtermine entre la valeur respective des diffrents mtaux monnays, la valeur du plus prcieux des deux rgle celle de toutes les espces monnayes. Parce que, de son temps, lor tait le mtal que les dbiteurs prfraient pour acquitter leurs dettes, il a cru que ce mtal possdait quelque proprit qui lui tait inhrente, et moyennant laquelle il rglait cette poque, comme il devait rgler toujours la valeur de la monnaie dargent. A lpoque de la refonte des monnaies dor, en 1774, une guine nouvellement frappe la Monnaie ne schangeait que contre 21 shillings dgrads ; mais sous le roi Guillaume, la monnaie dargent tant galement dgrade, une guine nouvellement frappe schangeait contre 30 shillings. L-dessus M. Buchanan fait lobservation suivante : Voici donc un fait trs-singulier, et duquel les thories reues noffrent aucune explication ; nous voyons une poque la guine schangeant contre 30 shillings dgrads (qui tait sa valeur intrinsque), et plus tard cette mme guine ne schangeant plus que contre 21 de ces mmes schillings dgrads. Il faut ncessairement quil se soit opr quelque changement remarquable dans
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
101
ltat des monnaies entre ces deux poques, changement sur lequel le docteur Smith ne donne aucun claircissement. Il me semble que la solution de cette difficult est trs-aise, si lon explique la diffrence dans la valeur de la guine aux deux poques mentionnes, par les diffrentes quantits de monnaie dargent dgrade qui se trouvait en circulation. Sous le rgne du roi Guillaume, lor ntait pas un moyen lgal de paiement, il navait quune valeur de convention. Tous les forts paiements taient vraisemblablement faits en monnaie dargent, surtout en raison de ce que le papier-monnaie, et les oprations de banque taient, cette poque, peu compris. La quantit de cette monnaie dargent dgrade excdait la quantit de la monnaie dargent dgrade qui serait reste en circulation, si la bonne monnaie avait seule eu cours, et par consquent elle se trouvait non-seulement dgrade, mais encore dprcie. Mais dans la suite, lorsque lor devint moyen lgal de paiement, et quon employa aussi des billets de banque dans les paiements, la quantit de monnaie dgrade dargent nexcda pas la quantit de la bonne monnaie dargent nouvellement frappe qui aurait circul sil ny avait pas en de monnaie dgrade dargent ; cest pourquoi, quoique cette monnaie ft altre, elle ne fut pas dprcie. Lexplication quen donne M. Buchanan est un peu diffrente ; il croit que la monnaie du mtal qui domine dans la circulation, est sujette la dprciation, mais que lagent subalterne ne lest pas. Sous le roi Guillaume, la monnaie principale qui tait dargent, fut par consquent sujette tre dprcie. En 1774, largent ntait plus que subsidiaire, et en consquence il conserva sa valeur. La dprciation des monnaies ne dpend cependant pas de ce quun des mtaux est lagent principal de la circulation, et lautre un agent subsidiaire ; elle ne provient que de ce que la quantit dun mtal monnay jet dans la circulation est excessive 1. Il ny a pas grand inconvnient tablir un droit modr de monnayage, surtout sur la monnaie destine au paiement des petites sommes. Les pices frappes acquirent en gnral un surcrot de valeur gal au montant du droit, et cet impt est par consquent un de ceux qui naffectent nullement ceux qui le paient, tant que la quantit de monnaie en circulation nest pas excessive. Il faut cependant remarquer que, dans un pays o il y a un papier-monnaie en
1
Toute cette longue explication se rduit ceci : les changes qui se font dans un pays exigent diffrentes coupures de monnaie, cest--dire des pices de petite valeur, soit pour les petits paiements, soit pour les appoints des gros. Tant que les petites pices ne sont quen quantit suffisante pour ce genre de circulation, le besoin quon en a soutient leur valeur courante au niveau de leur valeur lgale, quelque dgrades quelles soient par le frai. Ainsi quand les paiements se faisaient en or en Angleterre, on trouvait facilement une guine pour 21 shillings en argent, quoique les shillings eussent perdu plus du quart de leur valeur intrinsque. Leur valeur se soutenait par la mme raison qui soutient celle de tout billet de confiance : parce quon trouve partout les changer bureau ouvert. Cest en ce sens que Smith a dit que la valeur de la bonne monnaie soutient celle de la mauvaise. Mais si lon mettait dans la circulation plus de cette monnaie dgrade que les besoins du commerce nen exigent, alors on ne trouverait plus aussi facilement des personnes disposes la rembourser bureau ouvert, cest--dire vous donner en change une bonne pice. Il faudrait vendre cette monnaie dgrade avec perte ; cest ce qui tait arriv en France lorsquon avait laiss se multiplier les coupures de billet audel de ce quil en fallait aux appoints. Les porteurs de cette monnaie de billon taient obligs dy perdre pour la changer en argent, et il fallut une loi pour borner 1/40 de la somme totale la quantit de billon quon pouvait donner en paiement. Cette loi dgradait la monnaie tout entire comme aurait pu faire un alliage. - J.-B SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
102
circulation, quoique ceux qui lmettent soient tenus de le rembourser en espces, si le porteur lexige, il peut cependant arriver que ces billets, ainsi que les espces, soient dprcis de tout le montant du droit de monnayage tabli sur le mtal reconnu comme le seul moyen lgal de paiement, et cela, avant que les rglements tendant limiter la circulation du papier aient pu oprer. Si le droit de monnayage sur les pices dor tait, par exemple, de 5 pour 100, la monnaie courante pourrait, par une forte mission de billets de banque, se trouver rellement dprcie de 5 pour 100 avant que les porteurs de ces billets eussent trouv de lintrt les changer contre des espces pour les fondre en lingots. Nous ne serions jamais exposs prouver une pareille dprciation, sil nexistait point de droit de monnayage ; ou si, malgr lexistence du droit, les porteurs de billets de banque pouvaient en demander le remboursement en lingots, 3 1. 17 sh. 10 _ d., prix de la monnaie, et non en espces monnayes. A moins donc que la banque ne soit tenue de rembourser ses billets en lingots ou en espces monnayes au gr du porteur, la loi rcente qui a tabli en Angleterre un droit de monnayage de 6 pour 100, ou de quatre pence par once dargent, mais en ordonnant que lor sera frapp par la monnaie sans frais, est peut-tre la mesure la plus sage, et la plus efficace pour empcher toute variation inutile dans les monnaies 1.
M. Say serait davis que lHte1 des Monnaies se fit payer un droit de monnayage qui varierait selon la quantit de lingots quil aurait frapper. Le gouvernement ne frapperait les lingots des particuliers quautant quon lui paierait les frais et mme le bnfice de la fabrication. Ce bnfice pourrait tre port assez haut en vertu du privilge exclusif de fabriquer ; mais il devrait varier suivant les circonstances o se trouveraient les Htels des Monnaies et les besoins de la circulation. - J.-B. SAY, liv I, chap. 21. Une telle disposition aurait un effet trsdangereux, et exposerait le pays une variation considrable et inutile dans la valeur intrinsque des monnaies. (Note de LAuteur.) Je nai rien dire au sujet du danger que M. Ricardo trouve ma proposition, si ce nest que je suis assez port tre de son avis. Mais si lart dorganiser la socit ntait pas encore dans lenfance, si lon avait trouv des moyens pour que les intrts de ceux qui sont gouverns ne fussent pas toujours subordonns aux intrts de ceux qui gouvernent, on aurait lieu de regretter quune manufacture aussi lucrative (sans rien coter au consommateur) que pourrait ltre celle de battre monnaie, non-seulement ne donne aucun bnfice ltat, mais lui soit au contraire fort onreuse. Au surplus, je ne veux point indiquer les moyens de rendre cette manufacture profitable, jusqu ce quil me soit dmontr que ces bnfices tourneront au profit de la nation, en lui procurant un allgement quivalent dans Iimpt. - J.-B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
103
Chapitre XXVIII.
DE LA VALEUR COMPARATIVE DE LOR, DU BL, ET DE LA MAINDUVRE, DANS LES PAYS RICHES ET DANS LES PAYS PAUVRES.
Table des matires Lor et largent comme toute autre marchandise, dit Adam Smith, cherchent naturellement le march o lon donne le meilleur prix pour les avoir. Or, pour quelque denre que ce soit, ce meilleur prix sera toujours offert par le pays qui est le plus en tat de le donner. Le travail, comme il faut toujours se le rappeler, est le prix qui, en dernire analyse, paie tout, et dans deux pays ou le travail sera galement bien rcompens, le prix du travail en argent sera en proportion du prix des subsistances. Lor et largent schangeront donc naturellement contre une plus grande quantit de subsistances dans un pays riche que dans un pays pauvre, dans un pays o les subsistances abondent, que dans un pays qui nen est que mdiocrement fourni.
Mais le bl est une marchandise, ainsi que largent et les autres choses ; or, si toutes les marchandises ont une grande valeur changeable dans un pays riche, on ne doit pas en excepter le bl. Il pourrait donc tre exact de dire, en ce cas, que le bl schange contre une
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
104
grande quantit de monnaies, parce quil est cher, et que la monnaie schange de mme contre une grande quantit de bl, parce quelle est chre aussi, ce qui serait affirmer que le bl est la fois cher et bon march. Il ny a pas de principe qui puisse tre mieux tabli en conomie politique que celui par lequel on reconnat quun pays riche, de mme quun pays pauvre, est retenu dans laccroissement de sa population par la difficult progressive dobtenir des subsistances. Cette difficult doit ncessairement faire hausser le prix relatif des subsistances et en encourager limportation. Comment se peut-il que la monnaie dor ou dargent s'change contre plus de bl dans les pays riches que dans les pays pauvres ? Ce nest gure que dans les pays riches o le bl est cher, que les propritaires fonciers engagent la lgislature prohiber limportation du bl. A-t-on jamais entendu parler dune loi en Amrique ou en Pologne qui dfendt limportation des produits de lagriculture ? La nature y a mis un obstacle insurmontable en rendant la production de ces denres beaucoup plus facile dans ces pays-l que dans les autres. Comment donc peut-il tre vrai qu lexception du bl et dautres substances vgtales, qui sont entirement le fruit de lindustrie de lhomme, tous les autres produits naturels, le btail, la volaille, le gibier, les fossiles et les minraux utiles, etc., renchrissent naturellement mesure que la socit fait des progrs ? Lerreur du docteur Smith, dans tout le cours de son ouvrage, consiste clans la supposition que le bl a une valeur constante qui ne peut jamais monter, quoique la valeur de toutes les autres choses puisse augmenter. Selon lui, le bl a toujours une mme valeur, parce quil sert toujours nourrir le mme nombre dindividus. On aurait autant de raison de soutenir que le drap ne change jamais de valeur, parce quavec une quantit donne, on peut toujours en faire le mme nombre dhabits. Quy a-t-il de commun entre la valeur et la proprit de servir la nourriture et aux vtements 1 ? Le bl, comme toute autre marchandise, a dans chaque pays son prix naturel, cest--dire le prix que sa production exige, et sans lequel on ne pourrait pas le cultiver ; cest ce prix qui rgle le prix courant, et qui dtermine sil convient dexporter du bl ltranger. Si limportation du bl tait prohibe en Angleterre, le prix naturel du bl pourrait y monter 6 1. st. le quarter, pendant quil serait en France la moiti de ce prix. Si alors on levait la prohibition dimporter du bl, il tomberait dans le march anglais, non un prix moyen entre 6 1. et 3 l., mais il y baisserait en dfinitive, et sy maintiendrait son prix naturel en France, cest--dire au prix auquel il pourrait tre port au march anglais, en rapportant les profits ordinaires aux capitaux franais, et il se soutiendrait ce prix - que lAngleterre en consommt dailleurs cent mille ou un million de quarters. Si la demande de lAngleterre montait cet dernier chiffre, il est vraisemblable que la ncessit o se trouverait la France davoir recours la culture de terrains moins fertiles pour pouvoir fournir un si fort approvisionnement, ferait
1
M. Ricardo oublie la raison que Smith en donne. La tendance qu la population saccrotre au niveau des moyens de subsistances, multiplie lespce humaine partout o la production du bl augmente, et le travail humain, qui se multiplie en mme temps, fournit le moyen de payer le bl. Il nen est pas de mme du drap. On aurait beau multiplier les habits, cela ne ferait pas natre un homme de plus pour les porter, tandis que le bl fait natre ses consommateurs. De l, pour cette denre, une demande toujours peu prs proportionne a la quantit offerte. Je dis peu prs , car il ny a rien de rigoureux en Economie politique, - les besoins, les gots, les passions, les craintes et les prjugs des hommes, exerant une influence sur toutes les apprciations, et ntant point eux-mmes des quantits rigoureusement apprciables. - J .B. SAY.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
105
hausser en France le prix naturel du bl, et cela influerait par consquent sur son prix en Angleterre. Ce que je prtends, cest que le prix naturel des choses dans le pays qui exporte, est celui qui rgle en dfinitive le prix auquel ces choses doivent tre vendues, si elles ne sont pas sujettes un monopole dans le pays qui importe. Mais le docteur Smith, qui soutient avec tant de talent la doctrine qui tablit que le prix naturel des choses rgle en dernire analyse leur prix courant, a suppos un cas dans lequel il pense que le prix courant ne serait rgl ni par le prix naturel du pays qui exporte, ni par celui du pays qui importe. Diminuez, dit-il, lopulence relle de la Hollande ou du territoire de Gnes, le nombre des habitants y restant toujours le mme ; diminuez la facult quont ces pays de tirer leurs approvisionnements des pays loigns, et vous verrez que, bien loin de baisser avec cette diminution dans la quantit de largent, - laquelle, soit comme cause, soit comme effet, doit ncessairement accompagner cet tat de dcadence, - le prix du bl sy lvera au taux de famine. Je pense quil en rsulterait prcisment le contraire. La diminution des ressources des Hollandais et des Gnois, pour acheter du bl dans les marchs trangers, pourrait faire baisser le prix du bl, pendant un certain temps, au-dessous de son prix naturel dans le pays do on lexportait, aussi bien que dans le pays qui limportait ; mais il est absolument impossible que cela pt jamais faire monter le bl au-dessus de son prix naturel. Ce nest quen augmentant lopulence des Hollandais ou des Gnois que vous pourriez faire augmenter la demande du bl, et le faire monter au-dessus de lancien prix ; et cela naurait mme lieu que pendant un espace de temps trs-born, moins quil ne survnt de nouveaux obstacles qui rendissent plus difficile dobtenir lapprovisionnement ncessaire. Le docteur Smith dit encore ce sujet : Quand nous venons manquer des choses ncessaires, il faut alors renoncer toutes les choses superflues, dont la valeur, qui, dans les temps dopulence et de prosprit ; monte rapidement, baisse de mme dans les temps de pauvret et de dtresse. Cela est de toute vrit ; mais il ajoute : Il en est autrement des choses ncessaires. Leur prix rel, la quantit de travail quelles peuvent acheter ou commander, s1ve dans les temps de pauvret et de dtresse, et baisse dans les temps dopulence et de prosprit, qui sont toujours des temps de grande abondance, sans quoi ils ne seraient pas des temps dopulence et de prosprit. Le bl est une chose ncessaire ; largent nest quune chose superflue. Il y a dans ce raisonnement deux propositions mises en avant, qui nont aucune liaison entre elles : lune, que, dans les circonstances supposes, le bl pourrait commander plus de travail, ce que nous admettons ; lautre, que le bl aurait un plus haut prix en argent, ou schangerait contre une plus grande quantit dargent mtallique. Cest cette seconde proposition que je crois fausse. Elle pourrait tre vraie, si le bl tait rare en mme temps que cher, si lapprovisionnement ordinaire avait manqu. Mais, dans le cas suppos, le bl est en abondance, et on ne prtend pas que limportation en soit moindre que de coutume, ou quil en faille davantage. Il manque aux Hollandais et aux Gnois de largent pour acheter du bl, et, pour avoir cet argent, ils sont obligs de vendre leurs superfluits. Cest la valeur et le prix courant de ces superfluits qui baissent, et largent parat hausser si on le compare ces
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
106
objets. Mais cela ne fera pas augmenter la demande de bl, ni tomber la valeur de largent, qui sont les deux seules causes qui puissent faire monter le prix du bl. Il peut y avoir une grande demande dargent, soit faute de crdit, soit par dautres causes, et il peut renchrir en consquence par rapport au bl ; mais il est impossible dtablir sur aucun principe raisonnable que, dans de semblables circonstances, largent doive tre bon march, et que par consquent le prix du bl doive hausser. Quand on parle du plus ou moins de valeur de lor, de largent ou de toute autre marchandise dans diffrents pays, on devrait toujours choisir une mesure pour estimer cette valeur, si lon veut tre intelligible. Par exemple, quand on dit que lor est plus cher en Angleterre quen Espagne, si lon ne lestime pas en le comparant dautres marchandises, quel peut tre le sens de cette assertion ? Si le bl, les olives, lhuile, le vin et la laine sont meilleur march en Espagne quen Angleterre, lor, estim au moyen de ces denres, se trouvera tre plus cher en Espagne. Si, dun autre ct, la quincaillerie, le sucre, le drap, etc., sont plus bas prix en Angleterre quen Espagne, dans ce cas, lor, estim au moyen de ces articles, sera plus cher en Angleterre. Cest ainsi que lor paratra cher o bas prix en Espagne, selon que le caprice du spculateur lui fera choisir la mesure daprs laquelle il en estimera la valeur. Adam Smith, ayant imprim le caractre de mesure gnrale de la valeur au bl et au travail, aurait naturellement estim la valeur comparative de lor par la quantit de ces deux objets contre laquelle on pourrait lchanger ; et par consquent, quand il parle de la valeur comparative de lor dans deux pays, je dois croire quil veut parler de la valeur de lor estime en bl et en travail. Mais on a dj vu que lor, estim en bl, peut avoir une valeur trs-diffrente dans deux pays. Jai dj tch de faire voir que lor, compar au bl, sera bas prix dans les pays riches, et cher dans les pauvres. Adam Smith est dune opinion diffrente ; il pense que la valeur de lor estim en bl est plus leve dans les pays riches. Mais sans nous arrter davantage examiner laquelle de ces deux opinions est la vraie, lune et lautre suffisent pour faire voir que lor nest pas ncessairement plus bas prix dans les pays qui en possdent des mines, quoique Adam Smith soutienne cette proposition. Supposons que lAngleterre soit en possession de mines dor, et que lopinion dAdam Smith, qui veut que lor ait plus de valeur dans les pays riches, soit exacte ; dans ce cas, quoique lor sortt naturellement de lAngleterre pour aller schanger dans tous les autres pays contre leurs marchandises, il ne sensuivrait pas quil se trouvt ncessairement plus bas prix en Angleterre, compar au bl et au travail, que dans les pays trangers. Dans un autre endroit, cependant, Adam Smith dit que les mtaux prcieux sont ncessairement plus bas prix en Espagne et en Portugal que dans les autres pays de lEurope, parce que ces deux tats se trouvent tre les possesseurs presque exclusifs des mines qui les fournissent. La Pologne, dit-il, qui nest pas dlivre du systme fodal, est encore aujourdhui un pays aussi misrable quil ntait avant la dcouverte de lAmrique. Cependant le prix du bl a mont en Pologne; LA VALEUR RELLE DES MTAUX PRCIEUX Y A BAISS, comme dans tous les autres endroits de lEurope. La quantit de ces mtaux a donc d y augmenter comme ailleurs, et peu prs dans la mme proportion, relativement au produit annuel de ses terres et de son travail. Avec cela, cette augmentation dans la quantit de ces mtaux na pas, ce quil semble, augment ce produit annuel, na pas tendu lagriculture et les manufactures du pays, ni
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
107
amlior le sort de ses habitants. LEspagne et le Portugal, qui possdent les mines, sont peut-tre aprs la Pologne, les deux pays les plus pauvres de lEurope ; cependant il faut bien que la valeur des mtaux prcieux soit plus basse en Espagne et en Portugal que dans tout autre endroit de lEurope, puisque de ces deux pays ils viennent se rendre dans tous les autres, avec la charge, non-seulement du fret et de lassurance, mais encore avec la dpense de la contrebande, leur exportation tant ou prohibe ou soumise des droits. Leur quantit, par rapport au produit annuel des terres et du travail, doit donc ncessairement tre plus grande dans ces deux pays quen aucun autre endroit de lEurope ; cependant ces pays sont plus pauvres que la plupart des autres tats de lEurope. Cest que si le systme fodal a t aboli en Espagne et en Portugal, il y a t remplac par un systme qui ne vaut gure mieux. Voici, selon moi, quoi se rduit le raisonnement du docteur Smith. Lor, estim en bl, est plus bas prix en Espagne que dans les autres pays ; et la preuve en est, que ce nest pas du bl que les autres pays donnent lEspagne, en change pour son or, mais bien du drap, du sucre, des quincailleries, quon change contre ce mtal.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
108
Chapitre XXIX.
DES IMPTS PAYS PAR LE PRODUCTEUR.
Table des matires
M. Say exagre beaucoup les inconvnients qui rsultent des impts tablis sur les produits manufacturs, surtout lorsqu'ils portent sur la premire poque de la fabrication, et avant que ces produits soient termins. Les manufacturiers, dit-il, par les mains desquels le produit manufactur doit. passer successivement; sont obligs d'employer de plus gros capitaux, par la ncessit o ils se trouvent de faire lavance du montant de l'impt, ce qui est souvent trs-gnant pour des manufacturiers qui n'ont qu'un trs-mince capital et un trsfaible crdit. Un autre inconvnient sur lequel il insiste est que, par suite de l'avance de l'impt, l'intrt de cette avance doit tre aussi support par le consommateur, et que cette addition d'impt est une de celles dont le fisc ne profite pas. Je ne puis pas admettre cette seconde objection de M. Say. Supposons que ltat ait besoin de lever immdiatement 1000 1. st., et qu'il lve cette somme sur un manufacturier qui ne pourra la faire payer au consommateur que dans un an, quand les produits seront achevs. Par
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
109
suite de ce retard, il est oblig daugmenter le prix des ouvrages de sa fabrique, non-seulement de 1000 l., montant de l'impt, mais vraisemblablement de 1100 l., 100 l. tant l'intrt des 1000 1. qu'il a avances. Mais, moyennant cette addition de 100 1. payes par le consommateur, le fabricant a un profit rel, en ce que le paiement de l'impt que le gouvernement exigeait sans dlai, et qu'il doit payer en dfinitive, a t ainsi retard dun an. Cela met le gouvernement en tat de prter au manufacturier les 1000 1. dont il a besoin, 10 pour cent d'intrt, ou tout autre taux dont il soit convenu, - 1100 1. payables la fin d'un an, l'argent tant 10 pour cent, ne valant pas plus, en effet, que 1000 1. payables sur-lechamp. Si le gouvernement nexige limpt qu'aprs un an, lorsque la fabrication des ouvrages manufacturs se trouvera termine, il sera peut-tre oblig dmettre une obligation du trsor portant intrt, et lintrt lui coterait autant que ce que le consommateur pargnerait dans le prix, non compris cependant la partie du prix que le manufacturier pourrait, en vertu de limpt, ajouter son gain rel. Si le gouvernement avait d payer cinq pour cent pour lintrt de lobligation du trsor, il y aura 50 1. dimpts dpargns par la nonmission de lobligation. Si le manufacturier emprunte le capital additionnel dont il a besoin pour faire lavance de limpt 5 pour cent, et sil le fait payer 10 pour cent au consommateur, il aura gagn 5 pour cent sur son avance en sus de ses profits ordinaires ; en sorte que le manufacturier et le gouvernement gagnent ou pargnent tous deux prcisment la somme que le consommateur paie. M. .de Sismondi, dans son excellent livre de la Richesse commerciale, en suivant le raisonnement de M. Say, a calcul quun impt de 4000 francs, pay dans lorigine par un manufacturier dont les profits ne seraient quau taux modr de 10 pour cent, si le produit manufactur passait seulement par les mains de cinq diffrentes personnes, reviendrait au consommateur la somme de 6734 francs. Ce calcul est fond sur la supposition que celui qui le premier a fait lavance de limpt, a d recevoir du second manufacturier 4400 francs, et ce dernier du troisime 4840 francs ; en sorte que chaque fois que le produit passerait par les mains dun autre manufacturier, il se trouverait charg de 10 pour cent sur sa valeur. Cest supposer que la valeur de limpt saccrot selon un taux dintrt compos, non au taux de 10 pour cent par an, mais au taux de 10 pour cent charg chaque transmission progressive. Lopinion de M. de Sismondi serait exacte sil stait coul cinq ans depuis la premire avance de limpt jusqu la vente du produit impos au consommateur ; mais si une seule anne sest coule, une rtribution de 400 fr., au lieu de 2734, aura fourni un profit au taux de 10 pour cent tous ceux qui auraient contribu faire lavance de limpt, soit que louvrage manufactur et pass par les mains de cinq ou cinquante manufacturiers.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
110
Chapitre XXX.
DE LINFLUENCE QUE LOFFRE ET LA DEMANDE ONT SUR LES PRIX.
Table des matires
Ce sont les frais de production qui rglent en dernire analyse le prix des choses, et non comme on la souvent avanc, le rapport entre loffre et la demande. Ce rapport, la vrit, modifie pour quelque temps la valeur courante dune chose, selon que la demande peut avoir augment ou diminu et jusqu ce que lapprovisionnement en devienne plus ou moins abondant ; mais cet effet naura quune dure passagre. Diminuez les frais de la fabrication des chapeaux, et leur prix finira par tomber leur nouveau prix naturel, quoique la demande puisse doubler, tripler, ou quadrupler. Diminuez les frais de lentretien des hommes, en diminuant le prix naturel de la nourriture et des vtements qui soutiennent la vie, et vous verrez les salaires finir par baisser, quoique la demande de bras ait pu saccrotre considrablement. Lopinion que le prix des choses dpend uniquement de la proportion de loffre avec la demande, ou de la demande avec loffre, est devenue presque un axiome en conomie
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
111
politique, et a t la source de bien des erreurs dans cette science. Cest cette opinion qui a fait avancer M. Buchanan que les salaires nprouvent aucune influence par la hausse ou par la baisse dans le prix des vivres, et quils ne sont affects que par la demande plus ou moins grande de bras, et quun impt sur les salaires des travailleurs ne ferait point hausser les salaires, parce quil ne drangerait pas le rapport entre le nombre douvriers qui soffrent, et la demande quon en fait. On ne peut pas dire que la demande dune chose ait augment, si lon nen achte pas ou si lon nen consomme point une plus grande quantit ; et cependant, dans de telles circonstances, sa valeur en argent peut hausser. Si largent baissait de valeur, le prix de toutes les marchandises hausserait, car chacun des concurrents serait dispos dpenser plus dargent quauparavant faire des achats; mais quoique le prix de toutes les marchandises et hauss de 10 ou de 20 pour 100, si l'on n'en achetait pas plus que par le pass, je crois qu'on ne pourrait pas dire que le changement de prix de la marchandise a t l'effet d'une plus grande demande ; son prix naturel, ses frais de production en argent, se trouveraient rellement changs par la diffrente valeur de l'argent ; et sans aucun surcrot de demande, le prix de la marchandise s'accommoderait cette nouvelle valeur.
Nous avons vu (dit M. Say) que les frais de production dterminent le plus bas prix des choses, le prix au-dessous duquel elles ne tombent pas dune manire durable, car alors la production s'arrte ou diminue. Liv. II, chap. 4.
Il dit ensuite que la demande de lor ayant depuis la dcouverte des mines augment dans une proportion encore plus forte que lapprovisionnement, le prix de lor estim en marchandise, au lieu de tomber dans la proportion de dix un, na baiss que dans la proportion de quatre un ; cest--dire quau lieu de baisser en proportion de la baisse de son prix naturel, il nest tomb quen suivant la proportion de lexcs de lapprovisionnement par rapport la demande 1. La valeur de chaque chose monte toujours en raison directe de la demande et en raison inverse de loffre. Lord Lauderdale nonce la mme opinion :
Quand aux variations de valeur auxquelles toutes marchandise est expos, ditil, si nous pouvions supposer pour un moment quune substance quelconque possdt une valeur intrinsque et fixe, de manire quune quantit dtermin et toujours et dans toutes les circonstances une mme valeur, le prix de chaque chose, mesur par une telle mesure fixe et constante, varierait suivant le rapport entre sa quantit, et la demande quil y en aurait, et chaque chose serait sujette varier de valeur par quatre circonstances diffrentes :
1
Si, avec la quantit dor et dargent qui existe actuellement, ces mtaux ne servaient qu la fabrication de quelques ustensiles et de quelques ornements, ils abonderaient, et seraient bien meilleur march quils ne sont, cest--dire quen les changeant contre toute espce de denres, il faudrait, dans ce troc, en donner davantage proportion. Mais comme une grande partie de ces mtaux sert de monnaie, et que cette partie ne sert pas autre chose, il en reste moins employer en meuble et en bijoux ; or, cette raret ajoute la valeur. - J.-B. Say, liv. I, chap. 21, 3. (Note de lAuteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
112
1 Une chose augmenterait de valeur en raison de la diminution de sa quantit ; 2 Elle diminuerait de valeur, par laugmentation de sa quantit ; 3 Elle pourrait augmenter de valeur en raison dune plus forte demande ; 4 Elle pourrait diminuer de valeur, faute dtre demande. Comme il est cependant ais de prouver quaucune chose ne peut avoir une valeur intrinsque et fixe qui puisse la rendre propre mesurer la valeur des autres denres, les hommes ont t conduits choisir, pour mesure pratique de la valeur, la matire qui parait le moins sujette varier de valeur par lune ou lautre des quatre causes ci-dessus nonces, et qui sont les seules qui fassent changer la valeur des choses 1.
Si lesprit humain, dans ses recherches, navait pas lhabitude de viser trop haut ou trop bas, comme en tireur novice ; si la vrit navait pas pour caractre distinctif dtre la dernire formule qui nous apparaisse, dans les sciences comme dans les lettres, comme dans les nouveaux mondes quon dcouvre ; si, enfin, il ne fallait pas de prodiges de sagacit et de raisonnement pour extraire de linfinie diversit des phnomnes sociaux un corps de doctrines, et pour poser une science en quilibre sur des principes fondamentaux, on pourrait s'tonner bon droit de la lutte trange qui s'est tablie entre les conomistes, au sujet de la dtermination thorique et pratique des prix. Les uns n'admettent que l'influence des frais de production, les autres rejettent tout ce qui ne relve pas de la grande loi de l'offre et de la demande. Ricardo marche et combat la tte des premiers, J.-B. Say la tte des seconds, et les critiques ou les enthousiasmes, soulevs par la clbre thorie de la rente, n'ont pas d'autre origine que ce duel entre deux ides, entre deux notions parfaitement conciliables, ncessairement conciliables mme; selon nous. Quoique l'clectisme ne nous sduise pas plus en conomie politique qu'en philosophie, et quoique nous rpugnions fort ces accouplements monstrueux que l'on se plait imposer des doctrines qui se repoussent invinciblement, nous ne pouvons laisser s'isoler ici deux lois que l'on a cru compltes, prises sparment, et qui ne sont que les fragments dsunis de 1a mme vrit. Cest runir ces fragments, souder ces membres abstraitement et systmatiquement disjoints que nous allons viser. Qui ne voit, en effet,que ces deux termes : frais de production, offre et demande, sont le rsum scientifique de toutes les oprations commerciales. C'est l'apostrophe et la rplique du dialogue qui nat entre lacheteur et le vendeur : - lun demandant une somme suffisante pour couvrir l'intrt de ses capitaux, balancer les risques de sa spculation, rtribuer gnreusement son temps et son habilet ; lautre calculant lutilit du produit amen sur le march, et sinterrogeant sur l'importance du sacrifice qu'il peut et doit faire pour l'obtenir. Faites que ces deux exigences ne soient pas satisfaites ; rompez l'quilibre entre la somme de travail qu'il s'agit d'changer, et l'change ne s'effectuera pas. Si les frais de production ne sont pas couverts, le produit ne sera plus cr : car on trouve bien des Curtius pour combler les abmes politiques, mais on ne trouve pas des capitaux toujours prts s'engloutir dans une industrie ruineuse. Si, d'un autre ct, le prix ncessaire du produit n'est pas en rapport avec son utilit, le demandeur disparat et ses manufactures seront encombres. Vous aurez beau dsirer un objet, le demander, si vous ne parvenez pas rmunrer le travail qui sert le mettre votre porte, votre dsir restera l'tat de rve ; vous aurez beau produire chrement, envoyer, par exemple, sur les terres quinoxiales des patins destins glisser sur une glace qui n'existe pas ; enfin, vous aurez beau inonder de vins prcieux les pays vous l'eau par le Coran, votre opration pour tre coteuse n'en sera pas moins dsastreuse. Il y a donc action et raction constantes entre les conditions de la production et l'tat du march. Une augmentation et une diminution dans les frais resserrent et dilatent tour tour la demande ; des besoins plus nombreux, plus ou moins pressants activent ou paralysent luvre industrielle, et, par suite, grossissent ou diminuent les frais. C'est donc fausser la question que retrancher une de ces influences : c'est faire quelque chose d'analogue l'acte d'un individu, qui pour tablir l'quilibre dans une balance enlverait un des plateaux.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
113
Ce qui prouve bien, d'ailleurs, la ncessit de combiner des lois, si mal propos rendues antagonistes, c'est l'exagration que prennent les prix certaines poque et l'affaissement subit qui succde cette hausse. Les frais de production du bl, par exemple, ne varient pas sensiblement d'une anne l'autre : la somme de travail humain qui se dpense creuser les sillons, semer, prparer la moisson, reste peu prs la mme ; et cependant, vienne un beau soleil, une saison fconde, le prix des crales flchit, le pain descend la porte des bouches les plus humbles : vienne, au contraire, une anne calamiteuse, et ce sont des prix de famine qui s'tablissent. Les frais de production nont certes pas ajout un centime cette anne la valeur du bl ; mais le hasard a voulu que les populations fussent trop abondantes pour les produit alimentaires, et l'influence est ainsi passe compltement l'autre loi. Lorsque les Hollandais anantissaient leurs splendides rcoltes de Java et des Moluques, ils n'accroissaient pas d'un centime le prix de revient du gingembre, du poivre, de la muscade : ils rompaient violemment l'quation entre l'offre et la demande, et le renchrissement de ces denres tait destin combler le vide artificiellement cr. Mais aussi, lorsque Crompton, Watt et Arkwright armaient l'industrie anglaise de machines infatigables et abaissaient, par l'immensit des produits et l'allgement des frais gnraux, le prix des toffes de coton et de laine, la demande recevait un stimulant nergique et le march obissait son tour aux influences de la fabrication. Il n'est donc pas de choix faire entre l'ide de Ricardo et l'ide de J.-B. Say, l'une et l'autre tant ncessaires pour dterminer la valeur des choses ; mais il est incontestable que les frais de production ont sur les prix une influence plus gnrale, plus fondamentale. Comme, en ralit, dans une organisation conomique, lgitime et quitable, c'est le travail fui fonde la valeur des chose et dtermine la part de chacun dans la richesse collective ; comme les frais de production se composent de salaire ou rtribution d'un travail actuel et d'intrts ou rtribution d'un travail antrieur, on se trouve ainsi amen forcment reconnatre pour base des prix tout ce que les marchandises ont cot produire. Il est mme vident que les manufacturiers n'engagent leurs capitaux dans une industrie que lorsqu'ils pressentent une demande suffisamment active ; et comme il ne peut y avoir, ds lors, de fabrication inutile, il faut bien que cette fabrication rmunre sous peine de ne plus tre. D'ailleurs, si vous retranchez cette loi des frais de production, qui plonge jusque dans les entrailles mmes du problme des changes, quelle base offrirez-vous aux valeurs ? Vers quel centre les ferez-vous converger ; o sera votre point d'appui et o votre levier ? Placez l'offre en face de la demande, aussi longtemps que vous voudrez : faite les approvisionnements excessifs, faites-les insuffisants, vous n'en serez pas moins oblig de recourir, pour fixer vos oprations, au prix de revient de chaque denre, en d'antres termes la somme d'efforts et de temps que l'acheteur et le vendeur veulent se concder rciproquement sous des formes diverses. Alors seulement peut s'tablir cette quation qu'on appelle change et que niait Montesquieu, prtendant que l'intrt des uns se satisfait ncessairement aux dpens des autres. Si donc nous tendons sa loi de larges catgories d'annes, Ricardo nous parait tre dans le vrai et avoir vu la question de haut, puisquil fait prdominer la notion du travail. Mais si nous envisageons les faits actuels, les incidents conomiques de chaque jour, les fluctuations des besoins, des ides, des gots, il est impossible de ne pas reconnatre la loi de J.-B. Say une influence dcisive, et mme de ne pas lui attribuer les perturbations, les revirements incessants que prsentent les marchs. Ce n'est que lentement, aprs des ttonnements que se modifient les frais ou mieux les * conditions de la production : - les perfectionnements sont des plantes tardives qu'il faut arroser longtemps de sueurs et de capitaux : mais c'est dans un clin d'il que se modifient le got, les habitudes d'un pays et que surviennent les crises matrielles. A tout prendre, rien n'empcherait de fabriquer aujourd'hui, aux mmes frais qu'il y a tant de sicles, les catapultes, les bliers et les tortues qui servaient aux assauts de nos anctres : mais le canon a remplac, avec ses rugissements et ses violences, toute ces vieilleries de la guerre et il nen figure plus sur nos marchs. Pour rsumer maintenant en quelques mots cette dissertation qui ne nous semble pas avoir t poursuivie encore sous toutes ses faces ; nous dirons que, pour un moment donn, et des intervalles restreints, le prix relve surtout de l'offre et de la demande ; mais que pour de vastes poques, ce sont les fais de production qui gouvernent le march. Lune des deux lois est plus souple, plus actuelle, l'autre plus rgulire et plus forte : lune est la partie mobile, l'autre la partie fixe dune autre loi gnrale qu'elles constituent par leur runion , et qu'on pourrait appeler loi rgulatrice des changes, si l'on tenait absolument lui donner un nom. A. F. * Si nous proposons l'expression conditions de la production, au lieu de frais de production, cest quil est, en effet, un grand nombre de circonstances qui modifient la valeur du travail humain, et qu'on
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
114
Quand donc nous exprimons, dans le langage ordinaire, la valeur d'une chose quelconque, cette valeur peut changer d'un temps un autre par l'opration de huit causes diffrentes : 1 Par les quatre dj nonces, dans leur rapport avec la chose mme dont nous voulons exprimer la valeur ; 2 Par ces mme causes, dans leur rapport avec la chose que nous avons adopte comme mesure fixe de la valeur 1.
Tout ceci est vrai pour ce qui regarde les monopoles, et mme, quant au prix courant de toute marchandise, pendant un temps born. Si la demande de chapeaux devient deux fois plus forte, le prix en montera sur-le-champ ; mais cette hausse ne sera que temporaire, moins que les frais de production des chapeaux, ou leur prix naturel ne slve en mme temps. Si le prix naturel du pain baissait de 50 pour cent par suite de quelque grande dcouverte dans la science de lagriculture, la demande de pain naugmenterait pas considrablement, personne nen voudrait avoir que ce qui lui suffirait pour satisfaire ses besoins, et la demande naugmentant pas, lapprovisionnement naugmenterait pas non plus ; car il ne suffit pas quon puisse produire une chose pour quelle soit produite en effet, il faut encore quon la demande. Voici donc un cas o loffre et la demande ont peine vari, ou nont augment que dans une mme proportion ; et cependant le prix du bl aura baiss de 50 pour cent, et cela pendant que la valeur de largent naura point prouv de variation. Des produits dont un particulier ou une compagnie ont le monopole, varient de valeur daprs la loi que lord Lauderdale a pose ; ils baissent proportion quon les offre en plus grande quantit, et ils haussent avec le dsir que montrent les acheteurs de les acqurir ; leur prix na point de rapport ncessaire avec la valeur naturelle ; mais quant aux choses qui sont sujettes la concurrence parmi les vendeurs, et dont la quantit peut s'augmenter dans des bornes modres, leur prix dpend en dfinitive, non de l'tat de la demande et de l'approvisionnement, mais bien de l'augmentation ou de la diminution des frais de production 2.
1
2
ne saurait cependant, avec quelque justice, ranger au nombre des frais proprement dits. Ainsi l'intelligence plus leve du producteur, le monopole du gnie sont des faits qui se retrouvent dans la valeur du produit ; il en est tenu grand compte dans le mouvement des changes, et cependant ils n'impliquent aucun accroissement de dpense. Nous en dirons autant du privilge naturel de certaines terres et des privilges artificiels que crent les douanes, les octrois, les corporations d'arts et mtiers, etc., etc. O sont, dans tous ces cas, les frais de production ? - Ce n'est donc pas ici une lutte de mots, un exercice philologique que nous avons voulu faire : c'est une modification qui atteint la substance mme de la doctrine de Ricardo. Sans cette considration, nous n'aurions certainement pas voulu attenter la nomenclature habituelle, si controverse, si ardue, surtout depuis le livre curieux de Malthus sur les dfinitions en conomie politique : livre qui devait cependant mettre tout le monde d'accord. Nous aurions d'autant moins hasard un nom inusit que nous tenons pour galement mal aviss ceux qui croient avoir perfectionn une machine par l'addition d'une vis ou d'un clou, et ceux qui croient avoir fait marcher une science par l'addition d'un mot. A. F. Voyez An Inquiry in to the nature and Origin of public Wealth, pag. 13 Lorsque divers auteurs qui suivent les mmes mthodes d'investigation, et qui ont fait preuve de jugement en plusieurs occasions, diffrent compltement d'avis sur un principe, leur dissentiment ne peut venir que faute
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
115
de s'entendre. Essayons si l'on peut, dans ce cas-ci, de prsenter la question sous un jour nouveau qui rallie toutes les opinions. La plupart des conomistes politiques tablissent que la valeur ou le prix dune chose s'lve ou s'abaisse en raison directe de la demande qui en est faite, et en raison inverse de l'offre. M. Ricardo affirme que l'offre et la demande n'y font rien ; que le prix baisse par la concurrence des producteurs jusqu'au niveau des frais de productions, et s'arrte l. Mas que fait-on, dans la ralit, lorsqu'on demande changer une marchandise contre une autre ; lorsque, par exemple, un homme offre en vente dix-huit livres de froment qui valent 3 francs, pour acheter avec cet argent une livre de caf, qui vaut galement 3 francs ? Il offre les services productifs * (ou leur prix, c'est--dire les frais de production) qui ont servi payer les services productifs dont la livre de caf est le rsultat. Les services productifs de la livre de caf, ou leur prix et la livre de caf, ne sont pas les deux membres de l'quation : ce sont une seule et mme chose. Et quand M. Ricardo dit qu'un produit vaut toujours ce que valent ses frais de production, il dit vrai ; mais la question reste rsoudre : Qu'est-ce que valent ces frais de production ? quel prix met-on aux services capables de produire un produit appel une livre de caf ? Je rponds qu'on y met d'autant plus de prix, et qu'on est dispos les payer d'une quantit d'autant plus grande de tout autre service productif, que les services propres produire du caf sont plus rares et plus demands, et c'est dans ce sens qu'il faut entendre la demande et l'offre, le besoin et l'approvisionnement, le principe si connu des Anglais sous les noms de want and supply. La quantit de travail, de capitaux et de terrain ncessaires pour accomplir un produit, constitue la difficult de sa production, sa raret. Un produit qui ne peut tre le fruit que de beaucoup de services productifs est plus rare que celui qui peut tre le fruit de peu de services ; en d'autres termes, un produit est d'autant plus abondant, que la mme quantit de services productifs en fournit davantage. De l une plus grande quantit offerte, un prix plus bas. Lorsque, au contraire, la quantit de services ncessaires augmente, le prix s'lve. Au lieu de demander pour une livre de caf dix-huit livres de bl (ou les services productifs qui ont servi faire dix-huit livres de bl), on demandera peut-tre vingt livres, vingt-cinq livres, trente livres, jusqu' ce qu'il ne se trouve plus un seul acheteur dispos payer le caf, et alors il ne s'en produit pas. C'est le cas de mille produits qui ont ruin leurs producteurs, parce qu'ils ne valaient pas leurs frais de production. Une plus grande puissance de produire quivaut une plus grande quantit de services productifs verss dans la circulation. Si quelque grand perfectionnement en agriculture me permet d'obtenir trente-six livres de bl l o je n'en obtenais que dix-huit, c'est comme si je doublais l'offre de mes services propres faire du bl. Ils baisseront de moiti, et l'on pourra obtenir alors dix-huit livres de bl pour une demi-livre de caf seulement. Les services productifs propres faire dix-huit livres de bl vaudront autant que les services productif propres faix: une demi-livre de caf **. Dans le systme de M.Ricardo, qui professe dans tout le cours de ce livre que la quantit de travail ncessaire pour faire un produit est le seul lment de son prix, et qui ne tient nul compte de ce le peut avoir cot le concours du capital et du fonds de terre, voici comme j'exprimerais le mme principe : on met dautant plus de prix au travail ncessaire pour faire une chose, c'est--dire on est dispos le payer d'une quantit d'autant plus grande de travail propre faire toute autre chose, que le premier est moins offert et plus demand, et vice versa. - J.-B. SAY * Par services productifs j'entends l'action, le concours des travaux, des capitaux, des terres dont il rsulte un produit. Ceux qui fournissent leur travail, qui prtent leur capital ou leur terrain, reoivent le prix de ce concours, et ce prix compose les frais de production. ** Dans le cas toutefois o cette baisse ninfluerait en rien sur la demande. Il est probable, au contraire, quune semblable baisse du bl changerait tous les rapports de valeur.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
116
Chapitre XXXI.
DES MACHINES
Table des matires
Dans ce chapitre je me propose d'tudier l'influence que les machines exercent sur les intrts des diffrentes classes de la socit, question importante et qui ne me parait pas avoir t suffisamment approfondie jusqu' ce jour. Je me sens mme d'autant plus entran mettre mes opinions sur cette grave matire que ces opinions ont subi, sous l'empire de mditations prolonges, des changements adorables. Et quoique je ne sache pas avoir publi sur la question des machines une seule ligne que je doive rtracter, j'ai cependant pu soutenir indirectement des doctrines qu'aujourd'hui je crois fausses. G'est donc un devoir pour moi de soumettre l'examen du public mes vues actuelles et les raisons qui les ont fait battre dans mon esprit. Ds le moment o je commenai tudier les questions conomiques, je crus que toute machine qui avait pour effet d'introduire dans une branche quelconque de la production une conomie de main-d'uvre, produisait un bien gnral qu'altraient seulement les crises qui accompagnent le plus souvent le dplacement des capitaux et du travail d'une industrie vers
1
Ce chapitre est compltement neuf dans notre langue et ne figure dans les uvres de Ricardo que depuis la quatrime dition. (A. F.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
117
une autre. Il me parut que tant que les propritaires auraient les mmes rentes en argent, ils profiteraient de la diminution de prix survenue dans les marchandises qu'ils achetaient avec leurs rentes, - diminution que devait ncessairement entraner l'emploi des machines. Il en serait de mme, me disais-je, pour le capitaliste. Sans doute, celui qui dcouvre une machine ou qui en fait le premier l'application, doit, pendant quelques annes, jouir d'avantages spciaux et lgitimes et de profits normes ; mais l'emploi de sa machine se gnralisant peu peu, le prix de la marchandise produite descendrait, sous la pression de concurrence, au niveau des frais de production, et le capitaliste verrait baisser ses profits. Seulement il profiterait, titre de consommateur, de l'avantage rparti tous, et pourrait, avec le mme revenu en argent, se procurer une somme plus considrable de jouissances et de bien-tre. Je croyais encore que les machines taient une institution minemment favorable aux classes ouvrires en ce quelles acquraient ainsi les moyens d'acheter une plus grande masse de marchandises avec les mmes salaires en argent : et je pensais, plus, que les salaires ne subiraient aucune rduction par la raison que les capitalistes auraient besoin de la mme somme de travail qu'auparavant, quoique ce travail dt tre dirig dans des voies nouvelles. Si, par lemploi de machines nouvelles, on parvenait quadrupler la quantit de bas fabriqus, et que la demande de bas ne fit que doubler, il faudrait ncessairement licencier un certain nombre d'ouvriers ; mais comme le capital qui servait les entretenir existait toujours et que l'intrt des capitalistes devait tre d'employer productivement ce capital, il me paraissait qu'il irait alimenter quelque autre industrie utile la socit. J'tais, en effet, et demeure profondment convaincu de la vrit de ces paroles d'Adam Smith. Le dsir des aliments se trouve limit chez l'homme par l'troite dimension de son estomac ; mais le dsir du bien-tre, du luxe, des jouissances, des quipages, de la toilette est infini comme l'art, comme le caprice. Ds lors , comme je pensais que la demande de travail serait la mme et que les salaires ne baisseraient pas, je pensais aussi que les classes infrieures participeraient, comme toutes les autres classes, aux avantages rsultant du bas prix des marchandises, et par consquent de l'emploi des machines. Telles taient mes opinions : telles elles sont encore relativement au propritaire et au capitaliste ; mais je suis convaincu que la substitution des forces mcaniques aux forces humaines pse quelquefois trs-lourdement, trs-pniblement sur les paules des classes laborieuses. Mon erreur provenait de ce que je faisais toujours crotre paralllement le revenu net et le revenu brut d'une socit, et que tout prouve, au contraire, que les fonds o les propritaires et les capitalistes puisent leurs revenus peuvent grandir tandis que celui qui sert maintenir la classe ouvrire diminue. D'o il suit que la cause mme qui accrot le revenu net d'un pays peut en mme temps activer l'accroissement de la population, aggraver la concurrence des travailleurs et diminuer leur bien-tre. Supposons quun capitaliste spcule sur une somme de 20,000 1. st., et qu'il joigne aux fonctions d'un fermier celles d'un fabricant de denres de premire ncessit. Supposons encore que, sur ce capital, 7 ,000 1. st. soient engages dans des constructions, des instruments, etc., et que le reste, soit employ, sous forme de capital circulant, solder le travail.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
118
Supposons, enfin, que les profits soient de 10 %, et que les 20,000 1. st. rapportent rgulirement et annuellement 2,000 1. st. Chaque anne notre capitaliste, commence ses oprations en achetant la nourriture et les objets de consommation qu'il vendra dans le cours de l'anne ses ouvriers, jusqu' concurrence de 13,000 1. st. Pendant tout ce temps il leur donne sous forme de salaires la mme somme de monnaie, et ceux-ci lui restituent au bout de l'anne pour 15,000 1. st. de subsistances, d'objets de premire ncessit. Sur ces 15,000 1. st. il en est 2,000 quil consomme 1ui-mme ou dont il peut disposer comme il lui plait. Le produit brut de cette anne aura donc t de 15,000 1. st., et le produit net de 2,000 1. st. Supposons maintenant que l'anne suivante le capitaliste emploie la moiti de ses ouvriers construire une machine, et l'autre moiti produire, comme auparavant, des subsistances et des denres de premire ncessit. Pendant cette anne, encore, il dpenserait 13,000 1. st. en salaires, et vendrait ses ouvriers la mme quantit de nourriture et dautres objets ; mais quarriverait-il lanne suivante ? Le travail dtourn vers la fabrication de la machine abaisserait de moiti la quantit et la valeur totale des .subsistances et des denres de premire ncessit produites anciennement. La machine vaudrait 7,500 l. st. : les subsistances et autres objets 7,500 1. st. de sorte que la richesse du capitaliste serait absolument la mme, car outre ces deux valeurs, son capital fixe serait toujours de 7 000 1. st., donnant en somme le fonds primitif de 20,000 1. st. joint aux 2,000 1. st. de bnfice annuel. Mais aprs avoir dduit pour ses dpenses personnelles cette somme de 2,000 1. st.,.i1 ne lui restera plus, pour continuer ses oprations, qu'un capital circulant de 5,500 1. Sa facult de payer et maintenir des ouvriers se trouvera donc rduite de 13,000 1. st. 5,500 1: st., et par consquent tout le travail dfray jadis par la diffrence, 7 ,500 1. st. se trouveraient en excs. La quantit restreinte de travail que pourra occuper actuellement le capitaliste, devra, sans doute, grce aux machines, et aprs la dfalcation faite des frais de rparation et d'entretien, produire une valeur gale 7 ,500 1. st. et reconstituer le capital circulant avec un bnfice de 2,000 1. st. sur le fonds primitif ; mais s'il en est ainsi et si le revenu net n'est pas diminu, il importera fort peu au capitaliste que le revenu brut soit de 3,000, de 10,000 ou de 15 000 1. st. Quoique la valeur du produit net n'ait pas diminu, et que sa puissance d'acheter d'autres marchandises se boit au contraire notablement accrue, le produit brut n'en aura pas moins t ramen, dans ce cas, de 15,000 1. st. 7,500 1. st., et comme la facult d'entretenir une population et d'employer du travail, dpend toujours du produit brut d'une nation, et non de son produit net, la demande de bras diminuera ncessairement, la population deviendra excessive et les classes ouvrires entreront dans une priode de dtresse et d'angoisses. Cependant, comme le fonds qui grossit les parses de chacun est proportionnel au revenu net, la diminution du prix des marchandises, - suite de l'introduction des machines, aurait
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
119
pour rsultat vident d'accrotre la facilit d'pargner, de transformer des revenus en capitaux. Or, comme chaque accroissement de capital lui permettrait d'employer un plus grand nombre de bras, une fraction des ouvriers rejets hors des ateliers par les engins mcaniques trouverait de nouveau s'utiliser. Et s'il arrivait que, sous l'influence des machines, l'accroissement de la production ft assez grand pour fournir, sous forme de produit net, une quantit de nourriture et de denres de premire ncessit aussi considrable que celle qui existait auparavant comme produit brut, il resterait au service du travail un fonds tout aussi considrable et, par consquent, on n'aurait pas subir les maux d'une sur-population. Tout ce que je tiens prouver, c'est que la dcouverte et l'usage des forces mcaniques peuvent tre suivis d'une diminution de produit brut : et toutes les fois qu'il en sera ainsi, la classe laborieuse souffrira, car elle deviendra excessive comparativement aux fonds destins la maintenir, et une fraction de ses membres se verra prive de travail et de salaires. Le cas que j'ai choisi se recommande par son extrme simplicit ; mais les rsultats eussent t absolument les mmes si nous avions introduit, par supposition, les machines dans une manufacture, soit de drap, soit de coton. Si nous prenions l'exemple d'un fabricant de drap, nous verrions diminuer immdiatement la masse de ses produits ; car il n'aurait plus besoin de cette quantit de draps qui lui servait payer un corps nombreux d'ouvriers. Il n'aurait plus qu' reproduire une valeur gale la dtrioration des machines et aux profits lgitimes sur le capital total. 7,500 1. st. feraient ceci tout aussi bien que le faisaient auparavant les 15,000 1. st., ce qui prouve qu'il n'y a aucune diffrence entre les deux hypothses. On peut dire, cependant, que la demande de draps serait tout aussi grande qu'auparavant, et se demander comment s'approvisionnerait le march. Mais d'o viendront maintenant les demandes ? Des fermiers et des autres producteurs de denres ncessaires, lesquels consacraient leurs capitaux produire ces objets afin de les changer contre du drap : ils fournissaient au marchand de draps du bl et des produits divers en change de ses draps, et celui-ci les distribuait ses ouvriers en change du drap que leur travail lui fournissait. Mais ce commerce cesserait. Le fabricant, ayant moins d'hommes payer, moins de drap vendre, ne demanderait plus de subsistances ni d'autres denres. Les fermiers et ceux qui produisaient ces denres typiquement en vue de les changer, ne pouvant plus obtenir de drap, consacreraient directement leurs capitaux en fabriquer ou les prteraient d'autres, afin que la socit ft rellement approvisionne de la denre qui lui manque. Or, tout ceci nous conduit aux mmes conclusions. La demande de travail diminuerait, et les marchandises ncessaires au maintien du travail seraient bien moins abondantes. Si ces vues sont exactes, il en rsulte : 1 que la dcouverte et l'application des forces mcaniques conduit toujours l'accroissement du produit net du pays, quoiquil n'en augmente pas immdiatement la valeur ; 2 Qu'un accroissement dans le produit net d'un pays est parfaitement compatible avec une diminution du produit brut ; et qu'il suffit de savoir qu'une machine augmentera le produit
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
120
net, tout en diminuant, comme cela arrive souvent, la quantit et la valeur du produit brut : cela suffit, dis-je, pour dcider de son adoption ; 3 Que l'opinion de, classes ouvrires sur les machines qu'ils croient fatales leurs intrts, ne repose pas seulement sur l'erreur et les prjuges, mais sur les principes les plus fermes, les plus nets de l'conomie politique ; 4 Que si l'impulsion donne au travail par les machines pouvait tellement accrotre le produit net, quil n'en rsultt aucune diminution dans le produit brut, la situation de toutes les classes pourrait alors s'amliorer. Le propritaire et le capitaliste profiteraient non pas de l'accroissement de leurs rentes ou de leurs profits, mais de la rpartition des mmes revenus sur des marchandises d'une valeur considrablement rduite. Quant la condition de classes laborieuses, elle se trouverait aussi considrablement amliore, 1 par une demande plus considrable de domestiques ; 2 par le stimulant que les revenus nets , abondants, communiquent toujours lpargne ; et 3 par le bas prix des articles de consommation que payaient leurs salaires. Indpendamment de la question des machines que nous venons de traiter et dapprofondir, les classes laborieuses ont encore un grand intrt revendiquer dans la manire dont le produit du pays de trouve dpens, quoique dans tous les cas cette dpense soit destine la satisfaction et aux jouissances de ceux qui y ont droit. Si un propritaire ou un capitaliste dpense son revenu la manire dun baron fodal, en sentourant dun grand nombre de serviteurs, de laquais, il emploiera bien plus de bras que sil le consacrait acheter de belles toffes, de splendides ameublements, des voitures, des chevaux et tant dautres objets de luxe. Dans les deux cas le revenu net et le revenu brut seraient les mmes ; mais le premier serait transform en diffrentes marchandises. Si mon revenu tait de 10,000 l. st. la mme quantit de travail productif serait employe, soit que je men servisse pour acheter des objets de luxe, des velours, des tapis, soit quil ft consacr acheter une certaine quantit de vtements et de nourriture de la mme valeur. Toutefois en transformant mon revenu en objets de luxe, je naurai pas ncessairement employ plus de travail, tandis que si je le consacrais acheter des denres ncessaires et entretenir des domestiques, tous les individus que je pourrais entretenir avec mon revenu de 10,000 l. st. ou avec la nourriture et le vtement que ce revenu me procure, devraient tre considrs comme stimulant la demande de travail. Or, ce stimulant dpend uniquement de la manire dont il peut me plaire de dpenser mon revenu. Comme les ouvriers se trouvent ainsi intresss dans la demande du travail, ils doivent naturellement dsirer que lon enlve aux dpenses de luxe les plus grandes sommes possibles pour les consacrer lentretien de domestiques. De mme un pays entran travers les pripties dune guerre, et qui se trouve dans la ncessit de maintenir de larges flottes et de puissantes armes, emploie un nombre d'hommes bien plus considrable que celui qui sera employ au moment o la guerre cessera, et, avec elle, les dpenses qu'elle ncessitait.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
121
Ainsi si les ncessits de la guerre ne m'avaient impos une taxe annuelle de 500 1. st. destine entretenir des soldats et des matelots, j'aurais probablement dpensa cette somme en achat de meubles, d'habits, de livres, etc. Dans les deux cas la mme quantit de travail resterait consacre la production ; car la nourriture et le vtement du soldat et du matelot exigeraient la mme somme d'industrie que celle ncessaire pour crer des objets de luxe. Mais il est remarquer qu'en temps de guerre il se cre une demande additionnelle de soldats et de matelots ; et consquemment, une guerre que dfraie le revenu et non le capital d'une nation est, en dfinitive, favorable au dveloppement de la population. La fin de la guerre en me restituant une partie de mon revenu et me permettant de le consacrer de nouveau acheter des vins,des ameublements et d'autres objets de luxe, doit cependant laisser sans ressources ces hommes qui combattaient l'ennemi. La population deviendra donc excessive : la concurrence des travailleurs s'aggravera ; les salaires descendront, et la condition des classes laborieuses s'abaissera notablement. Il est important de citer encore un cas o l'augmentation du revenu net, et mme du revenu brut d'un pays, peut trs-bien s'allier avec une diminution de travail. Ce cas est celui o l'on substitue le travail des chevaux celui de l'homme. Si j'emploie cent hommes sur ma ferme, et que je dcouvre que la nourriture distribue cinquante de ces hommes peut servir entretenir des chevaux et me donner ainsi une plus grande somme de produits, j'couterai la voix de mon intrt, et je substituerai sans hsiter les chevaux aux hommes. Mais videmment la condition de mes ouvriers serait gravement atteinte ; et moins que mon accroissement de revenu ne soit assez considrable pour me permettre d'employer en mme temps hommes et chevaux, il est vident que la population deviendra excessive et descendra d'un degr vers les privations et la misre. Il est vident, en tout cas, que ces hommes ne pourraient tre employs en agriculture ; mais si le produit des terres tait considrablement accru, ils pourraient trouver du travail dans les manufactures ou titre de domestiques. Il ne faudrait pas croire cependant que mes conclusions dfinitives soient contre l'emploi des machines. Pour claircir le principe, lui donner plus de relief, j'ai suppos que des machines nouvelles auraient t soudainement dcouvertes et appliques sur que vaste chelle : mais dans le fait ces dcouvertes se font lentement, graduellement, et elles agissent plutt en dterminant l'emploi des capitaux pargns et accumuls, qu'en dtournant les capitaux existants des industries actuelles. A mesure que le capital et la population d'un pays grandissent la production devient plus coteuse, et le prix des subsistances s'lve gnralement. Or, la hausse des aliments entrane la hausse des salaires, et la hausse des salaires tend pousser plus activement le capital vers l'emploi des machines. Les forces mcaniques et les forces humaines sont en concurrence perptuelle, et il arrive souvent que les premires ne sont employes qu'au moment o s'lve le prix des secondes. En Amrique et dans un grand nombre d'autres pays o l'on pourvoit aisment la nourriture de l'homme, les stimulants qui poussent l'emploi des machines, sont loin d'tre aussi
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
122
puissants qu'en Angleterre, o la nourriture est chre et exige des frais de production considrables. La mme cause qui lve les salaires n'lve pas la valeur des machines, et c'est pourquoi toute augmentation de capital aboutit au dveloppement des engins mcaniques. La demande de travail continuera de s'accrotre avec l'accroissement du capital, mais non dans le rapport exact de cet accroissement 1. J'ai encore fait observer que l'accroissement du revenu net, valu en marchandises, accroissement qu'entrane ncessairement lemploi des machines, - doit conduire de nouvelles pargnes, de nouvelles accumulations. Ces pargnes, qu'on se le rappelle bien, sont annuelles, et doivent arriver bientt crer un fonds beaucoup plus considrable que le revenu brut dtruit tout d'abord par la dcouverte des machines. Ds lors la demande de bras sera aussi grande qu'auparavant, et la condition du pays sera encore amliore par l'accroissement d'pargnes que l'augmentation du revenu net lui permettra de faire. Il serait toujours dangereux d'entraver l'emploi des machines, car si l'on n'accorde pas dans un pays, au capital, la facult de recueillir tous les profits que peuvent produire les forces mcaniques perfectionnes, on le pousse au dehors, et cette dsertion des capitaux sera bien plus fatale l'ouvrier que la propagation la plus vaste des machines. En effet, ds qu'un capital est employ dans un pays, il y sollicite une certaine somme de travail ; et les machines ne peuvent fonctionner sans des hommes qui les surveillent, les guident, les rparent. Donc, si l'on consacre un capital acheter des engins perfectionns, on limite la demande de travail ; mais si on l'exporte on annule compltement cette demande. Dailleurs, le prix des marchandises se rgle d'aprs les frais de production ; ds qu'on emploie des forces perfectionnes, on diminue les frais de production des marchandises et, par consquent, on peut les vendre sur les marchs trangers des conditions rduites. Si cependant vous rejetez l'emploi des machines, vous serez oblig d'exporter de la monnaie en change des marchandises trangres, jusqu' ce que la raret du numraire abaisse le prix de vos marchandises au niveau des prix du dehors. Dans vos relations avec les autres pays vous pourriez tre amen donner une marchandise qui vous aurait cot deux journes de travail, pour une marchandise qui n'en aurait exig qu'une au dehors ; et ce march ruineux ne serait
1
La demande de bras dpend de laccroissement du capital circulant et non du capital fixe. S'il tait vrai d'ailleurs que la proportion entre ces deux genres de capitaux ft la mme en tout temps et dans tous les pays, il s'ensuivrait naturellement que le nombre des ouvriers serait proportionn la richesse du pays. Mais une telle proposition n'est pas soutenable. A mesure que les arts viennent purer le got des nations, que la civilisation s'tend, le capital fixe prend, relativement au capital circulant, des proportions de plus en plus vastes. La somme de capital fixe consacre la fabrication d'une pice de mousseline anglaise est cent fois, probablement mme mille fois, plus grande que celle qui, dans l'Inde, sert fabriquer la mme toffe ; et, d'un autre ct, la somme de capital circulant est cent fois ou mille fois moindre. Il est facile de concevoir que dans de certaines circonstances la totalit des pargnes annuelle d'un peuple industriel peut tre ajoute au capital fixe, ce qui n'aurait aucun effet sur la quantit de travail distribuer. B A R T O N . Sur la situation des classes ouvrires, page 16. Il n'est pas facile de concevoir comment un accroissement de capital peut ne pas accrotre la demande de travail : le plus qu'on peut dire, c'est que la demande va en proportion dcroissante. M. Barton, dans louvrage cit plus haut, me semble avoir, d'ailleurs, avez bien compris les effets produits par l'augmentation des capitaux engags sur les classes laborieuses. Son Essai renferme cet gard des vues utiles. (Note de lAuteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
123
cependant que la consquence de vos propres actes. En effet, cette marchandise que vous exportez et qui vous a cot deux jours de travail, ne vous en aurait cot qu'un, si vous n'aviez pas repouss ces machines, dont les forces ont t si habilement utilises par vos voisins.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
124
Chapitre XXXII.
DE L'OPINION DE M. MALTHUS SUR LA RENTE.
Table des matires
Quoique je me sois tendu assez longuement, dans les premiers chapitres de cet ouvrage, sur la nature de la rente, je me crois cependant oblig dexaminer certaines opinions mises sur cette matire, opinions qui me paraissent fausses, et qui sont d'autant plus dangereuses, quelles se trouvent nonces dans les crits d'un penseur auquel diverses branches de l'conomie politique doivent plus qu' aucun autre auteur vivant. Je saisis cette opportunit pour tmoigner de mon admiration pour l'Essai sur la population, de M. Malthus. Les attaques des adversaires de cet admirable ouvrage n'ont servi qu' dmontrer la solidit des doctrines qu'il renferme, et je suis convaincu que la rputation bien mrite de son auteur s'tendra mesure qu'on cultivera davantage la science dont il est l'un des ornements les plus distingus. M. Malthus a aussi expliqu d'une manire satisfaisante la thorie de la rente, et il a fait voir qu elle monte ou s'abaisse selon les avantages relatifs de fertilit ou de situation des diffrente terrains en culture. Par l il a rpandu beaucoup de lumires sur plusieurs point
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
125
difficiles qui ont du rapport avec le fermage, et qui taient inconnus auparavant ou trsimparfaitement compris ; il me parait cependant tre tomb dans quelques erreurs, que son autorit rend plus ncessaire de combattre ; et ce devoir devient moins pnible en raison de la noble simplicit qui le caractrise. Une de ces erreurs consiste dans la supposition que la rente est un profit net, et une nouvelle cration de richesse. Je n'admets pas toutes les opinions de M. Buchanan au sujet de la rente ; mais je suis parfaitement d'accord avec les observations contenues dans le passage suivant de son ouvrage, et qui a t transcrit par M. Malthus. Par la mme raison, je ne saurais adopter le commentaire que ce dernier auteur en donne :
Sous ce point de vue, la rente ne peut rien ajouter au capital de la communaut en gnral ; car l'excdant net en question n'est rien de plus quun revenu qui passe des mains d'une classe de la socit dans celles d'une autre, et il est vident que cela ne peut pas crer un fonds susceptible de couvrir l'impt. Le revenu qui paie les produits de la terre, existe dj entre les mains de ceux qui achtent ces produits, et si le prix des subsistances tait plus bas, il resterait dans leurs mains, o il serait tout aussi ais de le soumettre un impt, que lorsque, en raison d'un prix plus lev, il a pass dans les mains du propritaire foncier.
Aprs diverses observations sur la diffrence qui existe entre les produits de l'agriculture et les objets manufacturs, M. Malthus demande : Est-il ds lors possible de considrer la rente, avec M. de Sismondi, comme un simple produit du travail, comme une valeur purement nominale, et qui n'est que le rsultat de cette augmentation de prix qu'un vendeur obtient par l'effet d'un privilge spcial ; ou, avec M. Buchanan, comme n'ajoutant rien la richesse nationale, et comme une simple transmission de valeur qui n'est avantageuse quaux propritaires, et qui est, dans la mme proportion, nuisible aux consommateurs 1 ? J'ai dj, en traitant de la rente, exprim nettement mon opinion, et j'ajouterai que la rente est une cration de valeur, dans le sens que je donne ce mot, mais non une cration de richesse. Si le prix du bl, en raison de la difficult d'en produire une portion quelconque, haussait de 4 5 1. le quarter, un million de quarters vaudrait 5,000,000 1. au lieu de 4,000,000 1. ; et puisque ce bl s'changera, non-seulement contre plus d'argent, mais aussi contre une plus grande quantit de toute espce de marchandises, il est clair que les propritaires auront une valeur plus forte ; et comme cela ne diminuera la richesse de personne, la socit entire possdera une somme plus considrable de valeur, et dans ce sens la rente devient une cration de valeur. Mais cette valeur peut tre regarde comme nominale, en ce qu'elle n'ajoute rien la richesse de la socit, c'est--dire la masse des choses ncessaires, commodes ou agrables. Nous aurions toujours prcisment la mme quantit de choses, pas davantage, et le mme million de quarters de bl ; mais l'effet de la hausse du bl, de 4 5 1., serait de faire passer une partie de la valeur du bl et des autres marchandises des mains de
1
An Inquiry into the nature and progress of Rent, pag. 15.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
126
leurs anciens possesseurs dans celles des propritaires. La rente est donc une cration de valeur, mais non une cration de richesse. Il najoute riens aux ressources du pays ; il ne lui fournit pas les moyens d'entretenir des escadres et des armes ; car le pays aurait un fonds disponible plus considrable si son terrain tait d'une meilleure qualit, et il pourrait employer le mme capital sans donner naissance la rente. Dans une partie de son ouvrager M. Malthus observe que, la cause immdiate de la rente est videmment l'excdant du prix sur les frais de production, obtenus par la vente des produits agricoles sur le march : et dans un autre endroit il dit que les causes du haut prix des productions agricoles peuvent ce rduire aux trois suivantes : En premier lieu, et c'est la cause la plus importante, vient la qualit de la terre, qui permet d'en retirer une quantit plus considrable de choses ncessaires la vie. En second lieu, se place la proprit particulire qu'ont les choses ncessaires la vie, de voir se crer d'elles-mmes une demande, ou de faire natre un nombre de consommateurs proportionn la quantit de ces denres produites : en troisime lieu, enfin, la raret comparative des terrains plus fertiles. En parlant du haut prix du bl, il est vident que M. Malthus ne veut pas parler du prix par quarter ou par boisseau, mais plutt de lexcdant de prix de toute la production sur les frais qu'elle a cots, entendant toujours, par frais de production, les profits aussi bien que les salaires. Cent cinquante quarters de bl, 3 1. 10 sh. le muid, doivent rapporter une plus forte rente au propritaire que cent quarters 4 1., pourvu que les frais de production soient les mmes dans les deux cas. L'lvation du prix, si l'on prend l'expression dans ce sens, ne peut tre dite la cause de la rente. On ne saurait dire que la cause immdiate de la rente est videmment lexcdant des prix sur les frais de production ; car c'est prcisment cet excdant qui constitue la rente. M. Malthus a dfini la rente la portion de valeur de tout le produit qui reste au propritaire de la terre, aprs qu'il a pay tous les frais de sa culture, - de quelque nature qu'ils soient, et y compris les profits du capital employ, estim d'aprs le taux courant et ordinaire des profits agricoles une poque dtermine. Or, ce que la rente de cette portion peut rapporter en argent est le montant de la rente en argent ; c'est ce que M. Malthus appelle l'excdant du prix sur les frais de production ; et par consquent, en recherchant les causes qui peuvent faire monter le prix des produits agricoles, compar avec les frais de production, nous recherchons les causes qui peuvent faire monter les rentes. Par rapport la premire cause de hausse, M. Malthus fait les observations suivantes : Il nous reste encore combattre pourquoi la consommation et lapprovisionnement sont tels, qu'ils font monter le prix si fort au-dessus des frais de production. La cause principale est videmment la fertilit de la terre qui produit les choses ncessaires la vie. Diminuez cette abondance, diminuez la fertilit de la terre, et l'excdant diminuera ; diminuez-la encore, et il disparatra. Certes, l'excdant des choses ncessaires diminuera et disparatra, mais ce n'est pas de cela dont il est question : il sagit de savoir si lexcdant du prix de ces objets de premire ncessit sur les frais de production diminuera ou disparatra ; car c'est de cette
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
127
circonstance que dpend la rente en monnaie. De ce que l'excs de quantit doit diminuer et disparatre, M. Malthus est-il en droit de conclure que la cause de l'excdant de prix des choses ncessaires dpend de leur abondance plutt que de leur raret, et est non-seulement essentiellement diffrente de la chert occasionne par des monopoles artificiels, mais encore du prix lev des produits particuliers de la terre, autres que les subsistances, produits qu'on peut nommer des monopoles naturels et ncessaires ? Ny aurait-il pas des circonstances dans lesquelles la fertilit de la terre et l'abondance de ses produits peuvent prouver une diminution sans en occasionner une pareille dans ce produit net, c'est--dire, sans occasionner une diminution des rentes ? Si ce cas peut exister, la proposition de M. Malthus devient beaucoup trop gnrale ; car il me semble qu'il pose en principe gnral, que la rente doit hausser par l'augmentation de la fertilit de la terre, et qu'elle doit baisser par la diminution de sa fertilit. M. Malthus aurait raison sans doute, si, mesure que la terre rendrait plus de produits, il en tait pay une plus forte part au propritaire ; mais il en arrive tout autrement. Quand il n'y a en culture que les terrains les plus fertiles, le propritaire n'a que la moindre part de tout le produit, aussi bien que la moindre valeur, et ce n'est que quand on a besoin des terres de qualit infrieure, pour nourrir une population croissante, que la part de tout le produit qui revient au propritaire, ainsi que sa valeur, augmentent progressivement. Supposons que la demande soit de un million de quarters de bl, et que ce soit le produit des terres actuellement en culture ; supposons encore que la fertilit de ces terres soit tellement diminue, qu'elles ne rendent plus que neuf cent mille muids, la demande tant de un million de muids, le prix du bl hausserait, et il faudrait avoir recours des terrains d'une qualit infrieure plus tt qu'on ne l'aurait fait si les bonnes terres avaient continu produire un million de quarters. C'est cette ncessit de mettre des terres d'une qualit infrieure en culture, qui est la cause de l'augmentation de la rente. La rente n'est pas, il faut se le rappeler, en proportion de la fertilit absolue des terres en culture, mais en proportion de leur fertilit relative. Toute cause qui portera les capitaux vers la culture des terrains ingrats doit la faire hausser, puisque la raret comparative des terrains les plus fertiles est la source de la rente, ainsi que M. Malthus l'a annonc dans sa troisime proposition. Le prix du bl doit naturellement s'lever par suite de la difficult qu'on prouve d'en obtenir les dernires portions ; cependant, comme les frais de production ne s'accrotront pas sur les terres les plus fertiles, que le salaire et les profits, pris ensemble, conserveront la mme valeur 1, il est clair que l'excdant du prix par del les frais de production, ou, en d'autres termes, la rente, doit monter par suite de la diminution de fertilit de la terre, moins qu'une grande rduction de capital, de population et de demande ne s'y oppose.
Voyez le chapitre de Profits, o j'ai essay de dmontrer que, quelque facilit ou difficult qu'on puisse rencontrer dans la production du bl, les salaires et les profits conservent la mme valeur. Quand les salaires haussent, c'est toujours aux dpens des profits, et quand ils baissent les profits s'en augmentent. (Note de l'Auteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
128
Il ne parait donc pas que la proposition de M. Malthus soit exacte ; la rente ne monte ni ne baisse d'une manire immdiate et ncessaire proportion de l'augmentation ou de la diminution de la fertilit de la terre ; mais l'augmentation de sa fertilit la rend susceptible de payer la longue un: rente plus forte. Des terres trs-peu fertiles ne peuvent jamais fournir une rente ; des terres mdiocrement fertiles peuvent supporter de payer une rente modique lorsque la population s'accrot.; et, dans ce mme cas, les terres trs-fertiles peuvent payer une grosse rente, mais ce n'est pas la mme chose de pouvoir supporter une forte rente, et de la supporter effectivement. Les rentes peuvent tre plus basses dans un pays dont les terres sont entirement fertiles, que dans un autre o elles ne sont que d'un rapport mdiocre ; car la rente est en raison de la fertilit relative plutt que de la fertilit absolue, en raison de la valeur des produits plutt que de leur abondance. M. Malthus dit que la cause qui fait que des choses ncessaires la vie donnent un produit net, tient plutt l'abondance de ces denres qu' leur raret, et diffre essentiellement la fois de l'lvation des prix occasionne par des monopoles artificiels et du haut prix de certains produits naturels, autres que les subsistances, et que l'on peut nommer des monopoles naturels et ncessaires. N'arrive-t-il donc jamais que la fertilit de la terre et la richesse de ses produits diminuent sans diminuer ncessairement le produit net ou la rente ? Si ce fait n'est pas sans exemple, la proposition de M. Malthus prend donc un caractre trop absolu : car il parait avoir tabli avec l'inflexibilit d'un principe, que la rente s'lve ou s'abaisse toujours lorsque s'lve ou s'abaisse la fertilit de la terre. M. Malthus aurait incontestablement raison, si la part du propritaire se grossissait proportionnellement l'abondance croissante des rcoltes sur tout domaine : mais c'est dans le contraire prcisment qu'il faut aller chercher la vrit. Lorsque les terres d'une fertilit suprieure sont seules livres la culture, la part du propritaire, en quantit et en valeur, est son minimum ; et c'est seulement lorsque les besoins d'une population croissante ont provoqu le dfrichement des sols moins riches, qu'augmente progressivement cette part. Supposons que les ncessits de la situation fassent demander un million de quarters de bl, et que ce million soit rcolt sur la superficie de terrain actuellement cultive ; supposons encore que la fertilit de ce territoire s'altre au point de ne plus donner que 900,000 quarters : la demande restant toujours d'un million de quarters, le prix du bl s'lverait, et on devancera ainsi le moment o l'on aurait dfrich les terrains infrieurs, si la fertilit de l'ancien sol tait reste la mme. Mais c'est prcisment l'indispensable, l'implacable ncessit du recours ds terrains moins riches qui cre et lve la rente, et qui llve alors mme que le bl reu par le propritaire se trouve rduit en quantit. La rente, il faut bien se le rappeler, n'est pas en proportion de la fertilit absolue des terres cultives, mais en proportion de leur fertilit relative. Toute cause qui fait aller le capital sur un sol pauvre accrot la rente sur les qualits suprieures, - l'origine, la source de la rente tait, comme l'a tabli M. Malthus dans la troisime proposition, la raret comparative des sols fertiles. Le prix du bl s'lvera naturellement mesure que grandiront les difficults de la production, et, quoique la quantit rcolte sur une ferme ait diminu, la valeur de cette rcolte aura augment. Mais comme le cot de la production ne crotra pas sur les terres les plus fertiles,
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
129
comme les salaires et les profits, pris ensemble, conserveront toujours la mme valeur, il est vident que l'excdant du prix sur des frais de production, en d'autres termes, que la rente, moins d'tre entrave par une grande rduction de capital, de population et de demande, crotra paralllement l'puisement des terres. La proposition de M. Malthus ne me parat donc pas parfaitement exacte. La rente ne s'lve pas et ne s'abaisse pas immdiatement, ncessairement lorsque grandit ou diminue la fertilit de la terre : mais en gagnant en fertilit, la terre peut supporter et supporte un loyer plus considrable. Des terres d'une richesse trsmdiocre ne peuvent jamais donner de rentes ; celles d'une fertiliss moyenne peuvent, grce au mouvement ascendant de la population, donner une rente modre ; enfin, celles des catgories suprieures donneront de forts loyers, mais il y a une grande diffrence entrer l'aptitude payer une rente et le paiement actuel, effectif de cette rente. La rente peut tre plus basse dans un pays o les terres sont excessivement fcondes, que dans un territoire d'une richesse moyenne ; car elle se proportionne la fertilit relative plutt qu' la fertilit absolue, la valeur du produit plutt qu' son abondance. M. Malthus suppose que la rente provenant des terres qui produisent ces denres spciales, qu'on a pu appeler des monopoles naturels et ncessaires, est rgle par un principe diffrent de celui qui rgit la rente de ces terres qui produisent des subsistances. Il croit que c'est la raret de ces produits privilgis qui crent une forte rente, et que, pour les subsistances, c'est leur multiplicit au contraire qui amne ce rsultat. Cette distinction ne me parait pas fonde : car vous lverez tout aussi immdiatement la rente des terres qui donnent les vins prcieux que celle des terres bl, en accroissant le produit. Il va sans dire que la demande de bl se sera accrue, car autrement, un afflux de crales sur le march abaisserait, au lieu de l'augmenter, la rente des terres bl. Quelle que soit d'ailleurs la nature de la terre, une rente leve dpend du haut prix du produit ; mais ce haut prix une fois acquis, la rente s'lvera dans le rapport de l'abondance et non de la raret de ces denres. Il n'y a nul besoin de produire constamment une denre dans une quantit plus grande que la demande ne l'exige. Si, par hasard, la production excdait la demande, cette denre tomberait au-dessous de son prix naturel, et par consquent elle ne rapporterait pas ses frais de production, en y joignant les profits courants et ordinaires du capital ; l'approvisionnement en serait diminu jusqu' ce qu'il se trouvt en rapport avec la demande, et que le prix courant atteignit le niveau du prix naturel. M. Malthus me parait trop dispos croire que la population n'augmente que par l'effet d'un surcrot dans la quantit des subsistances ; que les subsistances se crent d'ellesmmes une demande ; que c'est en fournissant d'abord des aliments au peuple qu'on encourage les mariages, au lieu de remarquer que le progrs gnral de la population est affect par l'accroissement des capitaux, et par la plus forte demande de bras, et la hausse des salaires qui en sont la suite, enfin que la production des subsistances n'est que l'effet de cette demande.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
130
C'est en donnant l'ouvrier pulls d'argent, ou une plus grande quantit de toute autre marchandise, moyennant laquelle on paie son travail, que le sort de l'ouvrier devient meilleur. L'accroissement de la population et l'augmentation des subsistances seront presque toujours un effet, mais non un effet ncessaire de la hausse des salaires. Le sort de l'ouvrier, amlior par l'excdant de valeur qu'il reoit en paiement de son travail, ne lai impose pas l'obligation de se marier et de se charger du soin d'une famille ; il peut, si cela lui plait, changer son salaire augment contre des objets qui puissent contribuer augmenter ses jouissances, comme des chaises, des tables, de la quincaillerie, ou de meilleures hardes, du sucre et du tabac. Dans ce cas l'augmentation de son salaire n'aura d'autre effet que d'augmenter la demande de quelques-unes de ces marchandises ; et comme le nombre des ouvriers ne se sera pas beaucoup augment, leurs salaires se conserveront toujours levs. Mais quoique telle pt tre la suite de l'augmentation des salaires, cependant il est tant de douceurs dans la famille, qu'on voit constamment dans le fait l'accroissement de population suivre l'amlioration du sort de l'ouvrier ; et c'est uniquement parce que cela est ainsi qu'il survient une nouvelle et plus forte demande de subsistances. Cette demande est donc l'effet de l'augmentation de population, mais elle n'en est pas la cause ; c'est uniquement parce que les dpenses du peuple prennent cette direction, que le prix courant des objets de premire ncessit excde leur prix naturels et que la quantit de subsistances requise est produite ; et c'est parce que la population s'accrot que les salaires tombent de nouveau. Quel motif un fermier peut-il avoir pour produire plus de bl quon nen demande, quand il sait que cela fera tomber le prix courant au-dessous de son prix naturel, et le privera par consquent d'une partie de ses profits, en les rduisant au-dessous du taux gnral ?
Si les objets de premire ncessit, dit M. Malthus, les produits les plus prcieux de la terre, navaient pas la proprit de faire natre un surcrot de demande proportionn l'augmentation de leur quantit, une telle augmentation occasionnerait une baisse dans leur valeur changeable 1. Quelque abondants que soient les produits d'un pays, sa population peut rester stationnaire ; or, cette abondance qui ne serait pas accompagne d'une demande proportionne, mais qui lverait considrablement le prix des salaires du travail estim en bl, pourrait rduire le prix des produits de la terre, ainsi que celui des produits manufacturs, aux simples frais de production. Pourrait-on rduire le prix des produits de la terre aux frais de production ? Ce prix reste-t-il donc jamais bien longtemps au-dessus, ou au-dessous des frais de production ? M. Malthus lui-mme ne convient-il pas que cela ne peut jamais avoir lieu ? J'espre, dit-il., qu'on m'excusera si je m'tends un peu en prsentant aux lecteurs, sous diverses formes, la doctrine qui pose en principe que le bl, selon la quantit qui en est actuellement produite, se vend son prix ncessaire, de mme que les produits manufactures ; c'est que cette vrit, que je regarde comme tant de la plus haute importance, n'a t connue ni des conomistes, ni d'Adam Smith, ni de tous les auteurs qui ont avanc que les produits de la terre se vendaient toujours un prix de monopole.
De quelle augmentations de quantit M. Malthus veut-il parler ? Qui la produira ? Qui peut avoir des motifs poux la produire avant quil existe au pralable une demande pour cette quantit additionnelle ? (Note de l'Auteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
131
Tout pays d'une certaine tendue peut donc tre considr comme possdant une gradation de machines servant la production du bl et des matires premires, en comprenant dans cette gradation non-seulement toutes les diffrentes qualits de mauvais terrains, dont il existe en gnral dans tous les pays une assez grande quantit, mais aussi les machines moins parfaites dont on peut dire qu'on fait usage quand on force de bonnes terres donner un produit toujours croissant. A mesure que le prix des produits agricoles continue hausser, ces machines moins parfaites sont successivement employes, et mesure que le prix de ces produits continue baisser, on met successivement ces machines de ct. Cette application dmontre la fois le rapport ncessaire qui existe entre le prix actuel du bl et sa production actuelle, et l'effet tout diffrent qu'auraient une grande rduction dans le prix des produits manufacturs et une grande rduction dans le prix des produits de la terre 1.
Comment concilier ces passages avec celui o il est dit que, si les choses de premire ncessit n'avaient pas la proprit de faire natre une augmentation de demande proportionne l'augmentation de leur quantit, ce surplus de produit aurait alors, et alors seulement, l'effet de rduire le prix des produits agricoles aux simples frais de production ? Si le bl n'est jamais au-dessous de son prix, il n'est jamais plus abondant que ce qu'exige la population existante pour la consommation ; on ne peut en faire un approvisionnement pour d'autres consommateurs ; il ne peut donc jamais, par son abondance et par son bas prix, devenir un encouragement la population. A proportion que le bl peut tre produit peu de frais, le surhaussement des salaires des ouvriers augmentera les moyens qu'ils ont d'entretenir leurs familles. Aux tats-Unis la population s'accrot rapidement, parce que la nourriture y est produite bas prix, et non parce qu'il y existe des approvisionnements abondants produits l'avance. En Europe, la population augmente lentement en comparaison, parce que la production des subsistances y est coteuse. Daprs le cours ordinaire des choses, la demande prcde toujours l'approvisionnement d'une denre quelconque. En soutenant que le bl, comme les produits manufacturs, s'il n'avait pas la proprit de faire natre ses consommateurs, tomberait son prix de production, M. Malthus ne peut pas vouloir dire que toute la rente serait absorbe puisqu'il a lui-mme observ avec raison que lors mme que les propritaires renonceraient tout fait leur rente, le bl ne baisserait pas de prix pour cela. La rente est l'est et non la cause des hauts prix, car il y a toujours des terres en culture qui ne paient aucune rente, et dont le produit en bl ne rapporte pas un prix sassant pour payer les salaires et les profits.
1
Voyez Inquiry, etc. Dans tous les pays dont la prosprit est progressive, le prix moyen du bl n'est jamais plus haut qu'il ne faut pour maintenir le taux moyen de l'augmentation de production. Observations, pag. 21. Toutes les fois qu'on consacre de nouveau capitaux la culture de la terre pour en retirer des produits suffisants pour une population croissante, soit qu'on emploie ce capital dfricher de nouveaux terrains, ou bonifier des terres dj en culture, le point principal qu'on a en vue, ce sont les retours que l'on attend de ce capital ; c'est pourquoi l'on ne saurait retrancher la moindre portion des profits bruts sans affaiblir les motifs qui peuvent dterminer les capitalistes employer leurs fonds de cette manire. Toute diminution des prix qui n'est pas en totalit et l'instant mme contre-balance par une baisse proportionne dans les dpenses ncessaires d'une ferme, tout impt foncier, tout impt sur le capital du fermier, tout impt sur les denres de premire ncessit pour le fermier, doivent entrer en comptes ; et si, tous ces dbourss calculs, le prix du produit ne laisse pas une rtribution suffisante pour le capital employ, d'aprs le taux gnral des profits, et une rente au mains gale la rente que payait la terre dans son tat antrieur, il ne peut y avoir de motifs suffisants pour qu'on entreprenne les amliorations projetes. Observations, pag. 22. (Note de lAuteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
132
Dans le passage suivant, M. Malthus a expos habilement les causes de la hausse du prix des produits agricoles dans les pays riches dont la prosprit est croissante, et je suis ldessus entirement d'accord avec lui ; mais il me semble qu'il est en contradiction avec quelques-unes des propositions qu'il a avances dans diffrents endroits de son Essai sur la Rente.
J'ose affirmer, dit-il, qu'abstraction faite de variations subies par le systme montaire d'un pays, et d'autres circonstances temporaires et accidentelle, la cause du haut prix comparatif du bl en monnaie, est son haut prix rel comparatif, ou l'excdant de capital et de travail qu'il faut employer pour le produire ; je pense que ce qui fait que le prix rel du bl va toujours en montant dans des pays dj riches, et dont la prosprit et la population continuent s'accrotre, c'est la ncessit d'avoir constamment recours des terrains plus ingrats, des machines dont l'entretien exige plus de dpense, et o chaque nouvelle addition de produits agricoles ne s'obtient qu'avec plus de frais ; en un mot, la cause du fait ci-dessus nonc dpend de cette importante vrit : que le bl dans un pays qui avance en prosprit se vend au prix convenable pour que l'approvisionnement demand soit fourni ; et qu' mesure que cet approvisionnement devient de plus eu plus difficile, le prix hausse proportion.
C'est avec raison que dans ce passage on fait dpendre le prix rel dune denre du plus ou moins de travail et de capital (c'est--dire de travail accumul) qu'il faut employer pour la produire. Le prix rel ne dpend pas, comme quelques crivains l'ont prtendu, de la valeur en argent, ni, comme dautres l'ont avanc, de la valeur estime en bl, en travail, ou compare toute autre denre prise isolment, ou toutes les denres prises collectivement ; ce prix ne dpend, comme M. Malthus le dit avec raison que de la plus ou moins grande somme de capital et de travail qu'il faut employer pour la production. Parmi les causes de la hausse des rentes, M. Malthus compte un accroissement tel de la population qu'il en rsulte une baisse des salaires. Mais si mesure que les salaires baissent, les profits du capital s'lvent, et que, .pris ensemble, ils aient toujours une mme valeur, aucune baisse des salaires ne pourra faire monter les rentes, car elle ne diminuera ni la part, ni la valeur de la part de produit qui doit appartenir au fermier et au manouvrier ensemble, et par consquent elle ne peut point laisser une part plus forte ni une valeur plus considrable pour le propritaire. A proportion qu'on dpensera moins en salaire, il en restera plus pour les profits, et vice versa. Ce partage se fera entre le fermier et les travailleurs, sans que le propritaire s'en mle ; et dans le fait, c'est une affaire dans laquelle rien ne l'intresse, si ce n'est la manire dont un certain mode de partage peut plus qu'un autre contribuer faciliter de nouvelles accumulations, et augmenter la demande des terres. Si les salaires baissent, ce sont les profits qui monteront et non les rentes. Le surhaussement des fermages et des salaires, et la diminution des profits sont en gnral les effets invitables des mmes causes, et ces causes sont : - la demande croissante de subsistances, la quantit plus considrable de travail ncessaire pour les produire, et consquemment leur renchrissement. Le propritaire pourrait renoncer toute sa rente, sans que les travailleurs en tirassent le moindre profit. Si les travailleurs renonaient tout le montant de leurs salaires, les propritaires n'en
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
133
retireraient pas non plus le moindre avantage ; mais dans ces deux cas, le fermier recevrait et garderait tout ce qui pourrait tre ainsi abandonn. J'ai tach de faire voir, dans cet ouvrage, qu'une baisse dans les salaires n'aurait d'autre effet que de faire monter les profits. Une autre cause de la hausse de la rente, selon M. Malthus, consiste dans de telles amliorations en agriculture, ou dans un surcrot d'efforts suffisant pour diminuer le nombre des ouvriers ncessaires pour donner un rsultat dtermin. Cela ne ferait pas hausser la valeur de tous les produits, et n'augmenterait pas par consquent la rente. Au contraire : si, par suite de ces amliorations, la quantit ncessaire de subsistances pouvait tre obtenue en employant moins de bras ou moins de terres, le prix des produits agricoles baisserait, et une partie des capitaux serait retire de l'agriculture. Rien ne peut faire monter la rente que la demande Le nouveaux terrains moins fertiles ou quelque cause qui puisse occasionner un changement dans la fertilit relative des terrains dj cultivs 1. Des amliorations dans l'agriculture et dans la division du travail, s'tendent tous les terrains ; elles augmentent la quantit absolue des produits agricoles de chaque fonds de terre, sans peut-tre dranger beaucoup les proportions relatives qui existaient auparavant entre les diffrents terrains. M. Malthus a relev avec raison une erreur du docteur Smith. L'argument du docteur Smith, dit-il, de rduit ceci : Le bl a cette singulire proprit qu'on ne peut en encourager la production de la mme manire que celle de toutes les autres marchandises. Il ajoute : Je ne prtends cependant pas contester la puissante influence que le prix du bl a sur le prix du travail, en prenant le terme moyen d'un nombre considrable d'annes ; mais cette influence n'est pas telle qu'elle puisse s'opposer au mouvement des capitaux ports vers l'agriculture ou dtourns de cet emploi ; ce qui est le vritable objet de la discussion. Cela paratra suffisamment prouv par un examen rapide de la manire dont le travail est pay et dont il est offert dans le march, et par l'tude des consquences qui dcouleraient invitablement de la proposition d'Adam Smith, si elle tait une fois admise 2. M. Malthus cherche ensuite prouver que la demande et le haut prix encouragent d'une manire aussi efficace la production des produits agricoles, que la demande et la chert de toute autre marchandise encouragent leur production. D'aprs ce que j'ai dit sur les effets des primes, on voit que je suis entirement de l'opinion de M. Malthus. Jai cit le passage de son ouvrage intitul : Observations relatives aux crales, pour montrer combien le sens que cet crivain, dans cet crit, attache l'expression prix rel, diffre de celui qu'il lui donne dans sa brochure intitule : Motifs dune Opinion, etc. Dans ce passage, M. Malthus nous dit que c'est la hausse du prix rel du bl qui seule peut en encourager la production, et par prix rel il est clair qu'il veut dsigner l'augmentation de sa valeur relativement toutes les autres choses, ou, en d'autres termes, la hausse de son prix courant au-dessus de son prix naturel. Si
1
Il est inutile de le rpter sans cesse, mais il faut toujours faire attention que le mme effet aura lieu, nonseulement par l'emploi de diffrente portions de capital, mais encore en employant sur les terres dj cultives des portions diffrentes de capital avec des rsultats diffrents, le fermage tant la diffrence du produit obtenu moyennant un capital et un travail pareils sur une mme ou sur diffrentes qualits de terrains. (Note de l'Auteur.) Voyez Observations, etc., page 4.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
134
c'est l ce que M. Malthus entend par prix rel, son opinion est certainement fonde ; c'est en effet le surhaussement du prix courant du bl qui seul en encourage la production ; car on peut regarder comme principe infaillible que la seule chose qui puisse encourager l'augmentation de production d'une denre, c'est l'excs de sa valeur courante sur sa valeur naturelle ou ncessaire. Mais cette acception n'est pas celle que, dans d'autres endroits, M. Malthus donne l'expression prix rel. Dans l'Essai sur la Rente, il dit : Par prix rel croissant du bl, j'entends l quantit relle de travail et de capital qui ont t employs pour produire les dernires additions qui ont t faites au produit national. Dans un autre endroit, il dit que la cause du prix rel et comparativement lev du bl, est la plus grande quantit de capital et de travail qu'on doit employer pour sa production 1. Si, dans le passage prcdent, l'on substituait l'expression de prix rel la dfinition de M. Malthus, n'aurait-il pas le sens suivant ? Il est clair que c'est l'augmentation du travail et du capital qu'il est ncessaire d'employer pour la production du bl qui peut seule en encourager la production. Il vaudrait autant dire, que c'est videmment la hausse du prix naturel et ncessaire du bl qui en encourage la production - proposition tout fait insoutenable. Ce n'est pas le prix auquel on peut produire du bl qui peut influer sur la quantit produite, mais bien le prix auquel on peut le vendre. C'est en raison de l'excdant du prix sur les frais de production, que les capitaux sont attirs vers l'agriculture ou qu'ils en sont dtourns. Si cet excdant est tel qu'il donne au capital ainsi employ un plus grand profit que le profit gnral des capitaux, ces capitaux afflueront vers l'agriculture. Si ce profit est moindre, on les dtournera de cet emploi. Ce n'est donc pas par un changement dans le prix rel du bl que sa production est encourage, mais bien par un changement dans son prix courant. Car ce n'est point parce qu'il faut employer une plus grande quantit de capital et de travail pour produire le bl, telle est la dfinition exacte que M. Malthus donne du prix rel, - qu'il y a plus de capitaux et plus de bras attirs vers l'agriculture ; cela vient uniquement de ce que le prix courant est mont au-dessus de ce prix rel, et que, malgr le surcrot des charges, la culture des terres prsente encore l'emploi le plus profitable pour les capitaux. Rien n'est mieux fond que les observations suivantes de M. Malthus sur la mesure de la valeur adopte par Adam Smith. Il est clair qu'Adam Smith a t conduit raisonner de la sorte ce sujet, par l'habitude o il tait de considrer le travail comme la mesure constante de la valeur, et le bl comme la mesure du travail. Mais l'histoire de notre pays dmontre pleinement combien le bl est une mesure inexacte de la valeur ; on y voit combien la maind'uvre, compare au bl, a prouv de variations trs-grandes et remarquables, non-seulement d'une anne, mais d'un sicle l'autre, et pendant dix, vingt et trente ans conscutifs. Que ni le travail ni aucune autre denre ne peuvent servir de mesure exacte de la valeur relle
En montrant ce passage M. Malthus, au moment o ces feuilles allaient tre livres l'impression, il observa que dans ces deux passages, il avait, par inadvertance, employ l'expression prix rel au lieu de frais de production. D'aprs ce que j'ai dj dit, l'on verra, que je pense, au contraire, que dans ces deux cas il a employ lexpression de prix rel dans son acception vraie et exacte, et que ce n'est que dans le passage cit plus haut que cette expression est inexacte. (Note de l'Auteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
135
d'change, c'est l un des principes rangs aujourd'hui en conomie politique parmi les mieux tablis ; et en effet, il dcoule de la dfinition mme de la valeur changeable. Si, ni le bl, ni le travail ne sont des mesures exactes de la valeur relle changeable, et il est clair qu'ils ne le sont pas, quelle autre chose peut donc servir de mesure ? - Aucune assurment. Dans ce cas, si l'expression de prix rel des choses a un sens, ce doit tre celui que lui donne M. Malthus, dans son Essai sur la Rente : ce prix doit se mesurer par la quantit proportionnelle de capital et de travail ncessaire pour la production de ces choses. Dans ses Recherches sur la nature de la Rente M. Malthus dit : qu'abstraction faite des variations dans la monnaie d'un pays, et d'autres circonstances temporaires et accidentelles, la cause du prix en argent comparativement haut du bl, est son haut prix rel comparatif, ou la plus grande quantit de capital et de travail qu'il faut employer pour sa production 1. Voil, je pense, l'explication exacte de toutes les variations permanentes du prix du bl, aussi bien que du prix de tous les autres produits. Une marchandise ne saurait prouver une hausse permanente de prix que par une de ces deux causes, ou parce qu'il faut plus de capital et de travail pour sa production, ou parce que la monnaie baiss de valeur ; et, au contraire, une chose ne saurait baisser de prix moins qu'il ne faille moins de capital et de travail pour la produire, ou que la monnaie n'ait hauss de valeur. Une variation cause par un changement de valeur dans la monnaie agit la fois sur toutes les marchandises ; mais une variation cause par le plus ou moins de capital et de travail ncessaires la production d'une chose, est borne, dans ses effets, cette chose mme. L'importation libre du bl, ou des perfectionnements en agriculture, feraient baisser le prix des produits agricoles, mais n'influeraient sur le prix des autres marchandises, qu'en proportion de la diminution de valeur relle ou de fiais de production des produits agricoles qui pourraient servir fabriquer ces marchandises. M. Malthus a admis ce principe, et, pour tre convoquent, il ne peut pas, ce me semble, soutenir que la totalit de la valeur en monnaie de toutes les marchandises d'un pays doit diminuer exactement proportion de la baisse du prix du bl. Si le bl consomm annuellement dans le pays tait de la valeur de dix millions, et si les marchandises manufactures et trangres consommes pendant le mme temps valaient 20 millions, - faisant ainsi un total de 30 millions, - on aurait tort de conclure que la dpense annuelle serait rduite 15 millions, parce que le bl aurait baiss de 50 pour cent, ou de 10 5 millions. La valeur des produits immdiats de la terre qui entreraient dans la composition de ces marchandises manufactures, pourrait ne pas excder 20 pour cent de leur valeur totale, et, par consquent, la valeur des produits manufacturs, au lieu de baisser de 20 millions dix, ne tomberait que de 20 millions 18. Aprs la baisse de 50 pour cent dans le prix du bl, la
Page 40.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
136
somme totale de toute la dpense actuelle, au lieu de tomber de 30 millions 15, descendrait de 30 millions 23 1. Au lieu de considrer sous ce point de vue l'effet d'une baisse dans la valeur des produits agricoles, comme M. Malthus devait le faire d'aprs le principe qu'il venait d'admettre, il la regarde comme quivalant prcisment une hausse de 100 pour cent dans la valeur de la monnaie, et il raisonne en consquence comme si toutes les marchandises devaient tomber la moiti de leur ancien prix. Pendant les vingt annes qui se sont coules depuis 1794, dit-il, jusqu' 1813, le prix moyen du bl, en Angleterre, tait d'environ 83 shillings le quarter ; pendant les dix dernires annes de cette priode, il a t de 92 shillings, et pendant les cinq dernires de ces vingt aimes, de 108 shillings. Dans le cours de ces vingt ans, le gouvernement emprunta prs de 500 millions st. desquels, abstraction faite du fonds d'amortissement, il s'engagea payer environ 5 pour cent, selon un terme moyen approximatif. Mais si le bl baissait 50 shillings le quarter, et toutes les autres choses proportion, le gouvernement, au lieu d'un intrt de 5 pour cent, se trouvait en payer un de 7, 8, 9, et mme de 10 pour les derniers 200 millions. Je ne trouverais peut-tre rien redire une gnrosit si extraordinaire envers les rentiers de l'Etat, s'il ne fallait pas considrer aux dpens de qui elle est faite ; et un moment de rflexion suffira pour nous faire apercevoir que ce ne peut tre qu'aux dpens des classes industrieuses de la socit et des propritaires, c'est--dire aux dpens de tous ceux dont le revenu nominal est sujet varier par suite des variations dans la mesure de la valeur. Le revenu nominal de cette partie de la socit, compar avec le terme moyen du prix des cinq dernires annes de cette priode, se trouvera rduit de moiti, et sur ce revenu, ainsi rduit nominalement, ils auront payer le mme montant nominal d'impts 2. D'abord, que j'ai dj fait voir que le revenu nominal ne sera pas rduit dans la proportion que M. Malthus cherche tablir ; il ne s'ensuivrait pas de ce que le bl aurait baiss de 50 pour cent, que la valeur du devenu de chaque particulier se trouvt rduite de 50 pour cent 3. En second lieu, je crois que le lecteur conviendra avec moi que ce fardeau, en admettant qu'il existe, ne pserait pas exclusivement sur les propritaires et les classes industrieuses de la socit. Le crancier de l'tat, dans la dpense qu'il fait, paie sa part, pour subvenir aux dpenses de l'tat, de la mme manire que les autres classes de la socit. Dans le cas donc o l'argent augmenterait de valeur relle, quoiquil reoive une valeur plus forte, il en paiera galement une plus grande en impts. Il ne peut donc tre vrai de dire que toute
1
2 3
Les ouvrages manufacturs ne pourraient pas mme baisser dans cette proportion, car, dans le cas suppos, il y aurait une nouvelle distribution des mtaux prcieux dans chaque pays. Ceux de nos produite qui seraient bon march seraient exports pour tre changs contre du bl et de l'or, jusqu' ce que l'accumulation de l'or 1e fit baisser de valeur, et fit hausser en mme temps le prix en argent des denres. (Note de l'Auteur.) Voy. Grounds of an Opinion, etc., page 36. M. Malthus, dans un autre endroit de son ouvrage, suppose que les denres varient de 25 ou de 20 pour cent, pendant que le bl de 23 _ pour cent. (Note de lAuteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
137
l'addition la valeur relle de l'intrt, doit tre paye par les propritaires et par les classes industrieuses. Mais tout l'argument de M. Malthus repose sur une base peu solide. Il suppose que, parce que le revenu brut du pays est diminu, il faut, par consquent, que le revenu net le soit galement, et dans la mme proportion. Un des objets que j'ai eus envie dans cet ouvrage a t de montrer que, par suite de toute baisse dans la valeur des choses de premire ncessit, les salaires du travail doivent baisser, et les profits du capital s'lever, ou, en d'autres mots, que, sur une valeur annuelle dtermine, une moindre portion serait donne en paiement la classe ouvrire, et une plus considrable reviendrait ceux dont les capitaux ont servi payer le travail de cette classe. Supposons que la valeur des produits d'un genre particulier d'industrie soit de 1000 1. st., et qu'elle soit partage entre le matre et ses ouvriers ; de telle sorte que 800 1. appartiennent aux ouvriers, et 200 livres au martre ; si la valeur de ces produits tombait 900 livres, et qu'on pargnt 100 1. sur les salaires des ouvriers par suite de la baisse des objets de premire ncessit, le retenu net du fabricant n'en souffrirait nullement, et par consquent il pourrait aussi aisment payer le mme montant d'impts aprs cette rduction de prix 1. Il est essentiel d'tablir nettement la diffrence qui existe entre le revenu net et le revenu brut, car c'est au moyen du revenu net de la socit que s'acquittent les taxes. Supposons que toutes les marchandises du pays, tout le bl, les produits agricoles les produits manufacturs qui peuvent tre jets sur la march dans le cours de l'anne, aient une valeur de vingt millions ; supposons que le travail d'un certain nombre d'hommes soit ncessaire pour crer cette valeur, et qu'enfin le strict ncessaire de ces ouvriers exige une dpense de 10 millions : je dirai, dans ce cas, que le revenu brut de la socit est de vingt millions et son revenu net de dix millions. Il ne rsulte pas cependant de cette hypothse que les ouvriers ne doivent recevoir que dix millions pour leur travail : ils pourraient recevoir 12, 14 ou mme 15 millions et entrer ainsi en partage du revenu net pour une somme de 2, 4 ou 5 millions. Le reste se diviserait entre propritaires et capitalistes ; mais la totalit du revenu net n'excderait pas dix millions. En admettant maintenant que la socit, dont nous analysons ici les ressources, supporte un impt de deux millions, son revenu net tomberait 8 millions. Supposons maintenant que la valeur de la monnaie hausse d'un dixime, toutes les marchandises baisseraient la fois, entranant avec elles le salaire. En effet, comme les objets ncessaires l'ouvrier forment une portion intgrante de ces marchandises, le revenu brut descendrait 18 millions et le revenu net 9 millions. Si les taxes diminuaient dans la mme proportion, et qu'au lieu de 2 millions on ne prlevt plus que 1,800,000, 1. le revenu net descendrait 7 millions 200,000 1. qui auraient une valeur gale celle des 8 millions primitifs, et la socit n'aurait ni perdu ni gagn ces vnements. Mais supposons que, malgr la hausse de la monnaie, on maintint les taxes deux millions, la socit serait videmment plus pauvre de 200,000 1. par an, car en ralit les contributions se seraient accrues d'un neuvime. Et en effet, altrer la valeur pcuniaire des marchandises en altrant la valeur de la
1
Dans le chapitre XXVI, jai observ que les ressources relles dun pays et ses facults pour payer des impts, dpendent de son revenu net, et non de son revenu brut. (Note de lAuteur.)
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
138
monnaie et en continuant de lever la mme somme d'impts, n'est-ce pas accrotre incontestablement les charges de la socit ? Mais supposons que, sur ces dix millions de revenu net, les propritaires reoivent cinq millions titre de rente, et que par la facilit de la production, ou par l'importation du bl, le prix naturel de cet article descendit d'un million, la rente baisserait immdiatement d'un million, et les prix de l'ensemble des marchandises subiraient une dpression pareille ; mais le revenu net resterait invariable. Le revenu brut serait, il est vrai, de 19 millions seulement, et les frais ncessaires pour l'obtenir de 9 millions, mais le revenu net se maintiendrait 10 millions. Maintenant supposons qu'on prlve deux millions comme taxes sur ce revenu amoindri, la socit en serait-elle plus riche ou plus pauvre ? Plus riche, dirons-nous sans hsiter : car aprs le paiement de leurs taxes, elle aurait comme toujours un revenu libre de 8 millions dpenser en marchandises, dont la quantit se sera accrue et dont la valeur aura flchi dans la proportion de 20 l9. Et on pourrait non-seulement conserver alors la mme taxe, mais encore l'aggraver tout en voyant s'accrotre le bien-tre de la classe ouvrire. Si le revenu net de la socit, aprs qu'on aura pay les mmes taxes en argent, est aussi grand qu'auparavant, et si la classe des propritaires perd un million par l'abaissement de la rente, les autres classes productives, en dpit de la chute des prix, devront avoir des revenus en argent plus considrables. Le capitaliste jouira alors d'un double bnfice : le bl et la viande de boucherie que lui et sa famille consomment baissera de prix, et d'un autre cte, il pourra diminuer le salaire de ses domestiques, jardiniers, ouvriers de tout genre. Ses chevaux et ses bestiaux lui coteront aussi beaucoup moins acheter et nourrir ; et il en sera de mme pour toutes les marchandises o les produits naturels entrent comme partie principale. On le voit donc : cette srie d'conomies faites sur ses dpenses, jointe l'accroissement de valeur de son revenu, doit lui profiter doublement et lui permettre non-seulement d'augmenter la somme de ses jouissances, mais encore de supporter, s'il le fallait, des taxes supplmentaires. Ces mmes observations s'appliquent aux fermiers et toutes les classes de commerants. Mais, dira-t-on, le revenu du capitaliste ne se trouve nullement accru et le million enlev la rente du propritaire sera pay aux ouvriers sous forme d'un excdant de salaires. Soit, je l'admets ; mais cela mme ne change rien mon argument. La situation de la socit se sera amliore et elle pourra supporter avec bien plus de facilit les mmes taxes en argent. Seulement, - ce qui est infiniment dsirable et heureux,- la situation de la classe la plus importante, la plus utile de la socit, sera prcisment celle qui s'amliorera le plus sous l'influence de cette nouvelle distribution. Tout ce qu'elle reoit au-dessus de 9 millions, forme une partie du revenu net du pays et ne peut tre dpens sans ajouter son revenu, son bonheur ou sa puissance. Distribuez donc sans soucis le revenu net. Donnez-en un peu plus une classe, un peu moins une autre, et vous ne l'aurez cependant pas diminu : car la mme somme de travail n'en aura pas moins produit une plus grande somme de marchandises, parce que la valeur en argent de ces marchandises aura flchi. Mais le revenu net du pays, ce fonds qui dfraie les budgets et les jouissances du pays ; le revendu net, dis-je, sera bien plus apte que jamais entretenir la population actuelle, supporter les taxes nationales, rpandre de toutes parts le bien-tre et le luxe.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
139
Il est hors de doute que le rentier de ltat gagne beaucoup une forte baisse du bl ; mais si personne ne soufre de cette baisse, ce n'est pas une raisons qui puisse engager prendre des mesures pour faire renchrir le bl ; car le gain du rentier est un gain national, et, ainsi que tout autre gain, il augmente la richesse et la puissance relles du pays. S'il fait un profit indu, il faut examiner exactement jusqu' quel point cela est, et c'est alors la lgislature en chercher le remde ; mais rien ne peut tre plus impolitique que de nous priver entirement de tous les avantages qui rsultent du bas prix du bl et d'une grande abondance de produits, par le seul motif que le rentier de ltat en tire un avantage qui ne lui serait pas d. Jusqu' ce jour on n'a jamais essay de rgler les dividendes des fonds publics d'aprs la valeur en argent du bl. Si l'quit et la bonne foi exigeaient un pareil rglement, les possesseurs des vieilles rentes auraient une grande somme rclamer ; car ils ont, depuis un sicle, reu toujours les mmes dividendes en argent, quoique pendant cette poque le bl ait peut-tre doubl ou tripl de prix 1. M. Malthus dit : Il est vrai que les dernires additions que lon fait aux produits agricoles d'un pays dont la prosprit est croissante, ne sont pas accompagnes d'une grande augmentation de rente ; et c'est prcisment cela qui doit dcider un pays riche importer une partie du bl qu'il consomme, s'il peut tre assur d'en obtenir un approvisionnement uniforme. Mais dans tous les cas, l'importation du bl tranger ne peut convenir une nation, moins qu'il ne soit moins cher que le bl rcolt dans le pays, d'une valeur gale celle des profits et de la rente que rapporte le bl du cru, qui est ainsi remplac. Voyez Grounds, etc. page 36. De mme que la rente est l'effet de la chert du bl, l'extinction de la rente est la suite d'un prix trs-bas. Le bl tranger n'entre jamais en concurrence avec le bl du cru qui ne paie aucun fermage ; la baisse du prix est toujours supporte par le propritaire, jusqu' ce que tout son fermage soit absorb ; si le prix baisse encore davantage, le capital ne rapportera plus les profits ordinaires, il sera dtourn de la culture de la terre pour tre employ autrement, et le bl qui tait rcolt sur cette terre, sera alors, et pas avant, remplac par du bl import. L'extinction du fermage occasionnera une perte de valeur estime en argent, mais il y aura augmentation de richesse. La somme totale des produits de l'agriculture et autres se trouvera augmente par la plus grande facilit de leur production : et, quoique augments en quantit, ils auront diminu de valeur. Deux hommes emploient des capitaux gaux, l'un l'agriculture, l'autre aux manufactures. Le premier capital rapporte un revenu annuel net de 1200 1. st., dont 1000 1. restent pour les profits, et 200 sont payes pour la rente : le capital employ dans l'industrie ne rapporte
1
M. Mac Culloch, dans un crit plein de mrite, a fortement soutenu qu'il tait juste de rendre les dividendes de la dette nationale conformes la valeur rduite du bl. Il est partisan de la libert du commerce des grains, mais il pense qu'elle devrait tre accompagne d'une rduction de l'intrt pay au crancier de ltat *. (Note de lAuteur.) Ricardo a lui-mme rpondu cet expdient trange et inexplicable.
David Ricardo (1817), Des principes de lconomie politique et de limpt (trad. franaise, 1847)
140
qu'une valeur de 1000 1. par an. Supposons qu'au moyen de l'importation l'on puisse obtenir la mme quantit de bl en change de marchandises lui cotent 950 1., et qu'en consquence le capital de lagriculteur soit dtourn vers les manufactures, o il peut produire une valeur de 1000 1. ; dans ce cas, le revenu net de la nation aura perdu en valeur, se trouvant rduit de 2200 1. 2000 1. ; mais il y aura non-seulement la mme quantit de produits et de bl pour la consommation du pays, mais encore un surcrot gal la quantit de produits quon pourra acheter avec 50 1., montant de la diffrence entre la valeur que les produits manufacturs rapportaient de l'tranger, et la valeur du bl quon y achetait 1. M. Malthus dit : Adam Smith a observ avec raison, que jamais des quantits gales de travail employes en industrie ne sauraient reproduire autant qu'en agriculture. Si Adam Smith veut parler de valeurs, il raison ; mais s'il parle de richesse, ce qui est le point important, il se trompe ; car il a lui-mme dfini la richesse en disant qu'elle consistait dans les choses ncessaires, utiles ou agrables la vie. Des choses ncessaires ou utiles d'une espce ne peuvent pas tre compares avec celles d'une autre espce ; la valeur d'utilit ne peut tre estime d'aprs aucune mesure connue ; chacun l'estime sa manire.
FIN DU SECOND ET DERNIER FICHIER.
Or, voil prcisment la question rsoudre relativement aux avantages relatifs que l'on trouve importer ou faire crotre du bl. On n'importera jamais de bl jusqu' ce que la quantit obtenue au dehors par l'emploi d'un certain capital, excde la quantit que ce mme capital crerait dans le pays, et excde nonseulement la portion qui appartient au fermier, mais encore celle qui va au propritaire titre de rente.
S-ar putea să vă placă și
- Orgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceDe la EverandOrgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (20260)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe la EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (3269)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDe la EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (12942)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDe la EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (2515)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDe la EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (2306)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDe la EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (5700)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)De la EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Evaluare: 4 din 5 stele4/5 (9486)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionDe la EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (9752)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe la EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDe la EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (353)
- How To Win Friends And Influence PeopleDe la EverandHow To Win Friends And Influence PeopleEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (6507)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDe la EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (2564)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDe la EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (2499)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe la EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (20001)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDe la EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (3321)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDe la EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (7086)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDe la EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (19653)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)De la EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Evaluare: 4 din 5 stele4/5 (9054)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDe la EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (2506)
- The Iliad: The Fitzgerald TranslationDe la EverandThe Iliad: The Fitzgerald TranslationEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (5341)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)De la EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Evaluare: 4 din 5 stele4/5 (7769)